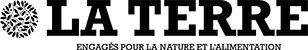Engagés pour la nature et l'alimentation.
Fabrice Savel
Texte intégral (969 mots)
Quel tribunal devra demain juger celles et ceux qui ont participé au coup de force anti-démocratique pour faire passer une loi visant « à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » ?
Les protagonistes de cette machination ont construit à l’Assemblée nationale une majorité allant des macronistes à l’extrême droite pour rejeter leur propre texte, de telle sorte qu’il ne soit pas discuté, et pour le faire adopter « automatiquement » par un quarteron de sept députés et de sept sénateurs réunis en conclave baptisé poliment « commission mixte paritaire ».
Le menu de cette loi est une succession de poisons. Réintroduction de pesticides interdits, autorisation d’épandre par drone ces produits toxiques, allègement des normes pour faciliter l’élevage industriel et construire, au profit des plus gros agriculteurs, des méga bassines qui pompent l’eau des nappes phréatiques.
S’abonner à La Terre
La France qui, à deux reprises en 2020 et 2022, a soumis à la Commission européenne des données nouvelles justifiant l’interdiction du pesticide néonicotinoïde neurotoxique du nom d’acétamipride va donc ré-autoriser son utilisation.
Il convient de mesurer toute la nocivité et l’exceptionnelle gravité de cette décision.
Des travaux menés en Suisse ont montré que l’on retrouvait cette molécule dans le liquide céphalo-rachidien – qui baigne le cerveau et la moelle épinière – de treize enfants sur un échantillon de quatorze, testés en 2022. Des études similaires menées en Chine, aux États-Unis, au Japon ont confirmé ce diagnostic alarmant. Et, on constate désormais une augmentation de pathologies diverses comme la baisse de la fertilité, la hausse de certains cancers et de maladies neurodégénératives.
L’utilisation de ces substances est dangereuse pour la santé des paysans travailleurs et pour celle de leurs champs. L’acétamipride est si toxique qu’il tue les insectes utiles à la biodiversité. Tuer des pollinisateurs sur un champ de noisettes revient à réduire considérablement les rendements des parcelles de colza ou de céréales à proximité.
Par contre, le rendement des grandes firmes de l’agrochimie, lui, progresse à vue d’œil. Celles-ci organisent la dépendance des paysans travailleurs à leurs onéreux produits et empêchent la recherche de voies alternatives qui protègent la santé humaine, celle de la terre et de l’eau.
L’épandage de ces produits aujourd’hui aura des conséquences néfastes pour le sol, l’eau et donc dans nos corps qui se révéleront d’ici vingt ou trente ans.
La responsabilité du petit conclave de parlementaires se permettant aujourd’hui d’autoriser l’utilisation d’un tel poison relève à la fois du déni démocratique, du déni d’intérêt général et de l’écocide. Ils racontent la main sur le cœur qu’ils défendent le paysan, alors qu’ils l’enfoncent dans ses difficultés, pour nourrir les monstres de l’agrochimie et couvrir la pression à la baisse des prix agricoles.
Du reste, la fameuse proposition de loi dite « Duplomb » ne dit mot de la rémunération du travail. Elle est une grave atteinte à l’agriculture paysanne. Celle qui permet les installations de jeunes, celle qui relocalise des productions, celle qui respecte les sols et préserve la biodiversité, les ressources en eau. Celle qui crée les conditions d’une authentique souveraineté alimentaire. Si la cohorte des droites et des extrêmes droites avait le souci de lever les entraves au métier d’agriculteur, elle agirait pour que s’améliore les rémunérations du travail. Elle desserrerait l’étau des emprunts qui enserrent les corps des paysans, spoliés sans cesse par le complexe agro-alimentaire qui pompe la valeur dégagée par le travail.
Chacune et chacun d’entre nous doit avoir à l’esprit, en permanence, que sur le ticket de caisse, le prix de l’aliment est la part la moins importante. Le transport, la logistique, les emballages, les coûts de la transformation, la publicité et les frais financiers pèsent infiniment plus que la matière première agricole. Il convient d’ajouter que les coûts sanitaires pris en charge par la sécurité sociale et les coûts environnementaux, notamment la dépollution de l’eau induite par ces empoisonnements, s’élèvent, selon les calculs, entre 400 millions et 18 milliards d’euros.
Et que dire des souffrances endurées par celles et ceux qui contractent des maladies neurodégénératives ou des cancers liés aux herbicides et aux pesticides. En fait, contre la santé, l’écologie et le travail paysan, ce sont les « contraintes » à l’exploitation capitaliste que lèvent la loi « Duplomb » et ses complices. Pour être assurés de leur forfait, ils placent l’office français de la biodiversité (OFB) sous tutelle. Pour ne plus connaître les effets du mortel danger des pesticides, ils veulent supprimer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Le tribunal de l’humanité jugera sévèrement cette forfaiture !
Image by Gerd Altmann from Pixabay.
Fabrice Savel
Lire plus (171 mots)
La Terre n°19 est disponible chez les marchands de journaux et par commande en ligne.
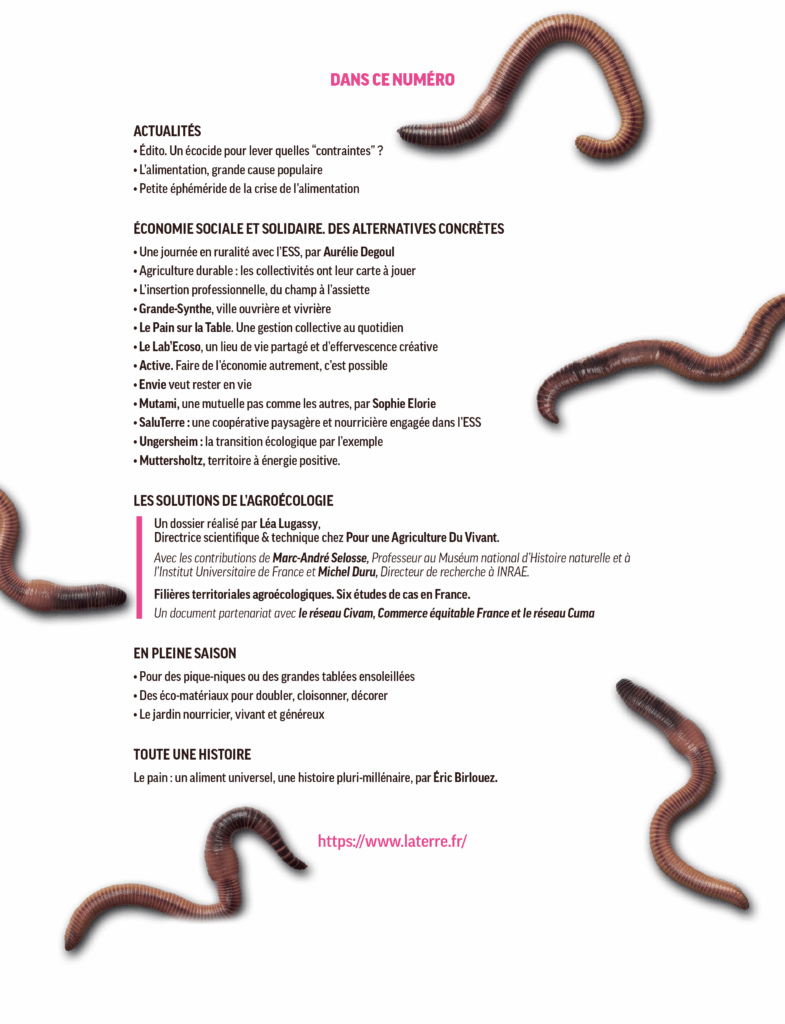
Fabrice Savel
Texte intégral (887 mots)
24 heures pour sauver les terres nourricières de Gonesse – RENDEZ-VOUS sur le Triangle de Gonesse – Du samedi 14 juin 2025 à 17 h au dimanche 15 juin 2025 à 17h.
Dans le cadre des actions des Soulèvements de la Seine, le CPTG vous invite à venir camper, planter, semer… vous informer sur la nouvelle enquête publique organisée par le préfet du Val d’Oise jusqu’au 30 juin 2025 pour la création d’une nouvelle zone d’activités de 122 ha à urbaniser sur le Triangle de Gonesse… et débattre des projets alternatifs possibles !
Les terres de Gonesse sont aujourd’hui au confluent des ravages du BTP (chantiers du Grand Paris) et de ceux de l’agro-industrie (agriculture céréalière intensive destinée à l’export mondial).
Depuis l’abandon du mégacentre commercial EuropaCity en novembre 2019, le préfet a réduit la zone à urbaniser de 300 hectares à 122 hectares. Ce sont 122 hectares de trop à l’heure du dérèglement climatique et du « consommer local », qui exigent de préserver les terres agricoles de proximité.
Le gouvernement et la Région Île-de-France s’entêtent à vouloir bétonner les terres les plus fertiles d’Europe : ils prévoient d’ores et déjà de construire une « Cité scolaire internationale » (collège, lycée, et même un internat) dans le bruit des avions qui décollent jour et nuit. Et comme dans toutes les zones d’activités autour de Roissy, ce sont des hangars de logistique – à cause de la création d’un échangeur routier – qui risquent au final de détruire les champs nourriciers.

Pourtant il est encore possible de sauver les terres du Triangle de Gonesse !
Il est encore possible de choisir
– un projet alternatif, comme celui d’AgriParis Seine de restauration collective 100% bio, locale et de saison pour nourrir les enfants des écoles, les malades dans les hôpitaux et les résidents et personnels des EHPAD.
– un projet nourricier pourra fédérer des agriculteurs déjà présents sur le Triangle de Gonesse, des maraîchers en recherche de foncier agricole pour s’installer, et des collectivités voulant s’engager dans cette démarche d’avenir, avec des maraîchers salariés (en régie).
– un projet nourricier allant vers une plus grande sécurité alimentaire des Francilien·nes et une meilleure qualité de vie des habitant·es.
Sauver les terres agricoles de Gonesse :
- c’est vital pour protéger les sols et l’eau et donc pouvoir manger sain,
- c’est vital pour créer des emplois locaux,
- c’est vital pour diminuer le réchauffement climatique en banlieue et avoir des espaces de respiration.
Le programme
Samedi 14 juin à partir de 17 h : installation du camping, chant, scène ouverte et veillée sous les étoiles. S’inscrire sur le site.
Dimanche 15 juin à partir de 10 h : plantations – puis Restauration sur place pour le pique-nique
A partir de 14 h : Conférence, avec :
- Stéphane DUPRÉ, conseiller municipal délégué à la Démocratie alimentaire de ROMAINVILLE
- Gilles BILLEN, chercheur émérite au CNRS, biogéochimiste, spécialiste des systèmes alimentaires et de l’agroécologie,
- Prises de parole d’élu·es et associations
17 h : Fin du rassemblement
Le programme complet sera actualisé sur le site : https://ouiauxterresdegonesse.fr
Image by Pantea Adrian from Pixabay
Patrick Le Hyaric
Texte intégral (889 mots)
Il est des jours au cours desquels de violents télescopages devraient aider à ouvrir les yeux. En voici trois dans la même journée du 27 mai.
Premier télescopage
On glose à la présidence de la République et à Matignon sur la possibilité d’organiser un référendum. On ne s’en était pas rendu compte, mais ces locataires des ors de la République sont soucieux de la démocratie ! Soucieux de votre opinion ! La preuve !
On vient d’assister à un événement sans précédent à l’Assemblée nationale. Unis, main dans la main, la droite de Retailleau et de Genevard, l’extrême droite au grand complet et des fractions non-négligeables du ventre mou macroniste font voter une motion de rejet contre leur propre proposition de loi antisociale, anti-sanitaire et anti-écologique bien nommée loi Duplomb, pour mieux la faire avaliser par une commission mixte paritaire des deux assemblées. Sans vote, donc. Décidément, leur créativité anti-démocratique n’a pas de limite.
Si nous avions besoin d’une leçon sur la prétendue « démocratie parlementaire » nous voici amplement servis jusqu’à la nausée. Trump en rougit de jalousie.
Sous prétexte de défendre les paysans, cette loi vise à ré-autoriser l’utilisation de pesticides, notamment l’acétamipride dont les études révèlent qu’ils polluent l’eau potable et à de néfastes conséquences sur la santé des enfants. En plus, la loi remet en cause l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et place l’Office français pour la biodiversité (OFB) sous tutelle. Voilà Trump copié, singé, concurrencé jusqu’à la nausée !
Deuxième télescopage
Le même jour, à tour de rôle, le Premier ministre de droite et le président de la Cour des comptes, dont les couleurs socialistes ne cessent de palir, sautaient de plateaux de télévision en studio de radio pour nous expliquer d’une voix tremblotante que la Sécurité sociale coûte cher, que les caisses sont vides.
Or, des études menées sur les coûts sociaux cachés de l’utilisation des pesticides s’élèvent, selon ce qui est pris en compte, de 370 millions d’euros annuels jusqu’à 18,7 milliards d’euros selon la revue Frontiers in Sustainable Food Systems et Nature Sciences Sociétés.
Le seul traitement des cancers du système lymphatique et de la maladie de Parkinson que provoque cette molécule engendre au moins 48,5 millions d’euros. Sans compter les souffrances sans nom pour les personnes qui en sont atteintes.
Troisième télescopage
Ouest-France consacre trois-quarts de page ce 27 mai à la fameuse loi Duplomb et en vis-à-vis, produit un article titré « les oiseaux des champs en fort déclin » à cause… des pesticides. Désormais, 18 000 espèces animales sont menacées d’extinction.
Ce même jour, après avoir montré des images de tracteurs de la FNSEA rentrant à la ferme, le journal du soir de France 2 consacre son sujet de « l’Œil du 20 h » à la pollution des eaux dans un village du département de l’Yonne. Celle-ci est le résultat d’un épandage de pesticides et d’herbicides depuis des dizaines d’années. En effet, nous subissons aujourd’hui les conséquences de ce qui a été épandu dans les champs, il y a un quart de siècle. Autrement dit, les effets du coup de force des droites de l’Assemblée nationale auront des conséquences sur notre santé et celle des générations à venir pour les vingt, trente, cinquante années qui viennent.
Comment qualifier des « irresponsables politiques » opérant un tel coup de force ?
Ne nous trompons pas. Ce ne sont pas les paysannes et paysans, premières victimes de ces poisons qu’ils défendent, mais les multinationales de l’agrochimie qui sont à la manœuvre, bien camouflées derrière les sièges des députés et des tracteurs. Plus ils vendent ces produits nocifs, plus les profits augmentent, plus ils prélèvent la valeur dégagée par le travail paysan. Du reste, le grand oublié de ces derniers jours est bien la rémunération du travail paysan. Ajoutons qu’il n’y aura pas de démocratique planification sanitaire et écologique sans normes de protection, précisément contre les dures lois du capital. Loin de la transition sanitaire et écologique, c’est le capitalisme qu’ils défendent.
Image by goat-privacy from Pixabay
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène