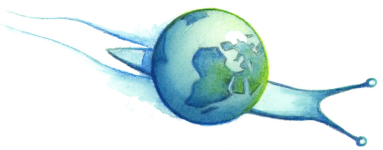la Maison commune de la décroissance
Rédaction
Texte intégral (2656 mots)
Les (f)estives, ce sont 10 demi-journées intenses de réflexion et de discussion. Mais elles ne sont possibles qu’à condition de savoir se limiter et de prendre le temps d’être ensemble : pour faire la cuisine, pour manger, pour s’amuser, pour se rencontrer. L’esprit des (f)estives, c’est de partager des lectures, des connaissances mais aussi des bouts de vie, des rires, des jeux… On ne fait pas table à part, on partage…
Tous les présents ont contribué au succès de ces (f)estives, aucun tire-au-flanc. Ce qui n’empêche pas d’avoir une attention pour Véronique et Phillip, toujours volontaires, toujours disponibles : aucun repas, aucun remerciement sans que l’un des deux ne soit cité. On compte déjà sur eux pour l’année prochaine…
Quand Denis nous croque






Être ensemble















Les goguettes
A bas la propriété !
Sur l’air de « Mourir sur scène » de Dalida
Viens, mais j’te préviens on sera pas seuls
Quand l’Etat un beau jour tombera
Je veux qu’il tombe avec fracas
Viens, je te préviens on sera pas seuls
Nous qui n’avons rien choisi d’nos vies
On veut bien plus que l’usufruit !
Il y a ceux qui veulent vivre tout seuls dans leur lofts
Et d’autres à plein au soleil
Il y a ceux qui veulent mourir seuls noyés dans leurs softs
Rentiers dans leur sommeil
Refrain :
Nous on veut plus d’propriétaires
A bas les spoliateurs
Nous on veut plus d’propriétaires
L’usus ouvert à toutes les heures
Vivre sans la moindre peine
Allez rejoignez-nous !
Nous on veut plus d’propriétaires
Et on ira jusqu’au bout !
Venez, mais on vous prévient on sera plus seuls
Ensemble on fait du commun déjà
Il y a plus d’huissiers et plus d’État
Venez on vous prévient on sera plus seuls
Allons au plus tôt fêter tout ça
Si vous vouler zbeuler nous voilà
L’abusus a brûlé sous notre colère
A Paris, New York et Londres
On a repris les terres finie la misère
Le peuple est sorti de l’ombre !
Refrain
La propriété, canon
Sur l’air de « Frère Jacques »
Usus, Fructus, Usus, Fructus
Abusus, Abusus
Propriété privéé, Propriété privée
Dans ton cul ! Dans ton cul !
Décroissance, Décroissance
Adviendra, Adviendra
Désormais les communs, Désormais les communs
Dans la joie, Dans la joie
Horizontal, Horizontal
Vertical, Vertical
On n’a rien compris,
On a tout compris
Onofrio, Onofrio
L’abusus est mort ce soir
Sur l’air de « Le lion est mort ce soir » par Pow Wow (1992), après Henri Salvador (1962), qui reprenait le succès The Lion Sleeps Tonight des Tokens (1961) qui reprenait une chanson populaire sud-africaine, composée par Solomon Linda en 1939 sous le titre Mbube.
Dans la décroissance, belle décroissance
L’abusus est mort ce soir
Les sans-abri s’endorment au logis
L’abusus est mort ce soir
Refrain :
Wouhhouhouhou…………………..
Fructus usus propriétus
Collectivus verticalus
Wouhouhouhou…………………….
Absolutus dette socialus
Anarchisus libertarius
Dans la décroissance , belle décroissance
L’abusus est mort ce soir
Les grand’forêts retrouvent la paix
L’abusus est mort ce soir (Refrain)
Dans la décroissance, belle décroissance
L’abusus est mort ce soir
Plus rien ne presse vive la paresse
L’abusus est mort ce soir (Refrain)
Rédaction
Texte intégral (9831 mots)
Un grand merci à Loïc pour sa prise de notes qui a été un support indispensable et complet pour ce compte-rendu.
Onofrio avait déjà été l’invité des (f)estives en 2017, et cela avait été la première occasion collective pour la MCD t’entendre parler du « régime de croissance »[1]. Depuis, chacun de notre côté, nous avons approfondi cette critique radicale de la croissance : Onofrio, vers une radicalité de la critique anthropologique ; la MCD, vers une radicalité de la critique politique que nous visualisons avec l’image d’un iceberg – dont l’économie de croissance est la partie émergée, le monde de la croissance la partie immergée, et qui flotte dans un milieu, le régime de croissance – ou en faisant une analogie entre « permapolitique » et permaculture.
Des deux côtés, « radicalité » ne veut pas dire « intransigeance » mais « cohérence » : ce qui signifie à la fois une exigence d’autocritique – en particulier dirigée vers une décroissance mainstream (là, on est au mieux en zone 3 de la permapolitique) et une recherche des causes à partir des symptômes, des effets : car il ne s’agit pas de dénoncer des effets (écologiques, sociaux) si on continue d’en chérir et d’en pratiquer les causes (politiques), en particulier la forme de l’horizontalisme.

Cette deuxième rencontre était donc l’occasion de creuser l’articulation entre critiques anthropologique, sociologique et politique.
- Onofrio Romano se revendique de la pensée de George Bataille. Une présentation de La part maudite (1949) : https://decroissances.ouvaton.org/2017/08/12/jai-relu-la-part-maudite-de-georges-bataille/
- Une présentation du livre d’Onofrio Romano, Towards a Society of Degrowth (Routledge, 2020, la traduction française, Critique du régime de croissance, est parue en 2024 chez Liber) : https://decroissances.ouvaton.org/2024/02/24/jai-lu-towards-a-society-of-degrowth-donofrio-romano/
- Une interview d’Onofrio Romano parue dans le n°3 de la revue Mondes en décroissance : http://revues-msh.uca.fr/revue-opcd/index.php?id=412
1. Présentation du régime de croissance par ses effets (mardi matin)
La croissance est aujourd’hui présentée comme naturelle, allant de soi, mais en réalité c’est une idéologie au sens marxien du terme, i.e. quelque chose qu’on ne discute pas. Parce que les êtres vivants cherchent à croître, la croissance serait bonne et naturelle ; pourtant, pour réfuter cet argument, on peut déjà noter que, dans beaucoup de langues africaines, le mot croissance n’existe pas.
On entend aussi que la croissance est une valeur avec l’idée qu’elle a été imposée par la classe dominante, au terme d’une bataille pour l’hégémonie culturelle au sens d’Antonio Gramsci[2]. Mais la croissance n’est pas seulement une valeur, c’est une obligation historiquement imposée par un cadre institutionnel. Il faut donc penser un changement structurel.
- Pour Norbert Elias[3], à partir des 15e et 16e siècles, l’Occident va changer de régime :
- Les communautés pré-modernes seraient caractérisées par une continuité entre le monde intérieur et le monde extérieur, dans une logique d’osmose : les sujets étaient « lyophilisés » dans la communauté, sans perception de soi.
- Mais le paysage social a évolué avec des liens et des coopérations complexes entre territoires de plus en plus grands, et le sujet a dû changer de perspective : d’où un double mouvement d’intégration des communautés et de différenciation / spécialisation des individus. Ce qui disparaît alors, c’est la possibilité d’être accueilli dans une totalité. Au contraire, pour chaque individu la prise de conscience de soi est vécue comme une séparation avec ma communauté et la machine à laquelle je coopère : s’instaure alors comme « un mur » (Elias) entre le moi et le monde extérieur.
- Pour David Riesman[4], pour expliquer l’apparition de la modernité, la variable démographique est déterminante : il y a passage du sujet tradition-directed (dirigé par la tradition), au sujet inner-directed (dirigé par soi). Dans l’ancien régime, les communautés pouvaient nourrir leurs membres avec des pratiques et un cadre normatif stables, sans besoin d’innover. Dans la modernité, ces pratiques ne suffisent plus : chacun.e doit trouver son pain, pour survivre ou bien fuir la communauté.
Pour Onofrio Romano, ce sont 2 narrations de la modernité qui s’affrontent – une sorte de Far West pour D. Riesman, un monde de discipline, d’organisation, d’industrialisation, de spécialisation pour N. Elias – mais qui amènent à une même question.
a) Pourquoi l’individualisation est-elle si importante pour la croissance ?
C’est là que l’apport de George Bataille est décisif quand il explique que la question des ressources – rareté ou abondance – ne se pose pas de la même manière suivant la perspective envisagée, individuelle ou générale :
« En principe, l’existence particulière risque toujours de manquer de ressources et de succomber. À cela s’oppose l’existence générale par laquelle la mort est un non-sens. A partir du point de vue particulier, les problèmes sont en premier lieu posés par l’insuffisance de ressources. Ils sont en premier lieu posés par leur excès si l’on part du point de vue général »[5].
Selon ce point de vue, c’est le cadre institutionnel moderne qui pousse à l’individualisme et nous met dans une situation d’urgence, de survie, de rareté des ressources : telle est la dimension servile des individus (reproduction et captation des ressources). Or il n’y a pas de rareté naturelle, car c’est une notion créée par la modernité.
Pour décrire cette tension infinie vers la croissance que subit le sujet individualisé, Onofrio Romano a recouru aux travaux de Jean Baudrillard[6] qui, à propos de la société de consommation, y trouve une nouvelle forme de connexion avec le monde extérieur, une nouvelle façon de se rapporter aux choses : sous la forme des besoins. Et du coup, une nouvelle façon de se rapporter à soi, comme individu réduit à ses besoins, à sa valeur d’usage.
« Voilà pourquoi la dimension économique, dans la société moderne, en est arrivée à occuper la prééminence sur les autres. La réalisation et la croissance même de l’individu issu du processus d’individualisation sont substantiellement assimilées à la croissance économique, à la capacité de répondre toujours mieux à plus de besoins. […]
La réalisation de l’être humain se confond ainsi avec la production et avec la consommation de la valeur d’usage, sans limites. C’est là que réside la légitimation sociale de la croissance »
Onofrio Romano, [7].
Si dans la modernité, l’individu est ainsi réduit à ses besoins, alors on voit mal, fait remarquer Onofrio Romano, comment la solution marxiste, qui consiste à supprimer la valeur d’échange pour revenir à la valeur d’usage, pourrait échapper aux pièges du régime de croissance.
Le sujet moderne identifie ainsi la valeur à la valeur d’usage, et il ne conçoit sa liberté que dans « la recherche de la valeur » (Mauro Magatti, Libertà immaginaria, p. 15-16). Cette recherche devient son affaire privée, dans laquelle les institutions modernes doivent s’interdire de regarder, au nom d’une exigence affichée de neutralité.
Tel est l’équation libérale du régime de croissance : le sens de la vie, celui de la finalité, celui des buts, n’est plus qu’une affaire privée et les institutions modernes (qui ne sont plus l’Église mais l’État centralisé et le Marché) ne doivent plus s’occuper que de leur affaire, i.e. la mise à disposition affichée de la maximisation des moyens, l’accès illimité aux ressources, autrement dit ne plus s’occuper que de la croissance économique et laisser chaque individu « libre » de continuellement chercher à satisfaire sans cesse de nouveaux besoins[8].
Les institutions publiques modernes prétendent ne pas être forgées pour créer du bien, de la justice, elles prétendent rester « neutres » pour que chaque individu puisse maximiser sa recherche de valeur. Dans ces conditions, les institutions de la croissance la présentent comme spontanée, naturelle.
b) Quelles sont alors les composantes du régime de neutralité ?
- Un marché autorégulateur, cf. Karl Polanyi[9], neutre par excellence, où chacun.e cherche à satisfaire ses besoins, avec une économie désencastrée des relations sociales.
- Une philosophie d’accessibilité illimitée, invention par René Descartes : le monde autour de nous est niable, mais ce dont on ne peut nier l’existence c’est l’ego. Comme « opérateur de la négation », si l’ego est créateur de tout alors les institutions doivent favoriser l’expression de tous les egos (considérés comme égaux)[10].
- Du point de vue juridique, passage du gouvernement des hommes au gouvernement de la loi : la loi est droit pur et ne parle pas de justice, elle permet juste de « périmétrer » les espaces de la liberté individuelle.
- Du point de vue politique, expansion du concept de citoyenneté, civile, puis aussi politique, puis aussi sociale. On passe ainsi de la liberté négative (= ce que mes conditions de naissance me permettent de faire) à la liberté politique. Cf. Ralf Dahrendorf : donner le maximum possible au plus grand nombre possible.
- Passage du legein (le monde se forme par le logos, la parole, une vision collectivement partagée dans la réflexion et la discussion) au teukein (la capacité de faire, celle de la technique, de la technè). Dans les institutions modernes, on veille à l’extension de la technique comme capacité de chacun.e à faire plus et mieux grâce à des infrastructures « neutres », sans que l’idée de bien commun ou de collectif soit discutée ou ait de l’importance : on passe ainsi d’un ancien régime de dévoilement à un nouveau régime d’accessibilité.
c) Quels sont les effets du régime de croissance ?
- Effets économiques. L’effet du marché autorégulateur selon K. Polanyi, c’est la destruction de la société (du point de vue écologique et économique). La marchandisation des facteurs de production (terre, travail et capital) en font des marchandises comme les autres, alors qu’elles ne sont pas des marchandises parce que pas produites (ni les ressources naturelles, ni le travail, ni la monnaie).
- On va éroder les bases mêmes de la société : par le travail on érode la vie physique et psychique des personnes ; la nature est réduite à ses éléments, les paysages détruits ou souillés, les écosystèmes massacrés, etc. ; et l’autorégulation monétaire devient autodestruction.
- Effets politiques. Processus d’apolitisation décrit par Zygmunt Bauman[11]: difficile d’imaginer un changement révolutionnaire dans ce monde, individuellement on se sent libre mais on a perdu la notion de liberté collective. Les institutions politiques de la modernité se sont auto-empêchées de jouer sur le cadre général, la construction de l’UE est paradigmatique de ce point de vue. Le monde nous apparaît immuable.
- Effets anthropologiques (qui intéressent particulièrement Onofrio Romano) :
- Affadissement / déprivation anthropologique (concept d’Onofrio) : la dimension symbolique a presque disparu, elle était fournie par la communauté, elle instituait une forme de grammaire. Désormais on est seul.e dans la définition de la valeur, la collectivité ne nous fournit plus le parapluie du symbolique qui donnait du sens au monde.
- Hypertrophie de la relation rationnelle (École de Francfort, Adorno, Durkheim) : rationalisation du comportement, ne plus pouvoir exprimer ses émotions sans honte. Dans une société moderne, il faut de l’autorégulation, de la maîtrise de soi, de la rationalisation. C’est N. Elias qui interprète cette rationalisation – en prenant l’exemple des dangers encourus lors de nos mobilités – comme le passage d’une hétéro-surveillance à une auto-surveillance.
- Absence de possibilité de renversement, comme le disent Bataille et Freud. Dans sa dernière conférence, Freud[12] revient sur ses précédents écrits mettant la recherche de plaisir et le rejet de la douleur comme centraux, et introduit l’idée de pulsion de mort chez l’humain : L’homme ne voudrait pas seulement vivre, il voudrait aussi mourir. Dans une société de croissance, cette perspective est un scandale. Quant à Bataille, il écrit : « Il est temps d’abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard pour tenir à être raisonnable et instruit, ce qui a mené à une vie sans attrait. Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout ou de cesser d’être ».
- Selon Onofrio, on est dans une sorte de stagflation anthropologique : il y a beaucoup de possibilités d’acquérir mais rien de fondamental à acquérir.
C’est le paradoxe de la société de croissance, aller d’une valeur à une autre jusqu’à exténuation de la valeur dans un jeu qui ne s’arrête jamais.
Georg Simmel[13] : la valeur existe, séparée de l’objet, elle augmente avec les obstacles à son accession et le moment même de sa jouissance consomme la valeur. C’est pourquoi nous apprécions de nombreux biens comme valeur seulement lorsque nous les avons perdus.
- Un vrai régime d’accessibilité illimitée conduit à une évaporation structurelle des valeurs. Cf. Lacan[14] : on passe du désir à la jouissance, de la névrose (comme empêchement de réaliser ses désirs) à la psychose (= sujet qui ne désire plus rien et qui n’arrive pas à jouir parce qu’il réalise tous ses désirs). Désirer vient de « desiderare » = vouloir accéder aux étoiles, vouloir posséder un bien qu’on n’a pas, qui nous manque. On est dans une société de jouissance parce qu’on veut que nos désirs soient instantanément assouvis.
Précisions après questions/réponses :
- L’Occident est certes en crise mais l’idée occidentale de régime de croissance, le style de vie occidental, sont hégémoniques, même dans les BRICS+[15]
- Bien sûr l’histoire n’est pas continue, il y a des fractures, des allers-retours…
d) La vidéo
2. La gestion du régime de croissance, entre horizontalisme et verticalisme (mardi après-midi)
Onofrio Romano propose une histoire de la modernité comme une alternance entre 2 paradigmes, tant descriptifs (comme visions du monde) que normatifs (comme manière de s’organiser et construire la réalité politique et réglementaire) : l’horizontalisme et le verticalisme.
Toutefois, même s’il étudie une alternance dialectique entre ces 2 paradigmes – et dans un paradigme horizontaliste il peut aussi y avoir (et il y a souvent) de la verticalité, et réciproquement – Onofrio Romano n’oublie pas de préciser explicitement que « la modernité est d’essence horizontaliste ». Attention, il y a bien asymétrie entre les 2 paradigmes et ce serait un contresens historique et politique de voir dans l’un le contre-pouvoir de l’autre.
- Le paradigme horizontaliste repose sur la conviction que pour comprendre la réalité sociale (dimension descriptive) il faut partir de la base, partir des particules singulières à la base de la société. Une bonne société (dimension normative) laisse les membres de cette société faire leur propre jeu avec une liberté individuelle maximale.
- Dans le paradigme verticaliste, les particules élémentaires n’ont pas d’autonomie, et la société à une « âme uniforme qui les informe » (dimension descriptive). Une bonne société (dimension normative) est celle s’organise centralement, que ce soit de façon autoritaire ou démocratique (et on peut même remarquer que le verticalisme peut mieux gérer une société que l’horizontalisme).
a) Histoire d’une double alternance, entre horizontalisme et verticalisme, entre régulation sociale et théorie sociale
Onofrio Romano esquisse une rapide histoire de cette double alternance croisée – longtemps fructueuse – entre régulation sociale et théorie sociale, et entre verticalisme et horizontalisme. Son idée est d’arriver au néo-horizontalisme actuel qui s’est d’autant plus facilement imposé que la décennie 70 se serait arrêtée au « seuil de la souveraineté ».
- 1ère phase (1815, Congrès de Vienne – 1929-1933, Grande Dépression / sortie des Etats-Unis du système monétaire international de l’étalon-or) : celle d’un libéralisme émancipateur (liberté dans la recherche de la valeur).
- Quant à la régulation sociale (cf. Karl Polanyi), 4 institutions organisent la société : équilibre géopolitique des puissances, étalon-or international, marché autorégulateur, État libéral (progressive libération des particules de la société de toute forme de corporations).
- Sur le front des idées, c’est le verticalisme qui domine : la sociologie naît, en tant discipline ontologiquement verticaliste[16]. Ainsi, bien que très différents, Tocqueville comme Marx réfléchissent à partir des mêmes problèmes : ils voient et pensent la critique de l’horizontalisme à cette époque en disant notamment qu’il crée du chaos social (exode rural forcé, conditions de vie épouvantables dans les villes, etc.).
- 2ème phase (1929-1973).
- En réaction aux crises profondes du début du 20ème siècle que l’on peut interpréter comme une crise de l’horizontalisme – causée selon K. Polanyi par la destruction de la société due à la marchandisation de la société de production – la société a généré ses propres formes verticalistes d’autoprotection : lois sociales (vs autorégulation du marché), protectionnisme agraire, banques centrales. Il ne s’agit là que de la poursuite d’une forme de collectivisme (produire par le public) amorcée pendant la 1ère guerre mondiale.
- Du côté de la théorie sociale : « Devant la diffusion de cette logique verticale, solide et bien organisée, les observateurs de la société se mettent à la recherche du désordre. Ils troquent les jumelles de leurs maîtres contre le microscope pour observer les stratégies des acteurs individuels et mettre en évidence leur rôle dynamique dans la transformation de l’ordre. La microsociologie est née. À l’unisson, les spécialistes de la pensée mettent à nu les présupposés épistémologiques du verticalisme analytique : désormais, pour comprendre la société, il faut partir des individus, de leurs stratégies d’action. Non seulement, mais ils entreprennent également de dénoncer les risques inhérents aux prétentions des institutions publiques de contrôler, limiter, guider les acteurs sociaux, en leur opposant des formes neutres de gouvernance. Cette position intellectuelle finit par imprégner l’imaginaire et inspirer les mouvements sociaux. Partout se répand un souffle critique contre toute idée d’identité, d’unité et d’ordre, ainsi que la stigmatisation de toute velléité de régler par le haut le cours du monde. Symbolisée par les événements de 1968, une révolte disciplinaire investit les institutions verticales »[17].
Onofrio évoque alors son article sur le libéralisme[18], dont voici un aperçu :
« Si le libéralisme classique du XIXe siècle (que nous avons appelé le libéralisme émancipateur) a été le premier modèle de traduction de la « liberté dans la recherche de la valeur », si le néolibéralisme régressif a tenté (en vain) de disputer au socialisme naissant l’hégémonie dans la représentation de l’idéal moderne, le néolibéralisme né à la fin des années 1970 et au début des années 1980 peut être défini comme « démodernisé », car il ne se met plus au service de la modernité, mais intervient pour encadrer une forme de réactivation sociale qui n’a plus rien à voir avec la logique moderne. En effet, l’objectif de ce mode de régulation n’est plus de permettre aux sujets d’accéder à la valeur, mais de leur en interdire structurellement l’accès ».
b) La faillite du verticalisme « au seuil de la souveraineté », entre la fin des 30 glorieuses et l’arrivée du néo-libéralisme
Ce qu’il faut expliquer c’est comment le néolibéralisme « démodernisé » a pu si facilement s’imposer alors que dans la décennie 70 nous étions au « seuil de la souveraineté », précisément sous la forme du verticalisme social-démocrate, celui de l’État-providence, qui, finalement, avait réussi à garantir, dans la dimension servile, la satisfaction des besoins de base.

Onofrio rappelle alors l’approche par G. Bataille et M. Mauss de la question de la gestion de l’énergie excédentaire, celle des surplus : concrètement : si les besoins de base sont couverts, pourquoi travailler ? Car la société moderne ne détruit pas cette énergie excédentaire comme le faisaient les sociétés excédentaires (cf. dépenses, potlatch…).
- Une 1ère voie de sortie, celle qui s’est imposée, est le libéralisme démodernisé :
- La précarisation[19] mobilisante en amont : obliger l’individu à « gagner » les moyens de sa subsistance par son travail : la reparticularisation, l’individualisation ont un pur effet disciplinateur (tout en étant présenté comme émancipateur) : Reagan « Starve the beast » (il parlait de l’administration publique mais cela pourrait s’appliquer ici à l’individu) ; Steve Jobs « Stay hungry, stay foolish ».
- La dépense privatisée en aval : la croissance des dépenses ne s’opère plus collectivement mais au seul profit d’une minorité, c’est la croissance drastique des inégalités.
- Pour définir l’autre voie, Onofrio Romano propose de renverser la formule précarisation mobilisante / dépense privée par le binôme protection désactivante / dépense collective (voir séance du mercredi matin).
Précisions après questions/réponses :
- Quand on évoque une limitation, de type seuil ou frontière, ce n’est pas parce qu’on ne peut pas la situer qu’elle n’existe pas : c’est comme si on passait à pied d’un pays à l’autre, à un moment on sait qu’on a franchi la frontière même si on ne sait pas exactement où.
- La frontière entre servilité et souveraineté, est floue, difficile à déterminer précisément, mais elle existe. Parallèle avec la plus-value de Marx : le salaire est censé couvrir le nécessaire qui permet la reproduction de la force de travail. Si les travailleurs donnent plus que ce qui est nécessaire à la reproduction du travail, ils donnent de la plus-value aux capitalistes. C’est au passage du seuil de souveraineté que la question Pourquoi travailler ? devient une question clé.
- Tout verticalisme n’est pas descendant (top-down). Sans se confondre avec l’horizontalisme, on peut avoir un verticalisme ascendant (bottom-up), et construire par la discussion, le collectif, une idée du bien, une vision de ce qui peut se réaliser collectivement.
- Sur la question de la technique : plutôt que la rejeter en bloc, il faudrait la réencastrer dans le social (mais c’est simple à dire, beaucoup plus difficile à faire…).
c) La vidéo
3. Pour sauver nos valeurs du brouillard de l’horizontalisme, quelles verticalités et quelles horizontalités ? (mercredi matin)
Si les 2 premières séances avaient proposé une critique de la croissance en tant que régime horizontaliste, les 2 suivantes vont assumer une position autocritique de la décroissance mainstream accusée de commettre un contresens politique. Parce qu’aveuglée par sa dévotion à l’horizontalisme, elle attribue cette crise aux « valeurs » promues par le néo-libéralisme et non pas à la « forme » du régime de croissance. Du coup, elle s’illusionne « au carré » (en échouant et en renforçant), parce qu’elle croit qu’elle doit mener son combat au nom de « ses » valeurs. Alors qu’en régime horizontaliste de croissance, toutes les valeurs et contre-valeurs s’équivalent !
« La lutte pour une société de la décroissance exige de passer des valeurs à la forme en répudiant le cadre horizontal. C’est l’unique moyen de mettre sur pied un régime souverain qui puisse garantir la permanence des ressources renouvelables et la conservation des ressources non-renouvelables, et libérer ainsi la vie collective de l’obsession de la croissance. Si nous restons piégés dans un régime politique et social horizontal, cela ne sera jamais possible ».
Onofrio Romano [20].
a) La question écologique et le spectre de la catastrophe
Comment ne pas s’apercevoir la légitimation du projet de décroissance baigne souvent dans la catastrophe : Or « le problème de la catastrophe c’est qu’elle ne se produit jamais ». Non seulement parce que la grande catastrophe est difficile à imaginer mais surtout, s’il y a catastrophe, alors la décroissance devient une nécessité, dictée par un diagnostic d’expert.es et avec des solutions d’expert.es. Et dans ce cas, tant du côté du diagnostic que des solutions, le teukein expulse le legein :
- « À l’origine, l’homme moderne se caractérise par le legein. Ce verbe grec décrit l’acte de production du monde (sa signification) à travers le langage »[21].
- Le teukein « renvoie à la notion d’action tout autant qu’aux moyens d’intervenir efficacement dans le monde à la poursuite d’objectifs utiles au bien-être de l’humanité. Il désigne en somme la technique[22].
Cette « expulsion » est anti-démocratique, « impolitique ».

- La compatibilité écologique devient un préalable pré-politique, non négociable. Si une technocratie nous dit qu’elle peut être compatible écologiquement, difficile de résister et pourtant rien ne changerait vraiment dans nos vies (politique de la Chine par exemple).
- Adopter l’imaginaire de la catastrophe, c’est un symptôme de notre « aphasie politique ». C’est un imaginaire déjà très répandu, cf. les films d’Hollywood.
- D’une certaine manière c’est le paradoxe de Z. Bauman : « le monde devient immuable » quand la « petite liberté » – la liberté individuelle, celle du « à chacun sa liberté » – pose son veto sur la « grande liberté », celle de la liberté définie collectivement[23].
- On commence à désirer la catastrophe comme unique voie de sortie, on invite la nature à faire le sale boulot, c’est le symptôme de notre faiblesse politique qui nous fait chercher une alliance avec une force supérieure, la nature.
b) Une question fondamentale : pourquoi survivre ?
Onofrio Romano pointe ici la compatibilité entre le slogan du régime de croissance – la croissance pour la croissance –, et celui de la décroissance mainstream – la vie pour la vie. Dans les 2 cas prime le paradigme de la rareté (et non pas celui de la dépense commune des surplus) ; dans les 2 cas la question du sens de la vie est privatisée (seule l’injonction à maximiser les possibilités est validée politiquement).
Cette décroissance mainstream – qui se reconnaît dans la formule de l’impossibilité d’une croissance infinie dans un monde fini – n’est qu’une « déclinaison euphorique » du régime de croissance et réduit la décroissance à n’être qu’une « technique de reproduction neutre de la vie ».
c) Décroissance et démocratie
Les arguments de la décroissance mainstream peuvent être démontés ou amoindris, car il n’est pas dit que cette décroissance soit démocratique :
- Les arguments de la décroissance mainstream parlant de croissance incompatible avec le bien-être, productrice d’inégalités et de dissolution du lien social, sont faibles selon Onofrio : même les utilitaristes (comme J. Bentham) ne pensaient pas qu’une vie heureuse soit liée au matériel, et la croissance a pu diminuer certaines grosses inégalités.
- On reste dans le modèle du toujours mieux, conformément au paradigme de la modernisation réflexive d’Ulrich Beck, Anthony Giddens et Scott Lash[24] ; on veut continuer la modernisation tout en l’assumant et en se contentant de corriger les conséquences prévisibles ou risquées.
d) Innocuité de la décroissance en posture horizontaliste
Pour Onofrio Romano, la décroissance mainstream adopte une posture horizontaliste qui la rend totalement inoffensive : elle ne serait qu’un modèle d’alternative conformiste :
- Sur le plan critique, elle dénonce les effets néfastes du mode horizontaliste du néolibéralisme (notamment la marchandisation de la nature)… mais elle propose une radicalisation de la forme horizontaliste… parce que sa critique se place sur le plan des valeurs.
- On attribue les dégâts de la régulation horizontale aux valeurs, comme s’il s’agissait uniquement d’une question de lutte culturelle et de décolonisation des imaginaires. Mais le défi est urgent, or une bataille culturelle est nécessairement très longue, et il faudrait une hégémonie culturelle mondiale
- Ou, on adopte la stratégie de la préfiguration : simplicité volontaire, mise en scène de ce que décroissance et post-croissance pourraient être, pour donner l’exemple, cela peut nous consoler, nous donner bonne conscience mais ce n’est pas si séduisant pour la majorité.
En réalité la croissance n’est pas une valeur mais le résultat de la forme institutionnelle horizontaliste. Mauro Magatti parle de capitalisme techno-nihiliste avec 2 caractéristiques centrales : la puissance de la technique, de la capacité de faire (le teukein) et l’indifférence aux valeurs (le rejet du legein). Autrement dit, le régime de croissance s’installe dans une séparation entre fonction (utilité) et signification : dans ce cas, la dimension éthique est inoffensive pour le système qui va continuer de produire parce que la prolifération de significations et valeurs est bonne pour lui. Au mieux, dans ce régime impolitique de croissance, la décroissance risque de devenir l’un des produits sur l’étagère, l’une des alternatives éthiques parmi d’autres.
e) Déplacer la critique du champ des valeurs au champ des formes
Autrement dit, assumer une posture verticaliste. a) Sans croire que cette posture, qui est nécessaire, soit suffisante. b) Sans abandonner la nécessaire lutte pour les valeurs, mais elle aussi, elle est insuffisante. La décroissance doit rentrer dans « la bataille des verticalités ».
Il faut renverser le binôme précarisation mobilisante / dépense privée et le remplacer par le binôme protection désactivante / dépense collective.
- La protection désactivante : tout ce qui revient à la dimension servile doit cesser d’être pris en charge par les individus et confiés à une instance collective.
- Construire un verticalisme pour revenir au nécessaire, définir collectivement les besoins.
- Abolir le marché.
- La production ne doit plus être privée mais complètement gérée par le public. L’économie doit devenir une « matière collective » : décider de ce qu’on produit et qui fait quoi, désactiver les particularismes individuels et les remettre sous le parapluie de la collectivité.
- Puis, ensemble, on gère la…
- Dépense collective
- Que faire de l’énergie en excès, comment dissiper les surplus ? C’est la grande leçon de G. Bataille : si une société ne détruit pas les excédents, alors ce sont ces excédents qui la détruisent ?
- Dilapidation collective dans le théâtre, les cérémonies, les monuments, la fête (mise en scène dramatisée de la destruction). Voir dans le livre d’Onofrio les différentes fonctions de la dépense.
- Restaurer la grande politique : décider ensemble de ce que veut dire une bonne vie.
- Onofrio Romano, in fine, fait remarquer que cette dépense collective ne devrait pas interdire une « créativité illimitée » de chacun, dans la mesure où il reviendrait au même de définir cette « expérience intérieure » comme une osmose retrouvée avec la totalité ou comme une « plongée dans le néant ». Il ne faut pas cacher que cette conclusion a laissé perplexe une grande partie de l’assemblée.
En résumé
- Construire un « verticalisme servile » assumant une garantie purement fonctionnelle ; ce qui peut s’appliquer pour de grandes tailles de population, par l’État (cf. Gramsci), par les « partis » (comme anneaux de connexion entre les citoyens et les institutions centrales », et même par des « experts » (parce qu’en réalité, « on n’a pas grand-chose à inventer », on a beaucoup d’expérience déjà, le tiers secteur a fait un bon travail sur l’identification collective des besoins fondamentaux).
- Construire un verticalisme souverain assumant la part symbolique, la « part maudite » de la vie humaine. Il s’agirait davantage d’un « verticalisme fragmenté », en retrouvant des formes et des lieux (l’agora) où la discussion politique est possible à la bonne échelle (à condition, encore une fois que la part servile soit garantie, par un revenu de citoyenneté par exemple).
f) La vidéo
4. Le sens de la vie comme bataille (mercredi après-midi)
Il s’agissait dans cette dernière séance d’ouvrir des pistes d’inspiration portant sur le sens de la vie, mais sans retomber dans le régime horizontaliste de croissance qui en fait une question seulement individuelle.
- Quels pourraient être les sujets de la révolution décroissantiste ? Attention à la décroissance mainstream qui va se focaliser sur des avant-gardes – celles des expérimentations minoritaires qui prétendent être exemplaires et préfiguratives, grosses d’essaimage au point d’atteindre une masse critique capable d’arriver à une bifurcation – au risque d’un aristocratisme éthique (= valeurs considérées comme justes, non négociables, cultivées sans les connecter à l’esprit du temps) : se creuserait alors un vide entre cette avant-garde et la troupe, l’infanterie.
- Il faut passer de la pensée critique – idée du bien, modèle de justice pour critiquer la société actuelle à la pensée radicale (c’est important mais c’est théorique, sur le papier et cela reste dans les étoiles) – à la pensée radicale (enracinée dans la situation concrète, dans l’esprit du temps).
- Quelques penseurs dans cette veine :
- Peter Berger parle de démodernisation, concept qu’Onofrio reprend à son compte.
- David Riesman a décrit le passage du sujet tradition-directed à self-directed (cf. 1ère séance), puis à other-directed = dirigé par et vers les autres.
- Daniel Bell (un fondateur du post-industrialisme avec Alain Touraine) parle de la société post-industrielle comme le passage de la morale protestante (cf. Max Weber) au bazar psychédélique : le nouveau sujet cherche la spiritualité dans le contact avec les autres.
- Peter Berg (The Homeless Mind) : On est dans le temps des tribus, retour d’une forme de socialisation, retribalisation : il faut diriger notre regard vers les personnes qui nous semblent éloignées.
- Autre inspiration : la Méditerranée comme lieu d’expérimentation pour la décroissance.
- Franco Cassano (décrit par Onofrio comme son maître) développe la pensée méridienne avec une complicité entre terre et mer :
- L’Occident a épousé la démesure (la mer), ce mouvement a été extrême, toute la culture disparait, l’émancipation infinie devient aliénation : le sujet occidental se perd, devient fou, à l’image de Friedrich Nietzsche qui a cherché la libération et est devenu fou (NB : intervention d’Arthur pour dire que cette affirmation est incertaine car les causes de la folie de Nietzsche ne sont pas clairement établies).
- La terre elle est une métaphore de l’enracinement, de la maison, de la famille, de la culture, du parapluie symbolique. Trajectoire de Martin Heidegger qui prend la terre sans limite et devient nazi.
- Voyage d’Ulysse, sujet méditerranéen : s’émanciper par le voyage et revenir chez soi. Ulysse comme sujet émancipé, à la fois dans la rencontre de l’autre et comme retour sur soi.
- Ruse d’Ulysse pour échapper au cyclope Polyphème : “je suis Personne”, comme forme d’oubli de soi, compression de l’ego comme stratégie de sortie.
- Franco Cassano (décrit par Onofrio comme son maître) développe la pensée méridienne avec une complicité entre terre et mer :
La vidéo
*
Conclusion-synthèse de Michel Lepesant (jeudi matin)
Un grand merci à Onofrio pour nous offrir ce concept de « régime de croissance » car il nous permet d’aller beaucoup plus profond dans la critique de la croissance, que ne le fait ce que l’on peut désigner comme la décroissance mainstream.
Au mieux, celle-ci quand elle ne se contente pas d’en rester à la critique des « ressources » (le niveau du PIB, de l’économie qui peut s’appuyer sur les ressources énergétiques et matérielles) peut approfondir sa critique en se tournant vers les « sources » socioculturelles de cette « économie de la croissance », autrement dit vers le « monde de la croissance », celui de nos imaginaires colonisés (S. Latouche).
Pour visualiser cette économie de croissance qui repose sur le monde de la croissance, on peut prendre l’image d’un iceberg et de ces deux parties, émergée et immergée. Mais là où Onofrio va plus loin, plus profond, c’est quand il nous fait comprendre que cet iceberg de la croissance baigne dans un milieu, qui est le régime de croissance.
Ce régime de croissance est un régime politique.
Autrement dit, la décroissance comme trajet est un faisceau de 3 trajectoires : la décrue économique, la décolonisation de nos imaginaires et le renversement d’un régime politique.
Toute décroissance qui ne s’attaque pas à ce milieu peut se prétendre « critique » (c’est de l’objection de croissance) mais pas « radicale ».
Mais les « freins » à cette radicalité sont nombreux :
- Il faut lutter contre l’attrait de l’individualisme, et s’opposer au deal libéral, celui du grand partage entre une neutralité affichée par les institutions (du Marché et l’État) quant à la question de la vie bonne, censée être devenue une question de vie privée et la promesse affichée par ces même institutions de ce consacrer à la croissance pour la croissance, i.e. de garantir la maximisation des ressources fournies à chacun.
- En réalité, il n’y a là que des affichages car dans leurs actes et leurs décisions, ces institutions sont bien loin de pratiquer une redistribution juste et sont encore plus loin de ne pas favoriser des modes de vie (production, consommation, loisirs) conformes à l’emprise que l’économie exerce sur la totalité de la vie sociale et de la vie naturelle.
- C’est là toute la ruse de ce régime de croissance que d’être un régime politique, autrement dit l’exercice d’un pouvoir au service d’une domination, tout en étant en même temps un régime de… dépolitisation qui s’exerce par :
- L’individualisation des responsabilités (parcelliser la démocratie).
- L’infantilisation de toute conflictualité (dénigrer la controverse idéologique et la faire tourner à la polémique personnelle).
- L’injonction permanente à agir plutôt qu’à discuter ensemble du bien public (priorité au teukein sur le legein).
- La naturalisation des dominations qui ne sont pourtant que des constructions sociales (« c’est comme ça, c’est dans la nature (humaine) »).
- Anthropologiquement, ce régime de croissance est un illimitisme ; illimitisme qui est proposé sous la forme de 2 variantes :
- L’illimitisme naïf type Buzz l’éclair (“vers l’infini et au-delà”) qu’on retrouve chez les transhumanistes et les technosolutionnistes (et qu’on ne trouve pas chez les décroissants).
- L’illimitisme déçu (qu’on trouve souvent chez des décroissants mainstream). Dans ce cas, il ne s’agit pas de désirer l’infini mais de regretter que l’accès à l’infini soit impossible. Ce qui peut donner une décroissance à reculons, qui en vient à défendre les limites parce qu’elles seraient « nécessaires » et du coup la décroissance deviendrait « inéluctable ».
C’est contre une telle décroissance plus déçue que radicale qu’à la MCD nous plaidons pour une décroissance volontaire, choisie et non pas subie, pour une décroissance politique.
C’est de ce point de vue que je peux formuler une réticence à l’encontre de ce que nous a proposé Onofrio et elle porte sur la filiation hégélienne de G. Bataille.
Car il y a chez lui une influence marquée d’une lecture très particulière de la fameuse dialectique de la maîtrise et de la servitude. Schématiquement, il lui reste cette illusion qu’il existerait un « bon infini » qui ferait la synthèse des oppositions et qui réaliserait le dépassement (Aufhebung) de toute dualité pour atteindre une totalité concrète.
D’où une interrogation en lisant chez Bataille cette nostalgie qu’une vie réussie serait celle qui arriverait à s’anéantir dans la totalité. Avec cette intuition que la véritable expérience consisterait à « aller au bout du possible de l’homme » (L’expérience intérieure, p.19) ; ou comme a conclu Onofrio, qu’il s’agirait pour la conscience de soi d’atteindre un repos, une « stase » dans laquelle « il ne vaudrait pas la peine de croître ».
D’où une bifurcation possible : soit le calme dans le néant de la vie inorganique comme « bout » (c’est la solution de Bataille reprise par Onofrio), soit une sérénité qui accepte tout au contraire de ne jamais aller au bout, de se contenter de la finitude comme condition du sens (c’est la solution camusienne que je choisirais parce qu’il me semble que la solution de Bataille reste sous l’emprise de l’illimitisme, fût-ce celui du néant).
Mais si humanisme de la décroissance il doit y avoir, n’est-ce pas précisément en acceptant de ne jamais aller au bout :
- Moment nietszchéen : quand Zarathoustra descend de la montage pour annoncer la nouvelle – Dieu est mort – ce qu’il veut dire c’est que : la totalité est morte.
- Moment camusien : il ne s’agit ni de descendre une fois pour toute de la montagne, ni d’accéder définitivement à son sommet. Il s’agit, tel Sisyphe, d’accepter un monde de la finitude, dans lequel le fini ne signifie pas un manque mais la condition même d’une existence sensée.
« Les conquérants savent que l’action est inutile. Il n’y a qu’une action utile, celle qui referait l’homme et la terre. Je ne referai jamais les hommes. Mais il faut faire « comme si ». Car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humiliée, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d’elle. La créature est ma patrie. Voilà pourquoi j’ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte. »
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe
La vidéo
[1] https://ladecroissance.xyz/2017/08/21/cr-des-festives-2107-de-la-decroissance/#EXPOSE_DE_LA_PENSEE_CRITIQUE_DO_ROMANO
[2] Si Marx affirmait que « l’idéologie dominante est l’idéologie de la classe dominante », il n’en attendait pas moins que les contradictions du capitalisme finissent par déterminer son effondrement. Mais face à l’échec historique de cette prédiction, Gramsci l’explique par l’emprise de l’hégémonie culturelle bourgeoise non seulement sur les sociétés mais aussi sur les organisations de travailleurs. Pour lutter contre cette hégémonie, Gramsci préconisait une « guerre de position », i.e. un combat culturel contre les valeurs bourgeoises (la compétition, le mérite…) qui se présentent comme « naturelles ». A condition de gagner cette guerre culturelle, on pouvait alors envisager de passer à une « guerre de mouvement » dont le sujet ne serait plus le « prolétariat » mais « un bloc historique ».
[3] Norbert Elias est l’auteur (1939, 1969) du Processus civilisation, qui est constitué de deux parties, publiées séparément dans la traduction française : La civilisation des mœurs (1974) et La dynamique de l’Occident (1975). Le premier décrit les processus de civilisation de l’individu moderne ; le second décrit le processus de centralisation de l’État moderne. Les deux processus ne sont en réalité que les deux faces – individuelle, institutionnelle – d’un même mouvement de la modernité que va décrire le régime de croissance quand il va expliquer pourquoi sont intrinsèquement liés individualisme et croissance.
[4] David Riesman (1950), La foule solitaire, (trad. fr.Arthaud, 1964).
[5] George Bataille (1949), La part maudite (1971, Points), p.81
[6] Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe (1972), consultable ici ; La société de consommation (1974).
[7] Onofrio Romano (2023), Critique du régime de croissance, Liber, p.63.
[8] « Celui dont les désirs ont atteint leur terme ne peut pas davantage vivre que celui chez qui les sensations et les imaginations sont arrêtées. La félicité est une continuelle marche en avant du désir, d’un objet à un autre, la saisie du premier n’étant encore que la route qui mène au second. La cause en est que l’objet du désir de l’homme n’est pas de jouir une seule fois et pendant un seul instant, mais de rendre à jamais sûre la route de son désir futur », Thomas Hobbes (1651), Léviathan, XI. Il est facile de montrer que ce portrait d’un homme hobbes-édé est celui du consommateur moderne guidé par le désir incessant, la peur de manquer et une rationalité seulement calculatrice (NDLMCD).
[9] Karl Polanyi, La grande transformation (1983), fiche de lecture consultable ici.
[10] Si Descartes est en effet le philosophe à la fois du sujet autofondateur et de la technique qui rend ce sujet « comme maître et possesseur de la nature », il est aussi celui qui dans la 6ème de ses Méditations métaphysiques nous apprend que pour un ego sentant, sentir ce n’est pas d’abord connaître, c’est vivre, et cela, non pas parce que le corps est séparé de l’âme mais tout au contraire à cause de leur union. C’est plutôt chez John Locke qu’il faudrait aller chercher un lien entre une philosophie du sujet comme propriétaire de soi et une politique qui accorde à chacun un égal droit naturel à la dignité et à l’accessibilité des ressources. C’est Locke qui publie une Lettre sur la tolérance (1689) et qui inspirera quelque peu la DDH de 1789 (NDLMCD).
[11] Zygmunt Bauman, In search of politics (1999) ; La vie liquide (2006)
[12] Sigmund Freud, Au-delà du principe du plaisir (1972)
[13] Georg Simmel, La philosophie de l’argent (1900), fiche de lecture consultable ici
[14] Jacques Lacan, Le séminaire, XVI, D’un autre à l’autre (2006), texte ici, comptes-rendus ici et là
[15] Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Éthiopie
[16] Robert Nisbet (1984), La tradition sociologique, PUF.
[17] Onofrio Romano (2023), Critique du régime de croissance, Liber, p.158.
[18] Onofrio Romano, «Dov’è la libertà?», Quaderni di Sociologia [Online], 94 – LXVIII | 2024, en ligne le 01 janvier 2025. URL: http://journals.openedition.org/qds/7008
[19] Sur la précarisation, lire Albena Azmanova, Capitalism on edge (2020); traduction française (par Baptiste Mylondo) : Contre la précarité. L’anticapitalisme au XXIème siècle (2023) ; site de l’autrice
[20] Onofrio Romano (2023), Critique du régime de croissance, Liber, p.166.
[21] Ibid.¸p.75.
[22] Ibid.¸p.76.
[23] Quand toutes les conceptions individuelles de la vie bonne deviennent équivalentes, alors il n’est plus possible de les départager par le legein. C’est alors le teukein, celui de l’action, celui de « ça marche », qui tranche. Autrement dit, il faut voir la proximité dans la décroissance mainstream de deux attitudes : celle de l’injonction permanente à « passer à l’action », « au concret » et celle de l’individualisme. Les débats de la fin des (f)estives et le rejet unanime de l’individualisme, fût-il anarchiste, y reviendront (NDLMCD).
Rédaction
Texte intégral (5150 mots)
Un grand merci à Loïc pour sa prise de notes qui a été un support indispensable et complet pour ce compte-rendu.
1- Pourquoi est-ce un sujet important ?
(a) Le sujet de la propriété est assez peu abordé par le mouvement de la décroissance. Par exemple, dans le sondage de l’Obope[1], il y a une seule question sur la propriété. Et il n’y a pas dans le mouvement de la décroissance de position commune sur ce sujet.
- Question pratique : regarder par exemple qui possède les médias ? Qui possède les grandes entreprises ?
- Question théorique : la décroissance n’est pas qu’un anticapitalisme (c’est aussi un anti-productivisme, une critique de la croissance, de son monde, de son régime, un anarchisme, une critique de tous les rapports de domination dont l’Etat, etc.) mais c’est aussi un anticapitalisme et cela suppose de s’attaquer à la question de la propriété.
- Question sociale : cf. Thomas Piketty[2]. En période de faible croissance (au contraire des « 30 glorieuses » où les inégalités entre revenus du travail et rentabilité du capital augmentaient moins), le taux de rémunération du capital est supérieur au taux de croissance (PIB) : les inégalités (de revenus, donc de patrimoine) augmentent d’autant plus que la propriété privée est inégalement répartie :
- 10% de la population française détient 57,7% du patrimoine immobilier privé[3].
- Environ 50% de la population français détient 10% du patrimoine immobilier privé.
- 3,5% des ménages français détiennent 50% du parc privé locatif (Insee[4]).
Si on met en œuvre la décroissance (qui implique une baisse du PIB, et pas seulement une croissance faible), sans changer le régime de la propriété, ça pourrait être encore pire. Il faut donc impérativement se poser la question de la propriété du capital.
On peut faire un parallèle avec la monnaie et la dette : de la même manière qu’il faut remettre en cause le fonctionnement de la monnaie (avec des propositions intéressantes pour ça comme la monnaie volontaire de Jézabel Couppey-Soubeyran[5] ou la monnaie bornée adossée à la biocapacité), il faut remettre en cause les principes de la propriété[6].
(b) Quelle place accorder à la propriété dans une société post-croissante et à quelle propriété ? Quelles formes de propriété ?
- Qui doit posséder quoi ?
- Comment ? Acquisition, transfert, etc.
- Pourquoi ? Pour faire quoi ? Notion d’usage.
- Combien ? Quelles limites ?
- Quand ? Combien de temps ?
(c) Baptiste Mylondo a commencé par écarter 2 options :
- L’option fiscale : telle que présentée par Th. Piketty, i.e. une taxe sur le patrimoine dont le taux serait la différence entre le taux de rendement du capital et le taux de croissance (pour geler les inégalités) = une sorte de taxe Zucman[7] un peu plus ambitieuse. Mais cette « solution » serait ex post, autrement dit elle ne ferait que (tenter de) réparer une injustice mais sans s’attaquer à la cause, qui est le régime propriétaire de croissance : ce n’est pas suffisamment ambitieux dans une perspective décroissante.
- L’option économique, celle du partage du capital, de la propriété, sous la forme d’une société de petits propriétaires, ce qui ne serait qu’une généralisation de l’idéologie libérale de la propriété et de la marchandisation.

2- Ce qui a été fait…
Pour Baptiste Mylondo, la propriété est une construction juridique. Et c’est de ce côté qu’il faut regarder, en particulier chez Katharina Pistor[8] qui repart de Piketty et se demande pourquoi le capital gagne toujours autant ? Parce que le droit le permet, enconférant aux biens matériels ou immatériels des caractéristiques spécifiques qui vont accorder des privilèges à leurs détenteurs (dont la capacité à générer des revenus passifs presque garantis).
C’est ainsi que le droit est central dans la perpétuation des inégalités parce qu’il permet de transformer des biens en capital en leur conférant certains attributs :
- Longévité, durabilité : Les biens transformés en capital conservent leur valeur dans le temps de manière quasi-illimitée.
- Priorité : Les détenteurs de capital sont prioritaires en cas de problème pour récupérer leur mise (en cas de faillite, il y a des créanciers prioritaires).
- Convertibilité (liquidité) : Il est possible de convertir le capital en monnaie sur simple demande.
- Universalité :
- N’importe quel Etat peut et doit garantir la sécurité des détenteurs du capital et faire valoir leur droit dans n’importe quel pays. Par exemple : la crise des subprimes => transformation de dettes en titres (collateralised debt obligation, CDO), adossés à des Credit Default Swaps (CDS) qui sont des assurances en cas de défaut. Les détenteurs du capital s’en sortent toujours.
- Extension progressive du domaine du capital : Terre, Entreprises, Dette, Idées, Vivant
3- … peut être défait
Mais si ce qui a été fait peut être défait, alors il peut être pertinent d’un point de vue décroissant d’attaquer la propriété sous l’angle juridique, i.e. en tant que droit : Il faut déposséder le capital de ses attributs pour déposséder les capitalistes de leurs privilèges.
Baptiste Mylondo conclut cette introduction du focus en évoquant l’apport des travaux de Pierre Crétois[9]. En particulier, quand ce dernier distingue entre l’idéologie propriétaire (l’idéologie libérale qui définit l’individu par sa propriété), l’ordre propriétaire (économie de la marchandisation généralisée) et le mythe propriétaire (qui en fait un droit naturel).
31- L’idéologie propriétaire
Rappel historique par Michel Lepesant[10] pour évoquer la conception classique du droit de propriété, i.e. la conception libérale telle qu’elle a été élaborée par John Locke au chapitre V de son Second traité du gouvernement civil (1690). Voici son raisonnement :
- Au départ, il y a la propriété commune de la nature, et chaque personne n’est naturellement propriétaire que d’elle-même : de ce que son esprit (mind) contient.
- Mais je ne suis pas qu’un esprit, je suis aussi un corps : dont ma personne est également propriétaire. Et ce corps, je dois le nourrir et satisfaire ses besoins pour le conserver en vie : c’est pourquoi je « travaille » : je glane des glands, je cultive un champ, je m’occupe d’un arbre fruitier. D’où une extension de ma propriété : qui porte cette fois-ci sur les « fruits » de mon « travail ».
- Locke ajoute alors une nouvelle extension : non seulement, par mon travail, je suis devenu propriétaire de ses fruits, mais si je continue à m’en occuper alors je deviens propriétaire de l’arbre, du champ. Et c’est ainsi, par le travail, qui ajoute de la valeur à la nature, que Locke en vient à justifier le droit de propriété sur une chose.
On doit relever 2 limites à cette idéologie propriétaire :
- Locke présente ce droit de propriété comme un droit réel sur la chose mais en réalité il ne peut échapper à la dimension relationnelle de ce droit : car il ne justifie la continuité de ce droit qu’après avoir fait remarquer qu’il n’est pas question de remettre en cause sa reconnaissance à chaque modification (naissance, mort) de la population, en demandant « un consentement exprès et unanime du genre humain » (id., chap. V, §29).
- Locke lui-même introduit une limitation à ce droit de devenir propriétaire de « ce sur quoi » mon travail a porté, c’est la « clause lockéenne » qui spécifie que je ne peux m’approprier une chose que s’il reste suffisamment de biens équivalents (en quantité et en qualité). Autrement dit, cela pose tout de suite la question de l’injustice environnementale, celui l’accès à la terre et de sa propriété.
On voit donc que dans cette idéologie propriétaire, il y a la valeur travail.
C’est la thèse de la découverte : quand les Européens débarquent aux Amériques et revendiquent les terres en tant que découvreurs, ils ne sont pas les premiers, car des populations autochtones y vivent déjà. L’idéologie libérale apporte la solution conceptuelle : nous sommes les propriétaires légitimes parce que nous avons amélioré la terre par notre travail.
N.B. : La propriété a un statut extrêmement fort en France (et dans les autres États de droit) que lui donnent les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
- L’article 2 fait de la propriété est un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l’homme : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
- Et l’article 17 la consacré comme un droit inviolable et sacré, mais… limité : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

32- L’ordre propriétaire
Pour l’idéologie propriétaire, « la propriété est un droit naturel de la personne humaine en tant qu’elle récompense le travail et le mérite et permet de faire ce qu’il veut avec sans subir l’interférence d’autrui ». Quant à l’ordre propriétaire, c’est cette tradition économique qui prétend que cette institution est souhaitable du fait de ses conséquences avantageuses[11].
- La soi-disant « Tragédie des Communs » : c’est un article publié en décembre 1968 dans la revue Science par l’écologiste Garett Hardin. Suivant son raisonnement, la gestion des communs tend vers une surexploitation et un épuisement de la ressource (chacun.e se sert pour ses propres intérêts sans prendre en compte le tout), avec des coûts partagés vs des gains individualisés. Il en conclut que pour éviter cette « tragédie » il faut soit recourir à la propriété publique (pour diminuer l’usage), soit la propriété privée (chacun.e sa parcelle).
- On trouve aussi chez le philosophe Thomas Hobbes une défense du droit de propriété, non parce que ce serait un droit naturel mais parce qu’il résulterait de la distribution souveraine des ressources par le Léviathan, « plutôt que de les laisser en commun »[12].
- L’ordre propriétaire est un ordre marchand : le marché est vu comme le principal mode d’allocation et de circulation des biens. C’est l’argument de Kenneth Arrow sur l’argent : pour lui, le marché serait efficace, efficient, juste et neutre. Puisque le marché serait neutre parce qu’il n’affecterait pas les biens qu’il touche et pas la société, alors sur un marché il faut être égoïste sinon ça n’est pas efficace, et cela permet de payer le moins possible et ainsi d’économiser nos vertus éthiques, l’altruisme, l’amour… C’est contre une telle argumentation qu’on peut lirelire Michael Sandel : « cette manière de réfléchir aux vertus généreuses ne peut que sembler étrange, voire saugrenue, à ceux qui ne baignent pas dans l’économie »[13].
- L’ordre propriétaire est un ordre conservateur. Philippe Askenazy dans Partager les richesses, (2019, Odile Jacob) parle de « verrou propriétariste » dans l’objectif de protéger l’ordre établi. Il y a une promotion active de l’accès à la propriété privée individuelle et lucrative (PPIL) → On crée un désir de PPIL. Dans les faits aujourd’hui en France, il y a 58% de propriétaires d’au moins un logement. Ce qui crée un “bouclier propriétariste” : les petits propriétaires, qui ont quelque chose à perdre, vont protéger les gros propriétaires de toute remise en cause de la propriété.
33- Le mythe propriétaire, triplement faux
C’est le mythe selon lequel la propriété est un droit naturel que l’Etat doit garantir et ce droit est absolu. En sous-texte : je peux faire ce que je veux avec mon bien, parce que je l’ai mérité, et personne ne peut me limiter ce droit. C’est dans cette esprit qu’il existe un « jour de libération fiscale »[14], le jour de l’année à partir duquel le fruit de mon travail est libéré parce qu’il, n’est plus capté par les taxes et les impôts.
- Contre la fable du mérite individuel, il faut rappeler que toute production a toujours une base collective. En contrepoint au mythe du self-made man, il y a toujours des déterminants sociaux : le droit, le cadre social (ex : footballeurs payés des millions vs joueurs de curling presque rien), le marché (lui-même impacté par les conditions de son organisation : SMIC ou pas, syndicats ou pas, etc.) Mais alors, de quoi est-on vraiment responsables ? Pas de ce dont on hérite, ni de nos aptitudes… On est peut-être de nos efforts, à condition qu’ils viennent vraiment de nous… Bref on ne « mérite » pas grand chose.
- Le droit de propriété n’est jamais absolu. Un exemple parmi d’autres pour illustrer : si j’habite dans un bâtiment historique, j’ai des normes très strictes pour l’usage et les modifications que je voudrais apporter.
- Et il n’a rien de naturel puisque la propriété repose sur le droit, des lois, qu’il nous revient de changer.
3. Pour la suite du focus
Baptiste Mylondo a conclu sa présentation en proposant 2 pistes : celle du faisceau de droit et une liste de critères de choix (quand il va s’agir de limiter la propriété).
(a) Le droit de propriété comme faisceau de droits
Pour lui, on pourrait reprendre la notion américaine de « faisceau de droits » (bundle of rights) : ces différents droits seraient, dans la tradition romaine l’usus (droit d’usage et de non-usage), le fructus (droit de tirer les fruits de son travail) et l’abusus droit d’aliéner, détruire, céder, vendre, donner, transmettre).
Note de la MCD
Il ne semble pas très rigoureux de ramener la conception américaine du faisceau de droits à la conception romaine de l’usufruit et de l’abus. Et il n’y a pas là une simple différence de vocabulaire mais une vraie bifurcation idéologique : et la critique unanime formulée le samedi matin à l’encontre d’une conception anarchiste individualiste de la propriété en est l’un des enjeux politiques.
- Revenons à Pierre Crétois : « La conception américaine du droit a, de longue date, admis que le droit de propriété n’est pas un droit homogène mais qu’il est composé de droits divers qui visent à organiser les rapports du propriétaire, des tiers et de l’État aux choses. Cette théorie doit être scrupuleusement (c’est nous qui soulignons) distinguée de la notion de démembrement de propriété dont nous disposons en droit français. L’idée est ici l’inverse du démembrement d’un droit conçu comme plein et entier. Il existe des droits de différentes natures portant sur les choses et la propriété est le résultat de leur combinaison (et de leurs différentes combinaisobns possibles). Cette intuition est particulièrement puissante et tend, si elle est bien comprise (c’est nous qui soulignons), à remettre en cause les fondements mêmes de l’idéologie propriétaire »[15]. Or, « remettre en cause les fondements », c’est l’objectif de ce focus.
- Dans la conception romaine, le droit de propriété est présenté comme un droit qui relie directement le propriétaire à la chose. Alors que dans la conception portée par la notion de « faisceau de droits », « le droit de propriété n’est donc pas présenté comme un droit direct sur les choses mais comme un droit sur (c’est nous qui soulignons) les autres : le droit de leur imposer le respect d’un droit sur les choses »[16]. Dans ce cas, le droit de propriété n’existe que par l’intermédiaire d’une obligation de la part des non-propriétaires. C’est là que l’apport du juriste Wesley Hohfeld[17] est décisif quand il propose une cartographie des relations juridiques fondamentales : droit (claim or right), privilège, pouvoir et immunité qu’il oppose à devoir (duty), non-droit, responsabilité et incapacité (disability). Car ce sont ces « corrélations » et « oppositions » qui ouvrent la voie aux dimensions sociale, politique et relationnelle de la propriété[18].
- Insistons. Dans un paragraphe au titre explicite – Sortir de la robinsonnade[19] – Pierre Crétois oppose explicitement une « conception isolationniste des droits de propriété » (le droit de propriété comme droit réel) à une conception interpersonnelle. Car la conception américaine du faisceau de droit peut se repérer chez des défenseurs français d’un républicanisme solidariste comme le juriste Léon Duguit[20] et l’homme politique Léon Bourgeois. Or, au moment d’élaborer des positions décroissantes sur la propriété, de la même façon qu’il faut faire droit à une vigilance anarchiste (contre les dominations, au nom d’un idéal d’émancipation), pourquoi ne faudrait-il pas faire droit une vigilance républicaine (au nom de la « propriété publique », de la res publica contre la res privata, celle des services publics et des gratuités, quand on ne la confond pas avec la « propriété commune » ou avec la « propriété collective »).
A ne voir dans le droit de propriété qu’un droit réel, non seulement on frise la robinsonnade, mais on focalise la critique sur l’abusus ; mais si le droit de propriété est pensé comme un droit interpersonnel, alors la vigilance portera sur le brin (stick) de l’exclusion : sur son île désertée, on voit bien que Robinson peut bien détruire une chose mais que ça n’a aucun sens d’avoir un droit d’exclusion tant qu’il est seul.
Note de Loïc Marcé
A mon sens, Fabienne Orsi pose bien la problématique dans son article[21] Réhabiliter la propriété comme bundle of rights : des origines à Elinor Ostrom, et au-delà ? dont voici le résumé :
« La définition de la propriété en termes de bundle of rights, ou faisceau de droits, constitue le cœur d’une puissante doctrine juridique américaine dont le développement au cours du XXe siècle a conduit à une véritable révolution dans la conception même de la propriété aux États-Unis.
Bien qu’objet d’âpres controverses, cette conception de la propriété est progressivement devenue une nouvelle « orthodoxie ». Toutefois, l’usage de cette notion a évolué dans un sens bien précis, où le droit d’exclure s’est imposé comme le critère déterminant de la propriété.
Ce faisant, ce sont les fondements mêmes de la notion de propriété, comme faisceau de droits, qui se trouvent annihilés, neutralisant de fait sa portée en tant que définition alternative de la propriété.
Celle-ci mérite d’être réhabilitée. C’est la tâche que s’assigne cet article.
Pour cela, nous revenons sur ses origines en mettant l’accent sur le rôle des fondateurs du réalisme juridique et de l’économie institutionnaliste. Nous mettons ensuite en perspective l’usage des bundle of rights par la théoricienne des communs et « prix Nobel » d’économie, Elinor Ostrom. Notre objectif est ainsi de montrer en quoi la contribution majeure d’Ostrom constitue un renouveau de la conception originelle de la propriété comme faisceau de droits et lui restitue toute son ampleur. »
Cette conception des droits de propriété ouvre le champ des possibles en sortant de la figure unique du propriétaire absolu, cf. Edella Schlager et Elinor Ostrom[22].

(b) Critères de choix
Baptiste Mylondo finit cette introduction au focus sur la propriété par un inventaire des critères qui nous ferait défendre une conception limitée de la propriété :
- Origine : D’où vient cette propriété ? De mon travail, du travail des autres, du vol des autres ?
- Objet : Sur quoi porte-t-elle ? Les moyens de production, de subsistance… ?
- Taille : Petite, grande propriété ? Y a-t-il des curseurs à placer, des limites à inscrire ?
- Usage : Quel usage ? Comment est-il organisé et régulé ?
- Durée : temporaire ou permanente ?
- Exclusivité : individuelle, collective, commune ou publique ?
[1] Les Français et la décroissance, Obope pour Alter Kapitae (2024).
[2] Thomas Piketty (2013), Le Capital au XXIème siècle, Seuil.
[3] https://www.inegalites.fr/Comment-evoluent-les-inegalites-de-patrimoine-en-France
[4] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432517?sommaire=5435421
[5] Pour un aperçu de sa proposition, voir son intervention lors du colloque sur la décroissance à l’assemblée nationale, à l’automne 2024 : https://decroissances.ouvaton.org/2024/10/16/seminaire-an-27-septembre/#Intervention_de_Jezabel_Couppey-Soubeyran_la_voie_de_la_%C2%AB_monnaie-subvention_%C2%BB
[6] Pour une remise en cause décroissante de la propriété, voir la thèse de Timothée Parrique (The political economy of degrowth. Economics and Finance. Université Clermont-Auvergne [2017-2020]; Stockholms universitet, 2019) dans laquelle il propose une déconstruction des piliers du système économique : The key, the clock, and the coin (la propriété, le travail, la monnaie), en référence explicite aux travaux de Karl Polanyi sur la marchandisation des facteurs de production. (NDLR).
[7] https://www.youtube.com/watch?v=fs1FFzPUyJs
[8] Katharina Pistor (2023), Le Code du capital – Comment la loi crée la richesse capitaliste et les inégalités (trad. fr. par Baptiste Mylondo), recension ici.
[9] Pierre Crétois (2020), La part commune. Critique de la propriété privée, recension ici. Pierre Crétois (2023), La copossession du monde. Vers la fin de l’ordre propriétaire.
[10] L’an dernier, le thème du focus des (f)estives était celui du travail et nous avions déjà réfléchi sur ce texte fondateur de John Locke : https://ladecroissance.xyz/2024/09/05/remettre-le-travail-a-sa-place/#21_La_reference_liberale_John_Locke
[11] Pierre Crétois (2023), La copossession du monde, p.16.
[12] Pierre Crétois (2014), Le Renversement de l’individualisme possessif. De Hobbes à l’État social, Garnier, p.43.
[13] Michael J. Sandel (2012, trad. fr. 2014), Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Seuil, p.201-207.
[14] Invention d’organismes affiliés au réseau néolibéral et libertarien Atlas (Contribuables Associés et l’Institut Économique Molinari en France), https://www.wikiberal.org/wiki/Jour_de_lib%C3%A9ration_fiscale
[15] Pierre Crétois (2020), La part commune. Critique de la propriété privée, p.155-156.
[16] Id., p.149.
[17] W.N. Hohfeld, « Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », Yale Law Journal, 23, 1913, pp. 16-59.
[18] Fabien Girard (2021), article « Hohfeld (Wesley Newcombe) » dans Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, p.674-679.
[19] Pierre Crétois (2020), La part commune. Critique de la propriété privée, p.139.
[20] Fabienne Orsi (2021), article « Faisceau de droits » dans Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, p.600.
[21] Fabienne Orsi, Réhabiliter la propriété comme bundle of rights : des origines à Elinor Ostrom, et au-delà ? Revue internationale de droit économique, t. XXVIII(3), 371-385 (2014).
[22] E. Schlager, E. Ostrom, Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis, Land Economics, 68/3, 1992, pp. 249-262.
Rédaction
Texte intégral (1250 mots)
Deux séances de discussion se sont appuyées sur des documentaires. Le jeudi après-midi, on a passé des extraits de la série de G. Mordillat diffusée sur Arte, Le monde et sa propriété. Le vendredi matin, Alix nous a proposé un documentaire beaucoup plus militant sur une expérience de squat à Barcelone, Squat, La ville est à nous, de Christophe Coello.
Le monde et sa propriété (présentation d’Arte)
« Gérard Mordillat et Christophe Clerc interrogent 14 chercheuses et chercheurs de différents pays et cultures sur la notion de propriété. D’où vient-elle ? Comment s’applique-t-elle aujourd’hui aux questions du corps, de l’intelligence, de la nature ?
Du vol, une liberté ou une grammaire ?
La question de la propriété constitue un enjeu social, économique, politique, philosophique, voire théologique. À l’heure de la mondialisation la question apparaît d’autant plus cruciale qu’elle est « diabolique » selon le juriste Mikhaïl Xifaras. Le droit de propriété diffère profondément d’un pays à l’autre. Pour les Français et les Allemands (en droit romano-civiliste) le droit de propriété est codifié, sa définition est précise.
En revanche pour la common law (Grande-Bretagne et ses anciennes colonies dont les États-Unis) le droit de propriété recouvre un pluriel plutôt flou : le « bundle of rights » (un faisceau de droits). Il n’y a donc aucune définition universelle de la propriété mais une floraison de définitions qui se croisent, s’opposent et parfois se combattent. Penser la propriété c’est définir un système politique, social et économique.Aux États-Unis, pays capitaliste par excellence, la constitution ne qualifie pas la propriété d’« inviolable et sacrée » telle qu’elle est dite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen !
Paradoxalement, c’est en Amérique que naissent les travaux les plus percutants remettant en cause la théorie néo-libérale de la propriété. En premier lieu, l’œuvre d’Elinor Ostrom, politologue et économiste américaine (1933-2012), première femme à recevoir le «prix Nobel d’économie », pour son analyse des communs. »
Inviolable et sacrée (1/4)

La notion de propriété, dont l’un des grands théoriciens se nomme John Locke, est rarement questionnée. Pourtant, chaque société en produit sa définition. En France, ayant constitué l’un des piliers de la philosophie des Lumières, elle garde aujourd’hui une dimension sacrée. Toute autre, la conception anglo-saxonne ne la reconnaît pas comme un droit naturel. En Amérique latine, des Constitutions établissent sa fonction sociale, notamment pour les grands propriétaires terriens : la propriété doit ainsi subvenir au bien-être de la société. En Afrique, elle établit souvent un lien entre l’individu et un collectif intertemporel. Mais quelle que soit sa définition, n’implique-t-elle pas toujours de la violence ?
Breveter le vivant (3/4)

Le 20e siècle n’aura de cesse de justifier les copyrights et les brevets dans un processus de marchandisation toujours plus prédateur. L’appropriation du vivant, qui fait la richesse de l’industrie biotechnologique, n’en constitue que la suite logique. Aujourd’hui, les multinationales du numérique amassent des fortunes en s’appropriant nos données, quitte à privatiser les relations sociales. Alors que ces données apparaissent comme le pétrole du futur et que les Gafam s’en emparent – à moins que nous ne les leur cédions -, des formes novatrices de propriété numérique privée apparaissent, à l’image des NFT (non-fungible tokens, « jetons non fongibles »)…
Mon corps est à moi (2/4)

Sommes-nous réellement propriétaires de notre corps ? Si les juristes chrétiens répondent par la négative, estimant que nous devons notre corps à Dieu et donc le respecter, les libertariens le conçoivent comme un capital semblable à tout autre, digne d’être commercialisé. En réalité, dans nos sociétés, sont imposées des limites, d’ailleurs pas toujours très claires : nous pouvons donner un organe mais pas le monnayer, louer notre corps mais pas le vendre. Penser la propriété de soi se révèle assez vite terrifiant. Par ailleurs, dans quel rapport entre celui qui vend sa force de travail ? Si la propriété moderne s’est construite sur le rejet de l’esclavage, quel regard porter sur les abus du travail domestique ou sur le contrat de travail ?
Posséder la terre (4/4)

Tous les peuples n’ont pas le même rapport à la propriété. Pour certains, elle se pense en harmonie avec la nature, pour d’autres, comme une domination. Certains accusent ainsi les traditions bibliques d’être responsables de la crise écologique. Aujourd’hui, la théorie des biens communs nous renvoie à des formes précapitalistes de propriété : des petites formes fonctionnelles de communauté émergent dans le système de propriété existant. Mais est-il possible de les développer à l’échelle d’un pays ? Et comment les intégrer dans les règles de décision collective ? En parallèle, des militants se battent pour reconnaître un droit de propriété à la nature. Mais avec quels résultats ?
Squat, la ville est à nous
À Barcelone, pendant six ans, l’aventure d’un groupe politique engagé dans le quotidien des luttes collectives, au moment d’une crise majeure de nos sociétés contemporaines : Squat.
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène