Accès libreLe média des combats écologiques
Clément Quintard
Texte intégral (2370 mots)
Face à l’oppression, les formes de la résistance prennent mille visages : la désertion qui fissure l’ordre établi, le blocage qui enraye les rouages du capital ou encore l’organisation qui accompagne complots et révoltes tout en leur donnant une direction. De la mutinerie du Potemkine aux dockers de Marseille, des conjurations clandestines aux luttes logistiques contemporaines, ces tactiques ramènent à la question que se pose tout révolutionnaire : comment inverser le rapport de force ?
Déserter
Une affaire de bidoche avariée. C’est par ce déboire trivial que débute, le 14 juin 1905, l’une des plus célèbres mutineries de l’histoire. À bord du cuirassé russe Potemkine, en manœuvre dans la mer Noire, les marins découvrent que la viande au menu est infestée de vers. Le mécontentement gagne l’équipage ; des affrontements éclatent et un comité d’insurgés prend le contrôle du navire, non sans zigouiller quelques officiers au passage. Rendu culte par le film d’Eisenstein, cet épisode inspire à Frédéric Lordon l’idée d’une « dynamique Potemkine » pour décrire l’escalade qui, à partir d’une insatisfaction bénigne, pousse à trahir des puissances jadis redoutées : « L’histoire est pleine de ces petits événements […] qui précipitent sans crier gare une sédition de grande ampleur, effet en apparence sans commune mesure avec sa cause, alors qu’il a été préparé par des cumuls de longue date », écrit le philosophe. On pense au mouvement des Gilets jaunes en France déclenché, en 2018, par l’annonce d’une nouvelle taxe sur les carburants ; ou encore aux manifestations chiliennes de 2019, dont l’étincelle fut la hausse de 30 pesos du ticket de métro.
Sur le papier, l’équation est simple : les petites humiliations font les grandes révoltes, et la somme des résistances individuelles, en se massifiant, devient une force potentiellement destituante. « Soyez résolus à ne plus servir [votre maître], et vous voilà libres, explique en 1576 Étienne de La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. » Mais avant d’inverser le rapport de force, il faut d’abord faire tache d’huile. « Je ne pouvais plus continuer de participer à des projets qui détruisent le vivant et portent atteinte aux droits humains, écrit Xavier, ingénieur démissionnaire de TotalEnergies, sur le réseau social LinkedIn en septembre 2024. En espérant que ma désertion en entraînera d’autres. » Ces dernières années, la mansuétude paternaliste qui a accueilli la multiplication de « bifurcations » de jeunes surdiplômés rappelle que certaines « dynamiques Potemkine » peuvent être endiguées par la mise à jour d’un plan RSE, quand d’autres s’attirent les charges de CRS.
« Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. »
— Étienne de La Boétie
Si tenter d’ouvrir une brèche expose toujours à des représailles, leur intensité dépend moins de l’ampleur de l’acte que de sa capacité à se propager. Le sort des lanceurs d’alerte l’illustre. En 2010, alors qu’elle servait comme analyste dans l’armée américaine, Chelsea Manning organise la fuite de centaines de milliers de documents classifiés révélant les exactions commises en Irak et en Afghanistan. Cette divulgation lui vaut une arrestation immédiate, avec des conditions de détention dénoncées par l’ONU comme inhumaines et, finalement, une condamnation à 35 ans de prison avant que sa peine ne soit commuée en 2017. « Ce retournement des soldats et des policiers s’explique par le dégoût et par la peur – dégoût de la tuerie et peur d’être à leur tour fusillés ou pendus », éclaire l’écrivain et éditeur Éric Hazan, qui fait de la défection des forces de l’ordre l’un des principaux ingrédients d’une insurrection réussie : « Ceux qui vont flancher, ce sont les “flics de base”, mal payés, maltraités par leur hiérarchie, qui sont des exploités comme les autres et même davantage. Signifions- leur que nous le savons, qu’ils font partie du peuple, pour qu’un jour ils refusent d’obéir. » De là à cesser de crier « ACAB » en manif ?
Bloquer
Début juin 2025, les dockers CGT du port de Marseille Fos refusent de charger trois conteneurs remplis d’armes sur un cargo à destination d’Israël. Une fois revendiquée, l’action trouve un écho immédiat dans le port voisin de Gênes, où les travailleurs portuaires annoncent qu’ils bloqueront, eux aussi, tout chargement militaire. « Nous nous opposons à toutes les guerres et refusons de nous rendre complices du génocide à Gaza », expliquent les syndicalistes italiens dans un communiqué. Cette résistance internationaliste des dockers face au militarisme rappelle aussi, en un sens, les origines profondes de la « science logistique ». Antoine Henri de Jomini, membre de l’état-major napoléonien, est le premier à la définir en 1838 comme l’ « art pratique de mouvoir les armées ».
« Au royaume des flux, résister, c’est mettre les navires à quai, bloquer les circulations, envahir les places, couper les ponts, tenir les ronds-points : faire barrage »
— Mathieu Quet
Depuis, la logistique a largement débordé le strict cadre guerrier, et apparaît comme l’un des rouages essentiels de l’emprise capitaliste. La circulation des marchandises, ressources, énergies, déchets et personnes – bref, tout ce qui génère du profit – repose aujourd’hui sur l’exploitation de masses toujours plus importantes de travailleurs précarisés : préparateurs de commandes, chauffeurs-livreurs, coursiers à vélo, manutentionnaires d’entrepôt, raccordeurs de fibre optique, etc. Cet afflux massif de nouveaux prolétaires concentrés dans des clusters et positionnés à la charnière entre production et consommation rend le capitalisme contemporain vulnérable. Leur place stratégique est même comparable à celle des mineurs du XIXᵉ siècle, estime le sociologue Razmig Keucheyan. D’autant que les tâcherons de la logistique détiennent tout un savoir-faire pour obstruer, ralentir et détourner les flux vitaux. Dans un livre passionnant, le sociologue Mathieu Quet raconte les luttes victorieuses, au début du XXᵉ siècle, des coolies et des lascars, cette main-d’œuvre logistique issue des peuples colonisés d’Asie, victime de la violence raciale de l’Angleterre impériale : « Par son besoin irrépressible de faire se mouvoir les hommes et les choses, l’Empire était à la merci des populations mêmes qu’il exploitait tout en les discriminant. Ce qui faisait la grandeur de l’Empire – une toile de transport et de commerce tissée grâce à l’exploitation des populations racisées et méprisées – était en même temps l’un de ses principaux points faibles. » Et le sociologue d’en déduire qu’« au royaume des flux, résister, c’est mettre les navires à quai, bloquer les circulations, envahir les places, couper les ponts, tenir les ronds-points : faire barrage ». En 2023, les grèves reconductibles votées en France par les cheminots, les routiers, les raffineurs ou encore les éboueurs dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ont illustré la centralité de ces travailleurs autant que leur capacité à paralyser des infrastructures indispensables au capital. Mais le blocage des flux serait-il réservé aux seuls salariés des transports et de la logistique ? Pour le Comité invisible, « Si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque. C’est n’importe qui, n’importe qui décide de bloquer – et prend ainsi parti contre la présente organisation du monde. » Sept ans après le mouvement des Gilets jaunes, un autre a commencé à prendre de l’ampleur cet été sur les réseaux sociaux et en dehors des canaux syndicaux. Son mot d’ordre ? « Bloquons tout le 10 septembre. »
S’organiser
En matière de complots, il faut, dit-on, se garder de deux périls. Le premier est d’en voir partout ; le second, d’en voir nulle part. Dans son Utopie publiée en 1516, Thomas More professait leur existence avec une contrition feinte : « Lorsque j’observe les républiques aujourd’hui les plus florissantes, je n’y vois, Dieu me pardonne ! qu’une certaine conspiration des riches […]. Les conjurés cherchent par toutes les ruses et par tous les moyens possibles à atteindre ce double but : premièrement, s’assurer la possession certaine et indéfinie d’une fortune plus ou moins mal acquise ; secondement, abuser de la misère des pauvres. » Le philosophe identifiait même l’instrument de cette machination. Sous couvert de la légalité, explique-t-il, l’État permet d’organiser cette oppression d’une classe sur une autre. Une forme de marxisme avant la lettre ?
« Que l’on conspire contre l’oppression, soit en grand, soit en petit, secrètement ou à découvert, dans cent mille conciliabules ou dans un seul, peu nous importe, pourvu que l’on conspire, et que désormais les remords et les transes accompagnent tous les moments des oppresseurs. »
— Gracchus Babeuf
Presque trois siècles plus tard, le précurseur du communisme Gracchus Babeuf prolongeait cette intuition, et appelait à répondre à la conjuration des puissants par la force de la multitude : « Que l’on conspire contre l’oppression, soit en grand, soit en petit, secrètement ou à découvert, dans cent mille conciliabules ou dans un seul, peu nous importe, pourvu que l’on conspire, et que désormais les remords et les transes accompagnent tous les moments des oppresseurs. » Pourfendeur de la liberté illimitée des propriétaires, le révolutionnaire en vient à s’opposer clandestinement au Directoire, ce régime affrété pour liquider l’esprit égalitaire de la Constitution de 1793 et y substituer une république bourgeoise. La résistance culmine le 10 mai 1796 avec la « Conjuration des Égaux », tentative de coup d’État ratée qui sera fatale à Gracchus Babeuf et ses camarades. Un échec que Marx et Engels verront tout de même comme « la première apparition d’un parti communiste réellement agissant ». Hantés par les déconfitures stratégiques et leurs issues le plus souvent sanglantes, les socialistes tenteront de déceler la formule secrète qui transfigure la simple jacquerie en révolution. Avec une question brûlante : quelle est l’organisation adéquate pour donner la poussée décisive et faire basculer le régime ? Au milieu du XIXᵉ siècle, Auguste Blanqui appelait par exemple à mener un ensemble d’opérations insurrectionnelles par de petits groupes d’élite dirigés de manière centralisée, ligne tactique qui le fit tremper dans maints complots et coups de force. Logique à laquelle les marxistes opposeront plus tard un véritable « art de l’insurrection », fondé sur une classe d’avant-garde et sur l’élan révolutionnaire du peuple. « La conspiration est ordinairement opposée à l’insurrection comme l’entreprise concertée d’une minorité devant le mouvement élémentaire de la majorité, écrit en ce sens Léon Trotsky. En effet : une insurrection victorieuse, qui ne peut être que l’œuvre d’une classe destinée à prendre la tête de la nation […], est profondément distincte d’un coup d’État de conspirateurs agissant derrière le dos des masses ». Aujourd’hui, la clandestinité semble menacer toujours plus de militant·es. Entre les restrictions répétées du droit de manifester, les réquisitions contre les grévistes, l’usage extensif de l’arsenal antiterroriste et du maintien de l’ordre, les dissolutions administratives d’associations comme, tout dernièrement, du collectif antifasciste La Jeune Garde, les signaux d’un glissement autoritaire rappellent que, si s’organiser (ou pas) « dans le dos des masses » donne matière à débats, s’organiser dans le dos de l’État devient une nécessité.
L’article Déserter, bloquer, s’organiser : les armes de la résistance est apparu en premier sur Fracas.
Philippe Vion-Dury
Texte intégral (988 mots)
Militants et militantes écolos avaient-ils besoin d’être davantage caricaturés, raillés, décrédibilisés ? Pas vraiment. Le paysage médiatique et la classe politique s’en chargeaient déjà très bien tout seuls jusqu’ici, dans un exercice collectif de greenbashing chorégraphié à la perfection, où le cynisme le dispute à la mauvaise foi. Mais dorénavant, leur vie va être encore plus facile grâce à l’intelligence artificielle – elle tient décidément toutes ses promesses.
C’est l’autoroute de toutes les misères, l’A69, qui nous donne un aperçu de ce qui nous attend. Depuis une semaine, des vidéos générées par IA de quelques secondes circulent sur YouTube et TikTok, mettant en scène des opposants à l’A69 imaginaires au micro d’un journaliste fictif. Ils n’ont rien à dire, sont bêtes, bobos, urbains, déconnectés, voire menteurs et cyniques. L’une refuse l’autoroute mais habite à Paris, l’autre traite ses opposants de fachos pour éviter la contradiction, une dernière est anti-autoroute, mais aussi anti-train, anti tout. Pour couronner le tout, des tee-shirts arborant les slogans «RSA Love» et «APL Love».
Derrière ce compte, Antony Frandsen, manager de magasin de e-cigarettes, résident de Castres, fondateur d’un groupe pro-A69, et relai de la parole de la propagande autoroutière sur CNews. Sur son compte TikTok, deux de ces vidéos «parodiques» ont été vues plus de 60 et 90 000 fois, suscitant un déferlement de commentaires moqueurs ou haineux, où sont noyés ceux qui indiquent que la vidéo est générée par IA.
Vague de contenus haineux
Relativement anodin à ce stade, ce type de vidéos croît à la vitesse de l’éclair depuis la sortie en grande pompe de VEO-3 par Google, qui ouvre la voie à la «démocratisation» de la génération de vidéos par IA… et au deepfake de masse. Ces contrefaçons numériques, connues du grand public depuis le faux discours d’Obama en 2017, sont devenues virales en l’espace de quelques semaines. L’une des premières utilisations spontanées qui en a été faite a été la génération de faux micros-trottoirs dont le seul défaut était d’être «trop beaux pour être vrai» – on attend la prochaine mise à jour…
L’outil a surtout été immédiatement utilisé pour générer des contenus racistes et réactionnaires, jusqu’à inonder TikTok. Au point que de nombreux experts anticipent déjà que l’outil pourrait devenir déterminant pour attiser des émeutes et conflits partout dans le monde.
Google se contente pour l’instant de minimiser les risques et de mettre en place des garde-fous à base de watermark indiquant que le contenu est généré par IA – non seulement très discrets mais facilement masquables.
La bataille perdue de l’IA générative
Pour les militants écolos, comme pour le reste de la gauche, le danger est imminent.
- La dimension la plus évidente du problème est que l’IA générative permet de générer le réel qui manquait jusqu’ici et de donner corps aux fantasmes réactionnaires en vogue. Wokes décérébrés, écoterroristes énervés, musulmans radicalisés… S’ils n’existent pas, on peut maintenant les inventer.
- La diffusion de ces vidéos ne peut qu’intensifier un peu plus la polarisation déjà intense sur les réseaux sociaux, justement parce qu’elle vient incarner de manière maximale des positions idéologiques, sans mélange, «chimiquement pures».
- La massification des deepfakes va terminer d’éroder la confiance dans les contenus en ligne : que croire, qui croire, à quoi m’intéresser dans cette avalanche d’informations choquantes ? Le chercheur Henk van Ess a confié au Time avoir tenté l’expérience de monter un «fausse histoire» de toute pièce avec Veo-3… et n’avoir eu besoin que de 28 minutes. «On parle de pouvoir potentiellement fabriquer des douzaines de scandales chaque jour.»
Sans trop préjuger de la suite et de potentielles régulations, il semble désormais trop tard pour éviter de prendre cette vague de plein fouet. Phénomène peut-être inédit dans l’histoire du numérique, on voit mal comme la gauche en ligne pourrait se «réapproprier» cette technologie, à moins de se faire à son tour l’apologue du mensonge généralisé. On peut comprendre les appels de certains militants de la gauche en ligne, à l’instar du Tréma, à vouloir mener la «bataille culturelle de l’IA» et ne pas la laisser à l’extrême droite. Malheureusement, sur ce terrain, on ne pourra jamais ferrailler à armes égales.
L’article Les luttes écologiques vont-elles survivre aux deepfakes ? est apparu en premier sur Fracas.
Fracas Media
Texte intégral (2009 mots)
Décembre 1930. Un brouillard d’une rare épaisseur se répand dans la vallée de la Meuse (Belgique) et fait plusieurs dizaines de victimes sur son passage. Plusieurs enquêtes sont menées par les autorités : toutes accusent la météo plutôt que les nombreuses usines présentes sur ce territoire industriel. Dans Brouillards toxiques (réédité aux éditions Amsterdam cette année), essai percutant mis en scène comme une « contre-enquête », le chercheur en histoire environnementale Alexis Zimmer interroge les effets délétères de l’industrie sur les territoires, mais aussi la fabrique de l’impunité industrielle adossée aux paroles scientifiques et expertes… Au XXᵉ siècle, comme aujourd’hui.
Un entretien réalisé par Emma Poesy issu du quatrième numéro de Fracas. Illustration : Chester Holmes.
Que s’est-il vraiment passé en décembre 1930, dans la vallée de la Meuse ?
De fait, un brouillard s’est répandu et ne s’est pas dissipé cinq jours durant. Il était si épais qu’il a entravé la circulation et rendu toute activité en extérieur difficile. Au bout de quelques jours, plusieurs habitant·es disent souffrir de difficultés respiratoires, avant qu’environ 70 d’entre elleux ne perdent la vie subitement. Les éleveurs de la région constatent que leurs animaux tombent malades, certains meurent dans les étables. Quant à ce qu’il s’est « vraiment » passé, à la compréhension de ce qui a pu entraîner cette catastrophe, cela va précisément être l’enjeu de disputes et de contestations.
Vous montrez que les enquêtes locales et nationales accusent plus volontiers la météo que les usines, qui répandent pourtant des substances chimiques dans l’atmosphère. Comment l’expliquer ?
Le rôle de la météo est indéniable dans cet épisode de pollution exceptionnelle. Cependant, l’incapacité des autorités à considérer le caractère problématique des émanations toxiques ordinaires des industries pose problème. Pour l’expliquer, il faut considérer la manière dont les enquêtes demeurent arrimées au cadre temporel, restreint, de la catastrophe et considèrent les pollutions ordinaires comme relevant d’un certain ordre des choses. Et pour comprendre cela, c’est plus d’un siècle d’histoire de l’industrialisation des territoires, du rôle croissant de l’expertise scientifique et technique, qu’il faut envisager, pour saisir l’incapacité structurelle des sciences à problématiser la production historique de territoires toxiques et, au contraire, à en normaliser l’existence.
Le grand public adhère-t-il à cette version de l’histoire ?
S’il ne fait aucun doute que les habitant·es de la vallée contestent les premières conclusions, innocentant complètement le rôle de l’industrie ; les deux enquêtes suivantes sont accueillies de façon plus ambivalente. Ce qui demeure contesté par certaines voix auxquelles donnent accès les archives, c’est la non-considération du caractère ordinairement toxique et destructeur du fonctionnement habituel des usines de la vallée.
D’ailleurs, les habitant·es ne sont pas entendu·es par les autorités, quand iels disent être régulièrement intoxiqué·es…
En effet, lors des enquêtes, leurs paroles sont systématiquement disqualifiées. Il revient aux experts et aux chimistes de déterminer ce qui est toxique et ce qui ne l’est pas. Lorsque les habitant·es évoquent les rejets constants d’émanations auxquelles iels ont affaire, les experts prennent soin de distinguer ce qui relève d’une gêne passagère et ce qui nuit à la santé. Cette distinction fut déterminante pour rendre acceptable, ou du moins, plus difficilement contestable l’industrialisation des territoires.
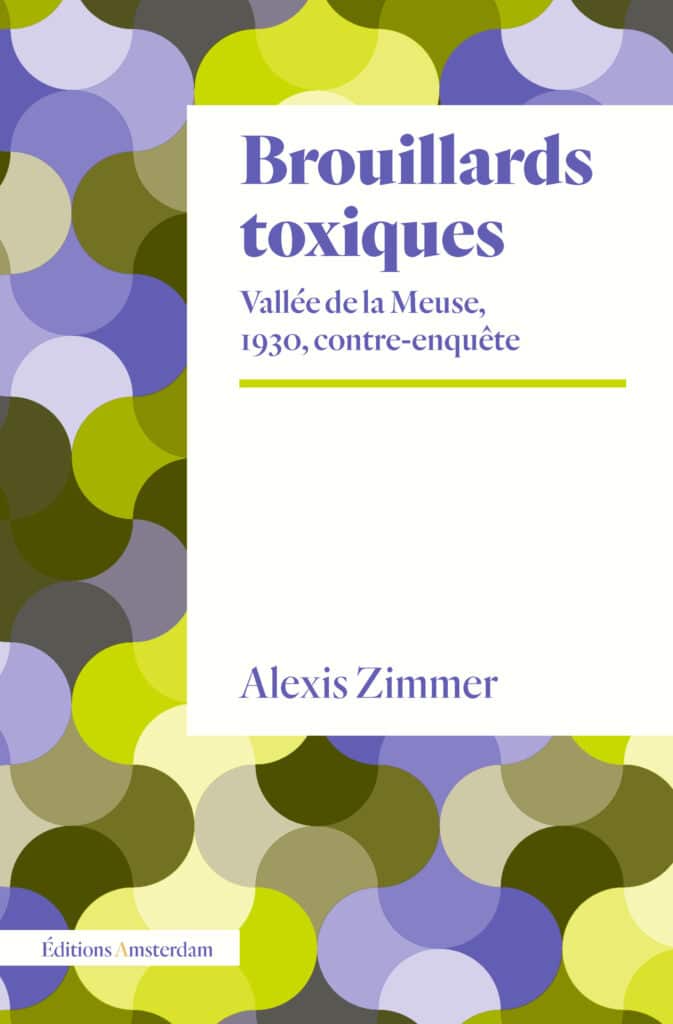
Que dit cette histoire de la place qu’a prise l’industrie en Europe au cours du XXᵉ siècle ?
Cela montre qu’il est devenu difficile de remettre en question la présence des industries, malgré leurs conséquences sanitaires et environnementales. Et pour en arriver là, il a fallu inventer toute une série de dispositifs techniques, savants, économiques, etc., qui ont progressivement rendu le développement de l’industrie prétendument inéluctable. Le fait que les scientifiques soient devenus incapables d’interroger le rôle de la toxicité des usines dans cette catastrophe en est l’indice. Cette situation contraste très fort avec celle qui caractérisait les débuts de l’industrialisation. À ce moment-là, les plaintes émises par habitant·es d’un quartier pouvaient conduire à la fermeture d’une usine ou d’un atelier. Avec la montée en puissance de l’industrie au cours du XIXᵉ siècle, encouragée par les États, les réglementations visent à protéger les industriels de ces contestations, et les capitaux toujours plus importants qu’ils investissent.
Certains scientifiques prêtent même des vertus aux fumées…
Dans la vallée de la Meuse, c’est le cas du médecin hygiéniste Hyacinthe Kuborn, qui considère que les vapeurs de l’industrie seraient susceptibles de protéger les habitant·es des épidémies de choléra. Pour beaucoup d’hygiénistes depuis le début du XIXᵉ siècle, les vapeurs chimiques auraient le pouvoir d’assainir les airs respirés. Les prétendues vertus assainissantes de la chimie furent un motif puissant dans les discours visant à légitimer l’industrie. Plus généralement, c’est une foi grandissante, entretenue par les industriels et les milieux scientifiques, dans les bienfaits supposés de la chimie, des techniques et des sciences, qui permet aussi d’expliquer ce type de discours.
En quelques décennies, les connaissances scientifiques sur les conséquences de l’industrie ont énormément progressé. Comment expliquer qu’elles n’aient pas donné lieu à davantage de régulation ?
Nous en savons plus, mais nous ne savons pas forcément mieux. Aujourd’hui, par exemple, la toxicologie permet d’analyser les effets d’une substance spécifique sur les organismes. Sauf que nous ne sommes jamais soumis à une seule substance – qui plus est selon les conditions de laboratoire dans lesquelles sont élaborés ces savoirs. C’est pour cette raison que ces sciences-là me paraissent ambivalentes : elles prétendent être précises, mais elles nous détournent des problèmes concrets. Les outils de la régulation des substances chimiques sont porteurs de la même ambiguïté : une valeur seuil, par exemple, ce n’est jamais rien d’autre qu’une autorisation à polluer jusqu’à un certain niveau (lire ci-contre). Ces normes censées nous protéger permettent surtout d’éviter de remettre en question le monde plus large, fait d’industries, d’économie, de sciences, etc., qui génèrent ces situations d’intoxication généralisée.
Dans votre livre, cette volonté de ne pas réguler les industriels se fait contre les habitants : non seulement on ne leur demande pas leur avis, mais, en plus on leur explique que, sans usines, ils seraient au chômage. Est-ce un problème démocratique ?
Je crois qu’il s’agit moins de ne pas réguler les industries que de les réguler de manière à permettre leur développement en les rendant acceptables. Quant au problème démocratique, oui, c’est évident, et pour deux raisons au moins. Tout d’abord, la confiscation scientifique et technique des discours jugés légitimes conduit le plus grand nombre à ne pas se sentir habilité à prendre part à ces questions. Dans nos démocraties représentatives, les questions liées à l’industrialisation des territoires sont essentiellement tranchées par des technocrates et des experts, les publics n’étant au mieux que « consultés ». Ensuite, nos sociétés n’ont pas développé une véritable et consistante culture scientifique et technique, laquelle est indispensable pour se doter des capacités de comprendre les enjeux d’emblée socio-environnementaux de toutes ces questions.
Presque cent ans plus tard, a-t-on tiré les conséquences de ces événements ?
Absolument pas. Ni d’ailleurs de toutes les catastrophes industrielles qui ont ponctué les XIXᵉ et XXᵉ siècles et dont, pour la plupart, nous ne nous souvenons pas. Je dirais même qu’aujourd’hui la situation s’est largement dégradée. L’industrie n’a jamais autant pollué et consommé de charbon. Et pour cela, les industriels et les États ont, en un siècle, développé ou renforcé toute une panoplie de stratégies qui leur permettent de minorer et de rendre invisibles les dommages qu’ils causent sur la santé des personnes et l’environnement.
Comment s’y prennent-ils, pour invisibiliser les dommages ?
Il existe plusieurs stratégies pour cela, bien documentées par l’histoire, la sociologie ou l’anthropologie des sciences. La délocalisation des usines, l’invention de dispositifs techniques rendant inodores et incolores les émanations de certaines industries, l’électrification de certains processus industriels ou des modes de transports (reléguant en d’autres contrées les dégâts générés par l’électricité et la production des moteurs électriques), l’enfouissement de déchets, etc. Tout ceci tend à rendre plus difficilement perceptibles les pollutions générées par les processus industriels et les modes de vie qui leur sont associés. Enfin, le fait de nous laisser croire qu’aucun salut n’est possible en dehors de l’industrie et que, d’une certaine manière, il faut bien s’accommoder des pollutions inévitables qu’elle engendre.
Croit-on encore, aujourd’hui, que point de salut n’est possible en dehors de l’industrie ?
C’est une question difficile. Nous sommes pris entre, d’une part, une catastrophe climatique et environnementale globale qui indique bien que nos modes de vie industriels sont catastrophiques et, de l’autre, une incapacité collective, largement entretenue par celleux qui nous gouvernent, à imaginer des modes de vie qui se passerait d’une industrie polluante et extractiviste. Les mirages d’une industrie verte et vertueuse étant là pour nous faire oublier qu’il ne peut y avoir d’économie marchande capitaliste sans dévastation environnementale. Alors oui, je crois que nous avons beaucoup de difficultés à imaginer un monde sans cela. Mais difficulté ne veut pas dire impossibilité. Et de nombreux collectifs, activistes et militants, de nombreux travaux académiques ou autres fournissent une matière généreuse pour apprendre à penser, agir, imaginer d’autres mondes possibles. Rien d’évident à cela, mais il nous revient collectivement d’y œuvrer, autant dans le quotidien de nos activités (il ne s’agit pas d’attendre le « Grand Soir ») que dans des moments de lutte plus spécifiques.
L’article Alexis Zimmer : «L’industrie n’a jamais autant pollué» est apparu en premier sur Fracas.
Philippe Vion-Dury
Texte intégral (1218 mots)
Ça y est, le pot aux roses a été découvert : l’objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, fixé lors de l’accord de Paris sur le climat en 2015, «n’est désormais plus atteignable». C’est le constat dressé par un groupe de scientifiques français de renom, dont plusieurs anciens rédacteurs du Giec. La nouvelle ne surprend guère: le non-respect des engagements incantatoires issus de l’accord de Paris par les États signataires ne pouvait mener qu’à un tel fiasco. Tout au plus est-on surpris de la précocité de la débâcle, car il était jusqu’alors d’usage d’affirmer qu’on avait «jusqu’à 2029» avant de bazarder l’objectif, selon d’autres études publiées il y a seulement deux ans.
Pourquoi un tel échec ?
 D’un point de vue épistémologique: il faut rappeler que ces «cibles», comme on désigne l’objectif de +1,5°C, sont des fictions, des seuils construits par des modélisateurs sur la base de travaux scientifiques, qui comprennent de grandes inconnues (comme de possibles effets de bascules climatiques). Sauf que la perception des changements climatiques ne suit pas cette représentation : le seuil des +1,5°C a déjà été dépassé momentanément en 2024, sans que la plupart des gens en aient conscience. En bref, ces seuils, fondés scientifiquement mais en partie symboliques, provoquent une disjonction entre connaissance et perception de la situation.
D’un point de vue épistémologique: il faut rappeler que ces «cibles», comme on désigne l’objectif de +1,5°C, sont des fictions, des seuils construits par des modélisateurs sur la base de travaux scientifiques, qui comprennent de grandes inconnues (comme de possibles effets de bascules climatiques). Sauf que la perception des changements climatiques ne suit pas cette représentation : le seuil des +1,5°C a déjà été dépassé momentanément en 2024, sans que la plupart des gens en aient conscience. En bref, ces seuils, fondés scientifiquement mais en partie symboliques, provoquent une disjonction entre connaissance et perception de la situation.
 Du point de vue des États: un objectif chasse l’autre, et à peine l’objectif des +1,5°C enterré, qu’un autre sera appelé à prendre sa suite. Rappelons ici qu’initialement, le +1,5°C n’est qu’un engagement «bonus»: le seuil à ne surtout pas dépasser est celui de +2°C… Mais pour accoutumer le public à une probable déconfiture, des élus français nous préparent déjà à des scénarios à +3°C et même +4°C.
Du point de vue des États: un objectif chasse l’autre, et à peine l’objectif des +1,5°C enterré, qu’un autre sera appelé à prendre sa suite. Rappelons ici qu’initialement, le +1,5°C n’est qu’un engagement «bonus»: le seuil à ne surtout pas dépasser est celui de +2°C… Mais pour accoutumer le public à une probable déconfiture, des élus français nous préparent déjà à des scénarios à +3°C et même +4°C.
 Du point de vue du marché et de l’industrie: ces objectifs ont permis de concentrer les efforts collectifs sur un objectif lointain de décarbonation, de capter des aides publiques et des avantages fiscaux, de se présenter comme des «partenaires» de la transition et non plus des responsables de la catastrophe.
Du point de vue du marché et de l’industrie: ces objectifs ont permis de concentrer les efforts collectifs sur un objectif lointain de décarbonation, de capter des aides publiques et des avantages fiscaux, de se présenter comme des «partenaires» de la transition et non plus des responsables de la catastrophe.
 Du point de vue de la population: derrière l’apparente simplicité des objectifs, la grande technicité de l’approche scientifique du réchauffement climatique n’a, de fait, pas facilité la sensibilisation des populations, écrasées sous des injonctions abstraites. La focalisation de ces cibles sur le carbone (empreinte carbone, budget carbone, marché carbone…) a même pu nourrir un rejet ou un sentiment d’impuissance. À l’échelle individuelle, «on n’en fait jamais assez».
Du point de vue de la population: derrière l’apparente simplicité des objectifs, la grande technicité de l’approche scientifique du réchauffement climatique n’a, de fait, pas facilité la sensibilisation des populations, écrasées sous des injonctions abstraites. La focalisation de ces cibles sur le carbone (empreinte carbone, budget carbone, marché carbone…) a même pu nourrir un rejet ou un sentiment d’impuissance. À l’échelle individuelle, «on n’en fait jamais assez».
 Du point de vue militant: les stratégies fondées sur une mise sous pression des gouvernements pour les contraindre au respect des engagements qu’ils ont pris, et la sensibilisation, parfois par des coups d’éclats, sur le mode du «compte à rebours», n’ont malheureusement donné à ce jour aucun fruit, voire ont pu entraîner découragement et démobilisation.
Du point de vue militant: les stratégies fondées sur une mise sous pression des gouvernements pour les contraindre au respect des engagements qu’ils ont pris, et la sensibilisation, parfois par des coups d’éclats, sur le mode du «compte à rebours», n’ont malheureusement donné à ce jour aucun fruit, voire ont pu entraîner découragement et démobilisation.
Et la rhétorique des cibles n’a pas fini d’accoucher de tous ses monstres. Le respect «à tout prix» des objectifs, sans sortie coordonnée du capitalisme, ouvre la voie à l’introduction de techniques de géo-ingénierie, dont le forçage radiatif. En réalité, les scénarios du Giec qui modélisent une «transition» réussie sont tous fondés sur l’intégration plus ou moins massive d’«émissions négatives» (lire notre article dans le numéro 4 de Fracas !) qui viennent compenser les efforts insuffisants de réduction des émissions de CO2. La cible de +2°C est dépassée ? Voilà qu’on nous propose des solutions technologiques pour mettre fin à cet «overshoot» et repasser sous la barre…
Malgré ces multiples constats d’échecs, il y a fort à parier que ces objectifs continuent d’errer dans l’espace public et politique, tels les zombies d’un ordre mondial déjà enterré. On comprend pourquoi : tout l’édifice de la coopération internationale, en matière climatique, s’effondrerait si on les abandonnait – ce que personne ne peut souhaiter.
Ce qui est hautement contestable n’est pas tant l’existence de ces indicateurs mais leur prédominance dans le débat, leur centralité dans un certain type d’engagement écologique, plus médiatisé parce que plus «respectable». Continuer de s’y accrocher coûte que coûte, alors même que la coopération internationale est démantelée par le camp occidental lui-même, Trump en tête, et que les politiques publiques écologiques et les institutions qui les mettent en œuvre sont méthodiquement pilonnées en France et ailleurs, semble relever de l’aveuglement collectif.
Le scientifique malheureusement médiatique François Gemenne, dans un exercice d’«introspection» radiophonique, regrettait qu’on ait voulu lier écologie et lutte des classes. Les conclusions qu’on devrait en tirer sont tout à fait contraire : dépasser la seule question climatique, politiser l’enjeu écologique, se mobiliser partout, tout le temps, dans une complémentarité de stratégies, une composition de tactiques, sans perdre de vue la perspective de forger de nouvelles alliances sociales. Pour preuve : depuis 2018 et la prise de conscience progressive de l’enfumage de l’accord de Paris, les seuls mouvements qui sont parvenus à faire bouger les lignes sont plus insurrectionnels qu’institutionnels. Pour elles – comme pour nous – la lutte des classes n’est pas un gros mot.
L’article +1,5°C, c’est foutu… et tout le monde s’en fout ? est apparu en premier sur Fracas.
Fracas Media
Texte intégral (2807 mots)
Le corridor migratoire Inde-pays du Golfe accélère la diffusion des styles de vie énergivores dont les seconds, exportateurs de pétrole, ont fait un modèle. Dans l’État indien du Kerala, où des millions de personnes vivent des salaires envoyés au pays par ceux partis travailler à l’étranger, l’influence du Golfe a fait des climatiseurs « une marque de prestige social ».
Texte et photos : Sebastian Castelier. Ce reportage est issu du deuxième numéro de Fracas.
Vu du ciel, de jour comme de nuit, le détroit d’Ormuz est le théâtre d’un ballet incessant. Les pétroliers et méthaniers s’y succèdent, à la file, pour acheminer vers les marchés de consommations internationaux les hydrocarbures extraits des entrailles du Moyen-Orient. Chaque année, plus de 7,5 milliards de barils de pétrole brut et de liquides pétroliers transitent via ce couloir maritime stratégique, situé à la sortie du golfe Persique. La vaste majorité de ces navires se dirigent vers l’Asie, où les pays du Golfe s’efforcent de stimuler la demande pour leurs combustibles fossiles et dérivés, tels que le plastique et les engrais.
En Inde, déjà troisième plus gros consommateur de pétrole au monde et où les pays du Golfe ont exporté pour 69 milliards de dollars de pétrole et de gaz sur l’exercice fiscal 2021- 22, la demande devrait atteindre 6,7 millions de barils de pétrole par jour en 2030, un quart de plus qu’en 2023. Et le pays le plus peuplé au monde depuis qu’il a dépassé la Chine en 2023 martèle son droit au progrès économique. En amont du 28ᵉ sommet sur le Climat de l’ONU en 2023, deux officiels indiens le résumaient ainsi : les pays enrichis au détriment de l’environnement depuis la révolution industrielle doivent devenir émetteurs nets négatifs de dioxyde de carbone (CO2) pour « permettre aux pays en développement d’utiliser les ressources naturelles disponibles pour leur croissance ».
Un milliard de climatiseurs
Une posture qui soulève la question du type de croissance que la population indienne perçoit comme son modèle de référence. Après avoir passé la bague au doigt de celle choisie par sa famille dans le cadre d’un mariage arrangé, Umar Mukhthar Odungatt, qui travaille à Riyad, partage son projet de vie : « Ma future maison sera climatisée et équipée de tout le confort requis. Je m’y suis habitué en Arabie saoudite et je veux en profiter ici aussi, lorsque je serai de passage au village. La climatisation est bien meilleure que les ventilateurs, qui ne suffisent pas pour se sentir au frais, et en Arabie saoudite tout le monde y a accès, les riches comme les pauvres. Et je veux aussi m’acheter une Ford Mustang. »
Comme lui, les 9 millions d’Indiens qui travaillent dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) goûtent à un modèle de société où la consommation d’énergie par habitant est l’une des plus élevées au monde, avant de le répliquer au pays. « Le mois dernier, nous avons vendu 100 climatiseurs en 5 jours suite à une promotion », se réjouit Asif Moolayil, un vendeur d’électronique au Kerala, état tropical pionnier de la migration vers le Golfe dès les années 1970. « Nous avons ouvert ce magasin ici parce que beaucoup gens y sont des travailleurs immigrés dans le Golfe et leurs familles dépensent beaucoup d’argent pour acquérir le ‘kit prestige’ typique du salarié du Golfe : climatiseurs, lave-vaisselle, lave-linge, voitures, téléphones et autres. Ils se sont adaptés au mode de vie du Golfe et ils ne peuvent plus revenir à leur vie d’avant », assure le vendeur.

« Les climatiseurs sont devenus une marque de prestige social. Les épouses des travailleurs du Golfe se vantent d’avoir de grandes maisons climatisées et moquent la nôtre qui ne l’est pas, disant que nous avons l’air pauvres. Ce type de jugement me met mal à l’aise, même si je refuse de climatiser. Au sein de la jeune génération, tout le monde veut acheter un climatiseur, regrette Khadeeja Manithodika, dont le fils travaille en Arabie saoudite, avant d’ajouter : la plupart du temps, c’est la fierté qui parle, pour pouvoir se vanter. C’est devenu une question de dignité. »
Ravi Raman, chargé des questions migratoires et énergétiques au Kerala State Planning Board, un conseil consultatif qui assiste le gouvernement, confirme le phénomène. « Il est tellement démodé de dire que l’on n’a pas de climatiseurs à la maison de nos jours ! », résume-t-il, pointant lui aussi du doigt le rôle clé joué par l’influence culturelle des pays du Golfe sur les travailleurs indiens expatriés.
Depuis 1990, la consommation d’électricité par habitant au Kerala a été multipliée par 3,7. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le nombre de climatiseurs en Inde pourrait être multiplié par 38 d’ici 2050, soit 1,1 milliard d’appareils susceptibles d’engloutir 44 % d’une production d’électricité essentiellement carbonée en Inde – le charbon et le gaz en assurent les trois quarts. « Tout le monde a besoin d’un climatiseur aujourd’hui, dans quelques années tout le monde en aura un ici, affirme Asif Moolayil. L’impact des climatiseurs sur le changement climatique, personne n’en parle ici, c’est un non sujet », ajoute le vendeur d’électronique. Ismail Koradan, marchand de parfums à Dubaï, ajoute : « Nos maisons traditionnelles en briques gardaient les pièces fraîches, mais elles sont démodées, alors nous avons opté pour la maison en béton, qui est chic. Mais elle retient la chaleur, et cela nous force à acheter des climatiseurs. Aujourd’hui, je dirais que nous copions environ 80 % du style de vie du Golfe. »
Copier-coller le loisir carboné
Le souci du paraître ne se limite pas au logement. « Je remplace mes chemises tous les trois mois pour montrer à ma communauté mon niveau de vie. Une manière de m’acheter un certain prestige social », confie Ashiq Kinattingarath, employé dans la province saoudienne de Tabuk, où le Royaume prévoit d’ériger des projets pharaoniques, tel que la première station de ski en plein air du Golfe. « Je suis devenu “un homme de Dubaï”, alors je dois renouveler ma garde-robe régulièrement. Avant, je dépensais vraiment très peu pour les vêtements, j’avais un style très “villageois”. Mais une fois sur place, je me suis dit qu’il fallait que je m’habille comme les gens de là-bas », témoigne Jubair Muhammad Haneefa. Établi dans la ville au gratte-ciel le plus haut sur terre où il travaille dans le secteur assurantiel, il alloue environ 20 % de son revenu à l’habillement. Selon une étude, chaque 1 000 euros additionnels dépensé par un ménage indien accroît de 0,8 tonne son empreinte carbone annuelle, estimée à 6,5 tonnes. En France, ce chiffre s’élève à 4,6 tonnes, par personne. Mais cet écart se réduit sur fond d’ascension de la classe moyenne indienne. Au Kerala, les familles de ceux qui travaillent à l’étranger dépensent un tiers de plus que la moyenne, y compris dans les loisirs, où le Golfe est là encore le point de référence.
« Nous avons un parc à neige au Qatar, alors quand ma femme et moi avons appris que le concept était arrivé au Kerala, nous avons décidé de venir nous amuser. Nous voulons en profiter ! », indique Said Valiyamadayi, un Keralite de 32 ans employé par l’industrie gazière qatarie depuis cinq ans et en visite dans sa ville natale pour les vacances. « Je suis certain qu’il y aura plus de parcs à neige au Kerala dans le futur, les gens viendront y chercher de la fraîcheur lorsque le climat dehors sera trop chaud. C’est un nouveau concept, inspiré des pays du Golfe. Nous voulons le même style de vie qu’eux, parce que c’est confortable », s’enthousiasme-t-il. Sa femme Shifana Valiyamadayi ajoute : « C’est aussi l’occasion de comprendre à quoi ressemble le changement climatique ! Et à première vue, le changement climatique ne pose pas de problème, à l’exception du fait que mon petit garçon ne semble pas trop aimer le froid. »

Sur le toit de ce centre commercial, la neige artificielle cède le pas au vrombissement des karts. « Ce type de loisir est nouveau ici. Nous copions-collons le type de divertissement que nous voyons dans le Golfe. Dans quelques années, je crois que l’offre de divertissement sera la même ici qu’à Dubaï, car nous importons leurs idées », affirme avec joie Muhannas Kunnikkandi, 23 ans, avant de s’élancer. Lui vit à Dubaï avec son père et sa sœur depuis trois ans. À cela, s’ajoute une appétence pour des voitures et des maisons toujours plus grosses, ainsi qu’une consommation accrue de viande. La diaspora établie en Occident acquiert souvent la citoyenneté et s’installe ainsi dans son pays d’accueil, ce qui limite son influence sur les modes de vie en Inde. A contrario, l’octroi de la citoyenneté est rarissime dans le Golfe, forçant les travailleurs à rester liés à leur terre natale, en vue de leur retour au pays après leur « Golfe life ».
« Un jour, le Bihar sera comme le Kerala »
Après avoir conquis le Kerala, les modes de vie carbonés des pays du Golfe se diffusent le long des routes migratoires intra-indiennes. Répliquant le modus operandi de sa région d’adoption, qui délègue toute tâche manuelle à la main-d’œuvre étrangère, le Kerala emploie environ 3,5 millions de travailleurs originaires d’États indiens plus pauvres dans les secteurs que sa population juge comme ingrats.
« La plupart de ces États ont en fait 30 à 40 ans de retard sur le Kerala en termes de développement humain. Parcourir l’Inde, c’est comme voyager dans une machine à remonter le temps. Les différences entre les États sont très, très marquées », analyse Benoy Peter, fondateur de l’ONG keralite Centre pour la migration et le développement inclusif (CMID). Ce contraste fait du Kerala « l’un des États les plus attractifs » pour la migration intra-indienne, selon Benoy Peter. Le salaire moyen dans la construction de 9,5 euros par jour y est le plus élevé d’Inde rurale, et près de 2,5 fois supérieur aux émoluments en vigueur dans l’État du Bihar, où la pauvreté frappe une personne sur trois.
Mais, une fois au Kerala, le processus d’accoutumance aux attributs de la vie carbonée débute. « Par rapport à d’autres États de l’Inde, le Kerala est mieux, en avance. L’une des raisons qui m’a poussé à émigrer ici, c’est de pouvoir profiter moi aussi de ce style de vie. Le Kerala a de super maisons et le niveau de vie y est plus élevé. C’est comme un mini-Golfe ; nous rêvons tous de construire au Bihar ce que nous voyons ici », confie Mohammad Tausif, un imam bihari qui vit au Kerala depuis dix ans.

À Deodha, un village au centre du Bihar, Vineet Kumar Thakur esquisse un sourire gêné face à la maison familiale dont les murs sont faits de paille. Lui est pompiste dans une station essence au Kerala et n’est de passage que pour de courtes vacances dans le logis où vivent ses parents, l’une de ses sœurs et sa grand-mère. Il en profite pour afficher son ambition pour la famille. « Notre prochain projet est de démolir cette maison pour en bâtir une nouvelle, plus grande et mieux équipée », ébauche le jeune homme de 22 ans. « Un jour, le Bihar sera comme le Kerala », espère Mohammad Reyaj, un coiffeur bihari qui travaille dans la ville keralite de Beypore depuis 2014.
Il confie avoir l’intention de quitter le Kerala pour se rendre dans les pays du Golfe où il espère toucher un revenu deux à trois fois supérieur. « Nous sommes nombreux à venir au Kerala pour acquérir de l’expérience pendant quelques années, puis nous partons vers le Golfe », indique-t-il. Le Kerala comme première étape d’une initiation au mode de vie carboné. Dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde, Irshad Malik reçoit dans la maison familiale, à 2000 kilomètres du Kerala où son fils travaille comme artisan du bois. « Le Kerala a une vraie influence ici. Lorsque mon fils me rend visite, nous parlons souvent du mode de vie là-bas. Et nous rêvons des choses matérielles qu’ils ont là-bas », indique ce père de famille. Une douce musique aux oreilles des pays du Golfe, qui misent sur la croissance de la demande indienne en énergies fossiles pour y accroître leurs exportations d’hydrocarbures.
L’article En Inde, la clim est devenue «une marque de prestige social» est apparu en premier sur Fracas.
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène
