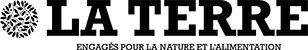Engagés pour la nature et l'alimentation.
Patrick Le Hyaric
Texte intégral (1934 mots)
Nous n’en avons pas fini avec les puissantes répliques sismiques provoquées par la loi « Duplomb », improprement baptisée « loi pour lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ».
Ce texte soutenu par les macronistes en perdition, les droites et l’extrême droite shootées au trumpisme a été imposé grâce à l’utilisation, par les soutiens de cette loi, d’artifices législatifs empêchant tout débat à l’Assemblée nationale, dans le but de réunir une commission mixte paritaire où ces mêmes forces politiques vivent dans un entre-soi donnant raison à Robespierre sur « la perfide tranquillité du despotisme représentatif * ».
Le souci du détail nous conduit à préciser que sur les quatorze membres de cette commission, trois ont été d’éminents responsables de la FNSEA.
Soulignons également d’emblée que cette loi ne « lève aucune contrainte au métier d’agriculteur ». Les contraintes du métier sont faites de lever aux aurores et de coucher bien après le soleil, d’inexistence de week-end et de jours fériés, d’absence de loisirs, de travail et encore de travail pour gagner toujours moins et répondre aux sommations de la banque qui ne perd jamais un sou des remboursements de crédits dopés d’intérêts, sans considération des incertitudes liées à la météo, à la fatigue, aux maladies humaines, animales ou végétales, alors que les prix des denrées agricoles à la ferme sont compressés.
La fameuse loi « Duplomb » ne dit mot de tout cela. Elle est en effet un projet programmatique de la concentration agraire, de l’accélération de l’industrialisation de la production agricole et alimentaire pour une insertion toujours plus grande de la production agricole dans le capitalisme mondialisé qui ne garantit plus la qualité sanitaire des aliments, les éliminations des plus petites fermes , l’assèchement des eaux des nappes phréatiques.
Une sérieuse et importante documentation montre désormais que ce type de développement agricole piloté par les firmes transnationales de l’agrochimie détruit la santé humaine en même temps que celle des sols, des eaux des rivières comme de la mer, et des végétaux.
Les médecins et les scientifiques ne cessent d’alerter sur l’augmentation des cancers, et le développement des maladies de Parkinson ou d’Alzheimer résultant de l’utilisation d’engrais phosphatés ou de pesticides.
Or, les articles de cette loi constituent un concentré de mépris pour les centaines de milliers de personnes et leurs familles atteintes d’affections de longue durée en lien avec l’environnement agricole où elles vivent et où elles ont grandi. Parmi elles, les paysans-travailleurs figurent en bonne place. Ceux-ci sont méprisés par les pouvoirs successifs, par les sociétés agro-chimiques qui amassent des brassées de milliards en vendant du poison et en combattant toute solution alternative. Méprisés aussi par les parlementaires qui ont voté cette loi contre le « principe » constitutionnel « de précaution ».
Mais l’une des nouveautés de ces dernières années est la conscience grandissante des possibilités de se nourrir correctement offertes par un autre système agro écologique à l’encontre de la fuite en avant ultra-capitaliste qui fait mal aux corps et à la nature. Leur insécurité et leurs angoisses franchissent encore une marche supplémentaire quand le projet de budget de super-austérité dans lequel est froidement prévu la réduction des remboursements de soins, notamment pour celles et ceux qui sont atteints de pathologies de longue durée.
Émerge la conviction, de plus en plus largement partagée, que le pouvoir en place gouverne contre le peuple, contre l’intérêt général et pour la seule minorité des possédants. Ils viennent d’en avoir des preuves manifeste: le rapport de la commission d’enquête du Sénat, à l’initiative de Fabien Gay, voté par les parlementaires de toutes opinions membres de ladite commission, établit que les aides publiques aux entreprises – sans contrôle ni contrepartie – représentent 211 milliards d’euros au moment même où le gouvernement dit chercher 40 milliards pour combler les déficits.
Le magazine économique Challenges, de tendance libérale, a montré que l’avoir total des 500 plus grandes fortunes françaises est passé de 454 milliards d’euros en 2016 à 1 228 milliards d’euros en 2024. C’est 100 milliards d’euros de plus chaque année pour chacune de ces 500 familles, soit l’équivalent de deux fois le budget de l’Éducation nationale.
Enfin, la protestation populaire contre la majorité du bloc bourgeois qui a voté la loi « Duplomb » s’exprime clairement avec une pétition signée – au moment où j’écris ces lignes – par plus de deux millions de citoyennes et de citoyens. Ses partisans ont beau sortir l’artillerie lourde avec ministres, sous-ministres, chaînes d’infos continues réactionnaires, Coordination rurale et Fnsea, rien n’y fait.
Et pour cause ! La double rupture démocratique que révèle une nouvelle fois cette loi travaille en profondeur la société.
Elle a d’abord été rédigée pour faciliter la construction de méga-bassines, soutenir les fermes industrialisées, autoriser l’utilisation de l’acétamipride. Mais elle a été votée contre l’avis de vingt-deux sociétés savantes médicales, contre la Ligue contre le cancer, contre les administrateurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, contre la Fondation pour la recherche médicale, contre la Fédération des mutuelles de France -représentant des millions d’assurés- , contre le Conseil scientifique du CNRS et des centaines de médecins et de chercheurs qui ont multiplié les tribunes d’alerte et de protestation, des dizaines de chefs cuisiniers et de spécialistes en gastronomie.
Il n’y a pas que dans le bureau ovale de Trump qu’on méprise les avis des scientifiques ! Ce déni de démocratie explose à la face de celles et ceux qui n’évoquent ce mot que pour leur gargarisme matinal.
Ensuite, le choc est frontal entre une majorité parlementaire composite qui n’est pas représentative de la société et des forces citoyennes qui se lèvent est manifeste. Les partis qui ont voté la loi « Duplomb » sont ceux qui n’ont pas obtenu de majorité en 2024.
Le président de la République – qui n’a recueilli qu’un faible des inscrits sur les listes électorales – ne doit son élection qu’à un vote barrage contre l’extrême droite et il est minoritaire au Parlement.
La droite de plus en plus extrémiste qui pavane au gouvernement n’a recueilli qu’à peine 6 % des votants. Le Premier ministre est à Matignon que grâce à des petits arrangements politiciens. Ajoutons que toutes ces bonnes âmes considèrent les abstentionnistes comme des citoyens n’ayant aucun avis. Or, c’est parce qu’ils en ont qu’ils considèrent cette prétendue « démocratie parlementaire ou présidentielle » comme une imposture contre le pouvoir démocratique des travailleuses, des travailleurs, des citoyennes et des citoyens.
Les expériences récentes les confortent dans ce comportement qui, en apparence, organise le silence des urnes pour mieux hurler l’aspiration à prendre son destin en main, à prendre le pouvoir sur les activités, le travail et la production.
Du référendum sur la Constitution européenne en 2005, aux mouvements contre la casse du droit du travail, à celui contre la contre-réforme des retraites – adoptée par un coup de force – ou encore le mépris des conclusions de la conférence citoyenne pour le climat en 2019… Les preuves de cette fausse démocratie ne manquent malheureusement pas.
Le mouvement contre la loi « Duplomb » et celui qui s’amorce contre le plan d’austérité Bayrou à l’initiative de l’intersyndicale montre que le mouvement social et citoyen existe bel et bien. Il est porteur d’espoir. Cela montre aussi que la thèse selon laquelle notre pays basculerait irrémédiablement à droite est contrebattue.
Le paysage médiatique et la représentation politique bêlante ne rendent pas compte de la réalité d’un pays pétri de justice sociale et environnementale, prêt à combattre les discriminations, aspirant à mêler combat anthropologique et combat écologique, brûlant du désir d’égalité et de volonté de vivre ensemble dans un monde de paix. Le champ médiatique et gouvernemental cache les opinions progressistes dans leur diversité. Mais cela ne les empêche pas d’exister, de penser et se penser, de se mobiliser, de se faire entendre, de se rassembler.
Voici mise à nu la violente collision démocratique en cours. Une aspiration démocratique populaire qui se heurte à un système institutionnel au service d’une démocratie parlementaire, faussement représentative manœuvrée par des élus qui décident majoritairement pour les intérêts du grand capital, quitte à briser la santé, à étouffer l’environnement, à raccourcir les vies jusqu’à rendre le monde invivable.
C’est parce que ce moment de rupture démocratique va à son paroxysme que les forces ayant constitué le Nouveau Front populaire doivent se retrouver, se reparler et bâtir ensemble un projet commun d’alternative progressiste. La démarche unitaire de l’intersyndicale contre le programme Bayrou montre une voie féconde à soutenir et à amplifier.
Au-delà, recoudre les fils coupés de la souveraineté populaire appelle de combattre la double dépossession des citoyennes et citoyens que masque le suffrage prétendument universel : dépossession de l’exercice réel du pouvoir sous couvert de démocratie parlementaire biaisée dans le cadre actuel des institutions ; dépossession de tout pouvoir citoyen et populaire sur la sphère de la production et du travail – chasse gardée des « actionnaires-propriétaires ». C’est ce combat contre le mépris de la citoyenneté qui émerge sous différentes formes, dont celle de la pétition contre la loi « Duplomb ».
Dans le même mouvement grandit l’aspiration d’une transformation fondamentale de l’organisation de la société humaine inséparablement d’un changement radical des rapports entre la société des humains qui doivent vivre en paix avec l’ensemble du vivant non-humain.
Émerge ainsi, particulièrement dans une part importante de la jeunesse, loin des discours dominants, non seulement l’aspiration à un changement de société, mais aussi d’un plus haut degré de civilisation. La conquête du pouvoir citoyen sur l’État et sur les productions, la démocratie réelle, deviennent le but et le moyen des transformations structurelles vers le post-capitalisme. Un terreau fertile à l’initiative communiste !
* M. Robespierre, Discours sur le gouvernement représentatif à l’Assemblée nationale le 10 mai 1793
Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay
Patrick Le Hyaric
Texte intégral (2995 mots)
Les forces de droite, les précaires ministres Retailleau et Genevard en tête, ont entrepris de justifier avec d’insoutenables arguments le contenu de la loi Duplomb.
Nous relevons ici une série de contrevérités et leur apportons des réponses argumentées.
– « Il faut respecter la science », « il faut de la rationalité dans le débat »
Celles et ceux qui invoquent la science et la rationalité pour défendre la loi Duplomb n’écoutent précisément pas la science et les scientifiques. En effet, pas moins de 1300 chercheurs et soignants de l’INSERM, du CNRS ou d’INRAE se sont prononcés contre la loi Duplomb, mettant en avant son impact sanitaire et environnemental négatif.
La loi Duplomb a été votée contre l’avis de 22 sociétés savantes médicales ! Contre l’avis de La Ligue contre le cancer, contre l’avis des administrateurs de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, contre l’avis de la Fondation pour la recherche médicale, contre l’avis de 20 mutuelles et groupes mutualistes, contre l’avis du Conseil scientifiques du CNRS, contre l’avis de la fédération des régies d’eau potable.
Une étude scientifique suisse sur 14 enfants a montré que l’on retrouve chez 13 d’entre eux de l’acétamipride dans le liquide céphalorachidien (liquide ou baigne le cerveau et la moelle épinière). Une étude chinoise sur un échantillon de 300 personnes confirme les résultats de cette étude suisse.
– « L’alimentation française, en termes de qualité et de normes environnementales, est ce qu’il y a de mieux dans le monde »
Cet argument pétri d’un relativisme ne garantit pas la santé. Ainsi, s’il est vrai que la « grippe est moins pire que le covid », vous pouvez cependant mourir des deux. Il est démontré désormais que l’utilisation d’engrais phosphaté issus des importations marocaines chargé en cadmium prépare une crise sanitaire d’ampleur. On retrouve partout désormais des pollutions des eaux dites « potables ». En Bretagne, les nitrates provoquent la prolifération d’algues vertes toxiques. Les insecticides et pesticides multiplient les cancers, notamment dans les familles paysannes.
– Quand le président de la FNSEA dit à la télévision : « Ma fierté, c’est de produire une alimentation de qualité à destination de mes compatriotes », il se moque du monde.
Précisément, l’une des questions aujourd’hui posée est celle de la « souveraineté agricole et alimentaire » dans ce qui était un grand pays agricole. Or, aujourd’hui 43 % de la surface agricole utile de notre pays sert à produire pour l’exportation dans le cadre du « grand marché libre ». Et nous importons globalement 20 % de notre alimentation. Mais il existe désormais des secteurs comme les fruits et légumes où nous importons jusqu’à la moitié de notre consommation. La direction de la FNSEA berne les paysans, et ses adhérents, depuis les choix faits par Giscard d’Estaing, en valorisant le concept « d’agriculture, pétrole vert ».C’est à dire une agriculture pour l’exportation afin d’améliorer la balance commerciale de la France.
En réalité, c’est l’intégration de la production agricole dans la mondialisation capitaliste avec en amont, de grands secteurs industriels fournisseurs des moyens de production – engrais, machines, produits de traitements, etc – Et en aval les oligopoles de la transformation « agro-alimentaire » et les centrales de distribution.
Partant de là, la production agricole et alimentaire capitaliste considère l’alimentation telle une marchandise comme une autre avec des prix mondiaux déconnectés des coûts réels de production et la rémunération du travail paysan.
En effet, qu’y a-t-il de commun entre un agrarien brésilien qui exploite 3 000 voire 4 000 hectares et un paysan du Burkina Faso où même avec un paysan de la plaine de la Beauce ? Rien, bien sûr. Le prix mondial est donc une hérésie du capitalisme mondialisé. Dans cette compétition mondiale, les droites françaises – mais pas seulement malheureusement – ont voulu faire de l’agriculture non plus le cœur de l’alimentation, de la santé et du développement des territoires, mais une marchandise pour la balance commerciale. Pour cela, il a fallu en permanence compresser les prix à la production. Il y a une différence entre une orientation consistant à développer une agriculture vivrière et une agriculture d’exportation.
– « Les consommateurs sont-ils prêts à payer des produits de qualité ? »
Cette phrase, maintes fois répétée sur des plateaux TV, ainsi que les crachats de ministres à la tête creuse, vise d’un même mouvement à culpabiliser le paysan et le consommateur. Le paysan produirait trop cher et le consommateur voudrait des produits peu chers et de qualité. C’est typique de l’argumentaire de justification des aliénations. Si les mandataires du capitalisme s’acharnent à ne pas vouloir installer des prix « plancher » ou « de base » rémunérant le travail paysan, c’est précisément pour ne pas avoir à augmenter les salaires des salariés.
Le prix d’une alimentation tirée d’une production agricole de masse à prix bas – contre la rémunération du travail paysan – de plus en plus intégrée à la mondialisation capitaliste, réduit l’alimentation à une variable d’ajustement (relative) des budgets des ménages écrasés notamment par le prix du logement.
C’est la quadrature du cercle : les salariés ont besoin de manger pour renouveler leur force de travail. Le capitalisme ne veut pas (ou peu) augmenter les salaires et a donc besoin de mettre en circulation une alimentation dont le prix est contenu – même s’ils ont augmenté ces derniers temps en conséquence de l’organisation de la fluctuation des prix mondiaux à la production par les firmes transnationales. Ainsi, le prix du beurre flambe actuellement parce qu’on détruit à petit feu la production laitière. Le prix du café est également très élevé en lien avec les modifications climatiques et l’organisation du marché par les firmes capitalistes. Il conviendrait de développer cette analyse, mais, à grands traits, le capitalisme fait en permanence pression sur les prix agricoles pour ne pas à avoir à augmenter les salaires ouvriers.
– « Besoin d’eau pour continuer à faire de l’agriculture »
C’est vrai. Mais la construction des méga bassines répond à d’autres objectifs. Elle privatise l’eau pour une minorité de grandes exploitations au détriment des petites exploitations et de l’ensemble de la population. De plus, l’eau des méga bassines est obtenue par pompage des nappes phréatiques dont le niveau est en souffrance avec le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse. Une autre réponse existe depuis longtemps, celle des « lacs collinaires » qui mettent en réserve l’eau de pluie. Ajoutons qu’il faut se préparer à de nouvelles pratiques culturales tenant compte des modifications climatiques. Celles-ci s’opposent à l’industrialisation de l’agriculture et appellent le déploiement d’un processus vers l’agrobiologie. De nombreuses études et l’observation montrent que, à la différence des parlementaires au service de l’agrochimie et de l’agro-industrie, partout dans le pays, des paysans de tout horizon travaillent déjà avec de nouvelles pratiques, combinent l’amélioration de la vie des cheptels et des cultures (et y compris de leur santé) avec recherche de meilleurs revenus en diminuant les intrants – engrais, antibiotiques, produits chimiques.
– « L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est-elle d’accord avec l’utilisation de l’acétamipride ? »
Sur 290 substances chimiques actives utilisées en France, l’Union européenne s’apprête à en interdire la majorité d’ici l’année 2035, au point que le ministère de l’Agriculture préparait un programme de suppression de l’usage de 75 molécules chimiques.
Pour l’acétamipride, l’EFSA a conclu à la nécessité d’approfondir encore les travaux de recherche et a souligné des risques sérieux pour la santé humaine, celle des organismes aquatiques, des pollinisateurs (les abeilles notamment) et des oiseaux. Rappelons que les populations d’oiseaux se sont effondrées en Europe ces dernières années, en lien avec l’intensification agricole. Dans son dernier rapport publié en mai 2024 l’agence européenne confirme son évaluation en mettant en garde : « Des incertitudes majeures dans l’éventail des preuves de toxicité neurodéveloppementale (toxicité pour le cerveau) de l’acétamipride »
– « On est obligé d’utiliser les mêmes produits phytosanitaires que les autres pays européens pour rester compétitif »
On rejoint ici une conception de l’agriculture extractive de matières premières pour les marchés mondiaux.
Rien n’interdit à notre pays d’imposer ses propres règles plus strictes en matière de protection de la santé et de l’environnement. Elle le fait d’ailleurs dans certains cas. L’article 44 de la loi Égalim interdit la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires qui ne sont pas autorisées à la production ou à la vente en France. Il suffit d’amender l’article 44 de cette loi pour interdire aussi les produits d’importation – qui ne respectent pas nos règles sanitaires et environnementales – destinés à la vente.
Ce n’est, en effet, pas un hasard si la loi n’a pas prévu d’exclure les produits importés. La FNSEA, et les droites n’en disent mot très bizarrement !
Pourtant, un rapport du Sénat avait calculé une fourchette entre 10 % et 25% de produits importés en France qui ne respectent pas les règles minimales imposées aux producteurs Français.
En cas de menace grave pour la santé et l’environnement, il est possible de faire déclencher « la clause de sauvegarde européenne » pour protéger nos producteurs, la santé et l’environnement.
Il se dit aussi que les produits néonicotinoïdes enrobés ne seraient pas dangereux pour les abeilles. Certains ajoutent que du fait du non-fleurissement de la betterave à sucre, il n’y a aucun risque puisque les abeilles n’y vont donc pas butiner. Or, les pollinisateurs vont butiner les repousses de racines brisées qui elles fleurissent et les mauvaises herbes qui sont forcément contaminées par les molécules présentes dans les sols. Elles aussi fleurissent et attirent des abeilles. Ajoutons que les molécules chimiques restent longtemps dans les sols et restent toxiques pour tous les insectes et peuvent être absorbées par la culture suivante, possiblement attirante des pollinisateurs. L’enrobage est aussi nocif que les pulvérisations.
– « Les normes environnementales tuent l’agriculture »
Ce qui tue l’agriculture, c’est la concentration agraire, c’est l’endettement et le surendettement des paysans, ce sont les prix insuffisants et le marché mondial.
Ce qui tue l’agriculture, c’est le réchauffement climatique comme l’a montré le Haut Conseil pour le Climat en 2024 qui montre que la production agricole est menacée dès l’année 2035. (Cliquez ici pour accéder au site du Haut Conseil pour le Climat). Dans le cas de la betterave à sucre, la prolifération de pucerons est liée aux modifications climatiques avec des températures hivernales moyennes qui augmentent.
– « Il n’y aurait pas d’alternative »
Au nom de ce mensonge il faudrait accepter le développement des cancers et d’autres maladies ?
Alternative technique ? La réintroduction de l’acétamipride concerne environ 400 000 hectares pour la culture de betterave sucrière et des noisettes. En passant, il s’agit pour la betterave d’alimenter des méthaniseurs pour du biocarburant. Et la noisette est la plupart du temps utilisée pour fabriquer le Nutella.
Ce pesticide est destiné à combattre le puceron vert, qui transmet le virus de la jaunisse aux betteraves et décime les cultures.
En 2018, une expertise collective d’Inrae et de l’Anses avait listé et analysé l’ensemble des alternatives disponibles, leur efficacité, leur possible utilisation et leur durabilité.
Après deux ans d’études il a été conclue que: 96 % des utilisations de néonicotinoïdes disposent d’alternatives efficaces. Dans 8 cas sur 10, ces alternatives ne sont pas chimiques : il peut s’agir d’application d’une couche d’argile protectrice, de lutte via des micro-organismes, de perturbation de l’accouplement, etc.
Il a été proposé aux betteraviers qu’une seule alternative chimique pour lutter contre le puceron vert : l’association de deux pesticides, le lambda-cyhalothrine et le pyrimicarbe. Puis en 2021, une mise à jour de l’avis, des deux agences sur la lutte contre la jaunisse de la betterave, ont ouvert la voie à plusieurs solutions.
Quatre d’entre elles sont immédiatement disponibles : deux insecticides (flonicamide et spirotétramate) et des techniques à appliquer sur les parcelles (paillage et fertilisation organique) doivent permettre de réduire les pucerons. À noter que les deux insecticides proposés ont des effets moindres sur l’environnement et seraient bien plus efficaces que l’acétamipride.
Et, l’Anses a établi que dix-huit autres solutions pourraient être disponibles dans les 2 à 3 ans ; Il s’agit des stimulateurs de la défense des plantes et l’utilisation de cultures compagnes permettant de réguler les populations de ravageurs. Ces méthodes ne sont pas suffisantes à elles seules. L’agence recommande donc de poursuivre les études pour identifier les combinaisons les plus prometteuses.
L’alternative fondamentale ? Repenser nos méthodes et revenir à l’agronomie contre le diktat des firmes chimiques. Du reste, dans un rapport publié en 2023 de l’inspection générale de l’agriculture insistait sur la nécessité de rechercher des alternatives en matière de protection des cultures. « La reconception des systèmes de production s’impose : la protection des cultures, en transition agroécologique, passe par un profond changement des itinéraires techniques et des modes de production » y est-il écrit. (Cliquez ici pour lire : Produire de l’alternative en protection des cultures – Retour d’expérience)
Mais ceci s’oppose à la mainmise des secteurs d’amont – firmes des semences, de l’engrais des machines, des banques – et des secteurs d’aval, celui qui achète les aliments – industries de collecte, de transformation, de distribution. Bref, cela s’oppose aux mécanismes capitalistes qui broient les petits et moyens paysans et s’enrichissent sur le consommateur.
Travaillons à l’unité des tous les travailleurs.
– Attention, comme Trump, le gouvernement veut contrôler ou détruire les agences de sécurité sanitaires et alimentaires
Alors que la loi ne traite pas avec précision des missions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un décret publié en catimini le 8 juillet prévoit deux dispositions particulièrement préoccupantes. L’une permet au ministre de l’Agriculture de décider, par arrêté, d’une liste de pesticides qu’il souhaite voir examiner de manière prioritaire et contraint l’Anses à prendre en considération cette liste dans la définition de son calendrier d’autorisation de mise sur le marché.
Il s’agit d’une pression directe sur l’agence veillant à la qualité alimentaire et à l’environnement, – l’Anses -, qui devra désormais d’abord examiner les demandes de pesticides choisis autoritairement par le ministre.
La seconde disposition, complémentaire de celle-ci, introduit dans les critères de mise sur le marché, celui dit « de condition agronomique ». Ceci cache en fait la volonté de permettre l’utilisation de produits dont la nocivité est avérée, mais jugée par certains indispensables à la production.
L’affaire est grave. Laisser seul le ministère de l’Agriculture prendre de telles décisions est contraire à notre droit puisque l’Anses est sous la triple tutelle des trois ministères.
Les principes de précaution et de prévention, qui, tous deux, figurent dans la Constitution, sont allègrement violés, tout comme le principe de non-régression. L’indépendance de l’Anses est mise en cause, ainsi que la possibilité de faire prévaloir les critères de santé et environnementaux sur les enjeux d’augmentation de la productivité – afin de ne pas traiter ceux de la rémunération du travail paysan.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État devraient être saisis immédiatement.
Amplifions le grand mouvement citoyen en cours.
Plus de deux millions de signatures de la pétition Non à la Loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective. SIGNER
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay
Patrick Le Hyaric
Texte intégral (722 mots)
À l’initiative d’Éléonore Pattery, 23 ans, actuellement étudiante en Master QSE et RSE (Qualité, Sécurité, Environnement / Responsabilité Sociétale des Entreprises), la pétition contre ce qui est communément appelée « Loi Duplomb » est en train de devenir un événement politique de haute portée. À l’heure où ces lignes sont écrites, nous marchons vers le million et demi de signatures.
C’est en tant que future professionnelle de la santé environnementale et de la responsabilité collective, qu’Éléonore Pattery a initié cette campagne de signatures sur le site de l’Assemblée nationale quand cette loi n’a été adoptée que par l’entremise de manigances d’arrière-salles au Parlement. L’Assemblée nationale n’a pas eu à en débattre véritablement. Les amendements déposés par l’opposition de gauche et des écologistes ayant été rejetés sans débat.
En plus d’être une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire, cette loi devient le symbole de la démocratie parlementaire foulée au pied par les intérêts de l’agrochimie et de l’agrobusiness. Et maintenant, la Présidente de l’Assemblée nationale, bien contrainte de la remettre à l’ordre du jour des débats, ne veut surtout pas de nouveau vote.
Or, il peut devenir impossible de nier cette vague citoyenne qui montre le rejet massif d’une loi qui menace notre santé, notre biodiversité et l’avenir de notre agriculture en réintroduisant des pesticides néonicotinoïdes, comme l’acétamipride, ou en facilitant l’appropriation de la ressource en eau au profit de quelques gros agri-manager et l’agrandissement de fermes-usines.
Un débat doit avoir lieu, avec un droit d’amendement et un vote. Le président de la République a le pouvoir de ne pas promulguer cette loi qui ne « protège » pas le travail paysan, mais protège les firmes de l’agro-industrie.
Et, l’Anses
Mieux encore, alors que la loi ne traite pas avec précision les missions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un décret publié le 8 juillet prévoit deux dispositions particulièrement préoccupantes. L’une permet au ministre de l’Agriculture de décider, par arrêté, d’une liste de pesticides qu’il souhaite voir examiner de manière prioritaire et contraint l’Anses à prendre en considération cette liste dans la définition de son calendrier d’autorisation de mise sur le marché.
Il s’agit d’une pression directe sur l’agence veillant à la qualité alimentaire et à l’environnement, -l’Anses-, qui devra désormais d’abord examiner les demandes de pesticides choisis par le ministre.
La seconde disposition, complémentaire de celle-ci, introduit dans les critères de mise sur le marché, celui dit « de condition agronomique ». Ceci cache en fait la volonté de permettre l’utilisation de produits dont la nocivité est avérée, mais jugée par certains indispensable à la production.
L’affaire est grave. Laisser seul le ministère de l’Agriculture prendre de telles décisions est contraire à notre droit puisque l’Anses est sous la triple tutelle des trois ministères.
Les principes de précaution et de prévention, qui, tous deux, figurent dans la Constitution, sont allègrement violés, tout comme le principe de non-régression. L’indépendance de l’Anses est mise en cause, ainsi que la possibilité de faire prévaloir les critères de santé et environnementaux sur les enjeux d’augmentation de la productivité – afin de ne pas traiter ceux de la rémunération du travail paysan.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État devraient être saisis immédiatement.
Amplifions le grand mouvement citoyen en cours.
La Terre
Texte intégral (708 mots)
Lancée par une étudiante le 10 juillet sur la plateforme de l’Assemblée nationale, la pétition contre la loi Duplomb dépasse le million de signatures.
À partir du seuil des 500.000 signatures, atteint samedi, et à condition qu’elles soient issues d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale peut décider d’organiser un débat en séance publique. Mais la loi ne sera pas réexaminée sur le fond et encore moins éventuellement abrogée.
La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s’est dite sur franceinfo « favorable » à l’organisation d’un tel débat. Mais il « ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée » qui va, selon elle, « sauver un certain nombre de nos agriculteurs ».
Aucune pétition n’a jamais été débattue dans l’hémicycle dans l’histoire de la Ve République.
Le texte de l’étudiante de 23 ans, Eléonore Pattery, suscite un engouement inédit, abondamment relayé sur les réseaux sociaux par des personnalités comme Pierre Niney et des députés de gauche. Le rythme des signatures s’est accéléré ce week-end.
Cette loi « est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire », écrit dans sa pétition l’étudiante.
Adoptée le 8 juillet au Parlement, elle prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous conditions de l’acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe.
Ce produit est réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes, qui estiment n’avoir aucune alternative contre les ravageurs et subir une concurrence déloyale.
A contrario, les apiculteurs mettent en garde contre « un tueur d’abeilles ».
Ses effets sur l’humain sont aussi source de préoccupations majeures.
La pétition réclame également « la révision démocratique des conditions dans lesquelles la loi Duplomb a été adoptée ».
Au Parlement, elle avait en effet connu un parcours expéditif avec une motion de rejet préalable, déposée par son propre rapporteur Julien Dive (LR) pourtant favorable au texte. Le député l’avait justifié en dénonçant l’ « obstruction » de la gauche, qui avait déposé plusieurs milliers d’amendements.
L’absence de réel débat dans l’hémicycle est l’un des arguments avancés par les députés de gauche qui ont déposé un recours le 11 juillet devant le Conseil constitutionnel, espérant sa censure pour vice de procédure, ce qui pourrait empêcher sa promulgation.
Cette possibilité de pétitions sur le site de l’Assemblée, qui date de 2019, est un exemple de « démocratie participative qui pourrait faire bouger des lignes », estime la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, qui évoque la possibilité, pour le président de la République, de retarder la promulgation de la loi en demandant une seconde délibération au Parlement.
En attendant, la pétition « met une pression politique » sur les députés, souligne son collègue Benjamin Morel.
L’ensemble des partis de gauche ont appelé samedi à la tenue de ce débat. « Face aux lobbies, nous sommes des millions: l’écologie contre-attaque », s’était félicitée sur X la patronne des Ecologistes Marine Tondelier.
Le président et le Premier ministre « doivent entendre la colère populaire contre cette loi passée en force. Ils doivent renoncer à la promulguer », a écrit dimanche sur X le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard.
À l’inverse, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, premier syndicat agricole, très favorable à la loi Duplomb, estime que l’agriculture française « disparaîtra » si on lui impose « des normes supérieures » à celles de ses voisins européens.
The Conversation
Texte intégral (4134 mots)
Par Pierre Lebailly, Maître de Conférences en Santé publique, membre de l’Unité de recherche Interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des cancers – ANTICIPE, chercheur en épidémiologie au Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse à Caen, Université de Caen Normandie et Isabelle Baldi, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, co-directrice de l’équipe EPICENE (Épidémiologie du cancer et des expositions environnementales) – Centre de Recherche INSERM U 1219, Université de Bordeaux
Plus d’un an après l’annonce de la mise en pause du plan Écophyto II+, qui visait à « réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50 % d’ici 2025 », et son remplacement par la controversée stratégie Écophyto 2030, la question des pesticides revient sur le devant de la scène parlementaire dans le cadre des débats autour de l’adoption de la proposition de loi « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », dite loi « Duplomb » (du nom du sénateur Les Républicains Laurent Duplomb, qui l’a initiée). L’occasion de rappeler que les agriculteurs sont les premiers exposés aux produits phytosanitaires, ce qui n’est pas sans conséquence pour leur santé.
Les effets délétères des pesticides sur la santé, et en particulier sur celle des exploitants agricoles des pays occidentaux et de leurs familles, sont de mieux en mieux documentés. Plusieurs types de cancers sont notamment plus répandus dans les populations d’agriculteurs que dans la population générale. C’est aussi le cas de diverses maladies neurodégénératives et respiratoires.
Voici ce que l’on en sait à l’heure actuelle, et les questions qui restent posées.
Qu’est-ce qu’un « pesticide » ?
Sous l’appellation de « pesticides » sont regroupés un ensemble de produits de synthèse ou naturels visant à lutter, le plus souvent en les détruisant, contre les organismes jugés nuisibles pour l’être humain ou ses activités, notamment en agriculture.
Ces substances répondent à quatre usages : il peut s’agir de produits phytopharmaceutiques (les plus connus des pesticides, ceux qui sont utilisés sur les cultures), de certains biocides (utilisés dans les bâtiments d’élevage ou en salle de traite, pour traiter le bois afin de le protéger des insectes et des moisissures…), de certains médicaments vétérinaires (antiparasitaires externes ou antifongiques) et enfin de certains médicaments destinés à la santé humaine (anti-poux, anti-gale, anti-mycoses…).
Les pesticides ont donc par nature une activité toxique vis-à-vis du vivant. Ils sont de ce fait soumis à une réglementation plus ancienne et plus contraignante que la plupart des autres produits chimiques. Cette réglementation, établie au niveau européen, est complexe, car elle vise à encadrer le quadruple usage de ces substances.
Des effets sur la santé connus de longue date
L’histoire des pesticides commence à la fin du XIXe siècle. En France, dès les années 1880, certaines substances (arsenicaux, dérivés du cuivre et du soufre) ont été employées dans les régions où l’agriculture s’intensifiait, notamment en viticulture et en arboriculture. Déjà à cette époque, des médecins hygiénistes notèrent chez les travailleurs agricoles l’émergence de nouvelles maladies liées à leur emploi.
Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que l’usage des pesticides prend véritablement son essor, avec le passage à une production industrielle en quantité et en variété des familles chimiques. Conséquence : dès les années 1950-1970, plusieurs constats préoccupants sont faits.

Des intoxications aiguës se produisent, dans les vergers en Californie, chez les applicateurs d’organophosphorés, ainsi que chez d’autres travailleurs en contact avec les végétaux après les traitements. Des contaminations alarmantes de l’environnement sont détectées, et des travaux révèlent que le lait humain est lui aussi contaminé, notamment par certains insecticides de la famille des organochlorés (tels que le DDT ou le lindane).
Dès les années 1960, en France, certains médecins du travail agricole se préoccupent des effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles. Aux États-Unis, les critiques associées à leur utilisation ont alimenté dès cette époque d’importantes mobilisations protestataires, dénonçant leurs effets délétères sur la santé des saisonniers agricoles, des consommateurs ou de la faune sauvage.
Après plus de cinquante ans d’études épidémiologiques (1970-2020), il est maintenant admis que les populations agricoles des pays à forts revenus, dans lesquels la plupart des études ont été conduites, présentent des particularités en matière de risque de cancer.
Trois cancers clairement plus fréquents chez les agriculteurs
Dans les pays occidentaux, on observe un excès de certains cancers dans les populations agricoles, par rapport à la population générale.
Il s’agit principalement des cancers de la prostate (cancer masculin le plus fréquent en France, il touche chaque année près de 60 000 hommes, entraînant le décès de près de 9 000 d’entre eux), des lymphomes non hodgkiniens et des myélomes multiples.
Pour les cancers de la prostate, au moins 5 méta-analyses ont été conduites sur le lien avec l’exposition professionnelle aux pesticides et elles ont conclu pour quatre d’entre elles à une augmentation de risque variant de 13 à 33 %. Quelques méta-analyses ont porté sur le lien avec des familles chimiques spécifiques de pesticides comme celle sur les insecticides organochlorés qui a conclu à une augmentation de risque variant de 30 à 56 % selon les molécules étudiées. Pour les lymphomes, une méta-analyse datant de 2014 montrait une augmentation de risque variant de 30 à 70 % pour les 7 familles chimiques étudiées.
Dans sa première expertise collective publiée en 2013, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) concluait à une présomption forte d’un lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et la survenue de ces trois cancers. Cette conclusion a été maintenue lors de la mise à jour de cette expertise collective, en 2021.
En raison de ces données scientifiques, ces trois cancers font l’objet de tableaux de maladies professionnelles en France (tableau 59 du régime agricole pour les lymphomes non hodgkiniens incluant les myélomes multiples et, tableaux 61 (régime agricole) et 102 (régime général) pour les cancers de la prostate).
D’autres cancers ayant fait l’objet de moins d’études (leucémies, tumeurs du système nerveux central, sarcomes, cancers du rein et de la vessie), seraient aussi plus fréquents chez les utilisateurs professionnels de pesticides. L’expertise collective Inserm de 2021 a conclu à une présomption moyenne de lien pour ces cancers.
Enfin, de nombreux autres cancers ont été très peu étudiés et n’ont d’ailleurs pas pu faire l’objet d’une analyse détaillée par les expertises de l’Inserm de 2013 et 2021 par manque de moyens humains et/ou de données disponibles. Il s’agit des cancers broncho-pulmonaires, des cancers digestifs (colorectaux, estomac, pancréas, foie, œsophage), des cancers gynécologiques (sein, ovaires, corps et col de l’utérus), des cancers ORL ou des lèvres et des cancers de la thyroïde.
Les données manquent pour étudier tous les pesticides utilisés
Il faut noter que peu d’études épidémiologiques ont analysé les liens entre la survenue de cancers ou de maladies chroniques et l’exposition à des familles ou des molécules pesticides spécifiques. En effet, la plupart des études conduites portaient sur des effectifs réduits, ne permettant pas d’explorer la diversité des molécules.
On considère que plus de 1000 molécules à activité pesticide ont été homologuées en Europe, et ont été présentes pour une utilisation agricole à un moment ou un autre. Certaines molécules étant retirées tandis que de nouvelles sont homologuées, aujourd’hui, on considère que le nombre de molécules autorisées est plus proche de 400.
Cependant, il est important de considérer également les molécules retirées du marché, en raison des effets retardés qu’elles peuvent avoir (comme dans le cas du lindane, interdit en France depuis 1998 pour les usages agricoles et assimilés – mais seulement en 2006 dans les produits anti-poux, qui persiste encore néanmoins dans l’environnement).
Ainsi, dans le meilleur des cas, pour des cancers très étudiés et pour des familles chimiques de pesticides très anciennes (herbicides tels que le 2,4D ou insecticides organochlorés comme le DDT, utilisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale), il n’existe pas plus d’une dizaine d’études disponibles permettant de documenter un lien.
Dans la méta-analyse de 2015 qui a conclu à une augmentation de risque de cancer de la prostate de plus de 50 % pour les expositions professionnelles au lindane, faute de données, les auteurs n’ont pu analyser que 5 organochlorés parmi la vingtaine qui ont été utilisés massivement dans le monde depuis les années 1950…
Les auteurs de la méta-analyse de 2014 qui a établi un lien entre lymphomes non hodgkiniens et expositions à des pesticides spécifiques (21 familles chimiques et plus de 80 matières actives rapportées) n’ont identifié que 12 études fournissant des données sur les phénoxy-herbicides (2,4D, MCPA…).
En 2017, d’autres auteurs se sont focalisés sur le lien entre ces lymphomes non hodgkiniens et l’exposition au 2,4D à partir de 12 études cas-témoins et d’une cohorte historique dans une usine de production de cet herbicide. Cette méta-analyse a pu conclure à une augmentation du risque de 70 % chez les professionnels les plus exposés.
D’autres maladies que le cancer sont aussi concernées
Au-delà des cancers, des données de plus en plus nombreuses et convergentes indiquent que l’exposition aux pesticides a pour conséquences d’autres effets sur la santé. Les effets sur le cerveau, par exemple, sont de mieux en mieux documentés.
D’après les expertises collectives de 2013 et de 2021 de l’Inserm, le niveau de présomption du lien entre l’exposition aux pesticides et le développement d’une maladie de Parkinson est fort. Les connaissances sur ce lien se sont constituées au cours du temps à partir de la survenue de quelques cas observés chez de personnes ayant été exposées à des substances proches de certains herbicides (des toxicomanes ayant consommé des drogues contenant une substance, le MPTP, très proche chimiquement du paraquat et du diquat, deux herbicides largement utilisés).
Ces constats ont été renforcés par des études géographiques montrant une plus forte prévalence de la maladie dans certaines zones agricoles, puis des études cas-témoins et quelques données de cohorte. Au final, les nombreuses études publiées mettent en évidence un risque de maladie de Parkinson quasiment doublé chez les personnes ayant été exposées aux pesticides.
Les données toxicologiques renforcent la compréhension de ce lien : chez des animaux exposés en laboratoire à certains pesticides (notamment la roténone, une molécule dérivée d’une plante et considérée comme un insecticide biologique), des atteintes neurodégénératives ont été mises en évidence.
Par ailleurs, plus d’une cinquantaine d’études ont également révélé des altérations des performances cognitives (capacités du cerveau à traiter les informations) chez les personnes exposées de manière chronique aux pesticides, ce qui a également conduit l’expertise collective de l’Inserm à conclure à un niveau de présomption fort pour ces troubles.
Ces résultats interrogent sur un possible lien avec la maladie d’Alzheimer, pour laquelle les troubles cognitifs peuvent représenter des symptômes précurseurs. Cependant, le nombre d’études sur cette maladie reste aujourd’hui encore limité. De ce fait, le niveau de présomption du lien est considéré comme « moyen ».
Il faut enfin souligner que certaines altérations respiratoires chroniques ont donné lieu à un grand nombre d’études probantes au cours des dix dernières années, amenant l’Inserm à la conclusion d’un niveau de présomption fort entre l’exposition aux pesticides et le risque de développer une bronchopneumopathie chronique obstructive, une grave maladie inflammatoire des bronches.
Accumuler et croiser les données grâce à des cohortes de grande taille
La difficulté à documenter l’effet de molécules pesticides spécifiques a été en partie résolue dans certaines études récentes, qui se sont essentiellement appuyées sur de grandes cohortes prospectives.
C’est par exemple le cas de l’Agricultural Health Study aux USA, qui porte sur plus de 50 000 agriculteurs utilisateurs de pesticides inclus à la fin des années 1990 (les questionnaires initiaux interrogeaient les agriculteurs sur l’usage d’une cinquantaine de molécules spécifiques).

En France, depuis le milieu des années 2000, la cohorte AGRIculture & CANcer (AGRICAN) suit plus de 182 000 affiliés agricoles dans 11 départements français métropolitains, dont près de 70 % d’agriculteurs/éleveurs. Ces participants sont utilisateurs de pesticides pour plus de 70 % des hommes et plus de 20 % des femmes.
Les cohortes Agricultural Health Study et AGRICAN sont en outre associées avec des données du recensement agricole norvégien au sein d’un consortium international de cohortes agricoles nommé AGRICOH.
Parallèlement, la plupart des études cas-témoins plus récentes permettent d’analyser le lien avec des pesticides spécifiques. De plus, certaines de ces études cas-témoins – les plus anciennes – sont réunies en consortium internationaux portant sur des maladies ciblées, généralement peu fréquentes, et bénéficiant du regroupement de cas à l’échelle internationale.
C’est le cas du consortium INTERLYMPH : regroupant plus de 20 études cas-témoins conduites dans une dizaine de pays différents, dont la France, il porte sur plus de 17 000 patients atteints de lymphomes.
Une nocivité confirmée
À l’heure actuelle, AGRICAN a permis d’obtenir des résultats concernant les effets d’expositions professionnelles agricoles – incluant les pesticides – sur les cancers de la prostate, de la vessie, du côlon et du rectum, du système nerveux central, des ovaires ainsi que pour les myélomes multiples ou les sarcomes.

Pour chacun de ces cancers, plusieurs secteurs de production ont été associés à des effets délétères, ainsi que certaines tâches associées soit à une exposition directe, lors de l’application des pesticides sur les cultures ou en traitement de semences, soit à l’exposition indirecte : réentrée (autrement dit, le fait de revenir dans les cultures juste après les traitements, ce qui conduit à un contact avec des surfaces traitées et un transfert de résidu de la plante vers la peau des travailleurs), contact avec des semences enrobées, récoltes…
Pour permettre aux personnes ayant travaillé en agriculture d’estimer leurs expositions à certains pesticides, en fonction des cultures sur lesquelles elles sont intervenues, un outil épidémiologique (PESTIMAT) a été élaboré. Celui-ci a permis d’évaluer l’influence, dans la survenue de tumeurs du système nerveux central, de molécules pesticides spécifiques, telles que les herbicides, insecticides et fongicides carbamates.
Par ailleurs, en 2019, AGRICOH a permis de conclure à une association entre l’exposition au glyphosate et la survenue d’un type de lymphome particulier, le lymphome diffus à grandes cellules B. Cette analyse a également permis de détecter une association entre l’exposition à un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes, la deltaméthrine, et la survenue d’une autre hémopathie lymphoïde (les leucémies lymphoïdes chroniques).
Enfin, en 2021, les travaux d’INTERLYMPH ont montré (en s’appuyant sur 9 études cas-témoins pour 8 000 patients atteints de lymphomes), que l’exposition des agriculteurs à deux insecticides, le carbaryl et le diazinon, était associée à un doublement du risque de certains lymphomes. L’année suivante, d’autres travaux menés dans le cadre d’INTERLYMPH ont révélé que chez les personnes ayant utilisé pendant de nombreuses années des phénoxy-herbicides comme le 2,4 D, les risques de survenue de plusieurs lymphomes spécifiques étaient doublés.
Des questions encore en suspens qui concernent aussi d’autres professions
L’impact de l’exposition professionnelle aux pesticides sur la santé humaine, notamment en termes de cancers et de certaines maladies neurodégénératives, ne fait guère de doute aujourd’hui, en raison d’une littérature scientifique nombreuse et convergente. Les arguments en faveur d’un lien entre cette exposition et d’autres maladies, en particulier respiratoires et endocriniennes, sont aussi de plus en plus nombreux au fil des ans.
Cependant, les connaissances nécessitent d’être encore renforcées. En effet, des zones d’ombre persistent notamment quant aux fenêtres d’exposition les plus critiques. L’impact des expositions aux pesticides pendant la vie fœtale et l’enfance est aussi une source de préoccupations.
Par ailleurs, si l’agriculture est le secteur professionnel utilisant les plus grandes quantités de pesticides, de nombreux autres secteurs d’activité sont également concernés, mais nettement moins étudiés (espaces verts, industrie du bois, hygiène publique, pompiers, industries agroalimentaires…).![]()
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Fabrice Savel
Texte intégral (969 mots)
Quel tribunal devra demain juger celles et ceux qui ont participé au coup de force anti-démocratique pour faire passer une loi visant « à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » ?
Les protagonistes de cette machination ont construit à l’Assemblée nationale une majorité allant des macronistes à l’extrême droite pour rejeter leur propre texte, de telle sorte qu’il ne soit pas discuté, et pour le faire adopter « automatiquement » par un quarteron de sept députés et de sept sénateurs réunis en conclave baptisé poliment « commission mixte paritaire ».
Le menu de cette loi est une succession de poisons. Réintroduction de pesticides interdits, autorisation d’épandre par drone ces produits toxiques, allègement des normes pour faciliter l’élevage industriel et construire, au profit des plus gros agriculteurs, des méga bassines qui pompent l’eau des nappes phréatiques.
S’abonner à La Terre
La France qui, à deux reprises en 2020 et 2022, a soumis à la Commission européenne des données nouvelles justifiant l’interdiction du pesticide néonicotinoïde neurotoxique du nom d’acétamipride va donc ré-autoriser son utilisation.
Il convient de mesurer toute la nocivité et l’exceptionnelle gravité de cette décision.
Des travaux menés en Suisse ont montré que l’on retrouvait cette molécule dans le liquide céphalo-rachidien – qui baigne le cerveau et la moelle épinière – de treize enfants sur un échantillon de quatorze, testés en 2022. Des études similaires menées en Chine, aux États-Unis, au Japon ont confirmé ce diagnostic alarmant. Et, on constate désormais une augmentation de pathologies diverses comme la baisse de la fertilité, la hausse de certains cancers et de maladies neurodégénératives.
L’utilisation de ces substances est dangereuse pour la santé des paysans travailleurs et pour celle de leurs champs. L’acétamipride est si toxique qu’il tue les insectes utiles à la biodiversité. Tuer des pollinisateurs sur un champ de noisettes revient à réduire considérablement les rendements des parcelles de colza ou de céréales à proximité.
Par contre, le rendement des grandes firmes de l’agrochimie, lui, progresse à vue d’œil. Celles-ci organisent la dépendance des paysans travailleurs à leurs onéreux produits et empêchent la recherche de voies alternatives qui protègent la santé humaine, celle de la terre et de l’eau.
L’épandage de ces produits aujourd’hui aura des conséquences néfastes pour le sol, l’eau et donc dans nos corps qui se révéleront d’ici vingt ou trente ans.
La responsabilité du petit conclave de parlementaires se permettant aujourd’hui d’autoriser l’utilisation d’un tel poison relève à la fois du déni démocratique, du déni d’intérêt général et de l’écocide. Ils racontent la main sur le cœur qu’ils défendent le paysan, alors qu’ils l’enfoncent dans ses difficultés, pour nourrir les monstres de l’agrochimie et couvrir la pression à la baisse des prix agricoles.
Du reste, la fameuse proposition de loi dite « Duplomb » ne dit mot de la rémunération du travail. Elle est une grave atteinte à l’agriculture paysanne. Celle qui permet les installations de jeunes, celle qui relocalise des productions, celle qui respecte les sols et préserve la biodiversité, les ressources en eau. Celle qui crée les conditions d’une authentique souveraineté alimentaire. Si la cohorte des droites et des extrêmes droites avait le souci de lever les entraves au métier d’agriculteur, elle agirait pour que s’améliore les rémunérations du travail. Elle desserrerait l’étau des emprunts qui enserrent les corps des paysans, spoliés sans cesse par le complexe agro-alimentaire qui pompe la valeur dégagée par le travail.
Chacune et chacun d’entre nous doit avoir à l’esprit, en permanence, que sur le ticket de caisse, le prix de l’aliment est la part la moins importante. Le transport, la logistique, les emballages, les coûts de la transformation, la publicité et les frais financiers pèsent infiniment plus que la matière première agricole. Il convient d’ajouter que les coûts sanitaires pris en charge par la sécurité sociale et les coûts environnementaux, notamment la dépollution de l’eau induite par ces empoisonnements, s’élèvent, selon les calculs, entre 400 millions et 18 milliards d’euros.
Et que dire des souffrances endurées par celles et ceux qui contractent des maladies neurodégénératives ou des cancers liés aux herbicides et aux pesticides. En fait, contre la santé, l’écologie et le travail paysan, ce sont les « contraintes » à l’exploitation capitaliste que lèvent la loi « Duplomb » et ses complices. Pour être assurés de leur forfait, ils placent l’office français de la biodiversité (OFB) sous tutelle. Pour ne plus connaître les effets du mortel danger des pesticides, ils veulent supprimer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Le tribunal de l’humanité jugera sévèrement cette forfaiture !
Image by Gerd Altmann from Pixabay.
Fabrice Savel
Lire plus (171 mots)
La Terre n°19 est disponible chez les marchands de journaux et par commande en ligne.
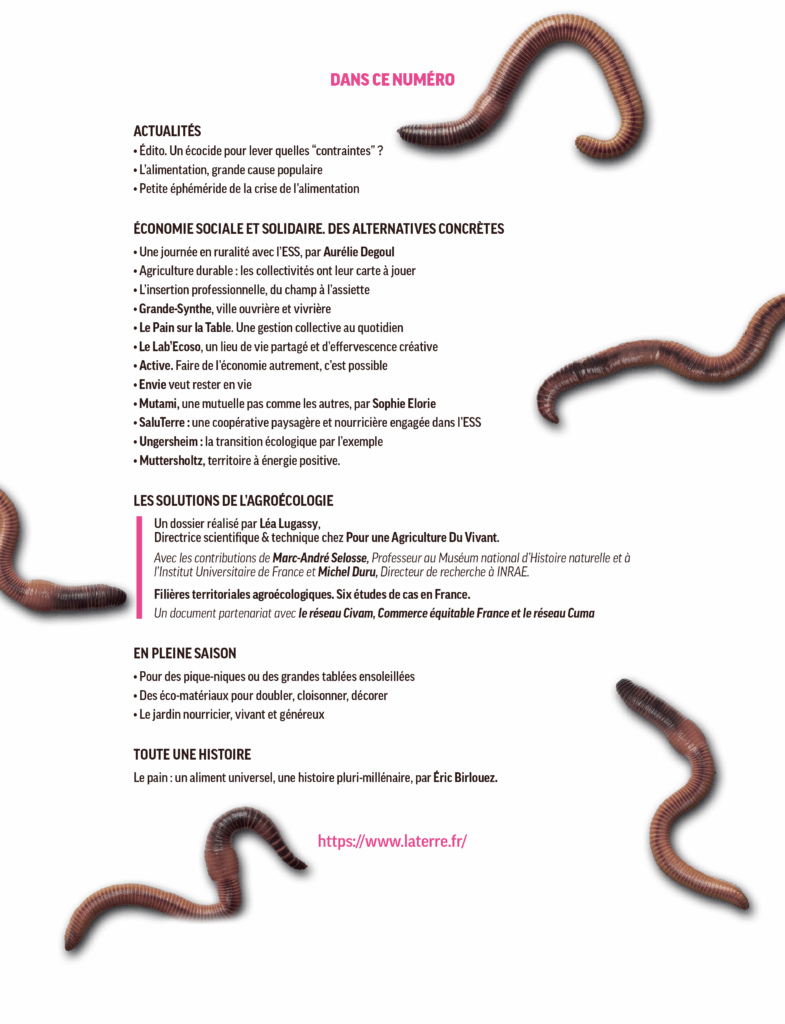
Fabrice Savel
Texte intégral (890 mots)
24 heures pour sauver les terres nourricières de Gonesse – RENDEZ-VOUS sur le Triangle de Gonesse – Du samedi 14 juin 2025 à 17 h au dimanche 15 juin 2025 à 17h.
Dans le cadre des actions des Soulèvements de la Seine, le CPTG vous invite à venir camper, planter, semer… vous informer sur la nouvelle enquête publique organisée par le préfet du Val d’Oise jusqu’au 30 juin 2025 pour la création d’une nouvelle zone d’activités de 122 ha à urbaniser sur le Triangle de Gonesse… et débattre des projets alternatifs possibles !
Les terres de Gonesse sont aujourd’hui au confluent des ravages du BTP (chantiers du Grand Paris) et de ceux de l’agro-industrie (agriculture céréalière intensive destinée à l’export mondial).
Depuis l’abandon du mégacentre commercial EuropaCity en novembre 2019, le préfet a réduit la zone à urbaniser de 300 hectares à 122 hectares. Ce sont 122 hectares de trop à l’heure du dérèglement climatique et du « consommer local », qui exigent de préserver les terres agricoles de proximité.
Le gouvernement et la Région Île-de-France s’entêtent à vouloir bétonner les terres les plus fertiles d’Europe : ils prévoient d’ores et déjà de construire une « Cité scolaire internationale » (collège, lycée, et même un internat) dans le bruit des avions qui décollent jour et nuit. Et comme dans toutes les zones d’activités autour de Roissy, ce sont des hangars de logistique – à cause de la création d’un échangeur routier – qui risquent au final de détruire les champs nourriciers.

Pourtant il est encore possible de sauver les terres du Triangle de Gonesse !
Il est encore possible de choisir
– un projet alternatif, comme celui d’AgriParis Seine de restauration collective 100% bio, locale et de saison pour nourrir les enfants des écoles, les malades dans les hôpitaux et les résidents et personnels des EHPAD.
– un projet nourricier pourra fédérer des agriculteurs déjà présents sur le Triangle de Gonesse, des maraîchers en recherche de foncier agricole pour s’installer, et des collectivités voulant s’engager dans cette démarche d’avenir, avec des maraîchers salariés (en régie).
– un projet nourricier allant vers une plus grande sécurité alimentaire des Francilien·nes et une meilleure qualité de vie des habitant·es.
Sauver les terres agricoles de Gonesse :
- c’est vital pour protéger les sols et l’eau et donc pouvoir manger sain,
- c’est vital pour créer des emplois locaux,
- c’est vital pour diminuer le réchauffement climatique en banlieue et avoir des espaces de respiration.
Le programme
Samedi 14 juin à partir de 17 h : installation du camping, chant, scène ouverte et veillée sous les étoiles. S’inscrire sur le site.
Dimanche 15 juin à partir de 10 h : plantations – puis Restauration sur place pour le pique-nique
A partir de 14 h : Conférence, avec :
- Stéphane DUPRÉ, conseiller municipal délégué à la Démocratie alimentaire de ROMAINVILLE
- Gilles BILLEN, chercheur émérite au CNRS, biogéochimiste, spécialiste des systèmes alimentaires et de l’agroécologie,
- Prises de parole d’élu·es et associations
17 h : Fin du rassemblement
Le programme complet sera actualisé sur le site : https://ouiauxterresdegonesse.fr
Image by Pantea Adrian from Pixabay
Patrick Le Hyaric
Texte intégral (889 mots)
Il est des jours au cours desquels de violents télescopages devraient aider à ouvrir les yeux. En voici trois dans la même journée du 27 mai.
Premier télescopage
On glose à la présidence de la République et à Matignon sur la possibilité d’organiser un référendum. On ne s’en était pas rendu compte, mais ces locataires des ors de la République sont soucieux de la démocratie ! Soucieux de votre opinion ! La preuve !
On vient d’assister à un événement sans précédent à l’Assemblée nationale. Unis, main dans la main, la droite de Retailleau et de Genevard, l’extrême droite au grand complet et des fractions non-négligeables du ventre mou macroniste font voter une motion de rejet contre leur propre proposition de loi antisociale, anti-sanitaire et anti-écologique bien nommée loi Duplomb, pour mieux la faire avaliser par une commission mixte paritaire des deux assemblées. Sans vote, donc. Décidément, leur créativité anti-démocratique n’a pas de limite.
Si nous avions besoin d’une leçon sur la prétendue « démocratie parlementaire » nous voici amplement servis jusqu’à la nausée. Trump en rougit de jalousie.
Sous prétexte de défendre les paysans, cette loi vise à ré-autoriser l’utilisation de pesticides, notamment l’acétamipride dont les études révèlent qu’ils polluent l’eau potable et à de néfastes conséquences sur la santé des enfants. En plus, la loi remet en cause l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et place l’Office français pour la biodiversité (OFB) sous tutelle. Voilà Trump copié, singé, concurrencé jusqu’à la nausée !
Deuxième télescopage
Le même jour, à tour de rôle, le Premier ministre de droite et le président de la Cour des comptes, dont les couleurs socialistes ne cessent de palir, sautaient de plateaux de télévision en studio de radio pour nous expliquer d’une voix tremblotante que la Sécurité sociale coûte cher, que les caisses sont vides.
Or, des études menées sur les coûts sociaux cachés de l’utilisation des pesticides s’élèvent, selon ce qui est pris en compte, de 370 millions d’euros annuels jusqu’à 18,7 milliards d’euros selon la revue Frontiers in Sustainable Food Systems et Nature Sciences Sociétés.
Le seul traitement des cancers du système lymphatique et de la maladie de Parkinson que provoque cette molécule engendre au moins 48,5 millions d’euros. Sans compter les souffrances sans nom pour les personnes qui en sont atteintes.
Troisième télescopage
Ouest-France consacre trois-quarts de page ce 27 mai à la fameuse loi Duplomb et en vis-à-vis, produit un article titré « les oiseaux des champs en fort déclin » à cause… des pesticides. Désormais, 18 000 espèces animales sont menacées d’extinction.
Ce même jour, après avoir montré des images de tracteurs de la FNSEA rentrant à la ferme, le journal du soir de France 2 consacre son sujet de « l’Œil du 20 h » à la pollution des eaux dans un village du département de l’Yonne. Celle-ci est le résultat d’un épandage de pesticides et d’herbicides depuis des dizaines d’années. En effet, nous subissons aujourd’hui les conséquences de ce qui a été épandu dans les champs, il y a un quart de siècle. Autrement dit, les effets du coup de force des droites de l’Assemblée nationale auront des conséquences sur notre santé et celle des générations à venir pour les vingt, trente, cinquante années qui viennent.
Comment qualifier des « irresponsables politiques » opérant un tel coup de force ?
Ne nous trompons pas. Ce ne sont pas les paysannes et paysans, premières victimes de ces poisons qu’ils défendent, mais les multinationales de l’agrochimie qui sont à la manœuvre, bien camouflées derrière les sièges des députés et des tracteurs. Plus ils vendent ces produits nocifs, plus les profits augmentent, plus ils prélèvent la valeur dégagée par le travail paysan. Du reste, le grand oublié de ces derniers jours est bien la rémunération du travail paysan. Ajoutons qu’il n’y aura pas de démocratique planification sanitaire et écologique sans normes de protection, précisément contre les dures lois du capital. Loin de la transition sanitaire et écologique, c’est le capitalisme qu’ils défendent.
Image by goat-privacy from Pixabay
Fabrice Savel
Texte intégral (1149 mots)
Pour qui désire un monde meilleur et un avenir sûr, l’heure est à l’inquiétude, parfois au désespoir. La montée des pratiques autoritaires aux États-Unis et en Europe, les attaques incessantes contre nos acquis sociaux et les droits humains, ainsi que l’explosion des inégalités entravent le progrès social. Derrière les appels à la violence et la chasse aux boucs émissaires, ce sont en réalité la science, la culture, l’éducation et la solidarité qui sont directement attaquées.
Si vous souhaitez rejoindre l’appel ou vous informer davantage cliquez ici.
En parallèle, le changement climatique et les catastrophes qui en découlent nous menacent tou·te·s : ils emportent des vies, empêchent nos enfants d’aller à l’école à cause des températures excessives ou des inondations, et frappent les plus vulnérables d’entre-nous, comme les quartiers populaires. Ils exposent nos aîné·e·s et les travailleur·euse·s à des chaleurs mortelles, détruisent nos logements, comme par exemple avec les inondations en Bretagne début 2025 ou dans le Nord-Pas-de-Calais en 2024. Les catastrophes climatiques menacent notre patrimoine, nos emplois, nos récoltes et les écosystèmes dans lesquels nous vivons (comme en Gironde lors des feux de forêts de 2022), et mettent en danger l’accès à notre alimentation et à l’eau.
Le passage du cyclone Chido à Mayotte nous rappelle que les plus durement exposé·e·s au changement climatique sont les plus pauvres, les moins responsables et nous montre à quel point l’Etat français est mal préparé pour protéger ses habitant·e·s. Il n’est pas à la hauteur de ses responsabilités en particulier dans les territoires ultra-marins, ne serait-ce que sur la question de l’eau potable, à laquelle l’accès n’est pas garanti.
Alors pour qui désire un monde meilleur et un avenir sûr, l’heure est au sursaut. Car tout n’est pas perdu.
De multiples échéances jalonneront 2025 (le sommet Océan en juin à Nice, ou encore la COP30 au Brésil) et seront autant d’occasions de mettre le gouvernement face à ses responsabilités.
Nous, acteurs et actrices de la société civile française, savons que la France a la responsabilité et la capacité de faire plus et mieux, aux niveaux national et international.
Mais pour cela nous avons besoin de vous.
Dix ans après l’Accord de Paris sur le Climat, signé dans notre propre pays, c’est ensemble que nous devons interpeller le Gouvernement pour construire et accélérer notre adaptation et transition face au changement climatique et à ses impacts.
C’est ensemble que nous devons appeler à débloquer des financements pour une transition juste, qui n’oublie personne, et écologique, qui respecte la Planète et le Vivant. Des réformes fiscales sont indispensables, notamment en taxant les plus pollueurs et les plus riches. En plus de financer sa propre transition, la France devra appeler à l’annulation de la dette des pays en développement et honorer sa dette climatique à leur égard en soutenant leur développement de manière durable et juste.
C’est ensemble que nous devons exiger de la France qu’elle s’attaque à la source du problème : stopper l’exploitation des énergies fossiles par l’Etat et les entreprises. Le chemin est tracé : conduire les transformations nécessaires dans tous les secteurs de l’économie, réduire la consommation énergétique et développer des alternatives, comme les énergies renouvelables. Elle devra assurer une transition juste pour les travailleur·euse·s concerné·e·s, leur garantissant un maintien de leurs droits et de leurs revenus. En parallèle, la France devra mettre en place des politiques d’adaptation pour protéger les territoires et les populations, notamment côtières, et plus particulièrement ses territoires les plus exposés que sont ceux dits ultra-marins.
C’est ensemble que devons demander une protection sans faille des écosystèmes marins et terrestres, la transition de notre agriculture vers l’agroécologie, en garantissant un revenu juste pour les agriculteur·rice·s et éleveur·euse·s, et garantir le droit à l’alimentation.
Enfin, c’est ensemble que nous devons revendiquer une transition juste et appropriée par tou·te·s, en garantissant la participation aux prises de décision des populations les plus impactées et concernées et les moins entendues. Cela concerne notamment les populations des territoires ultra-marins, les personnes discriminées en raison de leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur genre, les personnes en situation de pauvreté et précarité et les Peuples Autochtones.
Le gouvernement français se retrouve une nouvelle fois face à ses incohérences avant une étape cruciale, celle de la COP30 en novembre au Brésil, année des 10 ans de l’Accord de Paris. Il doit faire face à sa responsabilité historique. Pour nous, il n’y a pas le choix, c’est une question de survie et de justice pour l’Humanité. Si les dangers et conflits montent de toutes parts dans un monde en tensions, le changement climatique n’est pas en pause. Personne n’est ni ne sera épargné par ses conséquences.
Convaincu.es, abattu.es, isolé.es, motivé.es, quel que soit notre état d’esprit, nous savons que les victoires se gagnent toujours ensemble, en restant visibles, solidaires, fier.es des victoires passées, déterminé.es pour la justice. À l’heure où le péril climatique et l’effondrement des écosystèmes s’intensifient, nous ne devons pas nous cacher. C’est notre histoire et c’est ensemble que nous l’écrivons.
Si vous souhaitez rejoindre l’appel ou vous informer davantage, cliquez ici.
Image by Dominic Wunderlich from Pixabay
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène