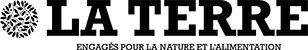Engagés pour la nature et l'alimentation.
Texte intégral (3086 mots)
Par Barbu Corentin, Aulagnier Alexis, Gallien Marc, Gouy-Boussada Véronique, Labeyrie Baptiste, Le Bellec Fabrice, Maugin Emilie, Ozier-Lafontaine Harry, Richard Freddie-Jeanne, Walker Anne-Sophie, Humbert Laura, Garnault Maxime, Omnès François, Aubertot JN. Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original. Face aux manifestations des agriculteurs début 2024, le gouvernement français a annoncé une « mise à l’arrêt » du plan Ecophyto jusqu’au salon de l’Agriculture fin février. Cette pause devait permettre de revoir les indicateurs utilisés pour évaluer la baisse de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides appliqués sur les cultures) en France. Certains indicateurs développés au niveau européen étaient fortement mis en avant avec le soutien de certains syndicats d’agriculteurs. À l’inverse, des organisations de défense de l’environnement et de la santé défendaient l’indicateur NoDU, indicateur actuel du plan Ecophyto. Le gouvernement a finalement tranché le 21 février, avec l’annonce par Gabriel Attal de l’abandon du NoDU, au profit de l’indicateur européen HRI-1. Comment s’y retrouver dans cette jungle d’acronymes ? En tant que membres du Comité Scientifique et Technique du plan Ecophyto, comité indépendant des pilotes du plan, nous avons notamment pour mission de guider le choix des indicateurs. Dans ce texte, nous souhaitons préciser la nature de ces derniers et en clarifier les enjeux. La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques nécessitent la définition d’indicateurs quantitatifs. Mais pour construire des indicateurs pertinents, il faut faire des choix quant à la nature de ce que l’on mesure, et à la façon dont on le définit. Du fait de ces choix, les indicateurs, y compris agro-environnementaux, sont par nature imparfaits. Une quantification des ventes décrira imparfaitement la toxicité et l’écotoxicité des produits, mais même un indicateur spécifique de la toxicité pose le problème de la définition des écosystèmes et espèces touchées : humains, insectes, faune du sol ou des cours d’eau… tous sont différents par leur exposition, mais surtout par leur sensibilité aux différentes substances actives. [Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui] Face à cette complexité, il est utile de se rappeler qu’un indicateur doit éclairer une décision. Il faut trouver un compromis entre pertinence et accessibilité des données mobilisées pour le calculer. Devant la difficulté de connaître l’utilisation de produits dans les champs, il a été choisi, aux niveaux français comme européen, de mesurer les ventes au niveau des distributeurs, par année civile. Il faut garder à l’esprit que la quantification des ventes ne permet pas de suivre les pratiques agricoles en temps réel, puisque les produits sont achetés à l’avance et que les agriculteurs adaptent leur utilisation au statut agronomique de leurs parcelles (mauvaises herbes, maladies, infestations par des insectes…). En France, le suivi des ventes a été rendu possible par la création de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en 2008, qui est une taxe payée par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Sa mise en œuvre a permis l’enregistrement de toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques en France dans une base de données (BNVD). À partir des données de vente, plusieurs indicateurs ont été proposés dans le débat public. Nous les présentons brièvement ci-après. La QSA correspond à la masse totale de substances actives dans les produits vendus au cours d’une année civile. Sa simplicité d’utilisation apparente voile un travers majeur : elle cumule des substances ayant des doses d’application par hectare très différentes, ce qui revient à additionner des choux et des carottes. Par analogie, c’est comme si l’industrie pharmaceutique additionnait les masses de médicaments ayant des posologies radicalement différentes. Or, pour les traitements phytopharmaceutiques, les « posologies » varient fréquemment d’un facteur 1 à 100. Des substances potentiellement très toxiques, mais actives à beaucoup plus faible dose peuvent ainsi se retrouver « masquées » par d’autres substances. Par exemple, les insecticides sont généralement efficaces à très faibles doses. Par conséquent, ces derniers ne représentent que 1,8 % de la QSA moyenne annuelle sur la période 2012-2022, alors qu’ils représentent environ 15 % des traitements. Par ailleurs, l’industrie phytopharmaceutique tend à produire des substances de plus en plus légères pour une efficacité donnée. Par conséquent, la QSA peut baisser au cours du temps sans que cela soit lié à une diminution du nombre de traitements, ou à une baisse de toxicité des substances utilisées. Par exemple, un herbicide en cours d’homologation serait efficace à un gramme par hectare, soit plus de 1000 fois moins que le glyphosate, efficace à plus d’un kilogramme à l’hectare. Si cette substance venait à remplacer les herbicides actuels, et notamment le glyphosate, la QSA pourrait baisser soudainement d’un tiers, sans que les pratiques ni leur toxicité potentielle n’aient changé. Le NoDU agricole est l’indicateur de référence du plan Ecophyto depuis sa création en 2008. Historiquement, il a été construit par des scientifiques d’INRAE en lien avec les pouvoirs publics pour pallier les faiblesses de la QSA. Sans rentrer dans les détails, on peut dire qu’il corrige le problème de la grande diversité des doses auxquelles sont utilisées les substances actives, en divisant chaque quantité de substance commercialisée par une dose de référence à l’hectare, appelée « dose unité » (DU). Le NoDU correspond ainsi au cumul des surfaces (en hectares) qui seraient traitées à ces doses de référence. Cette surface théorique est supérieure à la surface agricole française, puisque les cultures sont généralement traitées plusieurs fois. Le calcul de la dose unité, complexe et détaillé au paragraphe suivant, s’appuie sur les doses maximales autorisées lors d’un traitement (doses homologuées). Ces doses sont validées par l’Anses sur la base de l’efficacité et de la toxicité et écotoxicité de chaque produit. Dans le NoDU, les substances appliquées à une dose inférieure à 100 g par hectare sont bien prises en compte : elles représentent la large majorité du NoDU. Dans la QSA au contraire, les quelques substances appliquées à plus de 100 g par hectare représentent la grande majorité de la QSA et invisibilisent les autres substances. Bien que les indications données par le NoDU permettent de caractériser l’évolution du recours aux produits phytopharmaceutiques, il pose néanmoins des problèmes, liés notamment à la complexité du calcul des doses unités. Commençons par préciser que lorsqu’une substance est présente dans plusieurs produits commercialisés, chaque produit va être homologué sur plusieurs cultures et pour différents usages, potentiellement à différentes doses. La dose unité est définie, de manière complexe mais précise, comme la moyenne des maxima, par culture, des doses homologuées pour une substance une année civile donnée. Cette moyenne est pondérée par la surface relative de chaque culture en France. Chaque année, le NoDU est calculé avec les doses unités de l’année et les NoDU des années précédentes sont recalculés avec ces doses unités pour éviter que les changements réglementaires affectent les tendances observées. Le calcul des doses unités, tout à fait justifié du point de vue conceptuel, entraîne en pratique d’importantes difficultés : la définition est difficile à comprendre, ce qui en soi est un problème pour un indicateur aussi important ; l’utilisation des surfaces de culture implique d’attendre la publication de ces valeurs, ce qui retarde d’autant le calcul du NoDU. Pourtant, tenir compte des surfaces cultivées n’a qu’un impact très faible sur le résultat obtenu au niveau national. C’est également un frein à la généralisation du calcul à d’autres échelles géographiques ; l’utilisation des maxima des doses homologuées augmente la sensibilité du calcul aux évolutions réglementaires, ainsi qu’aux erreurs potentiellement présentes dans les bases de données. Cependant, et malgré les évolutions de surfaces de culture et de réglementation d’une année à l’autre, l’utilisation des doses unités d’une année ou d’une autre ne font varier la valeur du NoDU que de quelques pourcents au niveau national. Pour faciliter la compréhension et le calcul du NoDU, tant au niveau régional qu’européen, nous recommandons de définir la dose unité d’une substance comme la médiane de toutes ses doses homologuées – plutôt que la moyenne des maxima des doses homologuées par culture, pondérée par la surface relative de chaque culture. Cette modification ne remettrait pas en cause le principe général du NoDU pour caractériser les ventes des produits phytopharmaceutiques en tenant compte des doses homologuées. Enfin, les variations du NoDU en fonction l’année de calcul des doses unités deviendraient indétectables. De plus, nous avons montré que l’indicateur résultant est extrêmement corrélé au NoDU actuel. De sorte que même si les valeurs absolues sont différentes, les évolutions restent identiques. Depuis 2009, première année de collecte des données de vente, le NoDU a augmenté de 15 à 20 % jusqu’en 2014, puis s’est stabilisé jusqu’en 2017. S’en est suivi deux années exceptionnelles d’augmentation (stockage en 2018) puis de diminution (déstockage en 2019) liées à l’annonce, en 2018, de l’augmentation de la RPD au 1er janvier 2019. Depuis 2020, la valeur du NoDU s’est alors stabilisée à nouveau à un niveau proche de celui de 2009-2012. Cette dernière baisse pourrait être liée à l’augmentation de la RPD en 2019 mais aussi à des conditions climatiques globalement défavorables aux pathogènes et aux ravageurs ces trois dernières années. La relative stabilité du NoDU pour l’ensemble des substances entre 2009 et 2022 peut donner une impression d’immobilisme. Cependant, le plan Ecophyto prévoit aussi le calcul du NoDU sur la base plus restreinte des substances identifiées dans le code du travail comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux effets avérés ou supposés (CMR1) ou suspectés (CMR2). Ces substances particulièrement toxiques doivent en effet être éliminées en priorité. Or, le NoDU pour les CMR1, les plus dangereuses, a baissé de 88 % entre 2009 et 2020 (voir graphe ci-dessous), avant d’approcher 0 % en 2022. Les CMR dans leur ensemble ont vu leur NoDU diminuer de 40 % entre 2009 et 2020. Cette baisse met en évidence les changements importants permis par l’évolution réglementaire d’une part, et par l’adaptation des agriculteurs à ces évolutions d’autre part. Autrement dit, oui, le NoDU a été utile pour quantifier la limitation de l’usage des produits phytopharmaceutiques dangereux. De plus, et contrairement à ce qui aurait pu arriver, cette élimination des produits les plus dangereux, et potentiellement les plus efficaces, n’a pas entraîné une augmentation des traitements dans leur ensemble. C’est d’autant plus remarquable que l’interdiction de traitements de semences (par exemple néonicotinoïdes sur colza), non inclus dans le NoDU, a sans doute entraîné l’utilisation de traitements en végétation (par exemple contre les altises à l’automne) qui eux sont comptabilisés dans le NoDU. Il faudrait donc profiter de la réflexion actuelle sur les indicateurs pour intégrer l’ensemble des substances actives utilisées pour les traitements de semences dans le calcul. Au niveau européen, d’autres indicateurs ont été proposés : les HRI-1 et 2 (Harmonized Risk Indicator, prévu par la directive n°2009/128) et les F2F-1 et 2 (Farm to Fork, prévu dans la stratégie de la Ferme à la Table). Les indicateurs HRI-1 et F2F-1 sont jumeaux, puisqu’ils ne diffèrent que par l’éventail des substances prises en compte et par les périodes de référence considérées. Tous deux prennent en compte la masse de substances actives, comme le fait la QSA, mais en les pondérant en fonction de leur appartenance à des groupes de « risque » : 1 pour les substances de faible risque, 8 pour les substances autorisées, 16 pour les substances dont l’interdiction est envisagée, et enfin 64 pour les substances interdites. Ces indicateurs européens sont problématiques pour plusieurs raisons : tout d’abord les masses ne sont pas rapportées à des doses d’usage ; de surcroît, en France, environ 80 % des substances vendues sont par défaut classées dans le second groupe (substances « autorisées »), ce classement est donc peu discriminant ; enfin, les valeurs de pondération utilisées pour le calcul de ces indicateurs sont arbitraires et ne sont étayées par aucun résultat scientifique. Le NoDU n’est aujourd’hui utilisé qu’en France mais il suffirait de simplifier son calcul, tel que nous le proposons, pour le rendre utilisable à l’échelle européenne. Les doses maximales autorisées par application peuvent varier entre pays européens, la dose unité pourrait donc correspondre à la médiane de toutes les doses homologuées en Europe. Le calcul serait simple, pertinent et applicable partout en Europe. Cette méthode pourrait aussi être utilisée pour calculer l’évolution des ventes pour chaque groupe de « risque » défini actuellement au niveau européen. Une autre option acceptable pourrait être que les indicateurs européens soient modifiés pour utiliser, au sein de chaque groupe, un équivalent au NoDU et non une masse totale de substance. C’est fondamentalement ce que l’agence environnementale allemande propose dans son rapport de mai 2023 bien qu’elle critique aussi les coefficients de pondération du HRI-1. Par ailleurs, il apparaît difficile d’embrasser la complexité de la question de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques avec un unique indicateur. Idéalement, il faudrait que le plan Ecophyto se dote d’un panel d’indicateurs complémentaires permettant de décrire : l’intensité de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ; les services agronomiques rendus par les produits phytopharmaceutiques ; les risques pour la santé humaine ; les risques pour la biodiversité. Quelles que soient les options choisies, le comité alerte sur la nécessité de conserver un indicateur prenant en compte les doses d’usage, tel que le NoDU. Cet indicateur doit continuer d’une part d’être appliqué à l’ensemble des ventes pour caractériser la quantité totale de traitement et d’autre part d’être appliqué aux substances les plus préoccupantes pour quantifier l’effort d’arrêt des substances les plus dangereuses. Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay.
À l’origine des indicateurs, un besoin d’évaluation
Les ventes de produits phytopharmaceutiques en France comme prérequis
La quantité de substance active (QSA)
Le nombre de doses unité (NoDU)
Le calcul de la dose unité, ou quand le diable est dans les détails
Notre proposition pour simplifier le NoDU
Bilan du plan Ecophyto à l’aune du NoDU
HRI, F2F… Les indicateurs européens
Faut-il en finir avec le NoDU ?

Texte intégral (518 mots)
Le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a envoyé un extrait du Projet de Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles (PLOAA) au MODEF (Lire le document). Le MODEF refuse ce document de travail car il méprise les paysans !
Ce texte va détruire l’Agriculture Familiale et va mettre en péril la souveraineté alimentaire. C’est du blabla de technocrates ! Aucune mesure sur les prix agricoles et sur le revenu paysan ! Selon le dernier rapport institutionnel du Global Policy-Report – Food System Economics Commission (janvier 2024), le modèle agro-industriel fait peser des coûts cachés sur la santé, l’environnement, et la société s’élevant à 15 000 milliards de dollars par an soit 12 % du PIB mondial. Le gouvernement français prône ce modèle !
Le MODEF est scandalisé par cette orientation politique ! Le modèle Agriculture familiale à taille humaine et agroécologie rapporterait 10 000 milliards de dollars par an, selon le rapport des économistes. Le coût estimé de cette transition est de seulement 0,2 à 0,4 % du PIB mondial. Les libéraux français ont travaillé à vider la notion de souveraineté alimentaire de son objet fondamental.
Le MODEF demande la suppression de la définition écrite par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Nous revendiquons la définition de la Via Campesina : « la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles ». De plus, le MODEF exige la sortie du secteur agricole et de l’alimentation du cadre commercial de l’OMC. Le MODEF recommande au Gouvernement d’intégrer dans la définition de souveraineté alimentaire la capacité donnée aux peuples de construire démocratiquement leurs propres politiques agricoles et alimentaires !
Les paysans demandent au Premier Ministre de revoir sa copie en intégrant les 45 propositions du MODEF. Lire les 45 propositions du Modef

Image by Eszter Miller from Pixabay
Texte intégral (1986 mots)
Par Clément Reversé, Sociologie de la jeunesse, sociologie des espaces ruraux, Université de Bordeaux.
Si l’on pense pauvreté, une réalité urbaine vient à l’esprit. La grande ville, la banlieue, le péri-urbain. Seule exception dans cet imaginaire de pauvreté de béton : les agriculteurs. Leur mobilisation contre leur précarité grandissante est actuellement très médiatisée. Lorsqu’ils ne sont pas sur le devant de la scène, ils restent observés avec intérêt par les chercheurs et les pouvoirs publics. Trois raisons à cela : ils sont particulièrement subventionnés, le maintien de leur profession joue un rôle déterminant pour les espaces ruraux et les enjeux de « souveraineté alimentaire » cristallisent l’attention.
Mais en dehors de ce corps de métier, la pauvreté des espaces ruraux à très faible densité de population est comme invisible. Les questions de précarité et d’exclusion sociale sont très peu médiatisées lorsque l’on parle de tous les autres habitants des campagnes.
Depuis une vingtaine d’années, la pauvreté monétaire sur le territoire national s’accentue (elle se définit par un revenu inférieur à 60 % du revenu médian. En 2023, ce seuil est fixé à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne seule et de 2 314 euros pour un couple avec enfants). Alors qu’en 2004, 12,6 % de Français vivaient sous le seuil de pauvreté, en 2024, ils sont 14,5 %. La pauvreté monétaire est plus importante dans les grands centres-villes, c’est vrai.
Mais ensuite, c’est dans les communes rurales dites « isolées et hors de l’influence des villes » qu’elle est la plus forte. Celles-ci accueillent environ 5 % de la population métropolitaine. Que sait-on de cette pauvreté rurale ? Qu’en est-il notamment chez les jeunes ?
Que sait-on de la pauvreté des jeunes ruraux ?
Tout d’abord, pourquoi s’intéresser particulièrement aux jeunes ? Il y a environ 9 millions de personnes en situation de pauvreté en France. Les jeunes de moins de 30 ans représentent à eux seuls la moitié de cet échantillon. Ils sont deux fois plus susceptibles de se retrouver dans une situation de pauvreté que ne le sont les personnes de plus de 65 ans. Cela s’explique à la fois par un phénomène de reproduction sociale (qui exacerbe les inégalités au fil des générations) et par une redistribution des richesses et des places en défaveur des jeunes générations. La jeunesse est particulièrement hétérogène, mais elle fait face dans son ensemble à un contexte de marée montante de la précarité. Cependant, les choses ne sont pas les mêmes que l’on soit un jeune vivant en ville ou à la campagne.
Lorsqu’on s’intéresse aux chiffres, la pauvreté en milieu rural semble moins importante qu’en ville. Les ménages ruraux représentent un tiers de la population, mais un quart des ménages pauvres. Cela pourrait laisser penser que les espaces ruraux sont des espaces de « résistance » à la pauvreté, notamment chez les jeunes.
Ces chiffres sont trompeurs : ils dissimulent d’autres phénomènes. Le taux de pauvreté des urbains est supérieur à celui des ruraux, mais lorsque l’on s’intéresse aux actifs de moins de 30 ans, la pauvreté est très similaire. Les retraités, eux, sont même plus touchés par la pauvreté dans les campagnes que dans les villes. La sociologue Agnès Roche dénonce dans son ouvrage Des vies de pauvres les écrans de fumée qu’imposent les catégories administratives et notamment le découpage géographique de l’Insee qui homogénéise les différents espaces ruraux (périurbain, rural « profond », etc.) en un ensemble parfois incohérent. Difficile alors d’étudier les phénomènes de pauvreté dans un flou territorial.
Ainsi, là où les travaux statistiques tutoient parfois leurs limites, les enquêtes qualitatives réalisées auprès des jeunes ruraux permettent de mieux comprendre ces phénomènes. Elles se révèlent particulièrement éclairantes sur les questions de non-recours aux aides sociales et mettent à jour une pauvreté invisibilisée et stigmatisée dans les campagnes.
Un non-recours aux aides plus important
On observe un écart assez important en fonction des territoires lorsque l’on étudie les jeunes à l’aune des aides qu’ils reçoivent. Dans le modèle français, une grande partie de la solidarité qui permet aux jeunes d’accéder à l’indépendance repose sur l’aide parentale. Ce système « familialiste » crée une reproduction des inégalités importante puisqu’il fait reposer l’avenir socioprofessionnel des jeunes sur les ressources de leurs parents, ressources inégales entre les familles et souvent en défaveur des territoires ruraux. Pour autant, si la solidarité familiale est acceptée, les aides sociales sont en France particulièrement stigmatisées. Elles sont associées à l’hédonisme, à la fainéantise, à l’inaction, en bref, à l’imaginaire de l’assistanat.
Chez les jeunes ruraux, on observe un phénomène de rejet plus prononcé des aides sociales que chez les urbains. Le fait de vivre en milieu rural diminue d’ailleurs la probabilité de connaître de manière précise le RSA de 11,2 points. Une opposition assez flagrante entre deux domaines symboliques se dessine dans le discours des jeunes avec lesquels nous nous sommes entretenus : d’une part, la figure du travailleur pauvre, et de l’autre, celle de l’assisté. Dans cette manière très manichéenne de percevoir son rapport à ces revenus, on tente de se placer du côté de ceux qui maîtrisent leurs expériences de vie par le travail. Être ou devenir « un assisté » devient une crainte telle qu’elle détourne souvent les jeunes d’aides auxquelles ils peuvent pourtant prétendre.
Plus que craindre pour l’image que l’on se fait de soi, c’est surtout le risque de stigmatisation que l’on craint. Être perçu comme un « assisté », c’est être localement « mal vu » et donc souffrir d’une mauvaise réputation. Dans des espaces où les réputations se font et se défont rapidement, le fait d’être perçu comme « vivant aux crochets » des aides peut notamment limiter l’employabilité des jeunes. Ce non-recours aggrave la précarité des jeunes dans les campagnes. Il participe à une pauvreté plus silencieuse.
Les jeunes femmes plus durement touchées
Les jeunes ruraux sont plus souvent en situation d’emploi que les urbains mais ils sont également sujets à des phénomènes d’exploitation dans le travail de manière récurrente. Travailler sans contrat, être sous-payé, voire pas rémunéré du tout, est fréquent dans les parcours de vie de jeunes ruraux, en particulier chez les plus précaires. Parallèlement, les jeunes qui ne sont ni en emploi, étude ou stage (NEET) sont particulièrement nombreux dans les espaces ruraux. Ils représentent un quart des 18-24 ans, contre un cinquième en ville.
Les écarts entre hommes et femmes sont bien plus importants dans les campagnes. Si les territoires ruraux sont hétérogènes, on peut trouver chez les 15-24 ans, 32 % des femmes sont en activité contre 47 % des hommes. En ville, c’est 33 % des femmes de 15-24 ans et 40 % des hommes. Le chômage féminin peut être jusqu’à deux fois supérieur à celui des hommes dans certaines zones rurales.
Les inégalités territoriales, des politiques inadaptées et le manque d’intérêt jouent le jeu d’une pauvreté invisible et parfois trop silencieuse des jeunes en milieu rural. Leurs aspirations et leurs besoins semblent rarement pris en considération. Les politiques publiques à destination des jeunes sont urbanocentrées, et lorsque l’on s’intéresse aux habitants des territoires ruraux, il s’agit plus de « bricolage » administratif que de grands plans d’action adaptés et construits. On omet souvent la très grande hétérogénéité de ces espaces, et donc, de leurs besoins. Si la pauvreté semble numériquement plus faible dans les campagnes, elle cache d’autres phénomènes : « […] de stigmatisation, d’assignation territoriale et enferme dans une pauvreté silencieuse » comme le souligne Amélie Appéré De Sousa, qui a collaboré avec l’Observatoire Régional de Santé Bourgogne. Il est nécessaire de ne plus penser les espaces ruraux comme en périphérie ou à la marge des réalités contemporaines. Ces espaces représentent plus des deux tiers du territoire français.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Image by Daria Nepriakhina  from Pixabay.
from Pixabay.
Reporterre
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
France Nature Environnement AR-A
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Sauvage
Limite
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène
Présages
Terrestres
Reclaim Finance
Réseau Action Climat
Résilience Montagne
SOS Forêt France
Stop Croisières