Publié le 22.01.2026 à 13:24
A la suite de la publication de ce billet, j’ai reçu un message de Frédéric Martel, mentionné ici, exigeant que j’ajoute dans mon texte le renvoi vers sa réponse aux critiques qui lui étaient adressées, à défaut de quoi des poursuites pénales pourraient être engagées contre moi. Vous trouverez un renvoi vers ce texte dans le paragraphe concerné.
« ‘Le Mage du Kremlin’ (le film) est à peu près le meilleur cadeau que nous puissions faire au Kremlin (le vrai). »
J’ai posté ce commentaire hier sur les réseaux sociaux, en sortant de la projection du film d’Olivier Assayas, adapté du roman éponyme de Giuliano da Empoli. Je me dois d’expliquer.
Que les choses soient claires : je n’ai aucune compétence ni légitimité pour juger de la qualité cinématographique du film. Un bon film ou non, une adaptation réussie ou non : ce n’est pas mon propos. En revanche, en le regardant avec mes yeux de chercheuse travaillant sur les sociétés post soviétiques et sur la guerre russe contre l’Ukraine, je considère que ce film est dangereux.
Dangereux – je mesure mes mots – parce qu’en affichant une intention de dénoncer l’exercice du pouvoir autoritaire, il contribue à l’inverse à renforcer le récit russe, et aide le Kremlin à propager son narratif dans la société française.
La première chose que l’on voit du « Mage du Kremlin », c’est ce texte blanc sur fond noir qui affirme que les personnages et faits relatés dans le film sont fictifs. Et pourtant, malgré cette précaution soignée, tout le reste du film cherche à nous démontrer l’inverse: on est bien en train de parler de la Russie réelle.
Tout comme dans le livre, un certain nombre de personnalités politiques russes portent leurs noms réels – Poutine, Eltsine, Berezovsky, Setchine – et les acteurs cherchent à en reproduire le physique et les postures. Que le nom du personnage principal, Baranov, soit un pseudonyme et que sa biographie soit très différente du conseiller politique dont il est inspiré, Vladislav Sourkov, ne suffit pas à faire basculer la galerie des personnages du côté de la fiction. Le cinéaste ne s’en cache pas d’ailleurs : le personnage de Poutine est bien là pour figurer le Poutine réel. Méticuleusement, le film rejoue des scènes tirées des vidéos d’archives : la démission de Eltsine, l’inauguration de Poutine, le dîner au Royaume-Uni, la colère d’une mère lors du naufrage du sous-marin Koursk… . Enfin, ce sont des événements réels de l’histoire politique russe, annoncés en chapitres du film, qui le scandent de bout en bout. « Cette exigence sur la véracité historique est cruciale », confirme d’ailleurs le réalisateur dans Télérama. Message reçu: le film est perçu par la critique (et sans doute, le public), comme une analyse de la politique russe contemporaine.
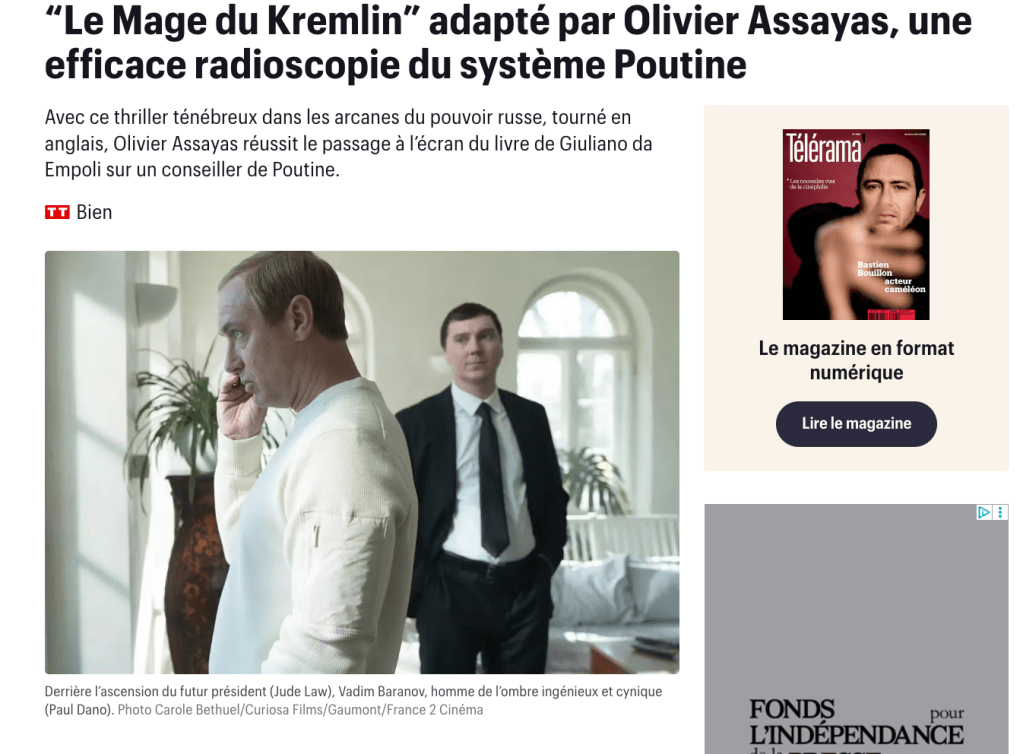
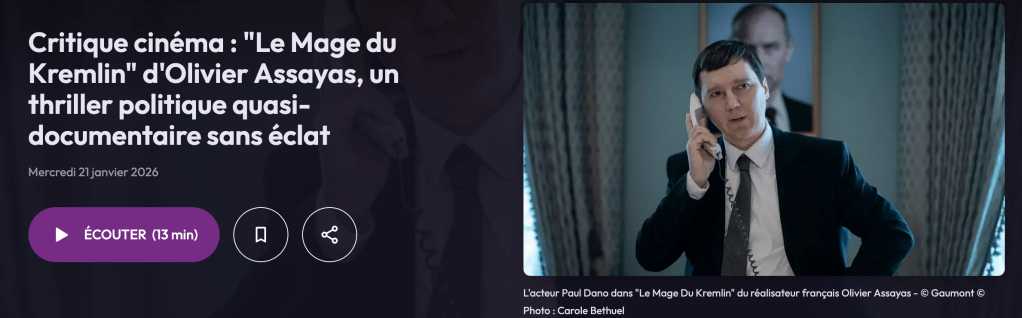

J’avais pu reprocher à Giuliano da Empoli d’entretenir dans son livre l’ambiguïté entre réalité et fiction, et de laisser penser aux lecteurs que ce roman était en fait une analyse de l’exercice du pouvoir en Russie. Lu comme un récit sur le pouvoir, c’est une magnifique fable orientaliste. Lu comme une réflexion sur la Russie, c’est un livre qui déforme et désinforme.
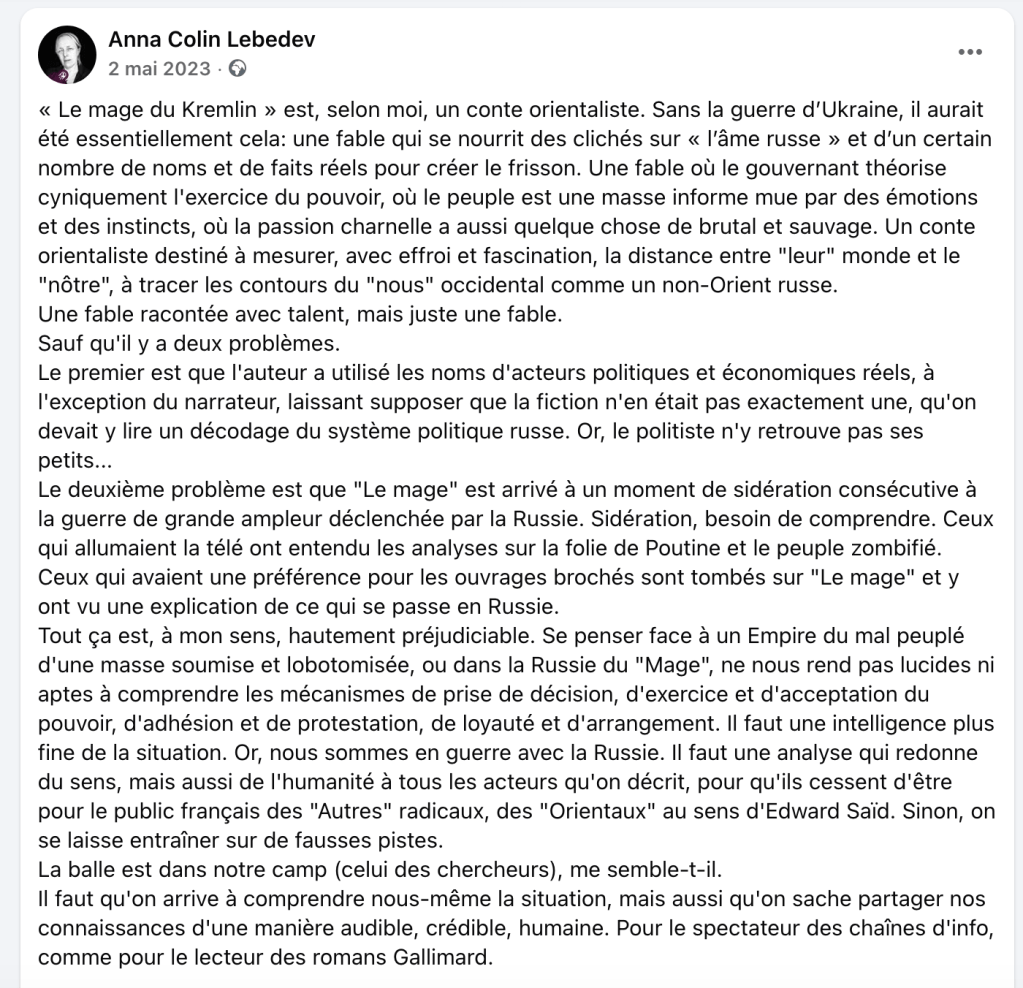
Dans le film, plus aucune ambiguïté n’est de mise : l’intention du cinéaste est d’expliquer le poutinisme. C’est une lourde responsabilité à un moment où la Russie nous fait la guerre, et où l’image de notre adversaire et la représentation de son pouvoir font partie de ses armes les plus puissantes.
Or, l’image de la Russie et du pouvoir russe transmise dans le film est exactement conforme à la manière dont Vladimir Poutine souhaite être perçu aujourd’hui à l’Ouest.
Olivier Assayas (et avant lui Giuliano da Empoli) lui font le cadeau du surnom « le Tsar », répété à l’envi dans le film, laissant supposer que les Russes parleraient ainsi de leur président. Ce qualificatif de « tsar » est en réalité un phantasme occidental, remontant probablement à Oliver Stone demandant en 2017 à Poutine s’il souhaitait être un nouveau tsar. Jamais je n’ai entendu ce mot dans la bouche des Russes pour parler de leur président. Le seul surnom qui colle à Poutine depuis plusieurs années maintenant est celui utilisé par l’opposition, « le vieux » (дед). Avouez que la connotation est un peu différente.
Mais parler de « tsar » est dans le film/le livre un signal très clair : nous sommes dans une verticalité parfaite entre un monarque et la masse de ses sujets, dont il comprend les aspirations profondes et dont il contrôle les élans et les choix. Des sujets qui ne comptent pas ; des sujets qu’on ne voit pas dans le film. Tout se passe au sommet et tout part du sommet. La machine du pouvoir montrée dans le film est huilée, fonçant à toute allure, sans échec possible.
Il est tout à fait dans l’intérêt du pouvoir russe que nous voyions ainsi la Russie : une société parfaitement dominée par un Kremlin surpuissant. Une lecture qui écarte comme négligeables ce que les spécialistes de la Russie décrivent depuis des années : un équilibre fragile où le Kremlin doit en permanence offrir à différents groupes sociaux des bénéfices pour maintenir l’adhésion, où la logique verticale se combine avec l’existence d’un système complexe d’interdépendances, de centres de pouvoir et de clans. Où le pouvoir n’a cessé d’étouffer les médias libres et de réprimer la prise de parole, et finit par être auto-intoxiqué et ne plus vraiment comprendre sa société, faute de capteurs honnêtes. Le vrai Poutine pense-t-il, comme son personnage de film, que les Russes admirent Staline non pas en dépit mais pour les répressions sanglantes qu’il a mises en œuvre ? Peut-être, mais si c’est le cas, il se trompe sur sa population. Le spectateur du film, quant à lui, risque d’entendre cette phrase comme une forme de vérité sur la société russe, expliquant son acceptation du pouvoir poutinien.
Vladimir Poutine pourrait également remercier Olivier Assayas de la stature d’homme d’État que lui offre le film. Que cela soit clair : on comprend que le réalisateur ne partage pas les idées de son « Poutine », et dit, par la bouche des personnages de Baranov ou de Ksenia, que les choix politiques du président russe sont moralement injustifiables. Et pourtant, il grandit le Poutine du film, seul homme d’envergure entouré de personnalités misérables, sous les yeux lucides de son alter ego, le conseiller politique Baranov. Khodorkovski le banquier devenu opposant (sous pseudonyme dans le film) est dénué de personnalité ; Setchine le bras droit est un petit carriériste. Berezovski le magnat des médias est curieusement conforme aux clichés de l’imaginaire antisémite : il est malin, cupide, aux petites mimiques nerveuses. Je ne sais pas si Olivier Assayas était conscient que le vrai Berezovski était juif, ou s’il s’est laissé prendre dans la représentation antisémite de cet homme, très répandue dans la société russe.
Le Poutine campé par Jude Law, à l’inverse, a une certaine grandeur. Il a une vision générale, là où les autres ont des petits intérêts ; il est spartiate et se contente d’une bouillie de céréales au lieu des (décadentes) coquilles Saint-Jacques que lui propose le serveur ; il a des amis fidèles et de longue date qu’il préfère aux courtisans ; il est sportif là où les autres se vautrent dans la débauche et l’alcool ; il prend les mesures impopulaires et cruelles, parce que conformes à ce qu’il perçoit comme l’intérêt du pays ; il est indifférent aux petites logiques politiciennes au nom de son grand projet politique. La fascination pour la grande figure sombre transpire dans le film, et magnifie Poutine en prétendant le dénoncer. Assayas n’est pas le seul aujourd’hui en France à se laisser porter par une telle fascination : la longue émission consacrée par Frédéric Martel à l’idéologue d’extrême droite Alexandre Douguine sur France Culture a fait l’objet de la même critique de la part de mes collègues et de moi-même.

Frédéric Martel avait fait valoir un droit de réponse dont je reproduis ici le lien à sa demande.
Nul doute que la personnalité du président russe a de quoi inspirer la fascination de l’artiste. Cependant, l’artiste ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur l’effet de son œuvre, et l’effet que produit le film est très flatteur pour le Kremlin : comment ne pas être effrayé et fasciné par la détermination, la pensée et la force de cet homme d’État, surtout comparé à un Trump inconséquent, ou encore à des leaders européens empêtrés dans des contraintes électorales et institutionnelles ?
Le message transmis par le film est saupoudré de l’habituelle imagerie sur la Russie : la neige (ok, ce cliché-là est vrai), les résidences en bois, le thé et le samovar, l’argent qui coule à flots, le yacht, le jet privé, les bureaux à la sombre ambiance stalinienne… La sauvagerie des hommes et l’intensité des émotions, la profondeur des réflexions et l’amour de la littérature et des arts. Quand on est un chercheur qui travaille sur la Russie, quand on est un Français qui connaît le pays, on prend l’habitude de soupirer avec résignation devant les romans, expositions, articles, séries télévisées qui alignent ces clichés. Nous avons l’habitude de l’engouement du public français pour cette représentation de la Russie, un mix orientaliste habituellement servi sous l’appellation d’ « âme russe ». Si je parle d’orientalisme (au sens d’Edward Saïd), c’est parce que cette image de la Russie est celle d’un Autre radical, la contrée sauvage de l’Est, traversée de violences et peuplée d’êtres mus par des pulsions si différentes des nôtres. Cet Autre nous effraie, nous fascine et nous rassure ; il est le reflet inversé de nous-mêmes.
L’orientalisme, nous enseigne Saïd, nous permet de nous dire, soulagés, que nous sommes différents de ces sauvages, et par le même mouvement nous empêche de comprendre les sociétés qu’on prétend décrire.
Le film dénonce le pouvoir poutinien et prétend le décortiquer, mais en même temps il empêche d’autant plus puissamment de saisir la Russie qu’il affirme la dévoiler. Avant l’agression de l’Ukraine, j’aurais considéré que ce n’était pas très grave, et qu’il fallait laisser aux artistes leur liberté de transmettre leur vision du monde, même en s’appuyant sur des clichés.
Aujourd’hui, les choses sont différentes. La Russie est en guerre contre nous. Les stratégies de désinformation et le façonnage des représentations sont des pièces centrales de l’arsenal qu’elle déploie en Europe de l’Ouest. Or, cela fait bien longtemps que l’État russe ne cherche plus à avoir une « bonne » image dans nos pays. Ce qu’il cherche en revanche à imposer, c’est l’image d’un Kremlin invincible, d’un leader puissant, déterminé et lucide, et d’une société sous contrôle, prête à déployer et à subir toute la violence nécessaire.
« Maintenant, j’ai encore plus peur de la situation actuelle », réagissait un spectateur après une avant-première du « Mage du Kremlin » à Arras. Tout ce que nous pourrons dire, en tant que chercheurs, sur les failles, la fragilité et la complexité de la Russie contemporaine, ne servira à rien face à la puissance de suggestion de ce film qui cartonne déjà en salles. Avec le soutien du « Mage du Kremlin », le message du Kremlin passe cinq sur cinq.
Publié le 03.07.2025 à 09:41
De la bonne manière de parler de l’ultranationalisme en Ukraine
Le sujet de l’extrême droite en Ukraine ne cesse de faire son come-back. Je me rappelle par exemple avoir parlé dans ce fil Twitter, dans les premières semaines de la guerre de haute intensité lancée par la Russie, du caractère récurrent de la dénonciation et de la focalisation sur le sujet.
Récemment encore, un reportage vidéo du Monde revenait sur la question, et identifiait des combattants, mais aussi des commandants charismatiques des régiments ukrainiens qui appartiennent ou appartenaient manifestement à des mouvements d’extrême-droite. Une enquête sérieuse? Oui. Et je ne vais pas accuser le journaliste auteur du reportage d’être au service de la propagande du Kremlin (d’ailleurs, il est tout à fait explicite sur ce point dans la vidéo).
Cependant, cette couverture me semble profondément insatisfaisante, car jouant essentiellement sur nos émotions et nos réflexes, plus que sur la réflexion et la compréhension de ce qu’on observe. Nous autres chercheurs en portons une part de responsabilité, car c’est à nous d’introduire de la profondeur dans un sujet qui parle en premier aux tripes. La question de l’extrême droite est aussi légitime à aborder sur le terrain ukrainien que sur le terrain russe, français ou américain, à condition de bien la traiter, en l’inscrivant dans son contexte, en la mettant en perspective et en s’appuyant sur une recherche de terrain. Sinon, on ne fait que réagir de manière réflexe à la volonté de Moscou de nous imposer ce sujet.
La discussion que nous avons conduite avec mon collègue Bertrand de Franqueville, publiée dans Le Grand Continent, adopte une démarche d’explication, pas de dénonciation. Bertrand a conduit une longue recherche en Ukraine sur les extrêmes politiques, à la fois de gauche et de droite , dans les milieux militants comme militaires. Cette profondeur de champ lui permet de réfléchir à l’histoire de ces mouvements, à leur ancrage dans le paysage politique ukrainien, à leur rôle dans la conduite de la guerre et à leur avenir politique. J’espère que la thèse de doctorat qu’il a consacrée à ce sujet sera bientôt publiée, et je renvoie également le lecteur désireux de continuer à approfondir le sujet à l’article en accès libre coécrit par Bertrand de Franqueville et Adrien Nonjon en 2023, portant sur le mouvement Azov, ou encore à cet ouvrage collectif, In the eye of the Storm, co-dirigé par Adrien.
Les mouvements ultranationalistes – vous allez le comprendre en lisant notre entretien avec Bertrand – ne sont pas un sujet central dans la vie politique ukrainienne. Ils ne sont pas non plus un non sujet. Mais ils cesseront de nourrir nos fantasmes à partir du moment où on aura une vision un peu posée de leur place dans la société. Tout ce que nous écrivons sur l’extrême-droite en Ukraine peut être (et sera) instrumentalisé par des acteurs pro-russes. Tout, sauf précisément ce qui introduit de la nuance et donne des outils pour comprendre.
Publié le 01.07.2025 à 08:04
« Sur le devant de la scène médiatique »
C’est un article que j’ai écrit il y a un an et demi déjà pour « Sociologies pratiques » et qui vient d’être mis en ligne
Je souhaitais partager mes réflexions autour d’une expérience personnelle forte, celle de ma soudaine et massive médiatisation suite à l’agression russe contre l’Ukraine. Même si j’étais déjà assez familière de l’interaction avec les journalistes, du jour au lendemain, l’intervention dans les médias est devenue, assez durablement, une partie conséquente de mon activité professionnelle. Si vous lisez ce billet, c’est sans doute un des effets de cette médiatisation et de la visibilité qu’elle m’a donnée.
Nous, les sociologues, avons une déformation professionnelle terrible. Tout est terrain d’enquête potentiel : la salle d’attente d’un médecin, la fête de famille, la réunion de travail… Alors, lorsque je me suis retrouvée en 2022 à enchaîner studios et plateaux et à répondre (ou pas) à une vingtaine de sollicitations par jour, j’ai assez vite pensé que ce que j’expérimentais était aussi un objet d’observation fascinant. Ce que j’observais, c’était ce processus de fabrication d’un discours sur la société selon des dispositifs bien particuliers, et dont j’étais un des acteurs. J’ai pris des notes. Quand j’y repense, c’était aussi une sorte de dédoublement qui me permettait de rendre plus supportable ce que je vivais. Alors que j’étais (et je suis toujours) profondément éprouvée et meurtrie par cette guerre, j’aurais pu m’horrifier de l’ambiance des plateaux où l’on se faisait la bise et on rigolait, avant de prendre un air grave à l’antenne pour parler de l’armée russe qui attaquait les villes ukrainiennes. Regarder cela en sociologue était apaisant. J’observais les inégales capacités des uns et des autres à peser dans le discours, je mesurais les contraintes et les ressources de chacun des acteurs engagés, j’essayais de comprendre les choix faits par les rédactions et la manière dont elles avaient construit leurs sujets. J’avoue: c’était aussi pour moi un réservoir à anecdotes dont je ponctuais ensuite mon cours de sociologie des médias. Assez rapidement, je me suis mise à tester des choses, et voir par exemple dans quelles conditions je pouvais co-définir, avec les journalistes, les questions qui méritaient d’être posées.
Aborder les médias en sociologue me permettait aussi de conserver une posture à laquelle je tenais: celle d’une relation mutuellement bienveillante avec les journalistes. Mon postulat de départ est toujours que les journalistes souhaitent bien faire leur travail, mais qu’ils le font dans un contexte de contraintes très fortes (même si elles sont inégalement fortes selon le média et le poste qu’ils y occupent…) C’est un travail que j’admire et dont les contraintes sont souvent méconnues. Nous avons tendance, dans ma communauté professionnelle, à attribuer la faute d’une interaction journaliste/chercheur qui tourne mal à l’un ou à l’autre des individus qui en sont partie prenante. Nous gagnerions vraiment à y voir des difficultés plus structurelles, inhérentes à l’exercice de chacun de nos métiers.
Tout ça pour vous dire que l’article que vous trouverez jusqu’à fin juillet en accès libre, est une réflexion modeste sur ces sujets qui me passionnent, à partir de mon expérience personnelle. Une autre sorte de « making of« : cette fois-ci, la fabrication du volet médiatique de mon travail.
Publié le 16.06.2025 à 15:28
« Ukraine, la force des faibles »: le making of.
Mon petit texte « Ukraine: la force des faibles » est sorti en librairie le 13 juin. Dans les présentations que je peux en faire ici et là, j’explique l’intention qui l’anime: faire comprendre comment la société ukrainienne s’est transformée pendant les dix années de guerre, et en quoi cette transformation très particulière a donné lieu à un mode très particulier de résistance armée .
J’entends d’ores et déjà, dans les premières questions qui me sont adressées, un doute. Serait-ce encore l’un de ces textes qui idéalisent la résistance ukrainienne, héroïsent la conduite de la guerre, cherchent à entraîner le lecteur dans l’admiration? Evidemment, ce sera aux lecteurs de trancher. Le texte est imprégné d’une émotion que je n’ai pas cherché à cacher.
Cependant, pour moi, ce petit essai n’est un pas un pamphlet, mais un carnet de terrain d’une enquête qui s’étale désormais sur dix ans. Une enquête conduite à Kyiv, Zhytomyr, Dnipro, Lviv, Vynnytsia, mais aussi Tchernivtsy, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson… Ce que raconte « Ukraine: la force des faibles », sous ce petit format qui ne permet pas une véritable démonstration de la preuve, ce sont quelques observations tirées de cette longue enquête. Je souhaiterais donner ici un aperçu de l’émergence de cette recherche et de sa cuisine interne.
J’aurais aimé emmener les lecteurs à travers ces dix ans de recherche en photos, mais je suis une photographe plutôt timide, et je demande rarement aux personnes que j’interroge l’autorisation de les photographier. Encore moins, paradoxalement, lorsque l’entretien s’est très bien passé, et qu’un véritable lien humain s’est tissé entre l’enquêteur et l’enquêté. Les images que je ramène de mes enquêtes sont prises à la va-vite, pour me permettre de garder une trace, vérifier une inscription, fixer une date, plutôt que pour les partager. Mes photos sont aussi très souvent kyiviennes, car dans cette ville qui m’est très familière, je suis d’autant plus sensible aux moindres changements du paysage urbain dans ces années de guerre.

En voici quand-même une. Nous sommes en juillet 2014, en plein centre ville de Kyiv, aux abords de la place de l’Indépendance, le Maïdan. La révolution du Maïdan s’est terminée, après des semaines d’affrontements meurtriers, quelques mois auparavant, mais les Ukrainiens mettront un certain temps à enlever les débris calcinés de la place. Ces débris sont les premiers mémoriaux aux manifestants tombés. Ils sont constellés de photos, fleurs, mots de condoléances. Je n’étais pas à Kyiv pendant les dernières semaines sanglantes de la révolution du Maïdan, et déambuler au milieu de ces débris calcinés de barricades était très émouvant pour moi. Pourtant, on n’était pas seulement à la fin d’une séquence importante pour l’histoire du pays, mais aussi et surtout au début d’une époque nouvelle. En ce juillet 2014, quelque chose de fondamental avait changé. L’annexion de la Crimée avait eu lieu. la guerre faisait déjà rage à l’est du pays, avec une Russie qui attisait l’insurrection dans le Donbass, mais intervenait aussi directement, militairement.

Quelques mois plus tard, les volontaires ramèneront et exposeront dans les villes ukrainiennes les carcasses calcinée des voitures, les blindés et les lance-roquettes russes ramenés du front de l’est. Quand je reviens en Ukraine en février 2015, j’assiste à cette exposition en plein air où se pressent les familles. Il y a pour moi à l’époque quelque chose d’un peu troublant de voir des enfants grimper dans les chars russes, et je me fais la réflexion que leurs parents ne réalisent sans doute pas qu’ils ne sont pas dans un musée de la guerre, mais dans une guerre au présent. Aujourd’hui, dans les villes ukrainiennes, on voit encore de tels trophées exposés. Mais je ne vois plus aucun enfant grimper dessus…

Je crois que l’un des objectifs était celui-là: faire prendre conscience aux Ukrainiens de la nature de cette guerre, et surtout leur faire comprendre que la Russie était en train d’agresser militairement l’Ukraine. Car dans cette année 2015, l’incertitude sur l’agresseur et sur la responsabilité sont parfois là, et certains Ukrainiens confessent leur difficulté à comprendre ce qui se déroule vraiment à l’est.

A côté des carcasses de blindés et des restes de missiles, une petite expo est montée dans des containers. « Preuves de l’agression militaire russe sur le territoire ukrainien ». Ce n’est pas par hasard que le titre est (aussi) en anglais: il s’agit entre autres d’interpeller la communauté internationale qui, à ce moment-là et pour de longues années, va faire tout son possible pour ne pas voir la Russie derrière les activistes séparatistes.

Cette guerre-là, entre 2014 et 2022, les Ukrainiens la conduisent seuls, sans soutien militaire international, et avec un soutien politique tiède de pays occidentaux encore sensibles à la vision russe de la guerre. C’est parce qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, parce que leur armée est défaillante et leur Etat fragile, que les Ukrainiens ordinaires, pour l’essentiel des civils, vont s’engager dans la conduite de la guerre.
Très rapidement en 2014, je commence à enquêter sur ces civils qui prennent les armes pour la première fois pour défendre leur pays, où qui s’organisent pour soutenir cette défense.

Les premiers que j’interroge sont mes anciens enquêtés, les vétérans de la guerre soviétique en Afghanistan, groupe avec qui j’avais fait des entretiens en 2010-2011. J’avais déjà visité, lors de ma première enquête, le petit musée de leur association kyivienne, où ils avaient exposé des objets militaires de l’époque soviétique. Quand je reviens les voir en 2015, le musée est transformé en entrepôt où, à côté des artefacts soviétiques, s’empilent les uniformes et pièces d’équipement neufs achetés par eux qui attendent d’être apportés sur le front: pantalons chauds, casques en kevlar (terme qui fait alors son entrée dans mon vocabulaire) et d’autres objets que je n’arrive pas à l’époque à identifier. J’ai pris cette photo dans une pièce trop sombre, parce que je voulais absolument garder l’image de la vieille mitrailleuse soviétique Maxim, à l’arrière de la photo, qui contrastait tellement avec les objets neufs d’une guerre nouvelle. Dix ans plus tard, j’ai vu une Maxim similaire dans la caserne d’une unité de défense locale composée de civils, dans une petite ville ukrainienne. En 2025, cette Maxim-là n’avait rien d’une pièce de musée: très efficace pour abattre les drones, m’expliquaient les combattants qui lui avaient fabriqué une nouvelle tourelle sur mesure.
En 2014, « mes » vétérans d’Afghanistan faisaient partie des rares groupes de personnes qui, en Ukraine, avaient une expérience quelconque d’une guerre. Bien que plutôt âgés pour combattre – la cinquantaine, voire la soixantaine – un certain nombre d’entre eux avaient choisi de partir au front. D’autres avaient décidé de les soutenir: équiper, armer, ravitailler. Et parfois, les deux à la fois: prendre les armes quelques jours ou quelques semaines; puis revenir à l’arrière et collecter de l’équipement pour le prochain voyage vers le front. J’avais fait de mon enquête sur ces vétérans reprenant les armes un article, intitulé « D’une guerre à l’autre: Les vétérans d’Afghanistan dans le conflit armé dans le Donbass ».

Mais déjà, je voyais partout en Ukraine émerger une nouvelle génération de combattants et un tissu associatif soutenant la guerre. On voyait se former en Ukraine des bataillons volontaires, se substituant aux unités insuffisantes de l’armée régulière. J’ai commencé à interroger ces combattants qui, à partir de 2015, rentraient progressivement du front. On voyait aussi également émerger des initiatives de soutien au front à l’arrière, parfois structurées en associations, parfois plus flexibles. Souvent d’ailleurs, les personnes à l’origine de ces initiatives étaient elles aussi des anciens combattants.
Financés par toutes sortes de donateurs – mais très peu l’Etat – et composés de civils qui n’avaient pas de statut de militaire des forces armées de l’Ukraine, les bataillons volontaires étaient très visibles dans l’espace public en Ukraine.

Les bataillons, comme « Donbass » dont on voit une voiture sur cette photo de février 2015, collectaient de l’argent, et des associations à l’arrière se chargeaient de faire circuler les cagnottes, d’identifier de quoi les combattants avaient besoin, de soutenir les familles. Les bataillons ont été assez vite intégrés dans l’armée régulière. En 2017, j’avais publié une étude sur ces groupes armés et leur place dans la conduite de la guerre.
En février 2015, les accords de Minsk 2, signés dans des conditions favorables à la Russie, ont marqué la fin de la première période de la guerre russo-ukrainienne, en la faisant entrer dans une seconde longue période, celle de la guerre de basse intensité qui durera sept ans de plus.
Ces sept années-là sont un angle mort pour la société française. C’est une période où les journalistes français avaient du mal à vendre à leurs rédactions un papier sur la guerre dans le Donbass qui n’intéressait pas grand-monde. « Ah bon, la guerre continue? », me demandait-on également en France quand je rentrais d’Ukraine. Pourtant, si la guerre était cantonnée à l’est du pays (et je ne suis jamais allée sur les zones de front), j’en voyais les traces sur tout le territoire de l’Ukraine. Une guerre « discrètement omniprésente », ai-je écrit dans un article, et c’est cela que me permettait l’approche sociologique et la longue fréquentation du terrain: voir la présence de la guerre là où un observateur de passage n’aurait pas remarqué la différence. Parfois, notre premier capteur, c’est ça: la sensation que dans un endroit qu’on connaît bien, dans un groupe qu’on connaît bien, quelque chose a changé.
En Ukraine, en réalité, le changement était massif, et il était porté par plusieurs groupes sociaux qui se recoupaient partiellement : ceux qui s’étaient engagés aux côtés la révolution du Maïdan; ceux qui étaient partis combattre dans le Donbass et qui revenaient à la vie civile; ceux qui avaient été forcés à fuir de chez eux ou à changer de vie du fait de la guerre. Puisque je continuais mon enquête sur les civils qui prenaient les armes, c’est surtout avec les combattants et anciens combattants que j’ai conduit mes enquêtes, mettant un pied dans un réseau de plus en plus vaste d’associations, groupements informels, entreprises, services ministériels, tous liés à la conduite de la guerre ou à la prise en charge des effets de la guerre. Après les entretiens, nous restions souvent en contact avec mes enquêtés; c’était d’autant plus facile que beaucoup d’entre eux étaient de milieux sociaux urbains et éduqués, proche du mien, et qu’à force, nous avions de plus en plus de connaissances en commun. Je suivais de loin, souvent sur les réseaux sociaux, les projets dans lesquels ils s’engageaient, liés à la réforme de l’Etat et de l’armée, à la défense et à la prise en charge des vétérans et des populations vulnérables, à l’information et à la culture comme vecteurs pour dire la guerre. J’en décris un petit nombre dans « La force des faibles », mais il y en aurait tant d’autres dont l’histoire mérite d’être racontée. Tout au long de ces années, jusqu’au Covid, nous essayions d’emmener des doctorants et post-docs, réunis en école d’été que nous organisions avec un groupe de collègues, voir l’une ou l’autre de ces associations.

Un exemple de ces associations, « Station Kharkiv« , lieu d’accueil pour les déplacés internes, créé en 2014, que nous sommes allés voir avec les étudiants lors de notre école d’été dans cette ville en 2016, deux ans après le début de la guerre. Les deux femmes que vous voyez au fond de la photo sont toujours aux manettes d’une association qui s’est élargie et professionnalisée entre 2014 et 2022. Dès les premiers jours de mars 2022, Station Kharkiv était en train de collecter des vivres et des médicaments, et de les livrer aux personnes vulnérables qui se sont trouvées plus isolées que jamais. Dans les premiers jours de l’invasion russe, l’association avait d’ailleurs perdu l’une de ses jeunes bénévoles, victime d’une attaque de missile.

D’autres groupes sont plus directement impliquées dans la conduite de la guerre. C’est par exemple le cas de « Notre bataillon », association fondée par un entrepreneur de la ville de Tcherkassy qui s’est engagé dans l’aide à l’armée lorsque l’un de ses salariés est parti au front. En 2014, la petite ONG se donne pour mission de parrainer et approvisionner « son » bataillon. Petit à petit, elle élargit son action à d’autres unités. La photo ci-dessous du stand de l’association a été prise en 2017, lors d’une journée de rencontre de vétérans et d’ONG. Quand on regarde la photo, tout ça a l’air très artisanal, et je trouve que c’est ça qui est intéressant: le soutien à l’armée part d’une toute petite échelle, puis se développe, se professionnalise, se structure.

Les bénévoles se forment aux besoins des forces armées, deviennent compétents en équipement militaire. Des liens solides se tissent entre l’armée et la société à l’arrière. Tout comme « Station Kharkiv », « Notre bataillon » se met immédiatement en action et s’ajuste aux nouveaux besoins qui émergent avec l’agression de février 2022. L’ONG continue à approvisionner le front aujourd’hui.
Ces initiatives sont une illustration de ce que je décris dans « La force des faibles »: quand la Russie tente d’envahir l’Ukraine en février 2022, la société ukrainienne est aussi prête qu’elle peut l’être, car elle a derrière elle huit ans de développement d’une société civile engagée dans la guerre.
« Ce que je trouve formidable dans notre société, me disait en 2024 autour d’un thé une collègue et amie ukrainienne, c’est que je sais que pour chaque problème qu’un citoyen pourra rencontrer, il y aura un groupe ou une association qui sera là pour l’aider. » Je suis d’accord avec elle, mais j’aurais pu compléter sa phrase: « … parce que l’Etat ne sera pas forcément là. » Le point de départ de « La force des faibles » est précisément dans ce paradoxe: si les Ukrainiens étaient aussi actifs, aussi innovants, aussi engagés, c’est parce qu’ils ne pensaient pas pouvoir se reposer sur leur Etat. Ni pour conduire la guerre, ni pour construire une armée performante, ni pour prendre en charge les plus fragiles. C’est de leur cheminement que je donne un aperçu dans le petit livre.
Beaucoup de collègues ont travaillé sur les mouvements associatifs qui ont émergé à partir de 2014. Je cite notamment dans le petit livre les travaux de Ioulia Shukan et d’Anastasia Fomitchova (dont on lira d’ailleurs bientôt un témoignage personnel). Pour ma part, je me suis tout particulièrement intéressée au parcours des civils, hommes et femmes, qui ont pris les armes depuis 2014. Pour moi, leur rôle a été crucial dans l’évolution des forces armées ukrainiennes et la préparation de la société à la guerre de haute intensité. J’ai consacré un article à cet « état de qui-vive » qui caractérise ces anciens combattants dans les années 2015-2022. Mais si cette action a pu se déployer, c’est parce qu’un lien entre les initiatives privées / associatives et l’Etat s’est tissé. Ce lien, je l’observais déjà en 2015-2022, par exemple via l’intégration des anciens combattants dans les institutions locales et centrales, autour de projets liés à l’armée ou aux vétérans.

C’est le cas par exemple de Ivan, jeune homme à droite de la photo, enseignant en informatique à l’université dans la ville de Dnipro, mobilisé dès le mois d’avril 2014 en tant que chef de peloton blindé. Quand il est démobilisé après une année sur le front, il est immédiatement invité par l’administration régionale a prendre la tête du Centre d’aide aux vétérans nouvellement créé. Lorsque nous nous rencontrons en 2017, cela fait deux ans à peu près qu’il occupe cette fonction. (Mes qualités de photographe sont encore une fois clairement démontrées sur l’image ci-dessous).

Dans les années suivantes et jusqu’à aujourd’hui, Ivan a pris en charge les projets de résilience et de sécurité numérique dans l’administration régionale, cette « ligne de front numérique » qui concilie son expérience militaire et sa spécialisation universitaire. Pour lui, le passage de l’armée à l’administration a été durable et facilité par sa position sociale. Pour d’autres personnes, la coopération avec l’Etat a été plus brève ou plus houleuse, mais en tout cas ce va-et-vient entre le front et l’arrière, la société civile et les institutions publiques est l’un des mécanismes au cœur de l’agilité et de l’adaptation de l’Ukraine à la guerre. J’y porte une attention particulière dans les enquêtes de terrain que je conduis aujourd’hui.
Beaucoup de mes enquêtés sont, comme Ivan, urbains, éduqués, internationalisés. J’ai très vite identifié ce biais de mon enquête: la proximité sociale avec les personnes que j’interroge. Comme je suis une sociologue consciencieuse, j’ai constamment cherché à élargir le cercle d’interviewés, pour voir des personnes avec qui nous avions moins de choses en commun. Et pourtant – je m’en rends compte maintenant – la proximité sociale a aussi été une ressource pour la recherche. Mes enquêtés n’étaient pas seulement proches de moi par leur position socioprofessionnelle; ils me ressemblaient parce que nos vies avant la guerre étaient similaires, dans les années où j’avais vécu en Ukraine. On avait peut-être eu des loisirs semblables, on avait vécu un quotidien semblable. Avec certains d’entre eux, les plus âgés, on avait eu des enfances semblables, même si la mienne était à Moscou alors que la leur se déroulait en Ukraine. Du fait de cette proximité, je ressentais d’autant mieux le choc de la guerre, la difficulté des choix qu’ils ont dû faire, les forces et les fragilités qui en ont été les conséquences. Oui, en tant qu’être humain, j’ai une admiration pour beaucoup de ces hommes et de ces femmes. Quels que soient mes efforts d’objectivation et de prise de distance, cette admiration, je n’arriverai pas à – et je n’aurai pas envie de – m’en défaire.
Cependant, « La force des faibles » n’est pas un hommage que je leur rends. C’est plutôt une tentative de démystifier la vision que l’on peut avoir de résistance d’une nation. Non pas glorifier la résistance, mais comprendre les mécanismes individuels et collectifs qui rendent une société prête à résister. Mais il y a un autre aspect de mon enquête qui est très présent dans ce texte. C’est cette question que je me pose d’entretien en entretien, d’observation en observation: et moi, qu’aurais-je fait à leur place? Que ferais-je dans un tel moment de grand bouleversement? Le jour où je finaliserai le grand manuscrit tiré de cette recherche, je m’en sortirai peut-être en mettant en œuvre des dispositifs de distanciation et de prise de conscience de la position sociale de l’enquêteur. J’évacuerai d’une manière ou d’une autre cette question troublante. Mais aujourd’hui, dans « La force des faibles », je ne souhaite pas l’évacuer, car il faut laisser son espace au trouble que suscite cette question essentielle : qui serions-nous, face à l’inconcevable?
Publié le 01.04.2025 à 18:40
160 000 jeunes Russes appelés sous les drapeaux: comment lire ce chiffre ?

La « conscription du printemps », campagne semestrielle d’appel de jeunes hommes sous les drapeaux de l’armée russe démarre en ce début d’avril, et c’est rare que je laisse passer un cycle sans faire un petit commentaire.
Le début de la campagne de conscription a fait hier l’objet de brèves dans beaucoup de médias, sans que la raison pour laquelle on en parle soit explicite… Le sous-entendu derrière est que l’armée russe se renforce, puisque le message essentiel est l’augmentation du nombre d’appelés visé: 160 000, un objectif record. Mais est-ce comme ça qu’il faut le lire?
En premier lieu, si augmentation il y a, elle est plutôt graduelle:
| Campagne d’appel | Nombre d’appelés visé |
| Printemps 2025 | 160 000 |
| Automne 2024 | 133 000 |
| Printemps 2024 | 150 000 |
| Automne 2023 | 130 000 |
| Printemps 2023 | 147 000 |
Plus qu’à la campagne précédente, il faut comparer les chiffres à la saison précédente: le printemps 2025 doit être comparé au printemps 2024 plutôt qu’à l’automne 2024. En effet, l’appel du printemps a traditionnellement des objectifs chiffrés supérieurs, car il touche notamment les étudiants qui viennent d’être diplômés (ou radiés) à la fin de l’année scolaire, et deviennent donc mobilisables, alors qu’ils bénéficiaient d’un sursis pendant le temps de leurs études. L’augmentation de la cible entre les printemps 2024 et 2025 est de 10 000 appelés; ce n’est pas rien, mais ce n’est pas énorme non plus. Rappelons que l’âge maximal de la conscription est, depuis le 1er janvier 2024, passé à 30 ans au lieu de 27 auparavant. L’augmentation graduelle du nombre de conscrits peut donc relever d’un rattrapage du surplus qui devrait être généré par l’ajout d’une cohorte supplémentaire? En tout cas, l’augmentation n’est pas illogique.
Au-delà de ces considérations un peu techniques, la question que les commentateurs se posent est peut-être: ces 160 000 sont-ils des combattants potentiels sur le front ukrainien?
La réponse est oui. Pas tant parce que les conscrits seront envoyés sur le front (même si dans les faits, un certain nombre le sont, et des cas de conscrits morts au combat émergent régulièrement), que parce que les conscrits sont un formidable vivier de recrutement sous contrat pour l’armée russe. Depuis le début de la guerre, et avec une intensité croissante, on constate une pression sur ces jeunes garçons pour signer un contrat – j’en parlais en octobre dernier dans cet article. La législation permet désormais à l’armée de les recruter dès le début de leur service (là où il fallait 4 mois de formation avant), et ce public est particulièrement vulnérable. Nous n’avons cependant aucune donnée chiffrée qui nous permette de dire quelle proportion de conscrits se retrouve en définitive enrôlée sous contrat.
L’Etat russe peut-il aller au-delà, et augmenter considérablement ses capacités de recrutement? La réponse ici est tout autant politique que logistique. Les nouveaux conscrits, comme les nouvelles recrues sous contrat, doivent être logés, équipés, entraînés. Le recrutement lui-même mobilise de la ressource humaine et administrative. Le passage à un système de convocations électroniques – dont on ne sait trop s’il est vraiment opérationnel et s’il va être massivement utilisé – devrait dégager un peu de personnel recruteur. Mais il faudra probablement toujours aller chercher les récalcitrants et organiser une battue aux appelés à la fin de la période de conscription, pour être sûrs de remplir les quotas fixés. Or, les autorités militaires sont aussi activement engagées dans l’organisation du recrutement de soldats sous contrat, avec une pression forte de la hiérarchie. Je ne suis pas certaine que l’administration militaire ait tout simplement les capacités matérielles et humaines à recruter beaucoup plus, en un temps plutôt court.
Quoi surveiller dans cette campagne de recrutement? Probablement cette base de données électronique des citoyens au regard de leur obligation militaire. Le nouveau système offre en théorie à l’armée des données actualisées sur les conscrits potentiels, et des outils de sanction en cas de non réponse à la convocation militaire. Donnera-t-elle à l’Etat russe des moyens de coercition vraiment plus efficaces – et réutilisables dans le cas d’une nouvelle vague de mobilisation militaire? Jusqu’à maintenant, la preuve n’en a pas été apportée, mais peut-être que cette campagne de conscription changera la donne. En tout cas, elle donnera forcément des informations utiles sur les capacités organisationnelles de l’armée russe… mais elle fournira aussi beaucoup d’éléments sur la volonté des citoyens russes à servir ou à échapper au service militaire.
Publié le 14.02.2025 à 11:44
Le coût de la paix pour la Russie
On parle souvent du coût de la guerre pour la Russie: en dépenses pour la défense, en impact des sanctions, en hommes. On ne réfléchit pas assez au coût inverse, celui du risque politique qu’entraînerait, pour le pouvoir russe, l’arrêt des combats. Quelques notes rapides pour évoquer cet aspect rarement abordé.
Le premier risque politique est lié à la démobilisation des combattants actuellement engagés sur le front. La Russie a traité avec une grande violence l’ensemble des hommes qu’elle a engagés dans la guerre. Les militaires sous contrat que comptait l’armée en 2022 ont été cloués au front par une transformation de leurs contrats en engagement à durée indéterminée, sans possibilité de démissionner. Les mobilisés, civils recrutés de force en 2022 et envoyés au front dans des conditions terribles, y demeurent toujours deux ans et demi plus tard. Les nouveaux soldats sous contrat bénéficient, certes, d’une rémunération confortable, mais ne sont ni correctement formés, ni correctement équipés, ni traités avec respect.
Démobiliser ces hommes, même en les glorifiant, et les laisser revenir dans la vie civile, c’est prendre le risque de voir le récit des facettes sombres de la conduite de la guerre se diffuser dans la société. C’est aussi devoir faire face à des centaines de milliers d’hommes qui pourraient en vouloir à leur pouvoir politique, qui sont profondément traumatisés, et qui savent désormais manier les armes. Le Kremlin a en partie conscience du problème et met en place de modestes politiques d’intégration des vétérans dans la vie civile, mais vu le contour de ces dispositifs, ils risquent de se révéler très insuffisants. Le pouvoir russe s’est refusé jusqu’à maintenant de démobiliser le moindre combattant et essaiera, autant que possible, de reculer le moment de la démobilisation.
Le second risque politique est la conséquence d’une transformation du système de rentes et de rétributions liées à la guerre. La croissance affichée par l’économie russe est une croissance nourrie par la conduite de la guerre. L’économie s’est recentrée sur la commande militaire, les actifs économiques ont été redistribués et réorganisés pour faire face aux sanctions. La guerre et les sanctions ont frappé beaucoup d’acteurs économiques, mais représentent également une nouvelle rente pour beaucoup d’autres. Si la Russie veut maintenir l’apparence de solidité économique et garder la loyauté des élites, elle ne peut se permettre, dans les années qui viennent, de sortir de ce modèle économique centré sur la conduite de la guerre.
Le troisième risque politique est celui des territoires qui resteraient sous occupation russe. L’expérience d’intégration des territoires saisis par la force par la Fédération de Russie se limite aujourd’hui à la Crimée; or, celle-ci a été annexée dans des conditions très différentes, avec un usage limité de la violence et les faveurs d’une partie de la population. Installer l’État russe sur les territoires conquis depuis 2022 sera un défi d’une autre taille, car la population de ces régions a une forte conscience de vivre sous occupation militaire. La violence, notamment contre les civils, y est considérable: le pouvoir russe n’a pas le consentement des habitants de ces régions. A certains égards, la situation risque d’y être plus proche de la Tchétchénie en 1995 que de la Crimée en 2014. C’est une guerre diffuse que la Russie devra conduire dans les territoires annexés.
Pour les républiques séparatistes du Donbass, j’ai beaucoup plus de difficultés pour l’instant à évaluer la situation et à faire des projections. Ces régions qui ont été dévastées et maltraitées depuis 10 ans, mais j’ai peu de sources fiables pour prendre le pouls de ce qui s’y passe et de la manière dont les habitants qui y vivent encore se projettent dans l’avenir.
Existe-t-il un risque réputationnel, où Poutine pourrait être accusé par son entourage de ne pas avoir atteint ses objectifs de guerre? Ce risque me semble limité, car en cas de cessez-le-feu ou d’un autre type d’accord, le pouvoir aura sécurisé sa victoire principale: arriver à faire admettre aux Occidentaux qu’ils sont impuissants face à la Russie.
Les trois risques structurels que j’ai pointés ici me semblent en revanche sérieux. Ils peuvent, me semble-t-il, amener la Russie à privilégier tout scénario où la guerre ne s’arrête pas vraiment, où le pouvoir peut garder un gros volume de forces armées mobilisé, investir dans la consolidation de l’industrie militaire et dans la production massive d’armes, maintenir une occupation militaire (plutôt qu’une administration civile) dans les territoires annexés.
On a souvent dit que la Russie n’avait pas intérêt à une négociation autre qu’une capitulation, parce qu’elle se voyait en train de gagner sur le front. Mais la Russie est aussi dans une situation politique interne qui la pousserait plutôt à éviter les scénarios de paix durable qui seraient paradoxalement aujourd’hui plus déstabilisateurs que la guerre. Le scénario le plus favorable au Kremlin, celui qui lui permettrait de garder le contrôle interne, serait celui d’une baisse de l’intensité de la guerre sans démobilisation, sans abandon de la rhétorique guerrière, et sans ralentissement de l’économie de guerre et du réarmement. Une guerre moins coûteuse en hommes et en armes, plus confortable pour l’économie, moins stressante pour la population, mais toujours une guerre.
Un cessez-le-feu instable et régulièrement violé serait peut-être le meilleur cadeau que l’on pourrait faire aujourd’hui au Kremlin.
Publié le 27.01.2025 à 09:15
Il n’a jamais été simple de parler du Bélarus en France sans tomber dans le cliché. La formulation « dernière dictature d’Europe » a encore été reprise par les médias aujourd’hui pour évoquer le scrutin présidentiel qui s’est tenu dimanche, et j’en veux un peu aux journalistes pour cette paresse intellectuelle.
« Dernière dictature d’Europe » était une formule confortable pour se rassurer sur le processus de démocratisation qui aurait été en voie de généralisation sur le continent européen; certes, à des vitesses variables, mais quand-même quasiment certain. Le Bélarus faisait alors office d’épouvantail et de dernier bastion d’un monde en cours de disparition. Cela empêchait de voir les dynamiques réelles sur place (et de s’interroger par exemple sur la manière dont la stabilité, les politiques sociales et le progrès économique pouvaient atrophier la sensibilité politique). Cela faisait aussi du bien à l’égo européen.
Nous n’en sommes plus là aujourd’hui, bien évidemment, et dans un contexte de montée d’attractivité des autoritarismes, le Belarus est plutôt un cas d’école qui devrait attirer notre attention. Dire que l’élection présidentielle qui vient de s’écouler était un simulacre, c’est à la fois vrai et stérile, parce que c’est une manière de dire « point, à la ligne, on passe à autre chose » qui neutralise toute volonté de compréhension.
Malheureusement, la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine m’a empêché d’être suffisamment vigilante sur le Bélarus pour livrer une analyse approfondie. Ce que je dis est à prendre avec des pincettes; ce sont des pistes à creuser.
Un régime politique autoritaire fonctionne grâce à un certain dosage de coercition et d’adhésion; il doit non seulement mettre en place une répression suffisamment forte pour bloquer les oppositions, mais aussi distribuer suffisamment de bénéfices pour susciter l’adhésion. Plus le ratio est en faveur des bénéfices, plus le pouvoir est stable; plus il penche du côté répressif, plus le régime est fragile. Pendant longtemps, le régime politique du Belarus s’est attaché à distribuer beaucoup de bénéfices à la population, notamment à travers des politiques sociales, des politiques de développement et une promesse de stabilité et de prévisibilité. Les Bélarusses vivaient – économiquement – plutôt mieux que beaucoup de leurs voisins, et en avaient conscience. Le prix politique à payer apparaissait donc comme acceptable.
Evidemment, le soutien de la Russie était et reste l’exosquelette du régime bélarusse, aussi bien d’un point de vue politique qu’économique.
Les protestations massives de 2020 étaient intervenues dans le contexte d’une certaine fragilisation du modèle, et notamment d’une perception du régime comme moins protecteur, mais aussi en décalage avec les demandes de la société. Les répressions violentes qui ont suivi et qui se sont maintenues tout au long des années suivantes ont fait basculer le ratio répression/bénéfices en faveur de la répression. Cette période violente va compter dans l’histoire politique bélarusse: on ne le perçoit pas encore, mais elle a donné naissance à une expérience différente, moins marginale de l’opposition politique, de la répression et de la prison. Elle a aussi permis de structurer une opposition à l’étranger et de lui donner des canaux de prise de parole. Derrière les apparences de « il ne se passe rien », le Belarus est en réalité bien plus prêt qu’en 2020 à entamer une transition politique, avec une nouvelle génération de citoyens jetés avec violence dans la politique.
Cependant, et paradoxalement, c’est la guerre en Ukraine qui a redonné de la stabilité au régime bélarusse. En effet, dans un contexte où la Russie essaie de toutes ses forces de faire du Bélarus un cobelligérant, il y a des choses que Loukachenko a réussi à protéger. Certes, des unités armées russes et des complexes d’armement sont désormais basés au Belarus, qui sert de base aux attaques contre l’Ukraine. Cependant, aucune unité armée bélarusse ne combat aux côtés de la Russie contre l’Ukraine. Pensez au paradoxe: des soldats nord-coréens, mais pas de soldats bélarusses, alors que le pays se déclare être le plus proche allié de la Russie. Le territoire du Bélarus reste un territoire en paix. Cela, les citoyens savent qu’ils le doivent en partie à Loukachenko… mais aussi en partie aux Ukrainiens qui ne désespèrent pas de retourner les Bélarusses contre Moscou, et qui ne les perçoivent pas de la même manière que les Russes.
La politique menée par Loukachenko vis-à-vis de la Russie a été caractérisée par un de mes anciens collègues bélarusses par la formule suivante: « on dit oui à tout, puis on bureaucratise au maximum le processus pour finalement ne rien faire ». C’est aussi une stratégie que les Bélarusses appliquent au quotidien vis-à-vis de leur Etat. Il y a une certaine résilience stratégique de la société bélarusse qu’on ferait bien de souligner. Ne nous laissons pas tromper par cette apparence de calme plat: le Bélarus n’est pas la Russie et suivra une dynamique qui lui sera propre.
Publié le 04.12.2024 à 18:19
Recruter pour le front en Russie et en Ukraine: deux articles
Je suis un peu négligente dans la mise à jour de ce site, toutes mes excuses.
Je me permets de partager deux articles récents qui traitent tous deux du recrutements de combattants, en Russie et en Ukraine. Les deux partagent un point de départ: on ne mobilise pas des hommes pour combattre et perdre potentiellement la vie sur le front comme on mobilise une ressource financière, ou comme on sort des stocks un armement qui attendait d’être utilisé. Recruter des combattants engage fortement les sociétés, avec leurs valeurs, mais aussi leurs peurs et tabous.
Dans The Conversation, je m’interroge sur les raisons pour lesquelles le pouvoir russe n’a pas encore pris la décision d’envoyer des conscrits sur le front.
Dans l’article du Grand Continent, je propose une analyse des difficultés de recrutement militaire en Ukraine, au-delà des analyses courantes – que je pense erronées – qui voient dans ces analyses une preuve de la démotivation des Ukrainiens.
Publié le 22.02.2024 à 08:26
Anna Colin Lebedev, politiste : « Les Ukrainiens ont bien des choses à reprocher à Navalny »
Tribune parue sur le site web du journal Le Monde le 19 février 2024, et dans le journal papier du 21 février 2024.
Le décalage dans la perception de la mort de l’opposant entre les Russes et les Ukrainiens éclaire sur la complexité des relations entre ceux qui font pourtant face au même ennemi, Vladimir Poutine, analyse l’universitaire, spécialiste des sociétés postsoviétiques, dans une tribune au « Monde ».
Dans les fils de mes réseaux sociaux, ce 16 février, deux mondes. D’un côté, mes contacts russes, abasourdis, endeuillés, écrasés par le chagrin de l’annonce de la mort de l’opposant Alexeï Navalny dans la colonie pénitentiaire où il purgeait une peine infligée par l’appareil répressif russe. Des portraits de Navalny, des photos prises sur les sites de commémoration spontanée où les Russes viennent se recueillir. De l’autre, le fil de mes contacts ukrainiens, écrasés par l’inquiétude et la fatigue, bouillonnants de colère, partageant les nouvelles du front, commémorant les civils et les soldats tués dans les frappes russes, collectant de l’argent pour acheter des drones ou de l’équipement militaire. Aucune trace d’Alexeï Navalny dans ces messages, mis à part, de temps à autre, un commentaire ironique sur sa mort, maniant cet humour noir et cruel qui aide les Ukrainiens à tenir dans la guerre.
Ce décalage profondément troublant n’a rien d’anecdotique. Il permet de prendre la mesure de la complexité des relations entre les Ukrainiens et les Russes opposés à la guerre, qui font pourtant face au même ennemi, le Kremlin. La figure de Navalny est le révélateur d’une incompréhension profonde de l’autre, dont les racines plongent bien plus loin que 2022.
D’Alexeï Navalny les Russes retiennent l’indéniable courage, la ténacité dans l’opposition au régime poutinien, la capacité à insuffler une foi dans un avenir meilleur. Si sa personnalité et ses choix politiques n’ont pas toujours fait l’unanimité dans les cercles opposés à Poutine, depuis son retour en Russie, en 2021, Navalny a acquis une stature symbolique qui a gommé les doutes et les clivages. De sa prison, il était devenu le leader de l’opposition russe.
Les Ukrainiens, pourtant, ont bien des choses à reprocher à Navalny. La première d’entre elles est sa position ambiguë sur l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie, en 2014. Tout en reconnaissant une violation flagrante des normes internationales, sur la radio Echo de Moscou, l’opposant avait suggéré aux Ukrainiens de ne pas se faire d’illusions : « La Crimée restera une partie de la Russie et ne ferait plus, dans un avenir prévisible, partie de l’Ukraine. » Aux yeux des Ukrainiens, cette posture revenait à reconnaître de fait l’annexion.
Contentieux profond
Si Navalny a cherché, par la suite, à nuancer sa position, évoquant le projet de décider du sort de la péninsule par un référendum, les Ukrainiens étaient loin de se satisfaire de cette idée, qui entretenait la vision d’une Crimée peuplée par des citoyens russes et gommait la nature violente de l’imposition d’un gouvernement russe sur place. Ce n’est qu’en 2022, déjà derrière les barreaux, que l’opposant russe a radicalement modifié sa position, en condamnant l’agression armée conduite par la Russie, et affirmé son attachement à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières de 1991, incluant donc la Crimée et les républiques autoproclamées du Donbass.
Cependant, derrière les déclarations publiques, les Ukrainiens perçoivent un contentieux plus profond. En 2014, la population russe est euphorique : 88 % approuvent l’annexion de la Crimée. Ce soutien ne descendra jamais au-dessous de 86 % dans les années qui suivent. Même dans les cercles critiques du pouvoir, la majorité a continué d’approuver l’annexion de la Crimée, et, en s’inscrivant dans cette majorité, Navalny a contribué à légitimer l’agression dans les milieux de l’opposition. Mais la responsabilité personnelle de l’opposant numéro un est, aux yeux des Ukrainiens, plus lourde encore. L’affiliation passée de Navalny aux mouvements nationalistes est connue, et lui a valu une exclusion du parti politique prodémocratique Iabloko, en 2007.
Entre 2007 et 2011, il a participé à des « Marches russes » – qu’il a parfois coorganisées –, manifestations annuelles de différentes mouvances nationalistes et ultranationalistes du pays. Internet garde la trace de sa violence verbale à l’égard des migrants en général, et des habitants du Caucase en particulier.
On reproche aussi à l’opposant son discours méprisant sur l’Ukraine. Ainsi, dans une vidéo de 2019, tout en reconnaissant l’élection démocratique de Volodymyr Zelensky, Navalny décrit un pays en déliquescence, dirigé par des élites qui sont « une bande de salopards tellement corrompus que nos propres salopards corrompus se sentent complexés ». Difficile de dire, dans ces positionnements, ce qui relève d’une conviction profonde, d’un bon mot lâché à la va-vite ou d’un ajustement stratégique aux préférences des citoyens russes.
Posture nationaliste grand-russe
Au fond, peu importe : ces éléments font de Navalny, aux yeux d’un certain nombre d’Ukrainiens, une autre tête du même monstre politique, une deuxième émanation d’un impérialisme russe profondément enraciné. Par son soutien à l’annexion de la Crimée, mais aussi par son dénigrement de ce qui est non russe, Navalny apparaît, aux yeux de certains Ukrainiens, comme coresponsable de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Si, bien évidemment, il n’est pas celui qui a orchestré l’invasion, il a été jugé responsable, parmi d’autres personnalités qui comptent aux yeux de la population, d’avoir contribué à légitimer l’idée de l’agression et l’idéologie qui la sous-tend.
Au-delà de la figure de Navalny, le reproche est adressé à ceux que l’on qualifie en Ukraine – les guillemets sont importants – de « bons Russes », ceux qui condamnent la guerre, mais partagent les idées impérialistes du pouvoir, qui s’opposent au Kremlin, mais font le choix de l’exil plutôt que du soulèvement, qui souhaitent la fin de la guerre, mais refusent d’y prendre part, laissant les Ukrainiens combattre le pouvoir russe et mourir à leur place.
Avec ces « bons Russes », pas de discussion possible. La possibilité d’un dialogue entre les deux sociétés repose, aux yeux des Ukrainiens, sur deux préalables : la reconnaissance et l’abandon de la posture impérialiste de la société russe vis-à-vis de ses voisins, d’une part ; l’engagement dans un combat contre le pouvoir poutinien, d’autre part.
Prendre le chemin de ce dialogue demanderait aux opposants russes de se détacher explicitement d’une partie de l’héritage de Navalny – la posture nationaliste grand-russe – pour embrasser l’autre dimension de cet héritage, à savoir le courage, la colère et l’inventivité de l’homme qui a défié le Kremlin.
Anna Colin Lebedev est maîtresse de conférences en science politique (UFR droit et science politique, université de Nanterre).
Publié le 01.02.2024 à 10:22
Lorsque L’Obs m’a demandé si j’accepterais de faire une note de lecture sur le dernier livre d’Emmanuel Todd, j’ai d’abord hésité. Qu’est-ce qu’une chercheuse – dont le domaine de compétence est par définition restreint – peut dire sur un essai qui se donne pour but d’embrasser le monde comme il va ? Mais devant l’insistance répétée de Todd à se déclarer historien et anthropologue (et non pas essayiste), je me suis dit que s’il jouait la légitimité scientifique, on lui devait une réponse scientifique. Et même si la Russie et l’Ukraine ne sont pas au centre de son raisonnement, elles ne sont pas non plus à la périphérie, puisque le diagnostic qu’il pose sur ces deux pays fonde aussi son discours général sur la faillite des Etats-Unis, et plus globalement sur les failles occidentales.
Vous trouverez ma note de lecture sur le site de L’Obs . J’ai décidé d’en dire un peu plus ici et dans un fil Twitter. Pourquoi? Parce que quand vous dites qu’un livre est bon, on vous demande rarement de le prouver. Mais quand vous dites qu’il est mauvais, on exige des preuves détaillées. Ma critique se limite strictement à son analyse de la Russie et de l’Ukraine, car c’est sur ces deux pays que j’ai une compétence de chercheuse.
De manière générale, pour un auteur qui se dit anthropologue, historien, qui ne cesse de souligner son « tempérament scientifique » (p.33) et de prétendre présenter les résultats d’une recherche, le livre est d’une pauvreté affligeante en termes de sources et de méthodes. La première chose qui frappe est l’ignorance complète par l’auteur de recherches publiées sur le sujet qu’il aborde. Le chapitre Russie cite bien brièvement quelques livres sans en détailler le contenu (p.58-59), mais tous les ouvrages cités ont au moins un demi-siècle d’âge et datent probablement des lectures étudiantes de l’auteur. Leroy-Beaulieu (texte de 1881) a tout particulièrement les faveurs de l’auteur et fait l’objet d’une longue citation. Tout cela ne serait pas problématique si Todd utilisait aussi des travaux publiés depuis la chute de l’URSS. Vous en trouvez très exactement deux dans le chapitre consacré à la Russie: un papier de James Galbraith sur l’effet des sanctions (ok, pourquoi pas) , et UN livre : l’ouvrage de synthèse du géographe David Teurtrie « Russie, le retour de la puissance » qu’il cite au moins sept fois dans un seul chapitre. Je n’ai absolument rien contre ce livre, écrit par un chercheur et faisant donc partie du débat. C’est quand-même un peu juste au regard de l’énorme littérature produite en anthropologie, démographie, science politique et sociologie sur la Russie contemporaine, que ce soit en français, en anglais, en russe ou dans d’autres langues depuis la fin de l’URSS. Surtout quand on entend poser un diagnostic sur l’état du pays.
Todd ne souhaite pas s’encombrer de décennies de travaux basés sur des enquêtes poussées. A la place, il veut produire un travail original basé sur des statistiques. Soit; ce n’est pas illégitime. Mais le choix des indicateurs et les conclusions qu’il en tire interrogent: il ne sélectionne que des statistiques qui vont dans son sens, et en tire des conclusions infondées.
Todd mobilise quatre indicateurs : la mortalité infantile; le décès par alcoolisme; le taux d’homicides; le taux de suicide. L’ensemble de ces indicateurs vont dans le sens de sa démonstration. Oui, la mortalité infantile a fortement décru en Russie, et la comparaison avec les États Unis n’est pas à l’avantage des US. Oui, les taux d’alcoolisme et de suicide ont aussi diminué. Oui, le taux d’homicide est en baisse. Mais s’il s’agit de juger l’état d’une société, on pourrait opposer d’autres indicateurs à ces statistiques. En effet, si les homicides ont continuellement diminué (avant de monter d’ailleurs en 2022), le taux de crimes violents est en augmentation depuis 2017, selon les statistiques officielles. De même, l’alcoolisme a certes diminué en Russie, mais la consommation de drogue a augmenté, notamment chez les jeunes. Les estimations officielles parlent de +60% de narcodépendants chez les mineurs entre 2016 et 2021. Statistique contre statistique…
La sociologue que je suis bute aussi sur la corrélation établie par Todd entre mortalité infantile et niveau de corruption dans la société. « La mortalité infantile, écrit-il, parce qu’elle reflète l’état profond d’une société, est sans doute en elle-même un meilleur indicateur de la corruption réelle que ces indicateurs fabriqués selon on ne sait trop quels critères. » Ce qui l’amène à conclure à un plus haut niveau de corruption aux États-Unis qu’en Russie. Cette corrélation n’est jamais expliquée, et pour la prouver Todd donne les exemples japonais et scandinaves, pays caractérisés à la fois par une faible mortalité infantile et une faible corruption. Il est facile de le contredire par d’autres exemples de pays où la mortalité infantile est très basse pour un index de corruption plutôt élevé (Estonie, Slovénie, Monténégro). La corrélation ne tient pas la route, et aucune autre argumentation ne vient l’étayer. C’est quoi d’ailleurs la définition de cet « état profond d’une société », aurait-on envie de demander à l’anthropologue?
Un autre des indicateurs fétiches de Todd est le nombre d’ingénieurs formés: la comparaison des USA et de la Russie, à l’avantage net de cette dernière, devrait démontrer la force du modèle russe et expliquer sa « supériorité dans la guerre » (que je ne commenterai pas). Là aussi, l’épaisseur et la complexité du monde social échappe à Todd. Oui, la Russie forme beaucoup d’ingénieurs, et a sans doute un système d’accès à l’enseignement supérieur plus ouvert que les Etats-Unis. Cependant, il ignore certainement ce qu’est cette formation d’ingénieur dans le contexte russe, et les nombreuses critiques qui lui sont faites : archaïsme des programmes et déconnexion des défis contemporains, corruption dans la délivrance des diplômes, taux d’insertion très bas (20% au milieu des années 2010) des ingénieurs dans des postes correspondant à leurs métiers. Les ingénieurs français « vont se perdre dans la banque et l’ »ingénierie financière » » (p.50), déplore-t-il. Les ingénieurs russes aussi!
Mais ce sont surtout les conclusions à l’emporte-pièce tirées de toutes ces statistiques (dont la fabrication n’est questionnée que quand elles vont à l’encontre de ses conclusions) qui laissent pantois: ces indicateurs montreraient un état de « paix sociale de l’ère Poutine » (p.63), une société stable et consolidée. Vraiment? Je suis parmi ceux qui prennent au sérieux l’attractivité de la promesse de stabilité et de prospérité faite par le pouvoir poutinien à la population. Cependant, il ne faut pas confondre la promesse formulée par un régime et la réalité du terrain qui est, on s’en doute, différente et plus complexe.
Enfin, le diagnostic de la Russie dans la guerre est totalement déconnecté des données réelles. L’Etat russe aurait « choisi de faire une guerre lente pour économiser les hommes ». Il aurait donc mobilisé « avec parcimonie » (p. 66) pour les préserver. Cette affirmation ignore à la fois les chiffres réels des hommes mobilisés (officiellement plus de 600 000, et non 120 000 comme il l’affirme) et la réalité de l’usage des soldats sur le front: une masse humaine envoyée en première ligne sans formation ni préparation. Là aussi, le discours du pouvoir russe fait office de preuve intangible.
Si le chapitre portant sur la Russie propose une vision partielle et partiale du pays, celui consacré à l’Ukraine est effarant, tant il est pétri de mépris et de méconnaissance totale du terrain. Pour l’analyse de la Russie, Todd s’appuyait sur pas grand-chose. Pour l’analyse de l’Ukraine, il ne s’appuie sur rien, si l’on exclut le même livre de David Teurtrie (qui n’a jamais été un spécialiste de l’Ukraine) et un article portant sur un sujet pérpihérique à la démonstration (l’émigration juive partant de l’URSS). La source principale du chapitre est… Wikipedia dont il tire les cartes de la population et du vote aux présidentielles. Là aussi: la littérature académique sérieuse, y compris critique, portant sur l’Ukraine, est abondante. Mais manifestement, Todd pense pouvoir écrire une analyse nouvelle de ce pays à grands coups de clichés non sourcés et quelques statistiques. Le dénigrement de l’Ukraine est omniprésent dans le texte. Celle-ci est présentée comme un État failli: j’avais consacré un fil à ce sujet l’an dernier. La langue ukrainienne est qualifiée de « langue des paysans » (p. 96), alors que le russe serait « la langue de la haute culture » (p. 111). Todd ignore complètement la situation linguistique de l’Ukraine, son bilinguisme très particulier qui a certes des dimensions régionales, mais aussi urbaines/rurales, générationnelles, professionnelles… Il reproduit le cliché – que j’ai déconstruit à plusieurs reprises – d’une Ukraine divisée entre un Ouest ukrainophone et un Est russophone. Il trace à tort un signe d’équivalence entre « Ukraine de l’est » et « Ukraine russophone »; entre citoyens russophones et citoyens pro-russes.
La guerre dans le Donbass est étrangement absente de tout son raisonnement. Pour prouver l’absence de représentation politique de « l’Ukraine russophone » et la « fin de la démocratie ukrainienne » (p.97), il pointe le taux d’abstention élevé dans le Donbass lors des élections présidentielles en 2014. A aucun moment il ne lui vient à l’esprit que le Donbass connaît au moment de l’élection des actions armées de haute intensité sur son territoire et une fuite de la population pour éviter les combat, et que l’abstention peut y être liée. Bien d’autres dynamiques, notamment politiques et lingiustiques, sont liées à la guerre. Comment peut-on ignorer à ce point le contexte?
Le mépris de Todd est sélectif: ce qu’il reproche à l’Ukraine, il le pardonne à la Russie. Lorsque Todd évoque l’autorisation et l’usage commercial de la gestation pour autrui, cette donnée est pour lui un « signe de décomposition sociale » (p.72) de l’Ukraine, alors que le recours massif à la GPA commerciale en Russie ne lui pose manifestement aucun problème. Todd dénonce, de manière attendue, une « corruption qui atteignait des niveaux insensés » en Ukraine, oubliant de mentionner que la Russie était moins bien classée que l’Ukraine dans les classements de la perception de la corruption par Transparency International.
Voulant démontrer la domination d’Ukrainiens de l’ouest dans la classe politique ukrainienne, il produit une carte des lieux de naissance des élites politiques. La source est sans doute Wikipédia, mais ce n’est pas grave: Wikipédia peut être une bonne source quand elle n’est pas la seule. Cependant, sa démonstration tombe un peu à l’eau.« L’Ouest, l’Ukraine ultranationaliste, est surreprésenté au sein des élites politiques. L’Est et le Sud, l’Ukraine anomique, n’ont pour eux que les oligarques » (p.104). Ce n’est pas ce que sa propre carte montre. Ce que montrent les lieux de naissance des élites politiques, c’est par exemple que le président actuel Volodymyr Zelensky est originaire de l’Ukraine de l’Est. Que son prédécesseur, Petro Porochenko, est originaire de l’Ukraine du Sud et a fait une bonne partie de ses études à Odessa. Les deux présidents sont issus de milieux familiaux à préférence russophone. Aucune représentation de l’Est et du Sud dans les élites politiques, vraiment?
Je pourrais continuer et multiplier les exemples de méconnaissance, déformation, manipulation. Je m’arrête là. Cette note ne prétend pas à l’exhaustivité: elle rassemble juste suffisamment d’éléments pour pouvoir juger de la partie de son texte consacrée à la Russie et l’Ukraine. Je ne vais pas conclure en disant que l’auteur agit pour le solde d’une puissance étrangère; ce n’est pas mon rayon et je n’ai pas collecté d’éléments pour le prouver. Mais puisque Toddse dit chercheur, c’est sur ce terrain-là que porte ma lecture. Les chapitres consacrés à la Russie et à l’Ukraine ne respectent aucune norme de rigueur scientifique ou tout simplement de sérieux intellectuel. On y voit une ignorance complète de la recherche produite sur le sujet, des arrangements méthodologiques à la limite de la manipulation et des jugements de valeur manifestes. Les défauts de ces chapitres, on ne les pardonnerait pas à un étudiant de master. Je ne sais pas ce que cela implique pour le reste du livre, car ma compétence s’arrête là. Mais apparemment, ça n’empêche pas le bouquin de bien se vendre.
 1/30
1/30