J’ai été l’invitée de Mathieu Vidard sur les ondes de France Inter le 26 septembre 2025. Voici la vidéo de l’émission et l’article accompagnant.
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce avec Corinne Morel-Darleux, un électron libre aux mille vies
Passée par une école de commerce, puis une galerie d’art, à consultante pour les entreprises du CAC40, puis secrétaire nationale d’un parti politique, militante dans les milieux libertaires, pour enfin être écrivaine, Corinne Morel Darleux a eu mille vies.
Sa vie actuelle s’ancre dans la Drôme, et, depuis 17 ans, l’écrivaine s’enrichit d’espaces et d’expériences plurielles, à la fois dans les milieux politiques, militants et littéraires.
Elle développe notamment une pensée critique autour des mobilisations revendicatives qui caractérisent celles qui ont eu lieu lors de la réforme des retraites, les Gilets jaunes, ou encore le principe de pétition pour “Notre affaire à tous”. Elle entrevoit ces formes comme ayant atteint un plafond de verre. Face au renforcement de l’appareil répressif, il conviendrait selon l’autrice de passer du registre revendicatif au registre performatif. Elle envisage ainsi des “double-pouvoir” pour ne pas imposer un rapport frontal, dont certains sont déjà expérimentés en France, comme les medics, des réseaux de ravitaillement, de l’autoconstruction, des fermes collectives, des groupes d’entraide mutuelle, des coopératives, des bases arrière et des cantines solidaires… Une forme d’archipélisation des lieux de luttes et de résistances.
La beauté comme rempart face à l’adversité
Une citation de Rosa Luxemburg, écrite depuis sa cellule en 1917, illustre la capacité à trouver de la joie et de la beauté même dans les circonstances les plus sombres. Luxembourg, emprisonnée, trouve du réconfort dans l’observation minutieuse de la nature, des bourgeons aux coccinelles, se sentant alors heureuse dans son infinie petitesse. Cette capacité à s’émerveiller face au monde, tout en restant lucide sur sa violence, est une leçon précieuse pour faire face au découragement actuel.
D’un engagement militant à une remise en question du système
L’invitée, Corinne Morel-Darleux, raconte son parcours. Ayant grandi dans un milieu familial marqué par l’engagement politique, elle a d’abord suivi une voie plus conventionnelle en intégrant une école de commerce, puis une carrière prometteuse dans le conseil en stratégie au sein de grandes entreprises. Cependant, elle réalise progressivement son malaise face à la consécration du système capitaliste. Ce sentiment la pousse à quitter ce monde pour s’engager dans des fonctions publiques et servir l’intérêt général.
Refus du système et recherche de sens : Bernard Moitessier et l’action performative
L’idée de refus du système prend une autre dimension avec l’exemple de Bernard Moitessier, navigateur qui a choisi de ne pas terminer une course autour du monde pour continuer sa route, privilégiant ainsi son bien-être intérieur à la victoire mercantile. Ce récit résonne avec l’approche de Corinne Morel-Darleux, qui privilégie désormais les ‘actions performatives’ et l’autogestion. Elle explique qu’il s’agit d’actions qui portent en elles-mêmes leurs revendications, comme peindre des passages piétons pour sécuriser une école, proposant ainsi des alternatives concrètes aux luttes plus conventionnelles.
La force des réseaux alternatifs et la littérature comme vecteur de changement
Corinne Morel-Darleux exprime un certain désenchantement vis-à-vis de la politique institutionnelle, jugée trop axée sur la communication et éloignée de l’urgence des crises actuelles. Elle met en avant l’importance des réseaux alternatifs, autogérés et plus proches du terrain, qui privilégient l’action concrète. Son parcours littéraire, marqué par des ouvrages comme “Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce” et “Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes”, témoigne de cette recherche de sens, d’alternatives et de la puissance de la littérature pour éveiller les consciences et proposer de nouvelles perspectives.
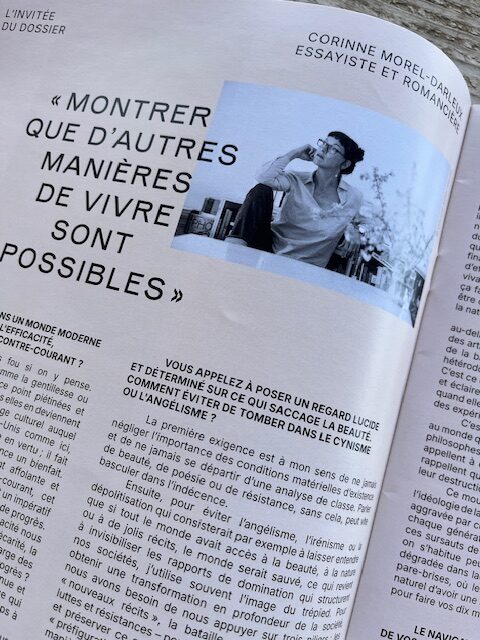 Choisir la beauté dans un monde moderne qui privilégie la vitesse et l’efficacité, n’est-ce pas devoir vivre à contre-courant ?
Choisir la beauté dans un monde moderne qui privilégie la vitesse et l’efficacité, n’est-ce pas devoir vivre à contre-courant ?