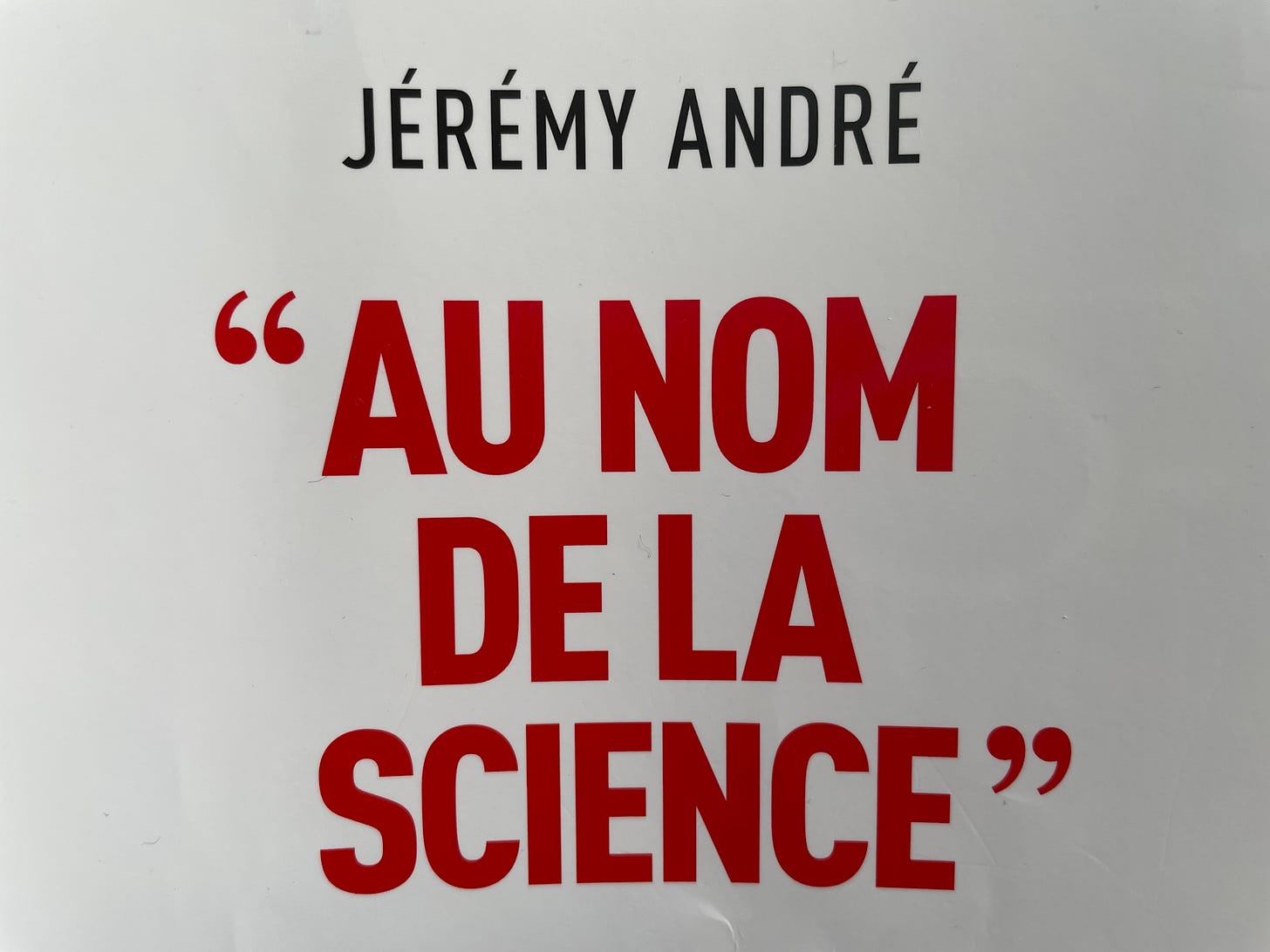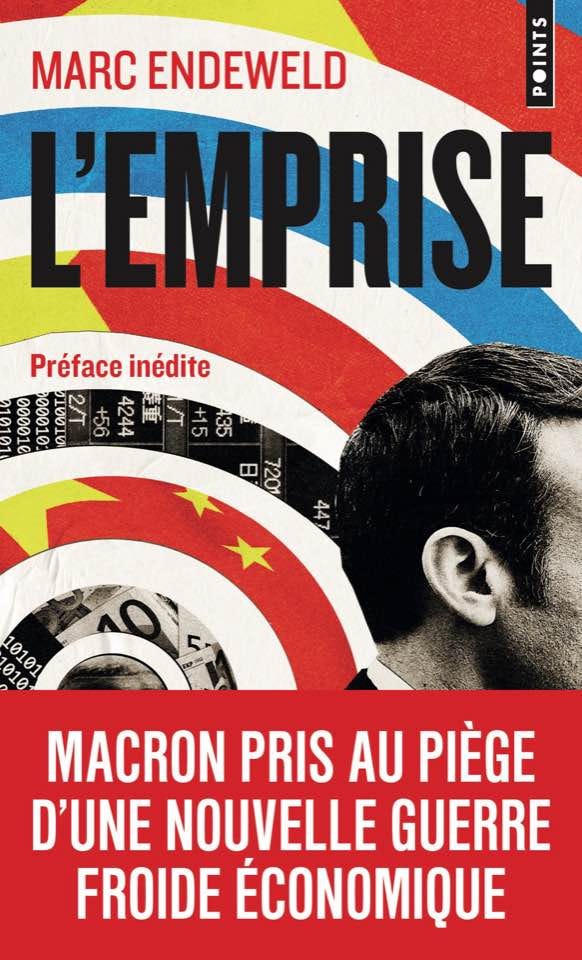The Big Picture
Marc ENDEWELDJournaliste et écrivain
27.12.2023 à 22:24
Emmanuel Macron, la fable du « progressisme »
Marc Endeweld
Texte intégral (5113 mots)
Cette semaine, Le Canard Enchaîné consacre un petit article intitulé « Dr Emmanuel et Mr Macron », dans lequel il est rappelé les déclarations d’Emmanuel Macron contre l’extrême droite, en l’occurrence contre le Rassemblement National, lors des élections présidentielles de 2017 et 2020, pour mieux s’étonner, aujourd’hui qu’Emmanuel Macron « assume totalement » la loi Immigration portée par son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pourtant, tout dans le parcours d’Emmanuel Macron, tant au pouvoir que durant ses années d’initiation, démontre une proximité avec les idées les plus conservatrices de l’histoire française. Et pas uniquement par calcul ou par suivisme dans les sondages.
Ceux qui continuent de dépeindre Emmanuel Macron comme une simple « girouette » ou un « opportuniste » sans idéologie (le « macronisme » serait ainsi caractérisé par son « vide » selon l’éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand), n’ont pas voulu voir un fait : Emmanuel Macron n’a aucune limite quand il s’agit de faire de la politique, pour conserver le pouvoir, au point de n’avoir aucun gêne à lever tout barrage à l’égard de l’extrême droite, dans ses multiples stratégies, petites et grandes. Cette « rupture », dans la droite ligne d’un esprit de « transgression » particulièrement apprécié par les commentateurs dès 2017 contre tout ferment de République sociale, n’est pourtant pas nouvelle. Car cela fait bien longtemps que le « en même temps » macroniste a pour objectif de concrétiser l’union des deux droites, si chère à Patrick Buisson, pour asseoir durablement son pouvoir et empêcher toute alternance à gauche, une option un temps envisagée par un certain Nicolas Sarkozy. Une posture qui va jusqu’à choquer Bernard Cazeneuve qui compare désormais Macron dans une récente tribune à « Janus », un être « double et menaçant », un « en même temps de droite et d’extrême droite ».
Certes, Emmanuel Macron pourrait être aussi le simple symptôme d’une époque terrible, celle d’un tout se vaut propre au marché néolibéral, mais s’il lui manque manifestement une assise historique et une profondeur de vue, sa connivence personnelle le porte naturellement vers la droite la plus dure. À l’Élysée, le conseiller mémoire, Bruno Roger-Petit, exégète favori de la geste présidentielle, n’a d’ailleurs jamais caché sa fascination pour son chef et son « ethos de droite », comme il l’a souvent confié à ses visiteurs. De mon côté, pour avoir enquêté depuis 2014 sur le président de la République et son parcours, cela fait bien longtemps que j’avais perçu ses inclinations anti-démocratiques. Et pour éviter de me répéter, je vous propose en cette fin d’année à la fois une interview vidéo enregistrée à l’automne 2020 pour la web télé QG, ainsi que la postface que j’avais publiée dans l’édition poche de mon ouvrage l’Ambigu Monsieur Macron dès janvier 2018 (éditions Points). Il y a bientôt six ans. Je remercie mon co-éditeur, Hugues Jallon, le PDG du Seuil, de m’avoir autorisé à reproduire ici ce texte.
La fable du « progressisme », postface de l’Ambigu Monsieur Macron (édition poche, janvier 2018).
Il était encore ministre de l’Économie de François Hollande. Mais on le sentait déjà bien éloigné de ses responsabilités gouvernementales et entièrement concentré sur son ambition présidentielle… En ce 20 août 2016, Emmanuel Macron visitait le parc d’attractions du Puy-du-Fou en compagnie de son fondateur, le très droitier Philippe de Villiers. Le jeune loup apparaît alors tout sourire à ses côtés et va jusqu’à lui rendre hommage, saluant un « un entrepreneur culturel ». Ce dernier répond avec la même emphase : « C’est la première fois que je vois un ministre conduire un char avec autant d’audace et surtout cette capacité à apprendre […]. Je pense qu’il y a pour Monsieur Macron, devant lui, un avenir pour conduire toute sorte de char. »
Aux journalistes qui demandent au ministre les raisons d’une telle visite, Macron répond droit dans ses bottes : « Pourquoi, c’est étonnant ? […] L’honnêteté m’oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. » Quelques jours plus tard, le jeune homme pressé de 38 ans retrouvera entièrement sa « liberté » après avoir donné sa démission à François Hollande. Sans scrupule. Quelques jours plus tard, il en aura encore moins quand il recevra, discrètement cette fois-ci, à petit-déjeuner une dizaine de prêtres, dont certains connus pour leur engagement contre le mariage pour tous, comme l’abbé Grosjean ou Pierre Amar, tous deux curés du diocèse de Versailles.
Peu importe pour celui qui, à travers ce geste très gaullien, se vit déjà au-dessus des partis. Et pourtant, quelle manière étrange de concevoir la sortie de tous les « conservatismes » de droite comme de gauche qu’il appelle alors de ses voeux ! Lui qui affirme son ambition de rassembler tous les « progressistes » finit par irriter son plus fidèle soutien, Henry Hermand, qui n’a pas du tout apprécié ses sourires aux côtés du vicomte de Vendée : « Je n’ai pas compris pourquoi il est parti au Puy-du-Fou et je l’ai d’ailleurs dit à Emmanuel. D’autant qu’il est apparu bien trop proche de Villiers. C’était trop. »
Un projet avant tout bonapartiste
Emmanuel Macron déconcerte donc jusqu’à ses plus fidèles. Chacun projette finalement dans le « macronisme » sa propre identité politique, comme pour mieux se rassurer. Au risque de quiproquos. Artisan infatigable des centres, de gauche comme de droite, François Bayrou a ainsi pensé, après son médiatique ralliement, devenir le partenaire indispensable de Macron. Même s’il a répété publiquement le contraire, réfutant toute forme de « ticket », sans doute le maire de Pau espérait-il secrètement devenir son Premier ministre. « La grande erreur de Bayrou est politique, et non humaine, critique un soutien du président. Il a pensé que Macron était d’abord un centriste. Or, si Macron prend l’espace politique du centre, il bouscule avant tout les codes. En réalité, son projet est beaucoup trop bonapartiste pour être fidèle au centre. » De même, le député socialiste Richard Ferrand, compagnon de la première heure, était persuadé au cours de la campagne que Macron allait « gouverner à gauche », comme il le confiait en privé, et qu’il resterait donc fidèle à sa « famille », tel le turbulent Nicolas Sarkozy, qui avait incarné la « rupture » à droite à l’égard du vieux Jacques Chirac. Là encore, quiproquo.
Car Macron qui n’a cessé de se présenter comme un homme « de gauche », ne s’inscrit pas en réalité dans les luttes ayant marqué la gauche. Macron et la gauche, c’est plutôt tabula rasa. L’ancien ministre de François Hollande ne s’encombre guère de la mémoire des partis, des syndicats et des associations de gauche. « Au fond, décrypte un ancien ministre socialiste, Macron est a-historique. Il pense pouvoir créer le nouveau monde à partir de rien. Mais on ne crée jamais à partir de rien. » (Libération, 6 octobre 2017).
Au cours du précédent quinquennat, ses amis socialistes aimaient pourtant le présenter comme un authentique « social-démocrate », sans pour autant expliquer quelle était la stratégie de leur petit préféré pour impulser un nouveau rapport de force face au capitalisme globalisé. En 2015, Julien Dray constatait ainsi que Macron n’avait « pas de surmoi marxiste » : « Il n’a pas cette culture. C’est à la fois une qualité et un défaut. Car parfois il apparaît “sans principes”, sans ancrage traditionnel. Et c’est vrai qu’il peut se laisser lui-même emporter par une certaine “modernité” à tout-va. »
Quelque temps après, Michel Rocard, peu avant sa mort, estimait ainsi que Macron, son jeune cadet, était « loin de l’histoire ». Oui, loin de l’histoire de la gauche et du progressisme. « Jeune socialiste, je suis allé voir chez les partis suédois, néerlandais et allemand, pour voir comment cela marchait. Le pauvre Macron est ignorant de tout cela », ajoutait l’ancien Premier ministre de François Mitterrand.
Entre manichéisme politique et chantage
De son côté, Dominique Strauss-Kahn, lors d’un hommage rendu à l’ancienne ministre Nicole Bricq, soutien de la première heure de Macron et décédée à l’été 2017, rappelait qu’elle-même « savait que les valeurs de droite et les valeurs de gauche ne sont pas les mêmes. Que les deux sont nécessaires à l’équilibre de la société ». Une forme de rappel à l’ordre venant d’un socialiste pour le moins modéré…
Au cours de sa campagne, Macron n’a pourtant cessé de répéter que le nouveau clivage se situait entre les « progressistes » et les « conservateurs ». Une vision binaire entre « modernes » et « archaïques » loin d’être du goût de tous les Français, et notamment à gauche, mais qui va lui servir pour dépasser le système bi-partisan traditionnel. Dans ce contexte, son « progressisme » est d’abord une stratégie électorale pour s’imposer face au repoussoirs que constituent alors François Fillon et Marine Le Pen. Au clivage droite-gauche, il cherche ainsi à substituer une opposition entre le « bloc libéral », qu’il aimerait incarner, et le pôle des « extrêmes », dans lequel il n’hésite pas à ranger Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon… Un manichéisme politique qui lui a finalement permis de clore tout débat de fond. Presque un chantage.
Certes, en ces temps de terrorisme, Macron a théorisé « la bienveillance » en politique, proposé un projet « positif » à la France, exprimé sa foi en l’Europe, s’est opposé au « néo-conservatisme » de l’après 11 Septembre. Comme cet homme né en 1977 avait joué avec la nostalgie de certains Français, celle des années 1970 justement, où les classes moyennes croyaient encore au progrès et au bonheur collectif. L’image d’Emmanuel Macron, celle d’un gendre idéal, ayant grandi à Amiens, loin du microcosme parisien, a sûrement été sa meilleure carte pour sa folle ambition de ravir le pouvoir.
Une forme de kitsch chez Macron
Qualifié de « moderne », il y a quelque chose d’anachronique chez Emmanuel Macron. Et c’est peut-être ce qui a rassuré certains Français. Une forme de kitsch dans un alliage un peu particulier de tradition et de modernité : entre French Tech, Puy-du-Fou, et Jeanne d’Arc. Emmanuel et Brigitte Macron sont amis de Line Renaud et Stéphane Bern, et font des selfies avec eux sur Instagram. Avec Macron, c’est finalement Retour vers le futur. Celui d’une France qui rêvait qu’en 2016 on irait sur Mars.
Résultat, libéral sur le plan économique, certains à gauche ont cru qu’il l’était également sur le plan politique, héritier de la « troisième voie » chère à Tony Blair, ou qu’il était un « social-libéral » à la manière d’un Justin Trudeau ou d’un Bill Clinton. Face aux postures autoritaires et aux coups de menton d’un Manuel Valls, Macron a utilisé cette image d’ouverture pour se différencier tout au long de l’année 2016 et se tenir à distance du bilan du gouvernement. C’était l’époque où il laissait dire par des proches qu’il ne soutenait par le projet présidentiel de la déchéance de la nationalité… C’est du reste ce que dénonce aujourd’hui la droite extrême qui le dépeint comme le représentant des élites globalisées, « hors-sol », et héraut d’un « libéralisme culturel » si décrié par le philosophe Jean-Claude Michéa.
Il est vrai que Macron aime jouer de cette image à l’international : défenseur de la planète et de l’écologie face à Trump, défenseur des homosexuels en Tchétchénie face à Poutine, meilleur « pote » de Justin Trudeau lors du G7, et même « héritier » de Barack Obama pour The New York Times et l’élite démocrate de Washington… Mais comme le président Chirac en son temps qui aimait prendre une posture progressiste à travers sa diplomatie, Emmanuel Macron est en réalité un conservateur sur les questions sociales et « sociétales ». Dès l’élimination de Valls aux primaires, Macron multiplia les déclarations pour séduire l’électorat de droite, évoquant, dès février 2017, la « tolérance zéro », ou expliquant que La Manif pour tous avait été « humiliée » par François Hollande et son gouvernement !
Un populisme renversé, technocratique
Au final, son « libéralisme » économique est à la fois complaisant à l’égard de la grande finance internationale et à l’égard des identitaires qu’il instrumentalise comme autant de « repoussoirs » pour asseoir son pouvoir. Cette forme de populisme renversé, technocratique, lui permet d’évacuer la question sociale au sens où on l’entendait en France depuis le XIXème siècle, issue de ces luttes populaires qui ont pourtant permis de renforcer notre démocratie. En réalité, le sujet d’Emmanuel Macron n’est pas celui de la justice ou de l’émancipation, mais celui de l’« unité » et de l’« efficacité », afin de sauver le système institutionnel et économique. Sa « révolution », qu’il a choisie comme titre de livre, est profondément conservatrice. Sa posture européenne mêle ainsi appel au débat démocratique et injonction technocratique. autre absence notable chez Macron : le questionnement sur notre modèle de développement actuel et son essoufflement.
Guère étonnant si, face à la crise de la social-démocratie en Europe, le président de la République essaye d’abord de draguer les traders de Londres après le Brexit et ne dit rien contre les « forces de l’argent ». Une expression toute mitterrandienne… citée à de multiples reprises au moment du lancement d’En Marche ! par un certain François Bayrou. Au nom de l’« efficacité », Macron préfère ainsi s’attaquer aux salariés, aux gens de peu, aux perdants de la globalisation, et multiplie les provocations à leur égard. Qu’on en juge : « Au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller regarder s’ils peuvent avoir des postes » (4 octobre 2017) ; « Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes » (8 septembre 2017, Athènes) ; « Une gare, c’est un lieu où l’on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » (29 juin 2017) ; « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien » (1er juin 2017) ; « Le meilleur moyen de se payer un costard, c’est de travailler » (27 mai 2016) ; « Il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires » (7 janvier 2015) ; « Les salariées de Gad sont pour beaucoup illettrées » (17 septembre 2014).
À l’automne 2017, Macron finit par être affublé de l’étiquette de « président des riches » comme Nicolas Sarkozy en son temps. « En fait, avec Macron, ce n’est pas de droite et de gauche, c’est de droite et de droite », fulmine un ancien pilier de la majorité socialiste, loin d’être un révolutionnaire. Les mesures décidées dès l’été 2017 annoncent en effet la couleur : ordonnances pour déréguler le marché du travail, respect des 3 % du PIB de déficit pour l’année en cours qui amène à de nombreuses coupes budgétaires, baisses d’impôts massives pour les plus riches, baisse des aides au logement, baisse des financements de l’État aux collectivités locales, coupes dans le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, nouvelle loi antiterroriste qui intègre de nombreux éléments de l’état d’urgence dans le droit commun, et réponse répressive du ministère de l’Intérieur à l’égard des migrants…
Jouer avec les symboles historiques
Presque mécaniquement, dans les enquêtes d’opinion, la popularité du nouveau président de la République plonge ainsi parmi les sympathisants de gauche et remonte du côté de la droite. C’est finalement le plus grand hold-up du banquier Macron : avoir été élu par une bonne part de l’électorat traditionnel du PS… et faire une politique de droite ! « La moitié de l’électorat de Hollande en 2012 a voté pour Macron au premier tour de la présidentielle de 2017, rappelle Jérôme Fourquet de l’institut de sondage IFOP. La droite a mieux résisté à l’offensive Macron : seulement 17 % de l’électorat de Sarkozy a voté pour lui au premier tour. Donc, clairement, oui, une grande majorité de son électorat (environ 60 %) venait de la gauche et du centre gauche. Mais une fois qu’il a eu brisé le PS à la présidentielle, Macron a cherché à casser la droite aux législatives en envoyant des signaux à cet électorat (nomination de ministres de droite, coupes dans les dépenses publiques, réforme du Code du travail…), stratégique qui a connu un certain succès. » (Le Monde, 7 octobre 2017)
Pour préserver son image et incarner un semblant d’« unité », Macron joue avec les symboles historiques autour de l’identité de la France. Le soir de son élection, le tout juste président élu investit ainsi le Louvre devant les caméras du monde entier. Palais royal de l’Ancien Régime, siège de la cour de Napoléon, et musée révolutionnaire transformé par Mitterrand. L’histoire millénaire de la France représentée en une image. En s’abreuvant de cette mythologie historique, Macron cherche à se « présidentialiser », à placer ses pas dans la grande histoire. Avant lui, Nicolas Sarkozy en avait fait autant lors de sa campagne de 2007, n’hésitant pas à citer dans ses discours écrits par Henri Guaino des figures de la gauche comme Léon Blum.
En pleine campagne, Macron s’était inspiré de la France unie de 1988, la célèbre campagne de Mitterrand pour mieux rassembler face à Fillon et Le Pen : « Pour s’émouvoir aux grand discours sur l’Europe de François Mitterrand quelques semaines avant sa mort, fallait-il être de gauche ? Pour éprouver de la fierté lors du discours de Jacques Chirac au Vél’ d’hiv’, fallait-il être de droite ? Non. Il fallait être français », déclamait-il dans le Palais des sports de Lyon, citant pêle-mêle de Gaulle, Mitterrand, Chirac. Cette posture de réconciliation l’a amené à faire des grands écarts, en reconnaissant à la fois des aspects positifs à la colonisation, pour ensuite la qualifier de « crimes contre l’humanité ».
Cette France qui manque d’un roi
À force de vouloir se placer dans l’histoire millénaire de la France, Macron en oublierait presque le moment fondateur de la République, la Révolution. C’est ainsi qu’en juillet 2015 il assure que, dans la politique française, « la figure du roi » est absente. Un roi dont il pense même « que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vidé émotionnel, imaginaire, collectif ». Les clins d’œil à cette France anterévolutionnaire, Macron les a multipliés. On l’a vu, en novembre 2016, le jour de l’annonce de sa candidature à la présidence, il tient à se rendre à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France…
Comme son ami Stéphane Bern, Emmanuel Macron préfère finalement la petite histoire, l’histoire événementielle. Celle des alcôves de la royauté, de la société de cour, des champs de bataille. Sa femme, Brigitte, est d’ailleurs fan de la célèbre émission de l’animateur télé, Secrets d’histoire. Une histoire romancée. En son temps, l’écrivain Alexandre Dumas excellait dans le domaine. C’est d’ailleurs dans son château de Monte-Cristo, construit au milieu du XIXème siècle dans un style néo-Renaissance, à Port-Marly dans les Yvelines, qu’Emmanuel Macron inaugure devant la presse les Journées du patrimoine et annonce sa décision de confier à Bern un rapport sur le sujet.
Ce château de Monte-Cristo qui incarne, là aussi, le kitsch d’une époque en plein bouleversement, en pleine révolution industrielle, et qui pourtant célèbre alors la nostalgie du Moyen Age, dans la droite ligne de l’architecte Viollet-le-Duc, spécialisé dans les restaurations de monuments. On est donc bien loin de l’école des Annales, de Marc Bloch ou de Fernand Braudel, l’histoire des grands mouvements de civilisations, du développement du capitalisme. Brigitte confie d’ailleurs que son mari est un « romantique ».
Justement, Macron préfère appeler, dans Le Point (31 août 2017), au retour de « l’héroïsme », et célébrer « l’intemporel ». Étrange mystique qui éloigne manifestement cet homme de l’histoire séculière. Macron semble préférer se réfugier dans les symboles et une forme renouvelée du sacré. Un homme « de son temps », si l’on en croit pourtant Laurent Fabius, le président du Conseil Constitutionnel, qui cita le romantique Chateaubriand, pour qualifier le nouveau président de la République lors de son investiture. Ou un symbole d’un « néo-protestantisme » hors-sol et globalisé selon Régis Debray. À l’image de son portrait officiel, surexposé, saturé de symboles (deux iPhones et des ouvrages de la Pléïade posés sur son bureau, une horloge à l’arrière plan, la fenêtre ouverte sur les jardins), rassemblant finalement tous les codes des précédents portraits des présidents de la Vème République (les drapeaux, le bureau, la bibliothèque, le jardin…). « Cette photo kitsch est maintenant accrochée dans toute la France », raille très justement le quotidien allemand Bild (29 juin 2017). Une compression historique digne de César. À défaut de proposer un nouvel avenir aux Français, Emmanuel Macron pourrait finir président d’une France devenue un grand parc d’attractions, tel le parc à thème reproduisant l’Angleterre dépeint en son temps par l’écrivain britannique Julian Barnes dans son roman England, England…
Des grands hommes à un simple aventurier
Cela pourrait suffire à Macron, lui qui se sent davantage proche des héros de la littérature qu’il découvrait, alors enfant, avec sa grand-mère, que du destin des peuples. N’a-t-il pas écrit, adolescent, un roman picaresque, Babylone, Babylone, dans lequel il racontait l’aventure d’Hernán Cortés, le conquistador espagnol qui s’est emparé de l’Empire aztèque ? C’est peut-être de cela dont parle Macron : sa tentative un peu folle de projeter dans son propre parcours l’hubris des grands hommes, ces destins qui pouvaient éclore quand l’Europe faisait encore la grande histoire. « La France doit redevenir une grande puissance tout court », affirme-t-il pourtant.
Devenu président de la Vème République, créée sur mesure pour le général de Gaulle, Macron se dit ainsi en recherche d’une « transcendance » perdue. Macron cite à dessein Hegel et sa théorie des grands hommes, toute en multipliant les références aux panthéons respectifs de la gauche et de la droite. En attendant, il essaye surtout d’écrire la suite du roman dont il est le héros, de proposer pour son image cette « identité narrative » chère à Paul Ricoeur. Finalement, ce « maître des horloges », tel qu’il se définit parfois en privé, « mobilise-t-il et illustre-t-il uniquement le kairos grec, celui qui est saisi du moment favorable, fait appel à la mètis, mais n’ouvre nullement un nouveau temps ? », se demande l’historien François Hartog. Comme le rappelait François Mitterrand à la fin de sa vie : « Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n’y aura plus que des financiers et des comptables. » Macron l’apprendra peut-être à ses dépens : l’histoire est souvent cruelle et pourrait le transformer en un simple aventurier.
Texte écrit en octobre 2017 pour l’édition poche augmentée de L’ambigu monsieur Macron (éditions Points, janvier 2018).
08.12.2023 à 12:21
Retour sur une caisse noire et un parfum de corruption chez ADP en Libye
Marc Endeweld
Texte intégral (8928 mots)
C'est « l'affaire libyenne » la plus méconnue et qui aurait pu être la plus explosive pour le microcosme français concernant ses relations avec l’ancien « Guide suprême » Mouammar Kadhafi. Après une longue enquête ouverte en 2014, le tribunal de Paris a validé, lundi, une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue en novembre 2023 entre le parquet national financier (PNF) et ADP Ingénierie, une filiale du groupe aéroportuaire, essentiellement pour des faits délictueux commis entre 2007 et 2011, lors de la passation de contrats en Libye. « ADP solde une vieille affaire de corruption liée à la Libye de Kadhafi », ont titré Les Echos sur leur site internet.
Rappelons qu’une CJIP est un mécanisme transactionnel inauguré par la loi Sapin II et inspiré par le régime de « DPA » (Deferred Prosecution Agreement) existant dans la justice américaine. Dans cette affaire libyenne, le groupe Aéroports de Paris a donc finalement décidé de payer une amende de 14,6 millions d’euros pour éviter un procès sur des faits de corruption en Libye, liés à des contrats signés… avant et après l’élection présidentielle de 2007 en France. Depuis 2004, les relations diplomatiques entre la France et la Libye de Kadhafi avait en effet été réactivées, vingt ans après l’attentat contre un DC-10 d’UTA, et avaient suscité de nombreuses tractations commerciales et économiques. À Tripoli, se multipliaient alors les visites d’émissaires français issus des équipes Chirac et Sarkozy. Dans le même temps, le groupe ADP avait multiplié les contrats de construction et de gestion d’aéroports à l’étranger, en particulier dans le Golfe, et dans des pays dits « sensibles » du point de vue des règles de « compliance » (conformité) dans le cadre de la lutte contre la corruption.
Aujourd’hui, grâce à cette justice pénale négociée, le groupe aéroportuaire s’en tire particulièrement bien, et communique auprès de la presse sur le fait qu’il a mis en place depuis ces épisodes de nombreuses procédures d’éthique et de conformité….
Il y a quelques mois, une source rompue à ce genre d’affaires m’avait confié que « dans ce domaine comme dans le domaine économique, il y a des dossiers “to big to fail”». C’est en tout cas l’occasion de (re)lire l’enquête que j’avais consacrée au dossier ADP en Libye : car les faits étaient nombreux et très illustratifs des vieilles pratiques du groupe français il y a encore peu de temps :
Enquête publiée dans Le Média en février 2020 :
Exclusif - Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d'ADP
Les policiers de l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) ont perquisitionné fin janvier le domicile de l’ancien responsable de la filiale internationale d’Aéroports de Paris (ADP). En cause : plusieurs contrats passés à l’étranger avant et juste après l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, notamment en Libye. Depuis, la direction d’ADP ainsi que son principal actionnaire, l’État, cherchent à étouffer le scandale et à retarder l’ouverture d’une information pour ne pas nuire à la privatisation d’ADP.
Par Marc Endeweld
Un scandale à plusieurs centaines de millions d'euros, de l'argent libyen qui nourrit des soupçons de corruption, des filiales dans le collimateur de la justice française, des groupes de BTP déjà inquiétés pour des cas de corruption internationale, avec, à la clé, le risque de tomber sous le couperet du gendarme américain anti-corruption : chez Aéroports de Paris (ADP), l’imbroglio est total tant l’hypothèse d’une ouverture d’information et la perspective de mises en examen brouillent les pistes qui devaient amener vers une paisible privatisation.
Ce sont les agissements de l'une des filiales internationales d'ADP, ADP Ingénierie (ADPI), qui ont éveillé les soupçons des enquêteurs français. Au sein du groupe public détenu encore à plus de 50 % par l’État, la direction est particulièrement inquiète et ne fait pour l'instant aucun commentaire officiel. En off, pourtant, des sources internes à l'entreprise nous expliquent que l’actuel PDG, Augustin de Romanet, avait alerté le parquet peu de temps après sa prise de fonction en 2012, suite à des rumeurs de pratiques troubles liées à ADPI.
Cette dernière est dans le collimateur des policiers et du parquet national financier (PNF). La plainte déposée par de Romanet n’avait pas donné de résultats jusqu’à ce que des dénonciations de salariés en 2016 viennent provoquer l’ouverture d’une très discrète enquête préliminaire. Depuis, les investigations menées par les policiers de l’OCLCIFF (Office Central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) se sont accélérées.
Perquisition surprise de l'ancien PDG d'ADPI
Dernier épisode en date : les agents de l'OCLCIFF de Nanterre ont procédé dans la semaine du 20 janvier à la perquisition surprise du domicile de l’ancien PDG d’ADPI, Alain Le Pajolec, l’un des cadres historiques de l’entreprise. Selon nos sources, la pêche aux documents aurait été fructueuse et la nouvelle aurait provoqué un vent de panique au sein du groupe aéroportuaire.
Contacté par Le Média, le PNF a confirmé l’existence de ces investigations sans vouloir entrer dans les détails : « Cette enquête est toujours en cours, tenue par le secret de l’enquête », nous a répondu par mail le service de communication du parquet. Selon d’autres sources, la Chancellerie et l’Elysée surveilleraient les suites judiciaires de très près. L'ouverture d'une enquête pourrait lourdement impacter le processus de privatisation, « car plus personne ne voudra assumer ce bâton merdeux » nous a indiqué en "off" un magistrat qui a connaissance du dossier.
Méconnue, ADPI est l’une des pépites d’Aéroports de Paris, et suscite de multiples convoitises, notamment du groupe Vinci ou du fonds d’investissement Ardian. Crée au début des années 1990 lorsque le savoir-faire de l’architecte historique d’ADP, Paul Andreu, commence à s’exporter à l’étranger, cette filiale d’ingénierie est aujourd’hui en train de fusionner avec ADP Management, spécialisée dans la gestion des aéroports à l’international, sous la dénomination ADP International.
« ADPI est à la fois le joyau et le mouton noir d’ADP », témoigne un ancien salarié de la filiale. « On y trouve à la fois des gens très brillants, des ingénieurs, des commerciaux, mais aussi des barbouzes qui ne font pas grand chose ». Équipements stratégiques, les aéroports ont toujours été au centre de l’attention des pouvoirs politiques, qui ont pris l’habitude d’y placer d’anciens militaires ou d’anciens agents du renseignement. En 2015, le préfet Alain Zabulon a quitté son poste de coordinateur du renseignement à l’Élysée pour devenir directeur de la sûreté du groupe aéroportuaire.
ADPI effectue des études, conçoit des aéroports et supervise la construction d’infrastructures, principalement des terminaux, sur tout le globe, dans des pays aussi stratégiques que « sensibles », notamment au Proche-Orient, mais aussi en Asie, comme le souligne cet ex-salarié que nous avons pu interroger. La société a construit ainsi les terminaux 2 et 3 de l’aéroport de Dubaï, a travaillé sur l’aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite, celui de Bagdad en Irak, ou plus récemment sur le terminal du nouvel aéroport international Daxing à Pékin, imaginé par l’architecte Zaha Hadid.
Dans le viseur des enquêteurs français : une sous-filiale d’ADPI, domiciliée au Liban, dénommée ADPI Middle-East, ainsi que trois contrats remportés en juillet 2007, en pleine lune de miel entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, le « guide » libyen alors invité en grande pompe à Paris. Ces contrats, qui n’ont pu être entièrement exécutés du fait de la guerre de 2011, concernaient la conception des aéroports de Benghazi, de Sebha et de Tripoli, mais également la supervision du chantier de Tripoli et la gestion des sous-traitants où figurent plusieurs groupes internationaux de BTP, notamment le brésilien Odebrecht, dans la tourmente depuis plusieurs années, et récemment mis en cause par la justice française au sujet d’un contrat de ventes de sous-marins français au Brésil.
Des risques de corruption et des surfacturations
Le Média a pu se procurer un rapport interne d’ADP soulignant de nombreux dysfonctionnements et des soupçons tangibles de corruption. Nous sommes également en possession d’un audit commandé par les autorités libyennes à la société américaine Arup Mott MacDonald, un concurrent d’ADPI qui dispose d’un cabinet d’expertise. Le rapport dénonce de multiples conflits d’intérêts, des surfacturations considérables sur ces contrats, ainsi qu’un étrange montage financier en Libye. « Cet audit est en réalité assez bienveillant malgré la gravité de certains faits relayés. La véritable histoire est encore plus scandaleuse… », commente anonymement un cadre d’ADP.
L’histoire, justement, commence pour ADPI en 2005. À la fin du second quinquennat de Jacques Chirac, de nouvelles relations s’établissent entre la France et la Libye, peu de temps après la levée de l’embargo international visant le pays. Dès 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, comme son conseiller Brice Hortefeux, son collaborateur Claude Guéant ou Patrick Ollier, compagnon de Michèle Alliot-Marie (alors ministre de la Défense), multiplient les voyages en Libye. L’Élysée et l’ensemble du gouvernement poussent les entreprises françaises - notamment celles engagées dans les domaines stratégiques, comme Thales ou Total -, à négocier de juteux contrats avec le régime de Kadhafi, quelques mois avant l’élection présidentielle de 2007 qui aboutira à la victoire de Nicolas Sarkozy.
C’est dans ce contexte qu’ADPI entame ses premières démarches en Libye, et prospecte en parallèle vers le Moyen-Orient, alors en plein développement aéroportuaire. Avec succès : « En termes de stratégie, les années 2007 et 2008 ont été des années de rupture pour ADPI avec les contrats signés en Arabie Saoudite et en Libye », se félicitait Felipe Starling, directeur général exécutif d’ADPI, lors d’une convention de cadres organisée à l’hôtel Marriott Saint-Jacques à Paris le 23 juin 2009. « Notre ambition à long terme est de devenir un grand groupe d’architecture et d’ingénierie internationale ». Entre 2000, date de sa création, et 2008, ADPI voit en effet son chiffre d’affaires quadrupler pour atteindre 107 millions d’euros.
En Libye, c’est le commercial d’ADPI pour la zone Afrique, Jean Assice, qui est à la manœuvre auprès des autorités et du clan Kadhafi. De son côté, le PDG d’ADPI Alain Le Pajolec fait aussi le déplacement en Libye. À Paris, le directeur juridique d’alors, Marc Birolichie, par ailleurs administrateur d’ADPI, suit de près l’avancée des négociations.
Mouammar Kadhafi, heureux de revenir sur la scène internationale, ambitionne de transformer la Libye en un véritable hub aéroportuaire panafricain : « La compagnie Afriqiyah Airways, de Kadhafi, voulait faire un grand hub entre l’Europe et l’Afrique. Sur l’exemple d’Emirates à Dubaï », témoigne un acteur de l’époque en Libye. Les Libyens sont gourmands : ils souhaitent disposer d’immenses extensions aux aéroports de Tripoli, de Benghazi et de Sebha, leur permettant de monter leurs capacités respectives à 20, 15 et 3 millions de passagers par an ! À Sebha, petite bourgade, mais ville de naissance de Kadhafi, le « Guide » souhaite construire un terminal présidentiel - « VVIP, very very important people », dans le jargon d’ADPI. Pour réaliser ces projets aéroportuaires pharaoniques, le régime Kadhafi signera au total pour 1,8 milliard d’euros de contrats. En parallèle, pour asseoir cette future domination sur les vols panafricains, Afriqiyah Airways commande, dès juin 2007, six A350 et cinq A320 d’Airbus. C’est le premier contrat signé entre la France et la Libye après l’élection de Nicolas Sarkozy, pour lequel les enquêteurs soupçonnent Claude Guéant, alors secrétaire général de la présidence de la République, d’avoir bénéficié de rétrocommissions.
Un audit commandé par la Libye conclut à des surcoûts et à un pourcentage inhabituel
Début juillet 2007, c’est au tour d’ADPI de remporter le gros lot. Deux contrats de 12,3 millions et 17 millions d’euros sont finalement signés pour la réalisation d’études de design pour les aéroports de Tripoli, Benghazi et Sebha. Peu de temps après, ADPI remporte un troisième contrat stratégique, celui de la supervision et la gestion des sous-traitants sur le chantier de Tripoli, pour un total de 89 millions d’euros. À Tripoli, ADPI n’est donc pas uniquement concepteur, mais également maître d’œuvre, chargé de surveiller la réalisation du chantier par les différents sous-traitants. Parmi eux, une joint venture dénommée ODTC JV, rassemblant trois groupes de BTP, le brésilien Odebrecht Brazil, le Turc TAV (Tepe Akfen Ventures) et un Libanais plus méconnu, CCCL (Consolidated Contractors Company Libya).
ADPI est alors rémunéré à partir d’un pourcentage sur les coûts de construction : « La société s’est retrouvée en conflit d’intérêt manifeste. Car plus les coûts de la construction étaient élevés, et plus ils touchaient ! », commente une source ayant travaillé avec ADPI. Placé en situation de contrôle, tout en bénéficiant des frais engagés par le maître d’ouvrage, ADPI n’avait théoriquement pas intérêt à comprimer les coûts des chantiers. « Quand on demande de juger les constructeurs, il n’est pas très sain de se faire payer sur un pourcentage sur le coût total de la construction », commente la même source.
Cette situation est d’autant plus étonnante que l’audit effectué par Arup Mott MacDonald sur commande des nouvelles autorités libyennes rapporte qu’ADPI va bénéficier d’un pourcentage particulièrement avantageux et tout à fait inhabituel sur les coûts de construction de l’aéroport de Tripoli. Le taux dont bénéficiera ADPI sur le chantier de Tripoli s’élève à 7,35 %. Pour des chantiers équivalents, les superviseurs réclament en moyenne un taux de 4,09 %.
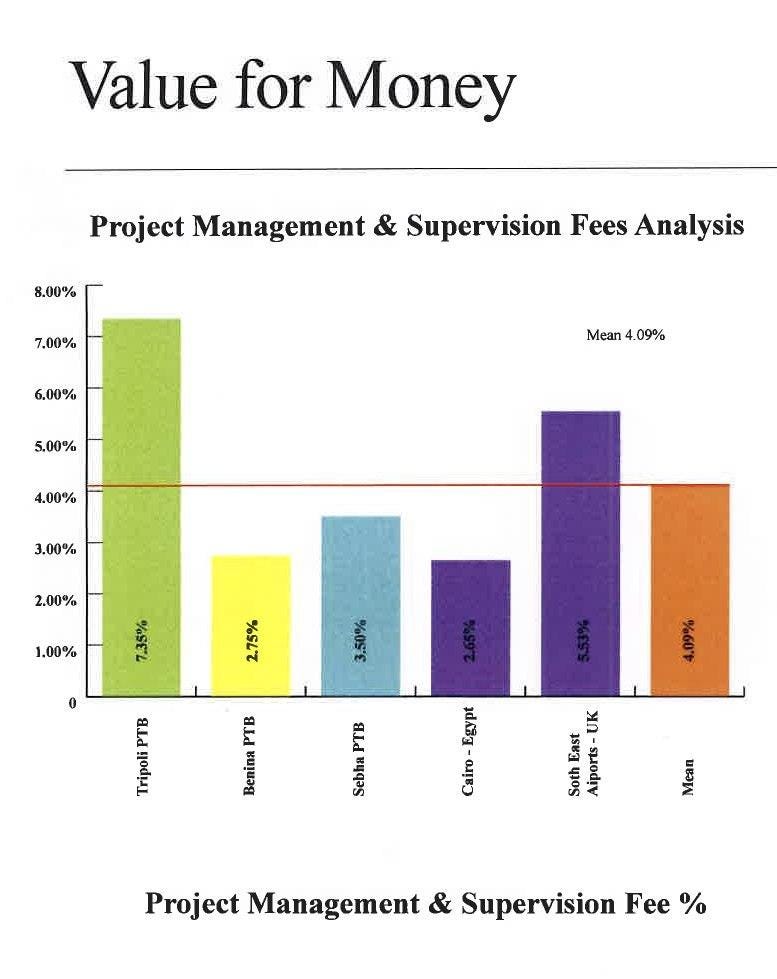
Mais au-delà du taux, ce sont les paiements finalement opérés par les autorités libyennes à ADPI qui interrogent. En effet, alors que les chantiers des trois aéroports ont dû être arrêtés en urgence par la guerre de 2011, les versements déjà effectués – de 2008 à 2011 - ne correspondent pas à l’avancée réelle des travaux sur place. La construction du terminal en était alors à peine au début de la structure. On aperçoit seulement quelques bardages. Les bâtiments sont tout juste sortis de terre. « Rien n’est encore installé manifestement : ni les ascenseurs, ni la climatisation, ni les parkings… J’estime que ces chantiers n’en sont arrivés qu’à 20 % de la réalisation, au mieux 30 % », estime un ingénieur spécialiste de la construction aéroportuaire.

Néanmoins, alors que le chantier de Tripoli est loin d’être achevé (on retrouve la même situation à Benghazi comme à Sebha), ADPI va largement facturer ses prestations, et se faire payer, auprès du maître d’ouvrage libyen, de la même manière que les sous-traitants Odebrecht, TAV, et CCCL, vont largement facturer et recevoir de larges paiements pour un chantier loin d’être terminé. « Peu de chantiers sont facturés à plus de 50 % quand il n’y a que la structure à peine. D’un point de vue commercial, ils n’ont pas bu la tasse, ce qui est étonnant car les chantiers ont bien été arrêtés. Pourquoi ont-ils réussi à récupérer une grande partie de l’argent alors que le chantier n’était pas terminé ? Y-avait-t-il des clauses dans le contrat ? », se demande le spécialiste que nous avons interrogé.
Au final, la facturation d’ADPI pour la supervision du chantier de Tripoli atteint près de 48 millions d’euros, soit plus de la moitié de ce qui est prévu au total par son contrat, alors que les travaux n’en sont qu’à leurs prémices. Le groupe français recevra pourtant 43,5 millions d’euros. De leur côté, les principaux sous-traitants, dont Odebrecht, facturent pour plus de 587 millions de travaux, soit plus de 60 % de l’ensemble du contrat prévu, et reçoivent pour 410 millions d’euros de paiements sur le seul chantier de Tripoli.
Ainsi, malgré la situation d’extrême urgence en Libye avec la chute du régime en 2011, ADPI comme les principaux sous-traitants du chantier de Tripoli n’ont pas eu de très grandes difficultés pour se faire payer. Sur l’ensemble de ses contrats (conception, supervision du chantier), ADPI a finalement reçu 73,6 millions d’euros, pour 83,9 millions de facturations, soit un recouvrement de près de 88 %. L’audit effectué par Arup Mott MacDonald pointe ainsi une double surfacturation sur le chantier de Tripoli, à la fois au niveau du pourcentage dont bénéficie ADPI sur les coûts de construction, et de la facturation finalement réalisée par les sous-traitants et ADPI sur le réel avancement du programme de travaux.
Ce ne sont pas les seules incohérences constatées par l’audit. Sur les chantiers de Tripoli, Benghazi et Sebha, les marges dont bénéficient au final les différents acteurs sont particulièrement importantes, entre 22% et 23,7 % alors que le secteur de la construction peut espérer généralement entre 5% et 10 %.
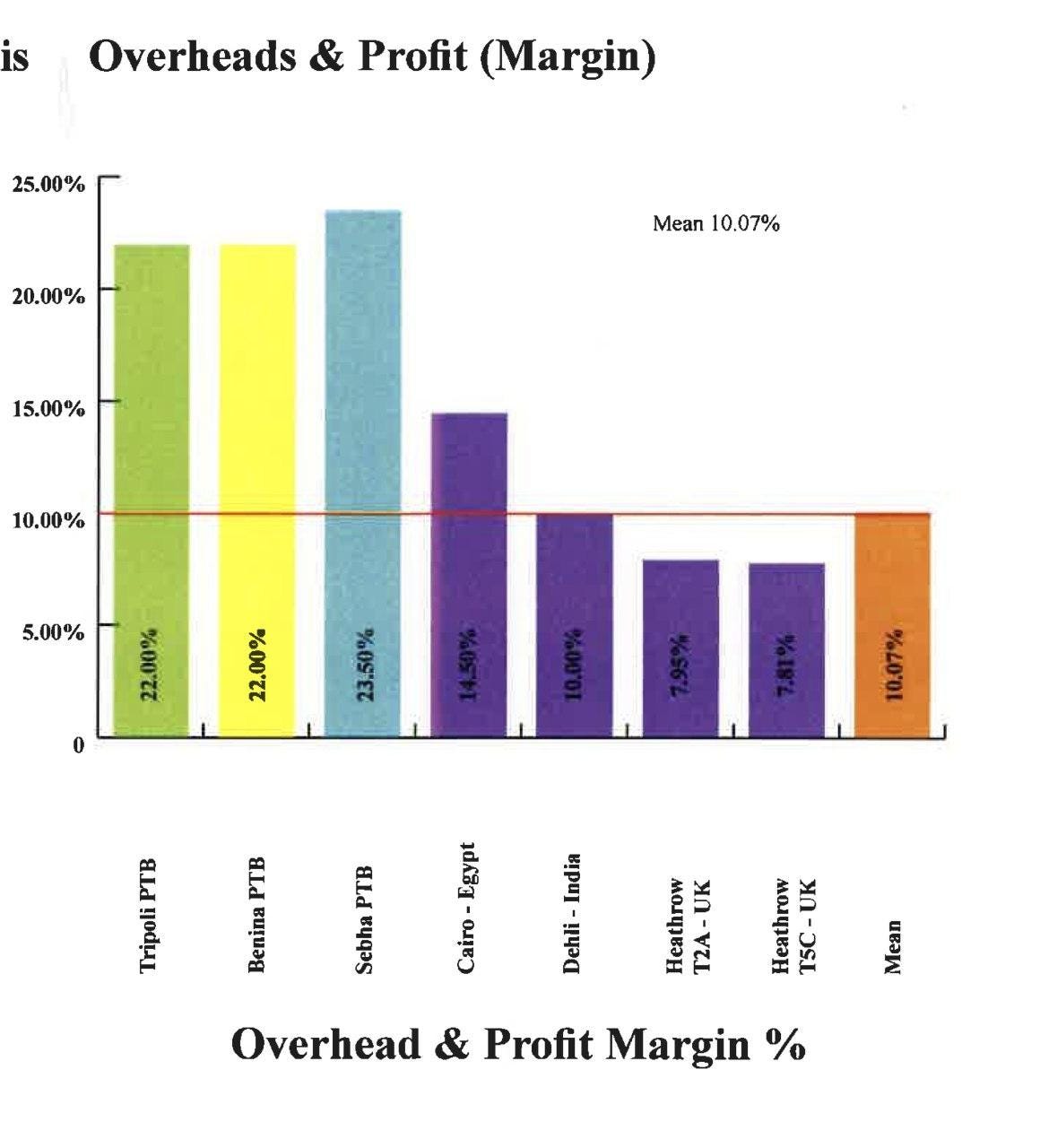
Les auditeurs s’interrogent aussi sur le sur-dimensionnement des différents terminaux prévus à l’origine par ADPI (154 000 m2 pour Tripoli, 77 000 m2 pour Benghazi, et 57 000 m2 pour Sebha). Par ailleurs, ils pointent de nombreux conflits d’intérêt, comme la présence parmi les sous-traitants de la société APAVE, chargée de faire des contrôles sur le chantier de Tripoli, alors qu’elle a aidé ADPI à remporter le marché auprès du régime libyen comme « business winning agent », ou encore la participation à la construction de la société turque TAV, rachetée en cours de chantier par le groupe ADP.
Dernière étrangeté : en 2011, peu de temps avant la guerre, plusieurs avenants aux contrats sont signés pour plus d’1,3 milliard d’euros, qui ne seront jamais engagés. Du fait de tous ces éléments, les auditeurs conseillent aux nouvelles autorités libyennes de mettre fin au troisième contrat d’ADPI, correspondant à la supervision du chantier de Tripoli et à la gestion des sous-traitants. À Tripoli, le programme de l’aéroport affiche alors un surcoût de 57 % par rapport à la moyenne des aéroports équivalents. À Benghazi, le programme est encore plus cher pour les autorités libyennes, avec un surcoût de 128 % !
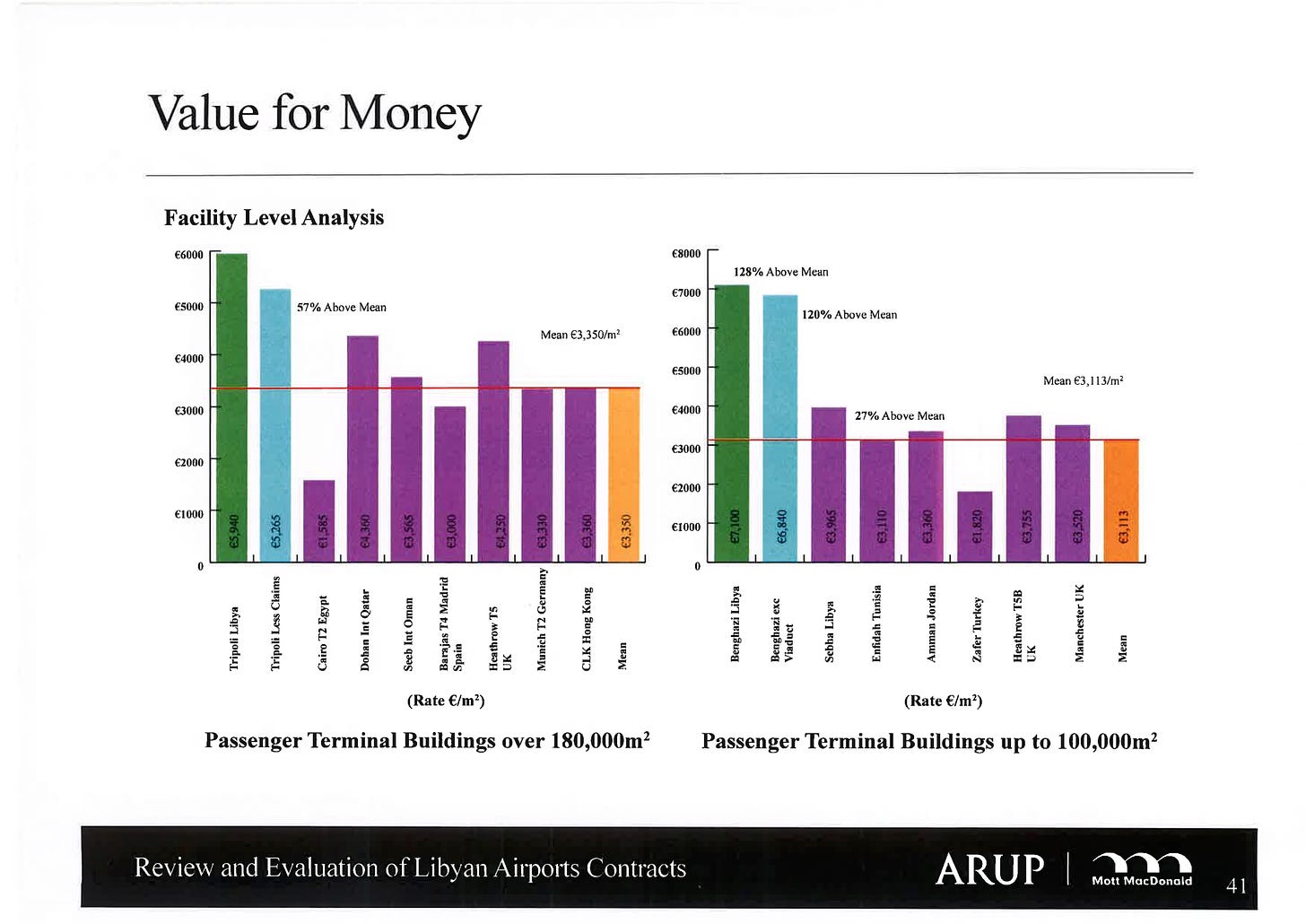
Dans ce dernier cas, c’est le groupe canadien SNC Lavalin qui avait été chargé du chantier. Ce dossier se retrouve depuis au cœur d’un scandale tentaculaire de corruption entre le Canada et la Libye, révélé dans la presse canadienne, aux multiples développements, et qui a provoqué de nombreux procès judiciaires en Suisse et au Canada. Dans ce scandale peu médiatisé en France, et qui a entaché l’année dernière la réputation du Premier ministre Justin Trudeau, on trouve Saadi Kadhafi, l’un des fils du « guide ». Ce sont les réseaux de ce dernier que l’on retrouve dans le versant ADPI de l’affaire.

À la lumière de tous ces arrangements, les enquêteurs n’excluent pas l’hypothèse d’importantes rétrocommissions entre les groupes de BTP, la France et des personnages influents du régime Kadhafi, qui auraient pu transiter par la filiale internationale d'Aéroports de Paris.
Un curieux montage financier et des commissions importantes
En effet, pour mettre en œuvre tout ce programme, la société ADPI va aller jusqu’à créer une filiale en Libye même, dénommée ADPI Libya, avec un proche de Saadi Kadhafi. Cette joint-venture est mise en place en juin 2008, soit plusieurs mois après la signature des contrats, avec un intermédiaire libyen, un certain Faraj D., qui en détient 35 %. « La création d’une Joint-Venture avec Faraj D. (un militaire, camarade de classe de Saadi Kadhafi et un de ses hommes de paille), donne à ADPI une image d’entreprise corrompue et compromise avec le régime de Kadhafi », dénonce un rapport commandé en 2013 par la nouvelle direction du groupe ADP et que Le Média s’est procuré. Ajoutant : « Les relations entretenues par le management de ADPI prouvent que l’entreprise se sentait en situation de pouvoir imposer son point de vue au client, pouvant alors donner le sentiment aux interlocuteurs qu’ADPI avait le soutien de personnes non recommandables ».
Ce document n’y va pas par quatre chemins pour dénoncer les risques juridiques, médiatiques et commerciaux pour ADPI à propos du contrat de l’aéroport de Tripoli. La société française pâtit aujourd’hui d’une « image corrompue » en Libye, car « elle a accepté de créer une JV avec un kadhafiste, Faraj D. », et qu’elle « a versé à cette même personne des commissions importantes ». Les journalistes Clément Fayol et Marc Leplongeon avaient pointé dans Le Point le rôle curieux de Faraj D. auprès d'ADPI dans un article en 2019.
Sur ce dossier, une expertise comptable sur les exercices 2008 à 2011 d’ADPI Libya a fait « apparaître un bénéfice de 25 millions d’euros sans qu’il soit possible d’en expliquer l’origine, le résultat comptable cumulé d’ADPI Libya pour la période 2008-2011 étant proche de l’équilibre et les écarts entre résultat fiscal et résultat comptable n’ayant pas pu être justifiés ». La justice française enquête actuellement pour déterminer où sont passés ces 25 millions d’euros.
Ce rapport accablant, aujourd’hui aux mains de la justice française, évoque également « des contrats de location de bâtiments et de véhicules disproportionnés avec des sociétés » et des « manipulations en tous sens pour se soustraire à l’impôt » ainsi que « la création d’ADPI Libya dans un mauvais usage », rappelant au passage qu’« il n’y a aucune obligation de créer une JV pour l’autorisation de réaliser des contrats en Libye ». Dans un mail interne à ADP que nous nous sommes également procurés, il est spécifié que « le recours à un partenaire libyen n’était (…) pas nécessaire ».
Le rapport recommande d’ailleurs à la direction du groupe ADP « de faire peau neuve en Libye », de « changer les anciens représentants », de « ne plus utiliser ADPI Libya »,et de « se positionner de façon plus humble ». « Le dépôt d’une plainte en France est à envisager sérieusement », est-il également conseillé.
Avant même d’attendre les conclusions de ce rapport, une plainte sera d’ailleurs déposée par ADP, à l’initiative discrète d’Augustin de Romanet, l'actuel PDG, auprès du parquet de Paris au cours de l’été 2013. De Romanet est alors en place depuis moins d'un an. Il a quitté la Caisse des dépôts pour venir remplacer Pierre Graff, un polytechnicien passé par l’aviation civile, en poste depuis 2003. À l’époque, pourtant, les enquêteurs ne disposent que de peu d’éléments. Selon des sources policières, après le dépôt de plainte en 2013, ADP n'aurait pas eu une attitude très collaborative : « C’était un peu comme de la poussière à glisser sous un tapis, personne n’avait vraiment envie d’y mettre le nez », nous explique une source proche du dossier sous couvert d'anonymat.
Une autre filiale au Liban intéresse la justice
Aujourd’hui, selon nos informations, les enquêteurs français s’intéressent également de près à une autre filiale d’ADPI établie au Liban, dénommée ADPI Middle East. Pourquoi ouvrir une telle société au Liban alors qu’ADPI n’a aucun contrat dans ce pays ?
C’est que derrière cette filiale, on trouve un certain Roger Samaha. Cet homme d’affaires libanais, proche d’Omar Zeidan, l’intermédiaire préféré des Français au Moyen-Orient sur les contrats d’armement durant une vingtaine d’années, a su se transformer en collaborateur indispensable à ADPI, notamment auprès d’Alain Le Pajolec, son ancien PDG. « Pourtant, son nom n’apparaissait sur un aucun organigramme de la boîte, nous explique un ex-cadre de l’entreprise. Ils ont donc fini par créer une filiale au Liban, ADPI Middle East, pour officialiser son rôle, car cet intermédiaire nous a permis de remporter de nombreux contrats ». En 2012, Roger Samaha était toujours vice-président d’ADPI Middle East.
Mais cette étrange structure rend d’autres services à la direction d’ADPI. Créée également en 2008, elle lui a permis de délocaliser des fonctions support, et d’embaucher des salariés locaux. « ADPI Middle East a souvent été présenté aux salariés à Paris comme un bureau étranger nous permettant d’employer des ingénieurs locaux à moindre coût. Mais ADPI Middle East est surtout le cœur du réacteur de la boîte, à l’abri des regards indiscrets », confie un ancien haut cadre. Selon nos informations, Roger Samaha, présenté comme un « partenaire » d’ADPI Middle East, aurait été propriétaire à 20 % de cette filiale jusqu’en fin 2015.
Scène révélatrice de l’importance de Roger Samaha pour les autorités françaises : le 25 juin 2012 à Beyrouth, l’ambassadeur de France Patrice Paoli lui remet les insignes de chevalier de la légion d’honneur, sur le quota de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le diplomate félicite alors M. Roger Samaha, « relais particulièrement efficace et loyal » de la France, pour avoir contribué à la signature des grands contrats d’ADPI à l’international, « totalisant un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros sur la seule période 2004-2010 ».
Aujourd’hui, les avancées de la justice sur ADPI pourraient déstabiliser en profondeur le groupe ADP, très engagé dans le processus de privatisation voulu par Emmanuel Macron. En effet, les investisseurs, notamment étrangers, n’aiment guère que la justice s’intéresse à une entreprise convoitée. Suite aux déboires judiciaires du groupe SNC-Lavalin sur ce dossier libyen, le cours de bourse de ce groupe de BTP a dégringolé.
Mais les menaces pour ADP sont multiples. Espérant élargir ses zones de prospection à l’international, le groupe a fait l’acquisition, en juillet 2018, de Merchant Aviation, un cabinet de conseil aéroportuaire établi dans le New Jersey aux États-Unis. Au vu de ce se qui profile avec les affaires libyennes, l’initiative pourrait avoir des effets détestables, car cette dernière acquisition place de fait l’ensemble du groupe ADP sous le coup des lois américaines de lutte contre la corruption. ADP sous la menace de la justice américaine ? La situation serait d’autant plus problématique que, selon nos informations, la banque française d’ADP est la BNP-Paribas, elle-même sous surveillance des autorités américaines depuis de nombreuses années.
Enfin, alors que l’intermédiaire Alexandre Djouhri vient d’être transféré à Paris, après avoir épuisé tous ses recours auprès de la justice britannique, ce nouveau volet de l’affaire libyenne pourrait intéresser grandement les juges d’instruction qui continuent d’enquêter sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alexandre Djouhri est en effet soupçonné par la justice française d'être un personnage-clé de l'affaire. Dans ce dossier, il vient d'être mis en examen pour "corruption active", "complicité de détournement de fonds publics", ou encore "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée". Le nom de ce proche de Claude Guéant, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, est notamment apparu dans l’enquête pour la vente en 2009 d’une villa située à Mougins, sur la Côte d’Azur, à un fonds libyen géré par Bechir Saleh, ancien dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi.
Comme l’avait souligné un câble diplomatique américain révélé par Wikileaks, investir sous la Libye de Kadhafi était pour le moins périlleux pour toute société occidentale : « La Libye est une kleptocratie dans laquelle le régime a une participation directe dans tout ce qui vaut la peine d'être acheté, vendu ou possédé », affirmait le département d'Etat américain en 2009.
L’actuel PDG d’ADP, Augustin de Romanet - nommé par François Hollande en 2012 sur les conseils de Bernadette Chirac – s’est rapproché d’Emmanuel Macron après avoir servi dans de nombreux cabinets de droite sous Jacques Chirac. Il a soutenu la privatisation tout en étant conscient des difficultés juridiques sur ADPI, comme s’il avait conscience du scandale en devenir. Un scandale à plusieurs centaines de millions d'euros, dans lequel sont impliquées de grandes boîtes du BTP mises en examen sur plusieurs continents : une bien mauvaise carte de visite pour tout investisseur. A l’état-major d’ADP, hier, c’était « no comment ». Comme avant une tempête. Une tempête venue de Libye.
Contacté, le groupe ADP n’a pas souhaité répondre à nos questions et nous a adressé le message suivant : « L’enquête suit son cours, nous n’avons pas d’informations supplémentaires à communiquer ».
26.11.2023 à 11:54
Enquête : Emmanuel Macron et Gérard Collomb, entre violence et passion
Marc Endeweld
Texte intégral (5333 mots)
Ma première rencontre avec Gérard Collomb, c’était il y a un peu plus de 15 ans. À quelques semaines des élections municipales de 2008, je l’avais interviewé un soir de janvier à la mairie de Lyon pour le magazine Têtu en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem qui allait devenir l’une de ses adjointes au maire. L’interview s’était déroulée dans une forme de dialogue, notamment autour de la notion de laïcité, qu’il ne concevait pas comme un moyen d’attaquer les religions, un refrain qu’un certain Emmanuel Macron allait reprendre pour sa campagne présidentielle de 2017.
Dans sa mairie de Lyon, on sentait que Gérard Collomb, qui soutenait alors Ségolène Royal, était bien attristé des jeux d’appareil du Parti Socialiste, qu’il n’avait jamais réussi à utiliser pour ses propres ambitions. Cinq ans plus tard, je le retrouvais à Lyon dans le cadre d’un reportage pour l’hebdomadaire de gauche Témoignage Chrétien : il m’avait convié à un déjeuner dans le quartier la Confluence pour évoquer la suite de ses grands projets pour sa métropole de coeur qu’il finira par perdre dans le « nouveau monde » de la politique. C’est donc tout naturellement que j’ai suivi de près son aventure auprès d’Emmanuel Macron.
En mai 2020, j’avais ainsi consacré une enquête dans le magazine Vanity Fair aux relations complexes et difficiles entre les deux hommes, notamment après « l’affaire Benalla ». Car entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, il y a un avant et un après 2018, quand le second décida de démissionner de son poste de Ministre de l’Intérieur. Je vous propose aujourd’hui de re(lire) cette enquête, et j’en profite pour m’excuser auprès des quelques contributeurs payants de The Big Picture de mon absence de ces dernières semaines du fait d’un souci de santé qui est en train de s’arranger.
Mai 2020, Vanity Fair :
Gérard Collomb est l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron. Il lui a ouvert ses réseaux, négocié des accords, s'est battu sans relâche jusqu'à la victoire... Puis plus rien. À quelques jours des municipales, Marc Endeweld remonte le fil d'une amitié blessée entre l'ancien monde et le nouveau.
Ce lundi d’octobre 2019, Gérard Collomb est inquiet. Le maire de Lyon ne supporte plus les critiques dans la presse contre sa personne et sa famille. À 72 ans, il se sent lâché de toutes parts, y compris par le cœur de la macronie à qui il a tant donné. L’un de ses anciens lieutenants, David Kimelfeld, 58 ans, passé du parti socialiste (PS) à La République en marche (LRM), s’est déclaré candidat contre lui à la métropole de Lyon, ce Grand Lyon qui regroupe cinquante-neuf communes autour de la capitale des Gaules. Après dix-neuf ans de règne sans partage, Collomb risque de tout perdre lors des élections municipales du printemps. Soudain, le 14 octobre en début de soirée, un communiqué tombe. La République en marche annonce l’investiture de Gérard Collomb, au nom « de la fidélité à l’un des premiers soutiens du président de la République ». L’intéressé est aussi heureux que surpris. Emmanuel Macron, qui s’est bien gardé d’arbitrer entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux à Paris, lui fait un fabuleux cadeau, mais il ne s’est pas donné la peine de le prévenir. Ni coup de fil ni SMS. « Tu te rends compte ? s’étonne Collomb devant un proche. Emmanuel ne m’a rien dit, même quand il est venu à Lyon il y a quatre jours pour la conférence du fonds mondial de lutte contre les maladies infectieuses... » Comme si quelque chose n’était pas réparé entre eux depuis son passage au ministère de l’intérieur.
C’est une histoire où se mêlent pouvoir, ambitions, jeux d’influence, amitiés blessées et déceptions croisées. Entre le vieux baron de la politique et le jeune chef de l’État, chacun s’est senti trahi et aucun ne l’a accepté. Le premier n’a pas supporté le silence de son champion durant l’affaire Benalla, au point de démissionner à peine un an et demi après son arrivée place Beauvau. Le second a mal vécu cette rupture personnelle et politique. Dans son esprit, on ne quitte pas le président. Encore moins « Gégé », comme l’appelait avec tendresse Brigitte durant la campagne. Il faut se souvenir de la cérémonie d’investiture en mai 2017, lorsque le héros du jour a tapoté les joues de son cher Gérard, qui, lui, n’a pas pu retenir une larme d’émotion. « Ils s’étaient trouvés, me confie le député LRM Bruno Bonnell, fondateur de deux fleurons du numérique, Infogrames et Robopolis. Gérard refuse d’en parler, par pudeur, mais il avait une relation quasi fusionnelle avec Emmanuel. » À l’approche des municipales, il était nécessaire d’en reprendre le fil pour éclairer la mécanique du pouvoir et de ceux qui l’exercent.
La première rencontre entre les deux hommes remonte au mois d’octobre 2013. À l’époque, Gérard Collomb, maire et sénateur PS de Lyon, ainsi qu’une poignée de parlementaires, veulent convaincre François Hollande d’appliquer la politique de l’offre prônée par le rapport Gallois sur la compétitivité de l’industrie française. « Voyez Macron ! » leur répond le président d’alors, en lançant le nom de son secrétaire général adjoint sans y prêter plus d’attention. Un dîner secret est organisé avec lui et sept socialistes de l’aile droite du parti, les futurs « réformateurs ». « Je ne suis pas sûr que le président veuille décider d’un tel choc, leur avoue Macron. Il faut m’aider. » Son « parler vrai » à la Rocard séduit Collomb. Lui, le fils d’ouvrier métallurgiste devenu professeur de lettres, le défenseur d’une ligne « pragmatique » à Solférino qui a souvent prêché dans le désert, se sent d’un coup moins seul. À Lyon, il règne en maître absolu, toujours accompagné de son épouse, Caroline Rougé, une juge administrative de vingt-neuf ans sa cadette avec qui il a eu deux enfants – il en a cinq en tout. Mais le PS ne lui a jamais fait de place sur la scène nationale. Il partage vite son amertume avec son nouvel ami, qui ne rate aucune occasion pour ironiser sur les socialistes – « une espèce en voie de disparition » – alors qu’il est encore au service du premier d’entre eux.
Fin août 2015, ils se retrouvent aux rencontres d’été des réformateurs du PS à Léognan, en Gironde. Le discours de Macron fait un tabac devant cette assistance de militants en chemisettes, dont l’âge moyen dépasse celui de la retraite. Collomb, conquis, lui propose de se présenter aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes face à Laurent Wauquiez, alors considéré comme le grand espoir des Républicains. Refus poli du ministre de l’économie. Il rêve déjà de l’Élysée. Trop tôt, pense le maire de Lyon. À la limite, se dit-il, ce novice pourrait créer la surprise comme « troisième homme » en 2017, puis se présenter pour de bon en 2022. Et entre-temps, il ferait un excellent successeur à Lyon en 2020. Mais Macron n’a que faire de ces plans de carrière. En avril 2016, il annonce la création d’En marche ! à Amiens. Collomb l’appelle souvent, lui écrit sur Telegram, la messagerie chiffrée. Le 2 juin, il officialise son soutien en l’invitant en grande pompe dans sa ville. « Ne te présente pas à la primaire socialiste, lui glisse-t-il entre deux discours. Si tu rentres dans leur jeu, tu vas te faire battre. »
Les mois suivants, il met ses réseaux à la disposition du futur candidat. Lors du meeting de la Mutualité du 12 juillet, la sécurité est ainsi assurée par le service d’ordre de la fédération socialiste du Rhône. En coulisses, tout est organisé par le jeune chef de cabinet du maire, Jean-Marie Girier. Un profil peu commun : fils de garagiste, ce drogué de politique est entré au PS à l’âge de 15 ans, avant de faire un BTS puis un master à l’IEP de Lyon. Il s’est ensuite mis au service de Collomb et, à force de travail et d’ambition, est devenu l’un de ses principaux collaborateurs, à la fois craint et respecté. Très vite, Girier se rend indispensable au sein de la macronie. Son expérience des campagnes, sa connaissance de la carte électorale, ses qualités d’homme à tout faire lui attirent les bonnes grâces du candidat. Le conseiller chargé des meetings le surnomme même « Voldemort », en référence au sorcier de la série Harry Potter. À 33 ans, le voilà « directeur de campagne » de Macron, parmi les fidèles Ismaël Emelien, Benjamin Griveaux et Sibeth Ndiaye.
Est-ce la différence d’âge qui explique la distance de Collomb à leur égard ? Le maire de Lyon, en tout cas, n’est guère à l’aise avec ces gamins qui se surnomment entre eux « les mormons ». Il se lie plutôt d’amitié avec Brigitte. Elle aussi est parfois agacée par l’attitude du clan autour d’Emmanuel. Ismaël Emelien a même eu l’outrecuidance de recommander à son chef de la tenir un peu hors du champ, sous prétexte que l’électorat la trouverait trop « bling bling » avec ses lunettes de soleil au moindre rayon et ses parures Louis Vuitton. Il a même commandé un sondage privé sur le sujet. « Pour moi aussi, c’est dur, se plaint-elle à son “Gégé”. Si vous saviez ce qu’Emmanuel m’impose... »
Au cours de la campagne, le maire de Lyon est sur tous les fronts. Il participe à la rédaction de Révolution, le livre du candidat, relit les discours, suggère parfois des corrections. Lors de la course aux cinq cents signatures, il convainc des maires proches d’Alain Juppé d’apporter leur parrainage à ce jeune candidat « ni de gauche ni de droite ». Dès le mois de janvier 2017, il engage des négociations discrètes avec François Bayrou pour le rallier à la cause. Les deux hommes se voient à cinq reprises, en secret, dans le bureau de Jacqueline Gourault, vice-présidente Modem du Sénat. Le 22 février, Bayrou annonce une « offre d’alliance ». Emmanuel Macron gagne plus de trois points dans les sondages. La campagne s’envole.
Quelques jours plus tôt pourtant, les relations entre Collomb et son protégé se sont brutalement refroidies. Si le meeting du candidat à Lyon a remporté un vif succès, son déplacement n’a pas laissé que de bons souvenirs. Les employés de l’hôtel Charlemagne, où l’équipe du candidat a séjourné durant trois jours, ont peu goûté les manières de la garde rapprochée. Quand il ne fallait pas répondre aux demandes en tout genre du chargé de sécurité, Alexandre Benalla, c’était la fille de Brigitte Macron, Tiphaine, qui réclamait de l’aide pour son bébé. Collomb l’a appris – l’hôtel Charlemagne appartient à un militant socialiste – et ça ne lui a pas spécialement plu, d’autant qu’il n’a pas reçu un mot de remerciement en retour. Il sent bien aussi que le courant ne passe pas entre son épouse et Brigitte. Lors d’un déjeuner à Lyon, la future première dame lui a lancé, sur un ton glacial : « Si Emmanuel est élu, il lui faudra quelqu’un de confiance pour être premier ministre », et Caroline lui a opposé une fin de non-recevoir. Rien ne rapproche ces deux femmes, à part leur foi catholique ; l’âge les sépare. Au fond, le couple Collomb est le négatif parfait des époux Macron.
Vexations et injonctions contradictoires
Pour le maire de Lyon, les derniers jours de la campagne sont intenses. Il réussit à obtenir un ultime soutien de poids, celui de Jean-Louis Borloo, qui l’annonce dans Le Journal du dimanche une semaine avant le scrutin. Alors, au soir du premier tour, lors de la réception organisée par Brigitte Macron à La Rotonde, les Collomb prennent place à la table d’honneur, celle d’Emmanuel, située au premier étage de la brasserie. « C’est le plus beau jour de ma vie », lâche Gérard, euphorique. Brigitte, qui préside la table voisine, avec ses enfants et la mère d’Emmanuel, a bien pris soin de reléguer les mormons à l’écart, en particulier Ismaël Emelien. Pas question de partager ce moment avec celui qui a essayé de l’évincer en début de campagne. Seul Jean-Marie Girier est autorisé à aller et venir entre ses deux patrons.
L’heure est à la fête, mais Collomb est épuisé. Au bord du burn-out, il doit être hospitalisé à Lyon durant près de quatre jours avant le second tour. Il n’est pas le seul des « marcheurs » à avoir tout sacrifié à son héraut : au cours de la campagne, des dizaines de volontaires et salariés ont fait des malaises plus ou moins graves. Les équipes ont aussi été traumatisées par la mort, deux jours avant l’élection, de la députée socialiste Corinne Erhel, victime d’une crise cardiaque.
Sur le plan politique, la joie est également de courte durée. Alors que Collomb aurait souhaité récupérer la tête du parti présidentiel, il hérite d’un grand ministère de l’intérieur, chargé tout à la fois des questions de sécurité, d’immigration et des collectivités territoriales. Certes, ce poste de numéro 2 du gouvernement est prestigieux mais le maire de Lyon y va à reculons. Il sait à quel point Beauvau est un ministère compliqué et, vu sa santé fragile, il aimerait aussi garder un œil sur sa ville. L’exercice du pouvoir central, surtout, le déçoit profondément. Le président a beau le chouchouter, le recevant en tête-à-tête chaque semaine, il ne se sent plus maître en son château. Son cabinet est réduit, il a l’impression d’être sous tutelle de l’Élysée qui le contourne régulièrement en passant par son directeur adjoint, Nicolas Lerner, un ancien camarade de Macron à l’Éna (il sera ensuite nommé à la tête de la DGSI). Et puis, son fidèle Girier s’est émancipé. À présent, le jeune homme rêve de travailler pour le président dont il s’est rapproché au fil des semaines. Mais Brigitte ne l’apprécie guère (pour des raisons mystérieuses) et il doit se résoudre à suivre Collomb à l’intérieur comme chef de cabinet.
Des échos contre Collomb paraissent dans la presse. « Ça vient d'un mec à L'Élysée », l'avertit un informateur.
Dans sa solitude, le nouveau ministre ne peut même pas compter sur la présence de son épouse : elle a décidé de rester vivre discrètement à Lyon avec leurs deux filles, alors âgées de 10 et 11 ans. Pas de chance : dès les premières semaines, elles sont poursuivies par des paparazzis. LyonMag publie une photo où l’on peut reconnaître son domicile en arrière-plan, et bientôt la presse compte ses week-ends passés à Lyon, évoque sa propension à utiliser les véhicules du ministère pour les visites de sa famille à Paris... « Ça ne vient pas des policiers, ça vient d’un mec à l’Élysée », l’avertit un informateur. Une certaine paranoïa s’empare du premier flic de France : qui, au Château, pourrait avoir intérêt à l’atteindre ?
Dès l’été 2017, Gérard Collomb se rend compte que plusieurs politiques impulsées par le président s’éloignent des promesses électorales. Dans son cas, il est soumis à de nombreuses injonctions contradictoires : on lui demande des résultats rapides sur la sécurité tout en essayant de lui imposer une coupe budgétaire de 500 millions d’euros. On attend de lui un texte d’une fermeté absolue sur le droit d’asile et l’immigration avant de l’édulcorer. À deux reprises, le ministre brandit sa démission pour se faire entendre. Ultime vexation, sur les questions de sécurité, Emmanuel Macron ne jure que par Frédéric Péchenard, l’ancien directeur général de la police nationale de 2007 à 2012 devenu vice-président LR au conseil régional d’Île-de-France. Péchenard a un allié puissant : Nicolas Sarkozy, son ami d’enfance, qui s’est étonnamment rapproché du président dès le début du mandat. Gérard Collomb n’en revient pas.
Pour ne rien arranger, il est maintenant contesté à Lyon. En juin 2018, un élu LR dépose plainte pour « détournement de fonds publics », soupçonnant un financement par la ville et la métropole de la campagne d’Emmanuel Macron. Une enquête préliminaire est ouverte par le procureur (elle sera classée « sans suite » en janvier 2020). Les policiers s’intéressent aux activités de Jean-Marie Girier durant la campagne. Gérard Collomb est tendu. Début juillet, il rencontre Brigitte Macron pour évoquer le cas de son chef de cabinet : « Je vais dire à Emmanuel de le nommer sous-préfet en Guyane », lui répond-elle. Le ministre commence aussi à se poser des questions sur l’entourage du chef de l’État. « De vrais enfants », répète-t-il. Au lendemain du 1er mai, son directeur de cabinet, Stéphane Fratacci, a averti l’Élysée qu’un certain Alexandre Benalla a commis une faute grave en accompagnant les forces de l’ordre lors des manifestations. Collomb a déjà croisé cet homme, mais il le prenait pour un simple garde du corps.
Baisse du taux d’humilité
Le premier article du Monde du 18 juillet va tout changer. À l’Élysée, c’est la panique. Ismaël Emelien tente de défendre la thèse de la légitime défense – pas question de lâcher Alexandre Benalla ! Le ministre de l’intérieur s’interroge : pourquoi l’équipe du président protège-t-elle ce garçon avec autant d’ardeur ? À l’Assemblée, les oppositions réclament une commission d’enquête, les débats sur la loi de révision constitutionnelle sont interrompus. Entre deux séances, le président de l’Assemblée, François de Rugy, appelle Gérard Collomb, paniqué : « Il faut que tu viennes ! » Car, au gouvernement, personne ne veut défendre la ligne de la présidence sur Benalla dans les médias. Le 20 juillet, une réunion en petit comité est montée à l’Élysée. Emmanuel Macron hurle : « C’est un coup de Squarcini ! » Le président vise l’ex-patron du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy : pour lui, toute cette affaire ne peut être qu’un complot organisé par la sarkozie.
Incapable de reconnaître ses propres erreurs, Emmanuel Macron voudrait maintenant que Gérard Collomb lui présente sa démission. Le dimanche soir, une nouvelle réunion de crise est organisée avec le ministre de l’intérieur en présence d’Édouard Philippe, de Christophe Castaner et de Richard Ferrand. Alors que le président est en retard, Ferrand, à l’époque patron du groupe LRM à l’Assemblée nationale, commence à exposer ses inquiétudes : « Si vous saviez ce que j’ai découvert... Ce qui se passe est extrêmement grave. » On décide finalement que le ministre de l’intérieur participera à la commission d’enquête sur « l’affaire Benalla » à l’Assemblée. Une audition a lieu le lendemain. Devant les députés, Collomb refuse de couvrir l’Élysée. Pire : il révèle que son cabinet a transmis l’information sur l’incident de la place de la Contrescarpe dès le 2 mai. Le jour suivant, Macron intervient devant ses fidèles à la Maison de l’Amérique latine : « Qu’ils viennent me chercher ! » lance le chef de l’État en visant ses détracteurs. Collomb est derrière lui, visage fermé et grave. À la fin de l’été, il critique sur BFM TV « l’hubris » et « le manque d’humilité » de l’exécutif. C’est décidé, il veut retrouver sa ville de Lyon.
À la surprise générale, le 18 septembre, il annonce dans L’Express son intention de quitter le gouvernement après les élections européennes. Puis il décide d’accélérer le mouvement en posant sa démission le 1er octobre. Le soir même, Emmanuel Macron le reçoit à l’Élysée. « Je t’ai sauvé la vie. C’était Philippe qui voulait te virer au moment de l’affaire Benalla », tente-t-il. Collomb est persuadé du contraire. La confiance est rompue. Un communiqué de l’Élysée précise que le chef de l’État a refusé la démission de son ministre, mais personne n’est dupe. Le lendemain matin, alors que deux journalistes du Figaro sont présents à Beauvau, Collomb revient à la charge. L’interview est mise en ligne sur les coups de 16 heures : « Je maintiens ma proposition de démission. » Cette fois, Macron est placé devant le fait accompli.
De retour à Lyon, l’air est pesant. Gérard Collomb a récupéré son fauteuil de maire, mais pas celui de la métropole, où siège désormais David Kimelfeld, son ancien lieutenant. Et celui-ci n’a pas l’intention de partir : il veut se présenter aux prochaines élections sous l’étiquette du parti présidentiel. Collomb enrage. Il se sent trahi par ceux à qui il pense avoir tout donné durant tant d’années. Même Jean-Marie Girier, recasé comme directeur du cabinet de Richard Ferrand à l’Assemblée nationale, aide Kimelfeld. La guerre est déclarée.
En février 2019, la police judiciaire multiplie ses investigations au sujet de présumés détournements de fonds publics dans le cadre de la campagne présidentielle. Les enquêteurs procèdent à plusieurs perquisitions à l’hôtel de ville, interrogent des salariés... Au même moment, la chambre régionale des comptes enquête sur la gestion de la commune. Les magistrats s’intéressent aux emplois exercés par une ancienne compagne du maire, Meriem Nouri, comme agent administratif. Gérard Collomb comprend que ces deux dossiers le menacent en personne. Il passe à l’attaque en envoyant un courrier au procureur de la République en avril 2019 pour dénoncer lui-même les irrégularités constatées par les services de la ville. C’est alors que le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics au sujet des emplois de Meriem Nouri. Le 5 juin 2019, à 6 h 30 précises, huit agents spécialisés dans la lutte anti-corruption débarquent dans l’appartement des Collomb, réveillant leurs filles. Caroline pique une colère, tandis que son mari s’interroge sur le « procédé » et « la période choisie ».
Quelques jours après cette opération policière, Brigitte Macron inaugure une maison de repos à Lyon. Elle en profite pour dîner en tête-à-tête avec son cher « Gégé » : « Mais qu’est-ce qui se passe dans ta ville ? lui demande-t-elle faussement ingénue. Pourquoi tu n’es pas venu au meeting du 9 mai pour les européennes ? » Peu après, c’est au tour d’Emmanuel Macron de lui rendre visite. Il a un marché à lui proposer : « Tu te présentes à la mairie et tu laisses la métropole à Kimelfeld. » Collomb refuse. Le lendemain, le chef de l’État prend un petit-déjeuner avec David Kimelfeld et lui suggère le ticket inverse, on ne sait jamais. Lui non plus ne veut pas en entendre parler : il rappelle, au passage, que la macronie lui avait promis l’investiture depuis des mois. Mi-juillet, l’Élysée tente une réunion de conciliation entre les deux hommes. Un fiasco : chacun campe sur ses positions. Même le communiqué officiel du 14 octobre ne change rien : le parti présidentiel a beau investir Gérard Collomb, son rival décide de maintenir sa candidature.
Jusqu’au bout, les tensions vont se multiplier et les noms d’oiseaux voler, l’un des principaux soutiens de Collomb allant jusqu’à qualifier de « douze salopards » les conseillers municipaux qui ont rallié Kimelfeld. Dans la deuxième ville de France, le conflit dessine aussi une ligne de fracture entre générations du parti présidentiel. D’un côté, les anciens qui ont toujours fait confiance au maire ; de l’autre, les jeunes qui ont porté Macron à l’Élysée et veulent poursuivre le « dégagisme » jusqu’à Lyon. Du haut de son Aventin, le chef de l’État semble être passé à autre chose. Il a même appelé Gérard Collomb début janvier pour lui souhaiter la bonne année. Mais le vieux briscard n’est plus dupe. Pour lui, la magie du « nouveau monde », si elle a un jour existé, s’est bel et bien dissipée.
26.09.2023 à 12:43
Atos : la fuite en avant de Meunier et le bal des prédateurs
Marc Endeweld
Texte intégral (8403 mots)
Quand il se déplace à Paris, le magnat Daniel Kretinsky, surnommé le « nouveau Pac-Man du capitalisme français » par Les Echos, a ses habitudes au Meurice, un grand palace situé rue de Rivoli face aux jardins des Tuileries. Jeudi 31 août, c’est donc au restaurant de cet hôtel de luxe que le milliardaire tchèque retrouve pour un rapide déjeuner de travail son fidèle conseiller Denis Olivennes (qui est aussi président de sa filiale médias CMI France) et Alain Minc, l’homme qui conseille de nombreux grands patrons, dont Bertrand Meunier, le président d’Atos.
Tout début août, le groupe français de services informatiques avait officialisé, dans un communiqué alambiqué, la cession prochaine de sa filiale Tech Foundations (représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Atos) à la société EP Equity Investment (EPEI), la holding de Daniel Kretinsky. Un jour plus tôt, j’avais annoncé via ma newsletter « The Big Picture » cette opération présentée lors du conseil d’administration du 27 juillet d’Atos.
Dans la torpeur de l’été, cette annonce n’avait guère suscité de réactions, à l’exception remarquée d’une tribune offensive publiée dans Le Figaro un jour après par de nombreux parlementaires LR qui s’inquiétaient d’une telle prise de contrôle pour la souveraineté stratégique de la France.
Alors, en cette fin août, les trois hommes ne se doutaient sûrement pas que l’opération Atos /Kretinsky allait affronter de telles difficultés et de telles oppositions qu’elle pourrait ne pas se réaliser au final. Durant des mois, le dossier Atos n’intéressait pas grand monde en dehors de quelques acteurs de la place de Paris. Mais en cette fin septembre, pour Atos et Bertrand Meunier, son président, c’est désormais l’hallali.
Meunier et son CA sous pression judiciaire
Depuis deux ans, le groupe informatique a subi un choc boursier considérable. Son cours de bourse a connu une dégringolade qui semble inexorable. Et cet été, l’annonce de la cession prochaine de la filiale d’infogérance Tech Foundations à Daniel Kretinsky a provoqué une nouvelle chute du cours amenant l’action à moins de 7 euros. « Ce qu’on oublie avec le temps, c’est qu’Atos était encore au CAC 40 il y a trois ans, et l’action valait alors 100 euros ! Aujourd’hui, à moins de 7, c’est une destruction de valeur considérable ! » s’indigne un des principaux petits actionnaires du groupe.
Étrange situation où la vérité des prix semble comme suspendue. Alors que le marché a durement sanctionné cet été Meunier et son plan Kretinsky de la dernière chance, le président d’Atos continue de rester à son poste contre vents et marées. Et ce, alors que une partie des actionnaires ne croient plus au discours de la direction d’Atos et de Bertrand Meunier.
Ainsi, depuis août, cinq actionnaires ont saisi l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour se plaindre des conditions de l’opération et de l’opacité de la direction d’Atos. Jusque-là très silencieuse, l’AMF me répond par ces mots : « Je vous confirme que nous avons bien reçu des courriers d’actionnaires sur ce sujet. L’AMF étudie avec grande attention l’ensemble des courriers qui lui sont adressés. La communication sur les suites qu’elle donne à ces courriers n’est pas publique car comme je vous l’ai écrit en juillet, l’AMF ne fait aucun commentaire sur les dossiers en particulier. » Aucun commentaire donc, mais on sent poindre une inquiétude…
Mais l’offensive la plus frontale contre Bertrand Meunier a surgi la semaine dernière avec la judiciarisation du dossier. Les avocats du fonds Alix PM (basé à Singapour et contrôlé par Hervé Vinciguerra), actionnaire du groupe de services numériques avec 1 million d’ations, ont déposé une plainte contre X pour « corruption active et passive » auprès du Parquet National Financier (PNF). La plainte vise notamment deux dirigeants d’Atos, mandataires sociaux chargés de négocier la cession de Tech Foundations avec Daniel Kretinsky, qui leur a promis dans le même temps un généreux plan d’intéressement pour continuer de travailler avec lui. « L’affaire ne fait que démarrer, ça va donner des sueurs froides à l’establishment », s‘amuse un haut cadre du CAC 40 qui suit le feuilleton Atos avec effarement.
En réaction, le conseil d’administration d’Atos déplore dans un communiqué publié vendredi que les actionnaires aient choisi « plutôt que de rencontrer la société pour exprimer leurs points de vue et obtenir des réponses, de les médiatiser ». Depuis des mois pourtant, la direction d’Atos se mûre dans le silence face aux questions des actionnaires et des investisseurs. Manifestement, le groupe informatique préfère jouer la victimisation : « La critique systématique, injustifiée de la société et sa médiatisation orchestrée lui portent préjudice » et « fait le jeu des vendeurs à découvert ».
De fait, les saisies de l’AMF et cette plainte au PNF font peser également une pression maximale sur les administrateurs d’Atos. Les actionnaires, dont certains se sont réunis au sein de l’association Union des actionnaires d’Atos constructifs (UDAAC), ne cessent de protester contre la direction du groupe informatique et… son conseil d’administration. Avec 1 % des parts du groupe, Hervé Lescene, mène également la fronde. « Il existe un gros problème de gouvernance avec le président actuel et une partie des administrateurs. On a rien contre la personne, mais quand on cristallise autant la méfiance et qu’on n’a plus la confiance des actionnaires, il faut avoir l’élégance de céder la place », explique l’un de ces actionnaires.
« On se retrouve dans la même situation qu’au début des années 2000 avec Jean-Marie Messier chez Vivendi, ironise un observateur. Qui va siffler la fin de la récré ? Qui prend la responsabilité ? Alors que c’est un enjeu de place… » Au début des années 2000, Jean-Marie Messier s’était fait débarquer de la direction de Vivendi en partie par l’action du puissant Claude Bébéar, alors patron d’Axa, considéré alors comme l’un des « parrains » de la place de Paris, très soucieux de préserver sa bonne tenue.
Près de vingt-cinq ans plus tard, on peine à trouver un nouveau « parrain » capable de taper du poing sur la table. Ironie supplémentaire : Jean-Marie Messier, devenu banquier d’affaires, est aujourd’hui l’un des conseils de Bertrand Meunier à la tête d’Atos.
L’objet du courroux des actionnaires ? Le plan Kretinsky présenté le 1er août dernier, mais surtout ses conditions qui leur apparaissent totalement contraires à l’intérêt social d’Atos. Un des actionnaires en colère résume la situation : « Là où ils ont complètement exagéré, c’est de faire croire que Tech Foundations était cédé pour 100 millions d’euros, ce qui était déjà un prix très bas, alors que dans les faits, cette importante activité d’Atos est cédé à un prix négatif de 900 millions d’euros ! » Un autre s’interroge : « Je ne vois pas ce que Kretinsky va apporter à cet actif, créer quelle valeur, alors qu’il n’a aucune activité dans le domaine informatique. Et puis, on ne cède pas des activités dos au mur ».
Les actionnaires, les salariés vent debout… avec les banques ?
Sur l’apport de 1 milliard d’euros au BFR de Tech Foundations une fois vendu à Daniel Kretinsky, des analystes s’en étaient très tôt étonnés, et avaient posé la question lors de la présentation de l’opération, mais ils n’avaient obtenu aucune réponse de la part d'Atos. Et si le communiqué officiel évoquait une reprise d’une partie de la dette, il ne s’agissait en aucun cas de la dette bancaire, qui sera bien entièrement supportée par la société Eviden, qui regroupera à terme les actifs non vendus à Kretinsky, et dans laquelle celui-ci est censé monter à 7,5 %, avec l’aide du financier Marc Ladreit Lacharrière (Fimalac) avec lequel il est allié dans cette opération Atos comme dans le dossier Casino. Face à ce deal, un analyste s’emporte et n’hésite pas à parler de « communication mensongère » de la part du groupe informatique. Et d’analyser : « La transaction sous valorise l’activité d’outsourcing d’Atos, avec un paiement net de 900 millions en négatif. Cette décision aura un impact majeur sur le fonctionnement de l’entreprise. Cette succession de deals affaiblit le groupe. On est en train de créer deux entités affaiblies au bénéfice de Kretinsky ».
Les actionnaires sont furieux, mais ils ne sont pas les seuls. Les salariés le sont également. D’autant plus qu’ils sont nombreux à s’être engagés dans un fonds d’intéressement, avec une mise initiale de 5o euros par action… Certes, les salariés d’Atos sont éparpillés entre de nombreux sites en France et à l’étranger (Environ 30 000 salariés en Inde, 15 000 aux États-Unis), et une bonne partie d’entre eux sont mis à la disposition des différents clients, ce qui ne permet pas de fonder une culture groupe très forte, mais aujourd’hui, l’inquiétude est telle que la CGT a publié la semaine dernière un communiqué cinglant et s’opposant à la scission du groupe : « Dirigeants d’Atos, nous connaissons le montant des primes et dividendes que vous percevez, mais quelles sont les performances qui les justifient ? »
Plus grave encore pour Bertrand Meunier et la direction d’Atos : selon mes informations, les principales banques du groupe informatique, la JP Morgan et la BNP Paribas commencent à perdre patience, et estiment se retrouver régulièrement mises devant le fait accompli par les dirigeants d’Atos. Alors qu’il est prévu qu’elles garantissent la future augmentation de capital de 700 millions d’euros annoncée le 1er aout dernier pour la future société Eviden, rien n’est moins sûr, selon plusieurs sources, et ce, malgré les affirmations répétées d’Atos.
À l’origine, le projet de scission d’Atos est une idée de Bertrand Meunier, comme je l’avais relaté dans une première enquête en avril dernier, secondé de ses conseils, les banquiers d’affaires David Azéma (Perella Weinberg Partners) et Grégoire Chertok (Rothschild & Co). Bertrand Meunier est peut-être un X Mines, mais c’est surtout un homme du private Equity et des LBO. Il est passé successivement ces dernières années par la Financière le Play, puis M&M Capital, PAI Partners, et enfin CVC Capital Partners. Le financier franco-britannique a fait fortune depuis les années 1980 (500 millions d’euros, ce qui attise la jalousie de certains selon Les Echos…) a également subi un échec cuisant en faisant racheter une filiale de Lafarge par PAI l’amenant ensuite à quitter la direction de ce fonds d’investissement. « Je me souviens qu’il avait dit par le passé à l’un de ses proches qu’il n’achèterai jamais une seule action Atos », persifle l’un des actionnaires. Au final, Meunier en a quand même acheté quelques milliers (d’actions Atos), mais c’est bien peu au goût de certains actionnaires.
Quand le plan A de Meunier tombe à l’eau
C’est à l’été 2021 que Meunier se met dans la tête de découper Atos en deux entités. Un découpage avant tout financier. Pour se constituer rapidement du cash, il se lance alors dans l’idée qu’il pourrait trouver en multipliant les cessions. Mais ce plan de scission, annoncé bruyamment en juin 2022, et que certains surnomment « le plan A », ne va pas se dérouler comme prévu.
Dans ce plan A initial, il s’agit surtout d’ouvrir le capital d’Evidian (censée devenir Eviden aujourd’hui) à un investisseur pour pouvoir financer la restructuration des activités moins profitables de Tech Foundations. Evidian intéresse beaucoup de monde car elle recèle la division BDS (Big Data & Security), héritage du mythique groupe Bull, concentrant les compétences françaises dans les supercalculateurs, et en contrat avec de nombreux acteurs de la Défense notamment pour la simulation de la dissuasion nucléaire, ou avec EDF pour assurer le contrôle commande de plusieurs centrales nucléaires du parc français. Les groupes Thales et Airbus regardent le dossier car ils convoitent tous les deux… BDS.
Mais, au final, c’est toute la justification financière de l’opération qui tombe à l’eau comme je l’avais exposé en avril. Car la valorisation estimée des deux entités n’est pas au rendez-vous. Les résultats 2022 d’Atos sont venus totalement chambouler les plans de Bertrand Meunier et de ses conseils : avec une sous performance inattendue d’Evidian, obtenant une marge opérationnelle de 5 % (et non de 10 % comme espérée), bien deçà de la concurrence (Capgemini est par exemple à 13 % en 2022), et avec une stabilisation de la situation de Tech Foundations. Dans ces conditions comment financer la restructuration de cette dernière entité par une activité moins rentable que prévue ?
Et puis, voyant Airbus et Thales s’intéresser à son opération, Bertrand Meunier tente de faire monter les enchères « Meunier se monte la tête entre Thales et Airbus et fait une proposition à 29,9 % sur 6 milliards de valorisation d’Evidian à l’époque », raconte un témoin des tractations d’alors. En février, Atos annonce en fanfare l’ouverture de négociations exclusives avec Airbus sur cette base… Mais le groupe aéronautique finit par comprendre, comme Thales avant lui, qu’il lui serait plutôt profitable de racheter la seule pépite que constitue BDS. Quel intérêt Airbus aurait-il tiré d’investir autant dans Evidian sans pour autant prendre le contrôle effectif des activités les plus stratégiques, BDS, et qui sont ses seules vraies cibles ? « Meunier a essayé de faire cracher au bassinet Airbus, ils ont mis du temps à s’apercevoir que c’était absurde de prendre juste 30 % d’une boîte sans vraiment avoir tout le pouvoir », explique la même source. Trop cher, pour un ensemble fonctionnant moins bien que prévu (Évidian), et sans pouvoir prendre réellement la main sur BDS. Airbus, par ailleurs sous le feu des critiques d’un fonds activiste sur cette opération, officialise unilatéralement l’interruption de ces premières négociations.
Kretinsky, le plan B de secours en mauvaise posture
Lors de ses communications, présentations aux actionnaires et déclarations publiques, Bertrand Meunier continue pourtant de présenter son premier plan de scission comme toujours en cours, alors qu’il a en réalité échoué avec le refus d’Airbus de jouer les investisseurs de secours auprès du groupe informatique. Un plan B se profile pourtant à l’horizon, et c’est Le Monde qui dévoile le pot aux roses dès début mars en publiant un article dévoilant des négociations entre Atos et Daniel Kretinsky pour le rachat de Tech Fondations. Or, fin juin, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires, Meunier et son équipe ne fait aucune annonce sur l’avancée de ces négociations, et surtout, fait comme si tout se passait selon son plan initial. L’objectif pour le président d’Atos est alors de se faire réélire coûte que coûte malgré une fronde naissante des actionnaires avec fonds Sycomore qui souhaite officiellement le départ de Bertrand Meunier. Un actionnaire est aujourd’hui furieux de ce stratagème : « Le plan Kretinsky a été présenté après coup, après l’AG. En juin, lors de cette Assemblée générale, Meunier présente toujours le plan A comme si de rien n’était et sans toucher un mot sur son plan B de secours. S’il avait annoncé le plan Kretinsky à cette occasion, il n’aurait pas été réélu président ».
Une fois sa reconduction acquise, le président d’Atos se concentre alors en juillet sur la finalisation du deal avec Kretinsky… Et le 1er août, lorsque Atos annonce la cession prochaine de Tech Foundations, le groupe tente de faire croire qu’il s’agit bien de la concrétisation du plan A de Meunier sur la scission du groupe présentée depuis juin 2022. Il y a quelques jours encore, à La Tribune, Bertrand Meunier affirmait : « Cette opération (…) est parfaitement cohérente avec notre projet de séparation ». Or, il n’en est rien.
La mauvaise surprise pour les actionnaires, c’est qu’ils ont découvert dans la torpeur de l’été qu’Atos comptait réaliser, en parallèle de la cession de Tech Foundations, une importante augmentation de capital concernant Eviden, à laquelle doivent également participer Daniel Kretinsky et son allié Marc Ladreit de Lacharrière (on a tendance à oublier ce dernier alors qu’il est très important). Une augmentation de capital de 700 millions d’euros, soit le double de la valorisation boursière actuelle du groupe. Les actionnaires se sont donc sentis d’autant plus floués par la direction d’Atos qu’ils vont se retrouver par cette opération de la dernière chance avec une très importante dilution du capital à travers cette soudaine augmentation de capital.
Après tant d’attente et après tant de destruction de valeur, c’en est trop pour les actionnaires. Dès début août, les coups de fil fusent entre les petits actionnaires et les acteurs intéressés par le dossier Atos. Pas question pour eux de se faire traiter de la sorte. « Meunier s’est retrouvé en position de faiblesse face à Rothschild et Kretinsky. Il n’aurait jamais dû négocier dans ces conditions », critique l’un d’eux. Résultat, en cette rentrée de septembre, la fronde anti-Meunier revient en force. Certains poussent à renverser le conseil d’administration actuel (et cherchent activement de nouveaux administrateurs potentiels) et à faire partir Bertrand Meunier. Pour cela, ils envisagent de convoquer une Assemblée Générale avant celle qui est prévue pour entériner l’opération Kretinsky. D’autres sont moins ambitieux et se satisferaient de constituer une minorité de blocage à la prochaine AG.
« Ceux-là ne sont pas prêts à s’attaquer au CA actuel. Il faut dire que s’attaquer au dossier Atos actuellement, c’est s’attaquer à tout le monde sur la place de Paris… », commente l’un des actionnaires les plus « activistes », pour qui l’heure n’est plus à la tergiversation. Autre difficulté pour les tenants d’un front anti-Meunier, ils ne sont pas tous d’accord sur les éventuels plans alternatifs car toute recapitalisation signifierait à court terme une dilution des actionnaires présents.
L’État entre attentisme et politique du pire
Dans ce contexte, Airbus est toujours sur les rangs pour récupérer BDS comme je l’avais annoncé en juillet dernier, tandis que Thales conserve un oeil dessus et reste en embuscade. D’autant plus que certains actionnaires seraient finalement favorables à une vente, seule, de BDS, dont plusieurs sources estiment la valorisation à 1,5 milliard d’euros, pour permettre au groupe de générer rapidement du cash tout en préservant son intégrité. D’autres au contraire sont vent debout contre une telle perspective de vendre les bijoux de famille, la pépite d’Atos.
La seule présence de BDS au sein d’Atos explique l'extrême nervosité des milieux de défense depuis le début des négociations entre le groupe informatique et d’éventuels acheteurs. Au sein de l’éco système défense français, la Direction des Applications Militaires (DAM), la Direction Générale de l’Armement (DGA), et le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), regardent de près le dossier, et « ne comprennent pas pourquoi l’Élysée ne bouge pas », comme me le confie un haut fonctionnaire. Ni l’Élysée, ni le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, ni Bercy, alors que Bruno Le Maire a été sollicité de nombreuses fois, tant par Bertrand Meunier que par ses adversaires.
Un attentisme, une passivité qui interroge de part et d’autre : « L’État n’a jamais voulu mettre au pot, notamment la BPI. Personne ne bouge, on l’a pourtant demandé à plusieurs reprises », nous fait-on ainsi savoir dans l’entourage de Meunier. Le président d’Atos a d’ailleurs demandé un rendez-vous avec Sébastien Lecornu. Officiellement, le gouvernement ne souhaite pas intervenir car Atos est une société de droit privé dont l’État n’est pas actionnaire. Des conseillers ajoutent que le seuil de 10 % d’investissements étrangers déclenchant le système de protection n’est pas atteint. Via les contrats défense d’Atos, et une partie des organismes publics comme Pôle emploi, qui sont également clients du groupe informatique, de multiples alertes ont été remontées tant à Bercy, qu’à Brienne, qu’à l’Élysée. Dans l’appareil d’État, de nombreux hauts fonctionnaires, très inquiets de la tournure des événements, ne comprennent toujours pas quelle est la position de l’État sur le dossier. Comme si en haut lieu la politique du pire prévalait…
Il y a quelques jours, le magazine Challenges a ainsi rendu public une note confidentielle à destination de l’Élysée rédigée par l’ancien administrateur général du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), et ancien directeur de son pole défense chargé de la dissuasion nucléaire, la DAM (Direction des Applications Militaires) entre 2007 et 2015, Daniel Verwaerde. Celui ci estime que les choix actuels pourraient conduire tout simplement à « un démantèlement fatal à l’entreprise », une société majeure pour la souveraineté française, comme il le rappelle également dans sa note.
Entre Yazid Sabeg et David Layani
Daniel Verwaerde y défend l’idée d’un « plan de sauvetage d’Atos alternatif aux menaces de démantèlement », plus précisément « un plan alternatif préservant l’intégrité de l’entreprise et assurant son développement à moyen terme ». Cette figure de la dissuasion nucléaire s’oppose ainsi avec force à toute scission du groupe. Il propose ainsi pour cela une « augmentation de capital d’un milliard d’euros », et explique qu’« un nouveau pacte d’actionnaires (…) pourrait comprendre un ou deux acteurs reconnus de la défense, du numérique et de la cyber française avec un investisseur institutionnel » et envisage « une gouvernance rénovée tant au niveau de la direction que du conseil d’administration ». Daniel Verwaerde est administrateur de CS Group, présidé par l’industriel Yazid Sabeg, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances sous Nicolas Sarkozy, et qui, selon plusieurs médias, prépare un plan alternatif pour Atos. Dans son article, la Lettre A, souligne que Sabeg est « très introduit dans le milieu de la défense ».
Justement, plusieurs observateurs de la défense s’interrogent aujourd’hui sur l’action ces dernières semaines de David Layani, patron du groupe OnePoint, qui s’est intéressé assez bruyamment depuis l’automne 2022 au dossier Atos en étant allié au fonds d’investissement britannique ICG. Dans l’entourage de Bertrand Meunier, on fait vite comprendre que Layani « n’a pas de proposition et n’a pas un rond à ce jour ». En juillet pourtant, j’avais été informé par plusieurs sources que David Layani avait réussi à trouver un accord avec la direction d’Atos pour racheter Eviden sans BDS. Depuis, le silence radio prime.
De fait, Layani, qui a rencontré tous les acteurs du dossier depuis des mois s’est fait particulièrement discret depuis mon article de juillet. Au point de susciter les hypothèses chez certains : « serait-il en fait en embuscade auprès de Daniel Kretinsky et son offre ? » Au sein de l’éco-système de la défense, on connaît en effet la proximité de ce jeune loup des affaires avec le couple présidentiel, comme avec Nicolas Sarkozy, ou David de Rothschild. L’homme suscite tant l’admiration que les moqueries (« David a une personnalité clivante », me confie l’un de ses proches), et de nombreux observateurs doutent de sa capacité à manager des activités aussi lourdes qu’internationales issues d’Atos. Les questions demeurent pour autant. Car au-delà de ses proximités politiques, Layani partage aussi de nombreuses connaissances communes avec le milliardaire Daniel Kretinsky, à commencer par Marc Ladreit de Lacharrière qui a appris à le connaître dans le dossier explosif de la succession du groupe Barrière. En tout cas, si en juillet, dans l’entourage de Meunier, on balayait l’impétrant d’un revers de la main : « David Layani fait beaucoup d’intox », en août, certains évoquaient l’hypothèse qu’il pouvait « essayer de racheter des morceaux à Kretinsky ».
Reste qu’au vu de l’évolution du dossier Atos, l’Élysée a fini par convoquer une réunion interministérielle (avec Bercy et Brienne) le 19 septembre dernier, selon Martine Orange de Mediapart. Présidée par Alexis Kohler, le puissant secrétaire général de l’Élysée, cette réunion était censée initialement aboutir à des arbitrages, selon les dires de hauts fonctionnaires. Au final, elle aurait abouti à la nomination de deux « commissaires du gouvernement » pour mettre « sous tutelle » Meunier selon Mediapart. Chez Atos, on se demande bien comment ces derniers vont pouvoir avoir le moindre pouvoir puisque l’État n’a aucun lien capitalistique avec le groupe.
Loin d’un désaveu clair à l’égard de Bertrand Meunier, l’Élysée chercherait surtout à gagner du temps… sans arbitrer, c’est-à-dire sans prendre une décision de poids sur l’avenir du groupe Atos. « L’Élysée est à la manœuvre. On a l’impression que le dossier Atos est devenu élyséen, et que tant que Kohler sera là, Meunier sera protégé. Résultat, les actionnaires sont passés à la lessiveuse », estimait en août un actionnaire. Cette semaine, le magazine Marianne, propriété de Daniel Kretinsky, rappelait que le magnat tchèque avait vu Alexis Kohler fin juin, et mettait carrément les pieds dans le plat au sujet du président : « Kretinsky a-t-il discuté d’Atos avec Emmanuel Macron du dossier en marge du dîner Choose France en mai, où il était placé à droite de Brigitte Macron et face au président ? »
Atos sous la tutelle de McKinsey
En attendant, Atos est surtout géré par des conseils externes. Si McKinsey a commencé à travailler pour Atos sous la direction de Thierry Breton, c’est en fait sous le mandat fugace de Rodolphe Belmer comme directeur général lors du premier semestre 2022 que la collaboration entre Atos et McKinsey a pris un tour bien plus considérable.
Selon mes informations, en janvier de cette année-là, un contrat de 80 millions d’euros sur un an entre le cabinet de conseil américain et le groupe de service informatique a été dans un premier temps retoqué par le comité d’audit et le conseil d’administration avant d’être renégocié à la baisse. Une chose est sûre : depuis 2022, Atos est l’un des principaux clients de McKinsey France. « Ils sont absolument à tous les étages », confie un salarié du groupe. Résultat, une grande partie du management est déresponsabilisé et ne s’occupe plus des opérations, d’autant plus que depuis deux ans, le plan de scission de Bertrand Meunier occupe tous les esprits. « Tout le monde discute de la découpe, et pendant ce temps-là, les gens ne s’occupent plus des clients, des salariés, des opérations », s’attriste un bon connaisseur d’Atos. « Il ne faut pas oublier que les principaux actifs d’Atos sont ses salariés. Ça peut vriller très vite, d’ailleurs, les clients partent de plus en plus » (de nombreux clients ont notamment un contrat à cheval entre les deux entités).
Les conseils ne sont pas uniquement chez eux chez Atos… Ils le sont aussi au sein du conseil d’administration, en étant régulièrement invités à assister aux réunions organisées souvent ces derniers temps en visio et en anglais. « C’est le modèle private Equity de Meunier : il ne peut pas prendre de décision sans avoir tous les conseils autour de la table », raille un actionnaire.
Déport tardif et panique à bord
Mais c’est bien sûr les management packages promis par Daniel Kretinsky à Nourdine Bihmane, actuel DG d’Atos, et à Diane Galbe, jusqu’à récemment secrétaire générale du groupe, qui suscite l’indignation chez les actionnaires. Une fois l’opération réalisée, ils toucheront respectivement 25 millions et 15 millions d’euros, en rejoignant Tech Foundations. « Avoir une package de 25 millions ça peut être dans l’ordre des choses dans le domaine du Private Equity pour remonter une boîte de cette taille. Mais le problème, c’est qu’ils ont négocié ça pendant la négociation du deal avec Kretinsky. Ils ne se sont pas déportés », analyse un observateur.
Selon nos informations, les deux hauts cadres d’Atos ne se sont en effet déportés que le 27 juillet, jour de la convocation du conseil d’administration pour la présentation semestrielle des résultats. Ce jour-là, les membres du conseil d’administration apprennent par Bertrand Meunier que Daniel Kretinsky est bien en négociation pour racheter Tech Foundations (comme je l’avais dévoilé dans mon article fin juillet), mais c’est également à cette occasion que le CA d’Atos découvre l’existence de ces management packages pour les deux principaux négociateurs d’alors !
Lors de cette séance du 27 juillet particulièrement riche en révélations, Bertrand Meunier aurait expliqué aux administrateurs qu’il est également surpris d’apprendre que Nourdine Bihmane, DG du groupe, et Diane Galbe, Secrétaire générale, vont pouvoir disposer de management packages de la part de Daniel Kretinsky l’acquéreur de Tech Foundations.
Ce que conteste en privé Nourdine Bihmane auprès de ses proches : « Meunier était parfaitement au courant », explique-t-il auprès l’un d’eux. De fait, ce 27 juillet, le conseil d’administration a demandé à Meunier de prendre le lead dans les négociations avec Kretinsky. « Mais il n’attendait que ça en fait », persifle l’un de ses ennemis. Aujourd’hui, l’entourage de Bertrand Meunier tente de minimiser la situation en expliquant que bien évidemment « tout cela s’est fait dans les règles, et que l’ensemble de la direction et Bertrand Meunier était au courant au préalable de la situation de Nourdine Bihmane et Diane Galbe. C’est une pratique tout à fait courante ».
En coulisses, c’est pourtant la panique. Quand sort l’article de Mediapart en août, Atos choisit de dessaisir discrètement Diane Galbe de sa fonction de secrétaire générale. Dans la précipitation, il est décidé que cette dernière rejoigne en avance la team Kretinsky, mais en réalité, elle finit par être « exfiltrée » à Tech Foundations en attendant la vente à Daniel Kretinsky. « Aujourd’hui, elle n’apparaît nulle part, elle n’est plus dans les hautes sphères du groupe, elle a totalement disparu de la circulation », constate un haut cadre d’Atos.
Enquête sur les administrateurs et nouveau secrétaire du conseil
Autre objet d’interrogation de la part des actionnaires : le conseil d’administration décrit par certains comme « ectoplasmique en dehors de quelques individualités ». « Meunier l’a constitué à sa main », critique un observateur particulièrement remonté contre la direction d’Atos.
On y trouve ainsi Jean-Pierre Mustier, un polytechnicien issu de la même promotion que Frédéric Oudéa et très proche de Bertrand Meunier. Comme lui, il est un pur produit du private Equity et un ancien banquier de la Société Générale (pour l’anecdote, il a été l’un des supérieurs de Jérôme Kerviel et a commencé sa carrière dans les années 1980 comme trader sur les produits dérivés). Selon plusieurs sources, Mustier a tenté d’apparaître ces derniers mois comme un éventuel successeur à Meunier à la tête d’Atos. Au vu de la dégradation rapide du dossier, il n’est pas sûr que sa proximité avec l’actuel président du groupe lui soit désormais favorable. Au sein du conseil d’administration, il peut compter sur le soutien de Carlo d’Asaro Biondo, un ancien de chez Google et de Lagardère, désormais conseiller principal au Boston Consulting Group (BCG).
Depuis le début de la crise à Atos, tous les regards se tournent vers le conseil d’administration. Dans son interview à La Tribune, Bertrand Meunier tient à expliquer : « Il faut également souligner que le conseil d'administration d'Atos est constitué aujourd'hui en majorité d'administrateurs non français. Personne n'a fait la moindre remarque sur ce sujet, y compris nos interlocuteurs publics ainsi que ceux du secteur de la défense avec lequel nous travaillons principalement dans le cadre de nos activités de cybersécurité et de calcul haute performance ». Pourquoi ces précisions ? Peut-être parce que la très secrète direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD), appelée précédemment la DPSD (pour direction de la protection et de la sécurité de la Défense), chargée notamment du respect du « secret Défense », ce niveau d'habilitation d'accès à un document gouvernemental ou militaire, a discrètement enquêté sur les administrateurs du groupe, en particulier l’américaine Elizabeth Tinkham, et les britanniques Kat Hopkins et Vernon Sankey.
Dans son interview à La Tribune, Bertrand Meunier explique également que « des experts indépendants ont supervisé le processus et suivi les négociations avec EPEI [Daniel Kretinsky] notamment pour s'assurer de l'absence de conflit d’intérêt (…) Nous leur avons demandé un rapport qui a été présenté lors du conseil qui a approuvé l'opération. Ils ont conclu qu'il n'y avait pas de conditions inhabituelles dans le projet de management package. » Ces experts sont en fait Finexsi et BTSG, experts auprès des tribunaux de commerce, mais selon nos informations, ils n’ont été nommés qu’en fin de négociations. Et s’ils ont approuvé oralement l’opération devant les administrateurs, leur rapport n’aurait toujours pas été rendu. J’ai cherché à les joindre pour les interroger sur ces points, sans succès.
Reste que BTSG, c’est Marc Sénéchal, un expert devenu incontournable dans le CAC 40, « l’homme qui dénoue les dossiers sensibles », comme le présente le Figaro dans un article de l’année dernière. Il est d’ailleurs présent, comme conciliateur, dans le dossier Casino. « Ce sont les mêmes personnages que l’on retrouve partout ! », s’étonne un banquier d’affaires.
Ce n’est pas les seules curiosités du dossier Atos concernant la gouvernance. Alors que Mediapart a souligné dans un récent article que les procès-verbaux des réunions du CA étaient disponibles tardivement, j’ai appris que le secrétaire du Conseil d’administration, Henri Giraud, un haut cadre du groupe spécialisé dans le droit boursier et des sociétés, a été dessaisi de sa fonction au cours de l’été alors qu’il avait la réputation d’être très scrupuleux dans la retranscription des réunions du conseil. Un secrétaire envoie habituellement les invitations aux administrateurs et retranscrit les minutes du conseil sur PV. Selon mes informations, Bertrand Meunier a demandé ces dernières semaines à l’avocat d’affaires Jean-Michel Darrois, grande figure du capitalisme parisien, de remplacer Henri Giraud dans cette fonction. Rappelons que le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier est l’un des conseils d’Atos : c’est l’avocat Bertrand Cardi qui s’occupe du dossier.
La peur d’une « banqueroute »
Clairement, depuis quelques jours, la pression juridique et judiciaire s’intensifie sur le management d’Atos, mais c’est surtout la pression financière qui fait craindre le pire pour l’avenir immédiat du groupe informatique. Au coeur de l’été, la directrice financière Nathalie Sénéchault a été remplacée sans ménagement par Paul Saleh, un américain passé par la direction financière de Walt Disney. « La directrice financière a été virée, car elle s’est opposée au deal avec Kretinsky et a tiré la sonnette d’alarme sur la situation du manque de cash disponible », croit savoir un actionnaire.
De fait, comme je l’avais souligné au cœur de l’été dans mes deux précédents articles, Atos consomme trop de cash ces derniers mois. La direction du groupe informatique a expliqué cette situation par les coûts de la réorganisation en cours, et s’est engagée lors de la présentation des résultats semestriels à réduire à zéro les pertes de cash sur le second semestre de 2023. Mais comme je l’ai rappelé un peu plus haut, la démobilisation générale au sein du groupe commence à peser lourd sur la rentabilité des différentes opérations et contrats. « Actuellement, c’est carrément le business qui brûle du cash. Le groupe perd actuellement jusqu’à 100 millions par mois ! » s’inquiète un observateur.
À cela s’ajoute le besoin de refinancer tout prochainement la dette. Comme je l’avais expliqué dès juillet, si aujourd’hui l’exploitation continue de perdre de l’argent, le pire est à venir avec le remboursement de la dette l’année prochaine (l’échéance doit en effet intervenir à la fin 2024, comme Atos a fini par le reconnaître dans son communiqué du 1er août comme je le soulignais dans un tweet). Le groupe doit obtenir un consentement des banques : « Mais c’est intenable par rapport à l’environnement du marché de la dette ! » s’exclame un analyste. « Par ailleurs, si les actionnaires ne veulent pas remettre au pot, les banques ne voudront pas de nouveau avancer… Or, au vu de leurs échéances, ils sont obligés de créer une nouvelle dette et donc de négocier auprès des banques pour pouvoir refinancer le groupe. »
Ces dernières semaines, Atos a essayé de convaincre ses banques (BNP Paribas JP Morgan) que seule la cession de Tech Foundations lui permettra de sortir de la spirale infernale. La direction a essayé de gagner du temps en renégociant les échéances du remboursement de sa dette. C’est expliqué dans le communiqué du 1er août : « Atos est très confiant pour obtenir auprès de son syndicat bancaire, les waivers nécessaires ». Dans l’entourage de Bertrand Meunier, on ne cache plus la gravité de la situation : « soit le split et la vente se font, soit on va au tapis. Si rien n’est fait, c’est malheureux de le dire, mais on va tout droit à la banqueroute ». Le mot est lâché. Une manière de dramatiser la situation et de faire pression sur les administrateurs et les actionnaires ? L’ensemble des observateurs du dossier Atos convient aujourd’hui que le risque d’une cessation de paiement dans les prochains mois est à prendre au sérieux.
Comme pour Casino, vers une sauvegarde accélérée ?
C’est pourquoi le scénario de l’appel à une « conciliation accélérée » notamment via le CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle), que j’annonçais dans un tweet, est de plus en plus évoqué en off sur la place de Paris. Cette nouvelle « procédure de sauvegarde accélérée », instaurée par une ordonnance du 15 septembre 2021, donne la possibilité, lorsqu’une société se retrouve en grande difficulté financière, de se passer dans l’urgence de l’avis des actionnaires et d’une partie minoritaire des créanciers pour mettre en œuvre un plan de restructuration. Cette procédure a déjà été mise en oeuvre dans les dossiers Orpea et Casino. « Conçue pour être une voie de sauvetage rapide pour les entreprises en difficulté, elle est opaque pour la plupart des parties prenantes, y compris les actionnaires et les employés, et trop favorable aux banques, dénonce un expert. Les détails de la restructuration, souvent négociés à huis clos entre les dirigeants de l’entreprise et les créanciers, demeurent en grande partie inconnus du grand public et même des employés ».
Mais même pour les banques, ce scénario n’est pas une réelle alternative. Car celles-ci marchent aujourd’hui sur un fil, essayant d’éviter tout soutien abusif ou toute rupture abusive de contrat. Et question image, elles n’ont pas du tout envie de porter la responsabilité de ce désastre industriel. « Meunier a mis les banques dans la seringue et ces dernières ne sont pas contentes », croit savoir une source présente dans le dossier. Une fois encore, le capitalisme français semble devenu ivre de l’ardoise magique permise par cette nouvelle procédure de sauvegarde accélérée. « Manifestement, Bébéar aujourd’hui s’appelle Kohler », ironise la même source. À se demander si la chute d’Atos n’est pas voulue pour mieux assurer un dépeçage à l’abri des regards.
17.09.2023 à 19:09
P4 de Wuhan : quand les « éléments de langage » français tombent à l’eau
Marc Endeweld
Texte intégral (6712 mots)
Le laboratoire haute sécurité de Wuhan dit « P4 » ou « BSL 4 » (biosafety level 4), construit avec l’aide de la France, est un dossier en train de devenir dans notre pays une véritable cold case, une affaire classée. Depuis bientôt quatre ans, aucun responsable politique ne s’est emparé du sujet, de la majorité aux partis d’opposition les plus contestataires. Au parlement, aucune commission d’enquête n’a été mise en place. Aucun responsable français ayant participé au programme d’échange technique et scientifique entre la Chine et la France, lancé après un accord d’État à État signé en 2004 sous l’impulsion de Jacques Chirac, n’a été interrogé.
Alors qu’aux États Unis, l’hypothèse d’une fuite de laboratoire à Wuhan à l’origine de la pandémie de Covid 19 a suscité un vaste débat national, au vu des collaborations scientifiques entre les deux pays, en France, on attend que les scientifiques se prononcent définitivement sur cette hypothèse. En l’absence de réponse, pas question en France d’en faire un sujet de polémique médiatique (en dehors de quelques articles de presse, notamment dans Le Monde via le travail du journaliste Stéphane Foucart ou Le Point qui y a consacré plusieurs dossiers) ou de susciter un quelconque débat politique sur une éventuelle co-responsabilité du pays. À la télévision, seul Envoyé Spécial sur France 2 s’est emparé du sujet de l’origine de la Covid 19 en mars 2021, ou encore le journaliste politique Patrick Cohen dans l’émission C à vous sur France 5 en juin 2022 qui en a consacré sa chronique (mais en centrant son propos sur le scénario d’un virus qui serait issu de la recherche américaine, voire d’un laboratoire américain… scénario aujourd’hui principalement porté par la diplomatie chinoise).
« En France, il n’y a eu aucune enquête officielle sérieuse sur la question.»
Dans ce contexte, le livre du journaliste Jérémy André « Au nom de la Science » publié au printemps dernier (Albin Michel, 21,90 euros), est salutaire et courageux. Correspondant Asie de l’hebdomadaire Le Point, André expose à ses lecteurs une enquête minutieuse à partir de nombreux documents exclusifs. Et au terme de celle-ci, il ne peut que déplorer dans sa conclusion : « En France, il n’y a eu aucune enquête officielle sérieuse sur la question. Maintenant que la sidération provoquée par les premières années de la pandémie est passée, il serait temps que l’opinion et les parlementaires se réveillent et exigent de l’État des réponses à ces questions : pourquoi l’accord de coopération entre la France et la Chine de 2004 ne nous a pas permis de mieux gérer le Covid 19 ? L’institut Pasteur, Alain Mérieux ou l’exécutif français ont-ils pu être informés de ce qui s’est passé à Wuhan ? »
Comme je le soulignais dans mon livre L’Emprise (Seuil, janvier 2022, Points, juin 2023), dans lequel je consacrais un chapitre à la pandémie de Covid-19 (« Les mystères de Wuhan »), si l’hypothèse d’une fuite de laboratoire n’est toujours pas avérée sur un plan scientifique, l’absence de transparence de la Chine comme des autres États sur les laboratoires haute sécurité devrait au moins susciter des questions, tant dans les médias qu’au sein de la représentation nationale dans un pays démocratique comme la France.
Depuis trois ans, tout au long de ses articles d’enquête pour Le Point sur la pandémie de Covid 19 et sa gestion par l’État français, Jérémy André a patiemment produit ce travail journalistique de transparence. Son livre traite autant de la réaction de l’État français à la pandémie de Covid-19 que des questions relatives à l’origine du virus, qu’aux débats aux États-Unis. Une enquête tout azimut, sur plusieurs continents. Sur le volet français de l’affaire, c’est grâce à Jérémy André qu’on a appris que début janvier 2020, Jérôme Salomon, directeur de cabinet d’Agnès Buzyn, alertait par SMS sa ministre sur la présence d’un laboratoire P4 à Wuhan alors que les premiers signes d’un début d’épidémie dans la mégalopole chinoise se multipliaient.
« Mardi 7 janvier, à 18h08, Agnès Buzyn envoie un court SMS à Jérôme Salomon, le directeur général de la santé :
- Des nouvelles de l’épidémie chinoise ? demande-t-elle.
- Élément troublant, Wuhan abrite le P4, précise Salomon.
- Le P4 n’est a priori pas fonctionnel, répond la ministre.
- A priori, lâche le DGS, mystérieux.»
« Le but est de dire que c’est un labo chinois géré par les Chinois »
C’est ainsi que quelques jours plus tard, la ministre de la santé envoie à ses « chefs » directs, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, deux SMS quasi identiques dans lesquels elle « suspecte le labo P4 de manipuler le virus », comme le dévoile Jérémy André dans « Au nom de la science ». La ministre demande immédiatement à ses collaborateurs de vérifier auprès du SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale). Rapidement, des « éléments de langage » sont également commandés par le cabinet de la ministre de la Santé qui se demande comment gérer les premiers articles de presse à propos de la présence d’un laboratoire haute sécurité à Wuhan : « Le sujet P4 monte, je veux bien une première trame dès que possible », écrit dans un mail le conseiller crise de la ministre au SGDSN. Jérémy André dévoile alors la réponse du SGDSN sous la forme d’une note confidentielle transmise au cabinet de la ministre :
« En 2017, les autorités chinoises ont informé la France de leur décision d’accréditation de ce laboratoire pour manipulation effective de pathogènes de classe 4 limités à Ebola, Nipah et au virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo.
Sur la période considérée, aucune information ou indication d’activité ne permet d’envisager la présence de pathogènes autres que ceux pour lesquels le laboratoire est accrédité ».
En guise de commentaire sur cette note confidentielle, Jérémy André cite anonymement dans son livre un conseiller à la Direction Générale de la Santé : « le but est de dire que c’est un labo chinois géré par les Chinois ». Cette citation permet manifestement au journaliste d’ironiser sur la situation.
Préparer des « EDL sur le P4 de Wuhan »
Car cette note va très vite servir de base pour les différentes sources officielles de l’État français, leur permettant ainsi de multiplier les « off » auprès des journalistes qui commencent à poser des questions sur le dossier P4 Wuhan en ce début de pandémie, alors que les réseaux sociaux bruissent de rumeurs. Très vite après cette demande auprès du SGDSN, la ministre avait ainsi demandé à son directeur de cabinet de préparer des « EDL sur le P4 de Wuhan », comme on l’apprenait déjà dans un long article du Point en juillet 2022. Par « EDL », comprendre les fameux « éléments de langage » à utiliser auprès de la presse ou tout autre interlocuteur.
Dès le 30 janvier 2020, dans une interview sur le site internet de Marianne, le journaliste Antoine Izambard, du magazine Challenges, qui avait écrit quelques mois plus tôt un livre sur les relations entre la France et la Chine (Il avait consacré un chapitre entier au P4 de Wuhan et s’était rendu sur place pour visiter le laboratoire en 2019), explique ainsi : « Le P4 a été par ailleurs accrédité par les autorités chinoises pour effectuer des recherches sur les virus Ebola, la fièvre hémorragique de Congo-Crimée (CCHF) et le Nipah (NiV) mais toujours pas pour le SRAS ou les coronavirus. »
Alors que les utilisateurs des réseaux sociaux commençaient à faire « monter » dès janvier 2020 la thématique du laboratoire haute sécurité P4 à Wuhan, il s’agissait donc d’assurer qu’il ne pouvait y avoir de liens entre la pandémie de Covid 19, une maladie liée à un coronavirus, et les éventuelles activités au sein du P4 de Wuhan, en partie construit avec l’aide de la France, rappelons-le.
Réunions de l’OMS à huis clos à Genève en janvier 2020
De mon côté, ce n’est pas après coup que j’ai pris connaissance de cette interview d’Antoine Izambard dans Marianne. Dès janvier 2020, je l’ai lue attentivement car, comme je l’explique dans L’Emprise, j’étais informé au même moment par une très bonne source de l’état des discussions au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur l’émergence de ce coronavirus à Wuhan, alors que des réunions de crise avaient été convoquées en urgence au siège de l’organisation à Genève.
Ces discussions se tiennent à huis clos au comité d’urgence de l’OMS, et elles sont alarmantes : ma source m’explique que la situation est en réalité « très grave », « hors de contrôle » même, que le virus se transmet principalement par « aérosolisation » (par l’air donc), et que sa séquence génétique est considérée comme « suspecte » au sein de ces réunions de l’OMS. Les scientifiques qui participent alors à ce comité d’urgence craignent un « gros risque de mutation du virus » en l’absence de vaccin et l’« aggravation de sa viralité », et prédisent déjà une « récurrence constante l’année prochaine ». Dans un échange de SMS datant du 10 février 2020 que j’ai pu consulter des mois après, entre une de mes sources et une responsable haut placée dans la structure sanitaire mondiale qui participait à ces réunions, les éléments sont même plus précis : « la source labo (manipulation) se confirme elle me dit ».
Le jour suivant, le 11 février, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tente d’ailleurs d’alerter l’opinion publique mondiale en qualifiant l’épidémie de « très grave menace » pour le monde, en préambule d’une conférence de presse qui passe inaperçue dans les médias français, bientôt focalisés sur l’« affaire » des sextapes de Benjamin Griveaux.
Justement, à la fin février 2020, n’étant pas un spécialiste de ces sujets et étant incapable de vérifier ces éléments immédiatement, je me contente de relayer sur twitter, onze jours plus tard, une nouvelle conférence de presse du patron de l’OMS dans laquelle ce dernier explique que « le virus est aéroporté » (ce que les autorités sanitaires françaises et les responsables politiques nient alors au grand public) et qu’il a « plus de puissance, de virulence » qu’Ebola, bien que les deux virus sont très différents (le second étant plus létal) : « Nous le prenons plus au sérieux », souligne ainsi le patron de l’OMS. Une alerte significative mais, à l’époque, certains médecins « experts » des plateaux de télé continuent de présenter ce virus comme une grippe un peu rude…
On l’a oublié, mais le sentiment alors dominant en coulisses est qu’il ne faut surtout pas provoquer de panique parmi la population. Et puis, les médias restent focalisés sur l’affaire Griveaux. Résultat, quelques jours plus tard sur Facebook, alors que j’ai écrit un statut pour expliquer que ce nouveau coronavirus se transmet par l’air, certains de mes contacts ironisent sur le « sensationnalisme » de ma modeste alerte.
Du Washington Post à Rupert Murdoch
En Chine, Wuhan est la Mecque de la recherche virologique. En plus de l’Institut de virologie, sont installés dans cette mégalopole de 11 millions d’habitants une grande université, un institut de technologie, l’université agricole de Huazhong ou encore le Centre de contrôle des maladies de la province du Hubei. Toutes ces institutions disposent de laboratoires de type BSL-2 ou BSL-3, des niveaux de sécurité inférieurs au BSL-4. Les services de renseignement du monde entier se sont pourtant focalisés sur le laboratoire BSL-4, livré par la France, car cette technologie est duale, c’est-à-dire utilisable pour des activités à la fois civiles et militaires.
Dans la presse mondiale, il faudra attendre le printemps 2020 et deux grands articles du Washington Post pour que le sujet des laboratoires de Wuhan commencent à être sérieusement évoqué. Le premier, publié dès le 4 avril, est celui de David Ignatius, qui envisage l’hypothèse d’une fuite de laboratoire. Le second, écrit par le journaliste Josh Rogin, révèle le 14 avril deux câbles diplomatiques (des messages transmis par l’ambassade américaine de Pékin) faisant état des doutes de diplomates américains quant aux conditions de sécurité des expériences menées à l’Institut de virologie de Wuhan qu’ils avaient pu visiter en janvier 2018. Dès le lendemain, lors d’une conférence de presse, le président Donald Trump annonce que les États-Unis mènent une enquête sur le laboratoire. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle au niveau international. Le 16 avril, dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron évoque à demi-mot le sujet : « il y a clairement des choses qui se sont passées que nous ne savons pas ».
À la même époque, cela a été peu relevé en France, mais l’Australie, par l’intermédiaire de son Premier ministre Scott Morrison, réclame également une enquête indépendante sur ce qu’il s’est passé en Chine et sur l’origine du virus. Au niveau de la presse mondiale, c’est d’ailleurs les journaux appartenant à Rupert Murdoch, le magnat australien, qui ont été les premiers à relayer avec force l’hypothèse d’une fuite du virus et qui ont mené des grandes enquêtes sur les laboratoires de Wuhan (notamment The Wall Street Journal, The New York Post, The Times), alors qu’à l’inverse des institutions de presse comme The New York Times ou The Guardian ont toujours été prudentes vis-à-vis d’une telle hypothèse, privilégiant le scénario d’une émergence via une zoonose.
Il n’existe pas de réglementation internationale sur les P4
En France, la presse, du Figaro à Radio France, commence à publier une série d’articles sur le fameux laboratoire P4 de Wuhan à partir de la fin avril 2020. Dans ces articles, il est souvent rappelé que les coronavirus ne sont généralement pas étudiés dans ce type de laboratoires de très haute sécurité. Mais comme je l’avais rappelé dans L’Emprise, il n’existe pas, en réalité, de réglementation internationale à ce sujet comme me l’avait expliqué une experte de l’OMS. « En général, un pathogène est supposé n’être manipulé que dans la classe de laboratoires correspondante mais il n’y a pas de réglementation internationale, et même au sein de chaque pays la règle peut varier », écrit aujourd’hui avec justesse Jérémy André. Autre élément de langage largement relayé au printemps 2020 : ces laboratoires P4 sont infaillibles, un accident d’exploitation ne peut survenir. Or, lorsque j’avais enquêté pour L’Emprise, j’avais découvert au contraire que la technologie du confinement (issue des recherches dans le nucléaire tant en France qu’aux États-Unis), n’avait jamais été infaillible et que nombreux incidents étaient survenus par le passé.
Enfin, tous ces articles publiés alors dans la presse française au printemps 2020 soulignent aussi l’inexistence depuis plusieurs années de collaboration active entre l’Institut de virologie de Wuhan et les différentes institutions françaises. Il est expliqué que les responsables chinois n’auraient pas joué le jeu de la coopération pourtant prévue initialement, et que les scientifiques français auraient été peu à peu mis à l’écart. Dans un long article du Point, dans lequel interviennent publiquement différents responsables politiques français, notamment les anciens Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et Bernard Cazeneuve, l’histoire racontée est quelque peu différente : la responsabilité de la faible coopération n’est plus mise sur le dos des Chinois, mais sur celui des hauts fonctionnaires de la défense en France, qui se sont toujours opposés à l’ouverture d’un laboratoire P4 en Chine, craignant notamment le détournement de cette technologie à des fins militaires.
Le 7 mai 2020, la Chine réagit aux accusations et rappelle notamment que « le labo P4 de Wuhan est [le fruit d’] une collaboration entre les gouvernements chinois et français ». Deux jours plus tard, le 9 mai, une dépêche AFP confirme, en forme de réponse, que le laboratoire P4 de Wuhan « mène des recherches avec des scientifiques français », mais que « cette collaboration, entamée en 2017, est encore balbutiante ». Dans cet article, on apprend qu’il existe « un grand programme » en cours entre la France et le laboratoire P4 de Wuhan sur le virus Nipah, un pathogène très dangereux découvert en Asie du Sud-Est. On le voit, côté français, les éléments de langage se multiplient en ce printemps 2020, et se contredisent parfois, entre « collaboration balbutiante » et « grand programme ».
L’institut Pasteur a signé un accord de collaboration avec le P4 de Wuhan
Or, comme je l’ai découvert en enquêtant pour mon livre L’Emprise, les liens entre la communauté scientifique française et l’Institut de virologie de Wuhan sont loin d’être coupés lorsque survient la pandémie de Covid-19. Et à travers son livre « Au nom de la science », Jérémy André apporte de nouveaux et nombreux détails confirmant mes informations. Dans un chapitre intitulé « Que cache Paris ? », il dévoile ainsi que Christian Bréchot, directeur du réseau Pasteur, a lui-même signé un accord en 2016 avec l’académie des Sciences chinoises selon lequel Pasteur Shanghai et l’Institut de virologie de Wuhan étaient censés établir un « laboratoire de recherche commun ». Fin 2017, le projet a commencé à se matérialiser avec la signature d’un nouvel accord, le « G4 », groupe de recherche de quatre ans, basé à l’Institut Pasteur Shanghai (IPS), et unissant le P4 de Wuhan, l’Académie des sciences chinoise, l’Institut Pasteur et la fondation Mérieux, doté de 150 000 euros annuels.
À l’été 2018, Frédérique Vidal, alors ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur est en visite en Chine accompagnée d’Yves Lévy, patron de l’Inserm et alors président du comité de pilotage des accords entre la Chine et la France de 2004 (il est par ailleurs le mari d’Agnès Buzyn). Vidal et Lévy tombent de leur chaise, selon le récit qu’en fait Jérémy André, quand ils apprennent que l’institut Pasteur (via son laboratoire de Shanghai) a signé un accord de collaboration avec le P4 de Wuhan en lisant cette note confidentielle préparée par l’ambassade française :
« L’accord G4 signé en avril 2018 par la Fondation Mérieux, l’Institut Pasteur Paris, l’Académie des sciences de Chine et l’institut Pasteur de Shanghai a été monté dans l’esprit d’être rapidement opérationnel : équipes de chercheurs identifiées, avec des moyens financiers confirmés et un plan de mise en oeuvre sur cinq ans. Il intègre largement la finalité sociale et sociétale de la lutte contre les MIE [maladies infectieuses émergentes] et pourrait constituer une bonne base pour initier rapidement des projets dans le P4 de Wuhan et y assurer une présence française dans le cadre de son utilisation ».
La délégation française en Chine apprend alors que des recrutements ont déjà été opérés ou sont en cours. Cette collaboration a pourtant toujours été niée par l’institut Pasteur à Paris : « Interrogée par mail sur le fait que sa page de lutte contre la désinformation nie toute coopération avec les laboratoires de Wuhan, la communication de Pasteur n’a pas répondu à nos questions », précise Jérémy André. Face à la presse, l'institut Pasteur, qui, au cours de la pandémie, a très peu communiqué contrairement à l’institut allemand Robert-Koch, a semble-t-il choisi l’opacité et la rétention d’informations. Ainsi, lors de mon enquête, un scientifique de Pasteur, que j’avais interrogé en « off », m’avait assuré que la direction de la communication de son institution lui avait demandé au printemps 2020 de ne pas évoquer l’hypothèse d’une fuite de laboratoire à Wuhan dans ses déclarations publiques. En mars 2023, Pasteur a en tout cas décidé de se retirer de son antenne chinoise à Shanghai.
Désaccords entre Lévy et Gourdault-Montagne sur l’accréditation du P4
Ces incohérences de Pasteur ne sont pas les seules « bombinettes » que dévoile Jéremy André dans son livre. Au journaliste du Point, Yves Lévy assure ainsi s’être opposé avant 2018 à l’accréditation du laboratoire P4 par la France, une accréditation pourtant promise en plus haut lieu au début du quinquennat d’Emmanuel Macron : « La responsabilité de l’accréditation et de la qualité, c’est de la responsabilité des Chinois. Depuis le début, je suis en opposition avec cette décision, témoigne Yves Lévy, qui a été prise au ministère des Affaires Étrangères en présence de Mérieux par Maurice Gourdault-Montagne, alors secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et qui a été de promettre que la France devait assurer la partie technique. Nous ne pouvons pas assurer la partie technique. » Pourtant, à travers un avenant à l’accord de 2004 obtenu par les Chinois et signé quatre plus tard, il était bien écrit « noir sur blanc que la France fournirait une “assistance technique” pour la “conformité aux normes” », comme le souligne Jérémy André. Rappelons au passage que Maurice Gourdault-Montagne était ambassadeur à Pékin entre 2014 et 2017, et a été nommé secrétaire général du Quai d’Orsay entre 2017 et 2019, par Emmanuel Macron en personne et contre l’avis du cabinet de Jean-Yves le Drian au ministère des Affaires étrangères.
Ce désaccord entre Lévy et Gourdault-Montagne est illustré par une note blanche datant 18 juillet 2018 produite par les services de l’Inserm, dans laquelle est souligné que « la notion de la responsabilité de la France en cas de problème survenant au cours de l’exploitation du P4 de Wuhan semble mal encadrée ». Surtout, dans ce document dévoilé dans le livre de Jérémy André, il est mentionné que l’Inserm avait été averti par la Chine que le laboratoire P4 de Wuhan était alors en phase de test avec des pathogènes de classe 3 comme des coronavirus : « Nous avions d’ailleurs été informés par la partie chinoise que la prise en main du laboratoire devait être réalisée avec l’usage de pathogènes de groupe de risque 3 pendant un an ». Cette note blanche se fait aussi l’écho d’alertes sur la sécurité du laboratoire P4 émises par des sources françaises. Mais comme le souligne Jérémy André, Yves Lévy n’aura pas le temps de faire valoir son point de vue au sein de l’État, car à l’été 2018, le patron de l’Inserm, après quatre ans de service, doit renoncer à un second mandat.
Des pathogènes de classe 3 utilisés dans le P4 de Wuhan
En tout cas, avec cette note blanche de l’Inserm qui dévoile que l’Institut de virologie de Wuhan a bien utilisé dans son laboratoire P4 des pathogènes de classe 3, comme les coronavirus, au moins jusqu’en 2019, c’est tous les éléments de langage français initiaux qui tombent à l’eau. Dès février 2017, un article publié dans la revue Nature évoquait les futures recherches au sein du laboratoire P4 de Wuhan, et notamment celles portant sur le virus de la fièvre hémorragique Crimée Congo présenté alors comme un pathogène de classe 3.
Alors que l’hypothèse d’une fuite de laboratoire est aujourd’hui toujours mise sur la table par l’OMS comme celle d’un scénario zoonose au sujet de la recherche de l’origine du Sars Cov 2, il serait ainsi nécessaire de se distancier des éléments de langage et de considérer toutes les pistes possibles, indépendamment des éventuelles conséquences politiques et diplomatiques. Dans une récente interview au Financial Times, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dit souhaiter qu’une nouvelle mission d’enquête soit envoyée en Chine avec un « accès total ».
Comme le conclut Jérémy André dans son livre : « La France elle-même a ses secrets. Elle craignait depuis des années un accident de laboratoire à Wuhan. Elle s’est abritée quand la pandémie a éclaté derrière des éléments de langage : le P4 ne travaillerait pas sur les coronavirus ; il n’y avait plus de coopération ; c’était une affaire chinoise. Mais faute d’enquête ouverte, rien n’exclut en réalité que le P4 ou la France aient été impliqués dans des recherches qui auraient provoqué un accident ». Parmi les multiples secrets de la France : comment, et surtout à partir de quand, l’État français a-t-il été tenu au courant de ce qui se passait à Wuhan ? Comme je l’expose avec de nombreux détails dans L’Emprise, manifestement bien plus tôt que l’histoire racontée jusqu’à présent à partir du storytelling de certains officiels.
12.09.2023 à 00:24
Retour sur un scoop : quand Valls a voulu démissionner de Matignon...
Marc Endeweld
Texte intégral (5760 mots)
Il y a quelques jours, j’ai rencontré un jeune journaliste politique qui m’avait proposé de prendre un café pour parler du métier. Ce dernier connaissait mon travail d’enquête, et il était curieux de connaître certaines de mes ficelles pour dénicher des infos : « Mais comment arrives-tu à te glisser au coeur du réacteur sans être physiquement présent ? » me demande-t-il en substance.
Parmi les conseils que je lui donne alors : il n’y a rien de mieux que d’élargir au maximum ses sources pour récupérer des scoops. Bref, il s’agit de ne pas en rester au off des entourages politiques qui ont souvent plus intérêt à « ambiancer » les journalistes, et à leur transmettre les fameux « éléments de langage ».
Quand la petite histoire politique se fait, ces entourages ont en fait une peur panique que les journalistes découvrent la réalité des coulisses, la véracité des rapports de force. Pas question pour eux que leur ministre ou leur élu puisse apparaître en mauvaise posture. Pas question que leurs manigances, leurs tactiques, soient dévoilées avant d’être éprouvées, et surtout avant qu’elles puissent être « vendues » aux Français par des stratégies de com’ et d’image. En politique, il est toujours dangereux de trop en dire. Et souvent, les meilleurs réussissent à taire leurs ambitions.
Mais que signifie élargir au maximum ses sources ? Notamment pour un journaliste politique ou un journaliste tout court ? Il s’agit avant tout de ne pas privilégier un entre soi, et de considérer qu’aucune source n’est mauvaise en soi. Même en couvrant la politique, et peut-être surtout quand vous êtes chargé de la suivre, je conseille ainsi de rester en contact constant avec des chefs d’entreprise, des relais d’opinion associatifs, des capteurs locaux dans les circonscriptions loin de Paris, des simples citoyens intéressés par la politique et qui peuvent échanger avec leurs élus, mais également Français expatriés, soutiens financiers d’éventuels candidats, policiers, magistrats, analystes financiers ou artistes… Car toute ambition présidentielle ne naît jamais de nulle part. Chaque responsable politique a son terreau de départ, c’est au journaliste de le découvrir, d’en comprendre son histoire. Et ce souci d’un carnet d’adresses (et de sources) diversifié est le meilleur moyen d’échapper au phénomène de la « bulle médiatique » qui a souvent trop tendance à s’auto-intoxiquer en meute.
« Je ne me vois pas à 60 ans faire de la politique »
Entre 2014 et 2015, quand j’avais enquêté sur Emmanuel Macron, nommé tout juste ministre de l’Économie, pour Marianne puis pour mon livre L’Ambigu Monsieur Macron (Flammarion, 2015, Points Seuil, 2018), j’avais élargi au maximum mes sources : j’avais ainsi exhumé une partie de son réseau d’affaires (à travers une centaine d’entretiens on et off), notamment à la banque Rothschild, sur la place de Paris, à l’Inspection Générale des Finances… J’avais également rencontré l’un de ses premiers mentors, Henry Hermand, l’industriel des centres commerciaux, et l’ami (et soutien financier) de Michel Rocard…
Et c’est en parlant avec l’ensemble de ces contacts, pourtant fort éloignés en apparence de la bulle politique, que j’avais compris qu’Emmanuel Macron était en train de se préparer à la présidentielle de 2017. Quand je l’avais interviewé à l’été 2015 dans le cadre de ce livre, il m’avait d’ailleurs donné un indice, une manière subtile de confirmer mon enquête : « Il faut se donner une durée : pas plus de dix ou quinze ans en politique. Je ne me vois pas à 60 ans faire de la politique. Il ne faut pas essayer de durer, mais de faire ». À l’époque, à ses communicants control freaks issus d’Havas (notamment le fameux Ismaël Emelien), j’avais accordé poliment un droit de lecture des citations (et non une réécriture, qui signifie souvent un off imposé après coup, et j’avais été très clair à ce sujet, relecture ne signifie pas réécriture…).
Or, malgré mes conditions très strictes, ces communicants avaient osé me demander d’enlever cette fameuse citation, trop révélatrice à leur goût de la suite des événements (d’autant plus qu’ils avaient compris que j’avais compris que leur champion Macron allait bien faire le grand saut de la présidentielle, dès 2017). J’avais bien évidemment refusé de supprimer cette citation de mon ouvrage (citation qui confirmait la conclusion de mon enquête !) malgré les cris d'orfraie de mes interlocuteurs : « Ce n’était pas le deal ! » Si, si, quand on accorde une interview, bien évidemment que c’est au journaliste de conserver le final cut des citations. Sinon, autant passer à l’IA.
Pour revenir au sources : en réalité, l’intérêt, la fiabilité et la crédibilité d’une source se teste sur le temps, au gré des informations qu’elle transmet. Pour un journaliste, il n’y a rien de pire que l’expression « les milieux autorisés me disent que… » Autorisés par qui et pour quoi ? Si, par cette expression, il s’agit de nommer pudiquement au public les fameux conseillers communication… c’est réduire particulièrement la fonction du journalisme au rôle de porte-voix. Or, enquêter, « construire » une information, en la dégotant puis en la vérifiant, sans forcément être « autorisé » par les communicants, est normalement la base du métier.
Quand j’apprends que Valls prépare sa sortie et va démissionner
Ces réflexions au sujet des sources me font penser à un autre épisode intéressant, et pour le moins méconnu, encore aujourd’hui. Fin 2016, le 27 novembre exactement, Manuel Valls accorda une interview assez franche au JDD dans laquelle il semblait annoncer une prise de distance à l’égard de François Hollande, son patron : « La loyauté n'exclut pas la franchise », balançait-il alors. Commentaire à l’époque du Journal du Dimanche : « Face au "doute" et au "désarroi" qui minent la majorité, le Premier ministre Manuel Valls accentue la pression sur François Hollande. Il n'exclut plus désormais d'être candidat contre lui à la primaire de la gauche.»
Or, au cours de ce week-end, j’apprends via une source dans le milieu de l’audiovisuel que Manuel Valls est clairement en train de préparer sa sortie, et qu’il a même décidé de démissionner le lundi qui suit. Pourquoi l’audiovisuel ? Tout simplement parce qu’à l’époque une pièce centrale de la future campagne travaillait pour la RTBF, la Radio Télé belge francophone, et que j’apprends par ma source initiale, que ce cadre a été démarché très explicitement par l’entourage de Manuel Valls pour rejoindre sa future campagne. Ces précisions, et la qualité de la source initiale que j’avais eu l’occasion de « tester » les mois précédents, m’amenait à penser que ces éléments étaient particulièrement « bétons ».
Le jour dit, pourtant, après la visite de Manuel Valls à l’Élysée, rien ne se passe comme prévu. J’essaye d’en savoir plus auprès d’autres sources, pour le coup, au coeur de la machine du PS de l’époque. J’arrive à me faire confirmer par deux contacts, notamment un hiérarque du PS, que Manuel Valls est bien venu voir François Hollande pour lui annoncer sa démission surprise, mais que rien ne s’est passé comme prévu. Comment le président a-t-il réussi à bloquer la démission de son Premier ministre ?
À l’époque, j’en parle rapidement à la direction de Marianne, mais les premières réactions sont prudentes, voire timorées : cette histoire de démission avortée leur apparaît farfelue. J’explique alors aux intéressés que j’ai pourtant déjà recoupé (c’est-à-dire vérifier auprès d’autres sources non liées entre elles) une bonne partie des mes informations, et que malgré l’aspect invraisemblable d’un tel projet de démission du Premier ministre, c’est bien ce qui était alors mis sur la table au plus haut niveau de l’État. À Marianne, comme souvent, c’est Soazig Quéméner, la rédactrice en cheffe alors chargée de la politique (elle vient d’arriver dans l’équipe de La Tribune Dimanche), qui me pousse à creuser ma piste. Elle, est enthousiaste. Elle sait que j’ai eu souvent par le passé une capacité à sortir des infos (il faut dire c’était tout juste un an après la sortie de mon livre, le premier, sur Emmanuel Macron).
Le temps presse, et je propose alors à Soazig de m’aider à travailler sur un projet d’article écrit à quatre mains. Dans un premier temps, comme elle sait que je suis à l’origine de ces informations, elle hésite avec élégance à « s’inviter » dans le papier en le cosignant, malgré mon invitation. Lundi soir, je lui explique qu’en si peu de temps (en gros un peu plus de 24 heures avant le bouclage de Marianne), il serait peut-être hasardeux pour moi de me lancer seul afin de bétonner totalement le papier comme me le demandait la direction.
Éléments d’ambiance et recoupements
Ce lundi soir, une ambiance étrange s’empare de l’entourage de François Hollande, comme un silence, un malaise… chacun se demande ce que va faire le président, acculé par ses propres troupes depuis plusieurs semaines après l’ouvrage de Davet et Lhomme, comment va-t-il pouvoir rebondir. Finalement, l’info qu’Hollande a confié à son Premier ministre qu’il allait se retirer de la course présidentielle, qu’il allait l’annoncer dans les prochains jours, et qu’il n’était donc pas nécessaire de démissionner, me parvient (et non par un coup de pression comme je l’avais supposé au début des premiers recoupements).
Ensuite, je n’en ai plus totalement le souvenir, mais à force de vérifications, et dès lors qu’une première version du papier était prête et présentée, le directeur de la rédaction, Renaud Dély, ancien rédacteur en chef politique de Libération, a senti, lui aussi, le scoop venir, et s’est mis à se renseigner auprès de ses sources historiques, notamment un hiérarque du PS que j’avais moi même interrogé quelques heures plus tôt, et qui m’avait en grande partie confirmé l’histoire. C’est alors qu’on a pu rajouter encore quelques éléments d’ambiance supplémentaires à l’article final, au sujet de la fameuse rencontre à l’Élysée entre Manuel Valls et François Hollande, avec quelques propos rapportés (De deuxième main donc).
Et c’est ainsi que le vendredi 2 décembre 2016 le nouveau Marianne en kiosques a pu afficher fièrement cette manchette « Le jour où Hollande a dit qu’il ne serait pas candidat… et où Valls a choisi de le croire », moins de douze heures après l’allocution officielle à la télévision du président Hollande dans laquelle il expliquait aux Français qu’il avait décidé de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2017. Mieux qu’un épisode d’House of Cards ou du Baron Noir.
Couverture du magazine Marianne du 2 décembre 2016, publié le lendemain de l’allocution présidentielle dans laquelle François Hollande annonce aux Français qu’il ne se présentera pas à l’élection présidentielle de 2017.
Et voici l’article, exclusif à l’époque, publié dans ce fameux numéro (je remercie au passage Natacha Polony, l’actuelle directrice de Marianne de m’avoir autorisé à le publier aujourd’hui in extenso via ma newsletter) :
Le jour où Valls a choisi de croire Hollande
Par Marc Endeweld, Soazig Quéméner, Renaud Dély (Marianne, 2016)
Décidé à démissionner de Matignon pour se lancer dans la course à l'Elysée, Manuel Valls n'en a rien fait. Le président lui a en effet laissé entendre que lui-même ne serait peut-être pas candidat. Récit.
Tout était décidé, tout était prêt. Manuel Valls avait organisé son évasion.
Cette semaine, ce mandat présidentiel qui ne ressemble décidément à aucun autre a été à deux doigts d'enregistrer le départ du Premier ministre, en plein état d'urgence et alerte terroriste maximale. Selon nos informations, le locataire de Matignon était bel et bien déterminé à annoncer sa démission à François Hollande lundi dernier à la mi-journée. Trois mois après le départ d'Emmanuel Macron, et surtout quinze jours après l'annonce de la candidature de cet ex-ministre de l'Economie qui l'obsède au plus haut point, le « M. 5 % » de la primaire de 2011 souhaitait à son tour se lancer dans la course à l'Elysée.
Ce lundi 28 novembre, comme chaque semaine, Manuel Valls est attendu à l'Elysée à 12 h 30 pour un tête-à-tête avec François Hollande. Exceptionnellement, une demi-heure plus tôt, le chef du gouvernement a un autre rendez-vous, avec le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Il l'accueille dans son bureau à midi, au premier étage de l'Hôtel Matignon. Valls lui déclare aussi sec son intention de démissionner pour annoncer sa candidature à la primaire de la gauche fin janvier. Pour justifier sa décision, le chef du gouvernement évoque une nouvelle fois la « colère » des élus socialistes à l'encontre de François Hollande depuis la publication de son livre de confidences, l'image brisée du président dans l'opinion, et le besoin d' « autorité » et d' « incarnation » qui remonterait, selon lui, des tréfonds du pays. Jean-Christophe Cambadélis le met en garde contre le rapport de forces au sein du parti qui lui serait défavorable. Il en appelle surtout à son « sens de l'Etat » pour ne pas commettre l'irréparable. Ebranlé par la réaction du premier secrétaire du PS, Manuel Valls n'en reste pas moins décidé à remettre sa démission à François Hollande lorsqu'il arrive à l'Elysée. Avant de quitter Matignon, le Premier ministre convoque d'ailleurs son cabinet restreint pour le début d'après-midi. Il a prévu d'officialiser son départ à ce moment-là devant son cercle de proches, à son retour de l'Elysée.
Valls passe la Seine pour se rendre chez son supérieur. A l'Elysée, changement de rive, de décor et de ton. Il retrouve d'abord Hollande pour un bref tête-à-tête d'un quart d'heure dans son bureau, au premier étage du Château. L'accueil est frisquet.
« Je ne me présenterai pas contre toi à la primaire », l'assure Valls. « Ce n'est pas ce que j'avais compris en lisant ton interview », réplique Hollande.
La veille, dans le JDD , Valls semblait bien agiter sa candidature quelques heures après que Claude Bartolone a souhaité que les deux têtes de l'exécutif se mesurent à la primaire. Alors que Hollande se trouvait à des milliers de kilomètres de là, retenu au sommet de la francophonie de Madagascar, Valls avait déclenché là un incroyable bras de fer. A la lecture de cet entretien dominical, plusieurs proches du président l'ont d'ailleurs assailli pour lui réclamer la tête de l'insolent et son remplacement par Bernard Cazeneuve à Matignon. François Hollande n'y songe pas un instant.
Aveu de faiblesse
A Matignon, Valls est ligoté, pas question de le virer et de lui rendre sa liberté. C'est pourquoi ce lundi, quand son second précise sa pensée, Hollande comprend aussitôt ce qu'il a en tête . « Il ne peut pas y avoir d'affrontement institutionnel. Je ne me présenterai pas en tant que Premier ministre », insiste Valls. C'est donc qu'il s'apprête à partir... Pour l'en empêcher, le président change d'attitude lors de leur déjeuner qui commence vers 13 heures, au rez-de-chaussée du Château. Après avoir disserté sur les conséquences de la désignation de François Fillon comme champion de la droite, François Hollande reprend l'antienne du « sens de l'Etat » qui doit animer le couple exécutif pour faire face à des circonstances « historiques » difficiles. Puis il évoque longuement l'état du pays, la faiblesse de la gauche et ses profondes divisions. « Qui est le plus à même de la rassembler ? », s'interroge-t-il à voix haute. Le chef de l'Etat fait assaut de lucidité, il reconnaît volontiers l'extrême difficulté de sa situation. Bref, serein, apaisé, il laisse clairement entendre à son hôte qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. François Hollande ne le promet pas explicitement, ce n'est pas son genre. Mais il énumère avec tant de force tous les obstacles, nombreux, divers, insurmontables, qui se dressent sur sa route que son retrait apparaît comme une issue logique. Il conclut d'ailleurs en glissant à Valls que s'il n'y va pas, ce sera son tour, « évidemment ».
Le Premier ministre est saisi. Il ne s'attendait pas à un tel aveu de faiblesse. François Hollande a-t-il bluffé ? C'est possible. Manuel Valls n'est pas dupe. Il connaît l'animal, tout en silences et en allusions. Mais il remballe sa démission pour choisir de lui faire confiance. Une fois encore. Pas le choix. Ce serait trop bête de tout gâcher en déclenchant une crise institutionnelle si le chef de l'Etat confirme dans quelques jours qu'il ne se présente pas.
Quand le « PM » réapparaît à Matignon sur le coup de 14 h 45, il est rouge, tout rouge. De fureur... envers lui-même. Son plan savamment pensé s'est écroulé : il n'a pas pu présenter sa démission. Devant ses collaborateurs, Manuel Valls ne cache pas sa rage. « "Culbuto" nous tient par les couilles ! » vitupère-t-il. « Culbuto » ? Le surnom aimablement attribué depuis des années au PS au président pour sa faculté à basculer, à presque toucher terre et à toujours réussir à se redresser.
Partie de poker
Pour son plus grand malheur, Manuel Valls a compris qu'il était ligoté à l'annonce de « Culbuto »... Et qu'il n'avait d'autre choix que de l'attendre. Dans la foulée, l'Elysée et Matignon annoncent dans un bel ensemble à l'Agence France presse que l'orage est passé. Circulez, il n'y a plus rien à voir. « Il ne peut y avoir et il n'y aura jamais de crise institutionnelle », déclare officiellement le Premier ministre. « Le président n'a pas encore pris sa décision » , souligne-t-on à l'Elysée en précisant : « Et chaque jour qui passe, le président est de plus en plus mystérieux. » L'arme au pied, Manuel Valls est condamné à la patience, quelques jours encore, convaincu que son tour viendra bientôt.
En attendant, il s'organise et ratisse large, jusque parmi les proches de... Martine Aubry. Samedi soir, un député proche de la maire de Lille adressait ce SMS à de nombreux élus : « Bonsoir, demain dans le JDD, interview de Manuel Valls. Gravité de la situation, nécessité de se rassembler face à la droite, grande exigence sur la qualité de la candidature de la gauche de gouvernement. Nécessité de jouer collectif autour du meilleur. » « Chacun est face à son destin . Manuel Valls a essayé de dire qu' il ne pouvait y avoir de décision solitaire, à l 'usure », résume Francis Chouat, l'actuel maire d'Evry. Un autre fidèle du chef du gouvernement, Christian Gravel, ancien responsable de la communication de l'Elysée, a commencé à démarcher de possibles compagnons de route pour la campagne de son patron. Avec ce message : « Manuel Valls s'en va. Il va l'annoncer à Hollande. Tu viens avec nous ? »
Depuis l'orage du week-end dernier, dans les camps des deux belligérants, on retient son souffle. A l'Elysée, certains conseillers ne répondent même plus au téléphone.
« Je fais silence jusqu'à l'annonce de la décision du PR », explique l'un d'entre eux par SMS. Les vallsistes ne sont pas plus diserts. Après l'ahurissant jeu de dupes de ce déjeuner du lundi 28 novembre, la partie de poker tire à sa fin. Ce jeu puéril et mortifère entre deux hommes à qui les sondages promettent au mieux la cinquième place dans l'ordre d'arrivée à la présidentielle exaspère la gauche entière.
La primaire en question
Et pendant que Manuel Valls s'applique à maintenir la pression en multipliant les petites phrases à double sens, une campagne parallèle a été engagée par le dernier carré de fidèles de François Hollande. Sur toutes les ondes, ils s'affairent à instiller le doute sur le sens et même la validité d'une primaire tronquée, privée d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, de Sylvia Pinel (PRG) et de l'écologiste Yannick Jadot. « Il faut un rassemblement, déclare Bruno Le Roux, le patron des députés PS. Et aujourd'hui, on voit que la primaire, malheureusement, ne permet pas ce rassemblement. » Sans compter le risque de voir cette consultation virer au référendum anti-Hollande, y compris avec le renfort d'électeurs de droite ou de gauche radicale comme l'a publiquement envisagé Arnaud Montebourg. Une candidature de Hollande hors primaire apparaîtrait sans doute aujourd'hui comme un insupportable fait du prince, et d'un prince tellement affaibli qu'il déclencherait la révolte de ce qui reste de la gauche. Finalement, critiquer comme le font les hollandais la règle du jeu des primaires, et la légitimité d'un scrutin qu'ils avaient pourtant cautionné par l'intermédiaire de Jean-Christophe Cambadélis, n'est-ce pas un moyen de préparer la sortie de leur champion ? De lui chercher une issue de secours ? C'est ce que veut croire Manuel Valls. Patience, plus que quelques jours...
04.09.2023 à 18:19
Groupe Dassault : Charles Edelstenne prépare son départ d’ici la fin de l’année
Marc Endeweld
Texte intégral (1781 mots)
C’est une surprise. Selon mes informations, Charles Edelstenne, tout puissant président directeur général du groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) quitterait la présidence du groupe dès la fin de l’année (ou au plus tard en début d’année), soit un an tout juste avant la date statutaire de la fin de son mandat prévu pour la fin 2024. GIMD détient les participations de la famille dans Dassault Aviation (62%), Thales (25%), Dassault Systèmes (40%), mais aussi Immobilière Dassault, Artcurial, Dassault Wine Estates ou encore le Groupe Figaro.
« Le dossier s’accélère. Edelstenne part plus vite que prévu », me confie ainsi une source bien informée du processus en cours. Aujourd’hui âgé de 85 ans, Charles Edelstenne, le véritable taulier de la maison Dassault, avait obtenu l’année dernière un répit de deux ans supplémentaire à la tête du groupe, en l’absence d’un successeur désigné. Début 2022, il avait donc été décidé de repousser la limite d’âge pour son poste jusqu’à 87 ans.
Départ anticipé pour mieux imposer son successeur
Ce départ anticipé ne signifiera pas une perte d’influence de celui qui a commencé sa carrière comme expert comptable avant de se hisser au plus haut niveau. Bien au contraire : car si Edelstenne a finalement décidé de partir avant la fin de son mandat, c’est pour mieux peser sur le profil de son successeur et le contrôle du groupe, notamment face à la famille Dassault.
De fait, en écourtant son dernier mandat, le patron du groupe essaye d’imposer le profil de son remplaçant pour mieux maintenir son influence au sein du groupe après son départ. Le nom d’Olivier Costa de Beauregard, l’actuel directeur général de GIMD, est évoqué. « Car face à Edelstenne la course est engagée, et tous les actionnaires familiaux ont leur petite idée, la plupart souhaite nommer un profil extérieur à l’éco système Dassault. Il y a des hypothèses extravagantes et en plus ils sont divisés », m’explique mon interlocuteur. Laurent Dassault, qui bataille ainsi depuis de nombreux mois contre Charles Edelstenne, préconise de nommer l’ancien patron d’ATOS, Thierry Breton, actuellement commissaire européen au Marché intérieur.
L’État refuse que la famille joue un rôle
Sauf que le groupe Dassault, qui n’a jamais été aussi riche et puissant industriellement qu’aujourd’hui, n’est pas une entreprise familiale comme une autre. Constructeur du Rafale, l’État reste son premier client et son premier agent commercial à l’étranger. Et l’État, traditionnellement, refuse que la famille joue un quelconque rôle : « L’idée que les enfants Dassault dirigent est une fausse idée, me souligne ainsi un haut fonctionnaire de la Défense. La famille est là pour toucher du fric mais ne commande pas ». D’autant plus que GIMD est l’actionnaire de référence du groupe de Défense Thales, et contrôle de ce fait Naval Group. Ces dernières années, Charles Edelstenne avait d’ailleurs l’habitude de dire aux enfants : « vous êtes les actionnaires, moi le patron, je m’occupe de l’industriel, vous, de vos dividendes ».
De fait, au sein de l’État, les hauts fonctionnaires commencent à perdre patience. Tous aimeraient être fixés sur leur prochain interlocuteur à la tête d’un groupe si stratégique. Mais remplacer Charles Edelstenne n’est pas chose facile. L’homme qui n’est pas un simple manager a su se constituer un véritable pouvoir depuis cinquante ans, et détient tous les secrets du groupe. Ainsi, au-delà de sa personne, c’est la perpétuation du système Dassault qui se pose. « Suite au scandale Agusta en Belgique, Edelstenne est devenu l’homme qui gère les relations avec les responsables politiques. Son remplaçant va devoir se coltiner les politiques », assure un observateur. Irremplaçable Charles Edelstenne ? Le haut fonctionnaire de la Défense que j’ai interrogé n’est pas loin de le penser : « C’est un homme remarquable. Et c’est un mec qu’on ne baise pas sur les chiffres ». Depuis que Marcel et Serge Dassault lui ont proposé d’investir au capital de Dassault Systèmes, une filiale devenue un fleuron de l’électronique qu’il a contribué à créer dans les années 1980, Charles Edelstenne a amassé une sacrée cagnotte : selon Forbes, c’est la 26e fortune professionnelle de France en 2021, avec près de 2,5 milliards d’euros. Cet été, ce patron et redoutable financier a d’ailleurs acheté de nouvelles actions de Dassault Systèmes pour 7 millions d’euros.
Mettre un terme au statu quo historique ?
Dans la bataille qui oppose cet homme de pouvoir à la famille, un premier épisode s’est déroulé au début de l’été. Alors que les enfants avaient tenté de placer l’ancien ministre Alain Lambert à la tête du comité des sages du groupe, Charles Edelstenne avait finalement réussi à imposer Henri Proglio, l’ancien patron de Veolia et d’EDF, à la présidence dudit comité, lieu clé pour contrôler la future succession. De son coté, Henri Proglio serait intéressé de succéder à Charles Edelstenne, mais sans grande illusion : il sait que le président Emmanuel Macron l’a inscrit depuis longtemps sur sa liste noire. À moins que le rapport de force n’ait évolué avec le temps ?
À son époque, Serge Dassault avait d’ailleurs envisagé de nommer Henri Proglio, un profil pour le moins politique, pour succéder à Charles Edelstenne. En attendant, la famille n’a pas dit son dernier mot. Certains souhaiteraient mettre un terme au statu quo historique, et renverser la table. En coulisses, Laurent Dassault caresse toujours l’idée de proposer à Vincent Bolloré d’entrer dans GIMD comme partenaire minoritaire, comme je l’avais dévoilé l’année dernière dans Marianne, espérant ainsi avoir enfin son mot à dire face à l’État.
02.08.2023 à 12:16
Atos / Eviden : les doutes de la "place de Paris"
Marc Endeweld
Texte intégral (2020 mots)
La descente aux enfers du cours de bourse d’Atos continue. Depuis la présentation des résultats semestriels jeudi dernier, la valeur du titre du groupe informatique a en effet chuté près de moitié. Hier matin, la direction d’Atos a tenté de réagir en publiant un long communiqué pour annoncer officiellement le début des négociations exclusives avec Daniel Kretinsky pour le rachat de la filiale Tech Foundations et la participation du milliardaire tchèque à une augmentation de capital du groupe (qui sera appelé Eviden après cession de Tech Foundations), une opération que j’avais annoncée dans mon article dès lundi, « Rien ne va plus chez Atos : vers un démantèlement ? ».
Un nouveau conseil d’administration convoqué en urgence
Dans cet article, j’y soulignais également que le groupe informatique traversait en réalité une grave crise de liquidité, et qu’il était à deux doigt de se retrouver en défaut de paiement, faute de cash. Et ce, malgré les cessions réalisées ces derniers mois ou annoncées prochainement (la direction évoque depuis jeudi dernier de vendre encore pour 400 millions d’euros d’actifs sans préciser lesquels). Pire, je dévoilais qu’Atos allait devoir rembourser sa dette avant la fin 2024. Celle-ci se monte désormais à 2,32 milliards d’euros.
Selon mes informations, Bertrand Meunier a dû convoquer en urgence un nouveau conseil d’administration entre lundi et mardi pour entériner l’officialisation des négociations avec Daniel Kretinsky (qui sera associé dans l’opération à venir du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière), ainsi que la nomination d’un nouveau directeur financier en la personne de Paul Saleh, histoire de calmer les marchés. Ce coup de com’ un 1er août est loin d’avoir convaincu, et ce matin, le cours de bourse d’Atos continuait de chuter. « C’est la panique ! », me confie un cadre du groupe.
Il faut dire que le communiqué d’Atos est particulièrement alambiqué, alternant entre méthode Coué et demi mea culpa. On y apprend ainsi que « le groupe cherchera ainsi à étendre ses échéances et à réduire sa dette, tout en poursuivant la normalisation de son fonds de roulement ». Atos reconnaît donc implicitement que le groupe se retrouve pour l’instant face à de véritables difficultés tant concernant ses liquidités qu’en ce qui concerne sa capacité à rembourser sa dette… à temps.
Dans le fameux communiqué, le groupe tente toutefois de rassurer actionnaires, investisseurs et marché, en réaffirmant que les cessions à venir, ainsi que l’opération avec Daniel Kretinsky, va lui permettre de se rétablir. Une fois séparé de Tech Foundations, le groupe, devenu Eviden, assure pouvoir envisager « d'accélérer sa création de valeur », et se positionner comme « un leader à forte croissance sur les marchés du numérique, du cloud, de la cybersécurité et de l'advanced computing ». Et d’ajouter que le groupe « est confiant dans sa capacité à réaliser ces cessions rapidement.»
Plus de questions que de réponses…
En attendant, on apprend aussi que l’opération à venir avec Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière aura « un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros ». Au regard des enjeux globaux, cette dernière remarque est particulièrement grotesque, et démontre bien la situation particulièrement critique du groupe concernant sa trésorerie. Comme le souligne Le Monde, ces 100 millions d’euros attendus après la cession de Tech Foundations est « une somme extrêmement faible au regard de la taille de Tech Foundations, qui réalise 5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie 52 000 salariés dans le monde ».
Au final, le communiqué d’Atos apporte donc plus de questions que de réponses. Si on comprend que l’augmentation de capital s’élèvera finalement à 900 millions d’euros avec la participation à la hauteur de 217,5 millions d’euros pour Kretinsky et Lacharrière, soit 7,5 % d’Evidian, on a du mal à voir comment l’actuelle direction va pouvoir convaincre le reste des actionnaires de mettre au pot pour compléter cette augmentation de capital. Par ailleurs, dans le cadre de la cession de Tech Foundations, on ne sait pas pour le moment quelle est la part de dette du groupe qui reviendra à l’acheteur… La dette est-elle reprise par Daniel Kretinsky ? Dans quelle proportion ?
Des perspectives de croissance irréalistes ?
Atos l’assure pourtant, avec cette cession, « le groupe bénéficierait d'une situation de liquidité nettement améliorée avec une génération de flux de trésorerie positive, grâce à sa performance opérationnelle et à des charges de restructuration nettement inférieures ». Le groupe informatique annonce ainsi qu’Eviden vise en 2023 « une accélération de sa croissance organique (par rapport à 2022) et une amélioration de sa marge opérationnelle (par rapport à 2022) ». Les objectifs annoncés à terme apparaissent quelque peu ambitieux : « L'ambition d'atteindre une croissance annuelle moyenne de 7% du chiffre d'affaires sur la période 2022-2026, avec une marge opérationnelle d'environ 12 % en 2026. »
Or, comme je l’avais rappelé dès le printemps dernier, dans cet article (« Le fiasco du projet de découpage d’Atos »), cette perspective sera particulièrement difficile à réaliser. À l’origine, pour engager ce découpage, Bertrand Meunier pariait en effet sur des résultats positifs issus de la filiale Evidian (qui deviendra donc Eviden), et justifiait le bradage de Tech Foundations par des mauvais résultats attendus. Las ! Les résultats 2022 d’Atos sont venus totalement chambouler ses plans : avec une sous performance inattendue d’Evidian, obtenant une marge opérationnelle de 5,3 % (et non de 10 % comme espérée), bien en deçà de la concurrence (Capgemini est par exemple à 13 % en 2022), et avec une stabilisation de la situation de Tech Foundations.
La consternation sur la place de Paris
Après ces dernières circonvolutions de communication de la part d’Atos, nombre d’observateurs sont restés sur leur faim. Pire, tous ont perçu la panique ambiante et le manque manifeste de clarté de la part de la direction d’Atos. Autre élément d’étonnement : le silence particulièrement pesant des pouvoirs publics et de l’AMF sur ce dossier pourtant hautement stratégique.
Sur la place de Paris, c’est la consternation. En off, les critiques fusent contre Bertrand Meunier. Même des acteurs éloignés du secteur numérique craignent désormais que le règlement de ce dossier, comme celui de Casino, révèle une nouvelle fois auprès des investisseurs étrangers, et notamment anglo américains, les faiblesses de la place de Paris, tant au niveau de son opacité que de la continuation des petits arrangements entre l’État et les dirigeants.
Beaucoup s’interroge également sur le rôle des banquiers d’affaires dans ce dossier. Comme je l’avais exposé dans mon premier article, la banque Rothschild est particulièrement pointée, comme dans le dossier Casino : ainsi, la banque d’affaires conseille officiellement Atos alors que l’un de ses principaux banquiers, Grégoire Chertok, travaille également pour Daniel Kretinsky. Un mélange des genres dans la grande tradition française et parisienne…
31.07.2023 à 12:48
Rien ne va plus chez Atos : vers un démantèlement ?
Marc Endeweld
Texte intégral (2733 mots)
Un plongeon vertigineux. Lors de la journée de vendredi, le cours de bourse de la société informatique Atos a plongé de plus de 20 %. Incontestablement, les marchés n’ont guère été convaincus par la publication intervenue le jour précédent des comptes semestriels du groupe. Les chiffres donnent le tournis : 600 millions de perte sur le premier semestre. Mais c’est surtout l’effondrement du flux de trésorerie disponible du groupe informatique qui inquiète actionnaires et investisseurs, passant de -555 millions à -969 millions d'euros, bien en dessous des attentes des analystes. Abyssal : en six petits mois, Atos a brûlé près de 1 milliard d'euros de cash !
La panique gagne le management
La direction tente de justifier cette situation financière par le coût du plan de réorganisation en cours (estimé à 274 millions d’euros sur les six derniers mois !). Ce projet de découpage en deux entités, voulu par Bertrand Meunier, le président du conseil d’administration, avait déjà donné des signes de faiblesse au printemps dernier, comme je l’avais relaté dans un article précédent. Inefficace, manifestement coûteux, il est clair, pour de nombreux observateurs, que ce découpage ne permettra pas de sauver cette entreprise de 110 000 salariés (dont 20 000 en France).
Malgré les critiques et la tentative des petits actionnaires en juin dernier pour le déloger de son poste, Bertrand Meunier reste droit dans ses bottes et explique à ses troupes que tout se déroule comme prévu. Au sein du groupe informatique, la confiance est pourtant rompue, la panique gagne le management, des cadres partent. Atos semble sans cap ni boussole. C’est que les cessions envisagées ces derniers mois ne pourront pas résoudre l’équation financière à laquelle doit faire face le groupe. Et selon mes informations, si aujourd’hui l’exploitation continue de perdre de l’argent, le pire est à venir avec le remboursement de la dette l’année prochaine (l’échéance doit en effet intervenir à la fin 2024). Pour ne rien arranger, les risques juridiques s’accumulent. Les commissaires aux comptes et les auditeurs sont sous pression.
Seuls les conseils d’Atos et les banquiers d’affaires présents dans le dossier gardent le sourire, profitant de leurs honoraires non rendus publics, ou alléchés par leurs fees à venir. Jean-Marie Messier, David Azéma chez Perella Weinberg Partners (PWP), et Rothschild & Co travaillent tous sur le cas Atos.
Le conseil d’administration a duré huit heures
Au sein de son conseil d’administration, Bertrand Meunier peut compter aussi sur Alain Minc et Jean-Pierre Mustier, l’ancien banquier de la Société Générale (qui a commencé sa carrière dans les années 1980 comme trader sur les produits dérivés), nommé notamment pour remplacer Édouard Philippe. L’ancien Premier ministre était en effet administrateur d’Atos depuis 2020, mais a préféré partir devant l’amoncellement des nuages noirs au-dessus du groupe informatique.
Signe d’une tension maximale : jeudi dernier, le conseil d’administration d’Atos a duré près de huit heures. J’ai pu recueillir plusieurs éléments qui ont été présentés à cette occasion et qui n’ont pas fuité jusqu’à présent dans la presse. Ainsi, après avoir présenté les résultats semestriels du groupe, Meunier a tenté de montrer aux administrateurs qu’il avait encore un cap et que son projet de découpage tenait toujours la route.
Augmentation de capital contre cession de Tech Foundations
Le président du conseil d’administration a annoncé une augmentation de capital d’Atos, à laquelle vont participer de concert les milliardaires Marc Ladreit de Lacharrière et Daniel Kretinsky (qui sont déjà associés dans le dossier Casino). Cette augmentation de capital s’élèverait à 300 millions d’euros (le chiffre de 350 millions a également été évoqué).
Cette opération comprendra en fait la cession de la filiale d’infogérance d’Atos, appelée Tech Foundations, à Daniel Kretinsky (associé donc à Marc Ladreit de Lacharrière). Pour ce dernier qui négocie avec Atos depuis des mois pour ravir Tech Foundations, c’est une nouvelle fois « tout bénef ». Même si tout n’est pas finalisé, le milliardaire tchèque souhaite bénéficier en retour d’une soulte confortable. Un généreux cadeau qui lui permettra de financer sa participation au capital d’Atos… Toutefois, cette perspective ne plaît guère aux banques créancières d’Atos, la JP Morgan, et surtout BNP Paribas, alors que la dette d’Atos s’élève désormais à 2,32 milliards d'euros, mais dans ce dossier, ces dernières vont surtout tenter de préserver leur intérêt.
Reste que si Kretinsky et Meunier sont tombés d’accord, ce « montage » n’est pas encore passé au vote lors du fameux conseil et n’a donc pas pu être rendu public (Avant la tenue du conseil d’administration, Bertrand Meunier, que j’avais contacté via sa communicante Anne Méaux, n’a pas souhaité s’exprimer). Au vu de son importance, il serait étonnant qu’une assemblée générale exceptionnelle des actionnaires ne soit pas convoquée prochainement pour adouber cette augmentation de capital doublée d’une cession. « Qui négocie pour Atos avec Kretinsky ? Meunier, alors qu’il n’est pas mandataire social ? La direction d’Atos ? Personne ne le dit. On n’est informé de rien, c’est l’opacité la plus totale ! », fulmine d’ailleurs un petit actionnaire qui en a assez de se retrouver devant le fait accompli depuis des mois. Malgré les critiques des actionnaires, l’Autorité des marchés financiers (AMF) reste silencieuse. Interrogé au sujet d’Atos, son service de communication me répond : « l’AMF est tenue au respect du secret professionnel et ne fait aucun commentaire sur les dossiers en particulier ». Silence radio également côté du cabinet de Bruno Le Maire, le ministre « de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique », qui suit pourtant le dossier de près.
[Actualisation mardi 1er août : ce matin, Daniel Kretinsky et Atos ont finalement officialisé la vente de Tech Foundations contre la participation à une augmentation de capital dans Evidian. Une augmentation de capital qui s’élèvera au total à 900 millions d’euros avec la participation à la hauteur de 217,5 millions d’euros pour Kretinsky et Lacharrière, soit 7,5 % d’Evidian. À travers cette opération (participation dans l’augmentation de capital contre cession), Daniel Kretinsky ne déboursera que 100 millions pour récupérer Tech Foundations]
Airbus espère toujours mettre la main sur BDS
D’autant que le dossier Atos n’intéresse pas uniquement Daniel Kretinsky. Malgré les fortes résistances au sein de l’éco-système de Défense français, les discussions avec Airbus continuent. Après avoir donné une fin de non recevoir assez brutale en mars dernier à la proposition de Bertrand Meunier d’entrer à la hauteur de 30 % au capital d’Évidian, la filiale d’Atos qui comprend les stratégiques activités cybersécurité et supercalculateurs, l’avionneur a bien continué à échanger avec le groupe informatique. Or si Airbus a refusé dans un premier temps la proposition de Meunier, c’est que le groupe aéronautique convoitait surtout la division BDS (Big Data & Security) au sein d’Évidian.
Justement, selon mes informations, les discussions en cours entre Atos et Airbus concernent désormais une cession de BDS à l’avionneur, bien que l’entourage de Meunier me fait dire « qu’Atos n’a aucun intérêt de se séparer de BDS car cela ferait perdre de la valeur à Evidian ». En réalité, les deux groupes ne seraient pas encore tombés d’accord sur la valeur de BDS.
Le scénario d’un démantèlement se précise
En attendant, Atos pourrait avoir trouvé un acheteur supplémentaire pour d’autres actifs. Début juillet, le businessman David Layani (One Point), qui n’a cessé ces derniers mois de montrer son intérêt pour le groupe informatique, semble avoir remporté un feu vert auprès de son management, pour récupérer le reste de la filiale Evidian (sans BDS donc), comme une partie de son entourage me le confirme.
Alors que cela fait des mois que la bataille autour d’Atos est engagée, à coup de campagnes médiatiques, de négociations menées via une nuée de banquiers d’affaires, et de lobbying auprès des pouvoirs publics, le groupe informatique, devant faire face à de nombreuses difficultés dans l’ensemble de ses branches, et se trouvant finalement au bord de la faillite, pourrait être finalement vendu par appartements.
Ce scénario du démantèlement, la direction d’Atos l’a toujours nié, et continue d’expliquer que son projet de découpage tient la route. Mais dans la torpeur de l’été, et à la faveur du silence des pouvoirs publics, on pourrait en fait assister en coulisses à une véritable liquidation du groupe informatique entre trois acheteurs. D’ailleurs, le groupe de Défense Thales, qui convoitait également BDS depuis de nombreux mois, a annoncé la semaine dernière le rachat de la société américaine de cybersécurité Imperva. Comme un lot de consolation ?
L’ardoise magique du capitalisme français
Pour Atos, un scénario alternatif est-il encore possible ? « Rien n’est possible tant que Meunier est là, cingle un observateur. Depuis qu’il a pris la main, la valeur de l’entreprise a été divisée par 10. C’est une sanction terrible, sans appel. Si une alternative doit se faire, c’est sans lui. Il faut que les pouvoirs publics ainsi que les banques réclament son départ ». Étrangement, au cœur de l’été, le silence prévaut. Et comme on a pu le voir ces derniers mois avec les dossiers Orpéa et Casino, la « restructuration » d’Atos semble se faire loin des regards des actionnaires et des obligataires.
Dans le dossier Casino, où l’on retrouve Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, ces derniers vont mettre 900 millions d’euros contre un effacement de la dette de près de 5 milliards d’euros. Et dans le dossier Orpéa, dans lequel certains actionnaires ont porté plainte, la dette de l’entreprise a été réduite de 3,8 milliards d’euros. Ces derniers temps, le capitalisme français semble ivre d’une ardoise magique. Comme le rappelle Mathias Thépot dans Médiapart, ces effacements de dette ont notamment été rendus possible par la nouvelle « procédure de sauvegarde accélérée », instaurée par une ordonnance du 15 septembre 2021, qui donne la possibilité, lorsqu’une société se retrouve en grande difficulté financière, de se passer dans l’urgence de l’avis des actionnaires et d’une partie minoritaire des créanciers pour mettre en œuvre un plan de restructuration.
11.06.2023 à 23:51
Et maintenant l’État au secours de Naouri : le dossier Casino au CIRI
Marc Endeweld
Texte intégral (1521 mots)
Durant près de trente ans, on lui a tout laissé passer, tout pardonné. C’est que Jean-Charles Naouri, patron de Casino, mastodonte de la grande distribution qui croule sous les dettes, est un petit génie des maths. Au concours de Normale Sup’, n’a-t-il pas réussi l’exploit (à 17 ans !) de battre le record de points du célèbre mathématicien Henri Poincaré ? Au pays de Descartes, c’est comme si Naouri avait pu disposer de la pierre philosophale.
Voilà comment cet énarque, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy aux ministères des Finances dans les années 1980 puis banquier d’affaires chez Rothschild, a pu grossir toujours plus, rachetant ces dernières années les franchises à tour de bras, malgré des signes de faiblesses flagrants et un marché de la distribution bouleversé par l’Internet. Aujourd’hui, le retour aux réalités est douloureux : l’ardoise de ce petit génie des mathématiques pèse près de 10 milliards d’euros de dettes, près de 3 milliards pour sa holding Rallye et plus de 6 milliards pour le groupe Casino en tant que tel.
Naouri penche pour Kretinsky
À 74 ans, Naouri est acculé. Ses principales banques, Crédit Agricole, BNP Paribas et Natixis n’en peuvent plus d’attendre depuis quatre ans le désendettement du groupe. Résultat, ces derniers mois, le cours de bourse a dévissé et les prédateurs rôdent. À l’affût, le groupe Intermarché qui souhaite racheter une centaine de magasins, mais aussi le trio Niel, Pigasse, Zouari (ce dernier est notamment propriétaire de Picard Surgelés), qui n’ont pas dit leur dernier mot devant le festin à venir, malgré l’arrêt des négociations entre Casino et le groupe Teract (dans lequel le trio a investi). Ces trois-là envisagent aujourd’hui de partir en solo à l’assaut de Casino.
Mais pour sauver sa peau, et même la face, Naouri penche plutôt pour le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui était déjà venu à son secours les années précédentes : conseillé par la banque Rothschild, déjà actionnaire de FNAC Darty et de l’allemand Metro, ce dernier pourrait apporter 750 millions d’euros au groupe, tandis que Marc Ladreit de Lacharrière, le fondateur de Fimalac, pourrait de son côté injecter 150 millions d’euros. Kretinsky, l’empereur du charbon qui a fait sa fortune en rachetant à bas prix de centrales à charbon délaissées, est pourtant dur en affaires, et attend, comme Naouri, que les dettes soient renégociées « généreusement ». Concrètement, que l’ardoise des 6 milliards des dettes soit au moins effacée de moitié !
Plus de 50 000 salariés en France
Las ! Les banques ne l’entendent pas du tout de cette oreille et ne verraient pas d’un mauvais œil le démantèlement du groupe. Fin mai, le tribunal de commerce de Paris a pourtant annoncé l’ouverture d’une conciliation sur l’épineux dossier des dettes, qui doit permettre à l'entreprise de conclure un accord avec ses créanciers en vue d'une potentielle restructuration de sa dette. De son côté, Naouri espère encore que l’État va venir à son secours pour convaincre les banques d’éponger ses dettes et éviter que ces dernières ne démantèlent son groupe. Dans la balance, lui comme Kretinsky peuvent faire valoir plus de 200 000 salariés, dont plus de 50 000 en France.
Le dossier Casino est ainsi en cours d’instruction au CIRI, le comité Interministériel de Restructuration Industrielle à Bercy. Peu connu du grand public, le CIRI est un outil pour aider les entreprises en difficulté. Le comité peut aider à trouver des financements et des solutions pour restructurer ou sauver des entreprises. Bien évidemment, les pouvoirs publics sont toujours sensibles aux versants sociaux de ces dossiers financiers et industriels traités en urgence. « C’est en général très suivi par le cabinet, quelque fois à la limite du jouet, remarque une ancienne conseillère ministérielle qui a connu les couloirs de Bercy. Nous, on a sauvé des entreprises qui s’étaient fait manger par des fonds de pension agressifs et qui voulaient les dépouiller ».
J’ai contacté le cabinet de Bruno Le Maire qui préfère pour le moment ne faire « aucun commentaire » sur ce dossier Casino explosif. Pas simple pour un ministre qui a l’habitude de se bagarrer avec les distributeurs pour les droits des consommateurs d’apparaître comme le sauveur de Casino. L’Élysée a également demandé au ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, de garder un œil sur le dossier. Autant dire qu’à 74 ans, et alors qu’il a passé quelques heures en garde-à-vue début juin dans un dossier de manipulation de cours (dont il est ressorti sans poursuites), Jean-Charles Naouri continue de bénéficier de nombreuses indulgences… « Mais les banques ne vont pas se laisser faire ! s’exclame un observateur de la place de Paris. Ça va exploser ! »
18.05.2023 à 00:56
Les ambitieux préparent déjà l’après Macron
Marc Endeweld
Texte intégral (4574 mots)
Un petit air de déjà-vu. Comme une énième fusée politique sur un pas de tir. La semaine dernière, Les Échos ont consacré, dans leur magazine du week-end, plusieurs pages pour le moins louangeuses à Gabriel Attal, le jeune ministre des Comptes Publics. « Le charme, c’est indispensable pour aller loin en politique », n’a pas peur d’écrire le journaliste Henri Gibier dans son « enquête » consacrée aux « secrets d’une ambition ». Flatteur, forcément.
Tout l’article tourne autour de l’idée que Gabriel Attal, aujourd’hui 34 ans, se prépare aux plus hautes fonctions. « L’ambition ancienne, méthodique, de quelqu’un qui a la prudence de ne pas se proclamer promis à grand destin, mais la volonté de s’en construire un », décrit Gibier avant toutefois d’enfoncer le clou, en rappelant que l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing s’était, lui aussi, retrouvé à 33 ans ministre du Budget, en 1959. « Il égalise le record de VGE », se félicite le quotidien économique dans un intertitre. Nuances ou gros sabots, il faut choisir. Interviewé, le député Jean-René Cazeneuve, rapporteur de la commission des Finances, constate : « A Renaissance, c'est une star ».
Le temps est passé vite. Cinq ans plus tôt, tout juste nommé au gouvernement, le jeune Gabriel était encore « coaché » par Laurent Fontaine, l’ancien animateur producteur de TF1 (mais si, rappelez-vous, l’émission « Y a que la vérité qui compte » du duo Bataille & Fontaine) et par ailleurs proche ami de Bruno Roget-Petit, l’ancien journaliste devenu « conseiller mémoire » à l’Élysée.
Attal 2027 ou 2032 ?
Dans son article, Gibier constate que Gabriel Attal est un véritable control freak qui ne laisse rien au hasard. Comme un certain Emmanuel Macron. Le jeune ministre des Comptes publics sait bien qu’il lui est nécessaire d’emprunter une ligne de crête pour asseoir son ambition : se faire voir et faire savoir, sans pour autant faire de l’ombre à son patron de l’Élysée. Surtout, ne pas dévoiler son impatience pour les plus hautes fonctions, tout en se préparant à toute éventualité. C’est ce difficile exercice que je rapportais dans ma chronique de La Tribune dès février dernier : « L'ambitieux monsieur Attal séduit et divise la macronie de 2017 ».
Contrairement à l’article des Échos qui montre sans assumer de dire les choses, j’optais pour la clarté dans La Tribune : « Et si c'était lui ? Le jeune ministre du budget et des comptes publics et ancien porte-parole médiatique d'Emmanuel Macron fait fantasmer un parti en manque de leadership. Celui qui aura 39 ans dans 5 ans peut-il s'imposer dans la course à la succession pour l’Elysée ? Certains le pensent, et tous ne comptent pas forcément parmi ses plus fervents soutiens. Alors, Attal 2027 ou Attal 2032 ? ». Cette simple question suscita l’ire d’une partie de son entourage. Surtout, ne pas trop en dire, éviter à tout prix de se griller les ailes.
“Entrer à l’Élysée autour de la quarantaine”
Pourtant, tout montre que le jeune ministre de Bercy est du genre pressé… Comme Emmanuel Macron en son temps. Après le « débat » à l’Assemblée Nationale sur les retraites, la « star » Attal a immédiatement enchaîné sur le dossier de la fraude fiscale avant de s'envoler pour les États-Unis fin février. À peine était-il arrivé qu'il participait à une émission de débat politique sur MSNBC à propos de la guerre en Ukraine. Sur la plateau, « Gaby » est à l'aise, déclamant un anglais fluent façon Sciences Po pour décrypter la politique des Européens vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. On est bien loin des questions budgétaires que le ministre est censé porter... Au programme également de cette visite nord-américaine à Washington et New-York rencontre avec des think tanks et autres relais d'opinion.
Bref, Gabriel Attal « réseaute » à fond et tente de prendre de l'épaisseur. Car, selon plusieurs sources, ses ambitions à venir sont importantes : « Il souhaite ravir la mairie de Paris en 2026 et rêve même de réitérer l'exploit d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire entrer à l'Elysée autour de la quarantaine », souffle un confident du premier cercle élyséen. Encore récemment, une communicante habituée aux jeux des pouvoirs s’exclame devant moi : « Bien sûr qu’Attal vise la présidence ! ». Bien sûr.
Gabriel Attal, présidentiable ? « Dès 2027 ou pour 2032 ? », osait se demander un conseiller du gouvernement à la même époque. Depuis, en « macronie », son nom tourne de plus en plus parmi les futurs candidats possibles. Au point qu'Emmanuel Macron, lui-même, en prend ombrage : « le président commence à être irrité par l'activisme de son jeune ministre », flingue un fidèle parmi les fidèles. C’est que, comme chacun sait, Emmanuel Macron a toujours veillé, depuis 2017, à ce qu’aucune tête ne dépasse dans son camp, et surtout, qu’aucune ne puisse le surpasser.
Résultat, dans 20 minutes qui lui consacrait également un article fin février, Gabriel Attal tentait de réaffirmer sa loyauté envers le président : « Je ne prépare pas de campagne, pas de candidature », assurait ainsi celui qui « [s']interdit de [se] poser la question ». Peut-être, mais avec leur longue story publiée la semaine dernière, Les Échos semblent répondre pour lui (le ministre leur a d’ailleurs accordé une interview).
Un pied dans l’establishment parisien
Dans le monde politique, la chance joue, mais la préparation encore plus. À l’origine, Gabriel Attal était le compagnon de Stéphane Séjourné, actuel président du groupe Renew au Parlement européen et secrétaire national de Renaissance, et ancien conseiller parlementaire d’Emmanuel Macron à Bercy après avoir été militant au PS tendance DSK, dans les réseaux jeunes choyés par le vieux briscard Jean-Christophe Cambadélis. C’est que Séjourné est un pilier de la « bande de Poitiers », ces jeunes étudiants ayant milité au MJS, notamment au moment du mouvement anti CPE, et qui ont très tôt rejoint l’aventure Macron (entre 2015 et 2016) : parmi eux, on trouve Pierre Person qui fut député LREM durant le premier quinquennat, tout comme Mickaël Nogal, mais aussi Florian Humez ou Jean Gaborit, tous deux un temps conseillers sous la macronie avant de rejoindre le privé, ou le député Sacha Houlié qui, lui, a rempilé pour un second quinquennat, et est même devenu le président de la Commission des Lois depuis juin 2022.
Pour ces petits gars de la « bande de Poitiers », Gabriel Attal a toujours été une pièce rapportée, via… Stéphane. Tous ont mis du temps à comprendre que lui seul avait déjà un pied dans l’establishment parisien. Quand la plupart d’entre-eux venait de la France des sous-préfectures, lui avait un papa grand producteur de cinéma et fut élève à l’école alsacienne, cette école privée hyper select de la rive gauche. Quand eux ont fait « seulement » des facs en province, lui a bien sûr fait Sciences Po Paris. Quand eux n’étaient que militants au PS, lui était dès 2012 au cabinet de Marisol Touraine, la ministre de la Santé sous Hollande, où il rencontra Benjamin Griveaux, un des piliers de la bande rivale, la « bande de la Planche », celle d’Ismaël Emelien (le conseiller stratégie de Macron à Bercy puis à l’Élysée au début du premier quinquennat), ces jeunes technos proches de Pierre Moscovici et d’Havas, qui avaient participé à la campagne DSK aux primaires du PS en 2006.
Les soirées de Daniel Vial place Vauban
Aujourd’hui, Gabriel Attal - qui est « toujours officiellement pacsé » à Stéphane Séjourné, comme le souligne Les Echos - a toujours su que son destin était tout tracé. Le jeune ministre des Comptes publics sait y faire avec les gens qui comptent. Il a toujours eu les codes de Paris. Il y a quelques années, ce parisien avait soutenu activement Íngrid Betancourt, alors prise en otage en Colombie par les FARC, une grande amie de Dominique de Villepin. Attal est aussi une proche connaissance de Daniel Vial, lobbyiste de la « big pharma » française et internationale, qui par le passé, avait mis le pied à l’étrier à Jérôme Cahuzac dans ce secteur. Vial est un grand mondain qui aime recevoir dans son appartement de la place Vauban près des Invalides dans le 7e arrondissement (Ségolène Royal est une habituée de ses soirées comme nous l’apprend récemment Solenn de Royer du Monde).
Depuis, « Gaby » s’est fait un nom, lui aussi. « Gabriel Attal a pris du poids à Bercy », constate un communicant de la place de Paris. Parmi les « successeurs » d’Emmanuel Macron, il rivalise désormais avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ou Laurent Wauquiez chez les Républicains. Comme Gabriel dans Les Echos, chacun de ces impétrants a d’ailleurs eu droit récemment à une grande interview ou un portrait dans la presse newsmag qui prépare l’avenir…
Dans l'entourage présidentiel, cette petite musique qui monte autour de Gabriel Attal n'est pas forcément du goût de tout le monde. Certains qui espèrent le retour d’Emmanuel Macron dès 2032 pour un troisième mandat (oui, oui…) craignent que Gabriel réussisse à « tuer le père ». Parmi ces plus fidèles et loyaux, il est hors de question de tourner la page aussi vite, il est tabou d'évoquer la fin politique d'Emmanuel Macron après ce second quinquennat. Pour cette catégorie de macronistes, personne ne peut réellement remplacer leur champion « disruptif » de 2017. À l'Elysée pourtant, d'autres sont séduits et tentés par l'énergie du ministre délégué aux Comptes Publics : « Il est très bien Gabriel ! » s'exclame ainsi un très proche de Brigitte Macron.
La guerre des ambitieux fait rage
De fait, depuis quelques mois, au sein de la macronie, la guerre des ambitieux fait rage. De tous les côtés, les écuries politiques se forment. « On a l’impression qu’Emmanuel Macron n’a déjà plus le pouvoir », remarque, sidéré, un ancien conseiller. Les médias se délectent. Ces derniers, las de la communication gouvernementale, relaient aussi les ambitions extérieures à la macronie considérées comme des alternatives aux « extrêmes » : Bernard Cazeneuve a refait un tour de piste ces dernières semaines pour taper sur la NUPES, et Laurent Wauquiez a commencé à parler et à s’exposer alors qu’il s’était interdit tout commentaire sur les retraites ces derniers mois.
Concernant les municipales, Clément Beaune, le ministre des Transports (ex conseiller d’Emmanuel Macron et plus loin encore, de Jean-Marc Ayrault) est déjà en campagne pour tenter de ravir la mairie de Paris à Anne Hidalgo. Sur ce terrain, la concurrence est rude : il se retrouve face à Gabriel Attal et à Olivia Grégoire, la ministre déléguée des PME, du Commerce et du Tourisme. « L’été dernier, Beaune avait également tenté de récupérer la direction de Renaissance, mais le président avait finalement tranché pour Séjourné », confie un ancien macroniste. À Paris, dans le milieu politique et économique, Beaune a bonne réputation. « C’est le plus sympa ! » lance un entrepreneur. Cette sympathie vient également du fait que ses relations avec Alexis Kohler, le puissant secrétaire général de l’Élysée, sont connues pour être exécrables…
Matignon, le match dans le match
Chez Renaissance, Stéphane Séjourné se pose quant-à-lui beaucoup de questions. Comme bien d’autres « ex » de la « bande de Poitiers », le responsable des macronistes se demandent où tout cela va nous mener… Au point d’envisager certains jours d’arrêter la politique et de revenir dans le privé. Cette grosse fatigue intervient alors que l’Élysée compte bien lui demander de rempiler pour porter les couleurs de Renaissance aux prochaines élections européennes.
Mais aujourd’hui, ce qui préoccupe les macronistes, c’est bien sûr Matignon, et une éventuelle succession d’Élisabeth Borne. « C’est le match dans le match ! » s’exclame un macroniste. Chaque camp, chaque écurie mène campagne plus ou moins discrètement par voie de presse. Il y a quelques semaines, l’éditorialiste des Échos, Cécile Cornudet, évoquait ainsi les noms de Gabriel Attal, de Gérald Darmanin et de Sébastien Lecornu. De leur côté, Challenges, le Fig’ Mag, le JDD, L’Opinion, ont sorti avec insistance la carte Julien Denormandie, l’ancien ministre de l’Agriculture et fidèle parmi les fidèles d’Emmanuel Macron, qui est revenu dans le privé en se lançant dans le projet d’une start up. En fait, son nom avait déjà été évoqué pour le poste de Matignon au printemps dernier. Certains le voyaient également comme un possible successeur d’Alexis Kohler à l’Élysée comme secrétaire général, ou comme un éventuel patron d’EDF. Cela ne doit rien au hasard : « C'est en fait ses anciens copains de l'Elysée, les fameux Mormons, qui font tourner son nom à chaque fois qu'un poste se libère, me rapporte un proche du président. Comme Denormandie est le chouchou du PR [président], et qu'il est le dernier de leur bande à forte valeur ajoutée, les Mormons font courir le bruit partout qu'il peut aller partout pour montrer qu'ils existent encore ! C'est drôle ! ». (lire à ce sujet ma chronique de septembre). Problème : le nom de Julien Denormandie est cité dans « l’affaire Kohler », même s’il n’a été entendu que comme simple témoin (Plusieurs de ses mails retrouvés par les policiers mettent ainsi à mal la défense de l’actuel SG de l’Élysée).
Le retour en grâce de Philippe Grangeon
En fait, en coulisses, chaque écurie pour Matignon est scrutée à l’Élysée. Du côté de « l’aile Madame » du château, certains poussent Gabriel Attal ou Sébastien Lecornu pour le poste. Du côté d’Alexis Kohler, on estime plutôt qu’Élisabeth Borne peut se maintenir. C’est en tout cas l’avis de l’ancien conseiller spécial d’Emmanuel Macron, Philippe Grangeon, considéré dans la macronie comme un des derniers tenants de « l’aile gauche ». Et à défaut de réussir à maintenir Borne en poste, Grangon et ses fidèles poussent… Julien Denormandie. Depuis le début du second quinquennat, Grangeon avait pourtant perdu de l’influence auprès d’Emmanuel Macron mais « il revient en force depuis un mois », me soufflait il y a quelques jours un initié de l’Élysée, c’est-à-dire depuis la fin mars. Ce soudain rapprochement s’explique-t-il par les difficultés présidentielles sur le dossier des retraites ?
Ces derniers mois, le président n’avait appelé son ancien conseiller spécial que dans les jours précédents le 49.3 (Avec Stéphane Séjourné, dont il est proche, et les patrons de groupes Renaissance à l’Assemblée et au Sénat, il était l’un des rares à être contre son utilisation). Il faut dire, Philippe Grangeon qui sera « macroniste jusqu’au bout », selon un initié, peut être précieux pour le président. Son bagage politique parle de lui-même : par le passé, cet ancien étudiant trotskiste a conseillé Nicole Notat à la CFDT, puis Florence Parly, Dominique Strauss-Kahn et Christian Sauter sous le gouvernement Jospin, et enfin, Bertrand Delanoë à la mairie de Paris.
Aujourd’hui, au sein de la macronie, Philippe Grangeon est en contact constant avec deux de ses proches, Elisabeth Borne, mais aussi le directeur de cabinet de cette dernière, Aurélien Rousseau. Il reste en lien avec l’ancien président de l’Assemblée Richard Ferrand, et ses « poulains » et chouchous s’appellent Gabriel Attal, Clément Beaune et Stéphane Séjourné. Au cours du premier quinquennat, s’il a plutôt bien travaillé avec Jean Castex, il s’était confronté à Édouard Philippe et à son directeur de cabinet d’alors, Benoît Ribadeau-Dumas.
Quand Grangeon marche avec Kohler et Notat
À l’inverse, sur la planète « technos », Philippe Grangeon voit souvent Alexis Kohler. Les deux hommes se voient soit le soir, soit lors de marches de 45 minutes partagées à deux. Régulièrement contesté au sein de la macronie, le secrétaire général de l’Élysée a récemment vu certains anciens conseillers de l’Élysée qui s’étaient surnommés « les Mormons », ceux qui avaient contribué à la victoire en 2017. Ainsi, on a appris que Sibeth Ndiaye était venue dîner à l’Élysée avec Alexis Kohler. Dernièrement, le secrétaire général a également rencontré Ismaël Emelien. Autre pièce importante pour Kohler, Grégoire Potton, ancien collaborateur socialiste sous le mandat Hollande, parmi les premiers à avoir rejoint l’aventure en Marche, et qui est discrètement devenu à la fin 2022 chef du pôle politique et parlementaire à l’Élysée. Potton, lui aussi, est un proche de Philippe Grangeon.
Mais si Philippe Grangeon est un véritable couteau suisse pour Emmanuel Macron, son compagnonnage passé auprès de la CFDT n’est pas forcément un avantage. Car le conseiller politique n’est pas du tout apprécié par Laurent Berger. Cela s’explique par de vieilles rancunes et des différences de lignes au sein du syndicat « réformiste » : car Berger, à l’origine, c’est la ligne de François Chérèque, alors que Philippe Grangeon fait partie de la team Nicole Notat qui s’est toujours opposée à Laurent Berger et qui ne cache guère son soutien à l’égard de l’actuel président de la République.
L’ancienne patronne de la CFDT, qui avait pactisé avec Alain Juppé lors du mouvement social de 1995, est notamment ulcérée de l’unité syndicale qui règne encore entre la CFDT et la CGT contre la loi sur les retraites. Ces derniers mois, elle a même tenté de rallier plusieurs anciens du syndicat dans un vague projet de tribune de soutien au gouvernement. Parmi eux, l’un des ses proches, Jacques Kheliff, ancien secrétaire général de la Fédération Chimie Énergie, avant de rejoindre le groupe chimique Rhodia comme directeur du développement durable, qui a exprimé auprès de certains macronistes son soutien à la « réforme ». « Tous ces gens n’ont pas compris qu’en 30 ans, le centre de gravité de la CFDT avait changé. Devenu le premier syndicat de France, il est plus écolo, plus à gauche, et plus jeune. Seul Pierre Ferracci, le patron du groupe Secafi Alpha, l’a compris », m’expose un très bon connaisseur de la CFDT. Ce n’est donc pas avec Philippe Grangeon qu’Emmanuel Macron va améliorer ses relations avec la CFDT dans les prochains mois.
Édouard Philippe réussira-t-il à devenir papy Biden ?
Et justement, à l’Élysée, n’en déplaise à Grangeon, Alexis Kohler a plutôt choisi Édouard Philippe pour la suite des événements. Le maire du Havre, qui a fait son retour médiatique en début d’année, a été le premier en octobre à publier un message de soutien au secrétaire général de l'Élysée quand a été rendue publique la mise en examen de ce dernier pour « prise illégale d'intérêt » dans le dossier MSC. Les deux hommes s'apprécient et se connaissent de longue date, et ce, bien avant Emmanuel Macron (Alexis Kohler fut représentant de l'État au conseil d'administration du port du Havre et également un « jeune rocardien » comme Édouard Philippe).
Ces deux « technos », parfaits représentants de la technostructure, aiment se rappeler les débuts du premier quinquennat. À l'époque, leurs vues étaient souvent semblables, et ils se retrouvaient à tomber d'accord sur de nombreux dossiers, accompagnés alors du secrétaire général du gouvernement de l'époque, Marc Guillaume, et du directeur de cabinet de Matignon d'alors, Benoît Ribadeau-Dumas. Cette « bande des quatre » avaient alors l'habitude de calmer les ardeurs de l'impétueux monsieur Macron. Pourtant, leur pouvoir sans partage leur a attiré de nombreux ennemis tant dans la macronie que dans le Petit Paris. « C'est injuste pour Édouard Philippe, il était beau, grand, il avait la gueule d'un homme d'État, mais maintenant, avec sa maladie qui se traduit par une perte de cheveux, on va le voir se rabougrir. Politiquement, cela va lui être fatal, il ne sera jamais président », cingle aujourd’hui un conseiller du soir d'Emmanuel Macron.
Forcément, dans notre monde de la politique spectacle et des apparences, et dans le match de l’après Macron, la jeunesse, la gueule d'ange et l'éloquence de Gabriel Attal sont peut être ses meilleures cartes. À moins que les Français ne se laissent pas séduire une seconde fois aussi facilement par un autre jeune premier et lui préfèrent pour les prochaines années un papy Joe Biden.
15.04.2023 à 22:03
Le fiasco du projet de découpage d’Atos
Marc Endeweld
Texte intégral (3675 mots)
C’est l’histoire d’une énième vente à la découpe sans projet industriel. Tout a commencé à la mi-février par un simple communiqué de presse. Atos, le géant français de services informatiques (110 800 salariés dans le monde), annonçait entamer des discussions avec Airbus en vue de céder 29,9 % de sa filiale Evidian, qui comprend les stratégiques activités cybersécurité et supercalculateurs. Depuis l’automne dernier, l’idée d’une « scission » du groupe informatique était déjà largement éventée par les médias économiques (après avoir été discrètement présentée en juin par la direction). À la manœuvre : la boîte de communication Image 7 dirigée par Anne Méaux, la « papesse » de la com’ du CAC 40, qui travaille pour Atos. Parmi les prédateurs potentiels, on apprenait que le groupe One Point de David Layani, un proche d’Emmanuel Macron, rêvait de ravir la pépite du groupe informatique, tout comme Thales, le groupe de Défense. Au coeur des convoitises : la division BDS (Big Data & Security), héritage du mythique groupe Bull, concentrant les compétences françaises dans les supercalculateurs, et en contrat avec de nombreux acteurs de la Défense.
À l’origine, c’est Thales qui aurait proposé une découpe d’Atos espérant mettre la main sur BDS. Car le groupe de services informatiques est mal en point. Lourdement déficitaire en 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros, Atos, qui a toutefois divisé par trois sa perte nette l’année suivante, a très mal pris le virage du cloud. Surtout, après dix ans de règne de Thierry Breton (aujourd’hui Commissaire européen pour le marché intérieur), sous lequel a notamment été décidée la cession des activités dans le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques (ce qui amènera à la création de la société Worldline), le groupe informatique a multiplié les erreurs stratégiques, au point que Siemens, son principal actionnaire, décida fin 2022 de passer sous la barre des 5 % du capital et des droits de vote. Compétences envolées, acquisitions mal digérées, désorganisation, faiblesse des actionnaires, les défis pour Atos sont multiples, sa survie incertaine, et l’héritage Breton pèse lourd.
Azéma et Rothschild, les banquiers d’affaires à l’affût
C’est dans ce contexte difficile que Bertrand Meunier, devenu président non exécutif d’Atos à la suite de Thierry Breton, s’est mis dans la tête de proposer un projet pour le groupe… Un projet financier. Logique : le polytechnicien Meunier a en fait un pur profil financier. Venant du private equity et des LBO, il est passé successivement ces dernières années par la Financière le Play, puis M&M Capital, PAI Partners, et enfin CVC Capital Partners. Chez Atos, Meunier peut s’aider sur deux administrateurs de « poids », l’ancien Premier ministre Édouard Philippe nommé dès septembre 2020 (quelques semaines à peine après son départ de Matignon…) et René Proglio, célèbre banquier d’affaires de la place de Paris (dirigeant de Morgan Stanley à Paris durant de nombreuses années et frère d’Henri, l’ex PDG d’EDF et Veolia).
Alléché par la situation fragile du groupe informatique, deux banques d’affaires vont proposer leurs services à Meunier. D’abord, Perella Weinberg Partners (PWP), une boîte américaine qui a ouvert des bureaux à Paris en 2018, ainsi que la banque Rothschild & Co.
Chez Perella, c’est le célèbre banquier d’affaires David Azéma, dont le nom est apparu dans les dossiers Alstom et Veolia, ancien haut fonctionnaire de Bercy, un temps big boss de la très stratégique APE (Agence des Participations de l’État), qui a construit ces dernières mois la solution Airbus pour Atos. Il est aidé pour ce projet de Stéphane Richard, l’ancien patron d’Orange, énarque comme Azéma, et qui a rejoint Perella l’année dernière. Les deux ont popularisé la solution Airbus pour Atos, ou plus exactement pour Evidian, auprès des pouvoirs publics, et notamment à Bercy. De son côté, la banque Rothschild a amené le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky à s’intéresser aux métiers historiques d’Atos rassemblés dans la filiale Tech Foundations. Début mars, on apprenait ainsi dans Le Monde que le groupe de Kretinsky était entré en négociation avec Atos pour reprendre Tech Foundations : « Atos écartelé entre Airbus et Daniel Kretinsky », titrait opportunément le quotidien du soir. Un éventuel deal facile pour la banque d’affaires de l’Avenue de Messine : si les banquiers de Rothschild travaillent bien pour Atos, c’est surtout eux qui ont aidé le milliardaire Daniel Kretinsky à débarquer dans le capitalisme hexagonal depuis 2017.
Les nuages noirs s’accumulent sur le projet de découpage
Rien ne va pourtant se passer comme prévu pour le plan Azéma / Airbus pour Atos. D’abord, la direction d’Atos estime la valeur totale de sa filiale Evidian à 7 milliards d’euros, une valorisation beaucoup trop importante pour Airbus. Chez l’avionneur, les actionnaires toussent, notamment le fonds TIC qui le fait savoir haut et fort. Au point qu’Airbus, après l’annonce des communicants Atos à la mi février, n’a jamais réellement confirmé l’opération Évidian publiquement. Et fin mars, le couperet tombe : l’avionneur annonce dans un communiqué mettre fin aux discussions engagées avec Atos pour acheter 29,9 % du capital d’Évidian. Immédiatement, l’action du groupe dévisse (de 18 %). « Airbus et Atos continuent de discuter d’autres options potentielles », écrit toutefois Airbus en maniant l’euphémisme. Pour Bertrand Meunier, ses équipes, et ses conseils banquiers d’affaire, le coup est rude.
En réalité, pour l’équipe Meunier, les nuages noirs se sont accumulés sur son projet de découpage d’Atos. Au-delà des hésitations d’Airbus, c’est toute la justification financière de l’opération qui est tombée à l’eau ces dernières semaines. Sur le papier, l’ouverture du capital d’Evidian se justifiait avant tout par le fait de pouvoir valoriser cette partie plus profitable d’Atos permettant de financer la restructuration des activités moins profitables de Tech Foundations. Or, les banques d’Atos voyaient déjà d’un mauvais oeil ce projet après avoir déjà prêté près de 2 milliards au groupe de services informatiques pour assurer ladite restructuration du groupe. Mais surtout, les résultats 2022 d’Atos sont venus totalement chambouler ces plans : avec une sous performance inattendue d’Evidan, obtenant une marge opérationnelle de 5 % (et non de 10 % comme espérée), bien deçà de la concurrence (Capgemini est par exemple à 13 % en 2022), et avec une stabilisation de la situation de Tech Foundations. Dans ces conditions comment financer la restructuration de cette dernière entité par une activité moins rentable que prévue ?
La scission, un non sens industriel
Ce n’est pas le seul problème. Car le projet de scission de la direction d’Atos implique en réalité des problèmes opérationnels et industriels colossaux. Car les technologies d’Evidian sont aujourd’hui principalement utilisées par les activités de la filiale Tech Foundations. D’un côté, on trouve donc les compétences, métiers et ressources du cloud, de l’autre, le socle de clients à travers des contrats d’infrastructures. Séparer les deux entités impliquerait une perte de valeur considérable. Un non sens industriel. Résultat, en interne d’Atos, les syndicats sont désormais vent debout contre la perspective d’un tel split et face aux difficultés, la décision a d’ores et déjà été prise par la direction de ne pas faire la scission comme prévu en juillet. Bref, après toute l’agitation de communication dans la presse de ces dernières semaines, à grands renforts de communiqués d’Atos, il est désormais urgent d’attendre.
Une chose est sûre : toute cette séquence aura considérablement fragilisé Bertrand Meunier à la tête d’Atos. Alors que la date de la future assemblée générale des actionnaires d’Atos n’est toujours pas fixée, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter un renversement de Bertrand Meunier à la tête du groupe. « Il y a de grosses pressions pour qu’il parte », me confirme un haut cadre d’Atos. Selon la Lettre A, c’est notamment les fonds minoritaires comme Sparta Capital ou Sycomore Asset Management qui poussent dans ce sens, et qui testeraient déjà un nouveau « ticket », composé de Bernard Bourigeaud, l’un des pères fondateurs d’Atos, qu’il a dirigé pendant dix-sept ans, président non exécutif de Worldline depuis fin 2021, et Vincent Rouaix, conseiller du groupe Inetum en matière de fusions acquisitions.
Au sein de l’État, la Défense se rebiffe sur Atos
La machine Meunier s’est également grippée car la solution Airbus proposée par David Azéma a fini par prendre l’eau du côté de l’État français. Si, dans un premier temps, le gouvernement a plutôt regardé d’un bon œil l’opération, les oppositions à Airbus au coeur de l’État se sont vite multipliées. Certes, à Bercy, le ministre Bruno Le Maire et les hauts fonctionnaires des Finances avaient tous été conquis par l’argumentaire des financiers David Azéma et Bertrand Meunier. Encore aujourd’hui, la seule vision de Bercy sur Atos est… financière. Peu importe, si désormais, l’Union Européenne semble vouloir prendre en compte également les considérations stratégiques dans le développement de son industrie ou si le président français ne cesse d’en appeler à « l’autonomie stratégique » de l’Europe.
À Bercy, le dogme des banquiers d’affaires de la découpe facile et des fees confortables continue de régner en maître, malgré les polémiques de ces dernières années. Résultat, au sein de l’État, l’offensive anti Azéma et anti Airbus est venue du ministère de la Défense, et notamment de la Direction Générale de l’Armement (DGA) et de la DAM (Direction des Applications Militaires) qui gère la force de dissuasion nucléaire, deux gros clients des stratégiques supercalculateurs de la pépite BDS d’ATOS. La DAM comme la DGA ont exprimé fortement leur opposition à la solution Airbus pour Atos auprès l’Elysée, où Alexis Kohler se chargeait de gérer ce dossier sensible et « de compter les points », selon un observateur du dossier.
Bercy l’oublie, mais historiquement, les compétences françaises dans les supercalculateurs ont été soutenues à bout de bras par l’État pour assurer l’autonomie de la force de dissuasion, face aux États-Unis (notamment après la sortie de De Gaulle du commandement intégré de l’OTAN). Après l’échec du plan calcul, la nationalisation de Bull sous Mitterrand permettra à la France de préserver d’une manière indépendante ses capacités en supercalculateurs, mais les échecs de gestion se multiplient et le gouvernement amorce une privatisation complète dans les années 2000. Bull se concentre alors principalement sur les supercalculateurs pour ses clients sensibles, le CEA et la DAM, avant d’être racheté par Atos en 2014.
L’épouvantail allemand pour les tenants de la bombe
Cette histoire stratégique de l’informatique française pousse aujourd’hui la DAM et la DGA à défendre auprès du château à une solution 100 % française pour ATOS, la seule permettant de conserver l’autonomie complète de la force de dissuasion nucléaire. Car contrairement aux apparences, les activités militaires et stratégiques d’Airbus, regroupées dans Airbus Defence and Space, sont aujourd’hui principalement allemandes et localisées outre-Rhin. « Cette opération Airbus étaient en fait destinée à embêter Thales », croit savoir un initié du complexe militaro-industriel français, « d’où la montée d’un “tout sauf les Allemands” au sein de l’État français, et notamment à la Défense » . De fait, Airbus ne fait pas partie de l’écosystème stratégique français.
D’autant plus que la rivalité entre Airbus Defence and Space et Thales remonte à loin. Dans les années 1990, ces activités outre-Rhin ne s’appelaient pas Airbus mais DASA qui s’était lancé dans le programme d’avion de combat Eurofighter Typhoon en concurrence frontale avec le Rafale français de Dassault et équipé électroniquement par Thales. Plus tard, une guerre commerciale a opposé en Arabie Saoudite le missile Crotale français de Thales avec le Mica VL d’EADS (avant que le groupe devienne Airbus). La partie fut alors remportée par Thales.
Et aujourd’hui, l’affrontement se situe autour du contrôle de la plateforme de combat du futur en Europe, à travers les discussions sur le SCAF (système de combat aérien du futur), qui vise, à terme, de coaliser des avions différents dans un système unifié de systèmes d’information, de transmission de données, de détection, d’intelligence artificielle… Dans ce contexte, Airbus Defence qui dispose de tout un tas de systèmes d’armes concurrents de Thales souhaite entrer dans l’écosystème Atos en espérant au final mettre un pied dans le cloud militaire français. Un véritable casus belli. Airbus, déjà présent historiquement dans les programmes d’avions européens Tornado et Typhoon, se retrouve en frontal en France avec Dassault et Thales.
Bien évidement, les considérations bassement financières de Bercy apparaissent presque puériles dans ce contexte. Lors des discussions entre Thales et les hauts fonctionnaires au sujet d’Atos, ces derniers n’ont cherché qu’à maximiser les prix plutôt qu’à réfléchir au mécano industriel d’ensemble. Selon nos informations, Thales serait d’ailleurs toujours intéressé par les pépites d’Atos, notamment dans la partie cyber et supercalculateurs. L’État doit donc réfléchir à une solution viable pour conjuguer optimisation industrielle et préservation des activités et des compétences. D’autant qu’au delà des considérations de Défense, le cloud, les calculateurs, le cyber, les services, les besoins de stockage et de calcul vont exploser avec l’ère de l’Intelligence Artificielle.
Quand Thales et Atos s’écharpaient pour Gemalto
Reste que ces dernières années, les relations entre Thales et Atos étaient loin d’être au beau fixe. Comme je le racontais dans mon livre l’Emprise (Seuil, 2022), à l’automne 2017, le groupe Atos, alors dirigé par Thierry Breton, annonce une OPA (Offre Publique d’Achat) hostile sur la société de sécurité numérique Gemalto (issue de Gemplus, société française mythique qui fabriquait les premières cartes à puce), dont l’État est actionnaire, via le Fonds stratégique d’investissement. Fin décembre 2017, la bataille s’engage alors lors d’une semaine décisive. Alors que Thierry Breton a le soutien de Martin Vial à l’Agence de Participation de l’État (APE) et pense également être soutenu par le président Macron (qu’il n’a pas manqué d’informer), il se trouve confronté trois jours après son annonce, à une contre-offensive blitzkrieg de Thales.
Tandis qu’Emmanuel Macron part avec sa femme Brigitte au château de Chambord pour le week-end, une conférence téléphonique est organisée le vendredi soir entre Alexis Kohler et toute l’équipe de Thales, ainsi que leurs conseils. C’est notamment le banquier d’affaires François Roussely, un homme de réseaux qui était alors toujours très puissant sur la place de Paris (décédé début 2023, il fut notamment dans sa carrière l’ancien patron de la police nationale sous François Mitterrand et Pierre Joxe, et le puissant patron d’EDF), qui se trouve à la manœuvre pour Thales. Au téléphone Roussely dit au passage à Kohler, pour emporter l’offre : « c’est pour le bien de la France ! » Volte-face de l’État, Atos perd son soutien, et le lendemain c’est l’offre Thales qui l’emporte. Au grand dam de Thierry Breton, qui laisse éclater sa colère quelques jours plus tard dans le bureau du ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Mais le petit protégé de Bernard Arnault ne perd pas tout. À l’automne 2019, sur les recommandations du grand patron du luxe, Emmanuel Macron le fait nommer, contre l’avis d’Alexis Kohler, commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense, et de l’espace. Manifestement, l’État français n’avait pas anticipé encore de devoir trouver une solution au casse-tête Atos, faute d’anticipation et de réflexion stratégique.
- Persos A à L
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Frédéric LORDON
- Blogs persos du Diplo
- LePartisan.info
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Romain MIELCAREK
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Fabrice NICOLINO
- Timothée PARRIQUE
- Emmanuel PONT
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- Numérique
- Binaire [Blogs Le Monde]
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Francis PISANI
- Pixel de Tracking
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- XKCD