Transition écologique, économique et financière
08.02.2024 à 16:59
La course au volume est-elle favorable aux agriculteurs ?
Billet invité
Les agriculteurs sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leurs multiples motifs de mécontentements. Comment expliquer que des agriculteurs qui travaillent beaucoup n’arrivent pas à dégager un revenu suffisant pour couvrir leurs charges ? Comment expliquer que les plus gros céréaliers qui poussent depuis des années à produire toujours plus, se retrouvent également […]
The post La course au volume est-elle favorable aux agriculteurs ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (3107 mots)
Les agriculteurs sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leurs multiples motifs de mécontentements. Comment expliquer que des agriculteurs qui travaillent beaucoup n’arrivent pas à dégager un revenu suffisant pour couvrir leurs charges ? Comment expliquer que les plus gros céréaliers qui poussent depuis des années à produire toujours plus, se retrouvent également dans cette situation ? Le discours de la FNSEA est de longue date de développer la production pour gagner plus. Cela ne semble pas être toujours gagnant. Il faut se demander si le modèle de développement promu par l’État et les organisations professionnelles majoritaires[1] n’est pas dans une impasse. Nous allons voir dans ce billet que la réponse est positive sans équivoque et qu’il existe des alternatives bien meilleures économiquement, socialement et écologiquement.
L’échec du modèle agricole dominant
Les agriculteurs travaillent beaucoup (plus de 80 heures par semaine). Si évaluer le revenu des agriculteurs n’est pas aisé[2], les prélèvements privés par actif non salarié travaillant sur l’exploitation[3] est l’indicateur qui se rapproche le plus de ce que serait un salaire. Ils s’élevaient en 2021 à 30k€ en moyenne par exploitation avec cependant une très forte hétérogénéité : ce revenu n’est que de 14k€ dans les plus petites exploitations (ce qui est très insuffisant pour vivre décemment) et plus de 46k€ chez les plus gros exploitants[4]. Cette forte différence s’explique par les aides de la PAC qui, depuis 1992, sont versées en fonction de la taille de l’exploitation (nombre d’ha) ou du nombre d’animaux présents. De ce fait, en 2020, 17% des exploitations françaises ont reçu 50 % des aides. Ainsi, le président actuel de la FNSEA, reçoit plus de 170k€ pour les près de 700ha qu’il exploite via diverses sociétés dans le Bassin parisien[5], alors qu’en moyenne une exploitation céréalière reçoit 33k€[6]. Ces aides européennes sont indispensables pour la plupart des exploitations. D’après la publication de référence Graph’agri 2022, publiée par le service statistique du ministère de l’agriculture « les subventions d’exploitation versées en 2020 représentent en moyenne, pour les bénéficiaires, 16,7 % des produits courants et 46,5 % de l’EBE »[7].
Le discours des organisations agricoles et des industries agro-alimentaires est d’encourager les agriculteurs à produire toujours plus, pour avoir plus d’aides et améliorer leur revenu. L’objectif est d’aider les exploitations à grossir pour réduire les charges par unité produite. Ceci implique, par ailleurs, un agrandissement régulier des exploitations au détriment de la reprise des fermes par les jeunes.
Les manifestations actuelles montrent que l’objectif d’amélioration du revenu n’est pas atteint dans la majorité des cas. Il est facile de comprendre pourquoi : pour produire plus les exploitations s’endettent pour acheter du matériel plus performant, plus d’engrais pour augmenter les volumes produits, plus de pesticides pour lutter contre les maladies. Pour produire plus, elles augmentent les surfaces, ce qui fait progresser les charges de structures mais aussi les charges opérationnelles notamment de carburant. Des machines plus puissantes, plus lourdes, équipées de logiciel d’aides à la gestion des épandages consomment plus de fuel. L’agrandissement conduit les agriculteurs à faire plus de kilomètres en tracteur, ce qui expliquent leur revendication pour atténuer les taxes sur le carburant au détriment de la réduction des émissions de GES.
Malgré tous ces moyens techniques, les rendements ne progressent plus car les sols ont perdu de leur fertilité, de leur humus. Les sols s’appauvrissent et les intrants coûteux ne parviennent plus à compenser la baisse de qualité du sol. Des sur- investissements, surtout dans le matériel, expliquent que malgré plus de volumes produits les agriculteurs ne voient pas leur revenu progresser. En 2020, l’endettement moyen des exploitations françaises est de près de 43%[8]. Les exploitations qui espéraient gagner plus voient une part de leur résultat aller vers les banques, vers les industries agroalimentaires ou les coopératives d’approvisionnement.
Certes, certains agriculteurs obtiennent le résultat escompté en cumulant un certain nombre d’atouts : une situation de départ favorable (ferme des parents déjà de taille importante et bien structurée), une excellente qualité agronomique des sols, des débouchés industriels sécurisés, des conditions de financement améliorées du fait de la taille et bien sûr une bonne compétence technique du chef d’exploitation. Dans le Bassin parisien ou dans la région Hauts-de-France, vue la qualité des terres, les incidents climatiques moins nombreux que dans d’autres régions plus centrales ou méridionales, la course au rendement peut être gagnante, même si aujourd’hui dans ces régions les exploitants constatent un plafonnement et même parfois une réduction des rendements[9]. Dans les zones intermédiaires de la périphérie du bassin parisien, en Bourgogne, en centre Val de Loire ou dans les régions du Sud-ouest, la qualité des terres moindre, des variations climatiques plus importantes ne permettent pas, le plus souvent , d’atteindre l’objectif de revenu.
Beaucoup de travail, un capital à gérer très important et des revenus qui progressent peu dans le temps : nous sommes face à une agriculture très capitalistique difficilement reprenable. Les exploitations de grandes tailles, fortement équipées sont très coûteuses et la reprise par des jeunes est difficile.
D’un point de vue environnemental, ce modèle a montré son échec : perte de fertilité des sols, réduction drastique de la biodiversité, ressource en eau réduite et polluée, conséquence négative sur la santé par l’exposition des agriculteurs et des riverains aux pesticides.
Ce schéma est-il universel et irréversible ? Heureusement, non. Les injonctions du syndicat dominant ne sont pas nécessairement suivies. Des agriculteurs de longue date ont choisi de revenir à des modèles reposant plus sur l’agronomie, sur la meilleure utilisation des ressources naturelles et locales. Plutôt que de suivre un modèle unique, ils s’appuient sur leur environnement proche, observent les conditions climatiques, les possibilités du sol, tirent profit des interactions positives avec le milieu naturel. Ils ne cherchent pas à produire plus mais à produire mieux en faisant reposer leur revenu sur un chiffre d’affaires moindre et des charges opérationnelles et de structures moins importantes.
L’équilibre financier repose sur un nouvel équilibre, qui n’est pas facile à faire comprendre aux banquiers. Une ferme avec un chiffre d’affaires modeste peut-elle être durablement rentable ?
Gagner plus en produisant moins, c’est possible.
Nous pouvons nous appuyer sur l’exemple[10] d’un éleveur laitier breton. Originaire du milieu agricole, il a repris en 2012, à 23 ans, la ferme de ses parents. Son projet d’installation était très classique : 350 000 litres de lait conventionnel, 69 hectares de maïs/céréales/herbe, des vaches produisant 7 500 litres par année. Le troupeau est monté rapidement à 35 vaches pour 70 heures de travail par semaine. Le système était bien maîtrisé avec des achats d’intrants optimisés. Il dégageait un bon Excédent Brut d’Exploitation, mais pas de trésorerie du fait des annuités de 55 000 euros à rembourser.
En 2017, à l’installation de sa conjointe, le couple décide de changer l’objectif de l’exploitation. L’objectif principal est devenu de produire le lait au moment où il coûte le moins cher à produire. Deux raisons ont poussé à ce changement d’orientation : améliorer le revenu en produisant du lait au moindre coût et travailler moins pour mieux vivre.
Ce changement fondamental a nécessité une remise en question rapide. En trois ans, toutes les surfaces sont passées en prairies. Le parcellaire bien groupé[11] avec 58 hectares autour du bâtiment et 10 hectares à trois kilomètres a permis de tirer profit au mieux de l’herbe. La suppression du maïs et des céréales a entrainé une forte réduction des frais de culture notamment des consommations de fuel.
Les exploitants ont accepté de voir la production par vache baisser. La ferme produit aujourd’hui autant de lait qu’avant le changement de système mais avec 10 vaches de plus. Les 47 vaches vêlent toutes au printemps du 1er mars à mi-avril. Elles produisent annuellement 4 200 litres de lait bio et ne sont traites qu’une fois par jour, ce qui réduit le travail sans effet néfaste sur les animaux. La salle de traite est fermée pendant deux mois (de mi-décembre à mi-février), afin de prendre des congés en famille. Aucun aliment n’est acheté en dehors du sel et des minéraux.
Au plan économique, la situation s’est considérablement améliorée. Tout d’abord, la vente des machines devenues inutiles (des travaux de culture ayant été supprimés) a permis de rapporter 50 000 euros de trésorerie au moment de la transition. Et les annuités d’emprunt se sont fortement réduites. La suppression des charges d’achat d’aliments complémentaires, d’engrais, de phytos et de semences a permis d’économiser 70 000 euros par an. Les deux exploitants fournissent, en moyenne sur l’année, et à eux deux, quarante heures de travail par semaine et leur EBE est pour chacun de 55 000 euros. En 2022, l’exploitation a dégagé 80 000 euros de revenu pour une production de 156 000 euros.
Ce système nécessite d’observer attentivement la pousse de l’herbe et de décider de faire brouter ou de faucher au bon moment. Le travail change et repose sur des passages réguliers dans les prairies et de tenir compte finement des conditions climatiques. Bien entendu, ce système fonctionne bien car il est adapté aux conditions climatiques humides avec une pluviométrie assez régulière.
L’exploitation s’est engagée dans la production bio et s’est intéressée également à l’amélioration des conditions environnementales : 2 km de haies ont été replantées avec des espèces locales. Ces haies sont utiles pour la reprise de la biodiversité et sont utiles aussi aux vaches qui peuvent trouver de l’ombre l’été ou se protéger du vent l’automne.
Au total, le chiffre d’affaires a baissé mais avec un travail réduit et en respectant l’environnement. Par contre, le revenu disponible s’est fortement accru : (80 k€ au lieu de 30k€ en moyenne comme on l’a vu plus haut). Certes, il est moins profitable aux fournisseurs d’intrants et aux banques qui ont moins d’investissements à financer…
Cet exemple montre qu’une autre agriculture et possible. Elle permet aussi d’assurer la souveraineté alimentaire, (elle produit autant avec plus d’animaux[12]), de mieux vivre et de respecter l’environnement.
Dans tous ces systèmes « durables » l’agriculteur doit tenir compte de son milieu et ne peut plus appliquer une recette valable pour tous dans toutes les conditions.
Les agriculteurs qui pratiquent cette agriculture durable[13] sont déjà nombreux (en ordre de grandeur ils représentent 10% du total) mais ont du mal à se faire entendre des pouvoirs publics[14]. Ce type d’agriculture moins équipée en matériel, moins capitalistique peut paraitre peu dynamique, mais ses résultats sont probants. Le syndicalisme majoritaire pousse à accroître le Chiffre d’affaires ce qui convient bien aux intermédiaires de l’agriculture (fournisseurs d’aliments, de machines, d’engrais, de phytos) qui en profitent pour développer leur propre activité. Le système intensif fait tourner l’amont de l’agriculture, mais le producteur lui ne s’y retrouve que rarement. Les systèmes durables replacent le revenu de l’agriculteur comme la variable principale.
En outre et c’est fondamental aujourd’hui, ces modèles sont plus facilement transmissibles et peuvent assurer l’avenir des exploitations sur le territoire. Dans la course à l’agrandissement et à la productivité la France sera, sans aucun doute, perdante car il y a d’autres pays dans le monde qui peuvent avoir de très grands espaces avec des charges faibles et des conditions sociales moins bonnes.
Annexe : comparaison sur la formation du revenu en système conventionnel et en système durable.
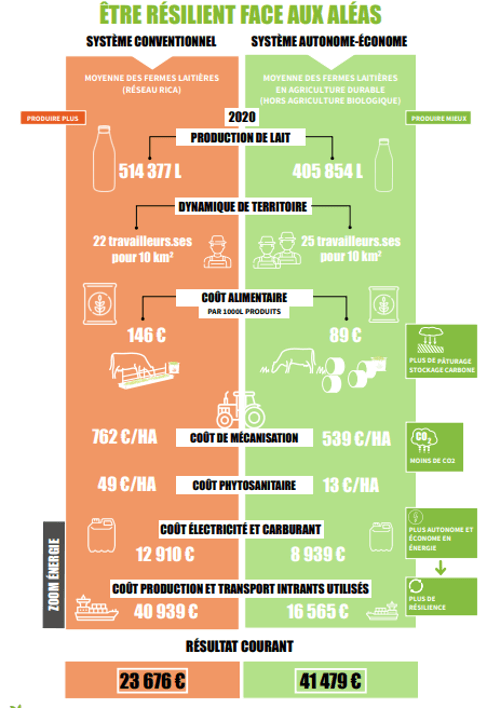
Michel Auzet, ingénieur agronome, directeur du master Management des politiques environnementales et soutenables , Institut Catholique de Paris
Notes
[1] Rappelons qu’en agriculture on assiste depuis les années 1960 à une cogestion des décisions politiques entre l’État et les deux syndicats FNSEA et JA. Cette situation est vraiment originale et particulière. Les syndicats ouvriers ne cogèrent pas avec le ministère du travail, pas plus que les syndicats enseignants avec celui de l’éducation nationale. Cela peut donc porter à sourire quand la FNSEA appelle à manifester contre une politique qu’elle soutient de longue date.
[2] Voir la fiche sur l’évolution du revenu des agriculteurs sur la plateforme The Other Economy
[3] c’est-à-dire l’agriculteur ou l’agricultrice ainsi que son conjoint et les éventuels aidants familiaux. Cet indicateur est exprimé en équivalent temps plein.
[4] Source : Les Résultats économiques des exploitations agricoles en 2021 – RICA
[5] Voir Arnaud Rousseau, un poids lourd de l’agrobusiness pour diriger la FNSEA, Mediapart (mars 2023)
[6] Voir Graph’Agri 2022 – Agreste, site de la statistique du ministère de l’agriculture (p. 69).
[7] L’EBE (Excédent brut d’exploitation) correspond au flux de ressources généré, au cours de l’exercice, par la gestion courante de l’exploitation (ou de l’entreprise) sans tenir compte de sa politique d’investissements (amortissements) et de sa gestion financière (frais financiers. Voir la définition de l’EBE sur Agreste le site de la statistique du ministère de l’agriculture.
[8] Graph’Agri 2022 – Agreste, site de la statistique du ministère de l’agriculture (p. 75).
[9] Voir Encyclopédie de l’Académie d’agriculture de France – Évolution du rendement moyen annuel du blé France entière de 1815 à 2021
[12] Les émissions de méthane par litre de lait sont donc supérieures. Mais, d’une part nous continuerons à manger de la viande et du lait en 2050 même dans un scénario de neutralité carbone. D’autre part, il est bien préférable sur tous les plans que ce lait soit produit ainsi (par des animaux pâturant l’herbe). Enfin, le bilan GES complet d’une telle exploitation doit intégrer le stockage du carbone par les prairies, la réduction de N2O et d’usage de fioul.
[13] Sans rentrer dans la bataille des labels, une agriculture durable est une agriculture économe en intrant qui vise l’autonomie. Elle met en avant le lien au sol et prône la sobriété énergétique.
[14] Les pouvoirs publics accordent peu de soutien aux mesures environnementales. Les Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) financées en partie par la PAC et la France ne sont pas suffisantes. L’État n’apporte pas les budgets pour financer ces mesures écologiques qui doivent accompagner la transition, plus de haies, respect des sols…
The post La course au volume est-elle favorable aux agriculteurs ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
05.02.2024 à 11:43
Enjeux économiques de la transition climatique, commentaires sur le rapport de la DGT
Alain Grandjean
La Direction générale du Trésor vient de publier un rapport sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone. Ce rapport est bienvenu après celui de Jean Pisani et Selma Mahfouz sur les incidences économique de l’action pour le climat. Il est en effet important de continuer à approfondir la question des impacts […]
The post Enjeux économiques de la transition climatique, commentaires sur le rapport de la DGT appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (7059 mots)
La Direction générale du Trésor vient de publier un rapport sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone. Ce rapport est bienvenu après celui de Jean Pisani et Selma Mahfouz sur les incidences économique de l’action pour le climat. Il est en effet important de continuer à approfondir la question des impacts économiques de la transition. Il est également appréciable de disposer d’un rapport intermédiaire ce qui permet d’exprimer des remarques susceptibles d’être prises en compte dans le rapport final ou au moins discutées. La note qui suit se limite à quelques remarques et ne constitue en rien une appréciation d’ensemble.
1/ Les impacts à terme du changement climatique sur le PIB sont très sous-évalués
Le rapport expose la difficulté de l’évaluation des impacts du changement climatique par rapport à un scénario contrefactuel « sans changement climatique » et les limites de la littérature existantes. Il est très clair sur le fait qu’il n’existe aucune méthode fiable permettant de chiffrer ex ante l’impact économique du changement climatique sur l’économie (Tableau 2, p. 22)[1] et il souligne à la fois le risque élevé de sous-estimation et le degré élevé d’incertitude de toute estimation (voir encadré ci-après).
Malgré toutes ces précautions, le rapport finit par citer (comme tous les autres documents abordant ce sujet) quelques résultats issus des travaux portant sur l’évaluation économique des dommages climatiques, qui sous estiment très largement les impacts.
Le rapport cite ainsi les conclusions des rapports du NGFS, le réseau de réflexion des banques centrales et superviseurs financiers sur le climat, selon lesquels une trajectoire de réchauffement menant à + 3°C en 2100 au niveau mondial (soit environ +2°C en température en 2050) se traduirait, en 2050, par une baisse du PIB de la France de 8%. Il est important de comprendre que cette baisse est envisagée par rapport à ce que le PIB aurait été sans réchauffement, l’hypothèse sur ce dernier point étant celle d’un croissance continue. Ce qui est envisagé ce n’est donc pas une baisse du PIB en valeur absolue d’ici 2050 mais un ralentissement de sa croissance.[2] Par exemple, au lieu d’une croissance du PIB sans réchauffement de 1% par an d’ici 2050, on aurait une croissance du PIB de seulement 0,7% an. A titre de comparaison, le coût des seules inondations de 2021 dans la vallée de l’Ahr en Allemagne est estimé à 40 Mrd d’Euros, soit environ 1% du PIB de l’Allemagne[3].
Le rapport évoque également le GIEC qui retiendrait dans son dernier rapport de synthèse, qu’ « un réchauffement des températures d’environ 4°C en 2100 entraînerait un déclin du PIB mondial compris entre 10 % et 23 % à cet horizon[4] » (par rapport à un PIB sans réchauffement).
|
Les risques de sous-estimation des impacts économiques du changement climatique et leur degré d’incertitude sont élevés. Le rapport décrit les raisons de la sous-estimation de chacune des méthodes utilisées pour estimer les dommages climatiques : la méthode énumérative ne prend pas en compte de certains secteurs ; dans les modèles d’équilibre[5], l’éloignement entre l’ancien et le nouveau point d’équilibre décrédibilise l’hypothèse de stabilisation par un ajustement des prix ; les méthodes économétriques[6] posent problème en raison notamment de leur linéarité. Quelle que soit la méthode, le manque d’observations pertinentes pour estimer des phénomènes inédits crée une incertitude majeure sur la qualité des chiffrages, sur le périmètre des dommages à prendre en considération et sur la régularité des liens entre différents phénomènes. En outre, l’estimation de l’impact du changement climatique s’articule nécessairement autour d’un scénario d’émissions de gaz à effet de serre (et donc de politiques mondialement menées) et de ses conséquences sur la hausse des températures. Même en fixant le scénario central pour les émissions de gaz à effet de serre, les sources d’incertitude, ce que « l’on sait ne pas savoir », restent nombreuses : A) Incertitudes liées à l’impact physique du réchauffement climatique sur la biosphère :
B) Incertitudes liées aux impacts sur les systèmes socio-économiques
Tout en mentionnant certains chiffrages, le rapport indique dans sa conclusion du chapitre 1.2 : « Cependant, ces estimations restent très incertaines, dépendent fortement des options de modélisations choisies. Elles n’incluent pas les enjeux non-monétaires détaillés au début de cette section, comme certains effets sur la santé ou le bien-être, ainsi qu’une partie des services écosystémiques rendus par la biodiversité. » |
Il importe de s’interroger sur la cohérence de messages qui communiquent en même temps sur des impacts possibles et reconnaissent que ce chiffrage est hautement incertain[8]. Le risque est double car les chiffres se retiennent plus facilement que la liste des caveat.
D’une part, l’écart entre les risques clés décrits par le GIEC qui affecteront directement ou indirectement la France et l’Union européenne et des chiffrages moyens très bas qui circulent dans la sphère publique décrédibilisent les travaux des climatologues tout en faisant disparaître les disparités régionales et sociales.
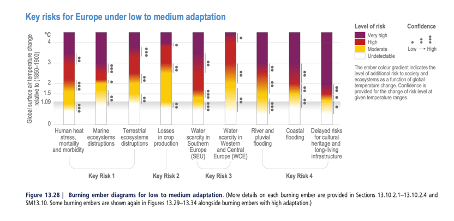
Source : IPCC Sixth Assessment Report, Impacts, Adaptation and Vulnerability, Chap. 13. Graph. 13.28, P. 1874
D’autre part, ces chiffrages vont guider les montants que les acteurs économiques (les administrations, les entreprises financières et non financières et les ménages) seront prêts à investir dans l’adaptation et pour respecter les engagements internationaux de réduction de gaz à effet de serre. Tenter de s’organiser pour adapter l’économie et la société françaises à un réchauffement de 4°C est une précaution légitime, même si elle a de fortes limites[9]. Mais un chiffrage faible des impacts d’un tel réchauffement est de nature à ralentir l’action : faire face à un tel niveau de réchauffement peut sembler tout-à-fait gérable au cas par cas avec un taux de croissance de 1 à 2% par an. La prudence élémentaire impliquerait non seulement de ne pas passer sous silence le coût humain (santé et mortalité) mais aussi de ne pas sous-estimer les impacts économiques et donc sociaux. Sinon, cela conduit à démobiliser les acteurs surtout dans un contexte social où les difficultés de la transition pour certains acteurs sont mises en avant.
Devant cet immense défi il faut avoir le courage de constater que les modèles macroéconomiques existants ne sont pas bien adaptés pour faire ces travaux et que la fiabilité de leurs chiffrages est faible, indépendamment des critiques génériques qui peuvent leur être faites[10] pour représenter des situations nouvelles, en rupture et à fort niveau d’incertitude. Il est nécessaire d’explorer dans les meilleurs délais d’autres approches.
2/ L’insuffisante prise en compte des risques de transition conduit à une impasse sur le bouclage avec le système financier.
La considération à apporter au bouclage avec le système financier est mentionné – incidemment – dans le rapport du Trésor à quatre endroits. Une première fois, pour indiquer que le secteur bancaire et assurantiel fera partie des cinq secteurs les plus affectés avec l’énergie, le tourisme, les infrastructures et l’agriculture[11]. Une deuxième fois, pour mentionner que « l’impact économique dépendra aussi de la réaction du système financier » (p.18). Une troisième fois, indirectement, pour noter que les études d’impact du changement climatique ne prennent en général pas en compte le coût des actifs dévalorisés (ce qui ne manquera pas d’impacter le système financier) ; une quatrième fois, pour répéter que la « stabilité macroéconomique et financière sera une condition nécessaire à une transition réussie » (p.44).
Il ne fait pas de doute que le système financier et sa réglementation font partie de la solution en complément indispensable des politiques budgétaires. Le système financier interagit avec le climat dans les deux sens : le changement climatique fait peser des risques de transition et des risques physiques sur le système financier et la majorité des activités financées émettent des gaz à effet de serre. Pour les acteurs économiques et financiers, c’est le terme de « double matérialité » qui est employé pour caractériser ces deux effets. L’Union européenne a commencé à intégrer cette double problématique dans la réglementation financière[12].
Le Réseau des banques centrales pour Verdir le Système Financier (NGFS) distingue, à la suite de Mark Carney[13], deux types de risques :
- les risques physiques qui sont la conséquence directe des impacts du changement climatique sur les actifs (inondations, sécheresse, tempêtes etc.)
- les risques de transition qui concernent les effets sur les acteurs économiques d’une modification inattendue de la réglementation et des politiques publiques, des préférences des consommateurs ou des innovations dans la perspective de réaliser une économie zéro carbone. Dans la mesure où ni les tendances actuelles ni les politiques annoncées ne suffiront à tenir les engagements climatiques les risques de transition ne sont pas nuls[14].
Le NGFS envisage sept scénarii qui, en fonction des politiques menées dans le monde et du réchauffement climatique qui en découle, combinent à des degrés divers les risques de transition et les risques physiques[15]. Ils fournissent un cadre dans lequel il est possible d’évaluer les politiques nationales de prévention des risques.
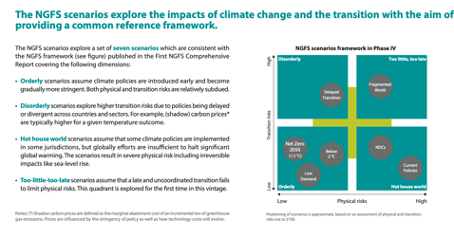
Source : NGFS scenarios for central bank and supervisors, Novembre 2023
Le rapport de la direction du trésor semble se focaliser sur le scénario mondial « hot house » qui postule de faibles risques de transition[16] et des risques physiques considérés comme élevés (même si largement sous-estimés), mais se matérialisant dans « longtemps ». L’adaptation du secteur assurantiel et bancaire se limiterait alors à la gestion de risques physiques accrus via des hausses des primes ou des déclarations de non-assurabilité[17].
Deux autres scénarios au niveau mondial mériteraient cependant une attention particulière :
- le scénario d’une « transition tardive = politiques de transition brutalement accélérées au niveau mondial autour de 2030 à la suite d’une multiplication de catastrophes et/ou pressions politiques » ;
- le scenario « monde fragmenté » = avec des politiques de transition divergentes entre grands blocs.
Dans de tels scénarios, la matérialisation de risques de transition par dévalorisation rapide de certains actifs et, en conséquence, de déstabilisation du système bancaire et financier ainsi que par des tensions sur les prix voire réduction de la disponibilité des énergies fossiles importées doit être considérée comme possible dès « demain » avec une probabilité qui augmente avec le temps, mais non estimable par manque d’observations passées pertinentes. Or il nous semble que c’est en insistant sur les risques de transition et en soulignant qu’ils sont de court/moyen terme que l’on augmente les chances d’une accélération « ordonnée » de politiques nationales d’atténuation, de réduction de dépendance aux énergies fossile et des risques de transition, y compris au travers d’une réglementation financière rigoureuse[18].
Focaliser sur le scénario du pire en termes physiques, le scénario « hot house » tend paradoxalement à retarder les efforts (soit par un raisonnement fataliste « tout est perdu » soit par un effet passager clandestin) d’autant plus que ses impacts macroéconomiques semblent gérables. Ceci incite aussi à privilégier des solutions dont les effets porteront dans plusieurs années et dont le coût politique/social ou de compétitivité est faible à court terme. Mais ces choix devront tôt ou tard être révisés sous la pression des conséquences inéluctables du changement climatique.
Pour réfléchir à ce type de scénarios que ce soit au niveau mondial ou national, les modèles macroéconomiques qui négligent les risques d’instabilité du système financier (en particulier, les modèles d’équilibre général) sont inadaptés par construction. L’objectif des politiques publiques ne doit pas être une optimisation sous contrainte et une recherche des « moindres coûts », mais a recherche de la résilience ou de la robustesse, comme le suggère Olivier Hamant[19], de nos sociétés à des chocs répétés, inattendus, et de diverses origines (météorologiques, épidémiques, géopolitiques, sociaux etc.). Dès lors la démarche à adopter devrait être d’abord de nature plus prospective et qualitative en identifiant les rares zones de certitude assez solidement établie et les divers grands aléas possibles. Les conclusions opérationnelles à viser sont plutôt de l’ordre de la prévention, de la précaution et de la préparation à l’adaptation plutôt que de l’ordre du moindre coût.
Il faut espérer que le rapport final inclura ces aspects, gages de la stabilité financière, dans ses réflexions.
3/ Comment réfléchir à la question de la soutenabilité des finances publiques ?
L’analyse précédente n’implique pas que nous suggérons de revenir au « quoi qu’il en coûte » et de ne tenir aucun compte des contraintes dues à notre endettement public.
Néanmoins force est de constater que l’approche retenue par les règles européennes (dans leur version actuelle ou dans les propositions de réforme en cours de discussion ) est étroitement comptable. Pourtant, les investissements permettant de réduire les risques climatiques pour nos sociétés et économies[20] limitent de facto aussi les risques pour les finances publiques, puisqu’ils sont de nature à réduire aussi les risques sur la hausse de la dette publique. Ce sont donc des éléments d’appréciation de l’évolution de sa soutenabilité.
Il est parfois avancé que la question de l’endettement public est indépendante de la nature de la dépense financée[21]. L’État français n’a jamais levé autant de dette (285 milliards prévus pour 2024) et il est parfois affirmé que du fait du niveau actuel de son endettement total, il court le risque que les agences de notation dégradent sa note, ce qui conduirait à un renchérissement des taux et alourdirait encore la charge de la dette et le déficit public. Cet argument est à prendre avec précaution.
D’une part la dette publique française reste très appréciée par les marchés, du fait en particulier des taux d’intérêt qui rendent ce placement attractif, mais surtout du fait qu’elle reste un placement sûr[22] par rapport aux alternatives.
D’autre part, si les risques évoqués ci-dessus sont réels il est difficile de croire qu’ils ne seront pas finalement pris en considération par les investisseurs, de même que les mesures prises pour les « réduire » pourraient être appréciées. Il est à l’évidence plus soutenable que la dette publique croisse un peu plus à court terme[23] pour éviter sa flambée que l’inverse – une dette apparemment maîtrisée à court terme mais potentiellement explosive.
Il est essentiel de sortir du schéma martelé par certains de nos partenaires européens selon lequel nous serions les « mauvais élèves de l’ Europe ». L’Allemagne a ralenti la transition en Europe et sur son propre sol par des politiques budgétaires beaucoup trop restrictives. Le gouvernement Scholz a été obligé de revenir sur ses engagements en matière d’investissements dans la transition parce qu’un jugement du tribunal constitutionnel ne permet plus d’accommoder les contraintes comptables de cette absurdité économique qu’est le frein à l’endettement, une disposition encore plus restrictive que les règles européennes.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer l’effet macroéconomique des investissements de la transition notamment du fait qu’ils contribuent à terme à la réduction des importations de pétrole et de gaz. A ce sujet les modèles utilisés pour évaluer l’impact macroéconomique de la transition sont peu adaptés pour la prise en considération de cet effet positif. On y reviendra plus loin.
4/ Atténuation : l’emphase sur la taxe carbone est trop forte même si la nécessité d’un policy mix est bien mise en avant.
Le rapport mentionne bien la nécessité de combiner divers instruments de politique publique (chapitre 2.1) mais insiste sur le fait que le signal-prix via une taxe carbone ou un dispositif de quotas est l’instrument le plus efficace, celui qui permet de réaliser la transition à moindre coût. La question fait couler beaucoup d’encre en France depuis le Grenelle de l’environnement.
Sans faire l’exégèse de tous les travaux limitons-nous à quelques considérations.
Tout d’abord, si l’on suit une logique de robustesse et non d’optimisation la question des coûts d’une mesure n’est pas une priorité absolue. En l’occurrence les auteurs du rapport en prennent acte en proposant une règle ABCD (dont on pourrait discuter dans le détail mais l’essentiel ici est l’esprit du raisonnement) pour les coûts d’abattement.
Ensuite, le rapport d’Alain Quinet sur La valeur de l’action pour le climat (2019) montre que le niveau que doit atteindre le signal-prix à lui seul (250 euros la TCO2 en 2030 et jusqu’à 775€ en 2050) est inaccessible politiquement. Les épisodes successifs des bonnets rouges, des gilets jaunes et la révolte des agriculteurs de début 2024 témoignent bien de la difficulté de l’exercice, alors qu’on est encore très loin des niveaux souhaités. Plus fondamentalement, les sociologues mettent en avant que le signal-prix ne peut être le seul levier quand les agents sont insérés dans un ensemble de contraintes structurelles matérielles ou immatérielles (infrastructures, contraintes budgétaires, normes sociales, etc.).
Enfin, la question de la transition juste ne cesse de se poser et nécessite des approches plus adaptées. Si l’on veut décarboner l’économie, dans le contexte et avec les objectifs rappelés ci-dessus au point 2, il faut admettre qu’il est nécessaire de recourir à un dispositif d’ensemble (infrastructures publiques, régulation de la publicité, aides et subventions, mécanismes de redistribution adaptées). Le rapport fait état d’ailleurs de la nécessite de prendre en considération les enjeux de redistribution.
La priorité mise à la fiscalité carbone dans le rapport n’est évidemment pas sans rapport avec la nécessaire maîtrise de la dette publique. La taxe carbone rapporte au budget de l’État et le sujet est d’autant plus sensible que les revenus issus de la distribution des énergies fossiles sont amenés à baisser comme le rappelle opportunément le rapport. Il faut donc reprendre la question dans son ensemble et chiffrer l’impact sur les comptes publics d’un ensemble de mesures cohérent dont la taxe carbone (et sa croissance lente éventuelle) pourrait faire partie.
Rappelons que le bouclier tarifaire a coûté environ 100 milliards aux finances publiques en 2 ans et que ce dispositif décidé dans l’urgence était clairement inadapté en permettant aux citoyens aisés d’en profiter et en les désincitant à réduire leur consommation d’énergie. D’autres solutions semblent à la fois moins coûteuses et plus efficaces[24] pour réduire les émissions de GES.
5/ La régulation des échanges internationaux est à approfondir sans se limiter au seul Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières.
L’évolution du contexte international est préoccupante à bien des titres. Pour ce qui concerne la transition écologique trois de ses aspects nécessitent d’être soulignés.
Premièrement, la disponibilité à bon prix des énergies fossiles en Europe pourrait être remise en cause pour diverses raisons. La guerre de l’Ukraine a fait l’effet d’un électrochoc en la matière mais la décision prise de suréquiper l’Europe en terminaux GNL étaient inadaptée pour ne pas dire plus, comme l’a montré alors le cabinet Carbone 4. La récente décision de l’administration Biden de suspendre l’autorisation de construction de terminaux GNL, issue de considérations climatiques et de politique intérieure, montre bien qu’on ne peut rester campé dans des certitudes sur cette question.
Deuxièmement, la montée des protectionnismes (et des plans d’envergure comme l’IRA de la même administration Biden) doit faire évoluer très fortement et rapidement nos modes de raisonnement. La fermeture décidée très rapidement de certaines usines en Europe doit nous alerter.
Enfin, l’impact sur la balance commerciale de la France et de l’Europe de la transition (qu’elle soit ordonnée ou pas !) est une question centrale. Si la dette publique est un sujet à ne pas ignorer ceux de notre dépendance et de notre balance commerciale sont d’une part encore plus sensibles et d’autre part fortement liées à l’ampleur des conséquences de la hausse de la dette publique. Si nous vivons au-dessus de nos moyens, c’est d’abord sur le terrain de la balance commerciale que cela s’apprécie et se mesure. Inversement, si notre balance commerciale se redresse, nous serons moins dépendants des approvisionnements extérieurs en capitaux pour financer notre dette publique.
En conclusion, nous ne pouvons plus prendre comme référence central un optimum collectif qui serait le libre-échange qu’il faudrait seulement tempérer dans certains cas[25]. Nous ne pouvons pas non plus prendre la politique de l’offre comme le cœur de notre raisonnement. Cette politique considère que la balance commerciale dépend au premier ordre de la compétitivité de nos entreprises. Ce n’est pas entièrement faux, bien sûr, mais la politique de l’offre a tout simplement échoué. La liste est longue[26] des disparitions ou contritions d’industries ou de services qui n’ont pas résisté au tsunami de la mondialisation libre-échangiste. Et cela ne peut que se poursuivre voire s’amplifier. Le risque que la France devienne un lieu de villégiature pour les gagnants de la guerre économique mondiale est élevée. Nous serons vertueux sur notre territoire en matière écologique mais aurons fait disparaître toutes nos industries.
Nous devons mettre la question de la sobriété au centre de notre raisonnement économique comme le suggère le politiste Benjamin Brice.
Le rapport intermédiaire mentionne la question internationale mais ne le traite pas exhaustivement. Il indique à juste titre qu’« Il est difficile d’anticiper les impacts de la transition pour la balance commerciale de la France. » (page 39). En effet, si l’on accélère la réduction de notre dépendance aux fossiles (pour satisfaire nos engagements climatiques mais aussi pour les raisons économiques et géopolitiques rappelées ci-dessus) cela aura un effet positif sur notre balance commerciale qui pourrait cependant être contrebalancé par les effets rappelés dans le rapport (fuites carbone, importations de composants et de technologies bas-carbone et d’intrants critiques).
Insistons ici sur un point. Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières qui a été décidé est une mesure « qui va dans le bon sens » comme tout dispositif de « mesures miroir ». Grâce à lui, les industriels concernés voient les conditions de la concurrence internationale aux portes de l’Europe redevenir plus justes sans passer par des allocations gratuites de quotas qui ne les incitent pas à se décarboner. Mais les industries exposées à la concurrence internationale qui n’en bénéficient pas voient leurs prix d’achat des matières soumises au MACF croitre. Il faut rapidement corriger ce biais en l’attente d’une généralisation du MACF.
Par ailleurs, cet outil ne répond pas à l’ampleur du défi rappelé ci-dessus ; il faut une nouvelle politique industrielle et commerciale en Europe et en France. Plusieurs instruments doivent être mobilisés : un moratoire européen sur les accords de libre-échange, le refus de signer l’accord UE-Mercosur et des taxes aux frontières pour les marchandises, les services (dont les transferts de données) et les capitaux.
Plus fondamentalement, comme le suggèrent David Edgerton et le collectif, Foundational economy[27] il s’agit de mettre au cœur de la réflexion les infrastructures et les marqueurs du bien-être quotidien.
6/ La rénovation du bâtiment public : un enjeu clef aux plans climatique et financier
Le rapport aborde, à juste titre car c’est un sujet important, la question de la rénovation du logement.
Pour autant celle du tertiaire public ne doit pas être mise de côté. Les enjeux sont significatifs en termes d’investissements : 400 millions de m2, un coût évalué à 4 à 500 milliards d’euros, a priori supporté par les finances publiques, ce qui n’est tout simplement pas possible au vu des politiques budgétaires annoncées. C’est également un enjeu important en termes d’émissions de GES (les émissions directes des bâtiments publics sont de l’ordre de 12 millions de tonnes de CO2) et la facture énergétique de ces bâtiments pèse chaque année sur les finances publiques. Le bâtiment a par ailleurs une valeur patrimoniale substantielle. L’estimation par la DIE de la valeur du patrimoine immobilier de l’État est de l’ordre de 70 milliards d’euros[28]. Il ne semble pas qu’il y ait d’estimations solides pour celle du patrimoine des collectivités territoriales (qui est en surface trois plus important) mais elle ne peut être inférieure à 200 milliards d’euros[29]. Enfin, elle concerne les salariés de la fonction publique qui vivent dans des bâtiments majoritairement dégradés ou au moins mal entretenus.
La rénovation du bâtiment public peut être aussi un levier majeur de réussite de la rénovation de l’immobilier en général. Les opérations peuvent être importantes[30], mobiliser les grandes entreprises du bâtiment qui peuvent structurer une filière qui reste dans le domaine de la rénovation trop fragmentée pas assez nombreuse et insuffisamment formée dans le domaine énergétique. Des propositions ont été faites dans le cadre des travaux de l’IFD pour accélérer ce chantier.
Alain Grandjean et Ollivier Bodin, co-fondateur de l’ONG Greentervention
Notes
[1] Ce qui est confirmé par Figure Cross-Working Group Box ECONOMIC.1 (IPCC 2022, WG 2 P. 2497)
[2] Pour plus d’explications sur les méthodes et les résultats des économistes qui font ces estimations voir la Fiche Réchauffement climatique : quel impact sur la croissance ? sur la plateforme The Other Economy.
[3] Les inondations de la vallée de l’Ahr en Allemagne (2021) ont couté la vie à plus de 200 personnes.
[4] Une lecture attentive de la synthèse faite par le GIEC conduit à une fourchette plus élevée, jusqu’à près de -40% pour une hausse de 4°C. Voir la figure Figure Cross-Working Group Box ECONOMIC.1 (IPCC 2022, WG 2 P. 2497). Le graphique est d’ailleurs reproduit dans le rapport du Trésor même, graphique 5 p. 23.
[5] L’estimation du rapport PESETA cité P. 21 combine une approche énumérative avec l’usage d’un modèle d’équilibre. Pour la liste des impacts qui ne sont pas pris en compte (beaucoup plus longue que celle de ceux pris en compte) voir p. 59 du rapport PESETA ou la note de Greentervention.eu (2020), P.4.
[6] Ces dernières projettent des observations historiques de l’impact de différences de températures entre pays ou d’un même groupe de pays à différentes dates.
[7] Voir par exemple The Economic Case for Nature, Wolrd Bank Group (2021).
[8] Voir aussi la Fiche Réchauffement climatique : quel impact sur la croissance ? sur la plateforme The Other Economy et la note La représentation de la question climatique par la Commission européenne. Un biais contre-productif ? Greentervention (2020)
[9] Voir l’article Les quatre degrés de l’Apocalypse, Alain Grandjean, Claude Henry & Jean Jouzel, Le Monde diplomatique (décembre 2023).
[10] Voir Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques, Alain Grandjean et Gaël Giraud , Chaire Energie et Prospérité (2017)
[11] « Dans les secteurs bancaire et assurantiel, l’augmentation de la sinistralité des biens assurés aurait pour conséquence une augmentation des cotisations d’assurance et pourrait aboutir à la non-assurabilité de certains risques, tandis que les placements financiers touchés par un événement climatique extrême verraient leur valeur se déprécier »
[12] Voir La CSRD: une opportunité pour construire une stratégie environnementale robuste, Carbone4 (2023)
[13] Mark Carney alors président du conseil de stabilité financière et gouverneur de la Banque centrale d’Angleterre a introduit cette distinction dans un célèbre discours à la Lloyds en 2015. En plus des 2 risques mentionnés, il a également introduit le risque de responsabilité (les procès). Pour en savoir plus, voir l’article Le climat est source de risques systémiques avérés, sur le site de la plateforme The Other Economy
[14] Sur la relation entre l’efficacité des politiques de transition et la stabilité financière voir aussi le rapport de la BCE Climate change and sovereign risk, (2023)
[15] Les scénarios peuvent aussi se décliner au niveau national ou européen. Voir rapport du Trésor, P. 34, pour comparer différents scénarios de transition en France à contexte international donné.
[16] peu d’actif échoués (stranded assets), c’est-à-dire d’actifs (usines, centrale à charbon, pipeline) qui seront fermés avant la fin de leur durée de vie.
[17] Les assureurs prennent dores et déjà de telles décisions. Et la surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles des assureurs français sera augmentée à partir du 1er janvier 2025, passant de 12 % à 20 % pour les habitations. C’est très problématique au plan social.
[18] Voir Conceptual note on short-term climate scenarios, NGFS, Oct. 2023
[19] Voir ses livres La troisième voie du vivant et Antidote au culte de la performance, La robustesse du vivant.
[20] Sur l’impact des investissements dans l’adaptation sur les risques et coûts, voir par exemple P. 16 du rapport du GIEC 6, Groupe de travail II
[21] Du fait de la tautologie suivante « une hausse de la dette est une hausse de la dette, quelle que soit la nature de la dépense financée ».
[22] La dette française est vue comme sure par les marchés financiers car la capacité fiscale des gouvernements est considérée comme solide mais aussi parce que la Banque centrale, financeur en dernier ressort, ne peut, au vu de la taille relative de l’économie française laisser tomber la France comme elle a menacé de le faire pour la Grèce.
[23] C’est clairement la position exprimée par les auteurs du rapport Pisani Mahfouz sur les incidences économiques de l’action pour le climat. Voir page 116 : « Retarder au nom de la maîtrise de l’endettement public des investissements nécessaires à l’atteinte de la neutralité climatique n’améliorerait que facialement la situation, sans aucun bénéfice sur le fond. »
[24] Citons par exemple la proposition de Christian de Perthuis et Marc Maindrault parue dans Le Monde Transition énergétique : « L’instrument à établir à la place du bouclier tarifaire doit être une véritable composante du revenu versé aux ménages » en janvier 2024.
[25] Le rapport recommande par exemple (page 41) de mettre en place une aide de type crédit d’impôt aux industries françaises des pompes à chaleur. Ce type de dispositif au cas par acas est souhaitable mais nettement insuffisant.
[26] Sidérurgie, papeterie, scierie, raffineries, et même l’apiculture…
[27] Collectif de chercheurs apparu au Royaume-Uni au début des années 2010. Voir l’article Capitalisme politique contre politique socialiste, David Edgerton, Le Grand Continent (2023)
[28] Le chiffre de 66 milliards d’euros pour l’année 2019 est cité dans le rapport d’activité 2020-2021 du Conseil de l’immobilier de l’État.
[29] Le chiffre de 1000 milliards d’euros est mentionné dans le livre « Gestion de l’immobilier public » paru aux éditions du Moniteur en 2017.
[30] Cela ne se fait pas spontanément, il peut être nécessaire d’organiser des regroupements. De ce point de vue, la création de foncières publiques est une voie de solution.
The post Enjeux économiques de la transition climatique, commentaires sur le rapport de la DGT appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
04.01.2024 à 14:07
Les leviers d’action de la BCE pour le climat
Alain Grandjean
Depuis la mise en évidence en 2015 par Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, des risques financiers systémiques liés au climat, les banques centrales ont peu à peu pris conscience des enjeux et de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et pour l’adaptation des acteurs publics et privés aux impacts de […]
The post Les leviers d’action de la BCE pour le climat appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (6397 mots)
Depuis la mise en évidence en 2015 par Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, des risques financiers systémiques liés au climat, les banques centrales ont peu à peu pris conscience des enjeux et de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et pour l’adaptation des acteurs publics et privés aux impacts de ce changement dont certains sont désormais inévitables. Ce rôle ne peut en rien se substituer à celui des États-Membres, de l’Union européenne et des collectivités publiques, et aux diverses politiques à impulser (fiscalité écologique et assimilé, aides publiques et subventions, plans d’investissements, normes et règlements, publicité, communication, formation …) mais il n’en est pas moins significatif.
D’abord focalisées sur la mesure des risques, certaines banques centrales ont commencé à intégrer l’enjeu climatique dans leurs politiques. C’est ainsi que le Réseau des Banques centrales et des superviseurs pour la finance verte (NGFS) a été créé en 2017. En 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté un programme d’action[1] visant à aligner ses opérations avec les impératifs climatiques. Elle a notamment intégré des critères climatiques dans ses rachats de dettes d’entreprise, dépassant ainsi la “neutralité de marché”[2] qui constituait jusqu’à récemment une doctrine immuable guidant son action.
A la suite des hausses des taux directeurs en réponse à l’inflation et de chocs énergétiques, il incombe au banques centrales de poursuivre et accélérer le verdissement de leurs politiques, tant sur le volet monétaire – surtout dans un contexte où elles envisagent une stabilité voire une baisse des taux- que sur celui de la supervision des banques.
Cette note écrite avec Stanislas Jourdan a pour objet d’exposer les leviers à la main de la BCE pour stimuler l’action en faveur du climat des banques et plus généralement de tous les acteurs économiques. Nous allons ainsi détailler les modalités de mesures répondant à cet objectif qui pourraient être mise en œuvre (certaines l’étant déjà en partie) dans le respect des traités européens et du mandat de la BCE.
———
Cette note n’aborde pas des enjeux de gouvernance et en particulier pas les questions relatives à l’articulation avec les politiques publiques des États-membre et de l’Union Européenne.
Elle a bénéficié des commentaires et suggestions d’Ollivier Bodin, Michel Cardona, Marion Cohen, Julien Marchal, Eric Monnet, William Oman, Thierry Philipponnat. Nous les en remercions chaleureusement, tout en assumant l’intégralité de son contenu et des erreurs ou manques résiduels.
Les banques centrales peuvent activer trois leviers pour l’action climatique
La BCE et les banques centrales nationales ont trois rôles principaux qui peuvent avoir un effet sur l’action climatique des banques. Les deux premiers sont relatifs à la politique monétaire et le troisième à la politique prudentielle[3] et son rôle dans la supervision des banques.
1. Le monopole de l’émission de monnaie centrale[4] se traduit par la fourniture de liquidité soit par prêts aux banques (en contrepartie d’un collatéral) soit par acquisition de titres sur le marché secondaire (le fameux “quantitative easing” ou assouplissement quantitatif).
2. La fixation du taux d’intérêt directeur applicable sur les prêts de la banque centrale aux banques. Le taux directeur est une référence pour les banques, qu’elles répercutent sur l’ensemble des crédits bancaires aux ménages et aux particuliers (les banques prêtent à un taux plus élevé que le taux de la BCE pour se faire une marge).
3. Dans le cadre de sa mission de supervision et de stabilité financière, la BCE et les banques centrales nationales surveillent étroitement l’évaluation des risques dans le bilan de chaque banque. La BCE peut par exemple imposer[5] des exigences de fonds propres plus élevées que la réglementation si elle observe qu’une banque ne maîtrise pas assez ses risques. On verra plus loin que les banques centrales nationales pourraient aussi dans le cadre cette mission, imposer des restrictions aux crédits bancaires destinés aux entreprises pétrolières.
La BCE peut agir sur ces trois leviers pour faciliter l’action climatique.
Levier 1 : injection de monnaie centrale dans l’économie
Les traités européens interdisent[6] à la BCE de financer directement des dépenses publiques favorables au climat, quel que soit le mécanisme envisagé[7] (dotation à des institutions publiques existantes ou à créer, prêt sans intérêt et non remboursable aux États ou à des agences publiques etc.). Nous n’évoquons pas ces pistes dans la suite de cette note, même si nous considérons qu’elles devraient vraiment être approfondies et articulées avec les enjeux budgétaires considérables que pose la transition énergétique.
Il est en revanche possible à la BCE d’être plus sélective sur les actifs financiers qu’elle accepte en contrepartie de ses refinancements aux banques (le “collatéral”) ou dans le cadre de rachat d’actifs sur le marché secondaire (quantitative easing).
- En 2022, la BCE a par exemple adopté un principe de “bonus-malus”, dans le cadre du programme de rachat d’obligations d’entreprises (CSPP, Corporate Sector Purchase Programme). Concrètement, la BCE ajuste les volumes de rachat d’obligations d’entreprises en fonction d’un score climat attribué aux entreprises émettrices, selon une méthodologie qu’elle a définie[8]. Cette méthode favorise donc les obligations « vertes » au détriment des obligations les plus carbonées, plutôt que d’acheter les obligations de façon rigoureusement symétrique à leur taille relative sur le marché (neutralité de marché). Mais ce programme, qui a représenté jusqu’à 345 milliards d’euros d’actifs au bilan de la BCE est aujourd’hui en train d’être clôturé (puisque la BCE réduit la taille de son bilan)[9]. Dans ce contexte, cette mesure de verdissement n’est donc plus aussi pertinente. Elle aurait cependant du sens si les réinvestissements voire les achats nets reprenaient.
- Le verdissement des règles d’éligibilité des actifs au collatéral est indépendant du quantitative easing puisque ce mécanisme fonctionne aussi bien quand la BCE resserre ou assouplit sa politique monétaire. La BCE pourrait par exemple exclure les actifs émis par les entreprises fossiles du collatéral éligible, ou du moins en limiter l’utilisation possible par les banques à un certain pourcentage de leurs refinancements par la banque centrale[10]. Une autre option serait d’appliquer une décote (“haircut”) sur les actifs carbonés et/ou sur les dettes des « entreprises fossiles » [11], ce qui conduiraient les banques à obtenir un financement moindre de la banque centrale que la valeur nominale de l’actif utilisé comme collatéral.
Ces mesures peuvent sembler très techniques, mais leur impact potentiel est significatif. En effet, la possibilité pour une banque de refinancer un actif au guichet de la banque centrale est un gage de liquidité pour cet actif, ce qui encourage donc les acteurs financiers à le détenir[12].
Ce type de mesures est parfaitement en phase avec le mandat de la banque centrale, qui lui impose de se protéger autant que possible des risques financiers à son bilan[13]. Les titres les plus porteurs de risques (de transition) seront décotés ou exclus. D’ailleurs la BCE a d’ores et déjà prévu d’évaluer l’opportunité et les modalités d’une prise en compte des risques climatiques dans ses règles d’éligibilité au collatéral en 2024[14].
Levier 2 : fixer un taux d’intérêt vert
Le taux d’intérêt est vu comme le principal outil de politique monétaire : il est mis en priorité au service de la fixation du niveau souhaité d’inflation. C’est la BCE qui fixe les taux directeurs auxquels les banques se refinancent. Notons cependant qu’une fois que ce taux est ramené à 0 (comme cela a été le cas de 2016 à 2022 dans la zone euro) il n’est évidemment plus mobilisable. C’est la raison pour laquelle les banques centrales font alors appel à des politiques dites « non conventionnelles » (évoquées dans le levier 1).
Dans les années 2010, l’inflation étant considérée comme trop basse trop basse, la BCE a ramené les taux d’intérêts à zéro comme rappelé ci-avant[15]. Elle a en plus mis en place un programme intitulé TLTRO, de prêts extrêmement généreux mais conditionnés[16] pour les banques, afin que celles-ci octroient davantage de crédits peu chers aux acteurs économiques.
Depuis juin 2022, le taux directeur a été relevé de 0% à 4,5 % (en septembre 2023) pour lutter contre une inflation considérée comme trop élevée[17]. Mais il est notoire que la hausse des taux d’intérêt engagée par la BCE (et qui a été stoppée récemment) a un effet négatif notamment sur les opérations de rénovation énergétique des bâtiments et sur les énergies renouvelables[18] etc. car elles en alourdissent le coût[19]. La politique monétaire restrictive de la BCE, qui se discute étant donné que l’inflation récente est surtout due à des facteurs liée à l’offre, risque donc de freiner la transition énergétique.
Pour éviter cet effet de bord, Il serait possible de différencier[20] les taux d’intérêt en fonction des emprunteurs et des projets : c’est l’idée d’un “TLTRO vert”[21] que Christine Lagarde a défendue à plusieurs reprises[22] et qu’a évoquée dans un récent discours[23] Frank Elderson , membre du comité exécutif de la BCE.
Concrètement, il s’agirait d’appliquer des taux d’intérêts moins élevés sur les volumes de prêts bancaires alloués à la transition énergétique[24]. Une telle approche pourrait être mise en place immédiatement pour les prêts à la rénovation énergétique des bâtiments dans la mesure où les banques déclarent déjà aux superviseurs leurs volumes de prêts à la rénovation[25]. Un tel programme inciterait les banques à déployer des offres de prêts à la rénovation, à taux moins élevés tout en s’articulant avec des dispositifs nationaux existants (comme par exemple l’éco-PTZ en France, les Contrats de Performance Énergétiques) dont le coût se verrait diminuer sensiblement par l’apport des taux bonifiés par la BCE.
En renforçant le financement de la transition énergétique, la BCE contribuerait à réduire la dépendance de l’économie européenne aux énergies fossiles importées, ce qui réduirait les facteurs de risques inflationnistes liés aux chocs des prix de l’énergie. Cette perspective est donc en phase avec le mandat de stabilité des prix de la BCE. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE déclarait d’ailleurs en 2022 que des facilités de prêts vertes pourraient être envisagées lorsque la politique monétaire pivotera de nouveau vers une baisse des taux[26].
Leviers 3 : mobiliser la politique prudentielle
Dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU), la BCE supervise directement 113 banques européennes systémiques, tandis que les autres banques, plus petites, sont supervisées par les banques centrales nationales. Dans ce cadre, la BCE a publié en 2020 ses recommandations sur la façon dont les banques devraient prendre en compte les risques climatiques[27], et elle a récemment annoncé son intention d’appliquer des sanctions aux banques qui ne les appliquent pas suffisamment[28].
Dans le cadre de son mandat, la BCE pourrait :
- Améliorer les analyses de scénarios climatiques qu’elle conduit[29] pour tester la résilience du système financier en renouvelant la panoplie de modèles utilisés, qui est très contestable et très contestée[30] du fait de la sous-estimation évidente des risques climatiques qu’elle conduit à faire (que ce soit les risques de transition, les risques physiques et surtout dans tous les cas les risques de perturbation de l’économie[31]).
- Proposer des renforcements de fonds propres[32] des banques en fonction de leur exposition aux secteurs fossiles (ou largement dépendants des fossiles).
- Augmenter le niveau d’exigence des plans de transition bancaires (qui sont en passe de devenir obligatoires par le paquet bancaire (CRR/CRD) ainsi que la directive CSDDD en cours d’adoption)[33].
Ces plans de transition bancaires devraient détailler la stratégie des banques pour sortir du financement des industries fossiles, mais également faciliter la transition de secteurs économiques clés tels que le transport et le bâtiment[34]. Par exemple, ces plans de transition pourraient aboutir à la définition d’objectifs en termes de performance énergétique des portefeuilles de prêts immobiliers, comme proposé par la Commission européenne dans une autre directive[35]. Dans le cadre du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), la BCE et les superviseurs nationaux suivraient étroitement la performance des banques, et pourraient proposer des mesures correctrices, le cas échéant[36]. À l’inverse, les banques qui remplissent leurs objectifs pourraient se voir accorder des rabais supplémentaires sur les taux d’intérêts applicables dans le cadre d’un programme de “TLTRO vert” (voir ci-dessus). L’autorité bancaire européenne va être mandatée prochainement pour définir plus précisément le contenu des plans de transition bancaires. De notre point de vue, ces plans ne devraient pas se limiter à une gestion du risque, mais intégrer aussi l’impact des financements bancaires sur l’environnement.
- Dans le cadre de leur mandat « macro-prudentiel[37]» les banques centrales nationales pourraient, par l’obligation d’une surcharge en capital, inciter les banques à limiter leurs prêts aux entreprises pétrolières.
Celles-ci font en effet peser un risque systémique au système financier car elles détiennent des actifs dont la valeur s’effondrera – ce seront des actifs échoués- dans un scénario respectant l’accord de Paris. Finance Watch propose de fixer un ratio maximal entre le prêt accordé et la valeur de l’actif financé[38] (loan-to-value en anglais), à l’instar de ce qui existe sur le marché de l’immobilier : si vous achetez un appartement, la banque ne vous prête pas quatre fois plus que sa valeur, ni même l’intégralité de sa valeur, vous devez apporter des fonds propres. Finance Watch suggère que les superviseurs imposent aux banques une surcharge en capital quand ce ratio dépasse une valeur estimée à 23 % (soit la part des réserves prouvées actuelles qui peuvent être consommées si l’on respecte l’accord de Paris).
Conclusion
La COP28 et le premier bilan mondial sur l’action climatique mettent en évidence que les acteurs privés et publics agissent mais beaucoup trop lentement ; sans avoir à se substituer aux gouvernements, les banques centrales ont un pouvoir et une responsabilité très significatifs pour peser sur les banques et par voie de conséquence sur l’économie réelle. La BCE est résolument engagée à avancer sur ce chemin, et Christine Lagarde a réaffirmé récemment la détermination de la BCE de continuer d’explorer de nouvelles options[39]. Cette note expose ici les principaux leviers à disposition de la BCE et suggère des pistes aussi accessibles que possible dans le cadre politique et juridique actuel.
Alain Grandjean et Stanislas Jourdan
Notes
[1] Voir le CP de la BCE annonçant le plan d’action (08/07/21) et le programme mis à jour en 2022.
[2] La neutralité de marché est une doctrine selon laquelle les banques, y compris les banques centrales, ne doivent pas privilégier un secteur économique plutôt qu’un autre et ne doivent pas orienter le développement de l’économie productive. Ce sujet est très bien expliqué dans l’article de Kempf, Hubert. « Verdir la politique monétaire », Revue d’économie politique, vol. 130, no. 3, 2020 (télécharger le WP ici )
[3] Rappelons que les accords de Bâle relatifs au cadre de la régulation prudentielle des banques classent les outils possibles en 3 piliers : pilier 1, exigences minimales de fonds propres ; pilier 2, supervision et éventuelles surcharges de capital imposées aux banques ; pilier 3, obligations de transparence financière. La mission de la Banque centrale comporte deux volets s’inscrivant dans ces accords (la supervision et la transparence). En Europe, c’est la Commission européenne qui propose l’application des règles du comité de Bâle qui sont ensuite votées par le Parlement et le Conseil Européen. Les dernières règles du comité de Bâle (appelées Bâle 3 ou Bâle 4) ont ainsi donné lieu à la réglementation CRR3/CRD6. L’autorité chargée par la Commission européenne de proposer des changements est l’EBA (Autorité bancaire européenne) qui vient de publier un rapport avec ses recommandations pour intégrer les risques environnementaux et climatiques dans les exigences en capital (Pilier 1) des banques.
[4] Pour plus d’informations, voir le livre « Une monnaie écologique » (Alain Grandjean, Nicolas Dufrêne, chez Odile Jacob) et le module sur la monnaie et la fiche sur le quantitative easing de la plateforme The Other Economy
[5] Le rôle de la BCE est d’assurer le respect de la réglementation prudentielle (cf note 3), mais elle ne peut changer les règles, qui sont validées au niveau européen. La BCE peut dans le cadre du SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) imposer des pénalités, ou demander du capital additionnel (Pilier 2 qui vient s’ajouter au capital réglementaire Pilier 1) si elle observe que la banque ne respecte pas la réglementation ou ne maîtrise pas suffisamment ses risques.
[6] Si une réforme des Traités était à l’ordre du jour, il serait bien sûr concevable et souhaitable de libérer certaines de ces contraintes pour faciliter le financement de l’action climatique, mais ce n’est pas dans ce cadre que nous nous plaçons ici.
[7] La BCE pourrait probablement refinancer des banques publiques au-delà de leur pur besoin de liquidité mais cette possibilité fait l’objet d’interprétations diverses (voir le livre Une monnaie écologique).
[8] ECB provides details on how it aims to decarbonise its corporate bond holdings, 19 Septembre 2022
[9] De 2016 à 2022, l’Eurosystème a procédé à des achats nets d’obligations du secteur privé dans le cadre du programme (avec une interruption de janvier à octobre 2019). A partir de juillet 2022, l’Eurosystème s’est orienté vers la clôture du dispositif en arrêtant les achats nets d’actifs et en se contentant de réinvestir les paiements en principal des titres arrivant à échéance d’abord intégralement, puis partiellement. L’Eurosystème a cessé tous les réinvestissements des titres CSPP à partir de juillet 2023. En savoir plus sur le CSPP sur le site de la BCE.
[10] Cette option a notamment été explorée par la Banque de France dans ce papier de Oustry, Erkan, Svartzman et Weber Climate-related Risks and Central Banks’ Collateral Policy: a Methodological Experiment (2020)
[11] Ces 2 options sont distinctes et nécessiteraient de rentrer dans des considérations plus techniques.
[12] Selon l’expression célèbre de Kjell Nyborg ” si la monnaie de la banque centrale n’était disponible que contre des igloos, ou des titres adossés à des igloos, alors des igloos seraient construits”
[13] L’article 18 des statuts de la BCE prévoit que la BCE doit “effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts.”
[14] Cf point 7 du programme d’action de la BCE pour le climat
[15] Et des taux de dépôt négatifs.
[16] Les TLTRO (targeted longer-term refinancing operations, opérations ciblées de refinancement à plus long terme) sont des prêts de long terme consentis aux banques par la BC à des taux d’intérêt faibles voire négatifs, conditionnés au fait que les banques prêtent en retour aux agents économiques. Ces taux d’intérêts ne sont pas considérés comme faisant partie des taux directeurs des banques centrales.
[17] Source : voir sur le site de la Banque de France. Il s’agit ici du taux directeur des opérations principales de refinancement.
[18] La Fédération néerlandaise des énergies renouvelables (NVDE) estime que la hausse des taux d’intérêts de la BCE augmente d’au moins 17 milliards le coût des projets. Voir ici. Les opérateurs spécialisés dans les énergies renouvelables estiment que la hausse des taux de 4 % a fait croître le prix du MWh de 20 euros, ce qui est loin d’être négligeable, sans être bien sur suffisant. Cet outil est donc utile sans être La solution au changement climatique. Des évaluations économiques complémentaires doivent être faites pour dimensionner les écarts de taux à mettre en place.
[19] La décarbonation de l’économie est intensive en capital car il faut investir pour créer des équipements qui ne consomment pas d’énergie fossile.
[20] Dans un discours à la COP 28, le président de la République française a plaidé pour une telle différenciation sans évoquer le rôle possible de la Banque centrale : « L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation et les réponses à leurs effets requièrent un accroissement conséquent des financements, notamment ceux à un taux préférentiel ». Il a également repris cet argument dans une tribune parue en décembre dans le journal Le Monde « Nous devons accélérer en même temps sur le plan de la transition écologique et de la lutte contre la pauvreté« .
[21] L’idée a été conceptualisée par Positive Money Europe dans l’article « targeting a sustainable recovery with green tltros » de Jens Van’t Klooster et Rens Van Tilburg. Voir également l’article de Kempf, Hubert. « Verdir la politique monétaire », Revue d’économie politique, vol. 130, no. 3, 2020 (télécharger le WP ici ).
[22] Lagarde seeks ECB green targeted lending, Green Central Banking, 10 Juin 2022
[23] Frank Elderson, Monetary policy in the climate and nature crises: preserving a “Stabilitätskultur” Le 22 novembre 2023. BCE. Libre traduction d’un extrait :« Chaque fois qu’il sera nécessaire à l’avenir, en matière de politique monétaire, de reconsidérer les opérations ciblées de refinancement à long terme des banques, il existe des raisons impérieuses d’envisager sérieusement de les rendre plus écologiques.(…) Des stratégies de ciblage similaires peuvent être envisagées pour soutenir les prêts verts ou exclure les prêts non verts à l’avenir, à condition qu’un processus de validation opérationnellement efficace soit réalisable. »
[24] Les critères permettant de dire si un prêt est alloué à la transition énergétique ou pas doivent être précisés et ne peuvent entièrement être du ressort de la BCE; la taxonomie verte européenne peut être utilisée mais de manière dynamique et dans une logique de transition car la part de l’économie européenne actuellement alignée avec la taxonomie est très faible. Voir ce rapport de Finance Watch sur la contribution de l’économie au Net Zero
[25] En vertu de l’application de l’article 8 de la taxonomie et des règles de reporting ESG liées au pilier 3 du cadre de supervision bancaire. Cf note de Stanislas Jourdan: The usability of the EU green taxonomy for ECB Renovation-Targeted Refinancing Operations (à paraître).
[26] Isabel Schnabel, Monetary policy tightening and the green transition, Janvier 2023, Extrait: “Green targeted lending operations, for example, could be an instrument worth considering in the future when policy needs to become expansionary again, provided the underlying data gaps are resolved.”
[27] Guide on climate-related and environmental risks, BCE, November 2020
[28] La BCE annonce des sanctions en cas de prise en compte insuffisante des risques liés au climat et à l’environnement, AEF Info, 14 Novembre 2023
[29] La BCE peut réaliser seule des stress-tests (comme en 2022), mais elle exécute en règle générale ceux de l’EBA (European Banking Authority) qui a reçu mandat de la Commission européenne pour développer des scénarios et des dispositifs de stress tests. L’EBA vient de lancer une nouvelle analyse de scenario « one-off fit-fo-55 climate risk scenario analysis » auprès des 110 banques européennes les plus significatives afin d’évaluer la résilience du secteur financier en ligne avec le paquet réglementaire Fit-for-55, et mesurer la capacité du système financier à soutenir la transition vers une économie bas carbone sous conditions de stress. La collecte des données commencera en décembre et s’achèvera en mars. L’exercice sera conduit en coopération avec les autres autorités de supervision européennes (EIOPA et ESMA), la BCE et l’ESRB (European Systemic Risk Board).
[30] Voir le papier de Camille Souffron et Pierre Jacques : The European Green Deal requires a renewed economic modelling toolbox et l’appel qu’ils ont lancé :
[31] Thierry Philipponnat, “Finance in a hot house world”, Finance Watch, octobre 2022 ; voir aussi la fiche Réchauffement climatique : quel impact sur la croissance ? sur le plateforme The Other Economy
[32] Ces renforcements sont limités (cf note 5) et relatifs au pilier 2 des accords de Bâle. Il faudrait une modification d’ordre législatif du règlement CRR3 pour que ces renforcements soient plus conséquents (et cohérents avec les risques systémiques potentiels de ce secteur d’activité), mais les parlementaires européens ne l’ont pas voté. Voir Finance Watch amendments proposal to CRR and Solvency II
[33] Cf La position du parlement européen sur l’article 449 de la CRR: “Institutions shall disclose (…) (b) climate targets and transition plans, including absolute carbon emission reduction targets, submitted in accordance with Article 76(2) of Directive 2013/36/EU, and the progress made towards implementing them”
[34] Mettre en place des plans de transition prudentiels pour les banques : quels sont les impacts attendus ?, Décembre 2022, I4CE – Institute for Climate Economics
[35] Dans le cadre de la révision de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (Directive EPBD, Energy performance of buildings), la Commission européenne propose à l’article 15 l’instauration de “mortgage portfolio standards” (normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires) qui obligerait les banques à améliorer le niveau de performance énergétique médian des actifs sous-jacents à leurs portefeuilles immobiliers.
[36] Il est bien sûr indispensable, là aussi, que soit précisé ce qui fait qu’un plan de transition bancaire est suffisant ou pas.
[37] On distingue la régulation micro-prudentielle qui traite des risques pris par les banques considérées séparément et la régulation macro-prudentielle qui traite des risques systémiques. En France, la politique macro-prudentielle est pilotée par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCFS), qui inclut la Banque de France mais est présidée par le Ministre des finances.
[38] Thierry Philipponnat, “Finance in a hot house world”, Finance Watch, octobre 2022
[39] “I can also tell you that we need to look at other measures and more measures in order to make sure going forward that we will remain Paris-compliant. (…) there will be work done by staff to propose options in order to remain Paris compliant.” Conférence de presse de la BCE du 14 septembre 2023
The post Les leviers d’action de la BCE pour le climat appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
24.11.2023 à 16:48
Allemagne : le « frein à l’endettement » freine d’abord…. le verdissement de l’économie
Billet invité
L’encadrement des politiques budgétaires par des règles numériques imposant l’équilibre des comptes publics est-elle compatible avec les investissements nécessaires à la transition énergétique dans un monde aux multiples sources d’incertitude ? C’est en Allemagne, pays chantre de l’orthodoxie budgétaire, que la réponse (négative) à cette question vient d’être apportée. Le 15 novembre, le tribunal constitutionnel […]
The post Allemagne : le « frein à l’endettement » freine d’abord…. le verdissement de l’économie appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (6260 mots)
L’encadrement des politiques budgétaires par des règles numériques imposant l’équilibre des comptes publics est-elle compatible avec les investissements nécessaires à la transition énergétique dans un monde aux multiples sources d’incertitude ? C’est en Allemagne, pays chantre de l’orthodoxie budgétaire, que la réponse (négative) à cette question vient d’être apportée. Le 15 novembre, le tribunal constitutionnel allemand a déclaré inconstitutionnelle une manœuvre budgétaire visant à développer un programme ambitieux d’investissement dans la transition énergétique en contournant la règle constitutionnelle dites du « frein à l’endettement ». Une semaine après cette décision fracassante, la programmation budgétaire pour 2024 et les années suivantes est toujours sous de fortes contraintes. Le risque est grand de voir la première économie européenne s’enfoncer dans une méga cure d’austérité auto-infligée. L’arrêt des juges de Karlsruhe aura cependant eu un intérêt majeur : pour la première fois, la question de la pertinence de la clause du frein à l’endettement, et donc de sa réforme, est au cœur du débat public. Espérons également que les chefs d’État et ministres des finances européens sauront tirer les leçons de l’expérience allemande à l’heure où se déroulent la phase terminale des négociations sur la réforme des règles budgétaires de l’Union.
1. Règles budgétaires dans l’Union européenne et en Allemagne : une histoire mouvementée !
A. Depuis les années 1990, la discipline budgétaire est introduite au cœur de traité européen[1].
Mise en place progressivement à partir du traité de Maastricht (1992), la gouvernance économique européenne consiste en un ensemble de règles et de procédures visant à faire respecter une discipline budgétaire par les États membres, à faciliter la coordination de leurs politiques économiques et à prévenir les déséquilibres macroéconomiques.
Parmi tous ces objectifs, la prééminence de la discipline budgétaire est manifeste. C’est, en effet, le seul domaine pour lequel des critères contraignants sont prévus au cœur même des traités de l’Union européenne (le déficit ne devrait jamais dépasser 3% du PIB, et la dette publique être inférieure à 60% du PIB )[2]. Cette situation est le résultat des négociations qui ont prévalu à la signature de l’Accord de Maastricht : l’Allemagne en a fait une condition pour accepter la création de l’euro. A partir de 1997, les grands principes de la surveillance budgétaire inscrit dans les traités ont été déclinés dans les différents textes juridiques qui constituent le Pacte de Stabilité et de Croissance. La difficulté à les faire respecter notamment en France et en Allemagne a conduit à une première réforme en 2005 mais c’est véritablement la crise financière de 2007-2008 qui montrera les limites de règles numériques rigides.
B. Crise financière de 2007-2008 : davantage de règles et de complexité pour l’Union européenne.
La crise financière conduit les gouvernements européens à intervenir de façon massive d’abord pour empêcher l’effondrement du système financier, et ensuite pour mettre en œuvre des plans de relance de l’activité économique. Partout, les déficits publics ont explosé du fait de la hausse des dépenses publiques, et de la baisse des recettes consécutives à la récession économique de 2009. L’endettement public a suivi. Certains pays (Grèce puis Irlande, Portugal, Espagne et Italie) ont vu leur taux d’intérêt s’envoler et se sont retrouvé dans l’impossibilité d’emprunter sur les marchés de capitaux. Contraints de faire appel au soutien financier du Mécanisme européen de stabilité (MES)[3] et/ou du FMI, les cinq pays au cœur de cette crise se sont vu imposer des plans d’austérité et des contrôles réguliers par la « troïka » (la Commission européenne, la BCE et le FMI). Les autres pays européens ont choisi de mettre fin aux plans de relance et de mener des politiques d’austérité afin de « rassurer » les marchés financiers et de revenir dans les clous des critères du Pacte de stabilité et de croissance. Pour tenir compte de l’expérience acquise, les règles du Pacte de Stabilité et de croissance ont été revues en 2011 et 2013 . Cela a abouti à un corpus de textes et de guides interprétatifs de plus en plus complexes. Cette extrême complexité ainsi que les nombreuses critiques portant sur les impacts négatifs de ces règles a conduit à partir de 2019 à l’ouverture par la Commission d’un cycle non abouti en novembre 2023 de consultation puis de négociation sur leur réforme[4].
C. 2009 : introduction de la clause constitutionnelle du « frein à l’endettement » en Allemagne
En Allemagne, les appels au retour à des finances publiques « saines » arrivent très rapidement après la crise de 2008. La hausse des dépenses liées à cette crise n’est acceptable qu’à condition d’avoir des garanties de haut niveau sur un retour rapide à la « normale », c’est-à-dire à un budget à l’équilibre voire excédentaire. Si la loi Fondamentale (la constitution) allemande contient déjà des dispositions posant des limites aux marges de manœuvre budgétaire de l’État fédéral et des Länder il s’agit de les renforcer drastiquement.
C’est ainsi qu’en mai 2009, le Parlement allemand à une majorité des 2/3 inscrit dans La Loi Fondamentale du pays la clause dite du « frein à l’endettement » (« schuldenbremse » en allemand)[5]. Le principe général est le suivant : « Les budgets de la Fédération et des Länder doivent en principe être équilibrés sans recettes provenant d’emprunts ». Une petite marge de manœuvre est cependant prévue : le déficit budgétaire du gouvernement fédéral « structurel » (c’est-à-dire corrigé de l’impact des variations conjoncturelles et de circonstances exceptionnelles) ne devra plus excéder 0,35% du PIB. Les budgets « structurels » des Länder – devront quant à eux rester équilibrés Ces dispositions s’appliquent à partir de 2016 pour le budget fédéral et de 2020 pour les Länder.
Norbert Lammert, membre du parti chrétien-démocrate (CDU) et président du Bundestag d’alors, vote contre la réforme. Pour lui, cette disposition est une erreur d’un point de vue constitutionnel car elle traduit une méfiance vis-à-vis des intentions que pourront avoir les majorités futures du parlement démocratiquement élu pour orienter la politique[6]. Une analyse prophétique, comme nous allons le voir…
Sous la pression du gouvernement allemand la constitutionnalisation de règles budgétaires a été étendue aux autres pays européens. Le 1er janvier 2013, le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG ou Fiscal Compact)[7] entre en vigueur. Les signataires, tous les pays de la zone euro plus quelques autres pays de l’Union, s’engagent à inscrire dans leur Constitution ou dans une législation permanente et contraignante l’objectif d’un déficit corrigé des variations conjoncturelles de 0,5% du PIB maximum pour l’ensemble des administrations publiques[8].
Durant les années suivantes,« l’assainissement » des finances publiques européennes se fait au détriment des investissements publics et de la qualité des infrastructures publiques, avec souvent des investissements publics nets négatifs notamment en Allemagne.
Retrouvez ce graphique sur l’évolution des investissements publics nets dans la zone euro de 2000 à 2022 en dataviz sur la plateforme The Other Economy.
Remarquons qu’à chaque fois il est question du déficit public « corrigé de l’impact des variations conjoncturelles » ceci suggère que quelques marges de manœuvre sont laissées aux gouvernements en particulier en période de difficulté économique. Cependant, le calcul de l’impact des variations conjoncturelles sur le solde budgétaire, et donc les limites imposées aux dépenses publiques, est loin d’être une science exacte[9]. Elle suppose de comparer le PIB effectif avec un PIB « normal » ou « potentiel ». Les hypothèses pour calculer ce PIB « normal » ou « potentiel » ont une grande part d’arbitraire et d’incertitude. Elles portent entre autres sur les taux de participation à l’emploi des différentes catégories de population, le taux de chômage « naturel », l’évolution de la productivité, le calcul du stock du capital productif et son amortissement. Il n’existe pas de méthode « scientifique » qui pourrait être validée par un consensus des économistes pour appliquer la prescription de la constitution allemande ou du TSCG.
D. Crise du COVID : suspension des règles budgétaires en Europe et création en Allemagne du fonds de stabilisation économique (MSF) dotés de centaines de milliards de dollars
Que ce soit en Allemagne ou au niveau de l’Union européenne, la pandémie de COVID suivie de la crise énergétique consécutive à l’invasion de l’Ukraine relèguent, pendant quelques années, les dogmes budgétaires au second plan. Heureusement, des clauses d’exception étaient prévues dans les textes européens et allemand.
Au niveau européen, il s’agit de la clause dérogatoire générale au règles du Pacte de stabilité et de croissance en cas de « grave récession économique. »[10]. Cette clause, activée dès mars 2020, est encore en vigueur en 2023. Elle est censée être désactivée en 2024 (selon les informations disponibles à la date de publication de cet article).
En Allemagne, l’article 115 de la Loi fondamental prévoit que « En cas de catastrophes naturelles ou de situations d’urgence exceptionnelles échappant au contrôle de l’État et affectant gravement la situation financière de l’État » la limite de 0,35% du PIB pour le déficit budgétaire peut être dépassée sur la base d’une décision de la majorité des membres du Parlement. C’est ce que votent les parlementaires chaque année de 2020 à 2022. En 2023, la clause du frein à l’endettement aurait dû fonctionner normalement : la crise budgétaire provoquée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe (dont nous allons parler ci-après) a cependant conduit le ministre des finances a demander un nouveau vote pour 2023 afin d’éviter que le budget en cours ne soit déclaré inconstitutionnel.
Par ailleurs, pour répondre à la crise du COVID puis aux tensions énergétiques, le gouvernement allemand crée un Fonds de stabilisation économique (le FSE) en mars 2020. Celui-ci a pu être alimenté par des emprunts sans être limité par la clause du frein à l’endettement puisque celle-ci était suspendue. Le FSE est au cœur de l’imbroglio budgétaire allemand actuel.
|
Deux fonds spéciaux au cœur de l’imbroglio budgétaire allemand actuel : le Fonds de Stabilisation Economique (FSE) et le Fonds Climat et Transformation Le Parlement peut créer des fonds spéciaux, distinct du budget fédéral, pour répondre à des besoins urgents, bien identifiés et temporaires. Dans un rapport publié fin août 2023, la Cour des comptes allemande identifie 29 fonds spéciaux de plus de 1 milliards d’euros encore actifs fin 2022 (dont certains depuis les années 1950). Leur volume financier total s’élève à 869 milliards d’euros (en incluant les sommes déjà dépensées et celles restant à dépenser dans les prochaines années). Ces fonds sont alimentés soit par le budget fédéral ou des recettes fléchées (à hauteur de respectivement 190mds€ et 90mds€ sur les 869mds€ précités), soit par des autorisations de crédits propres (pour 590 mds€) c’est-à-dire de la dette levée spécifiquement pour ces fonds (qui est soumis à la clause du frein à l’endettement) [11]. En mars 2020[12], la crise du COVID a conduit à créer le Fonds de Stabilisation Économique-CORONA (FSE), ensuite élargi à un volet « crise énergie » en 2022. Créé pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID, le FSE est initialement doté de 200 milliards d’euros d’autorisation de crédit propre, et de 400 milliards d’autorisation de garantie des créances d’entreprise, hors « frein à l’endettement » suspendu pour cause de crise. En décembre 2021[13], ces montants ont été réduit à 150 mds€ pour les crédits et 100 milliards pour les garanties. Les délais ont par ailleurs été prolongés jusqu’en juin 2022 (au lieu de décembre 2021). En octobre 2022, une nouvelle mission est attribuée au FSE : « atténuer les conséquences de la crise énergétique, notamment les hausses de prix de l’achat de gaz et d’électricité en Allemagne »[14]. Le gouvernement fédéral est autorisé à emprunter 200 milliards d’euros également hors « frein à l’endettement » pour alimenter cette nouvelle mission. Ces ressources sont utilisables jusqu’à fin juin 2024. L’autre fonds au cœur de la crise actuel est le Fonds énergie climat. Créé en 2011, il a été redéfini et renommé Fonds Climat et Transformation en 2022. En janvier 2022, le parlement décide de transférer à ce fonds 60 milliards levés pour la mission COVID du FSE et non utilisés. C’est ce transfert que la Cour Constitutionnel allemande a jugé inconstitutionnel (voir partie suivante) |
2. La crise actuelle : un révélateur de l’incompatibilité entre gouvernance budgétaire par les règles et investissement de long terme.
A. Un gouvernement de coalition marqué par un compromis entre rigueur budgétaire et transition écologique
En septembre 2021, les années Merkel prennent fin. Issu du Parlement nouvellement élu, le gouvernement de coalition qui entre en fonction le 8 décembre 2021 réunit les socio-démocrates (SPD), les Verts et les libéraux (FDP). Dirigé par O. Scholz (SPD), il entre en fonction le 8 décembre 2021.
Malgré des priorités apparemment contradictoires voire antagoniques un accord de coalition a pu être trouvé entre ces trois partis :
-Le SPD obtient la chancellerie confiée à O. Scholz, ainsi que certaines de ses mesures phares (hausse du salaire minimum, desserrement de l’étau pesant sur les prestations sociale).
-Les libéraux obtiennent le ministère des finances, confié à C. Lindner, et un accord sur une gestion budgétaire « rigoureuse » avec le rétablissement en 2023 de la clause du frein à l’endettement suspendue depuis 2020
-Enfin, le ministère de l’économie et de la protection du climat (anciennement ministère de l’économie et de l’énergie) est confié à C. Habeck (Verts) et les ressources du Fonds spécial pour l’énergie et le climat (renommé Fonds pour le Climat et la Transformation – KTF) augmentent substantiellement afin de financer les nombreux investissements de transition énergétique prévu dans l’accord de coalition[15].
B. les manipulation budgétaires allemandes annulées par la cour constitutionnelles
En réalité, l’accord de coalition a été rendu possible par un artifice budgétaire que la Cour constitutionnelle allemande a fait voler en éclat le 15 novembre dernier dans un arrêt qui fera certainement date dans l’histoire économique allemande.
Une grande partie des ressources du Fonds pour le Climat et la Transformation viennent des recettes tirés de la vente des quotas d’émission de CO2 sur le marché européen. Cependant, celles-ci étant insuffisantes (et le ministre de Finances s’opposant à toute hausse d’impôt) le gouvernement a fait voter en février 2022 un budget rectificatif pour 2021 : 60 milliards d’euros de crédit du Fonds de stabilisation économique qui n’avaient pas été dépensés pour répondre à la pandémie (FSE-Corona) ont été transférés vers le fond climat. Cette réaffectation présentait en effet l’avantage de contourner « le frein à l’endettement » puisque ces crédits avaient été voté lorsque ladite règle était suspendue (voir encadré). Cet artifice a permis de porter les ressources du fonds à 212 milliards d’euros sur la période 2024-2027.
La Cour Constitutionnelle saisie par les parlementaires de l’opposition (les chrétiens démocrates de la CDU) a jugé que la réorientation des 60 milliards était inconstitutionnelle notamment parce que les fonds spéciaux sont créés pour des motifs précis (l’argent prévu pour la crise du COVID ne doit pas être imputé à d’autres fins), qu’il ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’exercice pour lequel ils sont prévus (les crédits COVD étaient utilisables jusqu’en juin 2022), et en raison du caractère rétroactif de la décision[16]. Il y a donc désormais un trou de 60 milliards d’euros dans le budget du fonds climat.
Le feuilleton ne s’arrête pas là !
Si l’arrêt de la cour de Karlsruhe ne concerne directement que les ressources du fonds climat, le gouvernement allemand s’appuyant sur ses conseillers juridiques en a fait une interprétation plus large : la même logique pourrait s’appliquer aux 200 mds€ du fonds de stabilisation économique (FSE-crise énergétique) levés pour faire face aux chocs énergétiques. Avec un tel scenario une partie des dépenses déjà réalisées en 2023 seraient frappées d’inconstitutionnalité (ce qui pose des questions insolubles :impossible de ne pas dépenser ce qui a déjà été dépensé !) ainsi évidemment que celles de 2024.
C. L’Allemagne s’engage dans la voie de l’austérité sous stéroïde.
Si la manœuvre consistant à transférer des financements du FSE-Corona vers le Fonds climat était de toute évidence juridiquement acrobatique (lien ténu des dépenses supplémentaires avec l’épidémie, rétroactivité), son rejet par le tribunal n’en est pas moins politiquement problématique. Il remet en cause le choix d’une majorité parlementaire.
Il est surtout économiquement et écologiquement délétère en mettant un coup de frein massif aux investissements nécessaires à la transition. Les dizaines de milliards d’euros manquant pour mener la transition sont autant de dépenses publiques en moins permettant de sortir l’Allemagne de la stagnation économique qu’elle connaît depuis bientôt un an.
S’il est difficile de déterminer les chiffres exacts, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui manqueront à l’appel pour boucler les projets prévus d’ici fin 2023 et en 2024. A minima, le fonds climat se voit amputé de 60 mds€ (sur 212) ce qui représenterait autour de 24 mds en moins pour 2024. Le FSE quant à lui avait prévu d’engager en 2024 environ 20 milliards (13,5 mds€ pour les subventions énergétiques, 4,5 mds€ pour les redevances de réseau et 2,5 mds€ pour les hôpitaux). Le Tagesschau a commencé à dresser la liste des projets qui sont sur la sellette [17]: les usines de fabrication de puces, l’acier vert, les usines de batteries électriques, les subventions pour les pompes à chaleur et le renflouement de la Deutsche Bahn.
C’est aussi, une crise politique qui s’ouvre dans le plus grand pays d’Europe. L’Allemagne semble frappée de paralysie. Une semaine après l’arrêt de la Cour, la coalition n’a toujours pas présenté de plan sur la manière dont elle compte réagir au jugement. Les discussions sur le projet de budget fédéral qui devaient être voté au Parlement la semaine du 27 novembre 2024 ont été stoppées. Le ministre des finances a gelé toute les dépenses non déjà approuvées : celles du fonds climat évidemment, mais également celles du FSE ainsi que celles de tous les ministères. Aucune dépense non déjà approuvées ne peut être débloquée sans son accord explicite. Une seule décision a été prise à date : dans l’espoir d’éviter que le budget 2023 ne soit pas également déclaré inconstitutionnel, le ministre des finances va proposer au Parlement de lever à nouveau pour 2023 le « frein à l’endettement ».
Au-delà de cette décision, la position de Christian Lindner (et de son parti) est claire : le ministre des finances salue la décision au motif que la transition fera ainsi moins appel aux subventions publiques (considérées comme néfastes par essence), en ligne avec les revendications principales de son parti il refuse toute hausse d’impôt pour combler le trou d’investissement. Sa solution : réduire les dépenses, et en particulier les dépenses sociales, pour dégager les marges de manœuvre budgétaire. Plus de 60 milliards de baisse de dépenses en 4 ans : c’est la voie de l’hyper austérité, alimentant de vives tensions sociales, que défend le ministre des finances.
Du côté du SPD et des Verts, le discours est nettement plus alarmiste : les sommes énormes qui font désormais défaut pour investir dans la transition empêcheront l’Allemagne d’atteindre ces objectifs en la matière, et pèseront lourdement sur l’industrie allemande qui risque soit de quitter le territoire soit d’être dépassée dans la course mondiale à la compétitivité et à l’innovation. Ces dissensions peuvent facilement conduire à un éclatement à venir de la coalition.
D. La clause du frein à l’endettement en question
Malgré la gravité de la situation, les récents événements ont au moins l’intérêt de mettre pour la première fois en Allemagne au cœur des débats la question de la pertinence de la clause du « frein à l’endettement », en particulier au regard de son impact sur les investissements occupe l’actualité.
De nombreux acteurs appellent ainsi à la suspendre de nouveau et/ou à la réformer. La chef du parti SPD Saskia Esken a par exemple déclaré au groupe de médias Funke : « Comme nous nous trouvons dans une situation de crise permanente en raison d’influences extérieures, je continue à plaider pour une suspension du frein à l’endettement pour 2023 et 2024 ». Du côté des Verts, Katharina Dröge, l’une des deux présidentes du groupe parlementaire, a rappelé au quotidien berlinois Tagesspiegel que son parti plaidait « depuis de nombreuses années pour une réforme du frein à l’endettement, car il est mal fait sur le plan économique ». Selon elle, cette règle serait « dans sa forme actuelle un fardeau pour la place économique allemande ». C’est aussi la position exprimée par Stefan Körzell, membre du comité directeur de la Confédération des syndicats allemands (DGB), au Rheinische Post. « Une réforme fondamentale de ce frein à l’avenir est incontournable. Elle devrait avoir pour objectif d’exclure à l’avenir les investissements nets de la règle de l’endettement ». La présidente du comité consultatif économique du gouvernement allemand, Monika Schnitzer, s’est prononcée dans le même sens. Une « plus grande marge de manœuvre pour le financement par la dette des investissements nets » pourrait apporter une solution aux projets climatiques désormais menacés. Même le créateur de la clause du frein à l’endettement, Peter Steinbruck, ancien ministre des finances (SPD), a exprimé le besoin de réforme dans une interview parue dans le journal Die Zeit le 22 novembre : « Il doit y avoir un frein à l’endettement, mais l’actuel n’est visiblement plus adapté. Nous avons un besoin extrême d’investissements dans divers domaines et vivons à une autre époque qu’en 2009. »
Ainsi, la discussion sur une réforme de la clause du « Frein à l’endettement » est lancée en Allemagne. Pour aboutir une telle réforme nécessiterait la majorité des 2/3 au Parlement ce qui à ce stade n’est pas acquis puisque le FDP et la CDU-CSU s’y opposent pour le moment. Notons cependant que la volonté politique et la majorité des deux tiers n’ont pas manqué en 2022 pour inscrire dans la Loi Fondamentale qu’un Fonds de 100 milliards d’euros consacré aux dépenses de la défense serait financé hors « frein à l’endettement ».[18] Par ailleurs, il est clair que les syndicats tout comme les industriels se mobiliseront sur le sujet. Et déjà, au sein de la CDU/CSU, notamment parmi les ministres-présidents des Länder, des voix dissidentes ’élèvent pour faire évoluer le « frein à l’endettement »
Conclusion
On ne peut qu’être frappé par l’absurdité de la situation que vit l’Allemagne : la plus importante économie européenne est obligée de contourner les règles qu’elle s’est auto-imposées pour mener des projets essentiels tant au niveau industriel qu’écologique ou social. Mise au pied du mur de ses contradictions, la coalition au pouvoir est sur le point de s’auto-infliger une cure d’austérité sans précédent au risque de provoquer de vives tensions sociales, de compromettre la viabilité de son industrie et bien sûr son avenir écologique. Et tout cela alors qu’il n’y a aucune nécessité économique à le faire : l’Allemagne est l’un des pays du monde qui a le plus de facilité à emprunter, les taux sont encore assez bas, la meilleure preuve en est qu’avant le jugement de Karlsruhe les investissements massifs prévus ne rencontraient aucun obstacle d’ordre financier. C’est donc bien uniquement la permanence d’un dogme érigée en règle constitutionnelle qui est ici en jeu ! L’alerte de Norbert Lammert était juste.
Les leçons sont également importantes à tirer au niveau européen. L’ironie de l’histoire veut que le jugement du tribunal de Karlsruhe soit tombé au moment où les négociations sur de nouvelles règles budgétaires européennes lancées en 2019 atteignent leur phase décisive. Sous la pression de l’Allemagne, les ministres des finances discutent une proposition de compromis qui changerait finalement très peu de choses aux règles existantes[19] dont on a vu qu’elles avaient des effets délétères sur les revenus, les investissements publics et la préservation d’infrastructures de qualité[20]. Toutes les propositions visant à donner un statut privilégié à des dépenses prioritaires, notamment pour accélérer la transition et l’adaptation au changement climatique ont été rejetées. Les clauses de suspension des règles pour circonstances exceptionnelles sont en outre très restrictives.
Espérons que l’expérience allemande apportent un peu de sens commun aux chefs d’État et ministres des finances: une doctrine budgétaire qui accorde une priorité absolue au niveau du déficit et de la dette n’est pas adaptée aux nouveaux défis économiques et écologiques et à la conduite démocratique des politiques budgétaires. Il est urgent que les ministres des finances et la Commission européenne relancent la réflexion sur ce que serait une bonne gouvernance économique européenne en tenant compte de l’expérience allemande. Il n’est pas urgent de conclure sur la base d’un mauvais compromis.
Marion Cohen, co-Fondatrice de The Other Economy et Ollivier Bodin, Ancien haut fonctionnaire international, Fondateur de l’ONG Greentervention
Notes
[1] Pour en savoir plus sur la gouvernance économique européenne et en particulier la question relative aux règles budgétaire voir la fiche sur la plateforme The Other Economy
[2] L’article 126 du TFUE détaille, en effet, la surveillance par la Commission de la situation budgétaire des États membres, évaluée selon deux critères: la dette publique ne doit pas être supérieure à 60% du PIB et le déficit public à 3% du PIB (ces valeurs sont fixées dans le protocole n° 12, annexé au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Cet article précise également les étapes de la « procédure pour déficit excessif », déclenchée en cas de non-respect des critères et qui peut donner lieu à des sanctions.
[3] Créé en 2012 dans le sillage de la crise des dettes publiques européennes, le Mécanisme européen de stabilité (MES) pallie l’un des défauts originels de l’Union monétaire : l’absence de mécanismes de solidarité internes à la zone euro. Schématiquement, quand un État n’a plus accès aux marchés financiers (car les taux sont trop élevés), il peut emprunter au MES (qui lui-même emprunte sur les marchés à des taux très bas grâce à la garantie apportée par l’ensemble des pays de la zone).
[4] Voir sur la plateforme The Other economy l’article Les règles budgétaires européennes n’ont pas de rationalité économique et la proposition « Réformer le Pacte de stabilité et de Croissance » sur la Plateforme The Other Economy
[5] Voir les articles 109, 115 et 143d de la Loi Fondamentale allemande
[6] Rapporté dans l’historique de la « Schuldenbremse » récemment produit par le think tank Dezernatzukunft et cité dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 29/5/2009 : « Das Misstrauen, das künftigen demokratisch legitimierten Mehrheiten und Bundestag und Bundesrat und ihren möglichen Gestaltungsabsichten mit diesem Regelungsehrgeiz entgegengebracht wird, halte ich für verfassungspolitisch verfehlt.“
[7] Voir le texte du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance
[8] La limite de 0,5% du PIB hors variations conjoncturelles est censé maintenir en toute circonstance le déficit en deçà de la limite de 3% fixée par le Traité.
[9] Pour en savoir plus sur ce sujet vous pouvez consulter la fiche sur le solde structurel et le PIB potentiel sur la plateforme The Other Economy.
[10] Il existe aussi une clause de suspension particulière dont l’application peut être demandée par un pays pour couvrir des dépenses exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’État concerné..
[11] A l’exception des fonds spéciaux dont les autorisation de crédits propres ont été créé avant l’introduction du de la règle du frein à l’endettement.
[12] Loi sur la création d’un fonds de stabilisation économique (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – WStFG), Art.1. (27/03/20). Voir la version consolidée de la loi sur les fonds de stabilisation (SFTG) qui comprend les dernières dispositions concernant le fonds de stabilisation financière créé en 2008 et le fonds de stabilisation économique créé en mars 2020.
[13] Voir l’article qui modifie les montants (et prolonge les délais jusqu’au 30/06/22).
[14] Loi portant modification de la loi sur les fonds de stabilisation en vue de la réactivation et de la réorientation du fonds de stabilisation économique (StFGÄndG k.a.Abk.) (28/10/22)
[15] énergie renouvelable, efficacité énergétique des bâtiments, mobilité électrique, infrastructures ferroviaire, Production de semi-conducteurs, production d’hydrogène etc. Voir les dépenses prévues dans le Projet de plan budgétaire pour le « Fonds pour le climat et la transformation » de 2024 du ministère allemand des Finances.
[16] la décision de réaffecter les fonds non utilisés a été prise en février 2022 soit après l’exécution du budget 2021.
[17] journal télévisé de la première chaine publique allemande
[18] La Loi sur l’amendement de la loi fondamentale de juin 2022 introduit la disposition suivante à l’article 87a de la Loi Fondamentale allemande « Afin de renforcer la capacité d’alliance et de défense, l’État fédéral peut créer un fonds spécial pour la Bundeswehr, doté d’une autorisation de crédit propre, d’un montant unique de 100 milliards d’euros au maximum. L’article 109, paragraphe 3, et l’article 115, paragraphe 2, ne s’appliquent pas à l’autorisation de crédit. Les détails sont réglés par une loi fédérale ».
[19] Voir l’analyse de Greentervention sur la proposition de réforme des règles budgétaires mise sur la table des discussions par la Commission européenne le 26/04/23 et une analyse de la proposition de compromis apportée par l’Espagne. Voir également l’analyse de l’économiste Olivier Blanchard.
[20] Voir sur la plateforme The Other economy l’article Les règles budgétaires européennes n’ont pas de rationalité économique et la proposition « Réformer le Pacte de stabilité et de Croissance » sur la Plateforme The Other Economy
The post Allemagne : le « frein à l’endettement » freine d’abord…. le verdissement de l’économie appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
09.11.2023 à 14:24
Energie : faut-il vraiment craindre le risque de pénurie?
Marion Cohen, Alain Grandjean
Depuis le début des années 70, avec la crise du pétrole apparue un peu après le rapport Meadows, nous vivons dans la peur de manquer de pétrole et plus généralement d’énergie. Cette peur a été ravivée par la guerre de l’Ukraine. Il est vrai que nous devons à l’énergie notre confort, notre santé et les […]
The post Energie : faut-il vraiment craindre le risque de pénurie? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (4641 mots)
Depuis le début des années 70, avec la crise du pétrole apparue un peu après le rapport Meadows, nous vivons dans la peur de manquer de pétrole et plus généralement d’énergie. Cette peur a été ravivée par la guerre de l’Ukraine. Il est vrai que nous devons à l’énergie notre confort, notre santé et les progrès incessants de notre vie matérielle. Il est vrai aussi que la croissance exponentielle de la consommation d’une ressource planétaire finit nécessairement par en épuiser le stock. C’est vrai pour les ressources épuisables[1] comme pour les ressources dites renouvelables (à partir du moment où le rythme de la croissance de la consommation est supérieur à celui de la régénération de la ressource : pêcher plus vite les poissons qu’ils ne mettent de temps à se reproduire)[2]. Nous allons montrer ici qu’à l’horizon de quelques décennies cette peur est infondée et nous fait faire d’énormes erreurs alors que nous souffrons en fait d’une surabondance énergétique.
1. L’humanité ne risque pas de manquer d’énergie fossile d’ici 2050
En 2022, l’humanité a consommé 14,4 Gtep d’énergie primaire, soit deux fois plus qu’il y a une quarantaine d’années[3] (période pendant laquelle la population mondiale a cru de 75% environ). Comme on peut le voir sur le graphique suivant, plus de 80% de l’énergie que nous consommons est de source fossile.
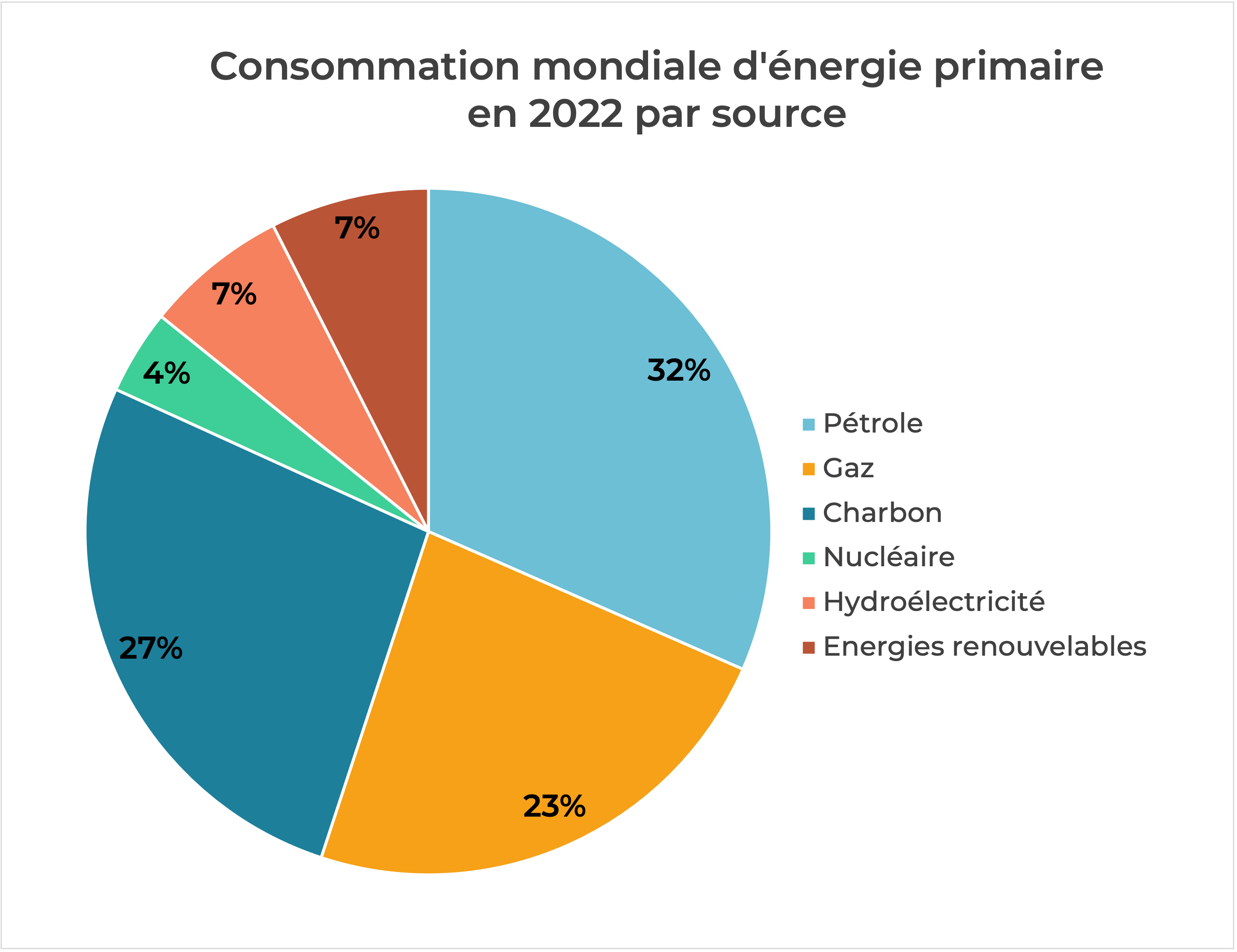
Statistical Review of World Energy (BP – 2023).
Cela fait une consommation moyenne de 1,8 Tep par habitant, moyenne qui cache de fortes disparités.
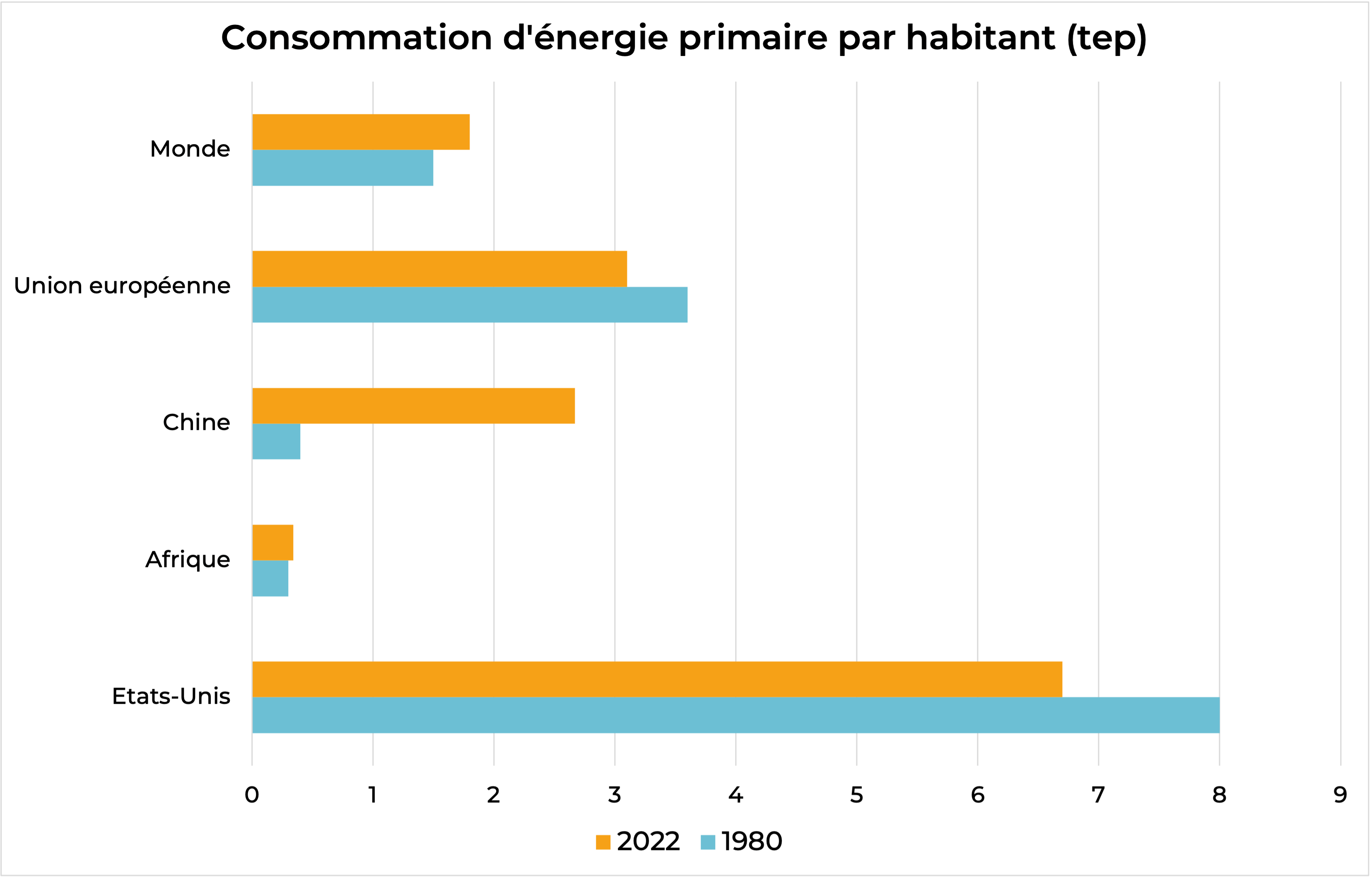
Source : Statistical Review of World Energy (BP – 2023)
Disposerons-nous toujours d’assez d’énergie pour en profiter dans les décennies à venir, surtout si ceux qui n’ont pas encore notre chance nous rattrapent ?
En ordre de grandeur, on peut fixer à 2 Tep par habitant en 2050 ce qu’il faudrait pour arriver à un niveau de vie « à l’occidentale » – compte-tenu de progrès restant à faire en matière d’efficacité énergétique partout et de sobriété dans les pays où la consommation est importante[4]. Il nous faudrait alors disposer de 20 GTep en 2050 en ordre de grandeur, soit 50% de plus qu’aujourd’hui.
Est-ce possible ?
Pour répondre à cette question nous ne disposons pas d’un « GIEC des énergies fossiles » qui nous aiderait à y voir clair dans les chiffres qui circulent et ce qu’ils signifient précisément. Pour autant il semble clairement acquis que nous disposons à cet horizon d’assez d’énergie fossile et de capacité d’extraction au niveau mondial. Les investissements considérables réalisés dans le secteur énergétique sont tels que les réserves prouvées de pétrole sont au plus haut. Celles de gaz et de charbon sont également très importantes. Les réserves prouvées désignent la quantité de ressource dont l’opérateur garantit l’extraction future aux conditions techniques et économiques du moment dans les gisements en exploitation[5]. Il s’agit donc d’une estimation minimale de l’énergie qu’on peut extraire et pas du tout d’une estimation de la quantité totale de la ressource restant sur la planète : les réserves prouvées peuvent rester stables d’une année sur l’autre voire augmenter. C’est ce qu’on constate pour les réserves prouvées de pétrole et de gaz depuis 1980.
Selon BP_Stat, les réserves prouvées d’énergies fossiles fin 2020, à environ 1000 Gtep au total (environ 240 Gtep pour le pétrole, 190 GTep pour le gaz et 570 Gtep pour le charbon). Ces sources d’énergie ne sont pas entièrement substituables mais le sont de plus en plus du fait des progrès en cours et à venir en matière d’électrification. En résumé, on voit qu’il y a là de quoi tenir au niveau mondial jusqu’en 2050 et ceci même en supposant une hausse de la consommation pour atteindre 20Gtep par an.
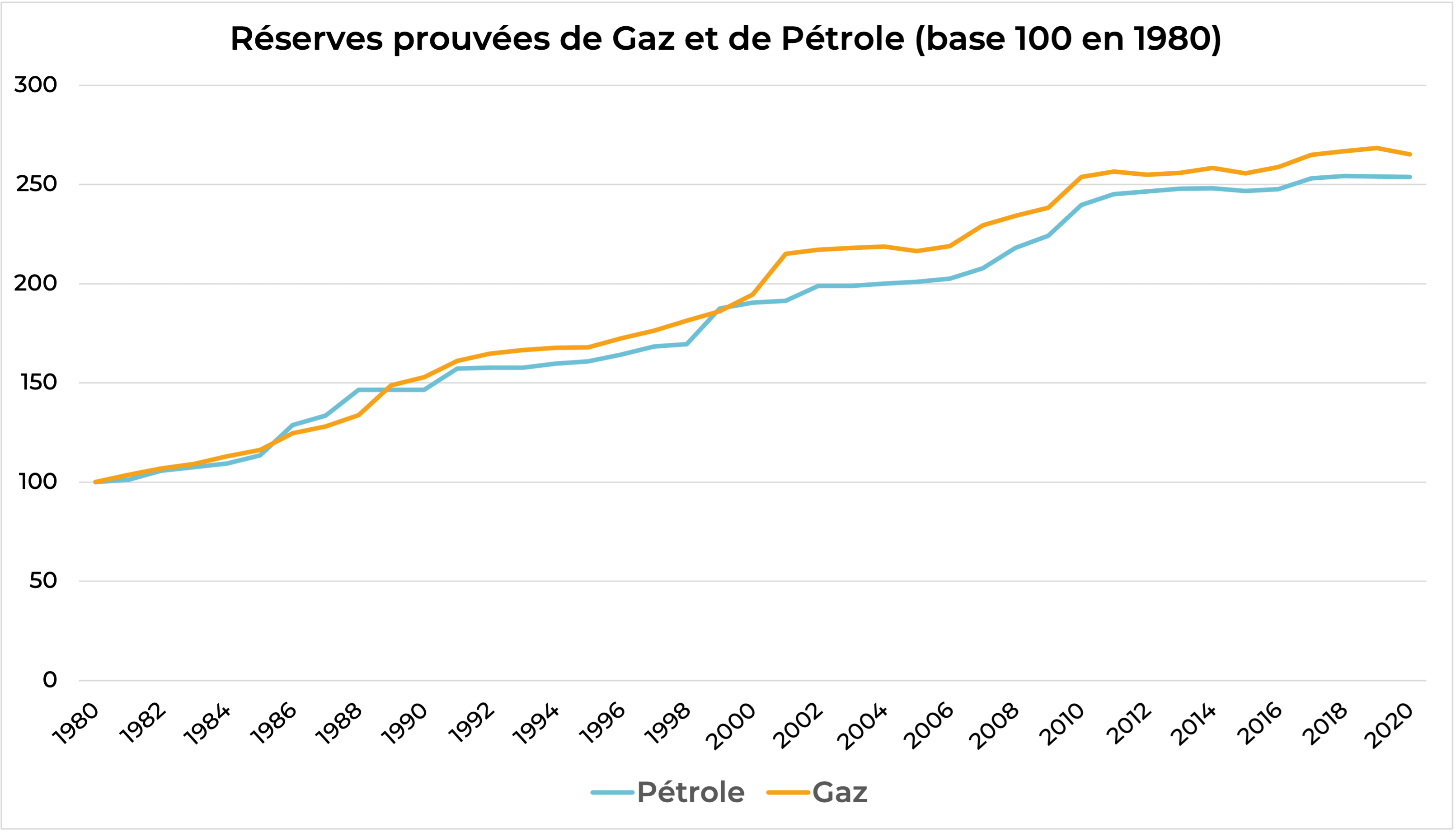
Source : Statistical Review of World Energy (BP – 2023) (BP Stat)
Quant au volume extractible de pétrole annuellement, il se maintient depuis près d’une décennie autour de 90 millions de barils par jour, selon BPStat[6].
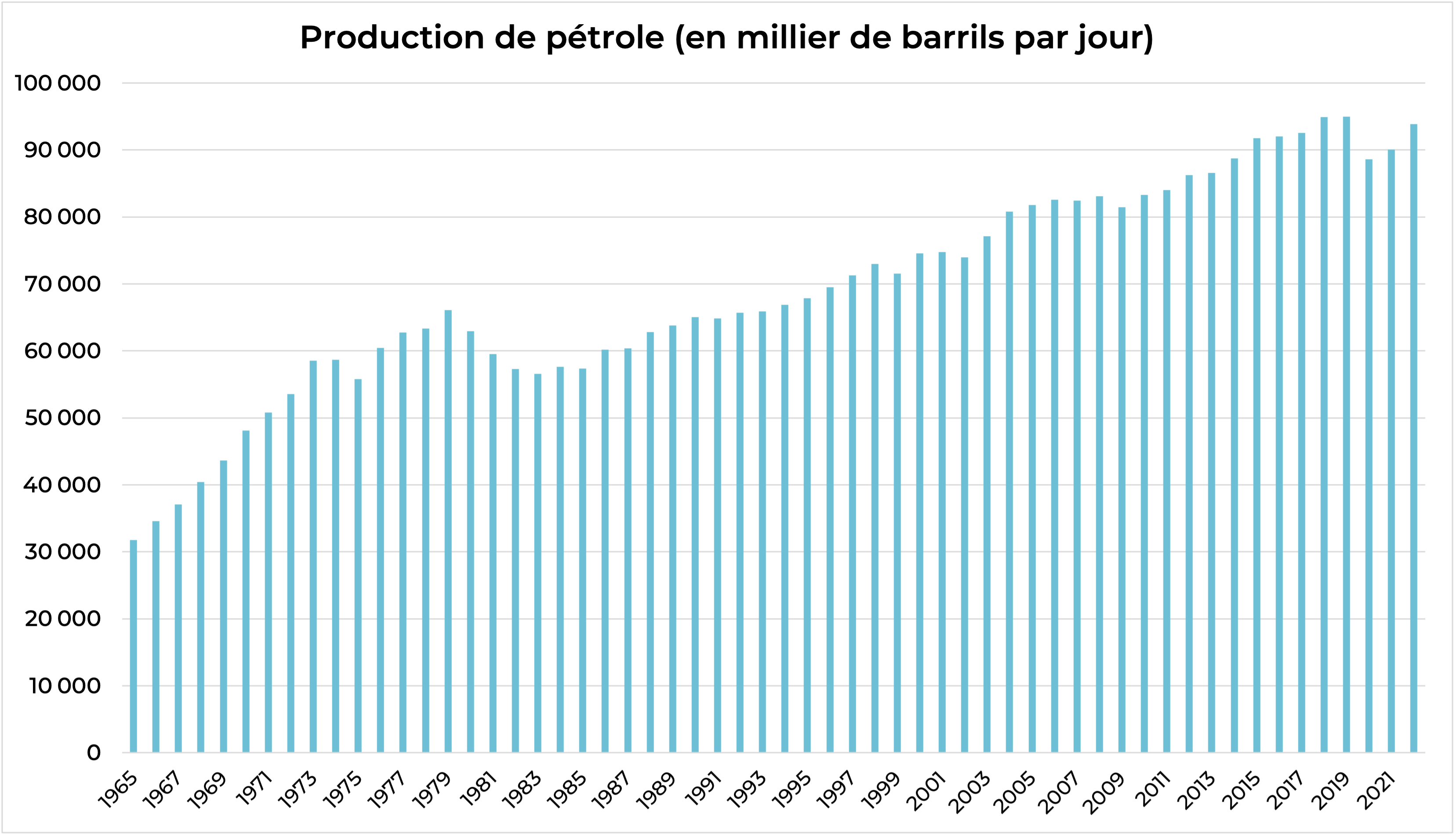
Source : Statistical Review of World Energy (BP – 2023)
S’il est appelé à se réduire dans les prochaines années, ce sera autant du fait de l’électrification en cours du transport, le secteur le plus consommateur de pétrole, que d’un éventuel plafonnement annuel de la production.
Il est probable que l’humanité dans son ensemble ne manquera donc pas d’énergie fossile dans les prochaines décennies sauf catastrophe majeure.
Ce constat mondial ne vaut cependant pas au niveau d’un pays ou d’un groupe de pays. Les ressources d’énergie fossile sont réparties de manière très inégale : certains pays sont très richement dotés (les États-Unis, la Russie, l’Arabie saoudite, le Canada, l’Iran, ainsi que la Chine, l’Inde, et l’Australie pour le charbon essentiellement…), quand d’autres n’en ont pas, peu ou plus.
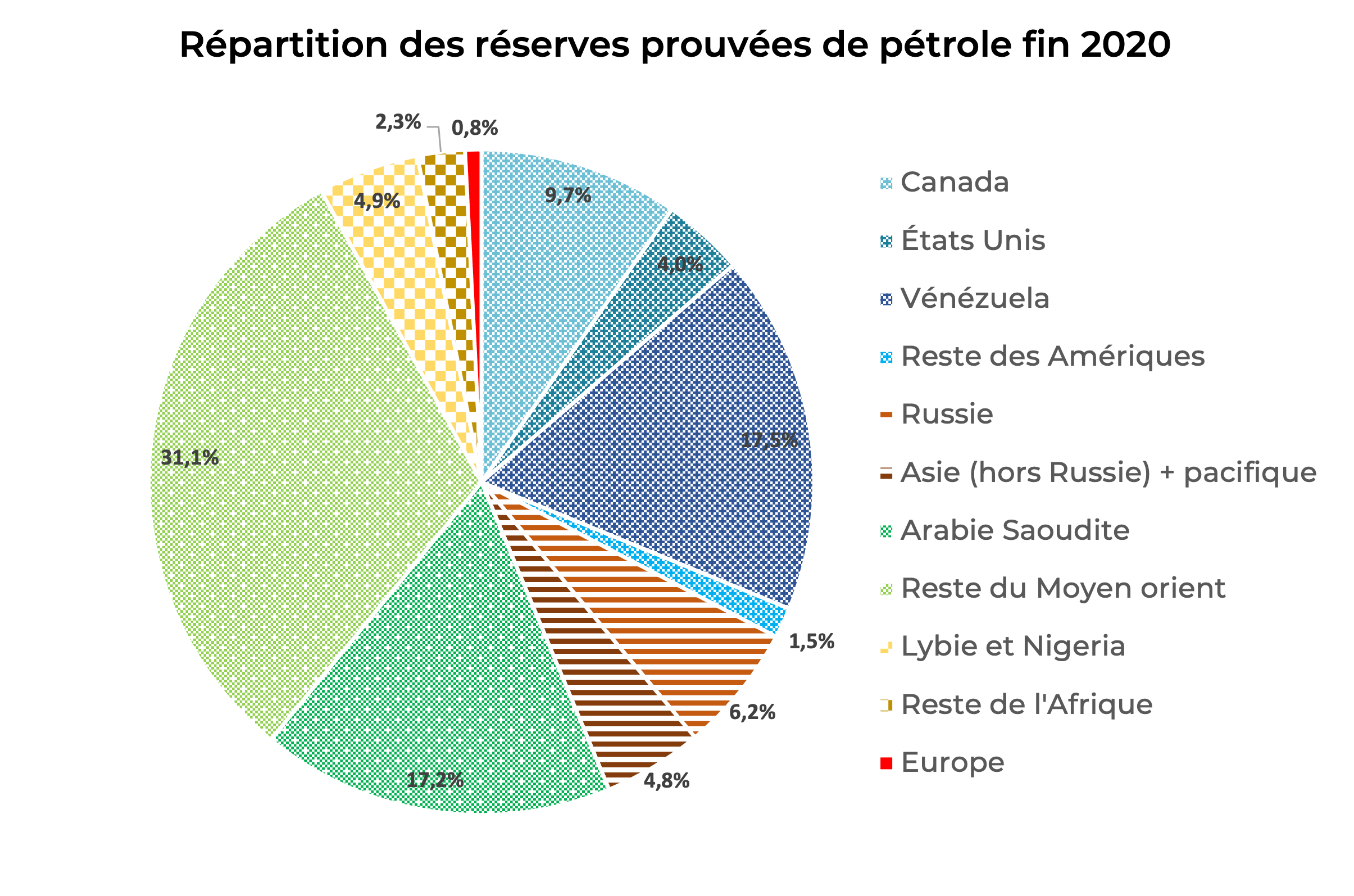
Source : Statistical Review of World Energy (BP – 2023)
La guerre de l’Ukraine a réveillé les Européens qui sont très dépendants en la matière. Mais nous verrons plus loin que la peur de manquer peut être très mauvaise conseillère.
2. Cinq problèmes majeurs liés à l’excès d’énergie fossile et non au risque de pénurie.
a/ Les réserves prouvées d’énergie fossiles sont telles que leur exploitation si nous les sortons de terre[7] nous fera dépasser les 2°C.
En effet, d’après le sixième rapport d’évaluation du GIEC, le budget carbone restant (à partir de début 2020) pour limiter le réchauffement à 2°C est estimé à 500 GtCO2 pour limiter le réchauffement à +1,5°C (avec une probabilité de 50%) et à 1150 GtCO2 pour le limiter à +2°C (avec une probabilité de 67%)[8]. A titre de comparaison, environ 2400 GtCO2 ont été émis sur la période 1850 à 2019, dont 42% depuis 1990[9]. En 2020 et 2021, les émissions de CO2 humaines se sont élevées à environ 40 GtCO2[10].
Les réserves prouvées d’énergies fossiles correspondent à plus de 3 000 GtCO2, soit près de 2 fois le budget autorisé pour limiter le réchauffement à 2°C par rapport à la période préindustrielle.
b/ La puissance que nous donne cette énergie nous permet de broyer le vivant sans vergogne
La crise de la biodiversité est largement liée à l’énergie que nous mobilisons contre le vivant : surexploitation des ressources vivantes permises par nos équipements surpuissants[11], destruction d’habitat et fragmentation des écosystèmes liés à nos constructions et infrastructures de transport, pesticides (fabriqués à partir d’énergie fossile et qui pour être produits, transportés et épandus nécessitent de l’énergie), invasions d’espèces dues aux transports, changement climatique, dû majoritairement au CO2 d’origine fossile et émis par la déforestation (permise par les machines…).
Ces deux premières conséquences dramatiques de la surabondance de l’énergie fossile ont été brillamment mises en lumière il y a une dizaine d’années par l’économiste Pierre-Noël Giraud[12].
c/ La surabondance énergétique dans les pays « développés » nuit à la santé des habitants
Ceux-ci ne font plus travailler leur corps, mangent beaucoup trop et mal (avec des aliments de plus en plus transformés, et aussi mauvais pour la santé que coûteux en énergie), avalent trop de médicaments ; leur cerveau est sur sollicité et perd ses capacités d’attention et de concentration, les pollutions dues à nos produits artificiels et nos machines engendrent des cancers, les relations sociales sont détruites aussi par cette surabondance qui a favorisé l’individualisme et briser la solidarité etc.
d/ L’injustice criante de notre monde où certains peuvent bénéficier de dizaines de fois plus d’énergie que d’autres est source de tensions et de guerres.
Et la dérive climatique ne fera qu’aggraver cette situation.
e/ Nous sommes drogués à cette énergie et la perspective d’en manquer nous faisant perdre tout discernement, nous sommes prêts à tout pour éviter ce manque.
3. Les risques du discours alimentant la peur de manquer
La peur de manquer, qui repose sur un diagnostic erroné au niveau global et dans l’horizon des prochaines décennies, nous fait faire littéralement n’importe quoi : nous allons installer en Europe des terminaux de Gaz Naturel Liquéfié en large surcapacité[13] et qui créent un effet de verrouillage vis-à-vis de cette énergie fossile, appelée abusivement énergie de transition[14] ; nous sommes prêts à financer des projets dévastateurs, comme Eacop, réalisé par Total en Ouganda et en Tanzanie et à accepter de fermer les yeux sur le soutien ainsi apporté au régime militaire en place[15]; nous continuons à financer massivement les projets de production d’énergie fossile ; les sociétés pétrogazières restent des stars en termes de capitalisation boursière[16] et attirent toujours les épargnants et les investisseurs ; nous sommes prêts à toutes les contorsions pour les considérer comme socialement responsables[17]. Pour se concilier les bonnes grâces du dirigeant de l’Arabie saoudite, un dangereux dictateur, le plus gros producteur mondial de pétrole, nous acceptons de participer à des projets pharaoniques (comme Néom et Alula) en outre présentés comme la pointe avancée du développement durable ; nous fermons les yeux sur sa « diplomatie « du football ! Nous sommes prêts à détruire le continent arctique, à continuer à forer en Alaska et dans le Golfe du Mexique. Nous sommes prêts – comme l’ont fait les Américains en Irak- à faire ou soutenir la guerre en inventant des motifs fallacieux pour cacher à nos propres yeux notre avidité….
En bref, si nous avons un problème de fond à résoudre c’est bien celui de la surabondance énergétique [18] dont nous pâtissons et faisons pâtir l’humanité entière.
4. Les solutions existent et sont connues
Si nous gardons raison, les solutions s’imposent d’elles-mêmes ; la priorité absolue est de nous désintoxiquer de notre boulimie énergétique : sobriété[19] énergétique, tempérance dans la consommation de biens et services, efficacité énergétique de nos procédés, de nos bâtiments et de nos équipements. C’est ainsi également que le partage de l’énergie dans le monde sera plus équitable. Nous allons devoir faire le deuil de nos désirs no limit, faire des choix collectifs adultes, conscients et non pas déterminés par une pénurie physique.
Dans cette optique de besoins énergétiques maîtrisés, nul doute que nous arriverons à les satisfaire avec des sources d’énergie renouvelables que nous développons à vitesse croissante[20].
Les multiples problèmes avancés à leur égard (surcoût, intermittence, besoins en matériaux critiques etc.) sont soit de l’histoire ancienne (comme les coûts des sources de production) soit essentiellement dus à notre voracité sans limite qui rend difficile leur satisfaction par des sources d’énergie qui butent effectivement sur un ensemble de contraintes[21].
En particulier, il est clair qu’une forte pénétration d’électricité intermittente suppose dans nos pays d’importants investissements dans les réseaux, bien identifiés et qui posent encore quelques défis technologiques, et des investissements en stockage coûteux. Mais elles seront beaucoup plus accessibles dans un monde qui maîtrise ses besoins énergétiques, isole ces logements, les gèrent au mieux et est capable de déplacer sa demande d’électricité : les gaz bas-carbone et les dispositifs de stockage en plein développement feront le reste.
Quant aux matériaux critiques[22] comme le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, une croissance indéfinie de leur extraction est elle aussi physiquement impossible. Cependant, dans les prochaines décennies, les limites à leur exploitation et à leur usage ne seront pas purement physiques, mais liées à des enjeux géopolitiques et sociaux (du fait des impacts locaux des mines). En tout état de cause, les tensions sont issus de l’ensemble de leurs usages, au premier rang desquels le numérique, dont un monde raisonnable limitera la croissance. Elles seront également substantiellement réduites par une accélération massive de la transformation de nos modèles de développement en modèles d’économie circulaire.
Conclusion
La peur de manquer d’énergies fossiles, puis de matériaux n’est pas infondée sur le long terme du fait des propriétés des courbes exponentielles, comme nous l’avons rappelé en introduction. Pour autant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité nous imposent maintenant des transformations, dont certaines sont en cours, de nos modes de production et de consommation. Si la question des limites physiques aux énergies fossiles et aux minerais ne semblent pas se poser au niveau mondial à court terme, elles restent d’actualité au niveau régional. L’Europe et la France en particulier ne peuvent s’en désintéresser, sans pour autant adopter des réponses compulsives à la peur de manquer. Si nous gardons raison, comme dit plus haut, les solutions s’imposent d’elles-mêmes. La priorité absolue est de nous désintoxiquer de notre boulimie énergétique : sobriété énergétique, tempérance dans la consommation de biens et services, efficacité énergétique de nos procédés, de nos bâtiments et de nos équipements. C’est aussi une condition pour que le partage de l’énergie dans le monde soit plus équitable et que nous mettions de la cohérence entre les valeurs que nous prônons[23] et nos comportements.
Alain Grandjean et Marion Cohen
Notes
[1] Prenons l’exemple de l’acier, en suivant la démonstration de François Grosse. Nous produisons annuellement de l’ordre de 1 milliard de tonnes d’acier par an, soit trente fois plus qu’au début du XXe siècle. La croissance aura été, sur cette période, d’environ 3,5 % par an. A ce rythme, la production cumulée d’acier en un siècle est égale à 878 fois la production de la première année. Si on prolongeait cette tendance, la production annuelle serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans 270 ans, 10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui !… Inutile d’être très précis dans l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme est impossible à maintenir. Voir François Grosse, « Le découplage croissance/matières premières. De l’économie circulaire à l’économie de la fonctionnalité : vertus et limites du recyclage », Futuribles, Juillet-Août 2010, numéro 365.
[2] Pour en savoir plus sur ce point, consulter le chapitre Nos prélèvements croissants sur les ressources naturelles ne peuvent que conduire à leur épuisement sur la plateforme The Other Economy
[3] D’après le Statistical Review of World Energy (BP – 2023), la consommation mondiale d’énergie primaire s’élevait à 604 Exajoule en 2022 et à 280 Exajoules en 1980.
[4] L’atteinte de la neutralité carbone pour la France à horizon 2050 dans la Stratégie Nationale Bas Carbone repose sur une baisse de la consommation d’énergie de 40% ce qui conduit en ordre de grandeur à 2 Tep.
[5] Elles n’incluent donc ni les gisements non encore découverts, ni les gisements découverts mais pas encore exploités, ni les évolutions techniques (nouveaux procédés) et économiques (hausse du prix de la ressources sur les marchés) qui permettraient de mieux exploiter les gisements existants. Sur la plateforme The Other Economy vous trouverez des explications concernant les différences entre réserves prouvées, réserves ultimes et ressources.
[6] Ce volume a dépassé les 100 millions de barils/jour en 2023 selon l’AIE.
[7] Sans Captage Stockage de CO2 (CCS) ce qui est le cas pour la quasi-totalité de la production actuelle. Le CCS n’est pas à négliger à horizon 2050 mais son développement est à ce jour lent et coûteux et ne remet pas en cause notre conclusion.
[8] Source : Résumé pour décideurs du Rapport de synthèse du 6ème rapport d’évaluation du GIEC, 2023 (p. 19). Les chiffres du budget carbone ont été révisés récemment par une équipe de l’IIASA selon laquelle « le budget carbone restant pour maintenir le réchauffement à 1,5 °C (avec une probabilité de 50 %) est d’environ 250 Gt CO2 (à date de janvier 2023) ce qui équivaut à « environ six années d’émissions actuelles de CO2« . Et, pour une même probabilité de 50 % d’atteindre 2 °C, le budget carbone restant « est d’environ 1 200 Gt CO2« .
[9] Source : Résumé pour décideurs du Rapport de synthèse du 6ème rapport d’évaluation du GIEC, 2023 (p. 4).
[10] Source : Data supplement to the Global Carbon Budget 2022. A noter que les données sont exprimées en GtC pour convertir en GtCO2 il faut multiplier par 3,664.
[11] Les bateaux de l’industrie de la pêche sont de véritables navires de guerre, comme ne cesse de le montrer l’association BLOOM.
[12] Voir la conférence Rareté des ressources ou épuisement des poubelles, cycle sur « Le défi du développement durable » qui s’est déroulé à l’ENS de Lyon en 2015-16.
[13] La demande européenne de GNL pourrait atteindre entre 150 et 190 milliards de m3 en 2030 alors que les capacités cumulées des terminaux de GNL pourraient s’élever à près de 400 milliards de m3. Voir Gaz naturel liquéfié : après l’improvisation dans l’urgence, reprenons nos esprits, Carbone 4 – Juin 2023
[14] Comme l’explique par exemple Jean-Baptiste Fressoz, nous n’avons jamais connu de transition énergétique : nous ne cessons de faire croître notre consommation d’énergie en additionnant les diverses sources. Voir la vidéo Transition Energétique : un mythe dangereux
[15] Le projet Eacop vise à extraire du pétrole du lac Albert et à le transporter chauffé sur 1445km jusqu’à l’Océan Indien en Tanzanie. Nous consolidons ainsi un régime dictatorial, où un des fils du dictateur, en charge des services spéciaux, supervise les tortures appliquées aux opposants, et où des tribunaux condamnent à mort pour «déviance sexuelle».
[16] La valorisation de Saudi Aramco dépasse les 2000 Mds de dollars, Totalenergies est la quatrième capitalisation du CAC 40.
[17] Voir la récente lettre ouverte à Elisabeth Borne demandant un label ISR sans greenwashing (octobre 2023)
[18] C’est aussi ce qu’affirme l’économiste Christian de Perthuis dans son dernier livre : Carbone fossile, carbone vivant. Vers une nouvelle économie du climat (Gallimard, 2023).
[19] Qui est en outre « gagnante » au plan économique, comme le démontre clairement Benjamin Brice dans son livre « L’impasse de la compétitivité » et comme je l’ai suggéré dans cette tribune publiée par le journal La Tribune.
[20] Les capacités des énergies renouvelables ont augmenté de 9,6% en 2022, d’après le rapport Renewable Capacity Statistics 2023 de l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). En 2022, 83% des nouvelles capacités de production d’électricité ont ainsi relevé de sources renouvelables. Et la grande majorité des constructions nouvelles (90%), relevaient du solaire (+22% de capacité de production) et de l’éolien (+9%). Certes, cette croissance n’est pas suffisante encore, mais elle est réellement significative.
[21] Le rayonnement solaire sur notre planète apporte une énergie considérable bien supérieure à nos besoins. Les limites ne sont donc pas dues à ce rayonnement mais à la fabrication et l’installation des « convertisseurs nécessaires pour transformer cette énergie, des dispositifs de stockage et de gestion des réseaux et de la demande. Voir pour le cas de la France, le post Leçons tirées des travaux récents de prospective énergétique – Janvier 2022
[22] Voir les rapports Critical Minerals Market Review 2023 de l’AIE et Métaux et climat : on touche le fond, mais on creuse encore, de Carbon4 finance 2023.
[23] Cette attitude permettrait de renforcer le poids de la déclaration universelle des droits de l’homme, attaquée par des gouvernements comme celui de la Chine au motif qu’elle serait l’expression d’un point de vue occidental, relatif donc. Il n’y a pas de doute que les régimes autoritaires et les pays en développement peuvent s’appuyer sur nos propres contradictions pour affaiblir la portée de cette déclaration.
The post Energie : faut-il vraiment craindre le risque de pénurie? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
02.11.2023 à 15:25
La transition climatique : une bonne affaire au plan économique !
Alain Grandjean
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer celles et ceux qui manqueraient de réalisme ou de courage en faisant croire que la transition se ferait sans effort et en n’insistant pas assez sur son coût qui serait très élevé. C’est ainsi que l’économiste Christian Gollier affirme qu’on « cache aux Français la réalité des […]
The post La transition climatique : une bonne affaire au plan économique ! appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (2341 mots)
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer celles et ceux qui manqueraient de réalisme ou de courage en faisant croire que la transition se ferait sans effort et en n’insistant pas assez sur son coût qui serait très élevé. C’est ainsi que l’économiste Christian Gollier affirme qu’on « cache aux Français la réalité des coûts de la transition », et que « nous vivons même dans une utopie de transition énergétique heureuse, oubliant que celle-ci impactera le pouvoir d’achat des ménages ». Il serait préférable à ses yeux que nos dirigeants adoptent une posture churchillienne promettant « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur »[1]. Il est vrai que reconstruire nos systèmes de production et transformer nos modes de consommation pour qu’ils deviennent sobres, propres et bas-carbone est un défi majeur, qui nécessitera d’importants investissements ainsi que des changements de comportement et de mode de vie conséquents. Ces investissements sont de mieux en mieux chiffrés, de l’ordre de 2 à 3% du PIB, ce qui est sans commune mesure avec des efforts de guerre qui peuvent être colossaux et même sans rapport avec ce qu’il a fallu investir pendant la reconstruction suivant la guerre de 1945. Quant aux changements de comportement les sondages montrent que l’opinion publique y est largement prête. Il est vrai aussi que des emplois dans des métiers trop dépendants des énergies fossiles seront supprimés et que des actifs seront « échoués »[2]. Mais qu’en est-il au total du coût de cette transition ?
Nous allons voir que d’une part, le sens à de cette expression est beaucoup moins clair qu’il n’y parait et que d’autre part, il est possible de faire en sorte que cette transition soit un projet de société extraordinairement stimulant, largement bénéfique au plan économique et finançable sans grandes difficultés. Sans doute faut-il pour cela ouvrir les yeux sur ces réalités futures et abandonner quelques idées reçues ?
Tout d’abord posons une question toute simple : de quels coûts parle-t-on ?
Des économistes du climat, attirent notre attention sur cette question centrale : « Quatre types de concepts de coûts existent dans la littérature sur l’atténuation du changement climatique : les coûts techniques, sectoriels, macroéconomiques et de bien-être. Ces types de coûts ne sont ni comparables ni équivalents » [3].
Dans la fiche Qu’est-ce qu’un coût ? de la plateforme The Other Economy nous avons également montré que la notion de coût ne se limite pas à celle de dépense et qu’elle dépend fortement du point de vue où on se place (individu, collectivité).
Si l’on raisonne au plan global, les concepts à mobiliser sont ceux de coûts macroéconomiques et de bien-être social.
Rappelons en effet que les dépenses des uns sont les revenus des autres : dès lors, le fait que certains coûts (comme celui de l’énergie) seront plus élevés à l’avenir ne permet pas de conclure qu’il en sera de même au niveau collectif. Plus significatif, les investissements massifs à réaliser sont évidemment générateurs d’emplois et de relance économique. S’ils coûtent aux uns, c’est qu’ils rapportent aux autres. Quant à la nécessaire baisse du contenu matériel de notre consommation, elle constitue une opportunité économique en contribuant à la baisse de notre déficit commercial[4] et en nous obligeant à inventer de nouveaux modèles d’entreprises. Enfin, les actifs échoués, le sont aux bilans des « entreprises du passé » (très dépendantes des énergies fossiles), pendant que le bilan et la valorisation des entreprises d’avenir vont connaitre un développement massif. Si des investisseurs valorisent une entreprise plus qu’une autre c’est qu’ils croient en son développement.
La question des actifs échoués, strictement financière, n’est vraiment pas nouvelle dans l’histoire du capitalisme et peut trouver des solutions, y compris si nécessaire par la mise en place de fonds publics de « défaisance » responsables, permettant de financer les « décommissionnements » (les mises en fin de vie effective, et non pas simplement leur cession, dans le cas présent alors qu’ils ne sont pas économiquement amortis). Les deux enjeux principaux de ces opérations ne sont pas physiques mais bien économiques. D’une part, il faut les réaliser sans créer de paniques sur les marchés donc en limitant les risques systémiques. D’autre part, il faut limiter la déresponsabilisation des acteurs privés en leur faisant payer une partie des coûts de décommissionnement.
Au total, il est plus que probable que la dynamique de la transition sera positive, si et seulement si, elle est pilotée et accompagnée intelligemment par les pouvoirs publics.
Par ailleurs, la croissance probable des flux marchands n’est qu’un aspect de la question ; ce qui va compter encore bien plus c’est le sentiment perçu en termes de bien-être social dont les revenus marchands ne sont qu’une composante. Même s’ils ne sont pas quantifiables avec un indicateur unique qui serait alternatif au PIB, les bénéfices de la transition sont multiples en termes de santé, de sens donné au travail, d’innovations sociétales, de coopérations territoriales et d’aménités environnementales, bref de qualité de vie. Il importe de rendre visibles ces bénéfices et c’est un travail collectif à faire ; tous les acteurs peuvent participer à la production d’un nouveau récit encourageant et stimulant.
Sera-t-il possible de financer cette transition ?
Au plan strictement monétaire rien ne permet d’en douter : l’argent se crée d’un simple jeu d’écritures et ne saurait manquer sauf décision politique[5]. Certains économistes raisonnent autrement : citons par exemple Eric Léser qui, dans un éditorial au titre très explicite « Pourquoi la transition énergétique ne peut être que chaotique », écrit : « Par définition, cet argent s’il est mobilisé même partiellement ne sera pas utilisé ailleurs. » Il cite ensuite le récent rapport de Jean-Pisani-Ferry et Selma Mahfouz: « Une part de l’investissement qui allait à l’extension des capacités de production ou à l’amélioration de la productivité du travail va devoir être consacrée à la recherche de l’efficacité énergétique, à la substitution d’énergies renouvelables à des énergies fossiles, ou au remplacement du capital prématurément déclassé. Toutes choses égales par ailleurs, l’impact sur le PIB potentiel ne pourra être que négatif. » Il conclut : « c’est donc un appauvrissement. Pour la bonne cause certes, mais un appauvrissement. Et il est aujourd’hui impossible d’en mesurer l’ampleur réelle. »
Curieux raisonnements : l’argent en question n’est pas mangé et ne disparaît pas ; il n’est pas non plus brûlé[6]. Il circule. Par ailleurs, il est bien sûr possible d’en recréer par le crédit. Ce qui limite l’efficacité du recours au crédit n’est en aucun cas d’ordre monétaire ou financier. Ce qu’il faut c’est :
- d’une part, assurer la rentabilité « microéconomique » des investissements écologiquement et socialement désirables, ce qui passe par une action déterminée de la puissance publique (via des réglementations, normes ou mécanismes fiscaux adaptés).
- D’autre part, bien comprendre que ce qui peut manquer ce n’est pas de l’argent (l’épargne n’a jamais aussi abondante et les guichets du crédit reste ouverts) mais les ressources de la sphère réelle (l’énergie, les matières premières, les ressources naturelles ou les équipements). Il est donc essentiel de ne pas gaspiller ces vraies ressources en développant le triptyque efficacité, sobriété, économie circulaire et d’accélérer le déploiement des technologies adaptées.
Et si on ne mettait pas les moyens nécessaires ?
Le focus mis sur les difficultés des transformations à effectuer pour cette transition climatique peut faire oublier ce qui se passerait si on ne les faisait pas. La notion de coût est en fait toujours relative.
Ce qui compte vraiment c’est de faire en sorte que le bilan (qualitatif au premier chef et pour partie quantitatif) des coûts et des bénéfices d’une « trajectoire » de transition soit globalement meilleur que celui d’une trajectoire sans transition.
Vu sous cet angle, il n’y a aucun doute. Rester les bras croisés, ou se contenter d’agir mollement ou à la marge, c’est une manière de se « préparer » à une vie de plus en plus difficile : nous serons toujours plus dépendants des énergies fossiles importées et de leur coût, nous vivrons dans un monde de plus en plus violent du fait des changements climatiques, de l’effondrement de la biodiversité, de la destruction des écosystèmes ,des pollutions diverses et de leurs effets socio-économiques en cascade et tout simplement de moins en moins beau…
Conclusion
Affirmer aujourd’hui que la transition coûtera cher est présomptueux car nous ne disposons en fait pas des outils et des modèles qui permettent de le prouver. En revanche, il y a de sérieux arguments pour penser l’inverse, conditionnels cependant à la mise en œuvre de politiques publiques volontaires et adaptées. La priorité est donc clairement à l’évolution de ces politiques, à l’élaboration d’un récit constructif, si possible désirable et bien sûr inclusif : un possible sentiment d’abandon généralisé pourrait rendre inaccessible une transition pourtant à la fois accessible, nécessaire et génératrice de progrès.
Alain Grandjean
Notes
[1] Célèbre phrase prononcée par Winston Churchill dans son premier discours devant la Chambre des communes (13 mai 1940), après sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale.
[2] On appelle actifs échoués, « stranded assets » en anglais, les actifs (usines, infrastructures, bâtiments, centrales de production) qui devront fermer avant leur fin de vie économique, que ce soit pour des raisons de régulation (ex. : décision politique de sortir du charbon) ou en raison de destructions anticipables (ex. : infrastructures et bâtiments construits dans des zones devenues inondables du fait de la montée du niveau des océans).
[3] Voir Köberle, A.C., Vandyck, T., Guivarch, C. et al. The cost of mitigation revisited. Nat. Clim. Chang. 11, 1035–1045 (2021).
[4] Voir : L’impasse de la compétitivité, Benjamin Brice, Éditions les liens qui libèrent, 2023 et la tribune « Et si la sobriété devenait le moteur de l’économie », parue dans le journal la Tribune.
[5] Les décisions prises par les banques centrales sont politiques par essence même si elles sont déléguées à une gestion indépendante des gouvernements élus. Il serait vraiment faux de croire qu’elles sont techniques et dictées par des lois économiques indiscutables. Les banques centrales ont inondé de liquidités les marchés financiers et haussent les taux d’intérêt maintenant, alors que l’inflation n’a rien de monétaire. Rien ne les y contraint, sauf des théories dépassées. Voir la fiche sur les liens entre monnaie et inflation sur la plateforme The Other Economy
[6] Les expressions courantes « telle entreprise a brûlé du cash », « l’argent lui brûle les doigts », donnent à penser que, sorti de la poche ou d’un compte bancaire, l’argent disparaît. Il n’en est évidemment rien : il se retrouve dans une autre poche ou dans autre compte bancaire.
The post La transition climatique : une bonne affaire au plan économique ! appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
11.10.2023 à 17:52
Changement climatique : nos efforts sont-ils vains ?
Alain Grandjean
Les climatologues nous alertent sur le fait que les actions menées au niveau mondial (et en France également) sont très insuffisantes pour respecter les engagements pris à Paris, lors de la COP21 pour contenir la hausse de la température mondiale bien au-dessous de 2°C par rapport à ce qu’elle était au milieu du XIX°siècle. Pour […]
The post Changement climatique : nos efforts sont-ils vains ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (2924 mots)
Les climatologues nous alertent sur le fait que les actions menées au niveau mondial (et en France également) sont très insuffisantes pour respecter les engagements pris à Paris, lors de la COP21 pour contenir la hausse de la température mondiale bien au-dessous de 2°C par rapport à ce qu’elle était au milieu du XIX°siècle. Pour autant ces efforts sont-ils vains ? On pourrait le croire en pensant aux événements extrêmes qui se sont produits cet été, aux records de température battus une fois de plus, à la relance du charbon en Chine et de l’exploration pétrolière partout dans le monde ou aux atermoiements des dirigeants politiques. Nous allons voir que c’est faux : les efforts passés et présents infléchissent nos émissions de CO2 -par rapport à l’absence d’effort – même s’il est nécessaire de les amplifier drastiquement pour contenir la dérive climatique.
Prétendre l’inverse en confondant insuffisance d’efforts avec absence d’efforts est non seulement inexact mais dangereux. Prétendre que le changement climatique est soit un faux-problème, soit un problème que la technique va résoudre spontanément, soit un problème insoluble conduit dans les trois cas à ne rien faire. Le déni climato-sceptique (ou climatodénialiste[1]), le techno-optimisme (consistant à croire que la technologie va nous sauver[2]) et le catastrophisme sont les meilleurs alliés de l’inaction climatique.
Il est d’autant plus important de ne pas décourager l’action contre la dérive climatique que la bataille se durcit au moment où l’on « rentre dans le dur ». Il est clair que limiter le réchauffement du climat ne fera pas que des gagnants. Comme le fait remarquer le climatologue Michael Mann : « Les pollueurs se sont donc tournés vers d’autres tactiques et, ironiquement, l’une d’entre elles a été le pessimisme. S’ils peuvent nous convaincre qu’il est trop tard pour faire quoi que ce soit, alors pourquoi le faire ? » [3]
Insistons sur un point. Constater comme nous allons le faire que des actions ont été menées et qu’elles ont eu des effets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ne doit pas être assimilé à une de ces manœuvres « rassuristes» utilisées par les climatodénialistes qui visent à minimiser les impacts du changement climatiques, donc l’ampleur des changements à effectuer pour les réduire.
Mais comment savoir si nos efforts sont utiles ?
Cet article a été inspiré par la lecture du post de Loïc Giaccone : COPs et concentration de CO2 : la gouvernance climatique est-elle vraiment inutile ?, blog Climat & Anthropocène (2022). Il est paru sous une forme légèrement modifié dans le journal l’Opinion Alain Grandjean: «Changement climatique: pourquoi nos efforts ne sont pas vains » (11/10/23)
1/ D’abord il est utile de se rappeler que nos efforts existent !
Citons quelques extraits du rapport annuel 2023 du Haut conseil pour le climat (p.161) :
« Plus de 3 145 lois climatiques sont en place au niveau mondial, comparé à 1 800 en 2020, tous les pays en ont au moins une. Les politiques publiques ont permis d’éviter d’émettre plusieurs milliards de tonnes de équivalent-CO2 par an[4] »
« Les États-Unis ont voté une loi sur la réduction de l’inflation (« Inflation Reduction Act » ; IRA) en août 2022 visant à soutenir la transition vers la neutralité carbone en injectant 370 Mrd$ (340 Mrd€) de fonds dans les 5-10 prochaines années vers l’innovation et la diffusion des technologies et infrastructures nécessaires à la transition, telles les énergies renouvelables, les batteries, l’hydrogène vert, le nucléaire, et la capture du carbone. Ces investissements, en plus de ceux soutenus par la loi sur les investissements pour les infrastructures et l’emploi, permettraient de réduire les émissions des États-Unis de 37-41 % en 2030 par rapport à leur niveau de 2005[5], pour un objectif de réduction de 50-52 %. »
« L’Union européenne (UE) a adopté la majeure partie des textes réglementaires du paquet « Fit for 55 » dans le cadre du Pacte vert Européen (…). »
En pratique, au sein de l’Union européenne la production d’électricité à base de charbon ne cesse de décroitre comme le montre le graphique suivant.
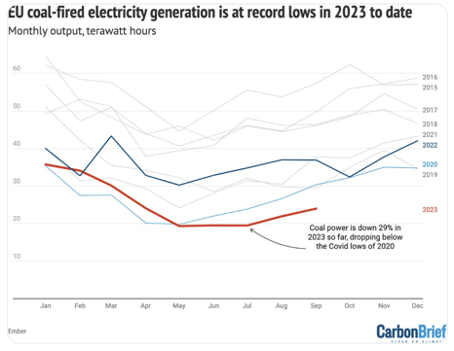
On peut prendre d’autres exemples. Celui du développement des pompes à chaleur dans les pays nordiques qui a contribué à une réduction des émissions de CO2 liées au chauffage dans les 30 dernières années de 72% en Finlande, 83% en Norvège et de 95% en Suède[6]. Si elles n’avaient pas été mises en place, il est certain que les émissions auraient été supérieures.
Les effets totaux des mesures prises ne sont pas faciles à estimer : il faut fabriquer un scénario dit « contrefactuel » qui « refait l’histoire ». Que ce serait-il passé en l’absence de mesures et toutes autres choses égales par ailleurs.
Voici ce que donne cet exercice de pensée fait par Eskander & Fankhauser (2020) qui ont calculé la réduction des émissions liée à la mise en place de politiques climatiques nationales entre 1999 et 2016, soit juste après la signature de l’accord de Paris. Leurs résultats indiquent une réduction, insuffisante bien sûr, mais tout de même significative, des émissions, de CO2.
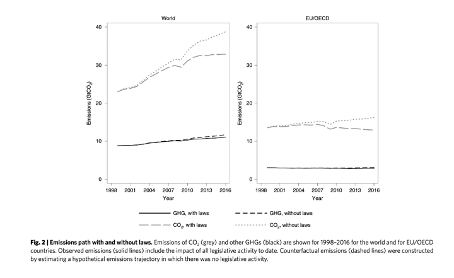
Source : Eskander & Fankhauser Reduction in greenhouse gas emissions from national climate legislation, Nature Climat Change (2020)
2/ Les baisses d’émissions se constatent dans certains pays et les émissions globales s’infléchissent.
Au moins 18 pays, dont la France, ont vu leurs émissions diminuer depuis au moins dix ans.[7]
Il n’y a pas de doute que si ces diminutions n’avaient pas eu lieu, les émissions seraient supérieures si on peut s’autoriser cette lapalissade.
Dans une récente tribune, l’économiste Antonin Pottier montre l’absurdité de l’argument selon lequel la France ne représentant que 1% des émissions de GES agir ne servirait à rien. Il écrit notamment : « La réduction des émissions des GES n’est pas une action tout ou rien, il n’y a pas des grosses actions utiles d’un côté et des petites actions inutiles de l’autre. Il y a surtout une série de petites réductions des émissions, qui chacune paraissent insignifiantes mais qui, additionnées les unes aux autres, finissent par atteindre l’objectif. »
On peut voir dans le graphique suivant, dû à Zeke Hausfather et Glen Peters que les émissions mondiales qui croissaient au rythme d’un scénario RCP 8.5 (le scénario « le plus réchauffant » parmi ceux qu’étudie le GIEC) en ont décroché depuis environ 2015. Dit autrement le scenario RCP 8.5 qui semblait être le scénario « tendanciel » au début des années 2010 ne l’est plus.
A l’inverse, ce même graphique montre également, comme dit en introduction, que nous sommes loin d’être sur une trajectoire 1,5°-2° RCP 2.6).
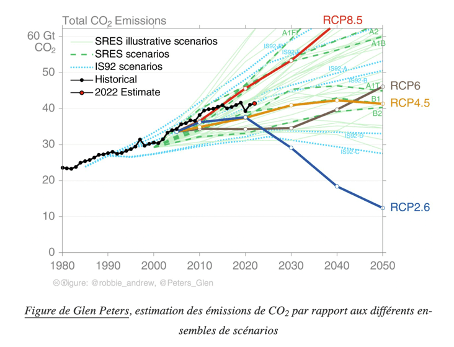
Source : Zeke Hausfather & Glen P. Peters, Emissions – the ‘business as usual’ story is misleading, Nature (2020)
3/ Les projections montrent que la croissance des concentrations de CO2 peut ralentir grâce à nos efforts.
Jusqu’ ici nous n’avons parlé que des émissions de gaz à effet de serre, or le vrai juge de paix ce sont les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre : c’est de leur évolution que dépend le changement climatique.
Cette concentration[8] ne cesse de croitre et, pire encore, elle s’accélère[9] ce qui pourrait donner à penser que nos efforts ont été inutiles.
Une telle conclusion repose sur une double erreur :
- d’une part si on ne les avait pas faits, il est clair que la concentration serait plus élevée. La concentration de CO2 continue à augmenter tant que nos émissions mondiales nettes sont positives ; même si elles baissaient rapidement, la concentration continuerait donc à augmenter.
- d’autre part, les émissions mondiales sont en ce moment de l’ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 alors que la quantité de CO2 dans l’atmosphère est de 3200 milliards de tonnes : réduire en un an ces émissions de quelques milliards de tonnes, ce qui est difficile, ne se voit quasiment pas sur la concentration de CO2.
On peut illustrer ce phénomène en mettant côte à côte deux courbes de projection élaborées par Richard Betts et al qui permettent de visualiser comment s’infléchirait la concentration deCO2 dans un scénario 1, 5° C qui suppose une baisse drastique des émissions :
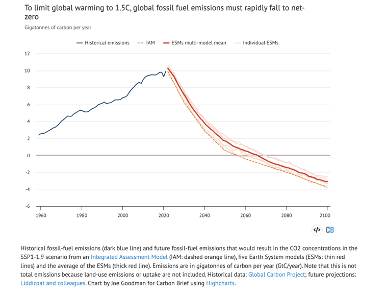
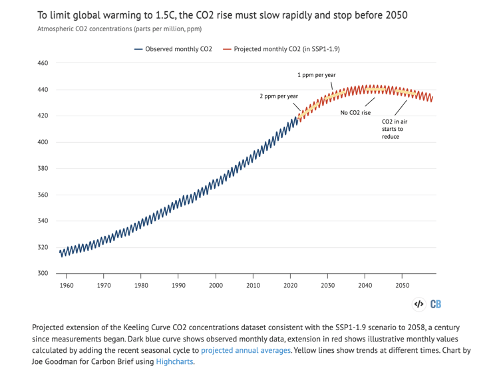
Source : How the Keeling Curve will need to bend to limit global warming to 1.5C, Prof Richard Betts et Al. Carbon Brief (2022)
La concentration actuelle de CO2 n’est pas un bon « juge de paix », c’est la concentration future qui le sera.
Conclusion
La lutte contre le changement climatique est un défi immense. Nous ne sommes pas allés assez vite et nous allons devoir nous organiser face à un changement que nous ne pouvons plus éviter. Mais il est faux et dangereux d’affirmer que nous n’avons pas agi ou que ces actions ont été inutiles. De nombreuses actions ont été menées par les entreprises, les gouvernements, les citoyens qui se matérialisent dans les données et projections chiffrées disponibles. A l’inverse, leur insuffisance est bien documentée. Nous devons passer à la vitesse supérieure et modifier en profondeur nos modes de production et de consommation. Mais les progrès réalisés doivent nous encourager : l’action paie.
Alain Grandjean
Notes
[1] Le scepticisme est plutôt une vertu fréquente dans le monde scientifique qui consiste à être circonspect et à ne pas croire sans examen critique une affirmation. Le changement climatique en cours et sa cause (les émissions anthropiques de GES) ont fait l’objet de ces examens critiques pendant des décennies d’un travail acharné de la communauté scientifique concernée. Ne pas le reconnaître n’est pas faire preuve de scepticisme mais de déni de réalité….
[2] La technique a sa part dans la résolution du problème (via l’efficacité énergétique, les PAC, les batteries, les EnR, les moyens de locomotion électriques, etc.) mais d’une part les choix techniques doivent être faits avec discernement et d’autre part ils ne suffiront pas : les plus aisés des habitants de cette planète devront faire preuve de sobriété. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles croire que la technologie va nous sauver est une illusion voir les articles suivants sur la plateforme The Other Economy : « La technologie va nous sauver ! » ; La révolution numérique serait l’alliée de la transition écologique ; La croissance verte fondée sur le progrès et l’innovation technique serait la voie de la transition écologique
[3] Extrait issu de l’article « Nous ne sommes pas encore condamnés » : le climatologue Michael Mann parle de notre dernière chance de sauver la civilisation humaine (2023). Michael Mann est un célèbre climatologue, luttant contre le fatalisme. Il vient de sortir le livre Our Fragile Moment. How Lessons from Earth’s Past Can Help Us Survive the Climate Crisis, PublicAffairs (2023). Voir la vidéo de présentation du livre sur Youtube (4,5 mn).
[4] Eskander, S.M.S.U., Fankhauser, S. (2020) « Reduction in greenhouse gas emissions from national climate legislation »; voir aussi le site Climate laws
[5] Jenkins et al. (2023) Preview: Final REPEAT Project Findings on the Emissions Impacts of the Inflation Reduction Act and Infrastructure Investment and Jobs Act
[6] How heat pumps became a Nordic success story, Jan Rosenow, Carbon Brief (2023). A noter que les pompes à chaleur ne peuvent déployer leur plein potentiel que dans des bâtiments correctement isolés.
[7] Voir Drivers of declining CO2 emissions in 18 developed economies Corinne Le Quéré et al. Nature climate change. VOL 9 | MARCH 2019 | 213–217.
[8] Le groupe 1 du GIEC, indique que le niveau de la concentration de CO2 est le plus élevé depuis 2 millions d’années.
[9] Elle est passée de 1ppm par an dans les années 1960 à 1,5 ppm dans les années 1980, à 2ppm dans les années 2000 puis à 2,5 dans les années 2010.
The post Changement climatique : nos efforts sont-ils vains ? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
25.08.2023 à 17:31
La rémunération du capital dans les entreprises de l’Économie sociale et solidaire.
Alain Grandjean
L’économie sociale et solidaire (ESS)[1] rassemble les entreprises organisées sous forme de coopératives, banques et sociétés d’assurances mutualistes[2], mutuelles, associations ou fondations, et les sociétés commerciales qui remplissent un certain nombre de critères fixés dans la loi[3] qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. D’après l’observatoire national de l’ESS, elle représenterait près de […]
The post La rémunération du capital dans les entreprises de l’Économie sociale et solidaire. appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (3278 mots)
L’économie sociale et solidaire (ESS)[1] rassemble les entreprises organisées sous forme de coopératives, banques et sociétés d’assurances mutualistes[2], mutuelles, associations ou fondations, et les sociétés commerciales qui remplissent un certain nombre de critères fixés dans la loi[3] qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. D’après l’observatoire national de l’ESS, elle représenterait près de 165 000 unités légales employeuses (principalement des associations), 2,4 millions de salariés, soit 10,5% de l’emploi salarié en France (et 14% de l’emploi salarié privé) et 12 millions de bénévoles. Le ministère de l’économie indique quant à lui que l’ESS contribuerait au PIB à hauteur de 10 %[4]. Les trois piliers partagés des formes de l’ESS sont la gouvernance participative ou démocratique, la poursuite d’un projet d’utilité sociale et une lucrativité encadrée (limitée ou interdite). Dans cet article, nous nous penchons plus spécifiquement sur ce troisième pilier : en quoi consiste cette lucrativité encadrée ?
1. Comment sont rémunérés les apporteurs de capital d’une société capitaliste « normale » ?
Le terme capital a des sens différents selon le contexte où il est employé[5]. Nous nous intéressons ici au capital au sens comptable du terme : c’est-à-dire les ressources de l’entreprise apportées par les investisseurs se matérialisant sous la forme d’action.
Lors de la création d’une entreprise, les fondateurs apportent des ressources (le plus souvent sous forme monétaire mais cela peut aussi consister en biens ou en nature) : c’est le capital social de l’entreprise. Celui-ci est ensuite divisé en titres financiers (les actions) et chaque apporteur de capital (actionnaire, ou associé, ou sociétaire) en reçoit un nombre fonction de son apport initial. Ces actions peuvent ensuite être vendues (soit sur un marché si la société est cotée en bourse, soit à d’autres investisseurs).
Au cours de la vie de la société, ses dirigeants peuvent demander aux actionnaires initiaux de réinvestir ou alors faire appel à de nouveaux investisseurs : de nouvelles actions sont alors créées.
Les apporteurs de capitaux peuvent se rémunérer de deux façons différentes :
- Si l’entreprise fait des bénéfices, les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent décider de se reverser tout ou partie de ces montants sous forme de dividendes.
- Les actions peuvent prendre de la valeur (parce que l’entreprise a de bons résultats financiers, parce qu’elle est dans un secteur porteur, parce que les marchés sont globalement orientés à la hausse) et donc générer une plus-value pour les actionnaires s’ils décident de les vendre (que ce soit sur une bourse pour les entreprises cotées, ou dans le cadre d’accords bilatéraux pour les entreprises non cotées).
2. Que signifie la lucrativité limitée d’une structure de l’ESS ?
Ce terme recouvre deux significations :
D’une part, les bénéfices (ou excédents) éventuels d’une structure de l’ESS doivent être prioritairement réinvestis dans la structure elle-même[6] (et consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de son activité) et/ou partagés avec les salariés. Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Pour les sociétés, la distribution de dividendes[7] est soit accessoire soit interdite. En cas de liquidation (ou, le cas échéant, de dissolution), l’ensemble du « boni de liquidation[8] » doit être redistribué à une autre structure de l’économie sociale et solidaire.
D’autre part, les apporteurs de fonds propres (que ce soit lors de la création ou au cours de la vie d’une structure de l’ESS) ne peuvent espérer un accroissement de la valeur de ces fonds ; ils ne peuvent donc s’enrichir du fait de ces apports. C’est évident dans le cas des associations et des fondations qui n’émettent pas de parts sociales et ne sont la propriété de personnes, les fonds apportés étant l’équivalent de dons[9]. Pour les mutuelles (qui sont des sociétés de personnes) l’apport se fait via des cotisations ; les mutuelles sont incessibles (c’est pour cela qu’on assiste essentiellement à des fusions dans ce secteur). Il est donc impossible de récupérer les fonds. Enfin, dans les coopératives[10] les banques et assurances mutualistes et les sociétés commerciales, l’apport de fonds se fait en contrepartie de parts sociales ou d’actions qui peuvent être revendues dans des conditions définies et très généralement sans pouvoir faire l’objet de plus-value.
Tableau récapitulatif des modalités d’encadrement de la lucrativité selon les types de structures
|
|
Versement des excédents éventuels |
Cessibilité des parts sociales (ou assimilées) |
Revalorisation des parts sociales (ou assimilées) |
|
Coopératives en règle générale |
Rémunération des parts sociales possible, n’excédant pas le taux de rendement des obligations privées fixé annuellement par l’État (TMO) majoré de 2 points et après mise en réserve obligatoire d’au moins 15 % du résultat. Possibilité de « ristournes » [11] coopératives. |
Oui si agrément [12] |
Cession à la valeur d’achat en général avec des exceptions [13] |
|
SCIC |
57,5% minimum aux réserves « impartageables » Solde peut être versé aux actionnaires (avec un plafond et en respectant la règle ci-avant) |
Cf ci-dessus |
non |
|
SCOP |
-Part travail (= ristourne) minimum de 25% (en pratique 40 à 45%) -Part entreprise minimum de 16% (en pratique 40 à 45%) -Le solde peut être versé aux actionnaires |
Cf ci-dessus |
non |
|
Associations/Fondations |
Les bénéfices quand il y en a sont intégralement mis en réserve |
La cession de fonds à une association ou une fondation ne donne pas lieu à l’émission d’actions ou de parts sociales. Cependant un droit de reprise des fonds peut être prévu. |
NA |
|
Banques mutualistes |
Excédents financiers majoritairement mis en réserve. Rémunération plafonnée au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) majoré de deux points.[14] |
oui |
Remboursement au prix initial |
|
Sociétés d’assurance mutualiste |
Excédents financiers majoritairement mis en réserve. Peuvent être redistribués aux sociétaires sous forme de ristournes ou de réductions de primes d’assurance. |
Oui |
Remboursement au prix initial |
|
Les mutuelles[15] |
Les excédents sont entièrement réinvestis. |
NA |
NA |
Quelles sont les conséquences de cette lucrativité limitée ?
Dans tous les cas, les structures de l’ESS ne peuvent pas conduire à l’accumulation du capital de leurs fondateurs et successeurs. En général, elles ne rémunèrent pas le capital apporté et ne garantissent pas le maintien de sa valeur : en effet, le rachat au nominal (c’est-à-dire au prix initial), quand il est possible, ne compense pas la perte liée à l’inflation. Un calcul élémentaire montre ainsi qu’a priori l’apport de capital se fait à pertes[16]. En revanche, dans le cas des coopératives, les gains liés à la position de coopérateur peuvent surcompenser dans certains cas ces pertes en capital.
Cette contrainte a une contrepartie positive en cela qu’elle permet une forme de sécurisation et de pérennisation des structures de l’ESS qui sont protégées des cessions et autres restructurations liées aux opérations « capitalistiques » (c’est-à-dire ayant pour objet principale de dégager de la valeur pour les actionnaires ou propriétaires de parts sociales).
Cependant, cela signifie également que ces structures ne peuvent attirer de manière massive l’épargne des ménages ; elles ne rémunèrent ni le risque, ni la privation de l’usage de l’argent placé (et la préférence pour le présent de la plupart des épargnants), ni le coût d’opportunité (le gain lié aux options alternatives). Elles peuvent uniquement offrir des rendements limités pour les sociétaires[17] les coopérateurs[18]. Ces structures relèvent donc fondamentalement d’une forme de capital très patient[19],de dons et des subventions à même d’assumer une partie des risques.
Notons que ce constat ne veut pas dire que ces structures ne soient pas capables d’investissements ni de développement, comme le montre par exemple le cas des sociétés d’assurance mutualistes ou de certaines coopératives agricoles. En plus des apporteurs de fonds propres, elles peuvent être financés[20] par autofinancement, par emprunts, dons ou subventions.
Mais ce développement ne sera simplement pas au profit des apporteurs de capitaux. Les principes régissant le partage de la valeur dans l’ESS semblent privilégier d’une part la qualité d’usager sur celle d’apporteur de capitaux (avec notamment la « double qualité » des sociétaires ou coopérateurs qui sont à la fois apporteurs de capitaux et usagers) et d’autre part la continuité de la structure sur l’enrichissement de l’apporteur de capitaux.
La logique de l’ESS, au plan financier, est donc bien orthogonale à celle des sociétés capitalistes.
Ce n’est pas le cas du deuxième pilier (utilité sociale) qu’on peut trouver dans les entreprises à mission ou à impact positif et pour le premier (la gouvernance) cela peut se discuter : les gouvernances « capitalistes » peuvent être plus ou moins participatives (à défaut d’être démocratiques) et celles de l’ESS peuvent être en pratique moins démocratiques qu’elles ne devraient l’être en théorie.
Alain Grandjean
Notes
[1] La loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 a renouvelé le cadre juridique de l’ESS.
[2] Les banques et sociétés d’assurance mutualistes sont soumises au régulateur (l’ACPR) qui impose des règles spécifiques et en assure le contrôle.
[3] Ces conditions sont fixées dans l’article 1 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014. Il peut s’agir par exemple des entreprises adaptées (AE), des services d’aides par le travail ESAT, des structures d’insertion par l’activité économique(SIAE) et des structures bénéficiant de l’agrément ESUS (entreprise solidaire à utilité sociale).
[4] Ce chiffre est cependant assez largement contesté d’une part car il ne repose sur aucune source et d’autre part car comme le PIB lui-même il ne tient absolument pas compte des contributions que les 12 millions de bénévoles apportent à l’économie.
[5] Pour en savoir sur les différentes significations du mot capital voir la fiche dédiée sur la plateforme The Other Economy.
[6] La loi de 2014 sur l’ESS (art. 1) a posé la limite suivante à la redistribution de bénéfices pour les sociétés commerciales : au moins 50 % des bénéfices (après imputation des pertes antérieures) doit alimenter le report bénéficiaire et les réserves obligatoires.
[7] A noter que dans tous les cas, les entreprises de l’ESS ne peuvent ni amortir leur capital ni procéder à une réduction de celui-ci non motivée par des pertes, sauf si cela assure la continuité de l’activité. On sait que la réduction du capital est pour les entreprises capitalistes une manière déguisée de distribuer des dividendes.
[8] Un boni de liquidation est un paiement effectué aux actionnaires lorsqu’une entreprise liquide ses actifs. Une fois les dettes remboursées, les recettes sont ainsi partagées par les actionnaires. Autrement dit, il s’agit de la somme distribuée aux actionnaires à la fin du processus de liquidation.
[9] Un droit de reprise des fonds apportés peut cependant être prévu.
[10] Le cas des coopératives est le plus diversifié. Il existe trois types de coopératives : coopératives d’entrepreneurs (agricoles, artisans, transports, commerçants, etc.), d’usagers (banques, consommateurs, etc.), de salariés (Scop, Scic).
[11] Une « ristourne» est un montant qui est affecté aux coopérateurs (ou aux sociétaires pour les assurances mutualistes) si les « excédents » sont suffisants ; cette ristourne ne dépend pas du montant du capital apporté mais est fonction de l’usage des services de la coopérative par les coopérateurs.
[12] Une clause d’agrément dans les statuts, obligatoire pour les coopératives, signifie que la cession à des tiers non associés n’est possible qu’avec l’accord des associés.
[13] Voir l’article La cession de parts sociales dans les sociétés coopératives : oui, mais à quel prix ? Trinity avocats (2015)
[14] Voir l’article Les parts sociales des banques mutualistes sur le site La finance pour tous
[15] Voir le site de la mutualité française
[16] Le calcul est fait dans l’article L’évaluation financière des coopératives modernes, Revue Française de Gestion, Patrick Sentis (2014), pour le cas des coopératives, mais il est instantanément généralisable
[17] Les sociétés mutualistes ont le droit d’émettre des « certificats mutualistes » dénués de droits de vote, qui peuvent offrir une rémunération limitée mais pas de perspectives de plus-values.
[18] La loi de modernisation des coopératives du 13 juillet 1992 autorise les coopératives à émettre différentes catégories de parts sociales :
– des parts ordinaires, comportant ou non le droit à un intérêt ;
-des parts à avantages particuliers (intérêt plus élevé que les parts ordinaires, remboursement prioritaire, imputation réduite en cas de pertes). Elles sont librement négociables entre associés mais les restrictions sur leur cession interdisent de les qualifier de valeurs mobilières ;
-des parts à intérêt prioritaire (à droit de vote suspendu), dont la souscription est réservée aux associés non usagers ou même à des tiers non associés, garantissant un intérêt statutaire prioritaire.
Elles peuvent également émettre, mais uniquement si elles ont la forme de société anonyme, des titres de capital dits certificats coopératifs d’investissement, qui sont les seuls titres de capital des coopératives reconnus par la loi comme des valeurs mobilières.
[19] Voir la thèse de Kristina Rasolonoromalaza, Recherche sur le droit du financement des entreprises sociales et solidaires. 2018
[20] Voir l’article Financements dédiés aux projets de l’Économie sociale et solidaire (ESS) sur le site BPI France
The post La rémunération du capital dans les entreprises de l’Économie sociale et solidaire. appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
25.07.2023 à 18:01
Faut-il sortir du capitalisme pour sauver la planète?
Alain Grandjean
La capacité de destruction des écosystèmes et de déstabilisation des régulations naturelles par l’humanité est née avec la révolution thermo-industrielle et s’est accrue dans un monde largement capitaliste. Si l’Union internationale des sciences géologiques statue sur la création d’une nouvelle époque géologique, l’anthropocène, sa date de démarrage se situera probablement autour de 1950, date du […]
The post Faut-il sortir du capitalisme pour sauver la planète? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (3776 mots)
La capacité de destruction des écosystèmes et de déstabilisation des régulations naturelles par l’humanité est née avec la révolution thermo-industrielle et s’est accrue dans un monde largement capitaliste. Si l’Union internationale des sciences géologiques statue sur la création d’une nouvelle époque géologique, l’anthropocène, sa date de démarrage se situera probablement autour de 1950, date du début de la « grande accélération »[1]. Andréas Malm propose de nommer cette période capitalocène et non anthropocène pour bien marquer l’idée que ce ne serait pas notre espèce biologique qui serait en cause, mais un système socio-économique spécifique : le capitalisme. Coïncidence temporelle n’est pas causalité et le débat sur la ou les causes de la destruction en cours du vivant n’est pas clos. De mon côté, je pense que l’émergence de l’anthropocène est liée à une révolution de nature anthropologique qui s’est produite au XVII° s. en même temps que la révolution scientifique moderne : c’est le basculement de l’Occident vers l’adoption de valeurs de transgression des limites (j’appelle cela la « culture no limit » ) qui se généralisent à toutes les civilisations[2]. Le capitalisme n’aurait pas émergé sans cette révolution culturelle, et il l’a entretenue. Il est clair aussi que sa puissance et son efficacité, liées à celle de la démarche scientifique, ont une responsabilité majeure dans la crise actuelle. Peut-on faire la part des choses ? Peut-on répondre à la question posée dans le titre de ce billet, et en conséquence se poser les bonnes questions, celles relatives aux mesures essentielles à prendre maintenant pour sortir de la crise écologique et sociale ? Il ne s’agit pas ici d’imaginer un système économique idéal dans l’abstrait, sans rapport avec l’urgence de la situation mais bien d’identifier les leviers à mobiliser et les actions à amplifier et accélérer.
1. Qu’est-ce que le capitalisme ?
Le terme capitalisme est associé à de nombreux affects (il peut être repoussoir ou l’objet d’idolâtrie) et il n’est pas facile à définir. Mais il est important de tenter une définition pour discerner au mieux ce qu’il faut changer aujourd’hui.
Le capitalisme est un système socio-économique dans lequel une partie (généralement majoritaire mais cette part peut varier fortement) des moyens de production est la propriété de « sociétés » à capitaux financiers majoritairement privés[3] qui en attendent rémunération (à plus ou moins long terme).
Ce système repose d’une part sur l’organisation (par la puissance publique, dont le rôle est essentiel dans la formation des institutions nécessaires au fonctionnement du capitalisme) de marchés, d’institutions garantissant le droit de la propriété et de ses limites, et d’autre part sur toute une série d’innovations juridiques, comptables et financières qui se sont produites depuis le XI°s[4].
Le pouvoir de décision dans les entreprises à capitaux privés est réparti entre les représentants de ces capitaux (qui veillent en priorité à leur propre intérêt, celui de valoriser et d’accumuler du capital) et ceux des autres parties prenantes (dont les employés) selon des modalités variables[5] dans le temps et l’espace. Notons que si l’accumulation du capital est pour les actionnaires un moteur évident, cela ne veut pas dire que cette accumulation se fasse fatalement au détriment de la nature et des autres agents économiques : en particulier on pourrait conditionner les bénéfices réalisés à la juste prise en compte des effets sur le « capital naturel » et le « capital social ». C’est ce que tentent de faire les comptabilités en multiples capitaux[6].
Le bon fonctionnement du capitalisme implique de clarifier, préciser et limiter les prises de risque, les responsabilités, les rétributions et les sanctions (civiles ou pénales) associées, des parties prenantes au projet concerné dont celles des actionnaires. On peut s’étonner d’ailleurs que la responsabilité des actionnaires soit limitée[7] dans les Sociétés Anonymes. Elle pourrait ne pas l’être, notamment au regard des effets de l’activité des dites sociétés sur les parties prenantes et la nature, et suite à la prise de conscience qui a conduit par exemple à la notion et au droit européen en matière de devoir de vigilance).
Le capitalisme permet de séparer[8] les apports en capital (financier) et en travail et de rémunérer de manière spécifique ces apporteurs ; la question de la juste répartition entre ces rémunérations dépend de rapports de force et aussi de décisions publiques (en termes de droits du travail, des sociétés et des affaires, de limitations des périmètres d’agissements des entreprises (lois anti-concentration, réglementations spécifiques à de nombreuses activités, limitations au commerce international, fiscalité, etc.).
Pour conclure cette tentative de définition, insistons sur deux constats.
1/ Le capitalisme ne peut se passer de la puissance publique qui non seulement en est un régulateur mais surtout le rend possible ;
2/ Le capitalisme a pris de nombreuses formes en fonction du poids relatif de la puissance publique et des entreprises privées, et de la financiarisation de l’économie.
2. Quels sont les apports/vertus du capitalisme ?
Le capitalisme a plusieurs vertus :
1/ Il permet d’organiser de manière assez précise, variée et évolutive (au gré des attentes sociales et individuelles) à la fois les rapports de pouvoir (et les désirs / besoins de pouvoir comme…de soumission) et d’argent au sein de collectifs petits ou grands grâce à des outils juridiques solides ; dès lors, il peut mobiliser des capitaux de manière massive ;
2/ Il permet d’aligner des intérêts (ceux des diverses parties prenantes à l’entreprise) notamment grâce à une comptabilité universellement définie -et évolutive – et un droit sophistiqué, adaptée à cet objectif ;
Ces deux premières « vertus » rendent le capitalisme très efficace (au sens d’aptitude à atteindre des objectifs en limitant les moyens humains et financiers).
3/ Il permet par la focalisation des entreprises sur leur raison sociale de produire des biens et services adaptés aux attentes variées de leurs clients et de leurs désirs, versatiles et évolutifs ;
4/ En tant que système d’ensemble, il permet la cohabitation d’entreprises à capitaux et d’entreprises de personnes comme celles de l’Économie Sociale et Solidaire, et de modèles de gouvernance multiples;
5/ Il permet de mobiliser l’épargne disponible vers des projets qui ont besoin de capitaux et, si besoin est, de créer des financements nouveaux (par les prêts bancaires et la création monétaire);
6/ Il permet l’innovation, la capitalisation de savoir-faire et les progrès individuels et collectifs, ce qui correspond à une attente fondamentale de l’être humain ;
7/ Il rend possible (mais pas nécessaire comme le montre le cas de la Chine) la séparation des pouvoirs économiques et politiques, conditions nécessaires à la liberté de chacun.
3. Quels sont les impacts négatifs du capitalisme dans sa forme actuelle?
Le capitalisme, dans sa forme actuelle (mondialisée et financiarisée), génère des impacts négatifs, d’autant plus importants que c’est un système efficace[9], et qui peuvent devenir catastrophiques voire conduire à son effondrement si des correctifs puissants ne sont pas mis en place rapidement:
1/ Il exerce une pression excessive, et potentiellement létale, sur les écosystèmes et l’ensemble des régulations naturelles ;
2/ Il contribue à la croissance des inégalités entre les humains (qu’elles soient de revenu, de patrimoine, de genre, de géographie, liées à l’origine familiale et patrimoniale, etc.) ;
3/ Il contribue à la « privatisation du monde » et à transformer le temps et les biens communs en marchandises ;
4/ Il a conduit à des concentrations excessives dans de nombreux secteurs (énergie, numérique, médicament, agro-alimentaire etc.). La domination exercée par quelques très grosses entreprises dans des secteurs vitaux ou stratégique met en risque la démocratie et rend très difficiles la mise en œuvre de régulations (environnementales et sociales) assez fortes ;
5/ Il contribue à faire de l’argent la valeur suprême, ce qui a des effets culturels délétères profonds et dévalorise la gratuité, le don, l’amour et les rapports humains fraternels « désintéressés » ;
6/ Il est aveugle au long terme (tragédie des horizons).
|
Le capitalisme au service des machines : un fait historique mais pas une fatalité. Le capitalisme a permis l’allocation du capital financier (issu de l’épargne et du crédit) au capital physique (les machines, les bâtiments, les infrastructures) ; la révolution thermo industrielle et le développement de l’économie depuis trois siècles ont nécessité et continuent à nécessiter des investissements considérables dans l’extraction et la transformation des énergies fossiles, leur transformation, les infrastructures, les usines de production et leurs équipements, les moyens de transport des marchandises et des personnes etc. Le capitalisme permet de financer ces investissements de manière efficace. Le pouvoir dominant des apporteurs de capitaux sur les entreprises, les a conduit à privilégier l’accumulation du capital physique et réduire la part des salaires dans la valeur ajoutée ce qui a permis des gains de productivité extraordinaires : les machines ont remplacé la main d’œuvre ou plus exactement lui ont permis à la fois d’être infiniment plus performante et un peu moins enchaînée au travail, du moins dans une large partie du monde. En même temps, la nécessité faite aux entreprises de vendre leurs produits à une clientèle solvable contraint les actionnaires à verser des salaires suffisants pour écouler ces produits mis en quantité phénoménale sur le marché par les machines et leurs assistants salariés. Cette ambivalence du capitalisme est un facteur clef de l’explication de son rôle dans la destruction de la nature, opérée essentiellement par nos machines qui sont sales et gourmandes en ressources énergétiques et naturelles et leurs produits dont la consommation génère également pollutions et destructions de ressources naturelles. Pour autant ce puissant mécanisme peut être mis au service de la planète : il peut financer les « capitaux physiques » (l’ensemble des équipements et dispositifs matériels) permettant la réparation des dégâts actuels et la capacité à produire sobre, propre et bas carbone. Il peut également financer les actifs incorporels permettant les indispensables transformations massives de la culture de consommation sans limite qui a été créée ex nihilo en quelques décennies. Cette mutation ne se fera pas spontanément par les seules forces de marché mais elle peut s’envisager pour autant que les règles du jeu édictées par la puissance publique soient adaptées à cette fin. |
4. Peut-on mettre le capitalisme au service de la planète ?
1/ Des investissements considérables sont à réaliser rapidement pour :
- rendre propres nos équipements, infrastructures et bâtiments (sans doute des centaines de milliards de tonnes cumulées);
- en détruire proprement certains et financer les pertes économiques associées ;
- nettoyer la planète (retirer le plastique des océans, dépolluer les sols…) quand c’est encore possible ‘ ;
- construire des équipements, infrastructures et bâtiments d’une part propres, sobres et bas-carbone et, d’autre part, adaptés au changement climatique à venir ;
- transformer profondément notre modèle agricole ainsi que la gestion des forêts ;
- rendre désirable une consommation sobre et bas-carbone (ce qui supposera des centaines de milliards d’euros de publicité[10]), outre le fait qu’il faudra également encadrer fortement la consommation qui ne peut que baisser pour les plus riches d’entre nous au niveau planétaire (les classes moyennes française étant donc incluses dans ce nous[11]) si l’on veut respecter les limites planétaires.
Il faut donc pouvoir mobiliser des capitaux considérables, ce qui est l’un des premiers atouts du capitalisme, comme indiqué plus haut. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas aussi recourir à la puissance publique ni à la force de frappe de la banque centrale et des banques publiques. Mais cela veut dire qu’il serait contre-productif de se passer des savoir-faire accumulés par les acteurs privés et de leur argent pour contribuer financièrement à cette « révolution ».
2/ Il n’y a pas de raison intrinsèque au capitalisme tel que défini pour qu’il ne puisse pas être transformé pour produire propre, sobre et bas-carbone.
Les leviers pour y arriver sont bien identifiés[12]. Il n’y a pas de raison pour que le capitalisme repose inéluctablement sur la croissance des flux matériels[13] et qu’il ne puisse pas au contraire, faciliter et stimuler leur décroissance. Mais bien sûr cela suppose une action publique forte et déterminée, comme par exemple une réelle planification écologique; cela ne peut provenir spontanément des forces du marché ni d’une action simplement incitative de l’État.
3/ Il n’y a pas non plus de raison pour que ce système ne puisse pas être beaucoup plus juste.
D’une part, les inégalités sociales ont été extrêmement fortes avant le capitalisme (elles ne sont donc pas dues à ce système) ; d’autre part elles ont beaucoup varié et varient beaucoup d’une forme à une autre du capitalisme. Enfin, les leviers sont connus (politique des revenus, fiscalité des revenus / patrimoine / succession, services publics de qualité etc.). Mais bien sûr, cela suppose également une action publique forte et déterminée, s’opposant à des forces du marché faisant spontanément croitre les inégalités.
A l’inverse, que veut dire concrètement sortir du capitalisme ? Et quelles sont les étapes et le calendrier pour y arriver ?
Conclusion
Aujourd’hui, la priorité de tous nos efforts doit être d’identifier les leviers les plus efficaces pour sortir de la crise majeure actuelle. Ce billet a tenté de montrer que la sortie du capitalisme n’est en rien un préalable et qu’il est sans doute plus utile de tenter de mettre le capitalisme – tel que défini ici – au service de la planète et de la réduction des inégalités sociales. Cela n’est pas contradictoire avec l’expérimentation de modèles nouveaux. Et cela ne veut pas dire qu’il faille conserver la forme qu’a prise le capitalisme dans les dernières décennies, bien au contraire. De nombreuses réformes sont à mener qui doivent conduire à des évolutions en profondeur des rapports. Mais ne nous trompons pas de combat. Le temps nous est compté.
Alain grandjean
Notes
[1] Voir Colin N. Waters et al (2023), Response to Merritts et al. (2023): The Anthropocene is complex. Defining it is not Earth-Science Reviews et la définition de la Grande Accélération sur Wikipedia
[2] Dont la caractéristique commune avant cette révolution est précisément la mise en place de régulations, morales ou physiques, éventuellement féroces pour que les humains dans leur quasi-totalité limitent leurs désirs à leurs possibilités et les acceptent, la seule exception étant bien sûr les dominants eux-mêmes (on devine le faste dans le quel devaient vivre les pharaons, et la misère qu’ils imposaient au peuple, pour ne prendre qu’un exemple).
[3] Dans les sociétés capitalistes contemporaines peuvent cohabiter des entreprise publiques, « mixtes » (à capitaux publics et privés) et des entreprises de l’ESS (Economie sociale et solidaire).
[4] Voir la fiche « Le capitalisme face aux limites planétaires » chapitre 3 C.
[5] Pour ne prendre qu’un exemple la codétermination – qui consiste en la participation, au sein du conseil d’administration ou de surveillance, de représentants désignés par les salariés- se fait selon des modalités très variables en Europe. Voir Christophe Clerc (2018) La codétermination : un modèle européen ?, Revue d’économie financière.
[6] Voir le module comptabilité de la plate-forme The Other Economy.
[7] Cette limitation, qui est apparue plutôt récemment dans l’histoire économique, a sans aucun doute été un facteur de dynamisme du capitalisme car elle facilite considérablement la prise de risque entrepreneuriale. Sur l’histoire de cette limitation voir Guillaume Vuillemey (2020), La responsabilité des actionnaire doit-elle toujours être limitée ?, Opinons & débats – Institut Louis Bachelier.
[8] La possibilité de cette séparation est essentielle et son intérêt souvent mal compris. Certains projets ont des besoins de capitaux considérables (qu’on pense aux infrastructures, aux usines, ou à la recherche de nouveaux médicaments) qui excèdent largement la capacité de financement des collaborateurs qui s’y engagent. Par ailleurs, dans le cadre d’une bonne gestion de risques il est utile pour chacun de pouvoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier de sorte que les revenus du travail, l’épargne et la constitution d’une retraite ne soient pas dépendantes de la même entreprise (le scandale ENRON…est illustratif de ce propos).
[9] La Chine communiste comme la Russie n’étaient pas tendres avec la nature ; mais la capacité de nuisance environnementale de la Chine, depuis qu’elle a adopté un capitalisme d’État, est sans commune mesure avec celle qu’elle avait quand elle était communiste.
[10] Les produits et services qui permettent à leurs consommateurs/ utilisateurs d’être sobres doivent être connus d’eux. Si la publicité a été mise au service du consumérisme et du « toujours plus », ce n’est pas une fatalité. Mais la mettre au service de la construction d’un monde propre, sobre et bas-carbone ne se fera ni facilement, ni spontanément et passera par une régulation bien plus ferme qu’aujourd’hui.
[11] Voir notre tribune parue dans le Monde : Compter sur les riches pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre ne suffira pas (21/09/22).
[12] C’est l’un des objets de la plateforme The Other Economy.
[13] L’idée selon laquelle le capitalisme repose intrinsèquement sur la croissance se discute ; ce système a résisté aux récessions, aux dépressions et aux guerres. Il est encore plus discutable de postuler qu’il repose sur la croissance des flux de matières. Le PIB peut croitre si la valeur des biens et services (donc les rémunérations des parties prenantes) croit ce qui peut provenir d’effets de qualité ou de rareté.
The post Faut-il sortir du capitalisme pour sauver la planète? appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
03.07.2023 à 15:40
Pour éviter un crime écologique de masse – Claude Henry
Alain Grandjean
Comment expliquer que les institutions et les bénéficiaires d’un ordre millénaire, cet Ancien Régime qui a duré jusqu’en 1789, n’aient pas étouffé la marche à la Révolution? Dans le Livre III de L’Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville décrit et analyse le fourmillement de visions nouvelles et d’initiatives hardies, apparues en France dans […]
The post Pour éviter un crime écologique de masse – Claude Henry appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
Texte intégral (1927 mots)
Comment expliquer que les institutions et les bénéficiaires d’un ordre millénaire, cet Ancien Régime qui a duré jusqu’en 1789, n’aient pas étouffé la marche à la Révolution? Dans le Livre III de L’Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville décrit et analyse le fourmillement de visions nouvelles et d’initiatives hardies, apparues en France dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, convergeant vers le renversement de l’ordre ancien et l’émergence, douloureuse, d’un monde nouveau. Visions et initiatives, aussi diverses et imaginatives que l’étaient celles du XVIIIème siècle, foisonnent aujourd’hui sur le chemin d’une transition écologique et économique vers un monde plus durable. Convergeront-elles à temps, et s’imposeront-elles face à l’ordre actuel, plus ancré encore et beaucoup plus puissant que l’était l’Ancien Régime ? C’est tout l’objet du livre Pour éviter un crime écologique de masse, (Editions Odile Jacob, 2023).
Prêts pour le transition écologique et économique
S’il est évident que certaines applications de la science constituent une des principales causes des maux dont nous souffrons, il est évident aussi que la méthode et la connaissance scientifiques sont cruciales pour comprendre ces maux et – dans des conditions politiques, sociales et économiques appropriées – engendrer des instruments qui aident à les surmonter. Les moyens scientifiques, techniques et organisationnels, ainsi que des structures économiques et sociales innovantes, sont dès à présent ou seront prochainement disponibles au service de l’indispensable transition; c’est dans une certaine mesure une surprise, en tout cas encourageante.
Nous en présentons dans ce livre (chapitres 1 et 4) un large éventail, qui atteste d’une capacité remarquable à inventer et innover sur des fronts très divers. Qu’il s’agisse de transformer les rayons du soleil, le souffle du vent ou la balle du riz en électricité, ou de substituer des pompes à chaleur aux climatiseurs traditionnels, qui aggravent le dérèglement climatique; de pratiquer une agriculture qui travaille avec la nature et non contre elle, de multiplier par six à huit le rendement d’une culture par goutte d’eau d’irrigation en l’apportant à la plante juste où il faut quand il faut ; d’extraire de plantes cultivées sur des terres abandonnées des plastiques recyclables et biodégradables ; d’enrôler mangroves, marais, parcs à huitres ou à moules aux défenses des côtes à la mer ; de s’associer à l’ordre naturel des rivières et des forêts et de les protéger notamment en leur conférant une personnalité juridique ; de coopérer et partager dans le cadre d’institutions traditionnelles ou nouvelles, de manière à concilier impératifs écologiques et sociaux. Dans chacune de ces avancées s’incarne la même alliance entre ressources offertes par la planète et ingénuité humaine, alliance dont on a trop longtemps sous-estimé, ou voulu ignorer, le potentiel.
Affrontés à des obstacles et des adversaires formidables
Avec une telle palette d’instruments, on devrait arriver à assurer la transition, à condition cependant de pouvoir et vouloir les mobiliser rapidement à l’échelle planétaire. Ceci est loin d’être acquis : d’une part, nous sommes confronté à des obstacles et des adversaires formidables, d’autre part les conditions de la vie sur la terre ont subi de terribles dégradations au long des cinquante dernières années, au cours desquelles la Terre a plus souffert aux mains des hommes que pendant toute l’histoire antérieure de l’humanité. Aujourd’hui, l’eau douce indispensable à la vie se raréfie dangereusement – pour un quart de l’humanité elle est même devenue presque inaccessible – les sols fertiles s’épuisent, l’extinction d’un grand nombre d’espèces végétales ou animales est en cours, enfin le climat qui a si bien servi l’humanité se retourne contre elle du fait même d’activités humaines. Nous contribuons tous à ce processus de dégradation ; nous avons donc tous quelque chose à faire pour y remédier. Mais nous n’avons pas tous les mêmes impacts, ni donc les mêmes responsabilités, et pas non plus les mêmes moyens.
Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres, observe George Orwell dans La ferme des animaux. A l’assaut de la planète, il y a des cochons – ce sont eux qui ont pris le pouvoir à la ferme – considérablement plus égaux que les autres : les entreprises qui produisent et distribuent les combustibles fossiles, et dans une moindre mesure d’autres ressources minérales ; les entreprises de la chimie, particulièrement à travers la domination qu’elles exercent sur l’agriculture industrielle ; et toutes celles qui exploitent intensivement les organismes vivants, particulièrement dans les forêts et les mers (chapitres 2 et 3). Directement ou indirectement, arrogantes et cyniques, elles tuent la vie ; c’est d’ailleurs une des principales sources de leurs profits.
Nous avons les instruments pour assurer la base matérielle de la transition. Nous travaillons à construire les institutions pour permettre la mise en œuvre et la diffusion de ces instruments. Nous rendons progressivement nos comportements plus conformes à la logique et à l’esprit de la transition (Chapitre 5). Mais tout ceci est vain si nous ne parvenons pas à maîtriser le rouleau compresseur qui écrase toute vie sur terre.
Rouleau compresseur ? Jugez-en.
Les entreprises produisant et distribuant les combustibles fossiles possèdent des réserves, enfouies dans le sol mais bien identifiées, de charbon, de pétrole ou de gaz, dont la combustion provoquerait des émissions de CO2 sept fois supérieures à 400 milliards de tonnes. Or 400 milliards de tonnes, c’est la quantité totale qu’on peut encore injecter dans l’atmosphère sans, espère-t-on, faire monter la température moyenne de la terre de plus de 1,5°C au-dessus du niveau d’avant la révolution industrielle. La science nous avertit qu’au-delà de ce seuil les désagréments que nous connaissons depuis quelques années – vagues de chaleur, périodes prolongées de sécheresse, inondations et tempêtes hors de proportion avec celles d’un passé encore récent, apparitions et diffusion de pathogènes dangereux – se transformeraient en bouleversements tels qu’ils rendraient la vie impossible sur des territoires progressivement de plus en plus étendus.
La transition comme révolution
Dans ces conditions, il paraîtrait raisonnable de ne pas, pour le moins, chercher à augmenter encore des réserves, qui ne seraient que très partiellement utilisées si on veut éviter une catastrophe climatique.
Ce n’est pas ainsi que les entreprises concernées voient les choses. Depuis l’Accord de Paris sur le Climat en décembre 2015, elles n’ont pas, comme espéré par les signataires, freiné, elles ont accéléré. Au cours des années 2016 à 2019, elles ont financé – avec leurs profits, des subventions publiques et des participations et prêts bancaires – plus de 1200 milliards de dollars d’investissements dans la recherche et l’exploitation de gisements nouveaux. D’après ce que l’on connait de leurs projets pour la décennie actuelle, elles s’apprêtent à investir davantage encore. D’autres investissements, n’impliquant pas les combustibles fossiles mais provoquant des destructions massives de plantes, d’animaux et d’écosystèmes, c’est-à-dire de biodiversité, sont financés par les grandes banques mondiales et d’autres institutions financières pour des montants encore plus importants.
Entreprises, banques et autres institutions financières, mais aussi autorités publiques complices, forment un syndicat du crime de masse écologique. Sur ces plans la transition sera nécessairement une révolution prenant le contrôle des entreprises impliquées et réorientant l’action publique en matière de fiscalité et de régulation, en particulier financière
Qu’espérer ? L’humanité est conduite par de vieux mâles que leurs préjugés, leurs intérêts et leur mépris des autres font détester la perspective même d’une transition. Tant pis pour l’avenir des jeunes, dont dans ces conditions seule la mobilisation et l’action en masse peuvent encore changer le cours des choses. S’ils amorcent un mouvement assez puissant, alors ils entraîneront nombre de leurs aînés, qu’il auront libérés de leur complexe d’impuissance.
Claude Henry
Pour éviter un crime écologique de masse, Editions Odile Jacob, avril 2023.
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1 : Introduction : Un pas dans la bonne ou la mauvaise direction
- Vers le salut
- Vers l’abîme
- Schizophrénies
Chapitre 2 : Tuer ses amis ou s’en faire des ennemis
- Glaciers, châteaux d’eau à sec
- Forêts, pompes inversées
- Océans, la vengeance de Poseidon
- Insectes, serviteurs congédiés
- La grande désarticulation des interactions naturelles
Chapitre 3 : Capitalisme de pillage, de mensonge et de manipulation
- Modèles de bonnes affaires fossiles
- Agriculture industrielle: une moisson d’effets externes délétères
- Falsification et mystification
- Filières d’influence et de domination
- Couper la musique et arrêter la danse
Chapitre 4 : Un puzzle d’innovations à assembler
- Energie et transport: approches multiples
- Villes en transition
- Aménagement de l’espace: complémentarité entre nature et science
- Exorciser la malédiction des plastiques
- Métamorphoses de la viande
- L’eau en dernier ressort
Chapitre 5 : Croyez ce que vous savez
- Témoigner
- Transmettre
- Participer
- Plaider
Chapitre 6 : La transition est une révolution
- Mise en faillite pour dommages majeurs à la planète et l’humanité
- Choix de consommation pour une planète habitable
- Marchés financiers et régulation bancaire
- Réhabiliter l’agriculture: esprit et méthodes de l’agroécologie
- Covid/Climat: éviter la récidive de l’indifférence au sort des pays pauvres
- Te Awa Tupua: faire de la Nature une personne pour cesser de la massacrer
- Nature et démocratie: du Rajasthan au bassin de la Loire.
Chapitre 7 : Desserrer l’étreinte du temps
- Géoingéniérie: efficacité rapide en apparence mais roulette planétaire
- Extraire du carbone de l’air
- Avancées technologiques en capture et stockage du CO2.
Quelques mots avant de baisser le rideau
Références bibliographiques
The post Pour éviter un crime écologique de masse – Claude Henry appeared first on Chroniques de l'Anthropocène.
- Persos A à L
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- EDUC.POP.FR
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Frédéric LORDON
- LePartisan.info
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Romain MIELCAREK
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Emmanuel PONT
- Nicos SMYRNAIOS
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- Numérique
- Binaire [Blogs Le Monde]
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Francis PISANI
- Pixel de Tracking
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- XKCD