12.05.2024 à 23:59
Front national : indignations sélectives et banalisation effective [2014]
Henri Maler, Julien Salingue
Dix ans ont passé. Analyse actuelle, mais révisable, publiée peu de temps après les élections européenne de mai 2014 dans la revue Savoir/Agir et mise en ligne ici même un mois avant les élections européennes de juin 2024.
- Sur les médias / Critiquer les médiasTexte intégral (5299 mots)

Dix ans ont passé depuis les élections européenne de mai 2014 et la publication de cet article dans la revue Savoir/Agir n° 29 de septembre 2014 pages 95 à 103. . Analyse actuelle, mais révisable, publiée ici même un mois avant les élections européennes de juin 2024.
Depuis les élections européennes du dimanche 25 mai [2014] et la victoire du Front national, le sens et la portée des résultats ont fait l'objet d'innombrables commentaires. Mais à quelques réserves près, une seule question retiendra notre attention : dans quelle mesure et comment les médias dominants favorisent-ils le Front national, non seulement en cette occasion, mais de façon plus générale ?
Un rôle effectif, mais second, voire secondaire
Commençons par éliminer deux idées reçues, non pour nier d'emblée un quelconque rôle des médias dans les dynamiques politiques actuelles, mais pour aller à l'encontre de certains raccourcis en vogue, qui desservent plus qu'ils ne servent la critique des médias.
Non, les médias ne sont pas les principaux responsables de la montée du Front national. Ce serait leur prêter un « pouvoir » disproportionné que d'expliquer prioritairement par leur rôle l'écho que rencontrent les « thèses » et « thèmes » portés par le Front national, ainsi que ses scores électoraux. Les médias ne créent pas les mouvements d'opinion : ils peuvent les accompagner, les amplifier ou les brider. Les médias n'interviennent pas isolément : leur « pouvoir » n'existe qu'en résonance ou en convergence avec d'autres pouvoirs, à commencer par le pouvoir politique. Enfin, ce serait faire bien peu de cas des intelligences individuelles et collectives que de penser que certaines pratiques et postures journalistiques et éditoriales, aussi répandues et critiquables soient-elles, s'imposent mécaniquement [1] . Nul besoin pour s'en convaincre de se référer aux enseignements de la sociologie de la réception (que l'on aurait tort de mésestimer) : il suffit de se souvenir de l'expérience du référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel européen (TCE) pour s'en convaincre [2] . Et c'est aussi à rebours de leur condamnation médiatique que les partisans du Front national forgent leurs convictions.
Non, ce n'est pas le temps de parole accordé aux représentants de ce parti ou à la mise en discussion, en leur présence, de leurs prises de position qui est en cause, du moins tant que ce temps se tient dans les limites des résultats enregistrés lors du premier tour des élections législatives (qui, pour les partis politiques, sont le moins pire des critères pour réguler leur présence médiatique) [3] et tant que le temps de parole consacré au Front national, en présence ou non de ses représentants – nous y reviendrons – ne se focalise pas sur les sondages, les pronostics et les résultats, au détriment de toute autre discussion. Dans tous les cas, ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on fait tomber la fièvre. Ce n'est pas en privant le Front national d'expression démocratique que l'on combat ses tentations pour le moins anti-démocratiques. Au contraire : la sous-représentation médiatique du Front national aurait continué à alimenter sa « victimisation ».
Oui, le rôle des médias est second, voire secondaire. Pour s'en convaincre il suffit de mentionner, sans prétendre proposer une analyse qui excède les limites que l'on peut assigner à la critique des médias, quelques facteurs explicatifs de l'enracinement du Front national qu'il serait incongru, pour ne pas dire dangereux, d'ignorer ou de négliger.
Cet enracinement est avant tout l'un des effets de la longue crise du capitalisme et de sa gestion néo-libérale, économiquement inefficace et socialement désastreuse, par les gouvernements qui se succèdent en France sans que les politiques changent radicalement. Cette crise, à elle seule, n'expliquerait pas la place prise par le Front national si elle ne se doublait pas d'une crise politique de la représentation par les partis dominants et d'une crise sociale qui met durement à l'épreuve les solidarités ouvrières et populaires : reflux des luttes sociales victorieuses, recul de la perspective d'une inversion des rapports de forces par des mobilisations collectives et, par conséquent, tentations du repli, qu'il soit national, identitaire ou communautaire. On comprend dès lors que la question nationale, dans sa version nationaliste, se substitue, pour de larges franges de la population, à la question sociale.
Si ce sont là les facteurs prépondérants de la place politique prise par le Front national, il n'est nul besoin de l'attribuer à la place qu'il occupe dans l'espace médiatique, voire à une « lepénisation » des médias eux-mêmes ou à une « lepénisation des esprits » dont ces médias seraient les principaux responsables.
Tout au plus peut-on leur prêter, mais c'est déjà beaucoup et beaucoup trop, des fonctions de légitimation et d'incitation : légitimation de thèmes portés par le Front national, incitation à lui faire confiance. Encore ne s'agit-il là que des tendances les plus lourdes. Sans doute, le traitement médiatique du Front national et des thèmes qu'il affectionne ne se résume-t-il pas à ces tendances : dans la presse écrite, les quotidiens et les hebdomadaires nationaux sont des médias de parti pris qui ne font pas uniformément le lit du Front national. Mais leur influence ne cesse de décliner au regard des radios et, surtout, des télévisions. Ce sont ces dernières qui sont particulièrement en cause.
La dépolitisation médiatique de la politique
Si les médias ou, du moins nombre d'entre eux, contribuent, même indirectement, à favoriser le Front national, c'est d'abord – bien que cette cause ne soit sans doute pas la principale – en raison de modes de traitement des questions politiques qui reposent, pour le formuler de manière abrupte, sur une dépolitisation de la politique.
La mise en scène médiatique des enjeux politiques est focalisée sur les confrontations qui agitent le microcosme partisan, au détriment, trop souvent, de l'information sur les débats de fond, les positions, les propositions, les projets. Quand elles ne se limitent pas au recensement des « petites phrases » et des « bons mots » que l'on commente longuement, les informations et les analyses se concentrent sur les stratégies de communication des acteurs politiques, sur des bruits de couloir, sur les chamailleries internes, sur les enquêtes de popularité, sur les ambitions personnelles, etc. Une telle focalisation sur les questions qui préoccupent le microcosme médiatico-politique, et non sur les problèmes dont les politiques sont censés s'occuper, accrédite une version politicienne de la politique, qui en détourne de larges fractions de la population (en particulier dans les classes populaires) et contribue à légitimer le discours « antisystème » du Front national.
Le traitement médiatique des « affaires » n'est pas non plus sans effets. Ce sont sans nul doute ces « affaires » elles-mêmes qui ont les conséquences les plus nocives. Et les enquêtes journalistiques qui les révèlent et/ou les médiatisent sont plus que souhaitables. Mais cette médiatisation ne garantit pas, en elle-même, des effets vertueux pour la démocratie, surtout quand elle s'en tient à des récits des circonstances particulières des malversations et des trajectoires personnelles de leurs auteurs, sans mettre en question les structures économiques et institutionnelles qui permettent et favorisent ces malversations. Une telle mise en scène nourrit moins une exigence démocratique radicale de transformation de ces structures qu'une contestation impuissante d'un « tous pourris », auquel s'abreuve le Front national.
Or les questions économiques et sociales sont elles-mêmes dépolitisées. Entendons par là que les questions économiques et sociales, souvent abordées à partir de quelques-uns de leurs effets de surface, sont soustraites à un débat public qui, à quelques exceptions près, ne se résume pas au trop ou au trop peu qui distingue la droite et la gauche politiquement dominantes.
La construction médiatique des cibles de la peur et de la haine
Ainsi en va-t-il particulièrement de la promotion et de la mise en scène de thèmes réputés refléter la réalité, qui alimentent le caddie du Front national, sans qu'il ait besoin de faire lui-même son marché : insécurité, immigration, islam.
Le traitement médiatique du problème de la sécurité des biens et des personnes soustrait généralement sa résolution à toute autre option politique que l'alternative entre le trop (réputé « sécuritaire ») ou le trop peu (réputé « laxiste ») de la répression. Or si personne ne songe à nier que la sécurité des biens et des personnes fasse problème, affirmer ou laisser dire que les causes de la délinquance, ce sont les délinquants eux-mêmes et que l'origine nationale (voire ethnique) de leurs parents l'emporte sur leurs conditions d'existence, c'est, dans nombre des médias, légitimer des discours de haine qui résonnent dans ceux du Front national. De même, monter en épingle les faits divers délictueux qui envahissent les informations télévisées [4]] et multiplier les reportages et les enquêtes sur les prouesses de la police et de la gendarmerie, au détriment des enquêtes sur la misère sociale [5]
Sur l'insécurité, l'immigration ou l'islam, une même conclusion semble dès lors s'imposer, dont témoignent d'innombrables micros-trottoirs qui, pour une fois, ne mentent pas : « Avec ce qu'on voit à la télé ! ». Or ce que l'on voit à la télé, ce n'est pas cette réalité qu'il serait malséant de nier, mais la construction médiatique de cette réalité, indexée sur l'audimat. Une construction qui cultive toutes les peurs et les intensifie : tant il est vrai que, parmi les effets reconnus par les études de réceptions, la peur est un sentiment que la télévision répand plus que tout autre et qui – sur l'insécurité, l'immigration, l'islam – gave le Front national de partisans, de sympathisants et d'électeurs.
Sans doute ces réductions ne sont-elles pas le fait de tous les médias, mais elles sont omniprésentes dans les médias les plus consultés : les radios et surtout les télévisions. Et quand bien même, pour ne prendre qu'un exemple, les articles du Point seraient moins caricaturaux que ses « unes » [6] et les lecteurs de cet hebdomadaire minoritairement tentés par le Front national, l'affichage des « unes » dans l'espace public contribue à une banalisation des thèmes chers au Front national. Une banalisation à laquelle concourent de trop nombreux médias. Au cœur de cette banalisation, l'idée absurde selon laquelle le Front national poserait de vrais problèmes, mais apporterait de mauvaises solutions : comme si les solutions n'étaient pas largement impliquées dans la façon de poser les problèmes.
Le dévergondage médiatique, particulièrement à la télévision, légitime les cibles qui font partie du patrimoine du Front national : on a pu le vérifier une fois encore quand, comme nous l'avions relevé, à l'occasion d'un débat sur l'Europe, « Pujadas tend la perche à Marine Le Pen ». Mais cette dépolitisation sensationnaliste n'est pas la seule.
La construction médiatique de débats mutilés
Depuis de longs mois (et récemment à l'occasion des « municipales » et surtout des « européennes » de 2014), le Front national a « enrichi » son patrimoine en se mobilisant sur la crise économique, les fermetures d'usines, les licenciements et toutes les formes de la misère sociale en prenant pour cibles la finance, « l'européisme » et « le mondialisme ». Qui pourrait faire grief aux médias dominants d'aborder notamment la question de l'Union européenne, du rôle de l'euro et plus généralement des politiques économiques ? Mais comment le font-ils ? En mutilant la présentation des options possibles. Autre forme de dépolitisation.
Le traitement médiatique de « la question européenne », de façon générale et pas seulement à l'occasion des récentes élections, favorise le Front national bien au-delà du temps qui lui est attribué ou qui lui est consacré. L'opposition d'un simplisme consternant entre « pro-européens » et « anti-européens » (selon une appellation parfois tempérée par celle d'« eurosceptiques », mais confirmée par celle d'« europhobes ») défigure le débat : cette opposition, quand elle est médiatiquement construite, confie en effet la défense d'un projet européen, quel qu'il soit, aux seuls partis qui chérissent l'Union européenne (sous réserve de quelques transformations). Dans la foulée, la même opposition amalgame toutes les critiques de l'Union européenne et les place sous l'égide quasi exclusive du nationalisme exacerbé du Front national. Au point que tous les « Non » à cette Europe, que l'on propose ou non de la quitter, sont, peu ou prou, présentés comme de simples variantes de ce nationalisme-là.
Le traitement médiatique des « questions économiques », fortement lié à « la question européenne », emprisonne les réponses dans des alternatives qui, une fois encore, font la part belle aux économistes orthodoxes (et aux partis qui les reprennent plus ou moins), en attribuant à toutes les variantes de l'hétérodoxie une place subalterne et en confiant au Front national leur représentation politique. « Pour » ou « contre » l'euro (que ce soit pour l'abandonner ou le refonder), « pour » ou « contre » des formes de protectionnisme (qu'il soit national ou européen) : tels sont les choix qui, tels qu'ils sont communément présentés, légitiment le libéralisme et le monétarisme économiques dominants et transforment, dans les discours médiatiques en vogue, tous les opposants en partenaires malgré eux du Front national !
La dépolitisation médiatique du Front national lui-même
Prisonniers de leurs présupposés politiques, la plupart des chroniqueurs et commentateurs, du moins en radios et télévisions, ne parviennent ni à exposer ni à discuter des thèses du Front national. En revanche, le privilège accordé aux jeux politiciens sur les enjeux politiques produit ici de néfastes effets.
Le traitement médiatique des sondages et des résultats électoraux contribue à placer le Front national au centre du débat politique. La surinterprétation de ces sondages [7] et de ces résultats qui, répétons-le, ne sont pas l'expression chimiquement pure d'une « opinion publique » scientifiquement objectivable et mesurable, contribue à l'imposition du Front national au centre de la vie politique française et du débat public, renforçant dès lors – en les légitimant – les ambitions du parti présidé par Marine Le Pen. Ainsi, il suffit d'être en tête d'une élection pour que dans la bouche de nombre de commentateurs qui ont oublié leurs cours de sociologie politique (s'ils les ont jamais suivis), le Front national devienne « le premier parti de France »… comme le Front national lui-même s'est empressé de le proclamer par affiches le lendemain de l'élection européenne.
Le traitement médiatique des images du Front national et de Marine Le Pen, quand il n'épouse pas les images qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, mobilise les commentateurs (secondés par des communicants) au détriment de la discussion des propositions de ce parti. Comme si les comparaisons entre le ton et le style (quand ce ne sont pas les apparences physiques et vestimentaires) de Marine Le Pen et de son père n'accréditaient pas l'existence de différences qu'il conviendrait d'abord de mesurer sur le terrain des positions et des pratiques politiques. Comme si les commentateurs et communicants qui se livrent à ces comparaisons ne contribuaient pas, parfois malgré eux, au déplacement sur le terrain des apparences du débat autour d'une prétendue « rénovation » du Front national, légitimant ainsi cette idée de « nouveauté », qu'un examen et une analyse sérieuse des propositions du Front national pourraient pourtant largement démentir. Ce faisant, les médias dominants contribuent à la dépolitisation du Front national en relativisant l'examen de la nature de son projet politique et social.
La dépolitisation de la critique du Front national épouse celle de sa mise en scène. L'administration récurrente (avec le concours des forces politiques) de cours de morale républicaine qui ne répondent en rien à ce qu'ils prétendent combattre, alors que tout le reste (voir ci-dessus) le légitime peu ou prou, demeure en deçà de toute mise en question. Mais à la prétendue « diabolisation » que le Front national dénonçait a succédé une « dédiabolisation » à laquelle les médias ont concouru. S'interroger sur la réalité de la « dédiabolisation », sur les moyens employés par le Front national pour y prétendre, etc… contribue largement à ladite « dédiabolisation ». En discutant et commentant les stratégies déployées par le Front national pour se normaliser, on accrédite l'idée selon laquelle il tendrait vers une normalisation et on concourt à cette normalisation. En d'autres termes, en ce cas, dire c'est faire : annoncer que le Front national se normalise contribue à sa normalisation… médiatique. Ce que l'on peut analyser comme une normalisation performative.
Que des médias d'opinion ou de parti pris, comme le sont ouvertement les quotidiens et hebdomadaires nationaux, exercent leur liberté d'opinion et prennent parti, rien de plus normal. Mais ceux qui, peu ou prou, cèdent aux tentations que nous avons relevées devraient retenir leurs larmes quand ils déplorent l'impact du Front national. Un peu moins d'inconscience ou de cynisme de leurs chefferies ne nuirait pas au débat démocratique quand on sait l'influence qu'elles exercent sur les autres médias. Mais ce sont surtout les télévisions et les radios généralistes, particulièrement (mais pas seulement) du secteur public qui devraient réviser (mais ne rêvons pas trop !) leurs options éditoriales et leurs programmes, quand ceux-ci incitent à la complaisance à l'égard du Front national. Non que celle-ci soit nécessairement intentionnelle. Mais moins de révérence à l'égard des institutions et aux effets du scrutin majoritaire, moins de soumission à la recherche commerciale de la plus large audience pourraient répondre à des exigences effectivement démocratiques. Les indignations contre la xénophobie et le nationalisme ranci seraient peut-être un peu moins impuissantes si la banalisation du Front national ne faisait pas bon ménage avec elles. Il serait ainsi de bon ton de ne pas jouer aux pompiers pyromanes, en entretenant, par les pratiques analysées ci-dessus, la flamme du Front national : si ce dernier aime toujours autant dénoncer « les » journalistes et « les » médias, le moins que l'on puisse dire est que cette rhétorique est de moins en moins fondée.
P.S. La dernière saillie de Jean-Marie Le Pen (sur la place réservée à Patrick Bruel dans la prochaine « fournée ») a suscité, comme il se doit, des indignations quasi unanimes, notamment dans les médias... Mais elle a permis aussi à quelques leaders du Front national de se dédouaner à peu de frais pour se décerner un brevet de respectabilité... dont nombre de médias se sont faits largement et complaisamment l'écho. Nous en sommes là !
Henri Maler et Julien Salingue
Annexe : Sur le sens et la portée du score électoral du Front national
Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Aussi sont-ils matière à controverses. Faut-il s'alarmer sans retenue ou se rassurer à peu de frais ? Pas si simple…
Si comme Philippe Pelletier le propose [8]] on prend en compte le nombre d'électeurs qui accordent leur suffrage au Front National, la victoire électorale de mai 2014 témoigne d'une persistance et non d'une percée : « Si on résume, l'étiage du FN depuis sa percée électorale à la fin des années 1980 se situe à 2 millions de voix (européennes de 1994). Il tourne autour de 4 millions de voix entre 1988 et 2007 (4,3 aux présidentielles de 1988, 3,7 aux législatives de 1997, 3,5 aux régionales de 2004)… Autrement dit, son score des européennes de 2014 (4,7 millions) se situe au-dessus de la moyenne des décennies précédentes, mais il n'en bat pas les records (6,3 en 2012). »
Il en va de même si on rapporte le score au nombre d'électeurs inscrits (et donc que l'on prend en compte l'abstention), comme nous l'écrit l'un de nos correspondants : Les résultats lors des dernières européennes montreraient que « un électeur sur quatre » aurait voté FN (24,86 %). Pourtant, une lecture plus juste serait de considérer non pas les bulletins exprimés, mais les inscrits (incluant donc l'abstention, les nuls et les blancs). Dès lors, le score du FN aux européennes de 2014 chute brutalement (10,12 %) et se retrouve en deçà du fameux premier tour de l'élection présidentielle de 2002 (11,66 %). On constate également que le nombre d'électeurs FN par rapport aux nombre d'inscrits a baissé depuis... 1995 (11,43 %). Et que celui du premier tour de 2012 – le plus élevé de l'histoire du FN (13,95 %) – est, grosso modo, le même que celui du second tour de 2002 (13,41 %). Enfin, si 6,4 millions inscrits ont voté pour Marine Le Pen en 2012, près de 40 millions d'électeurs n'ont pas voté pour le FN. On est encore loin du fascisme rampant. »
En revanche, si l'on prend en compte la nature du scrutin (sur l'Europe) et si l'on compare avec les élections européennes précédentes, le FN gagne beaucoup de voix, comme nous l'écrit un autre correspondant : « En 2009 ils récoltaient 1,1 millions de voix, en 2004 1,7 millions, en 1999 1 million, en 1994, 2 millions, etc. Et, à moins de considérer que parmi les abstentionnistes le FN est largement sous-représenté (je ne me hasarderais pas à formuler cette hypothèse...), il n'y aucune raison que le FN ne progressera pas en voix aux prochaines présidentielles, à moins d'un sursaut en termes de mobilisations, d'une victoire sociale, etc. D'autant que les conflits s'accentuent à l'UMP et que le PS approfondit sa politique pro-patronale. »
Mais si les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne mesurent pas l'enracinement du Front national : à la fois l'audience de ses thèses et, à la faveur des derniers scrutins, les progrès (encore limités dans les municipalités, mais consistants – ressources financières à la clé – au Parlement européen) de son implantation.
Tout cela se discute… et ce n'est pas notre propos. En revanche, la portée politique des résultats du Front national se mesure aussi à leur portée médiatique. Et, sur ce sujet aucun doute n'est permis : la construction médiatique du rôle du Front national est disproportionnée… et contribue, en le plaçant au centre du débat médiatique, à le placer au centre du débat politique, surtout quand celui-ci a pour enjeu… l'anticipation de l'élection présidentielle de 2017. ?
[1] Sur le « pouvoir des médias », écouter ici même une conférence de septembre 2012.
[2] La quasi-unanimité éditoriale en faveur du oui (qui faisait écho à la quasi-unanimité des partis de gouvernement) et le traitement médiatique très défavorable des partisans du non et de leurs arguments n'ont pas suffi à empêcher le large rejet du TCE. La contre-information réalisée par la campagne pour le non, les effets contradictoires du matraquage médiatique en faveur du oui, qui s'est en partie retourné contre ses artisans, et surtout le décalage entre le discours sur les vertus de l'Europe et la réalité quotidienne vécue par des millions de gens, ont largement conditionné un scrutin qui a démontré que les médias n'étaient pas tout-puissants.
[3] Si les règles fixées à ce sujet par le CSA sont très contestables, elles sont globalement respectées par les grands médias : le FN bénéficie d'un temps d'antenne équivalent à son poids électoral lors du premier tour des dernières élections législatives, et les déséquilibres qui ont pu être constatés durant la récente campagne (notamment sur BFM TV) ont été corrigés. Si une critique des temps d'antenne peut – et doit – être formulée, elle doit concerner l'ensemble des règles et non la seule place du FN. Les chiffres du CSA pour la dernière élection européenne sont, en .pdf, sur le site de l'Acrimed.[lien inaccessible, 2024]
[4] Sur les faits divers, voir « Flambée de faits divers dans les JT depuis dix ans ». Le baromètre thématique de l'INA met en évidence un recul du traitement des faits divers délictueux pour le 1er trimestre 2014. [Line inaccessible, 2024
[5] Voir : « “90' Enquêtes” sur TMC : racolages sécuritaires et spectaculaires »] , c'est laisser croire que les remèdes à la délinquance sont indépendants de ceux que requiert la précarité des conditions d'existence d'une part croissante de la population. Et réduire la lutte contre l'insécurité à la traque des délinquants, comme promet de la renforcer le Front national.
Le traitement médiatique des questions de l'immigration quand elles sont abordées sous l'angle de son contrôle aux frontières, comme c'est trop souvent le cas, ne laisse le choix qu'entre les modalités et l'ampleur de ce contrôle. Des problèmes existent : personne ne songe à le nier. Mais lesquels ? Affirmer ou laisser dire que ce sont des problèmes posés exclusivement aux Français et non des problèmes posés d'abord aux immigrés eux-mêmes, dans leurs pays d'origine ou dans leur pays d'accueil, et laisser entendre que les immigrés sont réellement ou potentiellement des envahisseurs, c'est non seulement dépolitiser la question des causes de l'immigration et de la situation des immigrés, mais aussi et surtout alimenter la traque de boucs émissaires, comme sait le faire le Front national.
Le traitement médiatique de l'islam, à la différence de celui qui est réservé à d'autres religions, est trop souvent dominé, non par une étude raisonnée de l'islam, mais par la dénonciation de ceux qui le pratiquent. Affirmer ou laisser dire que les citoyens musulmans se définissent exclusivement par une religion que l'on condamne sans même informer sur elle, c'est les traiter comme des citoyens au rabais. Affirmer ou laisser dire que cette religion est, à la différence de toute autre, une anomalie, c'est affirmer (ou du moins laisser entendre) que cette religion met en péril une prétendue identité nationale. Et sous couvert de combattre les fanatismes qui se réclament de l'islam (« l'islamisme »), suggérer (le cas échéant en prenant des gants) que c'est la pratique de l'islam qui, intrinsèquement, est potentiellement fanatique, c'est jeter la suspicion sur des millions de croyants. Ce faisant, les médias qui entretiennent cette stigmatisation (ou simplement ces préjugés) alimentent des phobies, des peurs ou des haines et légitiment, ouvertement ou en sourdine, les déclarations fracassantes, xénophobes et discriminatoires du Front national[[Voir « Les obsessions islamiques de la presse magazine ».
[7] Voire leur présentation totalement biaisée. Voir « L'opinion selon BVA : Marine Le Pen progresse... en régressant ».
[8] Voir sur son blog [« Le triomphe électoral du FN en trompe l'œil », http://libelalettredorion.blogs.liberation.fr/mon-blog/2014/05/nous-sommes-myope-face-à-la-victoire-du-fn.html
08.05.2024 à 15:08
Foucault et Marx : une confrontation inactuelle ?
Henri Maler
À quoi bon parler de Marx ? D'ailleurs, « Marx, pour moi, ça n'existe pas », déclare Foucault.
- Bourdieu, Foucault et alii / Michel Foucault, Karl MarxTexte intégral (7127 mots)
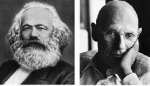
Communication au colloque « Foucault vu d'Est, Foucault vu d'Ouest », tenu à Sofia (Bulgarie) en Juin 1993. Publiée dans Michel Foucault : les jeux de la vérité et du pouvoir, Presses Universitaires de Nancy, septembre 1994.
À quoi bon parler de Marx ? D'ailleurs, « Marx, pour moi, ça n'existe pas. Je veux dire cette espèce d'entité qu'on a construite autour d'un nom propre, et qui se réfère tantôt à un certain individu, tantôt à la totalité de ce qu'il a écrit, tantôt à un immense processus historique qui dérive de lui [1] . » Comment ne pas souscrire à ce propos ? Et ne pas ajouter aussitôt, une fois encore avec sa caution, que Foucault non plus n'existe pas ? Aussitôt annoncé, mon propos menace de se dérober...
Nous voici dispensés, en tout cas, des exercices jadis imposés par l'existence d'orthodoxies parfois dérisoires et souvent meurtrières : je ne me demanderai pas si Foucault et Marx sont compatibles ou incompatibles. Je me bornerai à examiner ce que la critique de Marx par Foucault peut nous apprendre sur la pensée de Marx et de Foucault.
Mais la critique de Marx par Foucault est d'autant plus insaisissable que Marx dans Foucault fait l'objet de critiques indirectes qui le visent à travers les divers marxismes et de critiques obliques qui l'intègrent ou le discutent sans le nommer.
La critique de Marx par Foucault se dérobe derrières ses variations - que je ne chercherai pas à parcourir - et derrière ses variétés - entre lesquelles il convient de choisir. Foucault n'a jamais dissimulé son aversion pour toutes les variétés de marxisme orthodoxe, académiques ou étatiques, et ses réticences à l'égard de toutes les variétés de marxisme critique. Pourtant ces critiques indirectes ne nous intéressent pas ici, bien qu'elles puissent être riches d'enseignement, si l'on admet avec Foucault qu'un auteur n'est pas propriétaire de son texte.
Mais Marx lui-même ? A défaut d'être identifiable, encore faudrait-il qu'il soit localisable dans le discours de Foucault. Or Marx, dans ce discours, est, en général aux abonnés absents. Il fait l'objet de discussions et d'appropriations obliques, qui procèdent généralement par allusions plutôt que par références, par mise en œuvre ou mise à l'écart silencieuses, plutôt que par débat ou par combat. Aussi les appropriations seront-elles effectuées sans partenaire et les discussions esquissées sans adversaire, à charge pour les commentateurs, précisément, de rétablir les notes en bas de page volontairement effacées.
Je laisserai de côté ces critiques latérales qui nous entraineraient trop loin pour ne m'intéresser qu'à des critiques frontales.
J'en retiendrai deux : deux critiques « à coups de marteau », pour reprendre l'expression de Nietzsche , prises aux deux pôles de la théorie : archéologie du savoir et généalogie du pouvoir. À un pôle, Foucault critique le mariage de l'anthropologie et de la dialectique. À l'autre pôle, il critique le mariage de l'État et de la Révolution.
1. Archéologie
Premier coup de marteau : Dans Les Mots et les Choses, Foucault critique donc « les promesses mêlées de la dialectique et de l'anthropologie », qui culminent chez Marx dans une « utopie d'achèvement » [2] .
En suivant le fil de cette critique, pour la prendre en charge et la radicaliser, je dirai que la pensée de Marx est initialement dominée par la tentative, et en permanence marquée par la tentation, de se livrer une promesse utopique : l'essence humaine (tel est le versant anthropologique), par le truchement de la nécessaire négation de l'aliénation de cette essence (tel est le versant dialectique), est promise à son effectuation. Et force est de constater que cette utopie promise soumet la pensée de Marx, du moins dans ses premiers écrits, à un implacable enchaînement [3] .
Parce qu'elle promet l'adéquation de l'existence humaine à son essence, l'émancipation humaine doit être totale : c'est-à-dire tout à la fois complète (surmontant la totalité des aliénations), universelle (surmontant l'aliénation de la totalité des hommes) et intégrale (surmontant la totalité des aliénations de chaque individu) : la réalisation de l'homme total en chaque individu singulier.
Parce que cette émancipation est la réalisation historique de l'essence humaine, elle ne peut être qu'ultime : l'achèvement d'une émancipation totale ne laisse aucune tâche d'émancipation devant elle. Parce que l'unité de l'essence et de l'existence en constitue l'effectivité, l' émancipation, pour être achevée, doit être parfaite : elle sera accomplie dans une société rendue à l'immanence, à l'omnipotence et à la transparence.
Surmonter l'aliénation de l'essence humaine, parvenue à son comble dans les formes d'existence du prolétariat suppose le retour à l'unité de tout ce qui est séparé, le dépassement des oppositions par leur réconciliation, la présence de l'essence dans l'existence : une parfaite immanence.
Le retour des forces aliénées à leurs sujets créateurs et le dépassement de toutes les scissions qui font des hommes des êtres dominés par leurs propres créations impliquent que les hommes placent toutes les forces qui jusqu'alors les dominaient sous leur propre contrôle : une parfaite omnipotence.
La présence immanente de l'essence dans l'existence, de la nature sociale de l'homme dans ses formes d'existence sociale, et la puissance omnipotente des hommes sur leurs relations permettent d'instaurer la lisibilité de l'essence dans l'existence : une parfaite transparence.
Immanence, omnipotence, transparence : Marx reconduit ainsi les illusions des petites et des Grandes utopies. Tels seraient les points culminants d'une utopie révélée, si la pensée de Marx pouvait être enfermée dans cette première étape et rabattue sur les dimensions utopiques de celle-ci.
Telles sont mes raisons de souscrire - bien que jamais il ne soit allé aussi loin - à la critique de Foucault. Mais les coups de marteau destinés, selon Nietzsche, à « forcer à parler haut ce qui voudrait se taire » menace de réduire au silence ce qui pourrait encore nous parler. Il convient alors mesurer, mais avec Foucault lui-même, les déficits de l'archéologie du savoir si elle se replie sur elle-même [4] .
Deux questions sont en effet posées.
– Première question : la critique archéologique d'une utopie suffit-elle à rendre compte de ses effets théoriques ?
On connaît la formule de Foucault : « Le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme poisson dans l'eau : c'est-à-dire que partout ailleurs il cesse de respirer [5] » . Marx, semble-t-il, est entièrement enfermé dans l'anthropologie et dans l'épistémè du XIXe siècle.
La réduction à l'anthropologie est, on le pressent, essentiellement polémique, et indirecte. En effet, la « mutation épistémologique de l'histoire », encore inachevée aujourd'hui, à laquelle souscrit Foucault, « ne date pas d'hier cependant, puisque », précise-t-il, « on peut sans doute en faire remonter à Marx le premier moment » [6] . L'anthropologie ne saurait inaugurer une telle mutation, et l'on doit logiquement en conclure que si Marx n'a cessé de se débattre avec le dispositif initial de sa pensée, son œuvre ne saurait être entièrement enfermée dans ce dispositif, dominé par la problématique de la réalisation de l'essence humaine. Dans ces conditions, c'est moins l'anthropologie de Marx que les tentatives d' « anthropologiser Marx » que Foucault dénonce : les tentatives de sauvetage de la souveraineté du sujet « contre le décentrement opéré par Marx - par l'analyse historique des rapports de production, des déterminations économiques et la lutte des classes » [7] . Marx, précurseur ou fondateur, donc.
Ainsi, le rabattement sur l'épistémè ne saurait être que critique, et temporaire. Foucault, dans Les Mots et le Choses semble exclure tout excédent théorique de l'œuvre de Marx sur l'épistémè qui l'engloutit dans le XIXème siècle : on vient de voir qu'il n'en est rien. Aussi Foucault, en partie à rebours des énoncés-canon que l'on a rappelés, classera Marx (au même titre que Freud) parmi ceux qu'il propose d'appeler « les fondateurs de discursivité », qui ne sont pas seulement des auteurs de leur œuvre », mais « ont produit quelque chose de plus : la possibilité et la règle de formation d'autres textes » et ont établi une possibilité indéfinie de discours ». Marx ne serait alors que le fondateur des marxismes. Mais à la différence da fondation d'une science, « l'instauration discursive est hétérogène à ses transformations ultérieures » [8] : elle rend par conséquent possible le retour (divers retours) au texte : « au texte même, au texte dans sa nudité, et, en même temps, pourtant (...) à ce qui est marqué en creux, en absence, en lacune dans le texte » [9]. À ce titre, si le privilège de l'œuvre a été mis entre parenthèses, la parenthèse peut n' être que provisoire. Pourtant, rouvrir cette parenthèse ne nous découvre pas l'œuvre dans sa vérité, mais un texte dans sa nudité.
Ainsi le déplacement opéré par la lecture de Foucault n'est pas réductible aux formulations extrêmes qui en font percevoir l'orientation et la nécessité. Contre le commentaire qui aurait en charge une vérité ultime et toujours dérobée de l'œuvre, et à l'écart de la critique interne qui en éprouverait la cohérence (en cherchant dans Marx lui-même des points d'appui pour en tenter le dépassement), Foucault esquisse une méthode qui permet d'apprendre à lire : Marx bien sûr, mais aussi Foucault.
L'archéologie du savoir agit précisément comme un filtre qui permet de partager le dépôt historique et l'excédent théorique. Marx n'est sans héritage : aussi Foucault n'hésite-t-il pas à le capter pour en faire des usages partiels et circonscrits. Pourtant le texte de Marx ayant cessé d'être définitivement assignable à son siècle n'en devient alors que plus insaisissable, et en même temps plus disponible, pour le pire, sans doute, mais aussi pour le meilleur.
– Reste alors une seconde question : la critique archéologique d'une utopie saurait-elle suffire à rendre compte de ses effets pratiques ?
Ce que la critique archéologique suggère mais ne peut montrer, c'est comment une utopie d'achèvement - qui promet la réalisation de l'essence humaine - peut se retourner. Sommairement décrit ce retournement tient en quelques mots : de l'omnipotence des producteurs à l'omnipotence de l'état, de la transparence des relations sociales à la surveillance par l'état, de l'immanence de la société à la transcendance de l'État ; de la dictature du prolétariat à la dictature sur le prolétariat. Or, le retournement de l'utopie n'est pas mécaniquement inscrit dans le fait même de l'utopie. Les promesses de la dialectique et de l'anthropologie peuvent bien n'être pas tenues - parce qu'elles ne sont pas tenables : cela n'explique pas qu'elles se transforment - dialectiquement ? - en leur contraire.
La critique de Foucault, alors inachevée, doit remonter des effets à la théorie et expliquer ce qui en elle, comme pensée ou impensé, peut favoriser son destin. La critique archéologique est prolongée par une critique généalogique qui prend le relai. Selon la première critique la pensée de Marx semble rivée à son socle et appartenir entièrement au XIXe siècle. Selon la seconde, la pensée de Marx se confond avec ses effets et est entièrement solidaire du XXe siècle : non plus cette fois comme innocente utopie, mais comme sinistre réalité.
2. Généalogie
Second coup de marteau : Dans La grande colère des faits, dix ans plus tard, Foucault dénonce dans la théorie de Marx une variante du mariage entre l'État et la Révolution qui fait apparaître le stalinisme comme « la vérité "un peu" dépouillée, c'est vrai, de tout un discours qui fut celui de Marx et d'autres peut-être avant lui » [10] .
Le point de départ de cette critique est et reste sans appel. Foucault récuse avec une virulence justifiée les opérations qui permettent d'éluder la question du Goulag en faisant mine de la poser : en particulier le rabattement théoriciste (qui en fait une erreur lisible à partir des textes) et le rabattement historiciste (qui en fait un effet de conjoncture isolable à partir de ses causes). Rabattements qui font apparaître le stalinisme (et ses massacres) comme le résultat d'une affreuse erreur et/ou le résultat de fâcheuses circonstances [11] . Conséquence » : « Plutôt que de rechercher dans les textes ce qui pourrait condamner par avance le Goulag, il s'agit de se demander ce qui en eux l'a permis, ce qui continue à le justifier, ce qui permet aujourd'hui d'en accepter toujours l'intolérable vérité [12] . »
Reste la conclusion de cette critique. Foucault soutient que de Marx au stalinisme « il n'y avait pas "faute" on était resté dans le droit fil » [13] . Mais de quelle continuité s'agit-il ? Or Foucault retient, mais à sa façon, la critique des « Maîtres penseurs » proposée par Glucksman : la philosophie allemande a célébré le mariage de l'État et de la Révolution.
De là ce diagnostic qui englobe Marx : « Toute nos soumissions trouvent leurs principes dans cette double invite : faites vite la Révolution, elle vous donnera l'État dont vous avez besoin ; dépêchez-vous de faire un État, il vous prodiguera généreusement les effets raisonnables de la révolution. Ayant à penser la Révolution, commencement et fin, les penseurs allemands l'ont chevillée à l'État et ils ont dessiné l'Etat-Révolution, avec toutes ses solutions finales [14] .
Ce sont les faiblesses de cette critique qui nous découvriront ce qui fait sa force : la perversion originelle de la théorie de Marx ne suffit pas à éclairer son destin, surtout si l'on n'établit pas précisément en quoi consiste l'étatisme qu'on lui impute [15].
S'agit-il d'un étatisme par excès ou d'un étatisme par défaut ? La révolution est-elle chevillée à l'État comme à un moyen condamné à se retourner contre elle en raison d'un éloge aveugle de l'État ou en raison d'une critique borgne de cet Etat ? La première critique est difficilement tenable : on pourrait lui opposer cent textes qui démentent l'existence d'un culte marxien de l'État. Reste la seconde, qui met en évidence que les effets d'une pensée coïncident avec les effets de ses impensés.
Ainsi, déclare Foucault, « ...entre l'analyse du pouvoir dans l'état bourgeois et la thèse de son dépérissement futur, font défaut l'analyse, la critique, la démolition, le bouleversement des mécanismes de pouvoir » [16] : la thèse même d'une destruction de l'appareil d'État bourgeois est grevée par l'ignorance des pouvoirs qui le sous-tendent et menacent d'en reconduire tous les effets [17] . Étatisme par défaut : telle serait la leçon de l'analytique du pouvoir, qui, menée à l'écart de Marx, permet de penser dans l'écart à Marx et, sur ce point, contre lui.
En effet, la conception de Marx ne permet ni de prévenir ni de comprendre ces « formes pathologiques » - ces deux « maladies du pouvoir » que sont le fascisme et le stalinisme - parce qu'elle néglige la spécificité des rapports de pouvoir et la mobilité des technologies de pouvoir [18] .
Certes Marx n'a pas réduit l'existence du pouvoir à l'État. « On ne trouve pas chez Marx lui- même », déclare explicitement Foucault, « le schématisme (...) qui consiste à localiser le pouvoir dans l'appareil d'État, et à faire de l'appareil d'État l'instrument privilégié, majeur, presque unique, du pouvoir d'une classe sur une autre [19]. » En particulier Marx n'a pas méconnu les rapports de pouvoir imbriqués dans les rapports de production, comme le rappelle Surveiller et punir, en faisant référence discrète, par une note en bas de page, aux analyses de Marx sur la discipline de fabrique dans Le Capital [20].
Mais on peut reconnaître, et cependant négliger... Or, à en croire ceux qui souhaitent fabriquer leurs meilleures soupes dans de vieux pots, Foucault devrait et pourrait se loger comme un coucou dans la théorie de Marx. Pourtant, c'est quand Foucault semble au plus près de Marx qu'il en est le plus éloigné [21].
Sans doute Foucault ne manque-t-il jamais de souligner que l'émergence des deux pôles du biopouvoir - les disciplines qui permettent d'assujettir les corps et les régulations qui permettent de contrôler les populations - est liée au développement économique du capitalisme et à la centralisation politique de l'Etat. Pourtant la référence constante, mais allusive et faible, aux analyses marxiennes permet toujours de faire valoir, mais contre elles, la spécificité des relations de pouvoirs et la relative autonomie des technologie de pouvoir [22] .
– En premier lieu, la conception de Marx ne permet pas de penser la spécificité des rapports de pouvoir.
D'abord, à trop insister sur le rôle de l'État, « on risque de manquer tous les mécanismes et effets de pouvoir qui ne passent pas directement par l'appareil d'État, qui souvent le supportent bien mieux, le reconduisent, lui donnent son maximum d'efficacité » [23]. Ensuite, à trop réduire la fonction des rapports de pouvoir, on ignore ceci : « Le pouvoir n'a pas pour seule fonction de reproduire les rapports de production. Les réseaux de la domination et les circuits de l'exploitation interfèrent, se recoupent et s'appuient, mais ils ne coïncident pas [24] . »
Plus généralement, Foucault montre que le champ et les technologie de pouvoir ne peuvent être analysés en en termes de dérivation à partir des rapports de production ou à partir de l'appareil d'Etat : ils doivent être compris en termes d'imbrication des rapports de pouvoir (et de l'ensemble des autres relations) et de centralisation (ou d'étatisation par l'État) de mécanismes naissant et persistant en dehors de lui [25].
Ainsi les rapports de production ne font plus office d'infrastructure, invitant à établir une causalité simple et linéaire qui placerait les rapports de pouvoir (et les types d'assujettissement) en position de dérivation ou de conséquence des autres rapports : les rapports de production eux-mêmes sont pris dans le jeu de relations complexes et circulaires.
Ainsi l'Etat ne fait plus office de simple superstructure dont la matérialité se confondrait avec celle de ses appareils et dont la fonction dériverait exclusivement de la division de la société en classes. L'État remplit une double fonction d'intégration des rapports de pouvoir - sur lequel Foucault fait porter tout le poids de son analyse - et de verrou des rapports de production - que Foucault mentionne, mais sans y insister [26] .
– Mais Marx n'a pas seulement négligé la spécificité et l'extension des rapports de pouvoir : sa conception ne tient pas compte de la relative autonomie des technologies de pouvoir.
L'analyse de Foucault déploie alors tout son potentiel : la mise à jour de technologies à la fois locales dans leur invention et leur mise en œuvre, et générales dans leur déploiement ; à la fois spécifiques et transférables. C'est parce que les relations de pouvoirs forment une couche spécifique que les technologies de pouvoir peuvent gagner en autonomie. Et c'est cette autonomie qui les rend transférables. En d'autres termes, c'est dans la mesure où il ne se confond pas avec les autres relations (d'exploitation, de domination) que le pouvoir est tout à la fois résistant à leur transformation (il peut demeurer sous-jacent à des transformations économiques et politiques) et mobile (transférable dans d'autres contextes d'exploitation ou d'oppression). Ainsi le nazisme et le stalinisme « ont utilisé et étendu des mécanismes déjà présents dans la plupart des autres sociétés » [27] et transféré les disciplines qui s'exercent sur les corps et les régulations qui s'exercent sur les populations : les deux pôles du biopouvoir [28] .
On comprend alors que Marx a favorisé, mais pas plus, l'émergence de ces maladies, en désarmant ceux qui auraient voulu les combattre et en laissant ceux qui les ont propagé le faire en son nom : abandonnant ceux qui voulaient les comprendre...à la lecture de Foucault.
Foucault a raison : le mariage forcé de l'État et de la Révolution, chez Marx, n'est pas, mais dans les termes que l'on vient de tenter de préciser, innocent. Et en suivant le fil de cette critique, pour, une nouvelle fois, la prendre en charge et la radicaliser, on pourrait, me semble-t-il, présenter ainsi l'étatisme par défaut de Marx. En critiquant, à travers Hegel, l'État moderne, Marx souligne que c'est dans le déchirement de la société civile que s'enracine la séparation de la société civile et de l'État, et que toutes les tentatives de résorber cette séparation sans abolir ce déchirement sont vouées à l'échec : la multiplication de médiations reconduit les contradictions sans les résoudre. Cette critique porte en creux une critique de l'État totalitaire : la suppression des médiations polarise les contradictions sans les abolir.
Or Marx attend de la conquête de l'État et d'une destruction de son appareil la réalisation des conditions d'une transformation sociale, qui abolisse les contradictions elles-mêmes. Mais Révolution est à ce point nouée à l'Etat qu'elle menace de se condamner elle-même : parce que il néglige de s'attaquer aux rapports de pouvoir qui soutiennent l'existence de l'État et aux technologies de pouvoir qu'il centralise, le discours de Marx laisse le champ libre à l'étatisme forcené que par ailleurs il prétendait combattre.
Ainsi, non seulement l'abolition des anciens rapports de domination politique et les réformes des anciennes formes d'exploitation économique n'empêchent pas de voir reconduire les technologies de pouvoir qui leur servaient de support, mais une Révolution peut-être l'occasion d'une intensification de leurs effets et de leur cumul avec ceux de nouvelles formes d'exploitation et de domination.
Au point que les tentatives de restauration démocratique peuvent laisser ces transferts opérer, à des degrés divers, en sens inverse, comme le montre la reconversion de la régulation raciste fondée sur une guerre de classe en une régulation raciste fondée sur la guerre des nations.
Au point que les pays réputés démocratiques ne cessent de réinventer les quadrillages disciplinaires et les régulations xénophobes.
Qu'est-ce que nos sociétés peuvent donc avoir en commun pour qu'elles laissent proliférer des stratégies et des technologies de pouvoir, omniprésentes et réversibles, que les formes démocratiques de l'État parviennent à peine à tempérer ?
Quelles sont donc ces racines de la rationalité politique que Foucault invitait à attaquer ? Ne se confondent-elles pas avec l'existence de ces rapports d'exploitation que Foucault mentionne sans s'y attarder ?
La réponse à ces questions - qui est aussi une réponse à ma question initiale : « A quoi bon en parler ? » - peut se découvrir partiellement ...à la lecture de Marx.
Henri Maler
[1] « Questions à Michel Foucault sur la géographie », revue Hérodote n°1, janvier - mars 1976. Repris dans Dits et écrits, tome 3, texte169.
[2] Les Mots et les Choses, éditions Gallimard, 1966, pp.273-275.
[3] Je reprends ici les termes mêmes de mon article : « Avec Marx, malgré Marx : Convoiter l'impossible », Chimères N°18, Hiver 1992-1993 publié ici même.
[4] Je ne mentionnerai que pour mémoire la tentative très discutable de lier la pensée de Marx à celle de Ricardo, par le truchement de la théorie de la valeur-travail. Non seulement une telle critique réduit l'écart entre les deux versions de la théorie, mais surtout elle abolit la différence de leur visée : le propos de Marx n'est pas d'élaborer une nouvelle théorie économique de la valeur, mais de procéder à une critique des rapports de production capitalistes, c'est-à-dire des rapports d'exploitation.
[5] À Sartre qui présente le marxisme comme « l'horizon indépassable de notre temps », Foucault réplique, qu'il appartient entièrement à la pensée du XIXe siècle. Aussi Foucault pourra-t-il - non sans injustice - affirmer : « La Critique de la Raison dialectique est le pathétique effort d'une homme du XIXe siècle pour penser le XXe siècle. En ce sens, Sartre est le dernier hégélien et je dirai même le dernier marxiste » (« L'homme est-il mort ? » (entretien avec C. Bonnefoy), Arts et loisirs, 15 juin 1966. Repris dans Dits et écrits, tome1, texte 39.
[6] L'Archéologie du Savoir, éditions Gallimard, mars 1969, p.21.
[7] L'Archéologie du Savoir, op.cit., p.22-23
[8] Elle est, comme le note Raymond Bellour en commentant ce texte de Foucault, « en retrait et en surplomb », (Raymond Bellour, « Vers la fiction » in Michel Foucault philosophe, Rencontre internationale de Paris, janvier 1988, Seuil, Paris, 1989, p.180).
[9] « Qu'est-ce qu'un auteur ? », Bulletin de la société française de philosophie, séance du 22 février 1969, dans Dits et Écrits, tome1, texte n°69.
[10] « La grande colère des faits », dans Le Nouvel Observateur, n° 652, 9-15 mai 197è7. Repris dans Dits et écrits, tome 3, texte 204.
[11] « Pouvoir et stratégies - Entretien de Jacques Rancière avec Michel Foucault », dans Révoltes logiques N°4, Hiver 1977, repris dans Dits et écrits, tome 3, texte n°218. Ou encore : « Le Goulag, toute une gauche » [et je souligne ici : et non pas toute la gauche] « a voulu l'expliquer sinon comme les guerres par la théorie de l'histoire, du moins par l'histoire de la théorie. Massacres, oui ; mais c'était une affreuse erreur » (...) "une faute de lecture ». (...) le stalinisme erreur a été un des principaux agents de ce retour au marxisme-vérité, auquel on a assisté pendant les années 1960 » (« La grande colère des faits », op. cit.)
[12] « Pouvoir et stratégies - Entretien de Jacques Rancière avec Michel Foucault », dans Révoltes logiques n°4 op.cit.
[13] « Ceux qui cherchaient à se sauver en opposant la vraie barbe de Marx au faux nez de Staline n'aimèrent pas du tout ». Mais on peut laisser un instant, avec Foucault, les adeptes d'un vrai Marx à leur déplaisir sans exhiber le crâne de Marx en le présentant comme celui de Staline enfant.
[14] « La grande colère des faits », op.cit.
[15] Le rabattement théoricien n'est pas moindre quand on invoque une aberration de la théorie pour établir une perversion originelle que lorsque l'on s'abrite derrière la pureté de la doctrine pour invoquer une perversion ultérieure : la logique de l'imputation, qu'elle plaide pour l'innocence ou la culpabilité est entièrement prise dans la logique judiciaire de l'aveu, tant que l'on établit pas précisément en quoi consiste l'étatisme de Marx.
[16] « Crimes et châtiments en U.R.S.S. et ailleurs », Entretien avec K.S. Karol, dans Le Nouvel Observateur, n°185, 26 janvier 1976. Repris dans Dits et écrits, tome 3, texte n°172.
[17] Foucault qui ne souscrit sans doute pas à la thèse d'un dépérissement possible, et a fortiori inévitable de l'Etat.
[18] Foucault le rappellera ainsi en 1982 que la question du pouvoir a valeur de test. Car elle n'est pas seulement une question théorique, « mais quelque chose qui fait partie de notre expérience » (« Deux essais sur le sujet et le pouvoir » (1982) in Un parcours philosophique de H. Dreyfus et P.Rabonow (collection Folio, Gallimard) pp.297-321
[19] Entretien avec Michel Foucault, Hérodote, déjà cité.
[20] Surveiller et Punir, éditons Gallimard, 1975, pp.219 sq. dont note 1 p.222.
[21] Comme le souligne, dans un contexte différent mais proche du nôtre, Etienne Balibar dans « Foucault et Marx. L'enjeu du nominalisme », in Michel Foucault philosophe, op.cit.
[22] Ce que dit Foucault de lui-même, à propos des disciplines, est sans doute vrai : « Je montre sans cesse l'origine économique ou politique de ces méthodes ». Mais il prend soin de préciser que « tout en ne mettant pas le pouvoir partout, je pense également qu'il y a une spécificité de ces nouvelle techniques de dressage », qui forment « une sorte de couche spécifique » (« Du Pouvoir », un entretien inédit avec Michel Foucault avec P. Boncenne, réalisé 1978, paru dans L'Express, 6 juillet 1984). Il en va de même de l'autre pôle du pouvoir - la régulation des populations - et plus généralement de l'émergence du biopouvoir, directement connecté au développement du capitalisme : « Ce biopouvoir a été, à n'en pas douter, un élément indispensable au développement du capitalisme ; celui-ci n'a pu être assuré qu'au prix de l'insertion contrôlée des corps dans l'appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de population aux processus économiques ». Mais c'est pour préciser aussitôt que le biopouvoir « a exigé davantage » : notamment « des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, les aptitudes, la vie en général, sans les rendre plus difficiles à assujettir. La volonté de Savoir, 1976, p.185.).
[23] Entretien avec Michel Foucault, revue d' Hérodote, 1976, op.cit.
[24] idem
[25] Ainsi que Foucault le rappelle dans « Deux essais sur le sujet et le pouvoir » in H. Dreyfuss et P. Rabinow, Un parcours philosophique, éditions Gallimard, 1984, p.310 et p. 318.
[26] « (...) si le développement des grands appareils d'État, comme institutions de pouvoir, a assuré le maintien des rapports de production, les techniques de pouvoir ont, elles aussi, agi au niveau des processus économique ». (La Volonté de Savoir, op. cit.,p.185.
[27] « Deux essais sur le sujet et le pouvoir » in Un parcours philosophique, op.cit., pp.297-321.
[28] « C'est sans doute vrai que les Soviétiques, s'ils ont modifié le régime de propriété et le rôle de l'État dans le contrôle de la production ont tout simplement pour le reste transféré chez eux les techniques de gestion et du pouvoir mises au point dans l'Europe capitaliste du XIXème siècle » (Entretien avec K.S. Karol, 1976, op.cit.). Voilà pourquoi, « On a avec la société soviétique l'exemple d'un appareil d'Etat qui a changé de mains et qui laisse les hiérarchies sociales, la vie de famille, la sexualité, le corps à peu près comme ils étaient dans une société de type capitaliste. Les mécanismes de pouvoir qui jouent à l'atelier entre l'ingénieur, le contremaître et l'ouvrier, croyez-vous qu'ils sont très différents en Union soviétique et ici ? » (Entretien avec Michel Foucault, revue Hérodote, 1976, op.cit.).
06.05.2024 à 11:39
« Avez-vous lu Pierre Bourdieu ? »
Henri Maler
Entretien paru dans L'Humanité du 1er février 2002, quelques jours après le décès de Pierre Bourdieu le 23 janvier 2002.
- Bourdieu, Foucault et alii / Pierre Bourdieu, EntretiensTexte intégral (1721 mots)

Entretien avec paru dans L'Humanité du 1er février 2002] [1]. Pierre Bourdieu est décédé le 22 janvier 2022.
En guise de préface, une citation de Jacque Bouveresse [2]
« S'il y a une chose encore plus difficile à supporter que la disparition d'une des figures majeures de la pensée contemporaine et, pour certains d'entre nous, d'un ami très proche, c'est bien le rituel de célébration auquel les médias ont commencé à se livrer quelques heures seulement après la mort de Pierre Bourdieu. Comme prévu, il n'y manquait ni la part d'admiration obligatoire et conventionnelle, ni la façon qu'a la presse de faire (un peu plus discrètement cette fois-ci, étant donné les circonstances) la leçon aux intellectuels qu'elle n'aime pas, ni la dose de perfidie et de bassesse qui est jugée nécessaire pour donner une impression d'impartialité et d'objectivité.
Si Bourdieu pouvait se voir en première page d'un certain nombre de nos journaux, et en particulier du Monde, il ne manquerait pas de se rappeler la façon dont il a été traité par eux dans les dernières années et de trouver dans ce qui se passe depuis quelques jours une confirmation exemplaire de tout ce qu'il a écrit à propos de l'"amnésie journalistique" [3]. »
– L'hommage presque unanime rendu par les médias à Pierre Bourdieu ne contredit-elle pas son analyse du journalisme ?
Henri Maler. Dans les premières lignes du très beau texte qu'il a consacré à Pierre Bourdieu, paru dans Le Monde daté du Jeudi 31 janvier, Jacques Bouveresse dit l'essentiel en quelques mots. Le rituel médiatique consécutif à la mort de Pierre Bourdieu offre une vérification quasi-expérimentale de son analyse de l'emprise du journalisme, en particulier sur la vie intellectuelle. Une même rhétorique sur le sociologue engagé et - narcissisme médiatique oblige - particulièrement engagé dans la « critique de la corruption médiatique » (pour reprendre une sottise entendue sur LCI…), a permis à nombre de journalistes, mais pas tous, incapables de prendre la mesure de son œuvre et de son action, de se tailler un Bourdieu à leur mesure, parfois pour l'encenser, plus souvent pour l'esquinter. Quant à nos majestés éditoriales - ce club des omniprésents que l'on peut lire, entendre et voir partout et sur tout - elles remplissent leur office : Alain-Gérard Slama (du Figaro) ou Alexandre Adler (du Monde), Jacques Julliard ou Françoise Giroud (du Nouvel Observateur) ont déjà prononcé leur condamnation définitive. D'autres suivront.
– On a pourtant reproché à Pierre Bourdieu - et pas seulement ce que vous venez de citer - sa virulence et son schématisme dans sa critique des médias…
Henri Maler. Il s'est même trouvé un sociologue comme Cyril Lemieux pour faire de Bourdieu un héritier de la critique de la « presse pourrie », comme on disait dans l'entre-deux guerres ; un éditorialiste comme Laurent Joffrin pour découvrir dans le travail de Pierre Bourdieu une variante du marxisme le plus vulgaire (c'est-à-dire du marxisme tel que Laurent Joffrin le comprend…) ; et une tripotée de journalistes en vue pour déclarer qu'on ne trouve dans l'analyse de Bourdieu que des poncifs. Pourtant, s'ils avaient lu ses interventions avec plus d'attention qu'ils ne lisent une dépêche d'agence sur le cours du Nasdaq, ils se seraient peut-être privés de l'audace de les rabattre sur ce qu'ils savent déjà ou croient savoir. Des banalités ? Supposons … L'analyse du journalisme doit commencer d'abord, pour reprendre hors de son contexte une formule de Michel Foucault, par « rendre visible ce qui est visible ». Et il n'en faut pas plus pour que les notables de la presse détournent-ils les yeux quand, à l'instar de Serge Halimi, on met en évidence l'existence d'un journalisme de connivence (véritable société de renvois d'ascenseurs), d'un journalisme de révérence (à l'égard de tous les pouvoirs), d'un journalisme à voix multiples mais qui parle (presque) toujours dans le même sens : un journalisme hégémonisé par quelques dizaines de présentateurs et d'éditorialistes attitrés, flanqués de commentateurs et d'éditorialistes associés. On comprend que ces tenanciers de l'espace médiatique préfèrent se réfugier dans « l'ignorance volontaire » de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, quitte à dénoncer dans l'analyse de Pierre Bourdieu une agression intolérable contre la totalité des journalistes … et dans la critique de l'entrée du Monde en Bourse une atteinte insupportable à l'indépendance de la presse.
– Cet examen « par le haut » des sommets de la profession ne peut pas se présenter comme un sociologie du journalisme.
Henri Maler. Et c'est bien pourquoi la sociologie de Pierre Bourdieu invite surtout à « rendre visible ce qui est caché », en proposant une analyse complexe du champ journalistique - un champ de forces et de conflits - au sein duquel se distribuent et agissent des professionnels très divers : du soutier de l'information de la presse quotidienne régionale aux grands reporters. Un champ dominé par l'emprise de la télévision et qui exerce à son tour une emprise sur d'autres champs, en particulier ceux de la production culturelle. Il faut tout l'anti-intellectualisme latent de certains journalistes pour croire qu'il ne s'agit-là que de compliquer à loisir le vocabulaire, alors qu'il s'agit de rendre compte d'un microcosme très différencié, dont le fonctionnement rend parfois peu visibles les effets quotidiens des logiques commerciales et financières auxquelles le journalisme est assujetti. Ainsi, il y a infiniment plus de sociologie du journalisme dans les quelques dizaines de pages de Sur la télévision que dans d'épais volumes qui se contentent d'entériner la connaissance spontanée que la profession a d'elle-même. D'autant que l'apport que la sociologie de Bourdieu peut apporter à la compréhension du journalisme ne se limite pas aux quelques textes qu'il a écrits sur le sujet ; eux-mêmes ne s'éclairent que par la totalité de son œuvre. Ce n'est pas tout : pressés d'en découdre sans comprendre, nos maîtres-tanceurs préfèrent ignorer que la totalité de cette œuvre a plus ou moins directement inspiré de nombreux travaux sociologiques. Pour n'en citer que quelques-uns : les enquêtes d'Alain Accardo, Gilles Balbastre et quelques autres sur Le journalisme au quotidien et Le journalisme précaire ; les articles des Actes de la Recherche en sciences sociales, ou la synthèse orientée, mais ouverte aux apports les plus divers, d'Erik Neveu parue sous le titre Sociologie du journalisme.
– Voulez-vous dire qu'il y aurait en quelque sorte une volonté de « ne pas savoir » ?
Henri Maler. Sans aucun doute. Alors que le journalisme d'investigation prétend nous faire connaître le dessous des cartes dans tous les milieux sociaux, les journalistes sont rarement invités par leurs patrons à enquêter sur eux-mêmes. Raison de plus pour ne pas abandonner l'analyse critique du journalisme et des médias aux seuls journalistes. Pierre Bourdieu avait soutenu, dès 1996, la constitution de notre association et approuvait, sans y participer, son activité. De son côté, Acrimed a trouvé dans l'œuvre de Pierre Bourdieu une de ses sources d'inspiration. Une œuvre qui mérite un débat à sa mesure : un débat sans déférence - ainsi qu'il le souhaitait lui-même. Sans déférence, mais non sans admiration, n'en déplaise à nos majestés éditoriales. Foucault se réjouissait - je cite de mémoire - d'avoir « fait trembler sur leurs tiges quelques nénuphars qui flottent à la surface de la pensée ». Pierre Bourdieu, à n'en pas douter, en a fait trembler quelques autres. Des nénuphars qui entretiennent souvent des rapports très intimes avec la vase…
Sur la couverture médiatique de la mort de Pierre Bourdieu, voir ici même « La mort de Pierre Bourdieu et l'emprise du journalisme » (1), suivi de « La mort de Pierre Bourdieu et l'emprise du journalisme » (2)
[1] Et reproduit sur le site d'Acrimed.
[2] Cette citation n'est pas parue dans L'Humanité, faute de place.
[3] « Pierre Bourdieu, celui qui dérangeait », par Jacques Bouveresse, Le Monde, 31 janvier 2001.
26.04.2024 à 11:41
Contre la guerre du Kosovo : « Appel européen pour une paix juste et durable dans les Balkans »
Collectif
Appel adopté lors de la réunion internationale tenue à Paris le 15 mai 1999
- Interventions, altercations / GuerresTexte intégral (1455 mots)

Appel adopté lors de la réunion internationale tenue à Paris le 15 mai 1999 [1]
Les participant(e)s à la réunion internationale, tenue à Paris le 15 mai 1999, se sont fait l'écho de nombreux appels convergents qui, en Europe et aux USA notamment, se sont opposés à la fois à l'épuration ethnique au Kosovo et aux bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie.
Les Etats qui ont lancé ou soutenu cette guerre non déclarée, menée en dehors de toute légalité internationale, ont prétendu qu'elle était morale et légitime puisqu'elle serait exclusivement justifiée par la défense des droits et des vies d'un peuple. Ils admettent que des "erreurs" ou des "dégâts collatéraux " ont été commis, mais il ne s'agirait que de " faux pas dans la bonne direction". Toute critique envers la guerre de l'OTAN reviendrait, nous a-t-on dit, à soutenir le régime de Slobodan Milosevic ou, au mieux, à refuser d'agir contre sa politique réactionnaire.
Tout cela est faux. Quel est le bilan de plusieurs semaines de bombardement de l'OTAN ? Une tragédie ! Chaque jour qui passe, la guerre aggrave la situation des populations civiles et rend de plus en plus difficile la résolution des conflits nationaux au Kosovo et dans l'ensemble de l'espace balkanique.
On ne peut tenir pour moraux et légitimes :
- une guerre qui fournit un prétexte à une terrible aggravation du sort du peuple kosovar qu'elle prétendait secourir et favorise son exode provoqué ;
- une guerre qui soude autour du régime répressif de Slobodan Milosevic la population yougoslave agressée et ainsi aveuglée sur les responsabilités de Belgrade dans le nettoyage ethnique des Kosovars ;
- une guerre qui renforce le régime, fragilise son opposition démocratique, y compris au Monténégro et déstabilise la Macédoine ;
- des bombardements qui tuent des populations civiles, détruisent des infrastructures, des usines et des écoles.
Cette guerre contredit en tous points ses buts affichés. Elle favorise un catastrophique engrenage, dont il faut sortir au plus tôt : entre, d'un côté, l'intensification des bombardements, poursuivis pour tenter de sauver la "crédibilité" de l'OTAN ; et de l'autre l'expulsion brutale et massive de populations, accompagnée d'un déchaînement de violences sans commune mesure avec la répression qui sévissait avant le déclenchement des bombardements.
Il n'est pas vrai que tout avait été tenté et que les bombardements étaient une riposte efficace à la répression serbe et une réponse appropriée à la défense des vies et des droits des Kosovars. Rien n'a été fait pour maintenir et élargir la présence des observateurs de l'OSCE et pour impliquer les Etats voisins et les populations concernées dans la recherche de solutions. Les gouvernements occidentaux ont accéléré la désintégration yougoslave et ils n'ont jamais traité de façon systématique les questions nationales imbriquées de cette fédération. Ils ont entériné le dépeçage ethnique de la Bosnie-Herzégovine conjointement organisé à Belgrade et Zagreb. Et ils ont laissé s'enliser la question albanaise du Kosovo parce qu'ils préféraient ignorer l'expulsion des Serbes de la Krajina croate.
À l'occasion des négociations de Rambouillet, ils ont opté pour le recours aux armées de l'OTAN au lieu de proposer une force d'interposition internationale, agissant sur mandat de l'ONU, alors qu'une telle proposition aurait pu être alors légitimement imposée face à un refus de Milocevic : cette force d'interposition aurait été beaucoup plus efficace pour protéger les populations que les bombes de l'OTAN.
Aujourd'hui, il faut exiger :
- Le retour de populations albanaises sous protection internationale, placée sous la responsabilité de l'Assemblée Générale des Nations Unies,
- Le retrait des forces serbes du Kosovo,
Et, pour atteindre ces objectifs, obtenir d'abord :
- La cessation immédiate des bombardements.
- La réouverture d'un processus de négociation sur ces bases, dans le cadre de l'ONU, non seulement n'implique aucune confiance envers Slobodan Milosevic, mais elle serait plus déstabilisatrice pour son pouvoir que les bombes qui n'ont depuis quelques semaines affecté que la population et l'opposition yougoslaves.
Une telle démarche doit reposer sur un principe et s'accompagner de moyens indispensables.
Un principe : le respect du droit des peuples, et notamment du peuple Kosovar albanais et serbe, à décider eux-mêmes de leur propre sort, dans le respectdes droits des minorités.
Des moyens :
- Une aide économique aux Etats balkaniques, uniquement et strictement subordonnée au respect des droits individuels et collectifs ;
- Une enquête sur les atrocités commises au Kosovo, conduite sous l'autorité du TPI ;
Le respect du droit d'asile, , selon les termes de la Convention de Genève, l'accueil de tous les réfugiés qui le souhaitent et des déserteurs yougoslaves et leur circulation dans tous les pays d'Europe.
Nous exigeons enfin un débat public dans nos pays sur le bilan de l'OTAN, sur le rôle qu'elle s'attribue désormais et sur les perspectives de la sécurité en Europe. Celle-ci ne saurait reposer, à nos yeux, sur une logique de guerre ou d'augmentation des dépenses d'armements, destinée à mener une politique de grande puissance, mais avant tout sur une politique de développement et d'éradication de la misère sociale et de réalisation des droits universels des peuples et des êtres humains, hommes et femmes.
Nous poursuivrons quant à nous :
- L'action de solidarité avec les oppositions démocratiques politiques, syndicales, associatives, féministes qui résistent aux pouvoirs réactionnaires ;
_- L'action de solidarité avec les populations expulsées, en défense de leur droit d'asile comme de leur droit au retour et à l'autodétermination.
À Paris, le 15 mai 1999
Signataires
Allemagne : Joachim Bishoff, Franzisca Brautner, Richard Detj, Wolfgang Gehrcke, Frigga Haug, Wolgang Fritz Haug, Alex Neumann, Jakob Schäffer, Dr. Peter Strutynski, Frieder Otto Wolf Autiche : Wielfried Graf Belgique : Mateo Alaluf, François Vercammen
Danemark : Soren Sondergaard
Espagne : Francisco Fernandez Buey, Jaime Pastor, Carlos Taibo, Manuel Vazquez Montalban, Asceu Uriarte
Etats-Unis : James Cohen
Grande-Bretagne : Sebastian Bogden, Daniel Singer
Italie : Salvatore Cannavo, Giuseppe Chiarante, Rossana Rossanda
Suède : Anders Fogelström
France : Nils Andersson, Olivier Azam, Nicholas Bell, Daniel Bensaïd, Martine Billard, Alexandre Bilous, Pierre Bourdieu, Philippe Boursier, Suzanne de Brunhoff, Philippe Chailan, Jean- Christophe Chaumeron, Patrice Cohen-Séat, Marianne Debouzy, Françoise Dielhmann, Zorka Domic, Bernard Doray, Yves Durrieu, Danielle Espagnola, Concepcion de la Garza, Elisabeth Gauthier, Serge Guichard, Michel Husson, Isabelle Kalinowski, Pierre Lantz, Frédéric Lebaron, Francette Lazar, Catherine Lévy, Isabelle Lorand, Henri Maler, Roger Martelli, Anne Mazauric, Jean-Paul Monferran, Aline Pailler, Claude F. Poliak, Jean Sagne, Catherine Samary, Anick Sicart, Jeanne Singer, Marie- Noëlle Thibaut, Rolande Trempé, Catherine Tricot, Patrick Vassalo, Raphel Weil, Francis Wurtz.
Lors du meeting du 15 mai 1999 à Paris, il a été reçu des messages de Joachim Bishopp et Richard Detje (Allemagne), Arthur Mitzman, Marcel van der Linden et Michael Kratetke (Pays-Bas), Tony Benn et Ken Loach (Grande-Bretagne), Ignacio Ramonet (France), Noam Chomsky et Edward Saïd (Etats-Unis).
[1] Publié dans L'Humanité du 17 mai 1999. Repris dans Pierre Bourdieu, Interventions, 1961-2001. Science sociale et action politique, éditions Agone2022, p. 432-035. Consultable sur le site DocPlayer. Voir aussi Serge Halimi, Dominique Vidal, Henri Maler, Mathias Raymond, L'opinion ça se travaille. Les médias et la « guerres justes », édition Agone, sixième édition 2014.
27.01.2024 à 14:08
Transformer les médias
Henri Maler
Texte intégral (2708 mots)

Contribution à un ouvrage collectif intitulé 2012 : les sociologues s'invitent dans le débat, coordonné par Louis Pinto et paru en février 2012, aux éditions du Croquant dans la collection Savoir/Agir : une contribution synthétique qui, dans les limites d'un nombre de signes limité, présentait quelques propositions de transformation des médias [1].
À actualiser et compléter.
Transformer les médias
La conjugaison de la « révolution numérique » et de la dérégulation libérale bouleverse l'ensemble du paysage médiatique : elle favorise la création de nouveaux supports et redistribue la place et les rapports entre ceux qui existaient jusqu'alors ; elle accélère la concentration et la financiarisation des médias privés ; elle modifie les rapports de forces entre les différents acteurs technologiques et économiques ; elle affecte les droits des créateurs et transforme leur rôle ; elle ébranle le journalisme professionnel (les conditions d'emploi et les pratiques). Mais plus que jamais c'est la recherche du profit qui gouverne ces transformations.
Éléments de diagnostic
Les concentrations des médias privés sont à la fois transnationales (même si ses effets en France restent peu perceptibles), multimédias (et conglomérales puisqu'elles touchent des pans entiers de la culture et des loisirs) et financiarisées : entendons par là qu'elles ne visent pas être seulement rentables, mais profitables. Ces concentrations n'englobent plus seulement les médias devenus traditionnels. Elles font intervenir, dans les domaines de l'information, de la culture et du divertissement, de nouveaux et puissants acteurs. Les groupes médiatiques traditionnels (en France : Dassault, Lagardère, Bouygues, etc.), géants, hier encore, de la production et de la diffusion des contenus sont des nains sur le plan économique, comparés aux géants des télécommunications, de l'industrie électronique et d'Internet : la confrontation est d'ores et déjà à l'œuvre. La régulation, l'arbitrage ou le contrôle (comme on voudra…) de ces transformations par des pouvoirs publics garants de l'intérêt général sont dérisoires.
L'invention, à un rythme inédit, de nouveaux supports technologiques (Internet, téléphonie mobile, I-Pad, livre numérique, etc.) et la diversification, voire la fragmentation, de l'offre modifient les usages des divers supports et redistribuent leurs places respectives. S'il faut se garder des prophéties, enthousiastes ou catastrophées, force est de constater que les transformations des modes de diffusion et de consommation appellent des transformations des contenus et des financements qui ne soient pas soumises aux seules « lois du marché ». La multiplication des tuyaux n'est en rien une garantie de la qualité et de la diversité des contenus et de leur production.
« Dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu es » : si cette formule est un raccourci, elle n'est pas dénuée de toute pertinence, au moment où les modes de financement se transforment, se diversifient et se déplacent, avec les mutations de l'offre et des usages. Le modèle économique du double financement de la presse écrite par le lectorat et la publicité est durement touché. Les reculs des télévisions et des radios généralistes ne sont pas compensés par les fragmentations thématiques ou locales. Les médias du secteur public voient leurs ressources raréfiées. Les médias du secteur associatif sont laissés à l'abandon. Les acteurs indépendants, sur Internet, sont loin de disposer des moyens suffisants.
Dans le même temps, une « course-poursuite » est engagée entre, d'une part, le développement d'Internet et des libertés qu'il offre et, d'autre part, les forces déployées, comme ce fut toujours le cas avec les nouveaux supports médiatiques, pour les livrer à l'appropriation privée (et lucrative) et au contrôle (voire la censure) étatique. Parmi les conséquences des projets et les mesures qui visent à conforter l'emprise économique et politique du libéralisme autoritaire (mais peut-être s'agit-il là d'un pléonasme…), on peut citer par exemple la numérisation des livres par Google, les privilèges accordés aux logiciels payants, les remises en cause périodiques de la « neutralité du net », la « Loi d'Orientation et de Programmation Pour la Sécurité Intérieure » (dite Lopps1) adoptée en 2002 et « Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (dite Loppsi2), adoptée en 2011, qui organisent la traque des internautes.
Les transformations en cours déplacent les frontières déjà poreuses entre les divers producteurs d'information et de culture, en généralisant les informations et les créations bénévoles et gratuites. Elles mettent à rude épreuve les droits des journalistes, des auteurs de livres et des créateurs. La généralisation de l'existence des articles et des livres sur divers supports s'effectue au détriment de leurs auteurs. Et sous couvert de protéger les droits des créateurs, la loi Hadopi entérine le dépérissement des droits d'auteur des journalistes et consacre l'emprise des artistes les mieux rémunérés et des sociétés de perception des droits.
Sous l'effet conjugué (et apparemment paradoxal) de la montée en puissance des contributions bénévoles particulièrement sur Internet (« blogs ») et de la recherche de la rentabilité ou de la profitabilité maximale, les conditions de travail et les productions des journalistes professionnels ne cessent de se dégrader. L'extension du journalisme précaire (et sous-payé) et l'intensification des rythmes de travail, la généralisation d'un journalisme de flux (et de recyclage des dépêches d'Agence de presse) et de scoops spectaculaires au détriment, le plus souvent (mais pas toujours…) du journalisme d'enquêtes, la domination d'une minorité d'éditocrates sur une majorité de soutiers de l'information constituent des tendances lourdes que ne parviennent pas à enrayer quelques contre-tendances.
Quelques cibles
Face à des transformations d'une telle ampleur, les réajustements marginaux ne suffisent pas et les réformes partielles, aussi souhaitables soient-elles, ne seront que de simples échardes si elles ne s'inscrivent pas dans une perspective d'ensemble.
Pourtant, les propositions qui suivent ne sont que des fragments d'une utopie concrète qui, pour être effectivement rationnelle, devrait tenir compte de plusieurs contraintes. En effet, les transformations en profondeur du paysage médiatique ne peuvent aboutir sans transformations du système politique dont le paysage médiatique est nécessairement solidaire. En outre, ces mêmes transformations dépendent pour une large part de la mise en cause de traités et de directives européennes dominées par un libéralisme économique sans frein. Elles dépendent enfin et par conséquent de rapports de forces sociaux et politiques, nationaux et européens, qui devraient inciter à distinguer des objectifs à court terme et des objectifs à plus long terme qui, visés à travers les premiers, peuvent être - provisoirement, on l'espère - hors d'atteinte.
On l'a compris : il s'agit de présenter ici non des promesses, mais des cibles
Constituer et constitutionnaliser un Conseil National des Médias
Organisme-fantoche dépendant du pouvoir politique, l'actuel Conseil Supérieur de l'audiovisuel (CSA) est un organisme-croupion qui ne remplit que des fonctions subalternes sur un segment, somme toute restreint, du paysage médiatique. Il devrait être remplacé par un Conseil National des Médias, radicalement différent par son statut, sa composition et ses missions. Un tel Conseil devrait être composé de représentants élus, de représentants des salariés des médias et des usagers des médias. En particulier, à défaut d'une élection spécifique (au demeurant envisageable), ce sont les proportions observées lors du premier tour des élections législatives qui devraient être respectées. Un tel Conseil devrait être constitutionnalisé et les rapports de ce « quatrième pouvoir » (dont la notion aurait ainsi une signification claire…) avec les autres pouvoirs trouver une place distincte dans la distribution des pouvoirs. Un tel Conseil devrait avoir en charge la régulation de l'ensemble du secteur des médias et notamment de l'application des dispositions législatives, de l'élaboration des dispositions réglementaires et de l'affectation des ressources publiques. Bref, de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions qui suivent.
Contrecarrer la concentration et la financiarisation des médias
La défense du pluralisme politique et de la diversité culturelle passe par la mise en œuvre de dispositifs qui visent, directement et indirectement, à limiter les concentrations financiarisées et à leur opposer les renforcements des médias sans but lucratif et des droits des journalistes et des salariés.
Ces dispositifs anti-concentration ne consistent pas seulement, ni même peut-être prioritairement, en mesures d'imposition de seuils de concentration ; ils doivent veiller simultanément à contrecarrer la financiarisation des médias et l'emprise de la publicité.
De là, la nécessité d'un ensemble de mesures législatives destinées à abaisser le seuil des concentrations autorisées par les dispositions françaises (et d'un combat pour son abaissement conjoint et unifié dans l'ensemble des pays européens) .Les critères d'imposition de seuils de limitation des concentrations mono-médias ou multimédias, devraient cumuler des seuils de concentration capitalistique, des limitations du nombre de titres et de canaux possédés et des maxima d'audience ou de diffusion.
Dans le même esprit, il est indispensable d'interdire le contrôle des actifs médiatiques par des firmes qui sont largement présentes dans d'autres secteurs d'activité économique et, en particulier, par des firmes qui dépendent de l'obtention de marchés publics. De telles dispositions s'imposent particulièrement en France face à l'emprise de Bouygues, Dassault et Lagardère. De même, il est nécessaire non seulement de s'opposer à toute nouvelle privatisation des médias publics et des infrastructures de télécommunication, mais également de remettre en cause les privatisations déjà réalisées et de s'opposer à toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pensions ou des groupes et conglomérats multinationaux. Enfin il convient de limiter l'ampleur des financements par la publicité en réduisant la surface ou la durée des messages publicitaires.
Il reste que la meilleure des résistances contre les concentrations capitalistes réside dans la constitution d'un service public de l'information et de la culture.
Constituer un service public de l'information et de la culture
L'information et la culture sont des biens communs. Ils ne peuvent le rester ou le devenir qu'à condition que l'ensemble de leurs moyens de production et de diffusion fassent l'objet d'une appropriation démocratique qui donne la priorité à des médias sans but lucratif.
Une telle appropriation devrait reposer sur la conjugaison de deux formes de propriété : la propriété publique et la propriété coopérative L'ensemble de ces mesures pourraient permettre de développer un service public de l'information et de la culture, adossé à deux formes de propriétés ou deux secteurs : le secteur public et le secteur associatif.
(1) L'appropriation publique n'est pas condamnée à virer à la confiscation étatique et bureaucratique, du moins sous certaines conditions, parmi lesquelles la constitution et la constitutionnalisation d'un Conseil National des Médias indépendant et l'extension des droits des salariés des médias.
Cette appropriation publique devrait inclure, sous des formes spécifiques, le secteur public de l'audiovisuel, l'AFP et les infrastructures techniques des télécommunications et permettre de mutualiser les moyens de production, d'impression et de diffusion.
Plus précisément, l'audiovisuel public devrait retrouver la maîtrise de sa programmation et de sa stratégie économique. Ce qui passe par la fin de la concurrence faussée avec la principale chaîne de télévision et donc la déprivatisation de TF1. Ce qui suppose, en outre et entre autres, les mesures suivantes : l'intégration de l'audiovisuel extérieur (RFI et France 24) à France Télévisions ; l'abrogation des décrets Tasca (qui contraignent à un externalisation presque complète de la production et à l'abandon de tous les droits dérivés) ; l'augmentation progressive de la redevance qui serait rendue proportionnelle aux revenus.
À ces conditions, l'offre multimédia, garante du pluralisme politique et de la diversité culturelle, pourrait être effective sur tous les canaux.
(2) L'appropriation coopérative n'est pas condamnée à l'impuissance pour peu que lui soient donnés les moyens légaux et financiers de se développer. Les médias associatifs et coopératifs du tiers secteur (télévisions, radios, sites, journaux associatifs) sont aujourd'hui délaissés : ils sont privés de ressources suffisantes, d'accès à la TNT pour les télévisions et d'aide à la presse pour les journaux et pour les sites associatifs qui n'emploient pas de journalistes professionnels.
Or, l'importance de ces médias ne se mesure pas seulement à leur audience quantitative (d'ailleurs souvent sous-estimée) : médias de proximité, de partage et de solidarité, ils entretiennent des rapports qualitatifs irremplaçables avec leur usagers ; viviers de formation de journalistes et de créateurs culturels, ils sont indispensables à la diversité, notamment sociale, de l'information et de la culture. Ce faisant, ils participent pleinement à la refondation d'un service public bien compris. Ils doivent bénéficier d'une place et d'aides publiques appropriées.
(3) La presse écrite quotidienne confrontée à la crise du modèle économique fondé sur le double financement par la publicité et par les lecteurs, et à l'érosion de son lectorat, vit sous perfusion, notamment grâce aux aides publiques à la presse. C'est pourquoi il est urgent de transformer ces aides, qu'elles soient directes ou indirectes, pour qu'elles soient attribuées prioritairement, voire exclusivement aux médias sans but lucratif, qu'ils soient privés ou associatifs, et donc de créer un statut des sociétés de presse à but non lucratif.
Garantir les droits des journalistes, des créateurs et des usagers
L'ensemble des dispositions spoliatrices et liberticides, comprises dans les lois évoquées plus haut doivent être abrogées. Les droits des journalistes, des créateurs et des usagers doivent être garantis. Les journalistes doivent disposer de droits collectifs reconnus : c'est pourquoi il est nécessaire que les codes de déontologie soient annexés à la convention collective nationale et que les rédactions se voient reconnaître un statut juridique (et des droits effectifs) au sein de chaque média. Les usagers des médias, pour ne pas être traités en simples consommateurs, doivent être représentés, ne serait-ce qu'à titre consultatif, dans les principales instances d'orientation et de régulation des médias. La critique des médias, enfin, ne saurait être limitée au « Courrier des lecteurs » et aux « forums d'internautes » ni être réservée aux professionnels de la profession et autres « médiateurs ». C'est pourquoi cette critique, dotée non de pouvoirs de sanction, mais de pouvoirs d'interpellation doit être favorisée.
Si un autre monde est possible, d'autres médias le sont aussi ; pour qu'un autre monde soit possible, d'autres médias sont nécessaires.
Henri Maler, janvier 2012.
[1] Contribution publiée également sur le site d'Acrimed.
15.01.2024 à 13:32
Georges Sorel : de l'utopie au mythe (1)
Henri Maler
Des critiques de la science aux critiques de l'utopie
- Notes et travauxTexte intégral (9097 mots)

L'essai qu'on va lire, à bien des égards besogneux en raison de sa longueur et de la surabondance des citations, s'inscrit dans une recherche sur les impasses stratégiques que Marx a légué à ses successeurs. Nous en sommes encore les contemporains.
Version provisoire (en deux parties), dans l'attente d'une version plus courte moins prolixe en citations.
Georges Sorel (1847-1922), inclassable et insaisissable ? Inclassable, car il serait sans parenté parmi ses contemporains et sans postérité parmi les marxismes. Insaisissable, car son œuvre se déploierait en suivant d'inextricables méandres à l'intérieur d'instables frontières. Il est possible pourtant de suivre ou de retracer son parcours ou l'un de ses parcours et de saisir la structure significative que condense l'opposition entre le mythe et l'utopie C'est à tenter de dégager cette structure significative sans la soumettre à un examen critique détaillé que sont consacrées les notes qui suivent (et dont les références bibliographiques figurent en annexe).
I. Des critiques de la science aux critiques de l'utopie
La pensée de Georges Sorel, du moins jusqu'en 1910, peut être comprise comme une tentative de se dégager de l'utopie scientiste : elle se présente comme une critique du devenir utopique de la science fondée par Marx. Cette critique prolonge et radicalise la critique des utopies proprement dites et procède d'une mise en question de la science et des prétentions scientifiques, non seulement de l'orthodoxie dogmatique héritière de Marx, mais aussi de la théorie de Marx elle-même.
Préambule : La science en question
La critique des prétentions scientifiques, qu'il s'agisse des sciences en général ou de celles dont se prévalent marxistes et utopistes, fondateurs et successeurs, orthodoxes et hétérodoxes, passe par une clarification préalable du concept de science. Or, comme le montrent les textes réunis par Thierry Paquot sous le titre Décomposition du marxisme et autre textes, Sorel commence par accepter une conception de la théorie de Marx qui l'assimile aux sciences physiques et qui correspond, par conséquent aux interprétations positivistes ou scientistes du marxisme [1].
Dès 1893, dans un article intitulé « Science et socialisme », Sorel commence par distinguer la science que revendiquent les utopistes et la science rationnelle dont Marx se prévaut. Si, dit-il, cette science mérite examen, c'est à condition de l'entendre dans un sens proche de celui que l'on donne aux notions de science et de lois en physique : « On traite volontiers les socialistes de rêveurs ; on les compare à Platon et à Th. Morus. La science rationnelle et l'utopie sont choses quelque peu différentes (...) ». Et Sorel d'esquisser, quelques lignes plus bas, l'analyse de cette différence :
Les anciens inventeurs de réformes ne croyaient pas à la science ; ils imaginaient des recettes sociales destinées à faire le bonheur de l'humanité. S'ils parlaient de science et de lois sociologiques, c'était dans un sens bien éloigné de celui que l'on donne aux mots science et lois en physique. (...) Le socialisme moderne croit qu'il existe une science, une vraie science économique. Cette thèse est-elle fondée ? Voilà ce qu'il faudrait examiner d'un peu plus près qu'on ne l'a fait jusqu'ici (...) [2].
La science des socialistes et donc de Marx - comprise comme science positive opposée à l'utopie – devrait, si elle existe, être appliquée : « Le socialisme prétend établir, aujourd'hui une science économique ; si sa prétention est fondée, il a le droit de réclamer la refonte législative de l'État ; ses théorèmes doivent être appliqués ; ce qui est rationnel et démontré doit devenir réel [3]. » La prétention scientifique de Marx doit donc être mise à l'épreuve [4].
Non seulement la science dont se prévalent les socialistes et plus particulièrement Marx n'est pas équivalente aux sciences physiques, mais le socialisme ne relève pas de l'application d'une science quelconque. S'engager dans cette voie conduit inévitablement Sorel à une impasse : il ne s'y attardera pas.
S'agissant des prétentions scientifiques, la critique de Sorel s'exerce dans deux directions complémentaires (que l'on distinguera ici par souci de clarté) : contestations de l'autorité de la science et critiques la validité de la science de la théorie de Marx.
Dans l'article intitulé « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899) Sorel souligne que l'autorité de la science est un puissant argument. Aussi s'emploie-t-il à renverser cette autorité. C'est ainsi qu'il note : « L'expression socialisme scientifique flattait les idées courantes sur la toute-puissance de la science et elle a fait fortune [5]. »
C'est dans cet esprit qu'il refuse d'être aveuglé par les abus du terme de science qui permettent de revendiquer indûment son autorité. Il dénonce en particulier deux usages extensifs du terme de science destinés à annexer cette autorité : l'usage du terme de science qui permet d'embrasser l'utopie elle-même [6] et l'usage du terme de Wissenschaft par Engels et ses disciples qui n'a que de lointains rapports avec la science des savants.
La critique qui s'exerce alors prend pour cibles la superstition scientifique et l'orthodoxie dogmatique.
1. Critique des « superstitions scientifiques »
Prétention scientifique et superstition scientifique doivent être distinguées : si la prétention scientifique de la pensée de Marx doit être mise à l'épreuve, la superstition scientifique doit être, au contraire, immédiatement récusée.
C'est en effet céder à la superstition scientifique - la crédulité à l'égard de la science qui s'en remet à son autorité - que de soutenir d'emblée que la science sociale est aussi bien fondée que les sciences physiques et biologiques et surtout qu'elle est fondatrice d'un socialisme déduit de cette science. C'est ce que Sorel souligne dans l'article intitulé « La crise du socialisme » (1898) :
À l'époque où la propagande socialiste recommença en France, il y a un peu plus de vingt ans, on avait dans la science une confiance qui nous étonne un peu aujourd'hui. On croyait qu'il existe une science sociale, fondée sur les sciences physiques et biologiques, capable de résoudre tous les problèmes posés depuis la Révolution (...). On importait en France les théories de Marx (...). Le nom du célèbre philosophe allemand exerça à cette époque une grande influence ; on crut qu'on était arrivé à posséder un socialisme déduit de la science [7] . [souligné par moi]
Sorel, dans ce même article, revient donc sur l'illusion qu'il a provisoirement entretenue quand il rédigeait « Science et socialisme » (1893) [8] : il serait contradictoire avec l'esprit même de la science de concevoir le socialisme comme l'application d'une science aussi fondée soit-elle :
Bien loin de marquer la déchéance du socialisme, la crise actuelle du socialisme scientifique marque un grand progrès : elle facilite le mouvement progressif en affranchissant d'entraves la pensée. Longtemps on a cru que le socialisme pouvait déduire ses conclusions de thèses scientifiques et être une science sociale appliquée ; un interprète fort habile de Marx, M.B.Croce, a montré qu'une pareille opération est impossible à réaliser. La science doit se développer librement sans aucune préoccupation sectaire ; la sociologie et l'histoire existe pour tout le monde de la même manière ; il ne saurait y avoir une science appropriée aux aspirations de la social-démocratie, de même que les catholiques intelligents ne pensent plus qu'il puisse y avoir une science catholique [9]. [souligné »par moi]
On peut d'ores et déjà, par anticipation, tracer le trajet que suit Georges Sorel. s'en remettre à l'autorité de la science revient à substituer cette autorité de la science – « un socialisme déduit de la science » [10] - à la spontanéité du prolétariat - un socialisme produit par le mouvement ouvrier : « Le socialisme n'est pas une doctrine, une secte, un système politique ; c'est l'émancipation des classes ouvrières qui s'organisent, s'instruisent et créent des institutions nouvelles. » Et d'ajouter : « C'est pourquoi je terminais par ces mots un article sur l'avenir socialiste des syndicats : “Pour condenser ma pensée en une formule, je dirai que tout l'avenir du socialisme réside dans le développement des syndicats ouvriers” [11]. »
Autrement dit, la critique de la superstition scientifique sous-tend donc à la fois la critique de l'utopisme quand il se présente comme scientifique et la critique du scientisme marxiste qui se prévaut de la pensée de Marx. Et cette double critique, couplée à l'éloge du syndicalisme, culmine dans l'apologie des mythes : nous y reviendrons après un long détour.
En effet, la superstition qui incite à s'en remettre à l'autorité de la science conduit inévitablement à s'empêtrer dans ses dogmes : l'orthodoxie dogmatique fait corps avec la superstition scientifique. Ce qui est vrai des discours de sectes utopiques (fouriéristes et saint-simonienne notamment) l'est particulièrement du marxisme… orthodoxe.
2. Critique de l'orthodoxie dogmatique
La critique sorélienne du marxisme gagné par l'orthodoxie dogmatique repose sur une opposition fondamentale entre la lettre et l'esprit de la pensée de Marx. D'où cette déclaration d'intention, formulée une première fois dans « Pour ou contre le socialisme » (1897) :
Plus on va, plus on se débarrasse de tout le bagage aprioristique, légué par le passé. Ce qui est spécifiquement la conception marxiste me semble assez large pour pouvoir contenir les théories nouvelles à élaborer ; mais il est évident qu'il ne faut pas aborder ces difficultés avec un esprit théologique ; il faut s'inspirer de l'esprit plutôt que des textes [12]. [souligné par moi]
Et Sorel d'inviter, dans « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), à distinguer « les théories de Marx » et « les programmes des partis » et à « être fidèle à l'esprit de Marx » [13]. [souligné par moi]
Telle est l'attitude que Sorel, deux ans plus tard, dans « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme : Bernstein et Kautsky » (1900), met au crédit de Bernstein :
Avec M. Bernstein, on aime à se figurer que le marxisme constitue une doctrine philosophique, encore pleine d'avenir, qu'il suffit de l'émanciper de commentaires mal faits et de la développer en tenant compte des faits récents. L'auteur poursuit, avec une bonne foi admirable et une grande habileté, une œuvre de rajeunissement du marxisme : des formules surannées ou des interprétations fausses, il en appelle à l'esprit même de Marx ; c'est d'un retour à l'esprit marxiste qu'il s'agit [14]. [souligné par moi]
Force est de constater que ce que Sorel entend pas « esprit de Marx » ou esprit du marxisme n'est pas d'une lumineuse clarté.
Quoi qu'il en soit, Sorel ne variera pas dans cet éloge de Bernstein. Même quand l'orientation qui en découle se sera clairement manifestée, Sorel lui trouvera encore d'indéniable mérites et des excuses [15]. Parmi ces mérites : avoir pris la mesure de la contradiction entre le discours et la pratique de la social-démocratie et avoir invité ses camarades à avoir « le courage de paraître ce qu'ils étaient » [16]. C'est pourquoi, dans « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), Sorel salut ainsi la contribution de Bernstein : « il invite les socialistes à jeter par-dessus bord les formules, pour observer le monde, pour y pénétrer et surtout pour jouer un rôle vraiment efficace [17]. »
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point décisif : c'est le syndicalisme révolutionnaire qui incarnera bientôt le véritable esprit du marxisme, le retour à l'esprit du marxisme qui caractérise ce que Sorel appelle alors « La nouvelle école » [18].
L'opposition entre l'esprit et la lettre du marxisme en gouverne quelques autres que Sorel mentionne dans « La crise du socialisme » (1898). C'est dans l'intention de rester fidèle à l'esprit du marxisme qu'il oppose dans cet article : l'analyse du mouvement réel et le commentaire des textes [19] ; le socialisme des choses et le socialisme des socialistes [20] ; les leçons de la pratiques et les leçons des livres [21].
Rester fidèle à l'esprit du marxisme impose donc de procéder à une critique de l'orthodoxie dogmatique. Il s'agit de compléter, approfondir, adapter, réviser le marxisme. Sorel retrace ainsi, dans « Mes raisons du syndicalisme » (1910), le parcours qui fut le sien :
J'étais persuadé en 1894 que les socialistes soucieux de l'avenir devaient travailler à approfondir le marxisme, et je ne vois pas encore aujourd'hui que l'on puisse adopter un autre procédé pour construire cette idéologie dont a besoin le mouvement prolétarien [22].
Mais, précise Sorel, si j'avais aperçu les « graves lacunes » du « marxisme officiel « , les moyens faisaient primitivement défauts qui permettraient de « l'adapter à la réalité » .
L'étude de l'ouvrage de Saverio Merlino [23] lui montre qu'il est « devenu nécessaire de réviser les bases des théories socialistes afin de les mettre d'accord avec le mouvement social » [24]. Plus généralement, Sorel déclare que ses premiers écrits sont des « études que je faisais pour renouveler le marxisme par des procédés marxistes » [25]. La nécessité d'une révision aurait été, aux yeux de Sorel, relancée par l'affaire Dreyfus : « la révolution dreyfusienne constitue (...) une expérience qui établit de façon irréfutable l'insuffisance des théories socialistes reçues de ce temps [26]. »
C'est cette révision nécessaire, reconnue par Bernstein, qu'aurait accompli « La décomposition du marxisme » (1908), mais en suivant une autre méthode que celle de Bernstein [27].
Autant le dire clairement dès maintenant : pour Sorel, le marxisme dogmatique n'est pas moins utopique que les utopies proprement dites. En conséquence, Sorel invite à abandonner l'orthodoxie dogmatique pour revenir à l'interprétation (philosophique) du mouvement réel [28]. C'est ce retour au mouvement réel qu'accomplit, selon Sorel, « L'Avenir socialiste des syndicats » (1898) dont il célèbre la formule dans Réflexions sur la violence en affirmant : « C'était le commencement de la sagesse ; on s'orientait vers la voie réaliste qui avait conduit Marx à ses véritables découvertes [29]. »
Mais cette orientation rend nécessaire une critique de l'autorité scientifique de Marx lui-même.
3. Critique de l'autorité scientifique de Marx
S'il ne fait pas de doute pour Sorel que la validité du marxisme doive être mise à l'épreuve [30], cette validité doit être éprouvée dans les limites de son concept comme science économique ou science sociale [31]. Mais cette critique, ici survolée, s'étend à la critique du communisme de Marx.
3.1.Critique de la science de Marx
Selon Sorel, l'examen de la doctrine de Marx se heurte à des difficultés préjudicielles :
- Absence de clarté, notamment terminologique. Sorel justifie la nécessité de « s'inspirer de l'esprit plutôt que des textes » : « Cela est d'autant plus nécessaire que les textes de Marx sont, très souvent, d'une interprétation difficile : rien ne ressemble tant à la Philosophie de la nature de Hegel que le Capital. Marx a créé une terminologie ou plutôt plusieurs (...) ». Et Sorel de noter la pluralité des registres de la terminologie, l'existence de formules abstraites « présentées sans préparation », de « formules symboliques », de difficultés de traduction [32].
- Absence d'exposé didactique et systématique : « Il faut reconnaître que le système de Marx présente des difficultés considérables pour la critique, parce que l'auteur n'en a point donné un exposé didactique [33]. »
Ces difficultés étant posées, la critique par Sorel de la lettre de la doctrine fait flèche de tout bois et dans toutes les directions.
C'est le cas de la science économique, première à être sommée de rendre compte de ses prétentions [34]. Aussi l'évaluation du Capital de Marx, et plus particulièrement de la théorie de la valeur est-elle plusieurs fois reprise. C'est ainsi que Sorel demande que l'on tienne compte des travaux de W. Sombart et de C Schmidt, rend compte avec bienveillance de l'ouvrage de M. Merlino, et développe sa propre interprétation [35]. De même Sorel, en commentant Bernstein, reprend et étend les critiques contemporaines de la théorie de la valeur [36]. Enfin, il mentionne à plusieurs reprises de façon élogieuse les critiques de B. Croce [37]. La thèse fondamentale que Sorel accrédite est la suivante : « Il n'y a pas dans Marx de vraie théorie de la valeur [38]. »
C'est ensuite l'analyse des classes sociales et de leurs luttes, et en particulier des thèses sur la simplification de la composition des classes et de leurs antagonismes qui fait l'objet d'un examen répété [39].
De façon plus générale c'est le matérialisme historique, qui fait l'objet du plus large examen [40]. Mais c'est la discussion de la dialectique qui, comme on va le voir, mérite qu'on s'y arrête particulièrement [41].
Or, en dépit de leur ampleur, ce ne sont pas ces critiques qui sont décisives dans le déploiement de la conception originale de Sorel.
3.2. Critique du communisme de Marx
Déterminante est la critique des thèses de Marx qui, pour Sorel, excèdent les limites de toute science concevable, c'est-à-dire, dans l'esprit de Sorel, de toute science conçue sur le modèle des sciences positives : l'avenir prévisible, la catastrophe inéluctable, la dialectique historique. De proche en proche, c'est le communisme de Marx qui est dissous.
– L'avenir prévisible ?
Critique qui déborde celle de Marx et qui l'englobe : Sorel conteste que la science puisse prévoir l'avenir. D'abord, parce que l'évolution des sociétés ne peut pas être enfermée dans des formules [42] et surtout parce que l'avenir est hypothétique. Sorel le souligne avec insistance dans « Pour ou contre le socialisme » : « Sans doute on peut faire sur l'avenir des hypothèses nombreuses ; et la science ne permet d'en rejeter sûrement aucune, l'avenir étant pour la science enfermé dans le livre des Sept-Sceaux ; mais il y a des hypothèses plus vraisemblables les unes que les autres [43]. »
Ces hypothèses sont-elles nécessaires ou inutiles ? À quelques pages de distance, Sorel semble se contredire.
À la suite de Saverio Merlino, il soutient que les formules marxistes sur l'avenir de la propriété, de la famille, de l'État ne sont que des hypothèses stériles : « Ce sont là des hypothèses indémontrables et fort inutiles , je crois, au socialisme ». Ce sont « des survivances d'anciennes hypothèses sur l'avenir [44]. » [souligné par moi]
Mais, de telles hypothèses peuvent (malgré tout ?) s'avérer nécessaires : « L'histoire est tout entière dans le passé ; il n'existe aucun moyen de la transformer en une combinaison logique. Tout ce que nous disons de l'avenir est pure hypothèse, mais hypothèse nécessaire pour fournir des bases à notre activité [45]. » [souligné par moi].
Quelques années plus tard (nous y reviendrons), Sorel considèrera que ces hypothèses sont des mythes indispensables au socialisme.
Dès lors, s'agissant de Marx, ce sont le but final, le contenu et les modalités du communisme qui sont mis en cause [46].
Si l'esquisse du contenu du communisme relève d' « hypothèses indémontrables et fort inutiles », si elles ne sont que des « affirmations hasardées » que l'on doit comprendre comme des « survivances d'anciennes hypothèses sur l'avenir » [47], c'est notamment parce que l'idée même d'une nécessité historique du communisme n'est pas fondée.
Sorel résume favorablement les thèses de Bernstein qui « voudrait qu'on abandonnât l'idée de nécessité historique », que l'on distingue l'espérance d'une sortie de la préhistoire de l'humanité et « les parties sociologiques » de l'œuvre de Marx et Engels. Il convient de renoncer à l'idée d'une « prédestination sociale » - à l'idée d'une « palingénésie sociale » qui serait « fatalement amenée par la loi immanente du régime capitaliste » [48].
Encore faudrait-il distinguer deux idées, parfois confondues par Marx lui-même : la nécessité inéluctable du communisme et sa nécessaire possibilité [49]. Faute d'effectuer cette distinction, Sorel abandonne la perspective communiste.
Ainsi, Sorel attribue à Bernstein « le grand mérite de mettre en pleine lumière que Marx a fait ses recherches scientifiques en vue de justifier des thèses socialistes préconçues et que ses prénotions l'ont empêché de faire un travail satisfaisant ».
Et non content de citer Bernstein quand celui-ci affirme de Marx que « ce grand scientifique était le prisonnier d'une doctrine », Sorel poursuit : « Je crois qu'on pourrait aller plus loin et je me demande dans quelle mesure Marx était sérieusement communiste (...) ». Et d'affirmer notamment : « En 1875, dans sa lettre sur le programme de Gotha, Marx n'ose pas renier complètement le communisme, mais le renvoie à une date si lointaine et si indéterminée qu'en fait il le supprime [50]. » [souligné par moi]
Ce point est décisif : Sorel lui-même « supprime » la perspective du communisme. Tous les textes de Marx qui en évoquent la perspective et les conditions (domination politique ou dictature du prolétariat, socialisation de la production) – du Manifeste au Capital, en passant par La guerre civile en France - sont négligés.
Ainsi se trouve entériné l'effondrement de toute perspective stratégique fondée sur le communisme de Marx.
Ce n'est pas tout : dans le même mouvement, la théorie de la catastrophe, solidaire d'une certaine philosophie de l'Histoire est récusée [51].
– La catastrophe inéluctable ?
Une fois encore, la critique déborde et englobe la conception de Marx.
Sorel refuse que l'on puisse attribuer à Marx, comme le fait Saverio Merlino « un fatalisme économico-révolutionnaire » ou que « le bien doit sortir de l'excès du mal : le pire est le meilleur » [52]. Mais il admet la critique de « la conception catastrophique du socialisme » proposée par le même Merlino, auquel Bernstein, dit-il « s'est rallié » et la critique le « blanquisme révolutionnaire » [53].
Aussi Sorel entreprend-il à son tour « la discussion des thèses catastrophiques », en confrontant l'avant-dernier chapitre du Livre I du Capital et le Manifeste. Et il propose de distinguer les descriptions empiriques et les thèses catastrophiques, et voit dans l'avant-dernier chapitre un fragment, qui a été comme beaucoup d'autres parties anciennes, introduit dans Le Capital.
Il rejoint ainsi la conception de Bernstein selon lequel les écrits anciens de Marx « exhalent un parfum blanquiste, c'est-à-dire babouviste » et soutiennent le « terrorisme prolétarien ». Aussi Sorel soutient-il contre Kautsky que la « théorie de l'effondrement » existe bien dans la social-démocratie et que cet effondrement consisterait « en un long régime terroriste imité de 93 » . Et de conclure : « Cela était certainement la pensée de Marx et Engels autrefois ; c'est la pensée qui se dégage du texte apocalyptique. M. Bernstein a eu le très grand courage de dire ce qu'il en était [54]. »
Or quelques années plus tard (nous y reviendrons), Sorel considèrera que la catastrophe (comme les hypothèses sur l'avenir) figure parmi mythes indispensables au socialisme.
En revanche, la critique la substitution de la logique - et de la dialectique ainsi comprise - à l'histoire réelle [55] ne sera pas abandonnée .
– La dialectique historique ?
C'est particulièrement la dialectique qui est en question [56].
Sorel se félicite que Colajanni ait pu « laisser de côté (...) la théorie dialectique qui, d'après Engels, serait caractéristique de la nouvelle manière de penser ». Et Sorel de citer longuement Labriola « dans l'espoir - précise-t-il dans une note de 1914 - qu'un lecteur habile trouve un sens à cet oracle ». Engels est alors mis à contribution : « Cette mystérieuse dialectique est chose assez simple d'après les exemples donnés par Engels ». Mais si Sorel résume ces exemples, c'est pour conclure : « Ce ne sont vraiment que jeux de mots et il me semble qu'on peut fort bien se passer de toutes ces amusettes ; (...) je crois que cette dialectique n'a rien à faire avec le marxisme [57]. »
Dès lors, l'impossibilité de prévoir l'avenir ne peut pas, déclare Sorel, être contrebalancée par le recours à la logique hégélienne. Les trois moments qui, selon lui, sont envisagés dans la lettre sur le programme de Gotha ne doivent pas faire illusion : « Il ne faudrait pas supposer que cette vue sur l'avenir soit fondée sur une conception purement logique, sur une loi de la génération des formes : ce serait admettre que l'Idée crée ! [58] »
Bilan de cette triple critique - d'un avenir prévisible (communisme compris), d'une catastrophe inéluctable, et d'un dialectique historique – : ce sont pour Sorel des excroissances qui impliquent le glissement de Marx lui-même vers l'utopie. Ce sont les points de non-retour où la science verse dans l'utopie.
Georges Sorel critique, d'un même mouvement la science (ou du moins ses prétentions et ses illusions), le marxisme (d'abord dans ses versions dogmatiques), la conception de Marx (particulièrement son communisme). Et cette triple critique culmine dans la critique de l'utopie (particulièrement quand elle se présente comme scientifique).
Henri Maler
La suite : Georges Sorel : de l'utopie au mythe (2) - Le mythe contre l'utopie.
Annexe : ouvrages et éditions
En l'absence d'une édition complète et homogène des écrits de Georges Sorel, j'ai eu recours à des éditions disparates. La pagination des références et citations s'en ressent inévitablement.
Georges Sorel, La décomposition du marxisme et autres essais, anthologie préparée et présentée par Thierry Paquot, PUF, 1982
Georges Sorel, Matériaux d'une théorie du prolétariat, Paris, éditions Marcel Rivière, 1921.
Georges Sorel, Réflexions sur la violence, huitième édition, avec Plaidoyer pour Lénine, Paris, éditions Marcel Rivière, huitième édition, 1936.
Georges Sorel, Les illusions du progrès, suivi de L'avenir socialiste des syndicats, Paris, éditions l'Age d'homme, 2071.
Georges Sorel, Introduction à l'économie moderne, Paris 1903, M. Rivière & Cie, 1911 - 385 pages
[1] Georges Sorel, La décomposition du marxisme et autres essais, anthologie préparée et présentée par Thierry Paquot, PUF, 1982.
[2] « Science et Socialisme » (1893), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.41-42.
[3] . « Science et Socialisme » (1893), op.cit.,p.41.
[4] « Science et Socialisme » (1893), op.cit.,pp.40,41,42. « Pour ou contre le socialisme » (1897), in La décomposition du marxisme et autres essais p.51.
[5] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), in La décomposition du marxisme et autres essais, p. 94.
[6] Comme il croit le découvrir chez Anton Menger. « La décomposition du marxisme (1908) », in La décomposition du marxisme et autres essais, p.211-212.
[7] « La crise du socialisme » (1898), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.77-78. « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., p.94
[8] « Science et socialisme »(1893), op.cit., p. 41-42.
[9] « La crise du socialisme (1898), op.cit., p. 91.
[10] « La crise du socialisme » (1898), op.cit., p.78.
[11] « La crise du socialisme »(1898), p. 92. Citation de « L'avenir socialiste des syndicats », in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.133. Voir aussi : « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit.,, p.94.
[12] « Pour ou contre le socialisme » (1897), ) in La décomposition du marxisme et autres essais, p.75.
[13] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.78 et p.79.
[14] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme : Bernstein et Kautsky » (1900), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.182.
[15] Georges Sorel, Réflexions sur la violence (1906), op.cit., p.72,206,328.
[16] Réflexions sur la violence (1906), op.cit.,p.72
[17] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p.144.
[18] Réflexions sur la violence (1906), op.cit., p.186.
[19] « La crise du socialisme » (1898), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.80, « La décomposition du marxisme », in La décomposition du marxisme et autres essais, p.215.
[20] « La crise du socialisme » (1898), op.cit., p.90.
[21] « La crise du socialisme » (1898), op.cit. p.83-84.
[22] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.250
[23] . Saverio Merlino (1856-1930), anarchiste puis socialiste, auteur Formes et essence du socialisme, ouvrage popularisé par Sorel.
[24] « Mes raisons du syndicalisme » (1910,) op.cit., p.252.
[25] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), op.cit. p.253.
[26] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), op.cit., p.254. Voir également p.261.
[27] « La décomposition du marxisme » (1908), in La décomposition du marxisme et autres essais p.218 ; « Mes raisons du syndicalisme » (1910), op.cit., p.285-286.
[28] « L'éthique du socialisme » (1899), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.11 et p.120.
[29] Réflexions sur la violence (1906), op.cit., p.187.
[30] . « Science et Socialisme » (1893), op.cit., p.40,41, 42, 51.
[31] « Science et Socialisme » (1893), ), op.cit.p.39-40.
[32] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p.75 et p. 79 note 1.
[33] « La décomposition du marxisme » (1908), ) in La décomposition du marxisme et autres essais, p.213.
[34] « Science et Socialisme » (1893), op.cit., p.39-42.
[35] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p.54-57.
[36] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), in La décomposition du marxisme et autres essais p.145-150
[37] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit. p.145-150, 213.
[38] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit. p.146.
[39] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit.,p.57-61 ; « Préface pour Coaljanni » (1899), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.188-189.
[40] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit.,p..51-52, « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., pp.150-154.
[41] « Préface pour Colajanni » (1900), op.cit.,, p.181-182.
[42] « Science et Socialisme » (1893), op.cit., p. 42. Également « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p. 51.
[43] « Pour ou contre le socialisme » (1897) », op.cit., p. 50.
[44] « Pour ou contre le socialisme »(1897), op.cit., p. 52.
[45] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p. 61.
[46] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p. 50, 52, 62-63 ; « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900). op.cit., p. 154-155 et p. 176-177.
[47] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p. 52
[48] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900) op.cit., p. 154-155.
[49] Sur ce point, je me permets de me citer. Voir Convoiter l'impossible – L'utopie avec Marx malgré Marx, éditions Albin Michel, 1995, notamment p.151-169, et, ici même, « De Hegel à Marx, penser le possible. II. Marx : De l'indispensable à l'inéluctable »
[50] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p. 154-155, 176-177.
[51] « Pour ou contre le socialisme » (18997), op.cit., p 53-54 ; « La crise du socialisme » (1898), op.cit., p.79-80 ; « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., p. 94, 96-97 ; « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p. 163-167.
[52] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p 53-54.
[53] « La crise du socialisme » (1898), op.cit., p.79-80. Également : « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., p. 94.
[54] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p. 163-167.
[55] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme » ? (1899), op.cit., p.106-109,109-110 ; « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p. 159-163 ; « Préface pour Colajanni » (1900), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p. 180-182.
[56] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), op.cit., p. 159-163.
[57] « Préface pour Colajanni » (1900) op.cit., p. 180-182.
[58] « Pour ou contre le socialisme » (1897), op.cit., p. 62-63
15.01.2024 à 13:32
George Sorel : de l'utopie au mythe (2)
Henri Maler
Le mythe contre l'utopie.
- Notes et travauxTexte intégral (9220 mots)

Georges Sorel critique, d'un même mouvement la science (ou du moins ses prétentions et ses illusions), le marxisme (d'abord dans ses versions dogmatiques), la conception de Marx (particulièrement son communisme). Et cette triple critique culmine dans la critique de l'utopie (particulièrement quand elle se présente comme scientifique).
Version provisoire, dans l'attente d'une version plus courte, moins prolixe en citations.
II. Le mythe contre l'utopie
La critique de l'utopie prépare le dépassement de l'utopie par le mythe, selon un trajet théorique et politique que l'on peut tenter de reconstituer en suivant ses détours (dont les références bibliographies figurent en annexe) : l'avenir syndicaliste et éthique du socialisme,
I. Critiques de l'utopie
La critique de l'utopie est impliquée, ne serait-ce qu'en pointillés, dans la triple critique de la superstition scientifique, du marxisme dogmatique et du communisme de Marx. Ainsi se Ces coordonnées d'une critique de l'utopie trouvent l'une de leurs expressions les plus synthétiques dans la tentative de répondre à cette question : « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? », question fait l'objet de l'article qui porte ce titre [1]. Selon Sorel lui-même, cette question porte principalement sur le marxisme orthodoxe, mais elle concerne également la conception de Marx et Engels
Au lieu de suivre les méandres de l'argumentation de Sorel, on s'efforcera d'en relever les traits les plus importants.
Sorel tente d'exonérer Marx des débordements utopique qu'il critique chez ses successeurs.. Il concentre ses tirs sur le devenir utopique de la conception de Marx, chez des successeurs qui seraient infidèles à sa méthode. Malgré ces précautions, il apparaît que le conception de Marx elle-même est en cause.
Ainsi, sur la dictature temporaire du prolétariat : « Quand il s'agit de se représenter la révolution et ce qui suivra, on se trouve en présenter de symboles et de rêveries souvent peu intelligibles (…) On nous dit que le prolétariat exercera une dictature, fera des lois et abdiquera ensuite : Tout cela est purement utopiques (…) [2]. » Force est de constater que le marxisme dogmatique ne fait que suivre Marx sur ce point
De même, quelques lignes plus bas : « Ne sont pas moins utopistes, et par suite infidèles à méthode de Marx, les socialistes qui nous donnent des formules abstraites, qui nous parlent de la socialisation des moyens de production ou de l'administration des choses. Il faudrait expliquer comment on se représentes les mécanismes qui réalisent des notions aussi vagues par elles-mêmes [3]. » Aussi vagues soient-elles, ces notions figurent dans le texte de Marx et Engels
Plus généralement, on découvre dans le même article les trois critiques qui incluent Marx : l'avenir prévisible, a catastrophe inéluctable, la La dialectique historique
– L'avenir prévisible
Sorel reprend sa critique des spéculations portant sur la prévision de l'avenir et les attribuent expressément à l'utopie. Le retour à l'utopie sous les auspices de la science s'achève dans la prétention de lire l'avenir dans le présent [4].
À Ch. Bonnier qui soutient notamment que « les utopistes sont de véritables presbytes » et que « de l'étude d'un état présent l'utopiste peut calculer l'avenir », Sorel réplique : « Il ne faut pas se laisser duper par les mots sonores ; il n'existe aucun procédé pour voir, même avec des yeux de presbyte, l'avenir dans le présent, aucun procédé pour calculer l'avenir [5]. » Anticiper l'avenir dans le présent ou, du moins un avenir possible est constant dans de nombreux textes de Marx, sans prétendre « calculer l'avenir »
– La dialectique historique
Sorel critique une fois encore la substitution de la logique à l'examen des faits et attribue cette substitution à Lafargue et Engels : « Quand on raisonne comme Engels et M. Lafargue on admet que l'histoire se fait pour satisfaire les exigences de notre logique : on est idéaliste, au sens hégélien [6]. » Cette critique (dont Engels fait les frais) s'étend aux utopistes qui sont également des logiciens impénitents : « La logique joue un rôle considérable dans l'œuvre des utopistes et leurs procédés méritent d'être examinés de près ». Et Sorel d'entreprendre cet examen, à la suite de Merlino, qui permet de faire valoir le rôle des antithèses et des simplifications [7].
Force est de constater que la critique qui vise Socialisme utopique et socialisme scientifique d'Engels vaut pour Marx lui-même.
Elle est confirmée dans la Préface pour Colajanni » (1899) qui affirme que les exemples fournis par Engels sont des « amusettes » et que « cette dialectique n'a rien à faire avec le marxisme » [8].
– La catastrophe inéluctable
Parmi les caractères communs à toutes les utopies, Sorel retient, l'idée que « l'émancipation se produira par un renouvellement soudain (ou à peu près soudain) par une catastrophe faisant disparaître les causes du mal, par l'émancipation des opprimés débarrassés enfin de leurs maîtres ». Aux yeux de Sorel, les promesses de la démocratie relèvent de cette conception. Aussi ne craint-il pas d'affirmer : « Le socialisme a pris ses utopies du renouvellement et de la catastrophe politique dans la tradition démocratique, dont il ne s'est jamais sérieusement émancipé ». La « science sociale » peut au moins (et notamment) « examiner la probabilité d'une catastrophe émancipatrice ». Et les études effectuées sur ce point « ont été peu favorables aux thèses de la social-démocratie » [9].
De façon plus générale, certaines positions adoptées par les successeurs de Marx sont dénoncées comme utopiques : « Nous devons considérer comme utopistes tous les réformateurs qui ne peuvent pas expliquer leurs projets en partant de l'observation du mécanisme social. » Marx, déclare Sorel, s'est trompé sur les faits. « Mais s'il s'est trompé seulement sur les faits, ses disciples ont commis une grosse erreur de principe et ont été des utopistes (…) ils ont abandonné le terrain de la science sociale pour passer à l'utopie [10]. »
Distinction d'autant moins convaincante que « l'erreur de principe », une fois encore est attribuée à Engels (et Lafargue). En effet, Sorel leur applique reprend une définition de l'utopie par Plekhanov : construction à partir d'un principe abstrait [11].
Reste la question suivante : comment en finir avec l'utopie présente dans les marxisme doctrinaire, voire au cœur de la pensée de Marx ? Réponse de Sorel, dont il convient de suivre les détours : ce sont l'avenir syndicaliste et l'avenir éthique du socialisme qui doivent permettre de dépasser l'utopie et qui cristallisent leurs objectifs dans les mythes.
II. L'avenir syndicaliste du socialisme
(1) Au « socialisme des socialistes », Sorel oppose le « socialisme des choses » que réalise pleinement à ses yeux l'avenir syndicaliste du socialisme. Cet avenir est successivement perçu sous deux formes dont Sorel pense qu'elles sont convergentes avant relever leur divergence.
– À l'occasion de l'affaire Dreyfus, Sorel salue, dans « L'éthique du socialisme » (1899), la rencontre entre le syndicalisme et la démocratie, c'est-à-dire la rencontre, entre l'esprit ouvrier et l'esprit démocratique [12]. Ce qui nous vaut, dans la « Préface pour Colajanni » (1899), cette appréciation de l'évolution du socialisme : « Le socialisme devient de plus en plus, en France un mouvement ouvrier dans une démocratie [13]. »
– Pourtant, Sorel ne tarde pas à revenir sur les illusions contemporaines de l'affaire Dreyfus et souligne l'opposition entre le socialisme et la démagogie.
Ainsi, dans « Mes raisons du syndicalisme » (1910), Sorel revient sur l'Affaire Dreyfus et ses conséquences [14]. Citant longuement son « Essai sur l'Église et l'État » (1901), il souligne alors : « Je distinguais mal en 1901 le socialisme politique du socialisme prolétarien ». Puis il précise : « (...) la liquidation de la révolution dreyfusienne devait me conduire à reconnaître que le socialisme prolétarien ou syndicalisme ne réalise pleinement sa nature que s'il est volontairement un mouvement ouvrier dirigé contre les démagogues [15]. » [souligné par moi]
Dès 1901, pourtant, dans la « Préface pour Gatti », Sorel dénonçait déjà la « déviation de l'action ouvrière sous l'effet du danger démagogique », avant de conclure : « Nous sommes dans une époque critique : si, appuyée sur la philanthropie et la sottise bourgeoise, la démagogie l'emporte, la France est perdue : un fort courant vraiment socialiste pourrait seul, à l'heure actuelle, sauver la France de cette marche vers la ruine [16]. »
Les accents « pessimistes » de ce diagnostic sont d'autant plus prononcés que Sorel, dit-il, ne perçoit pas encore le potentiel du syndicalisme révolutionnaire. C'est du moins ce qu'il indique dans « Mes raisons du syndicalisme » (1910) : « Lorsque j'avais écrit en 1901 la préface pour le livre de Gatti, j'avais cru que le nouveau régime de grèves aurait pour résultat de subordonner complètement les mouvements prolétariens à la politique démagogique ; mais vers la fin des temps dreyfusiens, le syndicalisme révolutionnaire rencontra des occurrences qui favorisèrent son émancipation [17]. Et Sorel notera encore après coup, dans une note de 1914, de la « Préface pour Gatti », que celle-ci ne prend pas en compte le syndicalisme révolutionnaire [18].
(2) Cette option en faveur du syndicalisme révolutionnaire tient lieu de stratégie de transformation sociale et marque une rupture consacrée par les Réflexions sur la violence (1906) : une rupture attestée par le bilan rétrospectif proposé par Sorel lui-même :« Les Réflexions sur la violence ont été écrites, en bonne partie, pour faire comprendre aux Français les avantages que peut procurer un mouvement révolutionnaire qui, en 1905, semblait avoir évincé la démagogie des mauvais bergers [19]. »
Et le contenu même des Réflexions confirme ce bilan. L'opposition entre le socialisme parlementaire et le syndicalisme révolutionnaire gouverne l'ensemble de l'exposé. Elle est prolongée par l'opposition entre la grève générale politique et la grève générale syndicaliste. Et dans ce cadre Sorel ne manque pas de dénoncer l'utilisation politique des grèves [20]. De même qu'il critique avec véhémence la loi sur les syndicats de 1884 et de la politique de Waldeck-Rousseau [21].
Dans ce contexte, Sorel s'efforce de montrer que la grève générale politique et l'élaboration de plans de la société future relèvent de la même logique et doivent être critiquées conjointement [22].
Ainsi, Sorel critique dans le marxisme orthodoxe la substitution de l'autorité de la science à la spontanéité du prolétariat, et la substitution de la prescription du but final à l'organisation du mouvement : l'utopie au sens où Marx l'entend, mais dont Sorel n'exonère que partiellement l'œuvre de Marx, en raison d'une critique antipositiviste qui ne re¬connaît que les formes positivistes la science.
Aussi, à l'utopie – aux embardées utopiques de la science de Marx - Sorel répond par un devenir éthique du socialisme et surtout par le mythe que cristallise la perspective de la grève générale.
III. L'avenir éthique du socialisme
L'avenir du socialisme dépend, selon Sorel, de l'abandon du but au bénéfice du mouvement et de sa dimension éthique.
1. Du but au mouvement
(1) Dépasser l'utopie, c'est, selon Sorel (qui reprend à son compte une distinction proposée par Merlino) privilégier le »le socialisme des choses » », inscrit dans le mouvement social et historique, au détriment du « socialisme des socialistes » : « comme le dit M. Merlino, il y a un socialisme des choses bien plus intéressant que le socialisme des socialistes [23]. » [souligné par Sorel]
Et le trajet qui, selon Sorel, doit mener du « socialisme des socialistes » (qui conçoit le socialisme comme déduit de la science) au « socialisme des choses » (qui conçoit le socialisme comme produit du mouvement ouvrier) se double du trajet qui le conduit à revenir de la recherche du but (utopie) à l'étude du mouvement : à l'interprétation (philosophique) du mouvement. Cette double trajectoire est impliquée dans la définition du socialisme que Sorel propose.
C'est ce renoncement à la poursuite d'une avenir hypothétique considéré comme un but final, au bénéfice de l'action du mouvement ouvrier qu'il définit ainsi dans « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899) :
Mais alors demande-t-on : qu'est-ce donc le socialisme, si ce n'est la recherche de la société décrite en termes sibyllins par Engels ? La réponse me semble simple : “ le socialisme c'est le mouvement ouvrier, c'est la révolte du prolétariat contre les institutions patronales, c'est l'organisation, à la fois économique et éthique, que nous voyons se produire sous nos yeux pour lutter contre les traditions bourgeoises [24]. [souligné par moi]
Qu'importe à Sorel si la société décrite par Engels est celle-là même que Marx anticipe : le socialisme se confond avec « l'œuvre propre du prolétariat » qu'il évoque ainsi dans « L'éthique du socialisme » (1899) :
Le vrai mouvement socialiste (...) peut se définir ainsi : C'est à la fois une révolte et une organisation ; c'est l'œuvre propre du prolétariat créé par la grande industrie ; ce prolétariat s'insurge contre la hiérarchie et la propriété ; il organise des groupement en vue de l'aide mutuelle, de la résistance en commun, de la coopération des travailleurs ; il prétend imposer à la société de l'avenir les principes qu'il élabore dans son sein pour sa vie sociale propre ; il espère faire entrer la raison dans l'ordre social en supprimant la direction de la société par les capitalistes [25].
Conséquence : dans les Réflexions sur la violence (1906), Sorel interprète à sa façon la critique marxienne de l'utopie. Marx, écrit-il, « estimait que le prolétariat n'avait point à suivre les leçons de doctes inventeurs de solutions sociales, mais à prendre, tout simplement, la suite du capitalisme. Pas besoin de programmes d'avenir ; les programmes sont déjà réalisés dans l'atelier. L'idée de la continuité technologique domine toute la pensée marxiste [26]. »
Interprétation fondée s'agissant des solutions doctrinaires, mais à laquelle Sorel substitue une interprétation mutilée de la conception marxienne du rapport entre le capitalisme et le communisme.
(2) Sorel présente le devenir éthique du socialisme comme le dépassement de l'utopie, et, expressément, comme le passage de l'utopie à la science.
Le devenir éthique du socialisme se mesure à sa capacité de faire pénétrer des idées socialistes dans des institutions : « la conduite socialiste normale est celle qui est favorable au progrès des institutions socialistes [27]. » C'est ainsi que l'on peut mesurer la distance prise avec l'utopie :
Lorsque les institutions étaient encore peu développées, les socialistes attachaient une grande importance à la description des Cités de l'avenir. On peut poser en règle générale, confirmée par beaucoup de faits, que l'espérance de la vie parfaite se dissipe d'autant plus complètement que les institutions occupent davantage l'esprit des hommes ; c'est ainsi que les prophéties millénaires finirent par ne plus intéresser que quelques chrétiens exaltés lorsque l'Église se fut organisée. Le même phénomène se produit aujourd'hui dans les milieux socialistes et doit être examiné de près. Ce passage de l'espérance de la vie parfaite à la pratique d'une vie tolérable et animée de l'esprit nouveau constitue ce qu'on doit appeler le passage de l'utopie à la science (...) [28].[souligné par moi]
Or ce passage se confond avec le passage du dogmatisme à la pratique :
Aujourd'hui le prolétariat est partout préoccupé de pratique et s'intéresse peu aux dogmatismes ; il s'efforce de tirer parti de tous les éléments qu'il trouve dans la société capitaliste pour créer des institutions qui lui soient propres, pour obtenir de meilleures conditions de vie, pour faire changer la législation. Il fait ainsi vraiment œuvre de science ; c'est là ce qu'on a appelé le mouvement [29]. [souligné par moi]
Et Sorel de citer alors la formule de Bernstein – « Le mouvement est tout et la fin n'est rien » - qu'il interprète à sa façon : « il s'agit d'une question éthique de la plus haute importance [30]. » L'essentiel est bien dans le mouvement qui revêt toute sa portée éthique en inscrivant le socialisme dans les institutions : « Ce qu'on appelle le but final n'existe que pour notre vie intérieure » [31].
Ainsi s'opèrerait finalement le dépassement de l'utopie : il coïncide avec l'adoption de la formule de Bernstein sur le but et le mouvement, mais le mouvement est compris par Sorel en fonction de sa portée, non pas étroitement réformatrice, mais éducative - éthique.
2. Du mouvement à sa dimension éthique
La dimension éthique du socialisme - est très tôt revendiquée par Sorel. Dans la préface qu'il rédige en 1898 pour l'ouvrage de Merlino, Sorel souligne que « Le socialisme est une question morale » [32]. Puis, dans l' « Avenir socialiste des syndicats » (1898), et dans « L'éthique du socialisme » (1899), il développe sa conception [33].
(1) « L'Avenir socialiste des syndicats » (1898) le souligne : la dimension éthique du socialisme, c'est, selon Sorel, dans les institutions et en particulier dans les syndicats qu'elle se forge. Pour peu qu'elle ne consiste pas à « placer des automates dans des boites », l'organisation des travailleurs est décisive : « L'organisation est le passage de l'ordre mécanique, aveugle, commandé de l'extérieur, à la différenciation organique, intelligente et pleinement acceptée ; en un mot, c'est un développement moral [34]. » Il reste que « La partie faible du socialisme est la partie morale ». (souligné par moi)
Pour développer cette « partie morale », Sorel s'appuie sur Durkheim. « Il ne s'agit pas de savoir quelle est la meilleure morale, mais seulement de déterminer s'il existe un mécanisme capable de garantir le développement de la morale [35]. » Or un tel mécanisme existe selon Sorel (qui s'appuie une fois encore sur Durkheim) : ce sont les syndicats [36] : « les syndicats pourraient être de puissants mécanismes de moralisation » [37]. (souligné par moi)
Dans la conclusion qui récapitule son étude [38], Sorel revient sur « la discipline morale » que le prolétariat peut exercer sur ses membres par ses syndicats avant de conclure : « Pour résumer toute ma pensée en une formule, je dirai que tout l'avenir du socialisme réside dans le développement autonome des syndicats ouvriers [39]. »
(2) « L'éthique du socialisme » (1899) reprend cette conception. Sorel cherche les fondements éthiques du socialisme dans le rôle de la famille et, plus particulièrement, des femmes [40]. Puis dans la lutte des classes elle-même [41]. De surcroît, il tente de répondre aux arguments qui prétendent que « le socialisme fait appel (...) aux sentiments de haine et aux instincts violents » [42]. L'intérêt porté à l'éthique se traduit ainsi : « On parle beaucoup en Allemagne de revenir à Kant : c'est un bon signe [43]. » Et la « Préface pour Colajanni »(1899) souligne qu'il faut savoir gré à cet auteur de n'voir « jamais cessé d'attacher une très grande importance aux considérations morales [44].
Dans cette optique, ce n'est pas le but de l'action qui décide de sa valeur, mais c'est sa valeur éthique, éducatrice, qui décide du choix de l'action. Sorel justifie ainsi la place qu'il accorde aux institutions : « Les institutions exercent une action éducative puissante ; et à ce point de vue on ne saurait exagérer leur importance, car il est nécessaire (...) d'agrandir l'héritage d'idées morales que nous avons reçu de nos pères [45]. »
Mais c'est surtout ce point de vue qui justifie son désaccord avec Kautsky, et son approbation ambigüe des thèses de Bernstein :
Pour M. Kautsky et ses partisans toute action est jugée par rapport à ce qu'ils appellent le but final ; mais comment peut-on apprécier la valeur d'une action actuelle ou d'une réforme sociale comme acheminement vers un régime placé dans un futur indéterminé ? (...). Quand on accepte la manière de voir de M. Bernstein, il faut se demander quelle est la valeur éducative d'une pratique donnée ; l'éducation du peuple est chose beaucoup plus difficile à diriger que la politique électorale ! Développer l'idée de justice dans le peuple, voilà qui serait tout à fait essentiel pour M. Bernstein ; son adversaire semble avoir des doutes sur la valeur d'une pareille propagande pour amener les ouvriers au socialisme [46]. [souligné par moi]
C'est enfin de ce point de vue qu'il juge les allemanistes [47] :
Dans une affaire récente, les camarades d'Allemane ont, presque tous, marché avec une ardeur admirable pour la défense de la Vérité, de la Justice et de la Morale : C'est la preuve que dans les groupes prolétariens l'idée éthique n'a point perdu de son importance - alors que les socialistes, qui se réclament de la science se demandaient si le Droit et la Morale n'étaient pas des mots vides de sens ! [48].
À cet éloge Sorel associe « le grand orateur » : « La conduite admirable de Jaurès est la plus belle preuve qu'il y a une éthique socialiste . [souligné par moi]
(3) Or, c'est précisément le critère de la valeur éducative qui est au centre des Réflexions sur la violence (1906). Tel est en effet le rôle de la violence : il s'agit de faire en sorte que le socialisme « possède toute sa valeur éducative [49]. »
La violence doit avoir pour rôle sauver le monde de la décadence bourgeoise et de ses effets, en particulier parce que la violence est nécessaire pour « marquer la scission des classes qui est la base de tout le socialisme » [50].
Or la violence remplit sa fonction éthique en recourant à des mythes : « Les hautes convictions morales...dépendent d'un état de guerre auquel les hommes acceptent de participer et qui se traduit en mythes précis [51].
III. Le dépassement de l'utopie par le mythe
(1) Dès 1900, dans la « Préface pour Colojanni », Sorel, en reprenant la distinction entre les dimensions éthiques et scientifiques du socialisme, introduit un élément nouveau : le rôle éducatif des images. Il écrit en effet :
Comme tous les hommes passionnés, Marx avait beaucoup de peine à séparer dans sa pensée ce qui est proprement scientifique, d'avec ce qui est proprement éducatif ; de la résulte l'obscurité de la doctrine de la lutte des classes. Très souvent il a matérialisé ses abstractions et il a exprimé ses espérances socialistes sous la forme d'une description historique, dont la valeur ne dépasse pas celle d'une image artistique destinée à nous faire assimiler une idée [52]. [souligné par moi]
Dans le même article, Sorel interprète ainsi l'avant-dernier chapitre du Livre I du Capital :
Dans ce texte on trouve exprimées, d'une manière saisissante, les diverses hypothèses qui dominent sa conception de l'avenir (...). Pris à la lettre, ce texte apocalyptique n'offre qu'un intérêt très médiocre ; interprété comme produit de l'esprit, comme une image construite en vue de la formation des consciences, il est bien la conclusion du Capital et illustre bien les principes sur lesquels Marx croyait devoir fonder les règles de l'action socialiste du prolétariat [53]. [souligné par moi]
Selon Sorel, cette analyse du « mythe catastrophique », comme il titre ce passage dans la table des matières, est annonciateur. Il note en effet : « C'est, je crois, ici que j'ai indiqué pour la première fois la doctrine des mythes que j'ai développée dans les Réflexions sur la violence [54]. »
Ainsi, les textes de Marx dans lesquels Sorel voyaient jusqu'alors un retour de l'utopie prédisant le but que le mouvement doit atteindre sont désormais compris comme des recours au mythe stimulant l'éducation d'un mouvement privé de but
(2) En 1903, dans l'Introduction à l'économie moderne (1903), Sorel s'interrogeait déjà :
Je me demande s'il ne faudrait pas traiter comme des mythes les théories que les savants du socialisme ne veulent plus admettre et que les militants regardent comme des axiomes à l'abri de toute controverse. Il est probable que déjà Marx n'v avait présenté que comme un mythe, illustrant d'une manière claire la luttes des classes et la révolution sociales [55].
(3) Les Réflexions sur la violence (1906) parachève ce parcours. Dans cet ouvrage, Sorel se donne pour but de comprendre « le rôle idéologique de la grève générale », et donc de se placer du point de vue des syndicats révolutionnaires qui « enferment tout le socialisme dans la grève générale ». Plus loin, Sorel dira : « Toute la question est de savoir si la grève générale contient bien tout ce qu'attend la doctrine socialiste du prolétariat révolutionnaire [56]. »
Le témoignage des syndicalistes révolutionnaires le confirme :
Grâce à eux, nous savons la grève générale est bien ce que j'ai dit : le mythe dans lequel le socialisme s'enferme tout entier, c'est-à-dire une organisation...il faut faire appel à des ensembles d'images capables d'évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie, la masse des sentiments qui correspondent aux diverses manifestation de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne [57]. [Souligné par Sorel]
.
Le mythe devient alors l'auxiliaire de l'éducation du mouve¬ment et de sa préparation à la violence de la grève générale :
Cette contribution ne prétend pas embrasser la totalité de l'œuvre protéiforme de George Sorel, mais seulement de dégager la structure significative de sa principale trajectoire :l:e devenir syndicaliste et éthique du socialisme a pour charge de contrecarrer son devenir utopique. Or, de même que pour Sorel, le devenir dogmatique du socialisme se confond avec un devenir utopique qu'il réprouve, le devenir syndicaliste et éthique du socialisme culmine dans son devenir mythique. En dernière analyse, l'opposition entre le mythe et l'utopie parachève et synthétise le parcours de la critique : le mythe est au mouvement privé de but (mais non de valeurs), ce que l'utopie est au but privé du mouvement (mais non d'idéal).
Au terme de ce parcours, l'ensemble de la conception de Marx sur la perspective du communisme et sur les moyens de l'atteindre est effacé au bénéfice du syndicalisme et des mythes révolutionnaires, ensemble, qui tiennent lieu de projet stratégique.
Henri Maler
Annexe : ouvrage et éditions
En l'absence d'une édition complète et homogène des écrits de Georges Sorel, j'ai eu recours à des éditions disparates. La pagination des références et citations s'en ressent inévitablement.
Georges Sorel, La décomposition du marxisme et autres essais, anthologie préparée et présentée par Thierry Paquot, PUF, 1982
Georges Sorel, Matériaux d'une théorie du prolétariat, Paris, éditions Marcel Rivière, 1921.
Georges Sorel, Réflexions sur la violence, huitième édition, avec Plaidoyer pour Lénine, Paris, éditions Marcel Rivière, huitième édition, 1936.
Georges Sorel, Les illusions du progrès, suivi de L'avenir socialiste des syndicats, Paris, éditions l'Age d'homme, 2071.
Georges Sorel, Introduction à l'économie moderne, Paris 1903, M. Rivière & Cie, 1911 - 385 pages
[1] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1999) in La décomposition du marxisme et autres essais, essais, pp..93-117.
[2] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., pp. 100-101
[3] ibidem
[4] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899),op.cit., p.99-100 et p.104-105.
[5] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., p. 104-105
[6] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? », op.cit., p.106-109.
[7] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit.. p.106-109,109-110.
[8] « Préface pour Colajanni » (1899), op cit.., p.181 et 182.
[9] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899),op.cit., p. 96-97.
[10] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit..p.100.
[11] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? », op.cit., pp.102-104.
[12] « L'éthique du socialisme » (1899), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.139-140.
[13] « Préface pour Colajanni » (1899), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.179.
[14] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.253 sq.
[15] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), op.cit., p.268. Suit alors une longue dénonciation, centrée en particulier sur le rôle de Jaurès.
[16] « Préface pour Gatti » (1901), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p. 225-227.
[17] « Mes raisons du syndicalisme » (1910), op.cit., p. 283.
[18] « Préface pour Gatti » (1901), op.cit., p. 217. note 1 (1914).
[19] « Préface pour Gatti » (1901), op.cit., p. 227, note 2 (1914). C'est donc l'émergence du syndicalisme révolutionnaire (et sa prise en compte) qui sont décisifs : La note déjà citée de « La préface pour Gatti » l'indique : « En 1901, je n'avais encore qu'une idée assez confuse des propositions que je devais présenter plus tard dans les Réflexions sur la violence. » (« Préface pour Gatti », (1901), op.cit.,p.217. note 1 (1914).
[20] Réflexions sur la violence (1906), op.cit.,p.221.
[21] Réflexions sur la violence,(1906( op.cit., p.299-314.
[22] Réflexions sur la violence (1906), p.237-238.
[23] « L'éthique du socialisme (1899) », op.cit., p. 118.
[24] « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » (1899), op.cit., p. 117.
[25] « L'éthique du socialisme » (1899), in La décomposition du marxisme et autres essais pp. 119-120
[26] Réflexions sur la violence (1906), p.199.
[27] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p. 133.
[28] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.132-133.
[29] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.135.
[30] « L'éthique du socialisme » (1899, op.cit., p.135.
[31] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.136.
[32] Passage cité dans l' “ Avertissement ” (rédigé en 1914) à la deuxième partie des Matériaux pour une théorie du prolétariat, p.170. Sorel souligne plus loin que « ces thèses se rattachent aux conditions que l'affaire Dreyfus avait fait naître au milieu de l'année 1898 » (in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.173).
[33] « Avenir socialiste des syndicats » (1898), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, pp. 55-151 ; « L'éthique du socialisme » (1899), in La décomposition du marxisme et autres essais p.118-140.
[34] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p.111.
[35] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p. 127.
[36] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p. 127-131.
[37] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p.129.
[38] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p. 131-133.
[39] « L'avenir socialiste des syndicats » (1898), op.cit., p. 133.
[40] « L'éthique du socialisme » (1899,) in La décomposition du marxisme et autres essais, p.122-123.
[41] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.123-126. Et sur le rôle des femmes : « La femme est la grande éducatrice du genre humain », op.cit., p.131.
[42] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p. 126-129
[43] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.130, note 1.
[44] « Préface pour Colajanni » (1900), op.cit., p. 176.
[45] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit., p.134.
[46] « Les polémiques pour l'interprétation du marxisme » (1900), in La décomposition du marxisme et autres essais, p.155-156.
[47] « Allemanistes » : du nom de Jean Allemane (1843-1935), fondateur du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR). Ce parti, essentiellement actif de 1890 à 1901, est l'un des partis qui a donné naissance au parti socialiste Section française de l'Internationale ouvrière en 1905
[48] « L'éthique du socialisme » (1899), op.cit.,p.139-140. L'éloge des allemanistes est repris dans « Mes raisons du syndicalisme » (1910), Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.260. Texte où se trouve confirmée, avec une citation de la « Préface au livre de Colajanni », que Sorel pensait que « l'alliance des allemanistes et de Jaurès caractérisait bien le régime nouveau », in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.262.
[49] Réflexions sur la violence (1906), 8ème éd., Marcel Rivière, 1936, p.201. Nous citons par la suite sous l'abréviation Réflexions sur la violence
[50] Réflexions sur la violence, p.273.
[51] Réflexions sur la violence, p. 319.
[52] « Préface pour Colajanni », (1899), in Matériaux d'une théorie du prolétariat, p.188-189.
[53] « Préface pour Colajanni » (1899), op.cit.,p.189.
[54] « Préface pour Colajanni » (1899) op.cit., p.188-189.
[55] Introduction à l'économie moderne (1903), Paris, 1903, p 376-377.
[56] Réflexions sur la violence (1906), op.cit., p.181.
[57] Réflexions sur la violence (1906), op.cit., p. 182.
22.12.2023 à 11:21
Fragments d'analyse des médias français face à l'invasion de l'Irak
Henri Maler
Comment légitimer une guerre pourtant condamnée par le gouvernement français
- Sur les médias / Guerres, Critiquer les médiasTexte intégral (15161 mots)

« Fragments d'analyse des médias français face à l'invasion », dans Irak : Les médias en guerre (sous la direction d'Olfa Lamloum), Arles, Editions Actes Sud, 29 octobre 2003, p. 105-141.
Lors des guerres du Golfe en 1991, du Kosovo en 1999 et d'Afghanistan en 2001, les principaux médias français avaient apporté à la propagande des grandes puissances coalisées le renfort de leur propre propagande [1]. Les menaces d'invasion de Irak n'ont pas bénéficié d'un tel renfort. La position du gouvernement français, hostile au déclenchement de la guerre aux conditions américaines et les divisions qui ont marqué les préparatifs de cette guerre ont permis à la plupart des médias français de prendre leurs distances (en toute indépendance ?) avec la propagande américaine et les médias les plus bellicistes d'autres pays. Pendant plusieurs semaines avant le 20 mars, les journalistes français ont tenté de présenter les enjeux économiques et géopolitiques de la bataille diplomatique et des perspectives de guerre, alors que les motifs invoqués lors des guerre précédentes (guerres défensives, guerres humanitaires) avaient relativisé de tels enjeux et les avaient noyés, au point de les dissimuler, dans une rhétorique indistinctement humanitaire et belliqueuse. Mais surtout la plupart des questions relatives à la légitimité et la légalité d'une guerre contre l'Irak ont été, au moins, posées. Ainsi, non sans suivisme à l'égard de la position du gouvernement français, la plupart des médias se sont gardés de soutenir le déclenchement de la guerre aux conditions américaines, quand ils n'ont pas nettement marqué leur opposition.
Mais une fois la guerre déclenchée ? Convaincus d'avoir été « exemplaires », selon le mot de Laurent Joffrin du Nouvel Observateur, lors de la guerre du Kosovo et, sans doute, encore plus, lors de celle d'Afghanistan, les principaux médias français qui s'étaient proposés d'éviter les « erreurs » de la guerre du Golfe, sont apparemment persuadés d'y être parvenus [2]. Mais l'omission de leurs errements ultérieurs suggère déjà qu'une autocritique superficielle ne pouvait permettre que de soigner les symptômes les plus visibles. C'est donc à des aspects généralement négligés que seront consacrés ces fragments d'analyse : centrés sur les premiers jours de la guerre, mais prenant en compte son issue ; sur la base d'échantillons prélevés surtout dans les Journaux télévisés de TF1 et dans les éditoriaux de trois quotidiens (Libération, Le Monde et Le Figaro) et deux hebdomadaires (Le Nouvel Observateur et Le Point) [3].
I. À la télévision : la légitimation de la guerre par son récit ?
Mercredi 19 mars, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) adresse ses recommandations « à l'ensemble des services de télévision et de radio » [4]. Il « appelle l'attention des opérateurs sur la nécessité », notamment, de « vérifier l'exactitude des informations diffusées ou, en cas d'incertitude, de les présenter au conditionnel et d'en citer la source et la date » ; de « procéder, en cas de diffusion d'informations inexactes, à leur rectification dans les meilleurs délais et dans des conditions d'exposition comparables » ; (…) de « veiller à ce qu'il ne soit pas fait une exploitation complaisante de documents difficilement supportables » ; de « ne pas diffuser de documents contraires aux stipulations de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre (…) ». De simples conseils de prudence.
« Les sages ont-ils été entendus ? Affirmatif », déclarent des journalistes de Libération, à l'heure des bilans [5]. Et « les sages » sont plus que satisfaits. La Lettre du CSA d'avril 2003 publie un article en forme de bilan intitulé « Conflit en Irak : les médias font preuve d'une extrême vigilance » et pour Dominique Baudis, président de cette institution, la couverture médiatique de la guerre en Irak est un modèle du genre. « Indication des sources, utilisation du conditionnel quand les faits ne sont pas avérés, souci de se démarquer de toute tentative de manipulation, jamais, peut-être, une guerre n'a été couverte avec autant de rigueur », écrit-il. Un éloge pour le moins excessif et qui tait l'essentiel, car devançant et dépassant les recommandations du CSA, les principaux responsables des chaînes de télévision avaient eux-mêmes pris des engagements préventifs plus radicaux que la simple prudence : non seulement éviter les « dérapages », mais fournir une information explicative. Etienne Mougeotte, vice-président de TF1 l'affirme : « On a tiré toutes les leçons de la guerre du Golfe, où on n'avait pas assez conceptualisé l'image (..). Il faut donner du sens ». Car, précise Olivier Mazerolle, directeur général délégué chargé de l'information de France 2, « (…) la guerre c'est surtout une posture politique, et sociale, c'est un tremblement de terre dans les relations humaines et c'est ça qu'il faut traiter [6]. » Sans doute ces responsables sont-ils convaincus d'avoir tenu leurs engagements [7]. Pourtant, si les télévisions se sont efforcées de « donner du sens », on est en droit de se poser cette simple question : « quel sens la télévision a-t-elle donné à cette guerre ? ».
1. Propagande machinale : surinformation et désinformation
Les formes les plus outrancières et les plus efficientes de la propagande de guerre ne sont pas nécessairement les plus visibles. Les précautions dont les chaînes de télévision ont voulu s'entourer pour éviter les « erreurs » de la guerre de 1991, ne résistent pas face à la prétention de faire partager « la guerre en direct ». La partialité favorable à la guerre américaine [8] se niche sans doute dans les commentaires, le vocabulaire, les silences et les non-dits. Mais elle résulte plus massivement encore de la logique narrative qui gouverne la mise en mots et en images des opérations militaires. L'hostilité, certes fondée, au régime de Saddam Hussein sert de cadrage : l'ennemi étant désigné, il suffit alors de raconter la guerre pour qu'elle semble justifiée, pour peu qu'elle parvienne à jeter bas la dictature. Du même coup, le récit des opérations militaires est presque entièrement conduit du point de vue des troupes américano-britanniques : qu'il s'agisse de la puissance qu'elles déploient, des victoires qu'elles remportent ou des résistances qu'elles rencontrent. Cette légitimation de la guerre par son récit peut ne pas être intentionnelle. Elle est en tout cas – littéralement et dans tous les sens du mot – machinale : amplifiée par la fascination de la télévision pour la puissance militaire et pour sa propre puissance.
1.1. Auxiliaire du récit de guerre, cette fascination ou cette complaisance pour la puissance militaire américaine contribue à acclimater le soutien à la force et la barbarie technologique, sous couvert d'information. Ainsi, avant même le déclenchement de la guerre ouverte, la multiplication des reportages – en général complaisamment fournis ou tolérés par les armées américaine et britannique et achetées aux médias américains – sur l'entraînement des troupes, les armes et les munitions remplissent cet office. C'est encore le cas dans les Journaux télévisés la veille même des premiers bombardements sur Bagdad. Et cela ne cessera pas après. Au risque, il est vrai, que cette complaisance fascinée ne se retourne à la moindre défaite militaire des armées que, plus ou moins explicitement, on soutient. Mais c'est encore du point de vue des difficultés rencontrées par les troupes américano-britanniques, dans le vocabulaire de leurs opérations, que le récit de guerre est construit et les images de guerre sont destinées à l'illustrer quand la résistance irakienne se montre plus tenace que prévu ou espéré. Et s'il est inutile de présupposer systématiquement une intention maligne et des manipulations intentionnelles, elles se glissent, plus ou moins discrètement, dans cette construction préalable dont les effets sont démultipliés par la fascination de la télévision pour sa propre puissance
1.2. L'ampleur et la nature du dispositif mis en œuvre part les télévisions (et particulièrement par TF1), les moyens technologiques comme les équipes de correspondants et de reporters produit, presque mécaniquement, un récit ajusté aux exigences de la guerre américano-britannique. Le dispositif lui-même suppose un retour sur investissement, qu'il s'agisse des bénéfices escomptés ou des informations produites
Quelques mots sur les premiers. Pour des chaînes commerciales, les coûts du la guerre en direct sont considérables. Ils le sont d'autant plus que les publicitaires n'aiment pas les contextes violents et que l'audience reste la mesure de ce qu'il convient de montrer. Les chaînes Berlusconi en Italie ont, pour ces raisons mêmes, minoré la place accordée à la guerre dans leurs programmes. Longtemps avant le conflit, répondant à des analystes qui s'inquiétaient de la stabilité des recettes de TF1 pour 2002, dans le cas où « l'Irak serait attaqué par les USA », Patrick Le Lay, échaudé par la catastrophe industrielle de l'équipe de France en Coupe du Monde (soit 2 % en moins de CA pour la chaîne), en des termes d'une exquise délicatesse, manifestait ainsi sa prudence : « Il ne faudra pas nous en vouloir si l'US Air Force met à feu et à sang la Planète... » [9]. Le prix à payer est en effet très lourd. Selon Les Echos [10], TF1 a passé une provision de 3 millions d'euros dans le budget de la rédaction. Sans parler du coût des transmissions, c'est le prix à payer pour un effort que souligne, non sans vanité, Robert Namias, directeur de l'information de TF1, « nous avons 20 équipes entre l'Irak et les pays limitrophes, ce qui représente 80 personnes ». Quant à Olivier Mazerolle, directeur de l'information de France 2, il « reconnaît que ce genre d'événement coûte très cher, mais, précise-t-il, le surcoût sera en partie compensé (sic) par des réductions de traitement de l'information ». L'article des Echos qui livre ces informations en délivre également le sens : « les implications économiques sont importantes, mais ce type d'événement est un investissement pour asseoir sa crédibilité ». De là à subordonner la validité des informations produites, aux exigences de crédibilité de la chaîne qui les produit, le pas est rapidement franchi
Quoi qu'il en soit, le retour sur investissement suppose que le dispositif tourne à plein régime. Et c'est son usage intensif qui décide, presque de lui-même, des effets de propagande qui en résulte. La hiérarchisation, la présentation et la militarisation de l'information, comme inscrits dans l'usage même du dispositif, servent la guerre américano-britannique : machinalement. La tournée quasi obligatoire de tous les « postes d'observation », quelles que soient l'importance et la nature des informations apportées, remplace l'information vérifiée. Le sommaire du journal est comme décidé par le dispositif lui-même, au point que la rentabilisation du dispositif tient lieu de réflexion sur son usage : elle sélectionne et ordonne quasi-mécaniquement l'information ou ce qui en tient lieu.
Le journal de 20 heures sur TF1, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, le 19 mars 2003, peut devenir désormais un exemple de référence de ce simulacre de d'exhaustivité et de ses effets collatéraux. Après l'annonce des titres du Journal, PPDA, « pour vous informer au mieux, au cours de cette session », passe en revue les reporters qui seront sollicités et dont les photos viennent s'inscrire sur une carte de la région : une mise en scène préalable de l'importance de la « couverture » effectuée par TF1, qu'un rapide décryptage permet d'apprécier : quelques reportages honorables (et parfois mieux) dans une coulée informe et insidieusement orientée…
Du côté militaire
1. L'imminence de la guerre dont « les premiers signes ont été détectés par nos envoyés spéciaux », nous vaut, pour commencer un reportage de Denis Brunetti en provenance du Koweit qui fait le point des déplacements des troupes américaines.
2. Une second reportage dresse un état de difficultés auxquelles doit faire face l'armée américaine : le tempête, l'opposition de la Turquie au libre passage de l'aviation et des troupes, le « problème » que soulève les risque de conflit entre l'armée turque et les kurdes. En dépit de ces « facteurs contrariants », comme les désigne PPDA pour parler des tempêtes de sable, « le dispositif opérationnel est en place ».
3. C'est maintenant au tour de Loïc Berrou d'expliquer, doctement, « comment devrait se dérouler les opérations ».
4. Puis Philippe Morand tente de dresser la liste des pays qui soutiennent les USA. Une liste baptisée par TF1 « Coalition pour le désarmement de l'Irak ». De quoi séduire les Etats qui se sont donné ledit désarmement pour objectif, sans préconiser le recours à la guerre.
5. À quoi succède un reportage de Gilles Bouleau à la base militaire de Fairford (Grande-Bretagne), destiné à nous « informer » de la préparation des troupes britanniques.
6. Une préparation qui est aussi celle de la 82e division aéroportée, qui se prépare à la guérilla urbaine sous le regard de Michel Floquet, journaliste incorporé à cette division, pour la plus grande fierté de la rédaction de TF1.
7. La 101e division aéroportée est également prête, malgré le vent de sable, nous assure Isabelle Baillancourt.
8. Avant que Sylvie Pinatel ne nous décrive avec émotion, dans un reportage sur les Fusillés marins britanniques, l'attente anxieuse de l'un d'entre eux : Adam Cook, 19 ans.
9. Le moment est venu, pour Patricia Allémonière, en direct du Qatar où siège le Quartier général américain, de nous donner des détails, sans intérêt mais en direct, sur le calme qui règne du côté de l'Etat-major.
10. Et pour finir cette revue des troupes, un reportage de F. Collard sur « l'arsenal technologique » informe les téléspectateurs sur le rôle que jouent et que doivent jouer les satellites.
Dix reportages, en ouverture du journal, sur les préparatifs militaires de la guerre. Des informations effectives qui auraient pu être résumées en quelques minutes. On se doute que cette construction, qu'elle soit machinale ou intentionnelle, n'est pas sans effets.
Vient alors cet enchaînement : « Du côté irakien ». Ce qui nous vaut, après une information sur l'appui du Parlement irakien à Saddam Hussein :
11. Un reportage de Jean-Pierre Abou sur le climat qui règne à Bagdad. Les partisans armés du régime se préparent à une « défense bien sûr totalement illusoire ». Les habitants sont à la « recherche désespérée d'abris » et la visite d'un femme seule avec ses trois enfants, permet de conclure : « Ici tout le monde espère être épargné par les bombardements ». Une « dernière intervention en direct du centre de presse » nous permet d'apprendre que « l'ambiance est bien sûr très, très lourde ».
Du côté humanitaire :
12. Un reportage à Amman de Naida Nakab fait très précisément le point, avec l'aide de l'UNICEF, sur les risques sanitaires encourus par la population, et en particulier par les enfants. Le direct qui suit permet de souligner que les américains sont « honnis par l'opinion publique arabe » et que la France est « respectée et admirée ».
13. Un reportage de Michel Scott est consacré aux risques d'un afflux massif de réfugiés vers le Kurdistan
14. Un reportage de M. Pasinetti est consacré aux risques d'afflux des réfugiés tout autour de l'Irak.
15. Un reportage d'Isabelle Marque sur les troupes massées par la Turquie à la frontière avec l'Irak souligne les risques d'une offensive contre les Kurdes.
4 ou 5 reportages sur les effets possibles ou probables de la guerre sur les populations civiles : la dimension « humanitaire » du conflit n'a pas été oubliée.
Fin de la revue d'avant-guerre :
16. Un bref sujet de Bertrand Aguirre sur les dernières débats au Conseils de sécurité (en l'absence des USA et de la Grande-Bretagne)
17. Un bref sujet sur les difficultés politiques rencontrées par sur Tony Blair
18. Un reportage de F. Buch sur les opposants irakiens au sein de la communauté irakien en France
19. Un reportage de N. Ruelle en Arabie Saoudite permet d'apprendre que l'opinion saoudienne n'est pas franchement favorable à la guerre.
20. Un reportage de Michèle Fins au Pakistan permet de donner la parole à une représentante de l'Association révolutionnaires des femmes afghanes (RAWA) et de faire état de leur inquiétude en Afghanistan
21. Et pour finir, un reportage sur … les « perturbations de trafic aérien ».
Ce simulacre d'exhaustivité, consacré pour moitié aux préparatifs anglo-américains, met bout à bout le militaire et l'humanitaire, sans que les enjeux soient distinctement exposés. Et le même simulacre prévaudra dans tous les J.T. ultérieurs, comme si la longueur des temps d'antenne garantissait l'épaisseur de l'information. Subjuguée par la guerre et la puissance, la télévision est happée, du même coup, par le standard américain.
1.3. Cette surinformation apparente dissimule une sous information effective. La présentation des informations elle-même entretient brouillage de l'information. La priorité accordée au direct informe plus sur la prétendue capacité d'informer que sur la guerre elle-même ; elle mêle le factuel parfois le plus anecdotique à l'information effective, elle-même réduite à une bouillie où le conditionnel de distanciation dévore l'indicatif des fait vérifiés. La guerre est réduite à la mêlée des « rumeurs ». L'information sur les « rumeurs » remplace l'information sur la guerre. L'information en direct, c'est la confusion en direct : le brouillage de la guerre elle-même, - réduite le plus souvent à des images spectaculaires et à des interprétations lacunaires –, de ses conséquences humaines et de ses enjeux politiques.
D'abord, l'information est dévorée par la dramatisation, non de la guerre mais de son récit. L'exaltation de Jean-Pierre Pernaut pendant le direct ininterrompu de 3h45 à 11 heures du matin, sur TF1, le 20 mars 2003 est jusqu'à présent l'exemple le plus tristement éloquent d'un machiniste entièrement ajusté à la machinerie télévisuelle. La dramatisation du récit tient lieu de récit dramatique. Sur TF1, la télévision se raconte elle-même, commente ce qu'elle voit, se filme et résume son propre film, avec ses héros, son intrigue, ses surprises. Car la guerre c'est d'abord un scénario, et les surprises que réserve ce scénario : « On ne s'attendait pas du tout à des attaques aussi ciblées », « Ce scénario-là, les irakiens ne l'attendaient pas du tout » (Jean-Pierre Pernaut).
Ensuite, l'information est absorbée par le spectacle de la proximité. La « guerre en direct » est encore plus sélective que la « guerre en différé ». Celle-ci permet de choisir parmi les sources, entre celles qui sont produites de façon indépendante et celles qui émanent des chaînes américaines ou des chaînes arabes. Inutile d'insister sur le fait que la sélection des sources ne va pas sans discrimination : la suspicion jetée sur les reportages d'Al Jaseera, a permis notamment de relativiser l'informations produite du point de vue des victimes. À quoi s'ajoutent les effets de la « guerre en direct » qui entretient l'illusion de rendre compte de la guerre « en temps réel ». Jusqu'à la caricature exhibée sur TF1, le 20 mars 2003, au journal de 13 heures. Un direct avec Gilles Bouleau, à Londres qui explique les dispositions prises par l'armée britannique est interrompu pour faire place à une information en direct du Koweït où une nouvelle alerte a eu lieu. L'envoyé spécial, intervient : « Les sirènes viennent de se taire. C'est dommage. Vous auriez pu… ». Dommage, en effet !
L'information, enfin, est saturée par un usage désinvolte de l'exigence d'exactitude. Plutôt que de ne diffuser que des informations vérifiées, on informe en permanence sur des informations qui « restent à vérifier ». Plutôt que de réduire l'incertitude, on l'accroît, au risque de miner les informations la mieux établies. Et quand celles-ci font défaut, impossible de se taire : « D'où l'importance d'articuler, à partir du rien disponible, des discours basés sur l'ignorance des faits : la recherche d'information, en se faisant en direct, crée ainsi une situation d'attente tendue qui décourage le zapping. Un vide actif, en quelque sorte [11]. » La tragédie et l'incertitude de la guerre se transforment en suspense télévisé. Au mieux quelques fragments des opérations militaires américano-britanniques ; au pire « une collection de suppositions obscures (on dit aussi « rumeurs ») et des sujets sans contenus (une information décomposée, en somme) : bref, une incapacité totale à représenter les événements, leurs enjeux, leurs causes et leurs conséquences » [12] .
L'usage du conditionnel est à cet égard emblématique. Le conditionnel conditionne [13]. Il peut le faire dans les directions les plus diverses. Pendant la guerre du Kosovo, prévaut le conditionnel qui majore : « 100 000 à 500 000 personnes auraient été tuées, mais tout ça est au conditionnel » (Jean Pierre Pernaut, TF1, 20 avril 1999). Pendant la guerre d'Afghanistan, prévaut le conditionnel qui minore, que l'on peut reconstituer ainsi : « selon les talibans, Il aurait quelques dizaines de victimes civiles, tout ça au conditionnel, bien sûr ». Pendant la guerre contre l'Irak, prévaut le conditionnel qui ignore : celui qui informe … sur l'ignorance de celui qui en fait usage. De là, l'invasion de « l'information au conditionnel » ou, plus sobrement, de « l'information conditionnelle » (Jean-Pierre Pernaut). Tout se mélange, l'indicatif et le conditionnel finissant par se neutraliser.
Deux exemples, parmi les plus anodins. Le 20 mars 2003, au Journal de 13 heures sur TF1, le « spécialiste » des questions militaires, Jean-Pierre Quittard, propose une récapitulation des opérations militaires de la nuit précédente et présente ce qui va se passer : des prévisions intégralement formulées au futur. Jean-Pierre Pernaut corrige en plateau : « Tout cela au conditionnel, bien sûr, car personne n'avait prévu ce qui s'est passé cette nuit ». Prudence qui introduit cette autre, quelques temps après : « Une autre image que nous venons de recevoir – info ou intox, on ne sait pas… A prendre avec des pincettes. » Fallait-il alors diffuser cette image et livrer cette information ? C'est à peine si la question se pose et se posera les jours suivants. Le 12 avril 2003, Claire Chazal livre une information sur ce que « on » raconte : « On raconte même que des flacons qui contiendraient des virus très dangereux auraient disparu » [14]. Une rumeur anonyme suivie de l'usage audacieux d'un double conditionnel : un exemple, parmi cent autres, de la rigueur et de la vigilance exemplaire, saluées par le CSA.
Certes, les reportages des envoyés spéciaux ne sont pas réductibles aux effets du dispositif pris dans son ensemble. Pris séparément, ces reportages valent souvent beaucoup mieux. Mais les envoyés spéciaux restent généralement des rouages du dispositif qui informe à travers eux et parfois malgré eux. Et les informations qu'ils parviennent à glisser dans les mailles du dispositif propagandiste sont minées par d'autres avatars du récit des opérations militaires.
2. Propagande latérale : dépolitisation et doubles standards
La priorité accordée au récit des opérations militaires du point de vue des armées américano-britanniques, a pour premier effet une véritable militarisation de l'information. Entendons par là, non la dépendance des journalistes à l'égard des sources militaires, dont ils essaient, tant bien que mal, de s'affranchir, mais la mise en image des opérations militaires (quelle que soit la connaissance effective que l'on a de leur sens et surtout de leurs effets) au détriment des autres informations.
2.1. La dépolitisation de l'information est alors immédiate et durable : la guerre, réduite à la fausse évidence de son récit et légitimée par sa mise en scène télévisée est soustraite à tout débat politique. Ce dernier, quand il existe est relégué en fin de journal : maintenu au sommaire par la seule existence de manifestations qu'il est difficile de passer sous silence, même quand on tente d'en simplifier le sens ou d'en réduire la portée. Cette dépolitisation est manifeste dès les deux premiers jours de la guerre. Au journal de 13 heures, le 20 mars, sur TF1, priorité absolue aux informations « à prendre avec des pincettes », sur les opérations militaires. Il faudra attendre plus d'un heure pour que viennent enfin « les réactions » et que la « nouvelle intervention de Jacques Chirac », regrettant le déclenchement de la guerre soit diffusée intégralement. Encore est-elle présentée et conclue en soulignant essentiellement … les mesures prises en matière de sécurité.
Au journal de 20 heures, le même jour, il faut attendre plus d'une heure d'informations redondantes et approximatives, mêlant les reportages tournés sur place, les sujets réalisés à Paris, les directs en tous genres, pour que les commentaires sur la guerre elle-même soient mentionnés. Patrick Poivre d'Arvor peut alors livrer ingénument le sens de ce qui vient de nous être dit et montré : « Une édition consacrée aux frappes américaines sur Bagdad ».
Dernier exemple : le journal de 20 heures TF1 du 21 mars, présenté par Claire Chazal.. Après la tournée des « correspondants de guerre », viennent enfin les comptes-rendus des manifestations d'opposition à la guerre, assortis de tentatives de neutralisation de leurs objectifs et de leurs sens. Ainsi quand Gilles Boulleau rend compte des manifestations de Londres, c'est pour conclure : « Malgré les 100 000 personnes qui ont piétiné (sic) les pelouses de Hyde Park, tout le monde (re-sic) a bien conscience que la tornade pacifiste s'est transformée en vaguelette ». Quant au reportage sur la manifestation de Paris, dont le commentaire confronte le déroulement avec ce qui se passe au même moment en Irak, il est l'occasion d 'un parallèle d'une exquise délicatesse, dénué d'intention malveillante : « 1heures 20. La tête du cortège atteint la Place de la Bastille. A la même heures des soldats américains tombent dans une embuscades et son tués dans le désert irakien ». Et après l'habituel micro-trottoir, quelques images de jets de projectiles, assorties de cette vigoureuse leçon de morale : « La tentation de s'en prendre aux symboles américains est encore forte. Mais c'est le fait de quelques individus qui ont oublié le sens du mot paix ». Heureusement que TF1 est là pour nous rappeler, en pleine guerre, le sens de ce mot !
Ainsi, de la télévision à la presse écrite, les effets de la propagande de guerre n'ont pas manqué de s'infiltrer, comme en témoignent les doubles standards informatifs et explicatifs, dont la télévision nous a offert de nombreux échantillons : selon qu'il s'agit des armées américaine et britannique ou des Irakiens, militaires ou civils, les images de la guerre (et des prisonniers) ainsi la présentation des victimes, civiles et militaires sont singulièrement asymétriques.
2.2. Dépités, frustrés, contrits, nombre de journalistes ont déploré que la guerre de 1991 ait été une « guerre sans images ». Ou plus exactement qu'elle ait été une guerre dont les seules images étaient celles que fournissait le Pentagone : des images des bombardements « intelligents », vus du ciel, sans destructions visibles d'objectifs civils ni victimes innocentes. Aussi se sont-ils bruyamment félicités de l'importance des envoyés spéciaux, de la concurrence des chaînes, des reporters « embarqués », des directs de Bagdad et d'ailleurs qui donnaient à voir la guerre. Mais que donnaient-ils exactement à voir ?
Les images donnent à voir, d'abord …ce que montrent les caméras. Mais ce que montrent les caméras dépend de leur emplacement. Certes, l'armée irakienne n'avait pas invité de journalistes dans ses rangs. Mais cela suffit-il à expliquer que toute la guerre, s'agissant des opérations militaires, ait été tournée du point de vue de l'armée américaine ? L'asymétrie étant totale et le contenu très pauvre en informations véritables, pourquoi cette complaisance ?
Les images donnent à voir, ensuite, ce que choisissent les responsables de l'information. Fallait-il, sous prétexte que c'étaient les chaînes arabes diffusaient des images des blessés et des victimes ou que c'étaient les autorités irakiennes qui invitaient à filmer les destructions d'édifices civils et les blessés en user avec tant de précautions ? N'est-il pas plus choquant de s'attarder sur des images chars fonçant dans le désert ou de bombardements vus de loin que sur les effets les plus directs de ces bombardements ? Est-il indispensable de rendre insensible pour ménager les sensibilités ? Ou bien s'agit-il de ménager les opinions publiques hostiles à la guerre et à ses effets désastreux ? Pourquoi s'attarder sur les victimes militaires américaines et britanniques et sur la douleur (souvent doublée de fierté) de leurs familles et ne tenir qu'une approximative comptabilité des morts dans les rangs irakiens ? La douleur de leurs familles est-elle moins respectable que celles des familles occidentales ? Est-elle politiquement incorrecte ?
Les questions soulevées par les images des prisonniers sont exemplaires de l'existence de ce double standard. Les chaînes françaises ont diffusé des images de reddition de militaires irakiens. Mais la question déontologique ne s'est véritablement posée que lorsque les chaînes arabes ont diffusé des images de prisonniers américains. C'est alors et alors seulement que la controverse sur le traitement des prisonniers de guerre et en particulier sur leur traitement médiatique a pris de l'ampleur, notamment dans la presse écrite [15]. Pourtant Patrick Poivre d'Arvor, préposé à la célébration de sa chaîne, n'hésitait pas, dans le journal de TF1, à professer, avec l'assurance qu'on lui connaît, une demi-vérité où l'on reconnaît le spécialiste des demi-mensonges. Faisant référence à la Convention de Genève, mais n'évoquant que les images des visages des prisonniers, sans dire un mot des situations dans lesquels ils sont filmés, Patrick Poivre d'Arvor déclare : « Nous avions d'ailleurs pris soin de masquer leurs visages sur notre antenne ». En vérité, des images humiliantes (et sans « masque ») de prisonniers irakiens avaient été diffusées sans précaution sur la chaîne quand Le Monde, nous apprenait ceci : « Conscient de ne pas avoir procédé de la même façon la veille avec les images de prisonniers irakiens, M. Namias a fait "maquiller" les archives afin qu'elles ne permettent plus de reconnaître les individus [16]. »
2.3. Quant aux victimes, certaines d'entre elles ne seront pas « maquillées », même pour les archives : simplement déclassées ou oubliées.
Journal de TF1, 20 heures, 21 mars 2003, présenté par Claire Chazal. Alors que quelques reportages auparavant, on mentionne avec prudence le chiffre de 3 morts et 207 blessés à Bagdad, sans être en mesure de donner le moindre chiffre, fût-il contestable, de la totalité des victimes civiles et militaires du côté irakien, Claire Chazal, annonce, sans préciser quelle est l'origine des victimes dont elle parle : « Le bilan de ces quatre premiers jours de guerre, en termes humains, est assez lourd puisque selon les dernières informations, 21 soldats américains et britanniques auraient trouvé la mort ». Suivent alors les réactions de deux familles américaines – diffusées sur toutes les chaînes (sans doute en attendant de faire de même pour les familles de soldats irakiens…), puis des informations sur les journalistes morts ou disparus. Un bilan – c'est la fin de la séquence – des « premières victimes de cette guerre contre l'Irak ». On pourrait croire que le contexte suffit à expliquer cette présentation totalement unilatérale, qui ne retient comme victimes de la guerre que les militaires américains et anglais. Mais non. Quelques instants plus tard, après avoir cédé la parole à Loïc Berrou - qui évoque la « doctrine audacieuse », le « pari risqué » de l'Etat-major américain -, Claire Chazal reprend : « Il faut souligner à ce stade que, selon en tout cas les premiers bilans officiels, il y a plus de victimes du côté américano-britanniques que du côté irakien, selon, encore une fois les bilans officiels ». Ainsi, des bilans officiels dont on dit par ailleurs qu'ils sont invérifiables, permettent d'établir une comparaison… évidemment invérifiable, mais qu' « il faut souligner à ce stade ». Plus effarant encore, la comparaison indécente met en balance les chiffres officiels des victimes militaires de la « coalition » américano-britannique, avec celui des victimes civiles (vraisemblablement plus nombreuses que ne le disent les autorités irakiennes) de la seule ville de Bagdad, … alors que l'on ne sait rien des victimes civiles dans les autre villes ou localité du pays. Mais surtout « il faut souligner à ce stade » que le bilan de Claire Chazal, ne dit pas un mot des victimes militaires irakiennes. Pourquoi ? Parce que l'inhumanité des soldats irakiens (et de leurs familles …) serait telle qu'ils ne méritent aucune compassion – ce sentiment si fort répandu à tous propos sur TF1 ?
Journal de TF1, 1er avril 2003, 20 heures. Après plusieurs « sujets » centrés sur les opérations militaires du point de vue américain, un reportage dans un quartier sud de Bagdad, où des missiles ont raté leur cibles, donne à voir et à entendre des habitants : ceux d'une maison détruite (voisine d'une autre où deux habitants sont morts ). Enfin, Jean-Pierre About commente quelques images prises, dit-il, « sur la route du retour » : devant un cimetière « des familles qui portaient sur leurs épaules les morts de la dernière nuit d'horreur ». Fin. Patrick Poivre d'Arvor enchaîne aussitôt : « Il convient de rappeler que nos équipes de reportage là-bas sont toujours accompagnée d'officiels irakiens ». Comme s'il fallait, volontairement ou pas, neutraliser le reportage et la dernière phrase de Jean-Pierre About. D'autant que le reportage suivant porte sur le tournage d'un clip de propagande à la gloire de Saddam Hussein…
Journal de TF1, 2 avril 2003, 20 heures. Présentation du journal. Après un bref résumé des opérations militaires, cette liaison : « Par ailleurs, de nombreuses victimes civiles ont été touchées aujourd'hui ». Par ailleurs… Le journal proprement dit s'ouvre sur un reportage tourné de nuit dans les environs de Kerabala, aux côtés de la 3ème Division d'infanterie et fait état de « très nombreuses victimes civiles comme en témoignent ces images tournées sous contrôle irakien ». Une précision qui placée ici impose une distance sans doute indispensable… Et ce n'est pas fini. Après un second reportage, Patrick Poivre d'Arvor, maître des transitions, présente ainsi le reportage suivant : « Ces combats, on l'a vu, sont très meurtriers de part et d'autre ». Ce que l'on a vu jusqu'alors, ce sont des victimes civiles irakiennes, dont on nous a précisé que les images avaient été tournées sous contrôle. Ce qu'il s'agit de nous présenter maintenant, c'est un assez long reportage de Bernard Volker qui recueille les témoignages de militaires américains blessés.
Ce double standard dans la présentation des victimes peut s'étendre aux journalistes eux-mêmes, comme s'il fallait distinguer : « les nôtres » et « les autres ». Mercredi 8 avril 2003. Journal de 20 heures. Les titres : « Violents combats (…). Les chars continuent leur avancée ». Suivi de ceci : « Lors de cette percée, un blindé américain a tiré sur l'Hôtel Palestine où sont logés la plupart des journalistes. Deux de nos confrères ont été tués, un Espagnol et un Ukrainien. Par ailleurs, un correspondant d'Al-Jazeera lui aussi a été tué dans le quartier des Ministères ». Par ailleurs, encore…. Ainsi, il y aurait « nos confrères » et « par ailleurs, un correspondant ». Il y a « L'Hôtel Palestine où sont logés la plupart des journalistes » et « le quartier des Ministères ». En réalité : l'immeuble qui abrite les locaux d'Al.-Jazeera.
La neutralité est apparente, et la dépolitisation des enjeux est en vérité une politique. Intentionnelle ou non, elle se confirmera au fil des jours et culminera avec la « chute de Bagdad » : après la légitimation de la guerre par son récit, viendra le temps de la légitimation de la guerre pas son résultat.
II. De la télévision à la presse écrite : la légitimation de la guerre par sa propagande ?
En attendant, force est d'admettre que la plupart des journalistes ont fait un indéniable effort de sobriété et d'exactitude pour éviter que leur langage n'épouse sans discernement le point de vue des Etats-majors américain et britannique [17]. Pourtant, de la propagande insidieuse nichée dans les mots et la rhétorique de la guerre, à la propagande silencieuse sous-jacente aux commentaires, les médias français n'ont guère fait preuve d'autant d'innocence qu'il peut y paraître.1. Propagande insidieuse ? Les mots et la rhétorique de la guerre
1.1. Quelle est donc cette guerre qui, commencée en 1991, n'a pas cessé depuis et dont les bombardements dans la nuit du 19 au 20 mars 2003 ont marqué le début d'une nouvelle phase ? Pour la quasi-totalité de médias français, c'est une nouvelle guerre distincte de celle de 1991. Comment désigner alors cette nouvelle guerre ? De façon générale, on parlera plutôt la « guerre en Irak » que de la « guerre contre l'Irak ». Et pour Le Monde, nous serions passés – ainsi varie le surtitre de la « séquence » correspondante - de « La crise irakienne » au « conflit irakien ». Pourtant, non sans audace, Le Monde commence par appeler la guerre par son nom [18]. Le titre de « Une » de l'édition datée du 21 mars annonce : « La guerre américaine a commencé ». Et dans le numéro daté du 22 mars, le titre de la « Une » - « La coalition américaine envahit l'Irak » - est confirmé par celui la page 2 : « L'invasion de l'Irak par les troupes anglo-américaines a commencé ». Mais, sauf erreur ou omission de notre part, Le Monde n'a pas été suivi par ses confrères et n'a pas renouvelé son audace [19]. Pourquoi le terme d' « invasion », pourtant parfaitement approprié en l'occurrence, est-il absent du lexique journalistique ? Sans doute par ce que l'invasion n'étant ni légale, ni légitime doit être condamnée sans réserve, ni contorsion.
Reste à désigner plus précisément les auteurs de cette invasion. Les expressions exactes, mais longues, ne résistent pas toujours au souci de simplifier, voire de soutenir. De la « coalition aux « alliés », les à-peu-près et les dérapages se multiplient.
Les partenaires de la guerre contre l'Irak forment forme, certes une « coalition », c'est-à-dire, selon le dictionnaire, une « association de plusieurs nations contre un ennemi commun ». Mais comme ladite « coalition » est entièrement placée sous hégémonie américaine, la neutralité du vocable le rend moins neutre qu'il n'y paraît [20]. De surcroît, la « coalition » est dans le contexte de cette guerre, un terme venu du gouvernement et de l'Etat-major américains pour dissimuler leur hégémonie et donner l'impression qu'ils sont largement soutenus : c'est un terme marqué par la propagande (et par le souvenir de la guerre du Golfe de 1991).
Non contents de désigner l'attelage américano-britannique (flanqué de quelques troupes auxiliaires) par le mot - la « coalition » - qu'emploie le chef de file des bombardiers, nombre de médias trouvent plus simple, plus clair, plus percutant sans doute de le nommer « les alliés ». De France-Info ou TF1, où le terme prolifère dès le soir du 19 mars, à France 2, où il s'incruste occasionnellement, une évidence s'est imposée : une alliance ... est composée d' « alliés ». Ainsi, et à titre d'exemple, dans le journal de 20 heures de TF1, le lundi 24 mars, Patrick Poivre d'Arvor, à trois reprises au moins, se laisse aller. D'abord : « Le gros des troupes alliées poursuit son avancée sur Bagdad ». Ensuite : « Les troupes alliées semblent rencontrer des difficultés qu'elles n'avaient pas prévues ». Et enfin, plus sobrement : « Les alliés ne semblent pas avoir pris Bassorah et Oum Ksr ». Moins fréquemment, voire occasionnellement, la presse écrite fait de même. Ainsi, à la « Une » du Monde daté du 25 mars, on peut lire le sous-titre suivant : "Des morts, des prisonniers, des erreurs de tirs : les premiers revers des alliés" ? Et à la « Une » du Monde daté du 28 mars, on peut lire ce résumé : « L'offensive alliée marque le pas ». On voudrait croire à un effet de la simple routine ou de la nostalgie éplorée : pour ces alliances dont la France faisait partie dans les guerres précédentes. À moins qu'il ne s'agisse, plus cyniquement, de faire jouer toutes les résonances historiques de ce terme, venues de la dernière guerre mondiale. À défaut d'en être, nous aurions ainsi une alliance qui combattrait pour nous contre le nouvel Hitler du moment.
Le vocabulaire chargé de désigner les effets de la guerre ne lui résiste pas non plus. Impassibles, la plupart des journalistes enregistrent des « destructions », sans distinguer, comme les armées américaine et britannique, les objectifs militaires et les objectifs civils, du moins tant qu'il s'agit de bâtiment publics, de centrales électriques, d'écoles : tous objectifs réputés « militaires ». De même, ils parleront à l'unisson de « reconstruction », sans guère s'attarder sur l'origine des « destructions ». Mais surtout, les bombardements « ciblés » et les armes « intelligentes » atteignent des civils et multiplient les blessés et les morts. « Dégâts collatéraux » ? Les journalistes refusent désormais de reprendre à leur compte ce vocabulaire obscène. Pourtant, nombre d'entre eux continuent de dire « bavures ». La presse écrite peut tenter de se dédouaner en mettant les « bavures » entre guillemets. Encore cette maigre protection contre la barbarie des mots n'est-elle pas générale. Quelques exemples.
Le Figaro, Jeudi 27 mars 2003, p. 3, titre : « Première bavure de la coalition à Bagdad : 14 morts, 30 blessés ». L'auteur de l'article – Adrien Jeaulmes, envoyé spécial à Bagdad – place, il est vrai, la « bavure » (et l' « erreur ») entre guillemets. Mais il conclut ainsi son article, après avoir invoqué les « conditions météo épouvantables » : « Cette première « bavure » est aussi le résultat de l'habile stratégie irakienne, consistant à disperser ses forces à l'intérieur des villes. ». Tout compte fait, il s'agit à peine d'une « bavure », mais de la conséquence d'une erreur accidentelle, d'une météo épouvantable et d'une stratégie irakienne intentionnelle.
Libération, mercredi 2 avril 2003 sous-titre ainsi sa « une » (« Irak – Les civils sous le feu ») : « Bavures et bombardements meurtriers se multiplient, comme hier près de Hilla ». La différence entre « bavures » et « bombardements meurtriers » échappera peut-être au lecteur. Mais le titre des pages 2 et 3 est moins économe de précautions : « Premiers carnages civils de l'armée américaine ». [21]
Le Figaro, mercredi 2 avril 2003, p. 5. - Un titre : « Le Pentagone mis à mal par les bavures » Quelles bavures ? « La bavure de la route n°9 », comme l'appelle, à trois reprises, le correspondant du Figaro à Washington, Jean-Jacques Mével. De quoi s'agit-il exactement. D'un « incident », comme notre zélé correspondant rebaptise la « bavure » (ou la « tuerie », ainsi qu'il la désigne en passant) quand il est en panne de vocabulaire. Que s'est-il passé ? Ce n'est pas clair : « Les circonstances exactes de l'incident se perdent dans le brouillard de la guerre ». « Brouillard de la guerre » ! … « Brouillard » qui se dissipe sûrement lorsque l'on apprend au passage que « tout villageois est un terroriste en puissance ». Ainsi est « terroriste » quiconque a recours aux armes contre des militaires américains. Quoi qu'il en soit, le « brouillard » invite à tirer cette leçon pleine de tact : « Dans la bavure de la route n°9, les responsabilités sont sûrement partagées ». Par qui ? Par les soldats américains et leurs victimes sans doute.
Difficile d'invoquer, pour justifier de tels abus, la précipitation et les délais de « bouclage » : entre deux guerres depuis 1991, quelques périodes de répit avaient été laissées à la réflexion.. « Bavure » atténue la conséquence. On met en avant une prétendue cause avant d'en décrire les effets, comme si la cause elle-même ne résidait pas avant tout dans l'existence même des bombardements. Était-il si difficile de commencer par les faits ? Les bombardements provoquent des morts, souvent des tueries, parfois des carnages au sein de la population civile. Ensuite peut venir l'explication, qui devrait toujours souligner que ce sont les militaires qui parlent de « bavure », comme pour dégager leur responsabilité ou d'« erreurs », laissant ainsi penser que l'horreur est avant tout accidentelle.
1.2. Et l'on passe ainsi insensiblement des mots de la guerre à sa rhétorique. Question de vocabulaire, une fois encore. Les opérations militaires sont présentées dans le langage des armées américaine et britannique. Les bombardements continuent souvent à s'appeler des « frappes », et même des « frappes ciblées » ou des « frappes d'appui au sol ». Et tout le vocabulaire d'Etat-major suit : « sécuriser », placer « sous contrôle », se heurter à des « poches de résistance » et parfois même « pacifier » et « nettoyer. ». La désinvolture avec laquelle le vocabulaire militaire est pris en charge provoque de singuliers dégâts collatéraux, lorsqu'il s'agit d'expliquer les opérations des « alliés » contre les « poches de résistance ».
Ainsi, au Journal télévisé de 13 heures sur TF1 [22], une audacieuse comparaison nous informe que les jardiniers américains combattent les moustiques irakiens avec des jets d'aérosol. Voici comment. L'envoyé spécial de TF1 à Koweït-City tente d'expliquer au présentateur Jean-Pierre Pernaut, comment, du point de vue des soldats américains, se déroulent les combats : « Imaginez, Jean-Pierre, vous êtes dans votre jardin, piqué par des moustiques, mais ça ne vous empêche pas de bêcher ; si les moustiques deviennent trop nombreux, alors, vous allez lancer un jet d'aérosol... ». Tout y est : l'animalisation de l'ennemi, nuisible, combattu par des jardiniers, paisibles, qui n'utilisent leur aérosol qu'en dernier recours...
La narration de la guerre est indissociable de sa personnalisation. Une personnalisation qui contribue à sa dépolitisation. Dès le 20 mars, Le Monde (daté du 21 mars 2002) publie, sous la signature de Jan Krauze, un « portrait » de « Tommy Franks, chef de guerre » (c'est ainsi qu'il est présenté à la « Une »), sous le titre : « Tommy Franks, le Taciturne ». Ce portait sera suivi le lendemain (Le Monde daté du 22 mars) d'un portrait de Tony Blair, rédigé par Jean-Pierre Langellier et intitulé : « Tony Blair, l'obstiné ».
De même, le commentaire de la conférence de presse réunie par Tommy Franks, chef de l'Etat major américain, nous a valu dans le journal de 20 heures sur TF1 le 21 mars 2003, non un compte-rendu du contenu de cette conférence de propagande, avec ses informations biaisées et ses silences éloquents, mais une nomination pour de futures médailles. En effet, le journaliste a trouvé » « l'angle » qui permet d'informer sur la désinformation, sans rien en dire : parler de Tommy Franck lui-même. : « L'homme de cette 2e guerre du Golfe ». Dont on apprend ainsi, images et propos à l'appui, qu'il est « empreint de religion », « peu loquace », « fin communicant », « capable de plaisanter ». Certes, il a présenté « un show (sic) pendant lequel il n'a rien dit », mais l'essentiel est résumé dans cette conclusion du « reportage » : « La deuxième guerre du Golfe a trouvé son visage ». Et grâce à TF1, la guerre a déjà fait un héros. Et cette héroïsation pour la postérité est complétées par une comparaison pour le bon motif. Bernard Volker, dont chaque intervention mériterait d'être relevée tant elles sont de petits chefs- d'œuvre de propagande, commente : Saddam Hussein est sans doute « toujours vivant, terré dans son Bunker, en quelque sorte comme Hitler en avril 45 ». Très informé Bernard Volker « sait » que des tractations seraient en cours pour faciliter l'éventuelle fuite de Saddam Hussein. Mais, voilà : « Il se peut également que Saddam Hussein préfèrera entraîner dans sa chute le plus grand nombre possible de soldats et de civils en une sorte d'Apocalypse ». On peut ne pas éprouver une excessive sympathie pour Saddam Hussein, et apprécier la subtilité de la comparaison avec Hitler, … qui suffit à justifier la guerre sans avoir à le dire.
Enfin, avec une inconscience professionnelle qui coïncide curieusement avec leur récit militarisé de la guerre américaine du point de vue de la guerre américaine, la plupart des reporters de télévision et nombre de journalistes de la presse écrite amalgament sous l'expression d' « aide humanitaire », l'aide militairement désintéressée (que s'efforcent d'apporter la Croix-Rouge et un certain nombre d'ONG) et le ravitaillement convoyé par les troupes américaines et britanniques à des fins politico-militaires parfaitement identifiables : tenter de séduire les « populations » (comme ils disent…) dont ils ont provoqué ou précipité la détresse et le dénuement. Qu'importe si l' « humanitaire militaire » est une contradiction dans les termes que dénoncent certaines organisations (comme elles l'ont fait notamment lors de la guerre du Kosovo). Qu'importe si l'invasion américaine est la cause immédiate la plus directe des privations de nourriture et d'eau potable ! Qu'importe si les Irakiens ont été les victimes d'un embargo de dix ans qui est une des causes moins immédiates d'une situation alimentaire et sanitaire dont près de 500000 enfants sont morts et qui a miné la santé de tant d'autres ! Qu'importe si le marchandage « pétrole contre nourriture », que ce soit ou non avec la complicité active du régime irakien, a littéralement pris en otage tout un peuple !
L'aveuglement, intentionnel ou non, des envoyés spéciaux et autres commentateurs avisés, sans doute animés d'une non moins aveugle sincérité … humanitaire ne les incitent pas à pousser la compassion au-delà de ce qu'autorise un vocabulaire armé, alors qu'il serait plus exact de parler simplement de « ravitaillement militaire ». Il y aurait ainsi le nom : « ravitaillement », et sa sobre qualification : « militaire ». Le problème sous-jacent, pourtant, n'est pas nouveau. Libération, avant le commencement de l'invasion de l'Irak, titre à la « Une », le 4 mars : « Irak : Humanitaires contre militaires ». Un titre précisé par ce sous–titre : « Mobilisation chez les ONG, qui dénoncent la volonté américaine de les encadrer en cas de guerre » [23]. De semblables prises de position pourraient inviter à un minimum de prudence, sinon de décence. Celle-là même qui fait totalement défaut quand, dans Le Journal du Dimanche du dimanche 6 avril (p. 3), on peut lire sous le titre « Humanitaire » cette note signée S.J. : « Conscients de la faiblesse actuelle de l'aide humanitaire distribuée dans le dans le sud de l'Irak, des responsables américains ont annoncé hier que deux navires chargés de 56.000 tonnes de blé – une quantité suffisante pour nourrir 4, 5 millions d'Irakiens pendant un mois – faisaient route en direction du port d'Oum Qasr. ». Quelle est la cause de la « faiblesse » dont « des responsables américains » seraient « conscients » ? Quelle est cette « aide humanitaire », qui serait déficiente ? Celle qui seule en mérite le titre ou le ravitaillement, convoyés par les militaires et auxiliaires de leur combat ? Ces questions ne méritent même pas d'être posées.
En revanche, la prétention de bâtir sur des informations militaires, glanée au jour le jour, au conditionnel ou à l'indicatif, des explications générales, fréquemment démenties, a occupé des centaines de pages et d'heures d'antenne. Inutile d'insister sur les pronostics de la « guerre éclair » (généreusement attribués à l'Etat-major américain…) et les informations sur le soulèvement « au conditionnel » de Bassora, bientôt suivis, des pronostics sur une guerre longue [24], en raison d'une résistance irakienne (qui bénéficie alors des explications ad hoc) : hypothèses ou certitudes aussitôt balayées, après une prétendue « pause », par une nouvelle « surprise » : l'effondrement du régime et la « libération ». La frénésie dans le montage d'échafaudages qui s'écroulent aussitôt transforme le journalisme en version à peine améliorée des discussions de bistrot, au détriment des informations vérifiées et des explications nécessaires.
Propagande par excès d'imprudences que soutiennent, paradoxalement, les prudences très orientées de la presse écrite.
2. Propagande silencieuse ? Les prudences de la presse écrite
Les principaux quotidiens et hebdomadaires nationaux, selon des modalités qui diffèrent en fonction de leur périodicité, ont relaté et analysé la guerre américaine contre l'Irak avec beaucoup plus de distance et de rigueur que lors des guerres précédentes. Sans doute faut-il y voir un effet, non d'un examen intransigeant de ses errements passés, mais plutôt d'une position plus critique à l'égard de la politique américaine, avec pour conséquence une distinction plus rigoureuse entre les faits et les commentaires, eux-mêmes soutenus par un effort de mise en perspective de l'actualité : effort dont témoigne la multiplication des enquêtes et des dossiers. En particulier, la distance prise par les commentateurs à l'égard de la guerre américaine a partiellement rendu possible une relation moins belliqueuse des opérations militaires et de leurs effets. Il convient donc de distinguer nettement les reportages – dont certains étaient remarquables, comme ceux de Patrice Claude, dans Le Monde - et les commentaires des éditorialistes qui sont ici les seuls à être concernés. Comme on va le voir, on ne relève, à de rares exceptions près, aucune différence significative entre les éditorialistes, qu'ils soient classés à droite ou à gauche.
Quasi-unanime dans son soutien sans réserve (ou presque) aux guerres précédentes, la presse écrite s'est retrouvée cette fois dans un soutien quasi-unanime à la position diplomatique défendue par Jacques Chirac, au point même d'interpréter les manifestations mondiales contre la guerre du 15 février 2003 comme des manifestations de soutien à cette même position. Pourtant, à mesure que l'intransigeance américaine semble rendre la guerre inévitable, nombre d'éditorialistes modèrent leur hostilité. Pourquoi ? Parce que, au nom de la « stabilité », le point de vue institutionnel et diplomatique, européen ou occidental, voire atlantiste prévaut sur tout autre.
Ainsi, les éditorialistes de Libération - dont l'exemple peut suffire ici en raison de la position particulière de ce journal - déplorent avant tout la fracture transatlantique et soutiennent la recherche d'un improbable accord.
Dans l'édition du 4 mars 2003, Patrick Sabatier en appelle déjà à la recherche d'un compromis Et redoutant que ce compromis ne voit pas le jour, il renvoie dos à dos les « camps en présence » : « Le drame est que les uns et les autres ont peut-être déjà calculé avoir plus d'intérêt à ce que la guerre ait lieu, les uns pour la dénoncer, les autres pour la gagner… ».
Le 17 mars, Gérard Dupuy relève que le rôle des Etats-Unis dans le monde « suscite bien des réserves » et poursuit : « Quelle que soit la fortune des armes, la collectivité internationale devra retrouver un moyen de se redéfinir, ONU, Otan ou Union Européenne ». Quant aux Etats-Unis : « Il faut espérer qu'ils n'écouteront pas alors que leur ressentiment – à charge pour les autres, en particulier la France, de retrouver les voies d'une confiance restaurée. ».
Le 18 mars, Serge July s'insurge, mais surtout contre des conséquences sélectivement énoncées : « Le forcing guerrier américain, cet impérialisme de la démocratie et du marché (…) bouscule dans son sillage non seulement les Nations unies et l'Otan, mais aussi l'Union européenne. » .
Enfin, le 19 mars, Patrick Sabatier s'inquiète des attaques qui prennent pour cibles « la France » et invite celle-ci à « résister à cette dérive dangereuse » et à « éviter de tomber à son tour dans le caniveau en cédant à l'antiaméricanisme et à l'anglophobie ». La raison ? « (…) les Américains et les Anglais sont (…) deux peuples dont elle ne peut pas, et ne doit pas se passer pour construire l'Europe, et assurer l'équilibre du monde, sans oublier la reconstruction de l'Irak ». Alors que la guerre n'est pas encore commencée, on parle de « reconstruction » et d'alliance entre les peuples occidentaux : la guerre elle-même et les autres peuples sont déjà secondaires.
Un tel cadrage éditorial de la guerre peut être sans effet majeur sur son récit. Mais il permet lui aussi de se demander : « quel sens la presse a-t-elle donné à cette guerre ? »
2.1. Dans l'attente de la victoire - . Le jour même des premiers bombardements sur Bagdad, les éditorialistes de la presse écrite s'interrogent déjà sur l'après-guerre. L'opposition au déclenchement de la guerre fait place à son accompagnement critique, fondé – à quelques nuances près – sur les mêmes vœux : pourvu que la guerre soit rapide et que l'ONU participe à la reconstruction de l'Irak
Ainsi, à peine la guerre vient-elle de commencer qu'il n'est plus question de s'y opposer. C'est ce que Nicolas Beytout, dans Les Echos daté du 21 mars affirme en toute clarté : « La guerre était inévitable, elle est là. La question n'est donc plus de savoir si faut être pour ou contre, mais comment en sortir. Comment organiser l'après-guerre après avoir à ce point gâché la pré-guerre » [25]. Mais pour « en sortir », encore faut-il que la guerre ait eu lieu.
Premier souhait donc : pourvu que la guerre soir rapide. Tel est le vœu formulé dans Le Figaro du 20 mars par l'éditorial de Pierre Roussillon - « Guerre et reconstruction » - qui commence ainsi : « La France a tout fait pour un désarmement pacifique de l'Irak dans le cadre des Nations unies, mais ne pouvait empêcher un assaut (sic) décidé par Georges W. Bush. Il ne reste plus qu'à souhaiter que la guerre soit rapide, et, surtout, le moins destructible possible ». Michel Schiffres, dans Le Figaro du 21 mars, surenchérit : « Maintenant que la guerre est engagée, on doit espérer qu'elle se terminera le plus vite possible. Les raisons humanitaires justifient en priorité cette exigence. »
Dans Libération, le 23 mars, même doctrine. Gérard Dupuy écrit : « Que la guerre finisse vite au point que ce serait presque comme si elle n'avait pas lieu… C'est un souhait de bon sens. Les meilleures raisons qui portaient à repousser la guerre – les souffrances qu'elle induit (sic) inévitablement – amènent à souhaiter une prompte victoire anglo-américaine qui allégerait le sort des victimes civiles ». Comme si les souffrances que la guerre « induit » devaient être nécessairement réduites par une victoire rapide dont l'une des conditions pourrait être de recourir à des moyens militaires particulièrement dévastateurs.
Pourvu que la guerre soit rapide, car « les raisons humanitaires justifient en priorité cette exigence », déclare donc Michel Shiffres qui avoue pourtant : « Ce n'est pourtant pas la seule raison. En quelques mois, le monde a ajouté des fractures nouvelles à ses blessures anciennes. Pour n'en citer que quelques-unes, la faillite politique de l'Europe, le discrédit de l'ONU, la crise entre les pays appartenant à l'Occident. Encore, dans cette liste de troubles, ne doit-on pas oublier le Proche-Orient. ». La hiérarchie des conséquences est établie.
Quant à Gérard Dupuy, la compassion qui l'aveugle s'explique sans doute par son autre raison : « Une des bonnes raisons de souhaiter la fin rapide de la guerre, c'est qu'on pourra enfin entendre quelque chose d'encore inconnu : la propre voix des irakiens. En comparaison de celle-ci, les voix du Conseil de sécurité et leur décompte ne devraient pas importer beaucoup ». Ainsi est préparée une légitimation de la guerre a posteriori, … conformément aux vœux de l'administration américaine.
On se doute alors du sens que revêt le second souhait de nos éditorialistes : pourvu que l'ONU participe à la reconstruction de l'Irak. Car s'il n'est plus temps de condamner la guerre, il est temps de penser à l'avenir et, pour cela, de se borner à accepter une division des tâches, comme le précise Pierre Roussillon dans l'éditorial du Figaro déjà cité : « A l'heure où d'autres seront bientôt occupés (sic) à bombarder et à envahir, il ne sera pas trop tôt pour prendre à bras-le-corps l'immense et multiple chantier de la reconstruction ». Quant à Serge July, dans Libération du 20 mars, il consacre son éditorial - « Sauver l'ONU » - à l'enjeu correspondant à ce titre : « On peut être hostile à ce forcing guerrier. Ce n'est pas une raison pour abandonner l'Irak et les Américains à eux-mêmes. Les Nations Unies doivent revenir dans le jeu (…). ».
De cet attentisme vaguement inquiet sur l'issue de la guerre et de ces priorités très occidentales définies pour l'après-guerre, Le Monde fournit une bonne illustration.
Déjà, entre le 15 et le 20 mars, quand, l'éditorialiste anonyme s'inquiète de la guerre qui vient, c'est seulement pour enregistrer les échecs diplomatiques des gouvernements des USA (« L'échec diplomatique de George W. Bush », éditorial du 18 mars) et de Grande-Bretagne (« L'échec de Blair », éditorial du 20 mars), alors que Thierry de Montbrial, « pour Le Monde », se situe déjà – c'est le titre – « Au-delà de l'affrontement ». Et l'éditorial de l'édition datée du 21 mars titre sur une question - « Et après ? » - qui reçoit la réponse suivante : « Rien n'indique que le mécanisme d'inspection onusien, doublé d'une pression militaire, n'aurait pas fini par désarmer Saddam Hussein. Les Etats-Unis ont choisi d'abandonner unilatéralement cette voie. Rien ne les autorise à la court-circuiter à nouveau lorsque le temps sera venu de reconstruire l'Irak. Il faudra repasser par les Nations Unies ». Avec une légère réserve, l'opposition à la guerre est rapidement soldée. Il faudra attendre une semaine pour que Le Monde s'interroge à nouveau [26] et, le 28 mars, titre à la « Une » : « Où va la guerre de Georges W. Bush ? ». Mais si l'éditorial - « Les morts de la guerre » - commente les dangers qui menacent le déroulement de la guerre et, partant, son issue, il n'en tire aucune conclusion.
Ainsi, alors que dans les guerres précédentes, l'éditorialiste anonyme du Monde dispensait généreusement ses conseils politiques et militaires au « camp » qu'il avait choisi de soutenir [27], cette fois, il s'abstient. Préférant tirer le bilan des échecs diplomatiques de Bush et de Blair et des conséquences des divisions entre les gouvernements européens (ou réfuter les arguments relatifs aux objectifs pétroliers du « conflit »), l'éditorialiste ne se laisse pas distraire par la guerre elle-même. Mieux : il se consacre prioritairement aux problèmes que cette guerre rejette tragiquement dans l'ombre (la guerre en Tchétchénie ou la situation en Serbie) ou à d'importantes questions franco-françaises (comme la décentralisation ou le report des baisses d'impôt.) Journal d'opinion – quoi qu'il en dise – Le Monde n'aurait pas d'opinion ? Presque. Car Jean-Marie Colombani s'est chargé, le 25 mars, de nous dire, en consacrant essentiellement son éditorial à la question de l'Europe, où se situe son journal : « Au-delà du "non" ». Et l'éditorialiste anonyme se situe de préférence ailleurs, en deçà et au-delà…
Quelques exceptions méritent pourtant d'être relevées. Outre L'Humanité et La Croix, Marianne et Le Nouvel Observateur affichent une position intransigeante. Marianne daté du 24 au 30 mars titre : « La secte Bush attaque » et la totalité des pages consacrée à la guerre expose les raisons d'une condamnation totale de la guerre américaine. L'éditorial de Jean-François Kahn qui souligne notamment : « Les conséquences à moyen terme seront catastrophiques .Cauchemardesques ». Le numéro spécial du Nouvel Observateur (20-25 mars 2003) porte pour titre « La guerre américaine ». L'éditorial de Jean Daniel – « La guerre en aveugle » - résonne une condamnation vigoureuse de la guerre. Extrait : « Nous disions qu'une guerre contre l'Irak décidée sans associer les peuples musulmans et surtout arabes, sans se soucier de la tragédie israélo-palestinienne ne pouvait que servir le terrorisme. C'est ce que nous continuons de croire ». Examinant les hypothèses les plus favorables, Jean-Daniel souligne : « Quand bien même cette conjonction de miracles se réaliseraient, ses effets ne seraient positifs qu'à court terme. ».
2.2. Au secours de la victoire militaire ? -. Ainsi, avant et pendant l'invasion américano-britannique, la plupart de éditorialistes s'inquiètent surtout des fractures diplomatiques avec le gouvernement américain et au sein même de l'Europe. Aussi ne doit-on pas être étonné que la victoire militaire remportée par les envahisseurs incite ces même commentateurs à venir au secours de cette victoire en préconisant une réconciliation, fût-ce aux conditions américaines.
Le débat sur la légalité, la légitimité, les objectifs ou les enjeux de la guerre est, une fois de plus, déclaré clos. Si Claude Imbert dans Le Point daté du 11 avril, s'interroge – « Et après ? », c'est aussitôt « Après ? Ce n'est qu'après, et peut-être longtemps après – que l'on portera un jugement équitable sur l'équipée américaine. Mais c'est dès maintenant que la France doit tailler la route depuis qu'au carrefour irakien elle a choisi de bifurquer ».
Dans le même numéro du Point Bernard-Henri Lévy partage le même empressement : « Dans deux, huit ou trente jours, la guerre en Irak sera finie. Les pro et les antiguerre continueront, bien entendu, à échanger leurs arguments. On les entendra, longtemps encore, débattre de la question de savoir qui aura eu rétrospectivement raison ». Débat stérile voire futile, apparemment, puisque : « La vérité, c'est que nous sommes déjà dans l'après – et que les seules questions qui comptent, ce sont celles du monde qui va, ou non émerger de cette tourmente ». Et Bernard-Henri Lévy de passer en revue ces questions. Il suffit de relever que la question palestinienne ne figure pas dans la liste, pour saisir quels biais déterminent l'approche de ces questions [28].
L'urgence est donc d'inviter le gouvernement français à « tailler la route depuis qu'au carrefour irakien elle a choisi de bifurquer », comme le dit Claude Imbert., car, dit-il, « La France a pris le risque de creuser entre l'Amérique et nous un fossé impressionnant » et « L'ardeur spectaculaire mise chez nous à contrarier la guerre irakienne a pour effet pervers de contrarier notre dessein européen ». Et de conclure : « La posture française échouerait si elle devait se cantonner au harcèlement stérile de l'entreprise américaine. Mais elle retrouverait sa vertu morale (…) si elle contribuait à servir, avec ses propres atouts, l'apaisement ». [29] .
Autre conseiller réticent du gouvernement français, de gauche celui-là : Libération dont on se souvient qu'il incitait déjà au compromis dès avant la guerre. Ainsi, le 16 avril, Gérard Dupuy invite – c'est le titre de l'éditorial – au « Pragmatisme ». Après avoir félicité Jacques Chirac d'avoir téléphoné à Georges Bush, il poursuit : « L'heure est à la reconstruction non seulement de l'Irak, mais des liens transatlantiques. (…) Bâtir un Irak aussi démocratique, libre et prospère que possible ne doit pas être un projet américain. L'aide au peuple irakien et la stabilité régionale et internationale ne pourraient que pâtir d'une éventuelle guerre froide prolongeant l'opposition entre pro et anti-guerre. Ceux qui n'ont pas approuvé cette guerre ne doivent pas mener une diplomatie du pire et miser par dépit sur un échec américain en Irak, qui est loin d'être impossible. (…) Si on veut « multilatéraliser » l'après-guerre, et que l'ONU puisse y jouer un rôle central, une force de l'Otan pourrait peut-être permettre de réunir, dans le maintien de la paix, des alliés qui s'étaient divisés dans la guerre. » On ne commentera pas ce pieux conseil…
Pourtant, alors que nombre de commentateurs invitent à solder définitivement l'opposition à la guerre, quelques-uns font encore exception (mais pour combien de temps ?) Ainsi, Le Nouvel Observateur de la semaine du 10 au 16 avril 2003, titre « La Chute ». Mais Jean Daniel dans son éditorial – « Sortir du calvaire » - maintient son opposition à la guerre : « Le seul soulagement que procurera la victoire américaine, c'est qu'elle fera cesser la tuerie ». Et La Croix du 11 avril s'ouvre sur un éditorial de Bruno Frappat intitulé : « Le doute » qui répond négativement à la question qu'il soulève : « Faut-il s'incliner respectueusement devant la raison du plus fort et admettre que le vainqueur est légitime parce qu'il a gagné ? »
À lire la plupart des éditorialistes et à voir les journaux télévisés, cette question était devenue secondaire dès le premier jour des bombardements. Pour la plupart des médias français, la victoire militaire américaine l'a rendue subalterne, voire dérisoire. Si les télévisions ont favorisé la légitimation de la guerre par son récit, la presse écrite, même quand elle s'en défend, a contribué à légitimer la guerre par ses commentaires. On ne sera donc pas surpris si, le 21 mai 2003, le vote à la quasi-unanimité du Conseil de Sécurité [30] de la résolution américaine sur la reconstruction de l'Irak, qui tente de légaliser a posteriori l'invasion et légalise l'occupation, n'ait suscité aucun commentaire désobligeant. Et pourtant…
Henri Maler
[1] Serge Halimi et Dominique Vidal, « L'opinion, ça se travaille… ». Les médias et les « guerres justes ». Du Kosovo à l'Afghanistan, quatrième édition revue et augmentée, Marseille, Agone Editeur, 2002.
[2] L'absolution est presque unanime. Lire par exemple l'article de Télérama sur 16 avril 2003 titré « Les leçons du Golfe ».
[3] Documentation réunie avec l'aide de l'association Acrimed (Action-Critique-Médias) : http://acrimed.samizdat.net
[4] « Recommandation à l'ensemble des services de télévision et de radio relative au conflit au Moyen-Orient » (Recommandation n°2003-2 du 18 mars 2003) »
[5] « Une guerre en direct - La télévision s'est efforcée de tirer les leçons de 1991 », par Raphaël Garrigos, Catherine Mallaval et Isabelle Roberts, Libération, mercredi 16 avril 2003.
[6] « Les médias français veulent éviter les erreurs de la guerre du Golfe de 1991 », dépêche de l'AFP, datée du 17 mars 2003 et signée Andrea Graells. Voir également : « Les chaînes françaises dans la hantise de renouveler les erreurs de la première guerre du Golfe en 1991 », Le Monde daté du 25 mars 2003, p. 8.
[7] Sur France Inter, 22 avril 2003, Jean-Claude Dassier, directeur général de LCI : « Globalement, on a tous contribué à faire que les Français ont eu une vue assez claire de la manière dont les choses se sont passées » (Source : le journal Pour Lire Pas Lu).
[8] Partialité « tempérée », qu'un journaliste de France Inter « explique » ainsi : « Cette fois, la France n'est pas en guerre, ce qui enlève une part d'affectif. » (Patrice Bertin dans Télérama, 16 avril 2003).
[9] Stratégies, 13 septembre 2002
[10] « La délicate équation économique des médias », Les Echos, 20 mars 2003 -
[11] Lucas, « France2 : impressions d'un soir », sur le site d'Acrimed.
[12] ibidem
[13] Serge Halimi et Dominique Vidal, op.cit.
[14] Relevé par Serge Halimi.
[15] Libération du 24 mars consacre un article à cette controverse : « Faut-il montrer les soldats prisonniers ? Polémique autour de l'interprétation de la Convention de Genève. ». Et Le Monde fait de même dans son édition datée du 25 mars : « Face aux images de morts et de prisonniers, les télévisions hésitent », p.6 et 7.
[16] Art.cit.
[17] Tel était l'objectif affiché dès le début des bombardements. Lire notamment : « Radios et télés veulent se racheter - De RTL à France 2, la première guerre du Golfe aurait servi de leçon », par Catherine Mallaval et Isabelle Roberts, Libération, vendredi 21 mars 2003.
[18] Rappelons que Le Monde est daté du lendemain de sa parution dans la région parisienne.
[19] Le Monde daté du 28 mars préfère parler de « La guerre de George W. Bush » : une façon commode de prendre ses distances, sans désavouer totalement l'invasion ?
[20] Sans doute est-ce la raison pour laquelle Le Monde daté 22 mars recourt à l'expression « coalition américaine », qui n'a, en toute rigueur, aucun sens (une coalition suppose au moins deux Etats) et confirme cet emploi daté dans son édition des 23-24 mars, page 2.
[21] De même dans Libération du lundi 31 mars, p. 10..
[22] Exemple relevé par David Noël sur le site d'Acrimed.
[23] L'article correspondant - de Thomas Hofnung - porte pour titre : « Des humanitaires en guerre d'indépendance » » et commente (notamment) un communiqué commun de plusieurs organisations qui proclament leur refus « de subordonner (leur) action sur le terrain à une autorité militaire qui est partie au conflit » et rappellent que « l'aide humanitaire ne peut pas être considérée comme une arme au service du conflit ». Une critique réitérée, entre autres, dans une tribune de Jean-Jacques Ruffin, Président d'Action contre la faim, parue dans Le Figaro du mercredi 2 avril 2003.
[24] « Les échéances se mesurent en mois », affirme péremptoirement Serge July dans un éditorial de Libération titré « Constat d'échec », …le 28 mars 2003. Sans commentaires.
[25] Parler de « pré-guerre », c'est la consacrer comme inévitable, voire souhaitable. Et parler de « gâchis », pour le déplorer, c'est en rendre co-responsables les adversaires de la guerre et ses partisans.
[26] Le 22 mars, c'est « L'Europe déchirée » qui retient son attention. Le 23 mars, l'éditorial - « Guerre et pétrole » - a pour objet d'expliquer ceci, qui est la première phrase : « Le but des Etats-Unis en Irak n'est pas le pétrole, contrairement à ce qui est affirmé dans les manifestations contre la guerre (…) ». Un dossier central de 8 pages - « La nouvelle fracture mondiale ». – donne la parole à de nombreux « experts » qui proposent des diagnostics et des pronostics qui portent exclusivement sur les relations transatlantiques, les Nations unies et l'Europe. Le 25 mars, l'éditorial - « L'autre guerre » - est consacré à la guerre de la Russie en Tchétchénie. Le 26 mars, alors que « La bataille de Bagdad commence » (titre de « Une »), l'éditorial - « Pas d'interview » - est consacré au traitement réservé par les médias aux prisonniers de guerre. Le 27 mars, l'éditorial - « Fiscalité et croissance »,- il porte sur la politique du gouvernement Raffarin.
[27] Henri Maler, « Kosovo 1999 : Le Monde et la guerre », dans Variations n°1, Paris Syllepse, 2001.
[28] En août 2002, Bernard-Henri Lévy déclare : « Attaquer Saddam Hussein ? Oui, bien sûr ! » (Le Point, 16.08.02). En octobre 2002, il « maintient » ainsi : « Je maintiens qu'en faisant la guerre à L'Irak, l'Amérique se tromperait de cible » (Le Point, 25.10.02). Source : Pour Lire Pas Lu
[29] Dans Le Point du 18 avril 2003 (p.5), Claude Imbert est encore plus explicite. Inquiet de « L'engrenage de la discorde », - c'est le titre de son éditorial – il s'ingénie à inventer une fausse symétrie qui permet d'affecter de répartir équitablement les tords entre une Amérique qui « réinvente » une « doctrine de la force » et une « l'Europe du cartel de la paix réplique, faute de mieux, par celle du droit. » Mais c'est pour en appeler à une soumission de la diplomatie américaine aux effets de la victoire américaine. Peu convaincu, dit-il, par « l'actuelle agitation diplomatique française », Claude Imbert prodigue ses conseils : « éviter de ressasser l'« illégalité » de l'intervention américaine », car « (…) à l'heure de la victoire américaine, il est vain de cracher contre le vent ». Avant de conclure : « (…) la France - pourtant impuissante à rallier une Europe divisée - n'a que trop asticoté et chamaillé. L'Occident menacé n' que faire de ces bisbilles. »
[30] La Syrie s'est abstenue de participer à la séance en signe de protestation.
12.12.2023 à 21:32
Pour Patrick Champagne
Henri Maler
Texte intégral (1282 mots)

Patrick Champagne est décédé le 9 décembre 2023.
Connu pour ses travaux de sociologie, membre de l'équipe animée par Pierre Bourdieu, il était notamment l'auteur de Faire l'opinion. Le nouveau jeu politique (Paris, Éditions de Minuit, 1990) et de La Double Dépendance : Sur le Journalisme (Raisons d'Agir, 2016).
Pendant ces dernières années, il avait participé à l'édition des cours au collège de France de Pierre Bourdieu.
Patrick était aussi l'un des fondateurs de l'association Action-Critique Médias (Acrimed) dont les critiques ont été largement inspirées par ses travaux de sociologue : son analyse du champ journalistique et sa critique des sondages, notamment.
Depuis 1996, mes relations personnelles avec lui ont toujours été confiantes et fraternelles : des duettistes en quelque sorte.
Longtemps membre notre collectif d'animation de l'association, c'était un compagnon assidu et fidèle. Je veux retenir ici, non seulement ses interventions, mais aussi son l'humour un peu potache et sa modestie : « les noms célèbres sont déjà pris », disait-il en souriant.
Nous perdons un camarade et un ami.
Immense tristesse
Henri Maler
Parmi ses articles, publiés par Acrimed, je retiens la première contribution de Patrick : le résumé succinct d'une intervention dans notre premier débat public d'octobre 1996, publiée lors de l'ouverture de notre site en 1999 : à propos du mouvement social de novembre et décembre 1995 qui a suscité la fondation de notre association [1]
Comme l'ont amplement illustré les événements de décembre 95, et plus récemment encore la couverture médiatique de la grève de la faim des « sans-papiers », il existe un malaise entre le milieu journalistique et les autres secteurs de la société. Les journalistes, qui disposent d'un quasi-monopole de diffusion, tendent en effet de plus en plus à intervenir dans le fonctionnement des institutions syndicales, dans la désignation des leaders et des porte-parole et même dans la vie intellectuelle et politique. Souvent, les personnes interrogées par les journalistes ne se reconnaissent pas dans les déclarations reproduites dans les médias, la recherche du spectaculaire, de la mise en scène ou du scoop l'emportant sur le travail d'information.
Mais ce malaise n'est pas à sens unique. Les journalistes font également état des difficultés qu'ils rencontrent pour exercer leur métier, notamment lorsqu'ils doivent rendre compte des mouvements sociaux. Secteur peu prestigieux et souvent négligé de la plupart des médias, la rubrique « problèmes sociaux » tend à devenir très stratégique lorsque surgissent des situations de crise. Le travail journalistique, en interne comme en externe, est alors l'objet de pressions politiques directes et visibles parce que l'accès aux médias et la manière de traiter l'information deviennent des enjeux politiques majeurs : pressions du pouvoir politique en place sur les médias qu'il essaye de contrôler directement ou indirectement, pressions des différentes parties prenantes au conflit (associations, syndicats, porte-parole auto-proclamés, etc.) pour se faire entendre ou pour infléchir la production de l'information, mais aussi pressions des rédactions-en-chef sur les journalistes spécialisés, ces derniers étant parfois dépossédés du traitement du conflit au profit des journalistes politiques ou des éditorialistes. Comment les journalistes se défendent face à ces pressions multiples et contradictoires ? Quels sont les principes qui pèsent sur la production journalistique ?
Mais le traitement des mouvements sociaux pose bien d'autres problèmes, qui sont peut-être plus fondamentaux encore, bien que moins visibles, et à propos desquels il serait important de débattre. Par exemple, quelles sont les hiérarchies proprement journalistiques, variables selon les supports, qui existent entre les différentes catégories d'informations, quels en sont les fondements et quelles conséquences ont-elles sur le traitement de l'information, et notamment de l'information « sociale » ?
Quelles propriétés doivent avoir aujourd'hui les mouvements sociaux, généralement mal placés dans la course à l'information (« c'est ennuyeux », « c'est toujours les mêmes histoires », « ça ne fait pas rêver les lecteurs » ou même « ça favorise le Front national »), pour que ceux-ci puissent avoir quelques chances d'accéder à l'actualité et en bonne place ? Mais les intellectuels et les responsables syndicaux ne devraient-ils pas, de leur côté, être plus conscients des contraintes spécifiques qui s'exercent sur les supports de presse ?
Un autre problème est celui du vocabulaire utilisé dans la presse, le choix des mots étant souvent, dans ce domaine, un choix politique plus ou moins conscient.
Faut-il, par exemple, écrire « beurs » ou « jeunes » ou « jeunes français » ? Le mot « immigration » a-t-il un sens ? Or, si la presse dispose d'un pouvoir propre, c'est bien celui de contribuer à imposer, à travers les mots qu'elle diffuse largement, une certaine vision des choses et du monde.
Quels sont les débats qui existent à ce sujet ? Quel contrôle les journalistes ont-ils sur le titrage de leurs articles, titrage qui, parfois, détourne le sens même des articles ?
Ou encore - l'énumération n'est pas limitative-, comment faire accéder jusqu'aux médias, et notamment aux médias audiovisuels, la parole des milieux dominés ou culturellement défavorisés ? Qui parle à leur place ? Comment les met-on en scène lorsqu'ils accèdent aux médias ? Dans quelle mesure ceux qui s'expriment disent moins ce qu'ils voudraient que ce qu'on leur demande de dire ? Là encore, le problème n'est pas simple et demande qu'une véritable réflexion collective soit menée.
C'est pour réfléchir à ces problèmes, qui sont à l'intersection du journalisme, de la politique et de la vie intellectuelle, que des journalistes, des syndicalistes, des membres d'associations et des intellectuels ont décidé de se rencontrer et d'en débattre librement, afin de mieux comprendre les contraintes qui s'exercent sur les uns et les autres et de favoriser l'émergence d'une information plus démocratique.
Patrick Champagne
Parmi les articles qui témoignent d'une longue collaboration , je retiens celui que j'ai cosigné avec lui (et que j'ai publié ici même : « Usages médiatiques d'une critique savante de "la théorie du complot" ») [2].
[2] Publié dans la revue Agone n°47, janvier 2012.
30.11.2023 à 13:44
La mort de Pierre Bourdieu et l'emprise du journalisme (1)
Henri Maler
Ce que peut le journalisme quand il s'empare d'une œuvre majeure
- Sur les médias / Pierre Bourdieu, Critiquer les médiasTexte intégral (4962 mots)

J'avais réuni en février 2002, sur le site de l'association Acrimed (Action-Critique-Médias), une première compilation répartie en plusieurs articles que j'avais réunis en une seule contribution dans « Sciences et engagement », Variations n°4, éditions Syllepse, septembre 2003, p.97-110. Elle est publiée ici en deux articles en raison de la longueur et de la précision des observations.
Consacré à la couverture médiatique de la mort de Pierre Bourdieu le 23 janvier 2002, cette contribution analyse une nécrologie dont le rituel peut valoir pour les hommages déférents ou hagiographiques : tel est, me semble-t-il, son intérêt.
« S'il y a une chose encore plus difficile à supporter que la disparition d'une des figures majeures de la pensée contemporaine et, pour certains d'entre nous, d'un ami très proche, c'est bien le rituel de célébration auquel les médias ont commencé à se livrer quelques heures seulement après la mort de Pierre Bourdieu. Comme prévu, il n'y manquait ni la part d'admiration obligatoire et conventionnelle, ni la façon qu'a la presse de faire (un peu plus discrètement cette fois-ci, étant donné les circonstances) la leçon aux intellectuels qu'elle n'aime pas, ni la dose de perfidie et de bassesse qui est jugée nécessaire pour donner une impression d'impartialité et d'objectivité. »
« Pierre Bourdieu, celui qui dérangeait », par Jacques Bouveresse, Le Monde, 31 janvier 2001.
Le « rituel de célébration » auquel se sont livrés les médias après l'annonce de la mort de Pierre Bourdieu permet de vérifier ce que fait et ce que peut le journalisme quand il s'empare d'une œuvre majeure. Il ne s'agit donc pas ici de défendre la mémoire de Pierre Bourdieu et, encore moins sa contribution à la sociologie, mais seulement – si l'on peut dire - de mettre en évidence comment s'exerce l'emprise du journalisme sur la vie culturelle et intellectuelle [1].
À cette fin, il suffit – pour reprendre, en dehors de son contexte, une expression de Michel Foucault - de « rendre visible ce qui est visible ». Les citations, pour peu qu'elles ne soient pas trop sélectives, valent largement démonstration. À certains égards, elles n'apprennent rien que l'on ne sache déjà. Mais, pour peu qu'ils soient ordonnés, les documents que nous avons réunis permettent de saisir selon quelles modalités pratiques des journalismes, divers par les médias dans lesquels ils s'expriment et par leurs positions dans ces médias, exercent leur pouvoir de nuisance : quels sont les effets cumulés des prétentions des tenanciers de l'espace médiatique et des vulgarisations journalistiques assujetties à l'urgence sur la teneur du débat démocratique, théorique et politique.
Le constat est accablant. Pour dissimuler l'indigence ou la bassesse de la plupart de leurs commentaires, certains journalistes ou responsables des médias n'ont pas manqué de souligner l'importance des rediffusions à la radio et à la télévision et la publication d'extraits de son œuvre dans certains organes de la presse écrite ou d'invoquer la multiplicité des « points de vue » et des « tribunes » consentis à des producteurs culturels, notamment parmi ceux qui doivent à l'œuvre de Pierre Bourdieu une part décisive de leur inspiration.
Mais c'est oublier opportunément que la parole de Pierre Bourdieu a circulé en des points très limités de l'espace médiatique, confirmant ainsi la misère culturelle des grands médias de masse. Les prises de potion immédiates ne peuvent pas passer pour des expressions d'un effectif travail des journalistes. Pas plus que l'attention portée aux hommages unanimes et convenus de la plupart des responsables et des formations politiques et la simple reprise de leurs communiqués ne peuvent constituer des preuves de l'indépendance du journalisme. Quant aux journalistes eux-mêmes - éditorialistes et chroniqueurs en l'occurrence - loin de s'attacher à rendre compte de l'œuvre de Pierre Bourdieu, ils l'ont, à quelques exceptions près que nous avons essayé de relever, taillée à leur mesure. D'autres avant Bourdieu avaient déjà fait les frais de ces déplorables sollicitudes. Faut-il s'y résigner ?
Des urgences médiatiques au consensus politique
Rendue publique le 24 janvier 2002 dans la matinée, la mort de Pierre Bourdieu a fait presque immédiatement l'objet de rapides évocations à la radio et à la télévision.
Urgences médiatiques
Le simple recensement des informations diffusées dans l'urgence par quelques chaînes de télévision [2], met en évidence les distorsions quasi-spontanées que produit le mélange de la révérence obligée (qui se réfère à l' « influence » de Pierre Bourdieu), de la rumeur publique (qui rabat l'œuvre de Bourdieu sur ses engagements, réduits à des slogans) et du narcissisme médiatique (qui met en avant l'analyse critique des médias restituée en formules imaginaires).
– Sur LCI, à 12 heures, une brève annonce de la mort de Pierre Bourdieu nous apprend qu'il était un sociologue « influent », qui a « dénoncé la souffrance sociale, le libéralisme, et la mondialisation » , ainsi que les « rapports entre le pouvoir et la télévision » (que Pierre Bourdieu n'a jamais analysé comme tels. LCI renvoie à ses « prochaines éditions ».
– Sur i-TV, à 12 heures 15, on apprend, après les informations sportives, que « (…) Celui que l'on surnommait " le sociologue énervant " (…) s'était surtout attaché à dépeindre le monde des médias, celui de la télévision en particulier ».[souligné par moi] Quel est ce « on » anonyme auquel i-télévision attribue un surnom qui serait répandu ? La source est très certainement une consultation rapide du titre donné par l'auteur des pages consacrées à Pierre Bourdieu sur le site du Magazine de l'Homme moderne : « Bourdieu sociologue énervant » [3]. Un titre élogieux sur un site spécialisé devient ainsi un surnom dont on laisse entendre qu'il est communément répandu.
– Sur France 2, à 13h37, près de quarante minutes après le début du journal, Daniel Bilalian trouve le temps d'annoncer le décès de Pierre Bourdieu : « Considéré comme un intellectuel influent notamment dans le domaine de l'Education Nationale », connu pour son « engagement contre la mondialisation », il était « sévère à l'égard des médias et de leur rôle dans la société. »
– À TF1, au Journal de 13h, rien. Zappant d'une chaîne à l'autre, on a peut-être manqué l'information : en tout cas, elle devait être plus courte que les reportages consacrés à la « France profonde »,
– Sur LCI, à 14h03, le présentateur diffuse l'information dans des termes identiques à ceux qui avaient été rédigés deux heures plus tôt. À une réserve près : la critique du « monde des médias » devient la critique de « la corruption médiatique ». Cette innovation ne devant rien aux écrits de Pierre Bourdieu, on est en droit de se demander ce qui a poussé le présentateur à l'adopter. On la retrouve dans un papier de Claude Casteran pour (mentionné plus loin) qui parle, entre guillemets comme s'il s'agissait d'une citation de « la corruption de la société médiatique ». Une heure plus tard (LCI, 15h06) la critique de « la corruption médiatique » a disparu.
– Sur France infos, à 15h15, on apprend que Pierre Bourdieu « était considéré comme un des intellectuels les plus influents de notre époque » et sur RMC-infos à 15h30, exactement la même chose, exactement dans les mêmes termes.
À noter cependant, quelques heures plus tard, la prestation de Patrick Poivre d'Arvor, sur TF1, 20 heures. La mort de Bourdieu figure dans l'annonce des titres du journal. On apprend alors incidemment que Pierre Bourdieu était « titulaire d'une chaire à la Sorbonne » [confondue avec le Collège de France]. Et à 20 h 34, au terme d'une présentation conventionnelle, PPDA déclare (à peu près…) que « Pierre Bourdieu n'était pas seulement un critique des médias ». Pas seulement, en effet !
« Influent », « engagé », « critique des médias » : une partie de ces lumineuses informations, ajustées à une vision journalistique ordinaire, est empruntée aux informations d'Agence. En voici un exemple.
– AFP, 24 janvier. Pour Claude Casteran, Pierre Bourdieu « était devenu l'une des têtes pensantes contre la mondialisation libérale ». Comment ? « En 1993, il publie un pavé de près de 1.000 pages "La misère du monde". Cette analyse de la "fracture sociale" devient un best-seller et propulse l'intellectuel vers l'engagement militant. Pour la première fois, un grand chercheur tente de "théoriser l'exclusion". ». Le choix des mots - « têtes pensantes », « pavé », « best-seller » - offre un aperçu d'une tentative de traduire en langue journalistique ce que l'on ne comprend pas ou ce que l'on n'a pas lu, en répétant ce que l'on croit déjà savoir (et qui n'a rien à voir avec le contenu du « pavé » : « fracture sociale « , « théorie de l'exclusion » [4].
Claude Casteran poursuit en une phrase où l'art mineur des approximations (qui prête à Pierre Bourdieu un rôle de « théoricien-fondateur » d'Attac) se conjugue avec l'art majeur de la fausse citation (qui attribue à Pierre Bourdieu une dénonciation de « la corruption de la société médiatique »). Vient alors cette trouvaille : « En 1998, une vague de "Bourdieumania" déferle dans les médias. » Le rédacteur de l'AFP « oublie » que le prétendu phénomène qu'il prétend enregistrer ainsi n'est autre que la campagne de presse contre Pierre Bourdieu. De cette campagne, souvent haineuse, il ne reste plus qu'un mot - « Bourdieumania » - et quelques héros, comme Alain Finkielkraut et Jeanine Verdès-Leroux, dont Claude Casteran rapporte les prouesses.
Peu à peu - les délais jouent un rôle décisif dans la pratique du journalisme -, dans le cours de l'après-midi du 24 janvier 2002, les journalistes, faute de pouvoir étoffer leur information sur l'œuvre et l'activité de Pierre Bourdieu, se réfugient, en toute indépendance, derrière les déclarations des responsables politiques et de quelques experts.
Consensus politique
L'information sur la mort de Pierre Bourdieu change alors de sens : elle devient une information sur les « réactions » des responsables politiques. Et les journalistes s'abritent derrière la lecture d'extraits de leurs communiqués… C'est une raison suffisante de mentionner brièvement certains d'entre eux, qui marient la neutralisation emphatique des désaccords, le détournement des mots et l'invention des concepts.
– Ainsi, selon le RPR, Pierre Bourdieu « était un spectateur engagé de notre société qui inscrivait ses réflexions et ses travaux au cœur des grands débats publics ».
– Et pour Lionel Jospin, Pierre Bourdieu était « un maître de la sociologie contemporaine et une grande figure de la vie intellectuelle de notre pays » qui « laisse une œuvre forte et féconde ». De tels jugements, on le voit ne sont guère compromettants. D'autres sont plus audacieux, dans leurs tentatives d'annexion.
– Pour le PS - qui oublie opportunément que la politique du Parti socialiste était l'une des cibles de cet engagement salué solennellement - Pierre Bourdieu « s'est voulu, à l'image de Jean-Paul Sartre, la voix des sans voix et le porte-parole des laissés-pour-compte, contre les puissants, dans la tradition des grands intellectuels français ».
– Pour Jacques Chirac, Pierre Bourdieu « restera comme un penseur militant et un militant de la pensée ».
L'AFP, comme si le chef de l'Etat était le véritable auteur de ce communiqué en forme de notice plutôt bien informée, le résume ainsi : « "Son combat au service de ceux que frappe la misère du monde en restera comme le témoignage le plus frappant", a poursuivi le chef de l'Etat qui relève aussi son "combat pour la diversité culturelle". » … dont Jacques Chirac - convergence bienvenue – est le défenseur.
– Catherine Tasca, Ministre de la Culture et de la Communication se risque à un hommage théorique : Pierre Bourdieu a « inventé des concepts qui sont restés des références, tel l'arbitraire symbolique ». Voilà au moins une référence introuvable qui ne nous manquera pas.
Henri Weber, sénateur du PS, nous a offert une témoignage éloquent sur modalités de constitution provisoire d'un consensus nécrologique,. Cet exemple mérite qu'on s'y arrête.
– Dans Le Figaro , quelques mois avant le décès de Pierre Bourdieu, Carl Meeus recueillait les propos du sénateur [5]. Dans cet entretien se trouvaient dénoncés une « posture d'imprécateur » et un apport quasi-inexistant à la compréhension de la société et du monde – un populisme insignifiant. Ainsi, au journaliste qui lui demande s'il rejoint « les intellectuels qui dénoncent le populisme " bourdivin " ? », Henri Weber répond : « Oui, tout à fait, il s'agit bien de populisme. Ce qui le caractérise, c'est l'insignifiance totale de ses propositions et de ses analyses sur la situation. Et ce qui est complètement nuisible , c'est cette obsession de placer sur un même pied la gauche et la droite. » [souligné par moi]
– France Info, le lendemain de la mort de Pierre Bourdieu, diffuse, entre autres témoignages, l'avis très autorisé d'Henri Weber - soudainement frappé d'amnésie : il avait oublié l'entretien accordé Figaro. Sur France Info, notre sénateur commence par saluer « un très grand intellectuel français », qui avait fait entendre « la voix des sans voix ». Puis il résume - correctement, en souvenir de ses études de sociologie - quelques aspects de l'œuvre de Bourdieu, « penseur de l'inégalité ». Interrogé sur les rapports entre Bourdieu et le Parti Socialiste, notre Sénateur, après quelques propos convenus sur « les perspectives à long terme » et sur « la politique qui doit tenir compte des contraintes », conclut triomphalement : « Nous étions donc quelquefois en désaccord sur les moyens de réaliser le possible, mais totalement d'accord sur ce qui est souhaitable » [6]. [souligné par moi]
L' « insignifiance totale de ses propositions et de ses analyses sur la situation » a fait place à un accord total sur le souhaitable.
Question soulevée par ce florilège de déclarations : pourquoi les journalistes participent, même involontairement, à la stratégie de communication de responsables et d'organisations politiques qui sont prêts à dire (presque) n'importe quoi, pour peu qu'ils puissent obtenir la consécration, même posthume de créateurs ou de chercheurs qu'ils consacrent ... surtout à titre posthume ?
Ces tentatives d'appropriation symbolique de la notoriété de Pierre Bourdieu que les médias, dans un premier temps, ont relayées au détriment de leur propre information sur Pierre Bourdieu et son œuvre, s'effacèrent bientôt : quand sonna l'heure des éditorialistes.
Les petits matins matin de la Presse quotidienne régionale
Peu côtés par les grands médias nationaux, alors que son audience est loin d'être négligeable, La Presse quotidienne régionale a mobilisé ses éditorialistes le 25 janvier 2001 On veut ici contribuer à leur réputation.
– Dans L'Alsace , Olivier Brégeard : « Peu enclin à la nuance (ses propres positions font, heureusement, l'objet de débats fondamentaux), Pierre Bourdieu était un intellectuel radical (…) ». Si les positions de Pierre Bourdieu font « heureusement » l'objet de débats « fondamentaux », c'est parce qu'il était « peu enclin à la nuance ». Et s'il était « peu enclin à la nuance », c'est, évidemment, parce qu'il était « radical ». Mais pourquoi « radical » ? C'est ce que nous apprend la suite : « Pierre Bourdieu était un intellectuel radical : à ses yeux, la société impose et reproduit les inégalités, à travers le système scolaire, la culture, les médias, le langage, le sexe, qui contribuent chacun à l'intériorisation et à l'acceptation de l'ordre des choses. » De cette phrase confuse, mais presque exacte, il résulte que la radicalité consiste à penser que « la société impose et reproduit les inégalités ». Voici maintenant la conséquence : « Bourdieu était donc tout entier du côté des perdants (…) ». Par opposition aux « gagnants » ? Le vocabulaire d'époque fait des ravages. Et un peu plus loin : « Pour reprendre une des notions qu'il avait forgées, le professeur au Collège de France restait dans le « champ » des laissés-pour-compte. » Enfin, après cette prouesse, une conclusion ironique sur l'ironie du sort : « L'ironie du sort aura voulu qu'il devienne un maître à son tour, mais un "maître à penser". »
« Bourdieu, maître à penser et mandarin » : pour illustrer ce thème obligatoire, une seule citation suffira.
– Dans La Libre Belgique , datée du 24 janvier 2002, un certain E. de B. rédige sous un titre flamboyant – « L'homme qui portait `la misère du monde´... » - une notice qu'il conclut en ces termes : « Ce n'est pourtant qu'en 1998 qu'éclata un virulent conflit, jusqu'au sein de la gauche même, où l'on se plaignait de la place que prenait décidément l'intellectuel. S'était-il sacré nouveau roi des mandarins ? ».
– Dans Sud-Ouest , Frank De Bondt : « Bourdieu, né béarnais, l'un des rares intellectuels français contemporains reconnus, invités et étudiés aux Etats-Unis (…) ». Un béarnais qui a étudié aux Etats-Unis : une gloire du Sud-Ouest, en quelque sorte…, mais typiquement française : « Bourdieu (…) était un chercheur converti en agitateur d'utopie. Il appartenait foncièrement au paysage français en tant qu'héritier d'une Révolution jamais terminée. ». Cette affirmation péremptoire et discrètement dissuasive est suivie de cette réserve : « Mais, averti par ses recherches des contradictions des démocraties modernes, le sociologue était probablement sans illusion. Il y a longtemps déjà que la société de consommation a délogé la révolte de l'esprit des peuples pour lui substituer le désir, cette machine à entretenir la croissance. » Ayant ainsi logé ses poncifs à l'ombre de Bourdieu, Frank De Bondt lui inflige cette dure leçon : « À l'heure où la colère populaire n'est plus indexée que sur le prix des carburants, Bourdieu fait figure d'ancêtre. Sa voix s'est brisée sur le mur de l'argent qui s'est spontanément offert à l'affichage de la comédie médiatique désignée par le professeur. Celui-ci a mené l'un de ses derniers combats dans un dépôt de la gare de Lyon où il avait apporté la caution de quelques intellectuels au mouvement social de décembre 1995. »
– Dans Le Dauphiné Libéré , Gilles Debernardi : « Justement, en ce mois glacial de décembre 95, le pays est paralysé par les grèves. Bourdieu s'affiche au coude à coude avec les manifestants. Il ne signe plus des livres difficiles mais une pétition réglementaire. » Une trouvaille, la « pétition réglementaire » ! Il vaut la peine de citer quelques lignes supplémentaires pour saisir ce que l'on peut écrire, à grand renfort de poncifs, sur les mandarins et leur tour d'ivoire, les galons des intellectuels engagés dont on a l'habitude, les sujets de thèse et les cils qui bougent : « Deux ans plus tôt, en publiant "La Misère du monde", passionnante enquête sur la souffrance sociale ordinaire, le mandarin était sorti timidement de sa tour d'ivoire. Cette fois, plongé dans l'arène publique, il gagne ses galons "d'intellectuel engagé". Depuis Sartre et Foucault, on avait perdu l'habitude. Lui qui, en mai 68, n'avait pas bougé d'un cil, devient le héraut du combat "contre le fléau néolibéral". On le voit partout, aux côtés des chômeurs, de l'abbé Pierre, des mal-logés, des sans-papiers... Les "dominés" ne sont donc pas qu'un sujet de thèse. »
– Dans Le Journal du Centre , François Gilardi : « C'était un nom, le sien, porté par le succès d'un livre : La misère du monde, impressionnante plongée dans les nouvelles douleurs de la vie moderne. Tout d'un coup les travaux du sociologue et de son équipe quittaient le domaine étroit de l'édition universitaire pour atteindre le grand public. Beaucoup de lecteurs se sont reconnus dans les libres propos des personnes de toutes conditions dont les chercheurs avaient recueilli le témoignage. » La Misère du Monde ? Un recueil de libres propos… « Dans le prolongement de ce livre dérangeant, Bourdieu a cautionné les grands mouvements de protestation des années 90. Ce critique impitoyable du système des médias est paru à la télévision en compagnie de l'abbé Pierre. ». Soutenir, c'est cautionner. Et, semble-t-il, on ne peut à la fois critiquer les médias et paraître à la télévision avec l'abbé Pierre. À moins que le sens de cette phrase nous ait échappé.
– Dans Le Temps (Suisse),un article publié le vendredi 25 janvier, porte à incandescence la vulgate dominante. Sous le titre « Bourdieu, le sociologue qui n'aimait pas la télé » Jean-Marc Béguin écrit :
« Pierre Bourdieu n'aimait pas la télévision. Pas rancuniers, le journal France 2 lui a consacré son ouverture et TF1 un gros sujet. La TSR, curieusement, rien qu'une petite minute en fin d'édition. Bien sûr, certains ne manqueront pas de dire que la télévision a récupéré Bourdieu. Ce n'est pas faux, le système – tout système – a par nature tendance à récupérer ou exclure. La télévision a aimé Marchais quand il amusait les foules, elle a dopé Le Pen quand il grimpait dans les sondages, elle a aussi adopté José Bové et Bourdieu car ils étaient devenus des stars d'un mouvement social. C'est la loi de la notoriété. Bourdieu a-t-il pour autant été récupéré par un système qu'il rejetait ? Par conviction, ou par cabotinage, le sociologue s'est identifié complaisamment avec le mouvement de rejet de la mondialisation. Se pliant aux simplifications qu'il ne cessait de dénoncer, il laissait ses affidés réduire son discours à quelques slogans de cantine pour les agités des différentes sectes de la « gauche de la gauche ». Ses salves contre les médias avaient plus à voir avec l'agit-prop qu'avec la sociologie. Bourdieu, ces dernières années, s'est fourvoyé dans le schématisme réducteur de ces engagements, devenant par là même une star médiatique complice du jeu qu'il pourfendait. Jamais la télévision n'aurait consacré autant de minutes à sa disparition s'il était décédé dix ans plus tôt. C'est le gourou de l'antimondialisation qui a été enterré médiatiquement hier soir, pas le sociologue remarquable de la société contemporaine, dont la glose restera à tout jamais hermétique à l'écrasante majorité des téléspectateurs. »
Mais que l'on n'aille pas croire que cet échantillon de commentaires [7] signe une quelconque infériorité intellectuelle des journalistes de nos Provinces et des pays voisins. Ils valent bien les éditorialistes et chroniqueurs parisiens dont ils reproduisent les commentaires répandus depuis longtemps et renouvelés, à quelques exception près, à l'occasion de la mort de Pierre Bourdieu
À suivre donc : « Les médias et la mort de Pierre Bourdieu (2) » : quelques interventions du « haut clergé médiatique »
[1] Pierre Bourdieu, « L'emprise du journalisme », Actes de la Recherche en sciences sociales, 101-102, mars 1994, p. 3-9 ; Repris dans Sur la Télévision, Liber/Raisons d'agir, 1996.
[2] Les citations qui suivent, relevées au fur et à mesure sans avoir été enregistrées, peuvent souffrir de quelques approximations : encore l'urgence…
[3] Les « pages Bourdieu sur le site du Magazine de l'Homme moderne On peut y trouver un grand nombre des documents que nous citons ici.
[4] La « circulation circulaire de l'information », étant ce qu'elle est, Martine Veron (AFP, 24 janvier), dans un « papier » qui résume convenablement l'ouvrage que vise son titre - « Pierre Bourdieu, théoricien de la "misère du monde » - ne peut s'empêcher de reprendre les propos de son confrère : « Ce pavé austère de près de 1.000 pages, première analyse de la "fracture sociale", remporte un succès inattendu, devient un best-seller et propulse le professeur au Collège de France sur le terrain de l'engagement militant. »
[5] Je n'ai pas retrouvé la date exacte de cet entretien dont l'authenticité ne pouvait pas être mise en cause puisqu'il figurait sur le site dudit Sénateur, fier de son œuvre : http://www.senat.fr/senateurs/weber_henri/articles/hw0106.html. Malheureusement, ce lien est désormais périmé [note de 2023] .
[6] Transcription approximative, mais fidèle au sens.
[7] Deux articles, parmi ceux que nous avons consultés, font exception, à quelques réserves près : le premier est dû à Bernard Stéphan dans Le Berry Républicain et le second à Christian Digne, dans La Marseillaise.
- Persos A à L
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- EDUC.POP.FR
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Frédéric LORDON
- LePartisan.info
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Romain MIELCAREK
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Emmanuel PONT
- Nicos SMYRNAIOS
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- Numérique
- Binaire [Blogs Le Monde]
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Francis PISANI
- Pixel de Tracking
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- XKCD