23.10.2025 à 20:25
Comment le capitalisme contemporain a étendu le domaine de l’exploitation
Zoé Pebay
Texte intégral (6674 mots)
| Note de lecture du livre d’Ulysse Lojkine, « Le fil invisible du capital : déchiffrer les mécanismes de l’exploitation », Éditions La Découverte, 2025 |
Ulysse Lojkine est normalien, agrégé de philosophie, doctorant en philosophie et en économie à l’Université de Paris-Nanterre et à l’École d’Économie de Paris, chercheur post-doctorant à Sciences Po Paris. Il a travaillé sur les concepts de pouvoir et d’exploitation dans le monde du travail autour des pensées marxiste et postkeynésienne.
Qui travaille pour qui ? Et qui exploite qui ? C’est à partir de ces deux grandes questions qu’Ulysse Lojkine démarre son important travail d’élaboration théorique sur le capitalisme contemporain. Son point de départ est le suivant : il est désormais bien plus difficile que par le passé de déchiffrer les relations d’exploitation et de domination dans notre économie. Les évolutions du capitalisme – financiarisation, mondialisation et fragmentation des réseaux de production, émergence de nouvelles formes d’emplois… – ont conduit à un brouillage de ces rapports, auparavant cristallisés dans l’affrontement direct entre le travailleur et son employeur.
Partant de ce constat, Lojkine propose de renouveler la théorie de l’exploitation marxiste traditionnelle en se penchant sur l’émergence d’autres dimensions de l’exploitation, en dehors de la sphère salariale. Pour lui, cette multiplication des échelles et des formes d’exploitation capitaliste induit aussi une réévaluation de la nature du capitalisme : l’auteur nous invite alors à le concevoir non pas uniquement sous l’angle de l’exploitation, mais aussi comme un système de coordination économique particulièrement efficace, bien qu’injuste. Dès lors, si l’on souhaite substituer au système capitaliste un mode de production égalitaire, il s’agit non seulement de penser l’abolition de l’exploitation, mais aussi la construction de formes alternatives de coordination des échanges.
Ce livre est une pièce majeure aux débats sur la nature du capitalisme actuel, et, ce faisant, sur la construction d’une stratégie anticapitaliste adaptée à notre temps. L’Institut La Boétie en propose un aperçu à travers cette note de lecture.
I) (Re)définir l’exploitation capitaliste : appropriation du travail et relations de pouvoir
| « Le capitalisme est structurellement un système d’exploitation de certains groupes sociaux par d’autres, au sens d’une appropriation du travail d’autrui combinée à une relation de pouvoir asymétrique. » |
Comptabiliser le surtravail
L’ambition d’Ulysse Lojkine est de mettre en lumière les mécanismes contemporains de l’exploitation capitaliste. Pour cela, il prend comme point de départ la théorie de l’exploitation de Marx, qu’il propose d’amender et de prolonger pour l’adapter à la structure actuelle du capitalisme.
Il reprend à son compte la définition traditionnelle de la théorie marxiste : l’exploitation, c’est l’accaparement du surtravail, c’est-à-dire l’appropriation par les uns du travail fourni par les autres. Or, dans le système capitaliste, ce surtravail est rendu invisible aux yeux des travailleurs : il leur est impossible de savoir quelle partie de leur journée de travail travaillent-ils pour eux-mêmes, et quelle partie consacrent-ils aux profits du patron. Par ailleurs, dans une société marchande de division du travail, le travailleur ne récupère pas directement le fruit de son travail : celui-ci lui est rendu indirectement, par l’intermédiaire de la monnaie – son salaire – par laquelle il pourra acheter des marchandises produites par d’autres pour reproduire son existence. Ainsi, « on ne peut donc mesurer le travail propre qu’en mesurant le travail incorporé aux produits que son revenu permet au travailleur d’acheter ». Chez Marx, cette analyse sert à expliquer le processus de formation de la valeur des marchandises. Lojkine réfute cette explication et propose de garder une approche purement comptable du surtravail. Il formule ainsi son idée centrale : on peut tout à fait construire une mesure de l’exploitation à partir de la théorie de l’exploitation marxiste, tout en laissant de côté la question épineuse de la valeur[1].
Il propose alors de construire ce qu’il appelle une comptabilité en travail, c’est-à-dire une comptabilité des flux de travail au sein de notre économie, qui puisse s’appliquer à l’échelle nationale et internationale. Ce projet ambitieux fait face à plusieurs défis : comment comparer entre elles des réalités de travail très différentes ? Comment mesurer précisément qui s’approprie le travail de qui, dans une économie où les flux de travail sont de plus de plus en plus indirects et complexes ?
Ces questions sont essentielles, puisque la ligne de démarcation entre exploiteurs et exploités dépend précisément de la mesure que l’on retient. Ulysse Lojkine se concentre particulièrement sur deux enjeux décisifs : la place ambivalente des cadres (les salariés à hauts revenus) et les différences de rémunération du travail entre le Nord et le Sud (l’échange international inégal). Pour résoudre cette question de l’hétérogénéité du travail, plusieurs approches ont émergé au sein du marxisme. Parmi elles, deux principales, mais qui amènent des conclusions divergentes : la « réduction par le salaire », qui considère que le salaire reflète le degré de complexité du travail effectué ; et l’approche homogène, qui considère au contraire que toutes les heures de travail doivent être comptées de la même manière.
Si l’on comptabilise le travail selon la première approche, aucune inégalité de salaire n’est due à un rapport d’exploitation : les salariés qui gagnent davantage que la moyenne ne peuvent en aucun cas être catégorisés comme exploiteurs, puisque tous leurs revenus proviennent de leur travail, et non de revenus de la propriété. À l’inverse, si l’on adopte l’approche homogène, tout écart de salaire signale au contraire un transfert net de travail, et donc un rapport d’exploitation. Les cadres peuvent donc être considérés comme des exploiteurs, puisqu’ils s’approprient une part du travail global fourni supérieure à la moyenne.
Dans la figure ci-dessous, la droite en pointillé représente la démarcation de l’exploitation selon l’approche homogène (cas 1), tandis que la droite continue représente la réduction par le salaire (cas 2). Certains groupes conservent la même position dans les deux cas : les capitalistes et le prolétariat. Mais d’autres changent de position selon l’approche : la petite bourgeoisie est considérée comme exploitée dans le cas 1, contre exploiteuse dans le cas 2. Inversement, les cadres sont considérés exploiteurs dans le cas 1, contre exploités dans le cas 2.
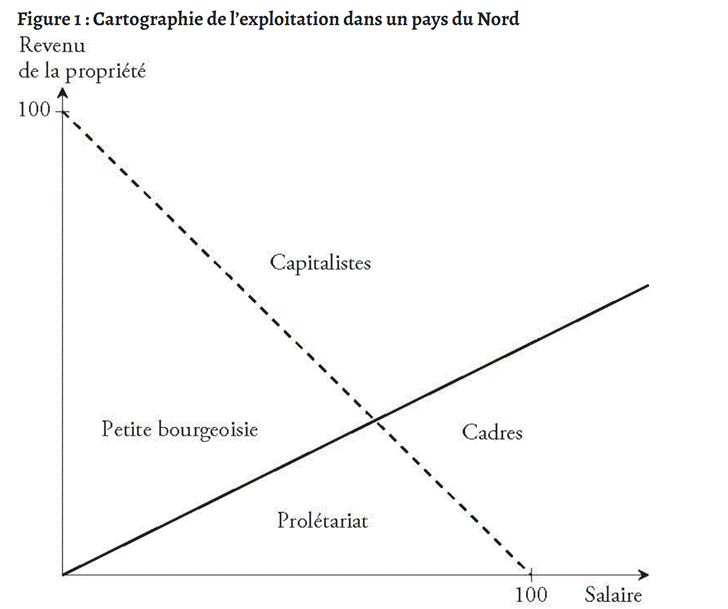
Cette même logique s’applique au cas de l’échange inégal entre le Nord et le Sud. Selon l’approche « au salaire », la ligne d’exploitation ne change pas. Mais si on opte pour l’approche homogène, une grande partie des salariés du Nord passent du côté des exploiteurs, dans la mesure où ils s’approprient une partie du travail des travailleurs du Sud – ils deviennent une sorte d’équivalent des « cadres » à l’échelle mondiale. Seuls les travailleurs pauvres du Nord demeurent dans le prolétariat mondial exploité. « En somme, résume Lojkine, les écarts de revenu entre pays sont tels que, si on considère vraiment qu’une heure de travail du Sud vaut une heure de travail du Nord, on est forcé de conclure que la majorité de la population du Nord s’approprie par le commerce un flux net de travail issu du Sud ».
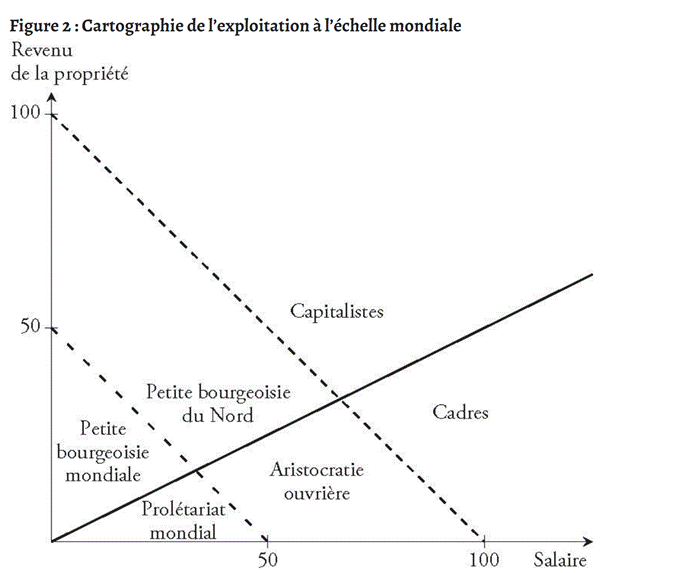
Aux termes de cet exposé, Lojkine n’impose pas de conclusion ferme quant à la meilleure manière de comptabiliser le travail, et donc de définir qui est exploité et qui est exploiteur. Mais son travail montre la capacité de l’approche homogène à rendre compte de certains mécanismes plus discrets de l’exploitation contemporaine, ainsi que ll’ambivalence de certaines positions de classe. Il appelle par ailleurs à réfléchir à la manière d’intégrer dans cette comptabilité des formes de travail non-marchand, en particulier le travail domestique des femmes que l’on ne compte quasiment jamais.
Les relations asymétriques de pouvoir dans le capitalisme
Décrire l’appropriation du travail des uns par les autres ne suffit pas à saisir les ressorts profonds de l’exploitation : on doit aussi comprendre comment cette appropriation est rendue possible, c’est-à-dire pourquoi certains se retrouvent du côté des exploités et d’autres des exploiteurs. Il faut alors se pencher sur les relations de pouvoir qui structurent le mode de production capitaliste et qui, elles aussi, sont invisibilisées par ce dernier. Pour les démasquer, Lojkine propose notamment de faire dialoguer entre elles les conceptions néoclassique et marxiste du pouvoir afin de construire une conception plus étendue de la notion de pouvoir dans l’économie capitaliste.
Pour la plupart des pensées économiques non-marxistes, le capitalisme peut exister sans exploitation. Il ne porte pas fondamentalement en lui des rapports de domination. La théorie libertarienne considère ainsi que les capitalistes n’exercent pas de domination sur les travailleurs car ils n’exercent pas de coercition. L’employeur peut simplement licencier le travailleur, mais il ne peut pas le sanctionner en usant de la violence, en confisquant ses biens ou en l’envoyant en prison, par exemple, contrairement à l’État.
Les théories néoclassiques, dominantes aujourd’hui en économie, expliquent, elles, qu’il n’y a pas de relations de pouvoir dans une économie de marché si celle-ci est suffisamment concurrentielle. Elles considèrent qu’il n’y a qu’une seule forme de pouvoir dans l’économie : celui du monopole – ou, dans le cas du marché de l’emploi, du monopsone –, que la concurrence neutralise totalement. Puisqu’une diversité d’employeurs existe, le travailleur est formellement libre de travailler là où cela lui plaît. Plus il y a d’emplois disponibles, plus il se sentira libre de refuser un travail aux conditions insatisfaisantes. La concurrence permettrait ainsi d’éviter l’arbitraire des employeurs sur les prix et les salaires.
Pour Lojkine, cette conception passe à côté du point central exposé par la théorie marxiste : la propriété privée des moyens de production permet aux capitalistes d’exploiter les travailleurs à leur gré. Ce n’est que parce que les capitalistes détiennent les moyens de production que les travailleurs sont obligés de vendre leur force de travail. Autrement dit, « la subsistance du travailleur est détenue par les possédants comme un otage, et c’est sa force de travail qu’il doit fournir comme rançon ». Marx parle en ce sens de « contrainte silencieuse » au marché : la propriété des moyens de production force les travailleurs à vendre leur force de travail sur le marché de l’emploi. Et c’est cette asymétrie de pouvoir qui fait du rapport salarial « un rapport unilatéral d’autorité et d’obéissance, de pouvoir et subordination ». La propriété privée offre un pouvoir sur le marché, indépendamment de la question de la concurrence.
Toutefois, on peut s’appuyer sur l’intuition néoclassique au sujet du rôle de la concurrence pour enrichir notre compréhension du pouvoir capitaliste, explique Lojkine. Là où les néoclassiques le définissent comme une domination individuelle, et les marxistes comme une domination impersonnelle, il propose de redéfinir le pouvoir comme une variation. Le pouvoir devient alors la capacité d’un agent à faire varier une réalité sociale, en prenant en compte la réaction des autres agents. Autrement dit, la capacité à imposer ses préférences. On y intègre donc le pouvoir formel, bien sûr, mais aussi les formes plus implicites et indirectes de pouvoir qui existent dans le capitalisme. Cette définition permet à la fois de confirmer le pouvoir issu d’une situation de monopole, mais aussi et surtout de montrer l’inégale répartition de ce pouvoir entre les groupes. En prenant l’exemple d’un marché locatif parfaitement concurrentiel, Lojkine démontre facilement comment les groupes les plus riches ont la liberté de choisir les biens qu’ils souhaitent, laissant les moins riches sur le carreau.
Ainsi le pouvoir de marché n’est pas tant déterminé par le degré de concurrence entre les agents, mais bien par la distribution de la richesse. Le capitalisme permet bien la domination structurelle des dominants sur les dominés. En suivant cette conception renouvelée du pouvoir capitaliste, on voit d’ailleurs qu’il ne se limite pas au pouvoir de l’employeur sur le marché de l’emploi, mais qu’il se déploie également ailleurs que dans le rapport salarial et la sphère de la production.
II) L’exploitation au-delà de la relation salariale : sous-traitance, crédit et rente
| « L’appropriation prend une variété de formes imbriquées, dispersées et réticulaires, souvent indirectes et en cascade. » |
Aujourd’hui, l’exploitation capitaliste ne passe pas uniquement par le rapport salarial, mais se déploie aussi dans de nouvelles sphères de l’économie : la sous-traitance, le crédit, et la rente. Selon Lojkine, ces formes d’exploitation ne sont pas dérivées de l’exploitation salariale, comme l’avançait Marx : elles existent de manière autonome, indépendamment de celle-ci. L’exploitation capitaliste n’est plus cantonnée à la seule sphère de la production, mais s’étend aussi à la sphère de la circulation des échanges. Si l’auteur rappelle toutefois la place particulière que continue de jouer le salariat, il permet de poser en de nouveaux termes le rôle de l’endettement, de la finance, ou encore de l’exploitation locative ; ainsi que leurs conséquences politiques.
L’exploitation commerciale par la sous-traitance
L’exploitation par la sous-traitance prend bien sûr une place croissante dans l’économie. Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier qu’elle a toujours existé dans l’Histoire. Déjà au XVIIIe siècle, les « manufactures » organisaient le travail sous une forme ternaire, c’est-à-dire avec trois parties prenantes. Le marchand ou négociant fournissait la matière première à un chef d’atelier, qui s’occupait de faire effectuer le travail par d’autres ouvriers que lui. Ce travail par intermédiaire a été perçu par Marx comme un modèle hybride, en transition vers le salariat traditionnel. Théoriquement, il l’analyse comme un rapport de salariat déguisé. Or, si le salariat s’est imposé comme la relation de travail dominante au XIXe et XXe siècle, la sous-traitance n’a jamais vraiment disparu. Surtout, Lojkine avance qu’elle a fait son grand retour à l’ère du capitalisme néolibéral, ce qui justifie de l’analyser comme une forme autonome d’exploitation.
Ces dernières décennies, la production s’est fragmentée à l’échelle mondiale, et le modèle d’entreprise en réseaux s’est largement développé. Aujourd’hui, « deux entreprises participant au même réseau sont désormais en moyenne séparées de dix chaînons intermédiaires par lesquels transitent les pièces ou les produits semi-finis ». Dans ce contexte, les entreprises elles-mêmes sont prises dans des rapports commerciaux inégaux. À l’échelle internationale, les grandes entreprises donneuses d’ordre du Nord externalisent leur production en faisant appel à des entreprises du Sud, qui embauchent elles-mêmes les travailleurs nécessaires. Cette relation implique des rapports de pouvoir ambivalents.
Pour illustrer ces rapports, Lojkine prend l’exemple d’un atelier de textile au Maroc, sous-traitant de Zara, qui fait travailler ses ouvriers dans un sous-sol. En 2021, 28 d’entre eux y trouvent la mort, suite à des inondations qui engloutirent l’atelier sans laisser aucune possibilité d’évacuation. En remontant la chaîne des responsabilités de cet accident, on met en lumière la position ambivalente de l’employeur intermédiaire : le chef de l’atelier de textile marocain est bien sûr responsable, dans la mesure où il exploite ses ouvriers (il extorque une partie de leur travail) et les fait travailler dans les conditions déplorables qui ont conduit à leur mort. Mais il y a bien un autre responsable : Zara, l’entreprise donneuse d’ordre, qui pousse ses sous-traitants à abaisser au maximum le coût du travail – jusqu’à entasser les ouvriers dans un sous-sol – pour augmenter ses propres profits.
Ces rapports d’exploitations inter-entreprises se jouent aussi à l’intérieur même des pays du Nord. C’est le cas avec les franchises. McDonald’s, Carrefour, Franprix… Toutes ces entreprises fonctionnent par système de franchise, dans lequel l’entreprise au sommet impose à ses franchisés leur fonctionnement, leurs prix, etc. Elles s’approprient ainsi de fait une partie de leur profit.
L’intérim, qui s’est largement développé ces dernières années, renvoie également à ce mode d’exploitation en cascade. Pour Lojkine, ces éléments témoignent de l’existence d’une forme d’exploitation commerciale entre des employeurs dominants et des employeurs intermédiaires : le dominant exerce sur le dominé un contrôle partiel de ses moyens de production et de son procès de travail, entraînant une appropriation partielle de son profit.
Ce phénomène s’observe par exemple à l’échelle de l’économie française. Entre 1990 et 2006, la part du profit (donc le taux d’exploitation) dans la valeur ajoutée totale est restée stable. Mais cette apparente stabilité cache deux dynamiques plus précises : si la part des profits dans chaque entreprise a bien diminué en moyenne à l’échelle nationale, les entreprises dans lesquelles le taux de profit a augmenté ont, elles, vu leur poids accru dans l’économie globale. Il y a eu une réallocation des profits entre les entreprises : autrement dit, un transfert de la valeur, et donc du surtravail de nombreuses petites et moyennes entreprises vers quelques très grandes. Donc un rapport d’exploitation.
L’exploitation financière par le crédit
Les employeurs comme les travailleurs peuvent être pris dans un autre rapport d’exploitation : celui du crédit, qui a gagné en importance à mesure de la financiarisation de notre économie. Lojkine distingue plusieurs strates de cette exploitation financière. La première est bien sûr l’actionnariat. Elle constitue une forme d’exploitation évidente, puisque l’actionnaire reçoit de l’argent (des dividendes) sans avoir fourni aucun travail, mais uniquement parce qu’il détient, via ses actions, les moyens de production.
L’exploitation par le crédit – via le versement d’intérêts – est quant à elle plus indirecte, mais toute aussi centrale. Le créancier ne détient certes pas les moyens de production, mais des fonds. En échange de ce prêt de fonds, il reçoit une somme d’argent. Ce rapport d’exploitation touche les entreprises (les capitalistes) comme les ménages. En effet, le capitalisme contemporain a connu une hausse considérable de l’endettement des entreprises. Non seulement le flux des intérêts est de plus en plus important, mais surtout, l’importance prise par ce rapport de crédit a un impact sur le rapport salarial au sein des entreprises. La pression financière exercée par les banques et les marchés financiers poussent notamment les entreprises à comprimer la masse salariale ou à réduire les salaires pour répondre aux attentes du marché. Le crédit est donc indirectement un instrument de discipline du travail qui permet d’intensifier l’exploitation.
Surtout, on ne contracte pas que pour investir, mais aussi pour assurer sa propre subsistance. Aujourd’hui, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers ou encore les crédits étudiants sont structurants dans la vie des classes populaires : « l’exploitation financière a autant de prise sur les travailleurs que l’exploitation salariale », résume Lojkine.
La relation de pouvoir (deuxième pan de l’exploitation) induite par le crédit se cristallise dès la phase de sélection, qui implique, pour celui qui souhaite contracter un crédit, de discipliner sa conduite ; puis la violence peut intervenir tout au long du crédit, à travers, en cas de défaut de paiement, une saisie sur le revenu ou une exclusion du marché.
Ainsi, « si Sisyphe, qui doit jour après jour pousser son rocher […] peut être comparé au salarié contraint jour après jour de suivre d’épuisantes prescriptions pour gagner ses moyens de subsistance, alors le crédit doit plutôt être comparé à l’épée de Damoclès qui ne fait peser aucune contrainte directe mais menace à tout instant de s’abattre sur l’imprudent ».
L’exploitation rentière
Le troisième rapport d’exploitation qu’analyse Lojkine est celui de la rente. Là aussi, il se déploie aussi bien entre les capitalistes qu’en direction des travailleurs. Il s’agit de s’approprier de la valeur, non pas grâce à la détention des moyens de production et donc à l’appropriation du surtravail, mais du simple fait du contrôle opéré sur une ressource ou un actif.
Pour ce qui est des rapports inter-capitalistes, l’exploitation rentière s’articule souvent avec l’exploitation commerciale. Elle s’appuie notamment de plus en plus sur la propriété intellectuelle : c’est le cas pour le rapport de franchise, déjà évoqué précédemment, dans lequel le franchisé paie pour utiliser la marque du franchiseur ; et qui s’accompagne parfois d’une rente foncière de la part du franchiseur, comme par exemple pour McDonald’s. On peut aussi penser aux brevets concernant des innovations technologiques, qui ont explosé ces dernières années notamment dans le domaine du numérique et qui reproduisent la même logique.
En plus d’être un rapport de force entre fractions du capital, la rente est aussi extraite directement sur les travailleurs, et ce de multiples façons. La plus frappante d’entre elles se joue sur le marché immobilier : c’est l’exploitation locative. Ici, comme pour le crédit, le rapport de pouvoir de la rente (en l’occurrence, du propriétaire immobilier) se cristallise en deux moments. En amont, les ménages sont soumis à l’arbitraire du propriétaire pour réussir à trouver un logement à louer. Ensuite, la menace de l’expulsion joue à tout moment aussi un rôle disciplinaire sur le locataire. Cette exploitation rentière, notamment immobilière, est essentielle aujourd’hui : dans tous les pays européens, pour le tiers des ménages les plus modestes, le loyer représente désormais plus d’un tiers du revenu, en nette augmentation par rapport aux années 1990.
Pour Marx, ces formes d’exploitation existent bel et bien, mais elles sont subordonnées à l’exploitation salariale, qui est perçue comme le rapport d’exploitation primordiale. Lojkine reconnaît lui aussi sa centralité (il concerne une immense majorité des travailleurs), mais il insiste sur sa spécificité : contrairement aux autres rapports d’exploitation, le rapport salarial déploie une forme de contrôle direct sur le travailleur ; et permet l’accumulation du capital industriel, donc le développement des forces productives, élément central du capitalisme. Mais il affirme que les autres formes d’exploitation ne lui sont pas subordonnées : elles peuvent exister sans lui, et ont pris une importance considérable dans le capitalisme contemporain.
III) Dépasser le capitalisme : le défi de la coordination
Le capitalisme, un rapport de coordination
| « [Le capitalisme est] un épais réseau de transactions commerciales, salariales et financières reliant à plusieurs échelles, de manière souvent indirecte, des agents individuels ou collectifs dispersés à la surface de la planète et dont les besoins se déterminent mutuellement. » |
Comment le capitalisme, comme système de production et d’exploitation, tient-il ensemble malgré sa dispersion en une multiplicité d’échelles ? Lojkine propose de concevoir le capitalisme non seulement comme un mode d’exploitation, mais aussi comme un système de coordination des activités entre elles. « En même temps qu’elle organise l’exploitation, la structure du capitalisme tient ensemble ceux qui y participent d’une manière relativement cohérente malgré leur dispersion », explique-t-il. Les mêmes institutions capitalistes qui organisent l’exploitation organisent cette coordination : le capitalisme fonctionne grâce à ces deux jambes.
Lojkine examine ainsi le rôle des trois institutions centrales du capitalisme : la propriété privée, le marché, et l’organisation hiérarchique de l’entreprise. Sans laisser de côté les failles et les limites de cette coordination, dont témoignent les nombreuses crises et la persistance du chômage, il souligne le rôle clé que jouent ces institutions dans le fonctionnement de l’économie à l’échelle globale.
La propriété privée, d’abord, permet d’abord une simple coordination négative, au sens où elle empêche le gaspillage des ressources et les conflits d’appropriation. À cette première forme primaire de coordination s’ajoute une coordination positive, celle du marché. Le marché permet en effet de coordonner les échanges entre des individus dispersés au quatre coins du monde, notamment grâce au « système impersonnel de prix ». Plus précisément, le marché des capitaux coordonne en sélectionnant les meilleurs investisseurs potentiels ; tandis que le marché de l’emploi coordonne en jouant un rôle d’appariement entre des travailleurs et des entreprises. Enfin, le capitalisme ne pourrait fonctionner sans une troisième institution coordinatrice : la structure hiérarchique au sein de l’entreprise. Elle prend la forme d’un commandement vertical et d’une distribution des tâches de chacun pour permettre de remplir l’objectif de production de l’entreprise. Lojkine souligne par ailleurs l’existence d’autres institutions de coordination, comme les formes de coordination particulières des entreprises en réseaux, évoquées précédemment. En somme, les formes de coordination du capitalisme sont elles aussi variées, tantôt marchandes et tantôt hiérarchiques, en fonction des spécificités de chaque activité.
Si Marx avait analysé le rôle structurant de la coordination dans le capitalisme, il la considérait toutefois comme secondaire face au rapport de production. C’est ce dernier qui, in fine, (re)conduit l’exploitation. Or, ce rapport de production peut être défini de deux manières dans la théorie marxiste. Au sens restreint, il désigne le rapport de production au sein de l’entreprise, et donc le seul rapport employeur/salarié. Ici, la sphère de production immédiate (le salariat) domine la sphère de la circulation (des échanges). Mais au sens large, il désigne les rappports dans la structure économique général du capitalisme. C’est dans cette deuxième conception du rapport de production que s’insère la thèse de Lojkine. En ce sens, il n’y a pas de séparation entre la sphère de la circulation et la sphère de la production dans l’économie : les deux sont transversales, et l’exploitation se déploie dans l’une comme dans l’autre.
Pour une coordination socialiste : planification, droits sociaux ou algorithmes d’appariement ?
| « Si les rapports d’exploitation actuels sont ancrés dans les institutions de coordination du capitalisme, alors ce sont d’autres institutions de coordination aux propriétés différentes qu’il faudrait mettre en place pour abolir l’exploitation. » |
Dès lors, pour remplacer le système capitaliste qui permet l’exploitation, l’enjeu est d’imaginer des formes alternatives – et au moins aussi efficaces – de coordination pour assurer la tenue de ce nouveau mode de production. L’auteur nous propose de se pencher sur deux institutions alternatives au capitalisme qui se sont développées à grande échelle historiquement : la planification étatique et les droits sociaux. Il en montre l’intérêt pour abolir (ou a minima contenir) l’exploitation, mais aussi les limites en termes de coordination, et propose donc de s’appuyer sur une troisième institution : les algorithmes d’appariement.
La logique de la planification étatique se définit par deux éléments : l’État fixe des objectifs en nature à atteindre en un temps défini ; et il utilise les différents leviers à sa disposition (y compris la coercition si nécessaire) pour les atteindre. L’expérience planificatrice historique la plus intéressante pour nous – sans en faire, loin s’en faut, un modèle – est celle de l’économie soviétique, puisqu’elle a, dans une certaine mesure, aboli la propriété lucrative, transformé radicalement les rapports de production et ainsi amoindri l’exploitation salariale. Sans compter la question fondamentale de l’inégale distribution du pouvoir dans le système soviétique, qui remet en cause l’idée d’une abolition de la domination, c’est aussi le caractère bureaucratique et vertical de la coordination qui pose problème. Lojkine avance ainsi que la planification étatique, dans son modèle traditionnel, ne permet pas de tenir suffisamment compte de la diversité des besoins et des désirs individuels dispersés. Elle est adéquate et même particulièrement efficace pour remplir un objectif collectif précis et situé, tel que la bifurcation écologique, mais insuffisante à l’échelle d’une économie entière.
Les droits sociaux, quant à eux, se sont développés au sein même des économies capitalistes suite aux luttes des travailleurs. On peut les définir comme « un droit qu’un individu ou un collectif peut faire valoir sur la société ou sur d’autres agents privés, et qui prime sur le droit de la propriété privé et des contrats ». Leurs trois piliers – la protection sociale, le droit du travail et les services publics – permettent indéniablement de contenir l’exploitation. Par exemple, au sein de la relation d’emploi, le droit du travail limite directement le droit patronal, tandis que la sécurité sociale et les services publics sortent partiellement du marché l’accès à des besoins essentiels (santé, éducation…). Mais les droits sociaux font face à une limite essentielle : leur logique n’est pas souveraine dans le capitalisme. Ces derniers agissent aujourd’hui comme un correctif, un complément au capitalisme, mais jamais comme un substitut.
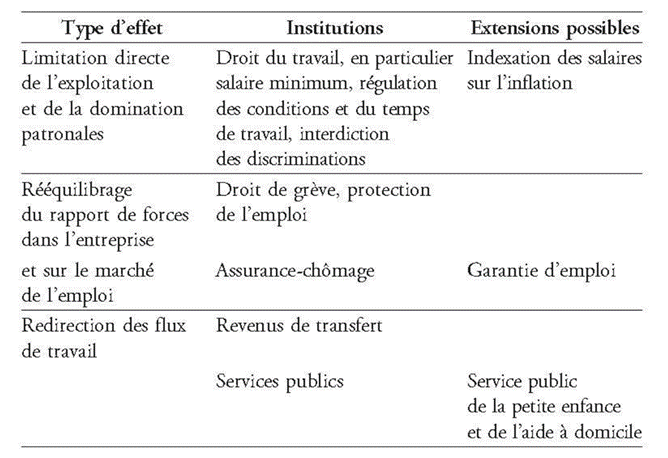
Lojkine résume alors l’enjeu comme suit : « Existe-t-il un système moderne de coordination socialiste à grande échelle qui ne soit ni, comme l’État social, un simple complément au mécanismes capitalistes, ni, comme le socialisme bureaucratique, soumis aux objectifs fixés au niveau de l’État ? ».
Il propose pour cela une piste innovante : s’appuyer sur les algorithmes d’appariement pour coordonner les échanges, qui opèrent des calculs d’optimisation économiques à la place du marché. L’intérêt est d’organiser une coordination par le bas, comme le marché, et non par le haut, comme la planification bureaucratique, mais en s’appuyant sur une décision politique démocratique, et non sur la « main invisible du marché ». Ce type d’algorithmes – algorithmes d’acceptation différée ou algorithmes des cycles d’échange – est déjà utilisé dans de nombreux pays pour diverses activités économiques nécessitant une coordination à très grande échelle : par exemple, pour allouer les greffes de reins entre donneurs et malades.
L’originalité de la proposition est de distinguer le moment de la décision politique – quelles règles souhaitons-nous pour faire fonctionner ces algorithmes ? – et le moment de l‘exécution, du fonctionnement économique. Il ne s’agit pas de s’en remettre aveuglément à des solutions technologiques au détriment de la décision collective, mais de s’appuyer sur des institutions déjà existantes pour mettre en œuvre un projet politique clairement défini, en l’occurrence anticapitaliste. En ce sens, Lojkine avance qu’une forme d’utilisation démocratique de ces algorithmes d’appariement pourrait résoudre le problème de coordination à grande échelle, tout en s’inscrivant dans un mode de production et d’échange socialiste qui abolirait l’exploitation.
Reste bien sûr à la décision démocratique la tâche de penser l’articulation de ces différentes institutions alternatives au capitalisme (planification, droits sociaux et algorithmes d’appariements), et la manière de les mettre en œuvre dans les conditions actuelles.
Conclusion
Que retirer de ce vaste travail d’élaboration théorique exposé dans Le fil invisible du capital ? D’abord, une compréhension plus fine du capitalisme contemporain. La financiarisation, la fragmentation de la production, la multiplicité des formes d’emplois, l’émergence d’un capitalisme rentier ou tributaire… : toutes ces tendances ont largement transformé les mécanismes par lesquels le capitalisme se déploie et se reproduit. Lojkine nous propose non seulement une description précise et essentielle de ces transformations, mais il analyse aussi la manière dont elles redéfinissent le cœur même de capitalisme. L’exploitation devient alors multiple, complexe, toujours plus insaisissable : elle ne se limite pas à la sphère de la production au sens de l’entreprise, mais se déploie également dans toutes les sphères de circulation de la valeur. L’extension du capitalisme à l’ensemble des sphères sociales nécessite pour l’appréhender une extension de la théorie de l’exploitation. De ce fait, la distinction entre les exploiteurs et les exploités se brouille elle aussi, et n’est peut-être plus aussi univoque qu’avant. La structure d’exploitation contemporaine définit une nouvelle multiplicité de positions de classes. Dans le même temps, ce que Lojkine ne dit pas, c’est que la généralisation de l’exploitation capitaliste à d’autres conditions que le salariat produit aussi une homogénéisation de tous ceux qui sont pris d’une manière ou d’une autre dans les rets surplombants des rapports de coordination capitalistes. De ce point de vue, on peut voir des correspondances entre la mise à jour de la théorie de l’exploitation par Lojkine et la théorie de l’ère du peuple .
Cette grille de lecture marxiste actualisée doit aussi nous permettre de poser à nouveaux frais la question de la construction d’un front de lutte anticapitaliste. Autour de quel sujet politique collectif doit-il se former ? Alors que l’ouvrier (ou même le salarié) représentait sans conteste l’acteur révolutionnaire aux siècles passées, la multiplication des rapports d’exploitation et de domination présentée dans l’ouvrage dessine un sujet exploité à construire dans un agrégat social pluriel dans des luttes sûrement plus intersectionnelles qu’avant et prenant en compte la manière dont le capitalisme saisi les individus en dehors du seul rapport salarial.
Enfin, en décrivant le capitalisme comme le couplage d’un système d’exploitation et d’un système de coordination efficace, l’ouvrage met en lumière un enjeu trop souvent éludé : pour renverser le capitalisme, il nous faudra non seulement abolir l’exploitation (ce qui est déjà une lourde tâche), mais aussi inventer des modes de coordination socialiste des échanges suffisamment structurés et efficaces pour garantir la tenue de nouvel ordre.
Le fil invisible du capital ne donne de réponse définitive à la question du dépassement du capitalisme, bien sûr. Mais la description de ses mécanismes, de ses forces et de ses faiblesses permet d’avancer considérablement dans la réflexion et la construction d’une stratégie anticapitaliste pour le 21e siècle.
| Pour aller plus loin : – Simon Verdun, La critique de l’exploitation peut-elle se passer de la théorie marxiste de la valeur ? Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Septembre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/critique-exploitation-capitaliste-theorie-marxiste-valeur/ – Jacques Bidet, Une ambitieuse alternative au « Capital ». Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Octobre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/une-ambitieuse-alternative-au-capital-sur-le-livre-dulysse-lojkine/ – Conférence d’Ulysse Lojkine, Hannah Bensussan, Marlène Benquet et Hadrien Clouet aux Amfis, Le capitalisme aujourd’hui : déchiffrer l’exploitation invisible, Août 2025. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WjFWJfwmuF0 |
21.10.2025 à 11:49
Quand Philippe Aghion abîme le débat économique
Émilien Cabiran
Texte intégral (1086 mots)
Cette tribune, initiée par des économistes de tout le pays contributeur·ices des travaux de l’Institut La Boétie, est parue dans Alternatives Économiques le lundi 20 octobre 2025.
Fraichement auréolé de son « prix Nobel d’économie », Philippe Aghion était l’invité de BFMTV vendredi 17 octobre. Interrogé sur des questions économiques et politiques, il a affirmé mettre le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) « sur le même plan ». Pour les signataires de cette tribune, qui ont contribué aux travaux de l’institut La Boétie sans pour autant être tous des soutiens inconditionnels de LFI, c’est une formule rapide, un effet de manche, qui est un double contresens.
D’abord parce qu’elle entretient un confusionnisme dangereux : quelle que soit l’hostilité que l’on peut nourrir à l’égard de tel ou tel programme, les valeurs, les pratiques et les propositions portées par ces deux forces politiques ne sont ni équivalentes ni interchangeables. Indépendamment de l’opposition fondamentale entre un mouvement défendant des valeurs humanistes (LFI) et un autre dont l’ADN est le rejet de « l’autre » (RN), leurs programmes économiques sont radicalement opposés.
Quand LFI propose une rupture avec le néolibéralisme, le RN le conforte. Quand LFI propose d’abroger la réforme portant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le RN oscille entre retour à 62 ans ou au contraire allongement à 65 ans. Quand LFI propose un système fiscal plus progressif et une meilleure redistribution des richesses, le RN promeut des mesures limitant les ressources de l’État et fragilisant notre système de protection sociale. Quand LFI propose de conditionner les aides aux entreprises, le RN s’aligne sur les positions du Medef. Quand LFI propose de s’engager résolument dans la planification écologique, le RN défend les politiques responsables de la crise climatique. Quand LFI promeut la hausse du SMIC, et plus généralement celle de l’ensemble des salaires, afin d’offrir des débouchés à la production des entreprises, le RN s’y oppose au nom d’une politique de l’offre qui a pourtant montré son inefficacité.
La formule de Philippe Aghion est également un contresens scientifique. En effet, lorsqu’un économiste est érigé en autorité scientifique, il lui revient plus que jamais de poser des critères, des faits et des arguments, plutôt que des sentences qui ferment la discussion. À l’heure où le débat public est miné par les « vérités alternatives » et les attaques contre la science, dévaluer la parole savante par des jugements à l’emporte-pièce, c’est affaiblir l’exigence de rationalité dont nous avons collectivement besoin.
Cette mise à distance du travail d’argumentation est d’autant plus regrettable qu’elle vient d’un chercheur reconnu qui, depuis son piédestal académique, n’hésite pas à intervenir dans le débat public afin de promouvoir le rôle de l’innovation. Or, trop souvent, la défense généreuse de l’innovation a servi de paravent à la préservation de rentes privées. De fait, les politiques de l’offre mises en place depuis 2014 par Emmanuel Macron, d’abord comme ministre de l’économie puis en tant que président de la République — CICE, baisse de la fiscalité sur les plus riches, flat tax, etc. — ont eu un coût budgétaire massif sans parvenir à transformer notre structure productive ni renforcer notre économie.
Si l’on veut parler sérieusement d’efficacité, jouons cartes sur table : l’attractivité de la France, mesurée par la hausse des investissements directs étrangers, se traduit aussi par des rachats d’entreprises françaises, donc par une perte de souveraineté économique. Philippe Aghion revendique sa participation à l’élaboration de ces politiques de « compétitivité » sans aucun recul critique ni esquisse d’un bilan de ces mesures.
Autre paradoxe : on ne peut pas marteler le rôle central de l’éducation dans le processus d’innovation tout en adoubant des politiques qui détruisent les bases de notre système éducatif. L’innovation n’advient pas par incantation. Elle réclame des enseignants considérés, des filières de formation continue sérieusement dotées, une recherche publique stable et exigeante, et un État stratège qui oriente, évalue et corrige. Si nous voulons une économie créative et robuste, la condition première est là : investir dans les capacités collectives plutôt que multiplier les cadeaux fiscaux sans conditionnalité.
Revenons alors à la méthode. Mettre RN et LFI « sur le même plan » n’est pas une analyse, c’est un argument d’autorité manipulateur et sans fondement. La science, elle, commence par spécifier un cadre, explicite des hypothèses, discute des preuves empiriques et accepte le débat contradictoire. Elle n’est ni un propos d’estrade, ni une morale commode qui distribue bons et mauvais points. Le rôle public des chercheurs n’est pas d’arbitrer la démocratie à la place des citoyens, mais d’éclairer les alternatives, d’en chiffrer les effets, d’en nommer les coûts et les bénéfices — y compris lorsque ces résultats contredisent leurs préférences. C’est cette éthique de la discussion que nous défendons.
Nous n’esquivons pas le débat, bien au contraire. Plutôt que d’en rester aux passes d’armes télévisuelles, nous proposons à Philippe Aghion un débat public, contradictoire et sourcé sur ses hypothèses théoriques et l’impact des politiques économiques menées par Emmanuel Macron, qu’il a largement soutenues, ainsi que sur les alternatives possibles.
Il y a, au fond, deux conceptions du débat démocratique. La première, verticale et paresseuse, aligne des étiquettes et met tout « sur le même plan » pour s’éviter toute contradiction. La seconde accepte la complexité : elle distingue, mesure, compare, et reconnaît le droit au désaccord — à condition qu’il soit informé. Nous plaidons pour cette seconde voie, non par courtoisie académique, mais parce qu’elle est la seule à la hauteur des défis économiques que nous devons relever. C’est ainsi que nous ferons progresser la science et la démocratie.
03.10.2025 à 17:31
Les jours fériés, une lutte de classes
Zoé Pebay
Texte intégral (3289 mots)
| Note de lecture de l’ouvrage d’Hadrien Clouet, « De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? », Éditions Le Bord de l’eau, octobre 2025 |
Hadrien Clouet est sociologue et député de la France insoumise depuis 2022. Il est chercheur associé au CERTOP (Université Toulouse-Jean Jaurès), au Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po) ainsi qu’au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNAM). Il est spécialisé dans la sociologie du travail et l’étude de l’action publique. Il est co-responsable du département de sociologie de l’Institut La Boétie. Il a notamment publié Emplois non pourvus : une offensive contre le salariat (2022) et coécrit Chômeurs, vos papiers ! (2023).
De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? À l’été 2025, le gouvernement Bayrou a annoncé vouloir supprimer 2 jours fériés pour économiser 4,2 milliards d’euros et redresser les comptes publics. Dans ce court ouvrage, Hadrien Clouet explique que cette proposition n’est pas simplement une provocation isolée et anecdotique du macronisme. Elle s’inscrit dans la lutte de longue date que mène le capitalisme contre le temps libre des travailleurs et des travailleuses. Symbole du « travailler plus pour gagner moins » de la droite néolibérale, elle est aujourd’hui au cœur de l’offensive conservatrice contre les conquis sociaux.
Pour mieux comprendre cette opération, Hadrien Clouet remonte le fil de la longue histoire des jours fériés en France et des luttes sociales qui ont mené à leur instauration malgré l’hostilité du patronat. Il démontre ensuite comment la suppression de 2 jours fériés proposée par les macronistes vise en réalité à diminuer le salaire réel des travailleurs au profit du capital, un objectif central pour les néolibéraux. Il revient enfin sur les vertus sociales du temps libéré pour la société, en décrivant les formes d’activité et de sociabilité que permettent les jours fériés.
Ce livre déconstruit minutieusement les nombreux poncifs néolibéraux sur la question du temps de travail et propose au contraire une lecture politique de la mise en place des jours fériés. Ce faisant, il la donne à voir cette pour ce qu’elle est : une lutte de classes.
| « Les luttes du capitalisme sont des luttes de temps. » |
I) Les jours fériés : du temps libre gagné par les travailleurs contre les élites patronales et politiques
Les premiers jours fériés apparaissent dans notre histoire avec l’instauration de la République. Il s’agit alors de souder le peuple autour de moments importants de la construction nationale, comme la proclamation de la IIe République le 24 février, après l’abdication du roi Louis-Philippe Ier. C’est ensuite sous la IIIe République que naissent la plupart des jours fériés que l’on connaît aujourd’hui : le 14 juillet, bien sûr, mais aussi les lundis de Pâques et de Pentecôte rendus fériés par la loi du 8 mars 1886. Surprenamment, la demande n’émanait pas des instances religieuses mais des banques et des chambres de commerces, pour des raisons purement commerciales et financières[1]. Malgré cela, la résistance patronale se met rapidement en place, notamment dans le secteur de l’industrie. Beaucoup d’employeurs refusent d’octroyer ces jours fériés à leurs employés. Les procès verbaux pour « violation de jours fériés légaux » se multiplient partout sur le territoire. C’est seulement grâce à la mobilisation des syndicats, associations et autres organismes publics que les salariés pourront bénéficier effectivement de ces droits.

Cet affrontement de classe est encore plus marqué dans le cas du Premier Mai, journée internationale des travailleurs, rendu férié par la mobilisation consciente de la classe ouvrière. Dès 1889, le congrès socialiste de Paris exige de proclamer ce jour férié. Les mairies socialistes puis communistes vont ensuite progressivement le mettre en place pour leurs propres services municipaux et défendre sa généralisation à l’ensemble du pays, en demandant un vote de la chambre des députés. Après son instrumentalisation par le régime de Vichy – qui le transforme en « Jour du Travail » – le Premier Mai est inscrit dans le marbre à la Libération par les forces de la résistance. Le 1er mai 1946 est le premier chômé à salaire constant. En 1947, le gouvernement pérennise la disposition pour tous les premiers mai à venir, et la loi du 29 avril 1948 précise les modalités de cette généralisation.

L’instauration du 8 Mai férié a elle aussi été le fruit d’un long combat. Au lendemain de la guerre, l’État ne souhaite pas reconnaître la spécificité de la victoire du 8 mai 1945 contre le nazisme, trop marquée politiquement par la résistance antifasciste et communiste. Alors que le 11 Novembre est rendu férié dès 1922 en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale, le jour de la capitulation allemande devra attendre 1953 – et des années de mobilisations communistes et gaullistes – avant de devenir un jour férié.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans les années qui suivent, le 8 Mai férié sera régulièrement supprimé puis rétabli – pour des raisons à la fois politiques et économiques. En 1959, De Gaulle décale la commémoration nationale au deuxième dimanche de mai, avec les mêmes justifications que celle d’un François Bayrou aujourd’hui : de trop nombreux ponts tueraient la productivité nationale… S’ensuivent plusieurs années de va-et-vient. En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing abroge tout simplement la commémoration officielle de la victoire sur le nazisme, au nom de l’amitié franco-allemande. En 1979, le Sénat vote son rétablissement comme jour férié, avant qu’il ne redevienne définitivement un jour férié et chômé sous la présidence de François Mitterrand.
Avec six évolutions en un demi-siècle, le 8 Mai symbolise à lui seul le caractère profondément politique et polarisant des jours fériés.
| Trop de jours fériés : les Français travaillent-ils vraiment moins que leurs voisins ? L’idée selon laquelle les Français travaillent moins que leurs voisins européens est un mythe, y compris du point de vue du nombre de jours fériés, rappelle Hadrien Clouet. • Les pays de l’Union européenne comptent en moyenne 12 jours fériés par an. Avec ses 11 jours fériés, la France se situe en dessous, à l’inverse de Chypre (15), de l’Espagne, Malte et la Slovaquie (13) ou encore de la Finlande, l’Autriche et le Portugal (13). • Même si on additionne jours fériés et congés payés, la France comptabilise 36 jours, contre 44 pour l’Espagne et Malte, 38 pour l’Autriche et 37 pour le Luxembourg. • Le temps de travail des Français n’est pas plus faible qu’en Europe. Un salarié français travaille 1491 heures par an en moyenne : c’est plus que les Allemands, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Autrichiens, les Islandais, les Hollandais ou encore les Luxembourgeois. • Le temps de travail hebdomadaire moyen en France est de 37 heures. Mais il cache de fortes disparités. 1 salarié sur 5 travaille plus de 48 heures par semaine. Pour ces travailleurs, supprimer un jour férié équivaut à supprimer l’une de leurs dernières bouées de sauvetage. |
II) L’offensive macroniste contre les jours fériés : une extorsion du salaire pour les poches du capital
Derrière la justification budgétaire du Gouvernement – « Il faut sauver les finances publiques » – la suppression des jours fériés cache en réalité un autre objectif : diminuer les salaires réels et accroître les profits privés. En supprimant des jours fériés, l’État entend se faire de l’argent sur le dos du travail gratuit des salariés, tout en taxant une une partie du revenu de l’entreprise en contrepartie de ce surcroît d’activité. Or, cette contribution patronale n’est pas fléchée. On ne sait donc même pas où ira le fruit de notre travail gratuit : « Va-t-on travailler gratuitement pour financer les engagements présidentiels en matière de Défense nationale à 5 % du produit intérieur brut, dans une logique farfelue voulant que l’on indexe nos crédits militaires sur le niveau de richesse du pays ? Va-t-on abdiquer le droit au repos pour passer commande auprès du complexe militaro-industriel nord-américain ? » (p. 33).

C’est un retournement de la logique de la Sécurité sociale, explique Hadrien Clouet. Depuis 1946, le développement de la protection sociale reposait sur une hausse continue des cotisations qui augmentait ses recettes. La Sécurité sociale ne s’est jamais appuyée sur la réduction de la rémunération du travail : au contraire, son fonctionnement repose sur la hausse des salaires. Or, aujourd’hui, les macronistes veulent renverser cette logique et lier le destin de la Sécurité sociale au développement du travail gratuit, en imposant l’idée que les comptes de la Sécurité sociale seraient minés par une trop forte rémunération du travail. Ils créent ainsi une opposition factice entre salariés et assurés, alors que le principe de la protection sociale est justement de lier leur sort.
Mais combien vaut cette manœuvre idéologique ? Pas beaucoup, visiblement. L’ancien Premier ministre François Bayrou estime à 4,2 milliards d’euros le gain de la suppression de deux jours fériés. Et encore, « le chiffre a été inventé sur un coin de table », avance Hadrien Clouet, et se fonde sur un calcul très incertain. En réalité, les recettes supplémentaires de la suppression d’un jour férié gravitent plutôt autour d’1,5 milliard d’euros, selon l’OFCE. Donc environ 3 milliards pour deux jours.
À titre de comparaison, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a coûté 4,5 milliards d’euros, soit 3 jours fériés. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 5 milliards, soit plus de 3 jours fériés. La mise en place de la flat tax : 4 milliards, soit 2,5 jours fériés. Autrement dit, rétablir l’ISF, la CVAE et l’imposition mobilière nous rapporterait 9 jours fériés ! Par ailleurs, les gains économiques attendus liés au regain d’activité productif sont illusoires : dans un contexte d’austérité sans précédent, la consommation populaire est largement en berne.

Ceux qui vont s’enrichir de cette mesure, ce sont donc les capitalistes. En faisant appel aux fondamentaux marxistes, Hadrien Clouet nous rappelle le principe du salaire : c’est la rémunération versée en échange de la location d’une force de travail pour un temps donné. Ainsi, « lorsque l’on loue sa force de travail plus longtemps, mais à salaire constant, il est évident que le prix de cette force de travail a baissé. ». Or c’est précisément l’objectif de la suppression des jours fériés. Travailler 2 jours de plus sans hausse de salaire, cela revient à perdre environ 1 % de rémunération annuelle, voire davantage pour les salariés disposant d’un accord de branche et qui bénéficiaient d’une majoration pour leur travail en jour férié.
Le gouvernement cherche donc à augmenter le temps de travail par tous les moyens. Sa dernière invention en date : la monétisation de la cinquième semaine de congés payés. Autrement dit, il s’agit d’offrir aux salariés la possibilité d’abandonner leur semaine de congé contre une rémunération supplémentaire. Jours fériés, congés payés, retraite… : l’offensive néolibérale pour rogner sur le temps libre restant est générale.
III) Le temps libéré, ferment d’une société de l’intérêt général
| « Sauver, garantir et augmenter les jours fériés demeure donc un outil fondamental pour donner un sens irréductiblement collectif et autonome à nos existences. » |
La suppression des jours fériés est non seulement antisociale et inutile économiquement, elle est aussi nuisible aux activités solidaires et collectives de notre société. L’extension continue de la sphère marchande étouffe les vertus sociales et politiques du temps libre, explique Hadrien Clouet.
Aujourd’hui, le jour férié n’est plus nécessairement un grand rassemblement national commémoratif. L’usage du temps libre et du divertissement est plus fragmenté, plus divers que dans le passé. Mais les jours fériés continuent de jouer un rôle de « synchronisation collective des temps non lucratifs ». Certes, une fraction non négligeable de salariés continuent de travailler les jours fériés, et il est difficile de savoir exactement combien d’entre eux chôment ces jours fériés. Mais l’enquête Emploi de l’INSEE montrent tout de même qu’en présence d’un jour férié, le temps de travail hebdomadaire général baisse de 31 %. Les jours fériés demeurent une expérience de masse.

Mais que font réellement les travailleurs et travailleuses lors des jours fériés ? Comment profitent-ils de ce temps extraordinairement extirpé du quotidien marchandisé et à quelles fins ? C’est d’abord un temps où le repos devient possible, lui qui est continuellement réduit car il représente un obstacle à l’accumulation capitaliste à court terme. Le repos du jour férié est un acte informel de résistance explique Hadrien Clouet : un temps qui échappe à la tutelle patronale et aux cadences toujours plus effrénées du travail. Le temps libéré par le jour férié est aussi une occasion de travailler autrement, d’effectuer ce que l’anthropologue Florence Weber appelle le « travail d’à-côté » : bricolage, réparation, entretien…
Mais le temps libre des jours fériés permet plus que cela : il est aussi le temps du collectif, des loisirs partagées et des sociabilités. Pendant les jours fériés, le temps passé entre amis augmente de 20 minutes par rapport au reste du temps ! Ils renforcent les liens sociaux et les relations informelles au sein de la communauté, et notamment l’aide et la solidarité envers les plus vulnérables (rendre visite aux personnes âgées, donner du temps à une association…). Bref, les jours fériés sont souvent le temps de l’organisation collective, sociale, culturelle, politique, en dehors du rythme quotidien si empêchant. Ils sont donc le ferment d’une société de l’intérêt général. Les supprimer au nom de l’équilibre budgétaire, c’est avoir une basse idée de nos existences collectives, affirme Hadrien Clouet.
Il conclut en proposant non seulement de défendre nos onze jours fériés pour toutes les raisons évoquées, mais aussi d’en instaurer de nouveaux. Le propre du puissant est de dicter le temps du dominé, écrit Clouet. Renverser l’ordre des choses, c’est donc reconquérir ce temps à ceux qui le volent tout au long de nos existences. C’est la tâche de gauche de rupture si elle prend le pouvoir, qui pourrait alors instaurer de nouveaux jours fériés d’utilité publique qui symbolisent les conquêtes sociales du peuple et les grands moments de son histoire. Par exemple, le 24 février pour la mémoire de l’abolition de l’esclavage par le République, et le 18 mars, en mémoire de la Commune de Paris.
| « Être révolutionnaire, c’est assumer que la joie et le bonheur sont des objectifs en tant que tels. » |
22.09.2025 à 18:24
Quand l’histoire se répète ou comment l’extrême centre a porté Hitler au pouvoir
Zoé Pebay
Texte intégral (4183 mots)
| Note de lecture de l’ouvrage de Johann Chapoutot, Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Éditions Gallimard, 2025. |
Une idée répandue voudrait que Hitler soit arrivé au pouvoir par les urnes et qu’une irrésistible marée brune ait emporté l’Allemagne des années 1930 dans le nazisme. Il n’en est rien : les nazis n’ont jamais pris le pouvoir, on le leur a donné.
Dans son dernier livre, Johann Chapoutot montre que l’arrivée au pouvoir des nazis est en réalité le résultat d’une série de manœuvres, de paris et de calculs qui ont conduit à ce que les libéraux autoritaires de l’époque, désireux que leurs politiques, notamment économiques, continuent à être mises en œuvre, nomment eux-mêmes Hitler à la Chancellerie du Reich.
En plongeant dans ce livre sur les années 1920-1930, les similarités avec notre époque sautent aux yeux. Au-delà du spectacle abject de l’actualité – des saluts nazis d’Elon Musk et Steve Bannon aux candidats du RN en 2024 affublés d’une casquette nazie, en passant par les milices criant « Paris est nazi » et qui poignardent des militant·es de gauche – c’est l’analogie entre le contexte politique général des années 1920-30 et celui d’aujourd’hui qui frappe. Les mécanismes qui ont concouru à l’ascension des nazis et à la nomination de Hitler à la Chancellerie du Reich le 30 janvier 1933 semblent en effet d’une troublante actualité :
- Une Constitution permettant l’autoritarisme de l’extrême centre, qui refuse de respecter le résultat des élections et dont les courtisans et conseillers méprisent les idées démocratiques ;
- L’industrie médiatique, qui panique devant le « bolchévisme culturel » – une chimère, inventée pour désigner tout ce qui se rapporte de près ou de loin au progrès social – tout en répandant une idéologie raciste et antisémite propre à l’extrême droite ;
- Des personnalités politiques et médiatiques qui condamnent « les extrêmes » et diabolisent une supposée « extrême gauche », alors même que l’extrême droite terrorise réellement les rues et les esprits ;
- Un « cercle de la raison » autoproclamé qui poursuit une politique d’austérité résolument probusiness, aggravant les inégalités et minant l’économie nationale ;
- Une gauche social-démocrate déboussolée qui soutient cette politique, afin dit-elle, « d’éviter le pire » ;
- Une propagande va-t-en-guerre et une politique de puissance, mêlant expansionnisme et impérialisme territorial…
La liste des forfaitures et des compromissions qui ont mené à l’arrivée du nazime au pouvoir est longue. Mais loin de nous conduire à la fatalité et à la résignation, le livre de Johann Chapoutot nous enseigne une chose : les situations politiques ne sont jamais écrites à l’avance. À travers une galerie de portraits des hommes qui, par calcul ou par aveuglement, ont contribué à porter Hitler au pouvoir, l’historien montre que si les dynamiques structurelles de la montée de l’extrême droite (chômage, sentiment de déclassement, racisme…) jouent un rôle, elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer son accession au pouvoir. Derrière la nomination de Hitler à la Chancellerie, il y a des visages et surtout des intérêts : ceux de la caste au pouvoir, dont la responsabilité est accablante.
Du comportement de l’extrême centre partisan au rôle des élites économiques, l’Institut La Boétie revient sur quelques-uns des éléments structurants du récit que fait le grand historien de l’accession au pouvoir du nazisme, malheureusement riche d’enseignement pour le présent.

I) Les libéraux autoritaires au pouvoir : en marche vers le fascisme
La crise politique de 1930 et le viol de la Constitution
C’est en décembre 1929 que le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg et Heinrich Brüning, futur Chancelier du Reich (équivalent au poste de Premier ministre), arrêtent, quelques mois avant la nomination de Brüning, un plan pour contourner la démocratie et conserver le pouvoir dans un contexte de crise politique.
Brüning est un technicien des finances publiques, docteur en économie et une figure importante de l’extrême centre allemand (Zentrum). C’est lui que le président Hindenburg décide d’appeler à la Chancellerie le 28 mars 1930 pour remplacer Heinrich Müller, le Chancelier social-démocrate, qu’il exècre au plus au point et auquel il reproche d’avoir échoué sur les questions sociales et budgétaires, alors que la crise économique frappe de plus belle l’Allemagne depuis l’automne 1929.
Leur objectif est clair : gouverner en faisant fi du Reichstag (le Parlement allemand), sur le fondement de l’article 48 de la Constitution. Cet article confère des pouvoirs exceptionnels à l’exécutif, destinés à être utilisés en cas de crise majeure. Cependant, les libéraux autoritaires en détournent l’usage : au lieu de répondre à un danger grave et imminent, l’article leur sert à promulguer des ordonnances en matière de législation financière (article 48-2), comme celles introduisant de nouvelles taxes sur le tabac et la bière.
Outre l’usage extensif et abusif de l’ordonnance législative, la nouvelle pratique institutionnelle du pouvoir fait basculer la République de Weimar dans un régime présidentiel autoritaire. La séquence du vote du budget est particulièrement saisissante à cet égard (toute ressemblance avec des faits contemporains existants serait fortuite). L’opposition social-démocrate rejette la politique austéritaire du gouvernement Brüning. En réponse, ce dernier utilise l’article 48-2 pour faire passer le budget en force. Pour le contrer, l’opposition a recours à l’article 48-3, dans le but de faire tomber le texte. L’article 48-3 dispose en effet que « les mesures ainsi prises [par le gouvernement] sont annulées à la demande du Reichstag ».
C’est alors que le Président Hindenburg décide, à la surprise générale, de dissoudre le Parlement (article 25). Profitant du vide parlementaire – l’Assemblée étant sans session, il fait adopter le texte budgétaire par l’article 48-2. Coup de théâtre : cette situation n’avait pas été prévue par les constituants de 1919 et contrevient gravement à l’esprit de la Constitution de 1919, en fragilisant l’équilibre entre les pouvoirs législatifs et exécutifs.
L’échec de la dissolution et la formation de gouvernements régionaux coalisant l’extrême centre et l’extrême droite
En pleine dérive autoritaire, le gouvernement est sanctionné dans les urnes suite à la dissolution. Lors des nouvelles élections qui interviennent le 14 septembre 1930, les sociaux-démocrates (SPD) perdent des voix (-5 points), mais restent le premier parti (24,5 %). Les communistes (KPD) gagnent 2,5 points et envoient 77 députés au Reichstag, tandis que le Zentrum (le parti de Brüning) dégringole avec un score de 14,8 % pour 68 sièges. Le grand gagnant est le NSDAP (le parti d’Hitler), qui progresse de manière spectaculaire, passant de 2,8 % à 18,3 %, envoyant 107 députés au Reichstag.
« Le gouvernement Brüning sera donc minoritaire au Reichstag : la « coalition nationale » de la droite libérale et conservatrice sur laquelle souhaitait s’appuyer le chancelier ne représente plus, au mieux, que 35 % des voix (…) contre plus de 50 % dans la législature précédente ». (p.45)
Battu dans les urnes, le gouvernement parvient néanmoins à mettre en œuvre sa politique de réduction des salaires et de baisse des dépenses sociales, pendant deux ans. Une longévité extraordinaire, qui tient à un fait majeur : le soutien de la gauche sociale-démocrate. Elle défend face aux nazis une politique du « moindre mal » – ce qui semble paradoxal, puisque cette même politique nourrit le vote nazi. Dans une résolution votée le 3 octobre 1930, le SPD fustige à droite le « mouvement fasciste des nazis » et à gauche « le parti communiste », accusé de diviser la classe ouvrière.
Cherchant des alliances, Brüning songe à faire entrer trois ministres nazis au gouvernement. Mais l’obsession de Hitler pour « l’extermination des communistes, des socialistes et des forces réactionnaires » le refroidit quelque peu. L’alliance avec les nazis au Reich attendra, mais pourquoi ne pas former un tel gouvernement au niveau des États fédérés (Länder) ? Ainsi, le Chancelier écrit dans ses mémoires :
« Pour ne pas trancher les fils déjà tissés (…), je me déclarais disposé à faire en sorte que le NSDAP et le Zentrum puissent former des gouvernements dans les Parlements des Länder, partout où cela serait arithmétiquement possible, et ce, dès cette première phase de rapprochement entre nous. » (p.49)
Cette ligne politique est décisive : en décembre 1932, les nazis gouvernent dans cinq Länder, dont trois dirigés par la droite et le centre. Ces coalitions régionales servent à la fois de vitrine et de laboratoire à l’extrême droite – en matière de politique intérieure notamment. Elles participent aussi, selon Chapoutot, à une « habituation réciproque entre droite et extrême droite » qui rend crédible l’hypothèse nazie.
Finalement, celui qui précipite la chute de Brüning est le même que celui qui l’a porté au pouvoir : Hindenburg. Et l’une des raisons est révélatrice des préoccupations de l’ancien maréchal prussien devenu président du Reich : les intérêts agrariens, un enjeu social majeur de l’époque.
Brüning propose une réforme agraire, visant à redistribuer les terres inexploitées de l’Est, pour les lotir et permettre aux habitants des villes de s’installer à la campagne, réduisant ainsi le chômage. Cette proposition touche un point sensible : la propriété terrienne des Junker, ces seigneurs de l’Est, dont fait partie Hindenburg et dont toute la sociabilité du Président est imprégnée : c’est ce projet de réforme qui scelle le sort de Brüning et marque le début de l’ère Papen – qui promet, lui, de mener une politique largement favorable aux intérêts privés mais aussi peu répressive à l’égard des nazis.

II) Les élites politiques et économiques au service de l’extrême droite
Hitler n’est pas arrivé seul au pouvoir. Il y a été amené, par la capitulation des partis de droite et du centre enlisés dans une crise politique et s’accrochant au pouvoir à tout prix. Mais ils ne sont pas les seuls : l’entremise de grands patrons séduits par le nazisme pour protéger leurs intérêts est elle aussi décisive.
Hugenberg, le magnat des médias qui rêve d’une « union des droites »
Surnommé le « Führer oublié » par son biographe, Alfred Hugenberg est un haut-fonctionnaire, spécialiste des questions agricoles, banquier et pionnier dans l’entrepreneuriat idéologique. Ayant fait fortune dans l’industrie lourde, il fantasme une Allemagne puissante, redoutée et triomphante – celle de Bismarck et de Guillaume II. Précurseur du magnat de la presse anglophone Rupert Murdoch et du français Vincent Bolloré, il est persuadé que ses projets financiers nécessitent une influence sur l’opinion publique.
Cette conviction le conduit à constituer un empire médiatico-financier inédit (Konzern), lui permettant d’imposer les thèmes de l’extrême droite dans le débat public. Dans la holding qu’il préside, il regroupe pas moins de 26 quotidiens et hebdomadaires nationaux et provinciaux – dont le troisième plus grand groupe de presse d’Allemagne, acquis dès 1916 avec l’aide du gouvernement allemand. À cette collection, s’ajoute une usine à textes (la WiPro) qui diffuse et produit du prêt-à-penser en continu. La ligne de cet empire médiatique est ouvertement antisémite, raciste, nationaliste et réactionnaire. Elle trouve un écho inédit dans l’espace médiatique : pas moins de 1600 journaux relaient les « informations » propagées par le Konzern. C’est une véritable industrie du fait divers qui est mise sur pied, afin de diriger l’attention de la population toute entière sur des faits montés en épingle[1]. Johann Chapoutot résume les conséquences de cette entreprise :
« En travaillant l’écume de l’actualité, on laboure en réalité les profondeurs océaniques de la psyché nationale, dans un sens conservateur, voire réactionnaire : quelques « unes » bien calibrées sur tel scandale impliquant des Juifs vont permettre de réactiver 1500 ans d’antisémitisme européen ». (p.91)
Outre son goût pour la presse, Hugenberg s’illustre aussi en politique. Il rejoint le Parti national du peuple allemand en 1918 – un groupement national-conservateur et en prend la tête en 1928. Hugenberg travaille à l’union des droites, mais Hitler veut le pouvoir pour lui seul. À l’automne 1930, Hugenberg propose alors à Hitler de créer un « front national » (sic). Il pense ainsi drainer le mouvement nazi tout en l’utilisant à son avantage, persuadé de pouvoir dominer cette alliance.
Ironie du sort : ceux qui pensaient avoir fait une affaire en or en misant sur les nazis à la baisse se retrouvent morts ou sous tutelle. Hugenberg en est l’exemple parfait. Il soutient Papen en 1932 et devient ministre de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Alimentation d’Hitler en 1933. En six mois de gouvernement Hitler, il est dépouillé et contraint de brader son empire aux nazis en leur cédant ses entreprises médiatiques. Ainsi, comme une grande partie des élites politiques de l’époque, celui qui croyait s’allier au NSDAP n’était pour Hitler qu’un simple marchepied vers le pouvoir.

« Plutôt Hitler que le Front populaire »
Le gouvernement Papen (1ᵉʳ juin 1932 – 3 décembre 1932) est généralement évacué en deux lignes dans les livres d’histoire. Johann Chapoutot s’attache au contraire à montrer que les libéraux autoritaires qui entourent le Chancelier Papen – banquiers, propriétaires terriens, industriels, militaires, journalistes, universitaires – avaient bel et bien une vision de long terme et un programme pour l’Allemagne (dérégulation du droit du travail, subventions massives aux entreprises…).
Une fois au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag, clamant que le pays a besoin d’une « clarification politique intérieure »[2]. Une décision irresponsable – résultant d’un accord discret avec le parti nazi – le NSDAP étant dans une dynamique électorale favorable. Les résultats marquent une défaite cuisante pour le gouvernement : les nazis obtiennent 37,3 % des voix, très loin devant le SPD qui obtient 21,6 % des voix. En août 1932, l’analyse de Wilhelm von Gayl (1879-1945), ministre de l’Intérieur de Papen, est stupéfiante. Il affirme que l’Allemagne est divisée en trois blocs : les marxistes (le SPD et le KPD), les nationalistes (le NSDAP et le DNVP), qui refusent de rejoindre le Zentrum, car ils veulent la Chancellerie, et le bloc central, titulaire de la meilleure politique et qui doit conserver le pouvoir par tous les moyens. Gouvernant avec moins de 10 % des voix, Papen cherche des alliances. Tout rapprochement avec la gauche – même la plus modérée – étant exclu, Papen engage alors des négociations avec les nazis.
III) Une décision irresponsable : nommer Hitler à la Chancellerie
L’effritement du NSDAP après la défaite : le parti au bord de la scission
Hitler rejetant tout scénario de victoire partielle, Papen doit lui aussi (comme Brüning) renoncer au soutien des nazis au niveau du Reich. Incapable de se maintenir au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag une nouvelle fois en septembre 1932. Le mythe de la prise du pouvoir par les nazis s’évanouit à la lecture des résultats de ces élections législatives. Le bilan est manifeste : loin d’une ascension fulgurante, le parti nazi est en net déclin. Il perd deux millions d’électeurs, 4 points (33 %) soit 34 sièges de député.
L’échec de la stratégie légaliste et maximaliste du NSDAP est tel que Hitler envisage de se suicider en décembre 1932. Outre le recul dans les urnes, le parti est au bord de la scission. Le n°2 du parti, Georg Strasser, nazi de la première heure, plaide pour l’entrée au gouvernement (ligne minimaliste). Une ligne que Hitler refuse puisqu’il souhaite être nommé Chancelier (ligne maximaliste).
Le général Kurt von Schleicher, l’un des personnages les plus influents du Reich, pousse pour que la ligne minimaliste du NSDAP entre au gouvernement, afin de disloquer le parti. Ayant pris conscience de la dangerosité de Hitler, pas question pour Schleicher de lui confier la Chancellerie.
Alors que Papen est seul, dépourvu d’un socle électoral solide sur lequel s’appuyer pour gouverner, ce dernier envisage de faire un coup d’État. Pour l’en empêcher, Schleicher convainc Hindenburg de le nommer Chancelier à sa place le 2 décembre 1932.
L’échec de la manœuvre de Schleicher et la nomination de Hitler à la Chancellerie
Schleicher est resté à la postérité pour sa stratégie du Querfront (« le front oblique »). Elle vise à traverser les organisations politiques et syndicales, afin d’en extraire une base transpartisane et dépasser les appareils. En dialoguant avec la droite de la gauche (SPD et syndicalistes conservateurs) et la « gauche » des nazis (aile « sociale » de Strasser), il cherche à fracturer les blocs électoraux pour bâtir une majorité nationale-sociale.
Finalement, l’effondrement psychique de Strasser le 8 décembre 1932, qui démissionne de toutes ses fonctions au sein du NSDAP, scelle le sort de l’expérience Schleicher. Il ne parviendra pas à faire une coalition entre l’aile de Strasser du NSDAP, le Zentrum et la droite conservatrice. En outre, le projet de réforme agraire, qui touche aux intérêts de la famille Hindenburg, le fait tomber en disgrâce auprès du Président. Enfin, Papen, rongé par la rancœur, intrigue en secret avec Hitler pour convaincre Hindenburg de franchir le pas qui changera l’histoire du monde à jamais : nommer Hitler à la Chancellerie du Reich.
Mais ce sont en dernière instance les intérêts fonciers des Hindenburg qui ont pesé dans la décision de nommer Hitler. Menacé par Hitler de révéler un scandale sur les aides publiques aux propriétés foncières de l’Est dont la famille Hindenburg a gracieusement bénéficié, Oskar von Hindenburg, fils de Paul von Hindenburg, pousse son père à soutenir Hitler. Le 10 janvier 1933, Hitler est nommé Chancelier.

C’est ainsi qu’une droite autoritaire, incapable d’obtenir plus de 10 % des suffrages, décide, après de sordides calculs patrimoniaux, de donner la Chancellerie aux nazis, alors en déclin. Les « centristes » Hindenburg et Papen pensent pouvoir manipuler les nazis par cette manœuvre et tourner la situation à leur avantage. En réalité, cette décision irresponsable scelle le destin de la caste au pouvoir, ainsi que celui de millions de vies qui périront du nazisme.
Conclusion : 1932 / 2025, une identité de rapport
L’auteur conclut son livre par une réflexion sur le statut de la comparaison en histoire, dont nous devons tirer toutes les conséquences pour agir avec lucidité dans la conjoncture actuelle :
« En l’espèce, en dépit de similitudes étonnantes, Hugenberg n’est pas Bolloré et Papen n’est pas Macron, mais leurs positions dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 2025 et de l’Allemagne de 1932 sont analogues. Pas d’égalité ou d’identité terme à terme (A n’est pas C), mais une identité de rapport (A/B=C/D). » Ainsi, « […] ce n’est n’est pas parce que l’histoire ne se répète pas que les êtres qui la font – qui la sont – ne sont pas mus par des forces étonnamment semblables ». (p.278)
Alors que le bloc bourgeois démontre jour après jour sa capacité à se compromettre avec l’extrême droite et ses idées, le livre de Johann Chapoutot résonne donc comme un appel à la lucidité et au courage politique face aux irresponsables d’aujourd’hui.
13.08.2025 à 11:42
Nouveau peuple, nouvelle gauche : le nouveau livre collectif de l’Institut La Boétie
Émilien Cabiran
Texte intégral (550 mots)
L’Institut La Boétie publie son deuxième ouvrage collectif, Nouveau peuple, nouvelle gauche, dans la collection « Les livres de l’Institut La Boétie » aux éditions Amsterdam.
Cet ouvrage collectif est dirigé par le sociologue Julien Talpin. Il s’ouvre par un entretien croisé de Nancy Fraser, philosophe féministe états-unienne et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie, et se clôt par une postface stratégique de Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut et vice-présidente de l’Assemblée nationale.
Il rassemble les contributions de 21 auteur·ices, sociologues, philosophes, économistes ou politistes, qui, ensemble, mettent à l’épreuve l’idée d’un « divorce » consommé entre la gauche et le peuple. Loin de la vision fantasmée d’une classe ouvrière uniforme, figée dans le marbre, il propose de décrire les classes populaires d’aujourd’hui, dans leur diversité et leurs transformations.
Il répond à des questions telles que « le peuple est-il devenu de droite ? », et revient sur des épisodes clés de l’évolution de la relation entre la gauche et les milieux populaires : évolution de la social-démocratie ; Gilets jaunes ; mobilisations des quartiers populaires, etc. Enfin, il propose des pistes pour quelques-uns des grands défis qui se posent pour construire une « nouvelle gauche » capable d’assurer la victoire de ce « nouveau peuple ».
Ce livre est donc une pièce majeure aux débats stratégiques qui animent actuellement la gauche française et internationale. En s’appuyant sur des analyses rigoureuses en sciences sociales, il trace un chemin clair pour l’action : s’appuyer sur la nouvelle réalité sociologique du peuple – plutôt que la nier – pour construire une nouvelle réalité politique.
Liste des contributeur·ices : Sarah Abdelnour, Bruno Amable, Sophie Bernard, Sophie Béroud, Jean-Baptiste Comby, Magali Della Sudda, Clara Deville, Nancy Fraser, Pierre Gilbert, Élisabeth Godefroy, Raúl Gómez, Clémence Guetté, Tristan Haute, Samuel Hayat, José Lopes, Hadrien Malier, Jean-Luc Mélenchon, Julian Mischi, Rachel Silvera, Julien Talpin, Vincent Tiberj.
Commandez dès maintenant Nouveau peuple, nouvelle gauche.
Découvrez la présentation du livre et le sommaire sur le site des éditions Amsterdam
Parution en librairie le vendredi 5 septembre. Plusieurs rencontres autour du livre partout dans le pays avec des contributeur·ices sont programmées ou en cours d’organisation, retrouvez la liste ci-dessous :
- Jeudi 18 janvier à Roubaix : Julien Talpin et David Guiraud à la permanence de David Guiraud
- Samedi 10 janvier à Grenoble : Sophie Béroud à la salle Moyrand
- Samedi 17 janvier à Perpignan : Élisabeth Godefroy à la librairie Torcatis
- Mercredi 11 février à l’ENSAE à Paris : Clémence Guetté
- Mercredi 18 février à l’université Paris Dauphine : Clémence Guetté
28.05.2025 à 07:55
Combien coûterait la nationalisation d’ArcelorMittal ?
Émilien Cabiran
Texte intégral (7933 mots)
À la suite de l’annonce de la suppression de 630 postes en France effectuée le 23 avril 2025 par ArcelorMittal, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la nationalisation des activités d’ArcelorMittal en France. Les opposants à la nationalisation avancent comme principal contre-argument le coût pour les finances publiques que représenterait une telle opération.
Cet article, rédigé par des économistes et des spécialistes du secteur de la sidérurgie, éclaire les enjeux autour d’une potentielle nationalisation d’ArcelorMittal et apporte en particulier des éléments d’évaluation du coût qu’elle pourrait représenter pour l’État.
État des lieux de la situation d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est pleinement engagé dans une logique de restructuration en Europe et en France, qui conduit à la réduction de son activité et à des plans de licenciements importants.
Il faut d’abord rappeler l’ampleur de la crise de l’acier en Europe, et surtout sa très grande violence en France ces dernières années. La France a subi le plus fort recul de la production d’acier européenne, 26 % et 3,7 millions de tonnes en moins par rapport à 2019, et ce principalement du fait des décisions d’ArcelorMittal.
Le récent plan de suppression de 630 postes n’est pas un événement isolé. Il s’inscrit dans une tendance profonde de réorganisation des activités d’ArcelorMittal en Europe et en France qui vise à renforcer la concurrence entre les sites européens et à réduire la présence européenne aux profits de sites en Inde, au Brésil et aux États-Unis.
En juillet 2024, ArcelorMittal confirme l’arrêt durable d’un des deux hauts fourneaux du site de Fos-sur-Mer. Cette décision a pour conséquence une division par deux de la production et la suppression de 308 postes. L’entreprise a laissé entendre que d’autres annonces pourraient suivre sur le front de l’emploi, ce qui paraît probable compte tenu des conséquences de la fermeture d’un haut fourneau sur l’activité globale du site.
Fin 2024, une vague de suppression de 140 postes dans les centres de services entraîne la fermeture des sites de Denain et de Reims. Cela coïncide avec la suppression d’une trentaine d’emplois dans la distribution et avec la fermeture de plusieurs agences.
Fin avril 2025, le plan « React » prévoit 400 suppressions de postes dans la production pour les sites du « cluster nord », c’est-à-dire Dunkerque, Florange ainsi que les sites associés en aval. En parallèle, un plan de délocalisation de fonctions support à l’échelle européenne prévoit le départ vers l’Inde et la Pologne de 1 500 postes, dont plus de 200 en France.
Ce plan vise à faire environ 100 millions d’euros d’économies par an. Une étude interne montre pourtant que ces montants sont largement surestimés et que le plan risque de fragiliser considérablement les capacités industrielles européennes et donc favoriser de nouveaux reculs à l’avenir[1].
Au bout du compte, plus de 1 000 emplois ont été supprimés en un an et ce dans des domaines aussi divers que complémentaires.
Rappel des grands enjeux industriels
ArcelorMittal est effectivement concerné par un certain nombre de défis.
En raison de logiques financières de réduction de coûts et de rétribution croissante des actionnaires, ArcelorMittal a laissé se dégrader l’outil industriel pour finir par dénoncer le manque de fiabilité du site de Dunkerque. La situation est encore plus préoccupante pour le site de Fos-sur-Mer : un scandale de pollution industrielle a mené à la mise en examen d’Arcelor pour « mise en danger d’autrui » et « faux et usage de faux »[2].
ArcelorMittal doit ensuite décarboner sa production en Europe. La sidérurgie est en effet l’industrie la plus émettrice de CO2 et elle doit donc se décarboner aussi vite que possible pour limiter le réchauffement climatique. Plus prosaïquement, la décarbonation doit être menée en raison d’un certain nombre d’évolutions de réglementation. La fin progressive des quotas carbone gratuits distribués dans le cadre du marché carbone européen[3], couplée à la mise en œuvre du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE, prévue entre 2026 et 2034, menace la viabilité de la production en 2030 si celle-ci n’a pas été décarbonée. Or, il faut environ quatre ans pour mener le processus à bien, du fait de la commande des outils et des travaux d’ingénierie publique nécessaires. Pourtant, ArcelorMittal n’en est qu’aux balbutiements[1] [2] , loin des engagements pris. Il y a donc urgence à passer des projets aux travaux pratiques pour assurer un avenir à la production d’acier primaire en France.
Le groupe a présenté en 2021 un plan de réduction de son empreinte carbone insuffisant. En Europe, ce plan visait à décarboner partiellement la production réalisée avec des hauts fourneaux en les transformant en fours à arcs électriques pour fer réduits directement (« DRI-EAF »), une technologie peu novatrice qui remplace le charbon par le gaz et l’électricité[4]. Cette voie technologique reste carbonée et ne réduit que de 30 % l’empreinte carbone de la production par rapport aux hauts fourneaux. Contrairement à certains de ses concurrents (SSAB, Greensteel, Saltzgitter…), l’utilisation d’hydrogène à la place du gaz n’est pas envisagée par ArcelorMittal à court terme. Ce procédé permettrait pourtant d’envisager la neutralité carbone, à condition que l’électricité soit issue de moyens non carbonés.
Même sans parler du choix technologique, les projets de décarbonation ne portent que sur une partie de la production et prévoient d’en abandonner des parties. Ainsi, pour Dunkerque, le plan était de remplacer seulement les deux « petits » hauts fourneaux du site et de conserver en l’état le plus gros (50 % de la capacité de l’aciérie). À Fos-sur-Mer, un seul four électrique est à ce stade envisagé. Cela conduit à penser que l’aciérie passerait de 5,5 millions de tonnes (Mt) d’acier de capacité par an à environ 2 Mt et que l’approvisionnement en fer préréduit se ferait à l’extérieur du groupe, ce qui marquerait également la perte d’un pan d’activité du site. Les investissements d’un peu plus de 2 milliards d’euros initialement prévus par ArcelorMittal font pâle figure face aux plus de 6 milliards d’euros qui seraient nécessaires pour un plan de décarbonation véritablement ambitieux.
Non seulement le plan de décarbonation d’ArcelorMittal est insuffisant, mais l’entreprise semble tout faire pour différer et diminuer la portée de ces investissements. ArcelorMittal a signé début 2024 un contrat de 850 millions d’euros d’aides publiques pour un investissement total de 1,7 milliards d’euros à Dunkerque, comprenant la construction de deux fours électriques et d’une unité de réduction de fer. ArcelorMittal a dans un premier temps repoussé de deux ans la date de mise en service des fours à arcs électriques et n’a pas lancé les commandes nécessaires. Après le gel du plan annoncé il y a quelques mois, ArcelorMittal a finalement assuré le 15 mai 2025 investir 1,2 milliard d’euros sur le site de Dunkerque, un montant inférieur à celui prévu dans le contrat avec l’État. Un seul four électrique serait construit, sous conditions hypothétiques de nouvelles protections aux frontières européennes : une décarbonation au conditionnel et très partielle, sans préréduction du fer (probablement en se fournissant à l’étranger).
Une entreprise en bonne santé financière
Rappel des résultats
Il faut d’abord couper court au mythe d’une entreprise qui irait mal et n’aurait pas les moyens d’effectuer les investissements nécessaires à l’adaptation de son activité. Les années exceptionnelles de 2021 et 2022 ont vu tout le secteur engranger des superprofits historiques. ArcelorMittal n’a pas fait exception, avec 24 milliards d’euros de bénéfices en deux ans.
Les deux dernières années ont été celles d’un retour à la normale, avec des taux de profits plus communs, qui ont conduit à faire 2,2 milliards d’euros de bénéfices en deux ans, soit 26 milliards d’euros en quatre ans au niveau mondial.
La situation pourrait être résumée par la formule des « trois dix ».
- Sur les trois derniers exercices, ArcelorMittal a reversé à ses actionnaires plus de 10 milliards d’euros en dividendes et rachats d’actions.
- La première phase du plan de décarbonation mondial du groupe, qui inclut notamment les projets en pause à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, a été évaluée par la direction à 10 milliards d’euros.
- Le groupe a une situation financière particulièrement solide avec moins de 10 % d’endettement (6,7 milliards de dollars de dettes nettes sur plus de 100 milliards de dollars de capitaux propres) au premier trimestre 2025. Pour un groupe comme ArcelorMittal, c’est un niveau très faible qui lui laisse beaucoup de marges de manœuvre.
ArcelorMittal a donc les moyens d’amorcer ses projets de décarbonation, de les rendre plus ambitieux et de ne pas organiser un chantage aux aides publiques comme il l’a réalisé ces dernières années.
Quid du cas spécifique de la France, qui représente 12 % des effectifs du groupe ? Le récit gouvernemental et patronal évoque un déficit de compétitivité vis-à-vis d’autres pays qui justifierait les restructurations à répétition.
Les chiffres montrent en réalité le contraire, alors même qu’ils sont trafiqués pour faire apparaître les résultats les plus faibles possibles ! Rien ne justifie une telle urgence dans les restructurations. En sortie de Covid, entre 2021 et 2023, ArcelorMittal France a ainsi effectué 1,2 milliard d’euros de bénéfices en cumulé.
Sur les mécanismes d’optimisation fiscale
Le siège d’ArcelorMittal se trouve au Luxembourg pour des raisons historiques mais aussi pour éviter l’impôt. 30 % de ses filiales seraient localisées dans des paradis fiscaux selon l’Observatoire des multinationales[5]. ArcelorMittal utilise de fait de nombreux moyens pour faire remonter les potentiels bénéfices français vers la maison mère luxembourgeoise.
ArcelorMittal applique une stratégie d’évitement fiscal assumée qui passe par une politique très agressive en matière de prix de transfert[6]. Concrètement, Arcelor transfère vers le Luxembourg une partie significative des richesses produites sur le sol français, pour éviter qu’elles soient imposées en France. Sont ainsi facturés 1 % du chiffre d’affaires en royalties sur l’utilisation de la marque, 2 % de frais d’utilisation des brevets du groupe, tous détenus au Luxembourg, et enfin des frais de management importants censés rémunérer le travail des fonctions support de la maison mère. Ainsi, ce sont plus de 3 % du chiffre d’affaires qui sont chaque année siphonnés des activités en France pour éviter l’impôt.
La politique de prix de transfert est souvent pointée du doigt par l’administration fiscale tant sur les sites de production que dans l’activité de recherche et développement. Industeel Loire et Industeel Creusot, filiales d’Arcelor France, ont ainsi été épinglées par l’administration fiscale pour des prix de transfert abusifs de rétribution de la marque, constat confirmé par une décision du tribunal administratif[7].
De même, le centre de recherche de Maizières-lès-Metz est en redressement fiscal depuis de nombreuses années concernant les prix de transfert[8]. Par ailleurs, les brevets associés à cette activité ne sont pas localisés en France.
Au bout du compte, sur les cinq dernières années, non seulement ArcelorMittal France n’a payé au total aucun impôt sur les sociétés, mais l’entreprise s’est même fait rembourser 116 millions d’euros d’impôts !
Des aides publiques substantielles
La direction d’ArcelorMittal France elle-même a donné des éléments lors d’une audition au Sénat ne pouvant être soupçonnés d’être surestimés. En 2023, ArcelorMittal France a bénéficié de 298 millions d’euros d’aides publiques directes, dont 200 millions d’euros au titre de taux réduits sur les factures d’énergie, 40 millions d’euros en Crédit impôt recherche (CIR), 40 millions d’allègements de cotisations et 6 millions pour financer le chômage partiel. Ces aides sont récurrentes et donnent donc un ordre de grandeur crédible pour les années précédentes. Une aide de 850 millions d’euros était également prévue pour les prochaines années dans le cadre de la décarbonation d’une partie du site de Dunkerque.
En plus de l’argent versé par les administrations françaises, ArcelorMittal a bénéficié de plus de 5 milliards d’euros au niveau européen issus de la vente de quotas carbone en trop. Plutôt que de garder ses quotas pour assurer sa production à terme en Europe, ArcelorMittal en a fait un instrument financier en spéculant avec.
Que retenir de ce rapide état des lieux ?
Nous avons affaire à une entreprise qui :
- doit investir et décarboner son activité dans les quatre ans à venir. Compte tenu du temps de mise en œuvre, il y a urgence à le faire avant fin 2025.
- refuse de le faire alors qu’elle en a les moyens.
- diminue peu à peu sa présence en Europe et en France en particulier, laisse l’outil industriel se dégrader, siphonne au maximum la valeur créée en France et les aides publiques et fait une nouvelle fois du chantage pour obtenir toujours plus d’aides.
Une reprise de contrôle par l’État est donc justifiée par l’urgence des investissements dans la décarbonation à mener, conjuguée au refus des propriétaires actuels de les effectuer et à l’engagement public financier considérable déjà réalisé par l’État dans cet appareil de production.
Les paramètres de reprise de contrôle par l’État
L’exercice d’un contrôle de l’État peut prendre des formes, des modalités et un périmètre différents.
Les différentes modalités de prises de contrôle
Les exemples internationaux
Plusieurs États ont été confrontés à des défaillances et des déboires de la part de sidérurgistes. Certains d’entre eux ont pris des mesures pour imposer un contrôle sur les activités. Alors que le laissez-faire était plutôt la ligne majoritaire en Europe, le caractère stratégique de l’acier est revenu récemment en force sur le devant de la scène et a conduit à un début de remise en cause de ce dogme.
Le Royaume-Uni a ainsi organisé une forme de mise sous tutelle via l’adoption d’une loi dédiée le 12 avril 2025. L’État britannique a pris le contrôle du dernier site de hauts fourneaux du pays et s’est chargé d’assurer les salaires, la gestion des approvisionnements et flux logistiques, etc. Cela faisait suite à la décision de l’actionnaire chinois du site de le fermer. Cela aurait fait du Royaume-Uni l’unique pays du G7 sans production primaire d’acier. Pour assurer la pérennité du site et les investissements, un fonds de 3 milliards d’euros a été mis en place, notamment alimenté par les bénéfices de l’entreprise.
En 2024, l’État italien est aussi monté au capital d’Ilva, le plus grand site sidérurgique d’Europe à hauteur de 38 % (et 50 % des droits de vote), via un accord avec ArcelorMittal pour 400 millions d’euros. Sur le fondement d’un décret, il a ensuite dû mettre sous tutelle le site face au sous-investissement constaté d’ArcelorMittal[9]. Après une procédure judiciaire et collective, ArcelorMittal est privé de tous ses droits d’actionnaires et est sorti de la structure actionnariale d’Ilva. Cette nationalisation de fait s’est faite sans montée supplémentaire au capital ou rachat de la majorité des parts par l’État italien. Un repreneur est désormais recherché.
En décembre 2023, le complexe sidérurgique d’ArcelorMittal Termirtau a été nationalisé par le gouvernement kazakh suite à un accident qui a tué 46 mineurs. Alors qu’ArcelorMittal réclamait 3,5 milliards de dollars, le gouvernement l’a fait plier en divisant ce montant par 12, rachetant le site via un fonds d’investissement contrôlé par l’État pour 286 millions.
Il est d’ailleurs notable que les entreprises européennes de sidérurgie qui fonctionnent le mieux sont celles où l’État et/ou les salariés sont actionnaires et en position de peser sur les décisions.
Ainsi, le groupe suédois SSAB a l’État suédois à son capital via une entreprise minière publique (LKAB), mais aussi l’État finlandais. Une mutuelle proche des syndicats sudédois en est aussi un des actionnaires de référence. Le groupe autrichien VoestAlpine a comme deux premiers actionnaires (15 % et 15 %) des banques régionales coopératives et leurs salariés, tandis que le groupe allemand Salzgitter a une moitié de salariés dans son conseil d’administration. Ces deux groupes n’excluent pas de réorganiser leurs activités ici ou là mais ils poursuivent leur décarbonation et ne font pas du chantage à l’emploi.
Résumé des méthodes de reprise de contrôle par l’État
Méthode 1 : Imposer des obligations aux propriétaires par la loi
L’État pourrait imposer des contraintes ou une mise sous tutelle de certaines activités à ArcelorMittal par une loi dédiée. Il faut pour cela en décider le périmètre, par exemple un ou deux sites (Dunkerque et Fos-sur-Mer) où les enjeux sont les plus forts, et prévoir des investissements en conséquence. Cela est toutefois peu adapté aux activités françaises d’ArcelorMittal qui se déploient à de multiples points de la chaîne de valeur.
Méthode 2 : Trouver un accord avec ArcelorMittal sur une entrée au capital et un projet industriel
Il est possible de négocier avec ArcelorMittal l’entrée de l’État au capital pour tout ce qui concerne les activités spécifiquement françaises. Cela reviendrait à créer une forme de co-entreprise « Arcelor France ». L’État pourrait alors bénéficier d’un droit de veto via ce que l’on appelle une action spécifique ou golden share[10]. Le capital pourrait être ouvert aux salariés, aux collectivités, au pôle public bancaire.
Méthode 3 : Montée au capital du groupe monde ArcelorMittal
Le groupe ArcelorMittal est coté en bourse avec 60 % de capital flottant[11]. L’État pourrait alors monter au capital de l’ensemble du groupe, dont les activités se déploient sur toute la planète, avec ses opérateurs comme l’Agence des participations de l’État (APE) ou la Banque publique d’investissement (BPI). Une minorité de blocage[12] et le rang de premier actionnaire pourraient être obtenus avec un tiers du capital, tandis qu’il faudrait 51 % des parts pour en prendre le contrôle.
La montée au capital pourrait se faire avec d’autres États européens en rassemblant les activités « Europe ». Dans ce cas, il faudra atteindre une part du capital suffisant pour disposer d’une minorité de blocage. Cela est possible même avec une faible participation au capital, grâce à des dispositifs particuliers tels que les droits de vote double ou les actions spécifiques.
Méthode 4 : Nationalisation
La nationalisation implique un transfert total de propriété à l’État grâce à une loi dédiée. Ce n’est pas une simple montée au capital à 51 % d’une entreprise. La loi de nationalisation fixe elle-même le périmètre de reprise de contrôle par l’État ainsi que les critères pour déterminer le montant de l’indemnisation.
La question du périmètre du contrôle de l’État
Carte des installations d’ArcelorMittal sur le sol français
ArcelorMittal a en France plusieurs « ensembles » d’activités de production :
- Un ensemble « produits plats » est destiné au marché de l’automobile avec les aciéries de Dunkerque et de Fos. Ces deux sites disposent de lignes de laminage et de galvanisation, c’est-à-dire de réduction de l’épaisseur du métal et de protection contre la corrosion.
- Un ensemble « produits longs », à moins haute valeur ajoutée et de plus petite taille, avec des sites comme Gandrange ou Wire, qui ne disposent pas de leurs propres outils de fusion (hauts fourneaux ou fours).
- Un ensemble hétéroclite est logé dans la division « sustainable solutions » (solutions durables) avec notamment de la distribution et des productions pour l’automobile ainsi qu’une activité importante de finition pour le bâtiment (ArcelorMittal Construction, plus de 1000 salariés en France).
- Industeel est un sous-ensemble à l’autonomie plus avancée au sein d’ArcelorMittal. Il produit des alliages d’aciers spéciaux peu communs chez ArcelorMittal. Industeel sert les marchés stratégiques et de souveraineté comme les industries nucléaire et de défense. À cet égard, cette entité aurait toute sa place dans un périmètre de nationalisation.
- Enfin la situation du principal centre de recherche d’ArcelorMittal dans le monde, situé en banlieue de Metz, doit faire l’objet d’une réflexion spécifique. En effet c’est un actif déterminant tant pour un futur ensemble nationalisé que pour ArcelorMittal.Mais ce centre de recherche travaille fiscalement « à façon » pour le siège luxembourgeois : il ne possède pas les brevets sur lesquels ses chercheurs travaillent.
Cette question des actifs immatériels comme les brevets doit être approfondie pour la nationalisation : s’il peut apparaître difficile d’exproprier l’entité luxembourgeoise, une disposition relative à l’utilisation des brevets peut être inclue dans l’opération. Cela concerne moins les brevets liés aux techniques de production que ceux liés à des produits spécifiques, singulièrement dans les plats pour l’automobile. Plusieurs inventions françaises dans ce domaine (Usibor, Ductibor) donnent en effet à ArcelorMittal une position dominante auprès des constructeurs automobiles, notamment dans l’emboutissage à chaud.
La nationalisation la plus large possible émerge donc comme la solution la plus pérenne et posant le moins de difficultés. Elle permet d’avoir un ensemble industriel cohérent et viable et de ne pas être privé de notre souveraineté. Et elle ne nécessite qu’une loi pour être mise en place.
Les autres méthodes de prise de contrôle par la puissance publique ne suffiraient en effet pas. L’imposition de contraintes ou des mises sous tutelle par la loi pourrait s’envisager sur un ou deux sites précis mais semble peu adaptée à la multiplicité et la diversité des activités d’ArcelorMittal en France. De la même façon, la montée au capital au niveau mondial permet certes d’avoir une influence sur un plus large spectre d’activités, mais se heurte à la question du coût et implique une moindre contrôle sur les activités spécifiquement françaises. Enfin, la constitution d’une coentreprise pourrait constituer une solution intéressante mais il est évident que ArcelorMittal n’accepterait pas d’en discuter, à moins précisément d’être menacé de nationalisation.
Les enjeux financiers d’une nationalisation
Les travaux classiques pour établir la valeur d’actifs industriels mobilisent des ressources considérables qu’un article rapide ne peut qu’effleurer. Il s’agit donc ici de donner des ordres de grandeur cohérents et crédibles qui permettent de cadrer les débats sur la nationalisation.
La valeur estimée ne relève jamais d’une évaluation seulement « objective » : elle découle toujours d’une négociation et d’un rapport de forces entre les deux parties. On retrouve ainsi pour de mêmes actifs des montants divergents même dans des laps de temps court. Par exemple, l’entreprise américaine Cleveland Cliff a proposé en janvier 2025 une OPA[13] de 7 milliards d’euros pour racheter US Steel, quand Nippon Steel en a proposé 15 milliards d’euros quelques mois plus tard.
Néanmoins la sidérurgie est un secteur où l’information publique abonde si bien qu’il est possible de se faire une idée assez robuste d’un ordre de grandeur.
Le processus de nationalisation doit aussi préparer les conditions de la pérennité du futur ensemble. Chez ArcelorMittal comme dans de nombreuses multinationales, les entités légales ne constituent pas des périmètres opérationnels pertinents. Il s’agira de préparer les accords de transition (Transition Services Agreements ou TSA) pour assurer à court terme le maintien des fonctions nécessaires du périmètre nationalisé, et qui sont actuellement réalisées par des entités situées à l’étranger : fonctions support, fonctions commerciales, maintenance, système d’information, etc. Comme évoqué précédemment, la question des brevets devra aussi faire l’objet d’une attention particulière.
La nationalisation doit enfin prévoir dans le même temps les investissements nécessaires à la transformation de l’activité en particulier en matière de décarbonation.
Estimation de la valeur des activités d’ArcelorMittal en France
Nous raisonnons ici autour de la valeur d’entreprise et non de la valeur des simples titres financiers comme les actions. Autrement dit, nous nous appuyons sur l’activité concrète de l’entreprise, c’est-à-dire la valeur qu’elle génère[14].
Méthode 1 : patrimoniale
En un mot, il s’agit de regarder la valeur du patrimoine de l’entreprise. C’est une méthode comptable qui s’appuie sur la valeur des différents actifs de l’entreprise, nette de ses dettes. La situation nette comptable de l’entreprise était un des critères choisis lors des nationalisations de 1982, qui ont concerné la sidérurgie mais aussi le secteur des hautes technologies, le secteur de l’énergie et celui de la banque.
Elle pose plusieurs problèmes dans l’évaluation des activités d’ArcelorMittal en France. D’abord, elle ne donne aucune indication sur la rentabilité et la performance économique de l’entreprise. Surtout, elle est très peu adaptée aux grands groupes de ce genre. Les flux commerciaux et comptables entre les différentes entités et notamment en direction de la maison mère, qui concentre l’endettement par exemple, fausse l’image que reflète les bilans des entités françaises. Cela est particulièrement vrai pour les entités en bout de chaîne, elles-mêmes détenues par d’autres entités françaises. L’autre principale limite de cette méthode est que la valeur des parts qu’ArcelorMittal France détient dans d’autres entreprises est celle du coût d’achat, qui est totalement décorrélé de ce que cela vaut réellement aujourd’hui.
Avec l’ensemble de ces réserves, si l’on applique cette méthode aux entités ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée qui sont les plus importantes et qui détiennent d’autres entités, cela donne 1,4 milliard d’euros. Mais cette estimation laisse de côté plusieurs activités importantes comme Industeel, les activités pour la construction, les produits longs ou la distribution.
Méthode 2 : évaluation des bénéfices futurs attendus
Il s’agit d’évaluer l’argent que peut générer l’entreprise dans les années à venir. Cela se fait par une actualisation des flux de trésorerie que l’on peut prévoir. Cette méthode repose sur l’évaluation du cash attendu généré par l’entreprise dans les prochaines années. Il faut ensuite ajuster cette somme pour tenir compte du coût du financement de l’entreprise (coût moyen pondéré du capital). C’est la méthode la plus utilisée lors des opérations de fusion-acquisition[15] et dans les entreprises pour valider ou non des investissements.
Dans le cas d’ArcelorMittal France, les manipulations des prix de transfert pour évader une partie des bénéfices au Luxembourg complique les évaluations financières réalistes. Pour dépasser cet obstacle, et en considérant que les outils industriels pourraient rapidement de nouveau fonctionner de manière « normale », nous avons estimé un niveau de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (la norme comptable dit « EBITDA ») standard[16] en reprenant la profitabilité à la tonne moyenne d’ArcelorMittal en Europe[17].
En retenant par ailleurs des hypothèses financières prudentes (2 % de taux de croissance, 11 % de coût moyen pondéré du capital[18]) et des investissements de maintien de l’outil à 35 € / tonne hors projet de décarbonation, on obtiendrait une valeur d’entreprise d’environ 1,2 milliard d’euros pour ArcelorMittal France et 630 millions pour ArcelorMittal Méditerranée. Le reste des activités (Industeel, construction, produits longs, distribution, etc.) serait valorisé à 770 millions, soit un total d’environ 2,6 milliards d’euros.
Méthode 3 : comparaisons
En un mot, il s’agit de comparer l’entreprise avec des semblables. Cette méthode consiste à appliquer à certaines données de l’entreprise un multiple qui s’appuie sur des exemples comparables. C’est là encore un des moyens ayant été utilisés en 1982. C’est souvent la méthode la plus utilisée en première approche.
Toute la question est celle de l’indicateur retenu. On utilise le plus souvent l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) mais, compte tenu du caractère cyclique de la sidérurgie et des spécificités de chaque usine, il est difficile de dresser des comparaisons valables.
Dans la sidérurgie, comme dans d’autres industries lourdes, les comparaisons peuvent également se faire à l’aune d’indicateurs de production (tonnage par exemple). Ainsi, l’observation des cas des rachats des entreprises Stelco et de US Steel donne une valorisation d’environ 1 100 dollars par tonne de capacité d’acier brut. Ce montant est toutefois surestimé pour une application directe en France, compte tenu à la fois des perspectives économiques plus importantes aux États-Unis et des investissements nécessaires sur les sites d’ArcelorMittal pour relancer tout ou partie de la production. En prenant en compte ces facteurs et les principales opérations récemment menées par ArcelorMittal, nous pouvons utiliser une valorisation à 730 dollars par tonne.
En partant donc d’une capacité de 8,2 millions de tonnes par an en France, cela donnerait 6 milliards de dollars, soit 5,6 milliards d’euros pour ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée. Les tonnes produites par Industeel valent plus cher compte tenu de la spécialisation. En les valorisant à 1 000 dollars, Industeel est évalué à 200 millions d’euros. Pour la partie produits longs, en l’absence de comparable fiable, nous nous appuyons sur un multiple d’EBITDA de 5 qui donne moins de 100 millions d’euros (85 M€). Les activités construction et distribution sont difficilement évaluables avec cette méthode en l’absence de comparables indépendants facilement mobilisables.
Bilan
| Secteur des activités ArcelorMittal en France | Méthode | ||
| Patrimoniale | Évaluation des bénéfices futurs attendus | Comparaisons | |
| ArcelorMittal France (Dunkerque, Florange, Mardyck, Montataire, etc.) | 1,4 milliard d’€ | ~ 1,22 milliard d’€ | ≈ 3,73 milliards d’€ |
| ArcelorMittal Méditerranée (Fos-sur-Mer, St-Chély-d’Apcher, etc.) | ~ 629 millions d’€ | ≈ 1,85 milliard d’€ | |
| Industeel | Non applicable | ~ 260 millions d’€ | ~ 200 millions d’€ |
| Construction | Non applicable | ~ 250 millions d’€ | Données non accessibles |
| Produits long (Gandrange, Wire et Tubular) | Non applicable | ~140 millions d’€ | ~ 85 millions d’€ |
| Distribution et divers (AMDSF, AMCS, AMTBL) | Non applicable | ~120 millions d’€ | Non applicable |
| Total | Non pertinent | 2,6 milliards d’€ | 6,25 milliards d’€ |
L’indemnisation décidée dans le cadre d’une loi de nationalisation peut tout à fait mélanger plusieurs critères et méthodes. C’est par ailleurs le cas également dans les faits dans une opération financière privée de rachat. Selon l’article 27 de l’ordonnance du 20 août 2014, l’évaluation doit être « conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir ».
Ainsi, en faisant la moyenne des méthodes d’évaluation des bénéfices futurs attendus et par comparaison cela donnerait une proposition d’indemnisation de 4,4 milliards d’euros.
Cette valeur est un intervalle « haut ». Les évaluations sont en effetbrutes des investissements nécessaires pour, d’une part, rattraper le sous-investissement chronique et, d’autre part, assurer la part de décarbonation qui devait être financée directement par l’entreprise.
Ensuite, l’État possède des créances envers ArcelorMittal. ArcelorMittal France a par exemple 150 millions d’euros de dette fiscale et sociale en 2023.De plus,le montant conséquent des aides publiques attribuées ces dernières années a poussé la valorisation à la hausse en permettant à l’entreprise d’être plus rentable et de développer ses actifs.
Fixer la barre des 4 milliards d’euros comme une borne maximum pour la nationalisation d’ArcelorMittal semble donc raisonnable. Ce montant est indicatif. Les chiffres et les méthodes de calculs présentés jusqu’ici n’ont pas pour objectif de déterminer « scientifiquement » la valeur à laquelle on doit indemniser une entreprise – si tant est que cela soit possible. Ils permettent en revanche d’encadrer les négociations avec des éléments objectifs.
Comme évoqué en préambule de cette partie, le montant final de l’indemnité est le résultat d’un rapport de forces et d’orientations politiques. Pour toutes les raisons évoquées précédemment, tant l’argent déjà investi par la puissance publique dans l’appareil de production, que la manifeste mauvaise volonté de l’entreprise pour effectuer des investissements importants pour la souveraineté nationale, il est possible de faire tomber ce chiffre plus bas.
Cela constituerait une opération relativement importante pour l’Agence des participation de l’Etat (APE) mais pas du tout inédite. La renationalisation complète d’EDF en 2023 a coûté 9 milliards d’euros. L’augmentation du capital de la SNCF en 2020 a coûté 4 milliards d’euros.
Enfin, il faut insister sur le fait que la nationalisation est une condition nécessaire au maintien de l’activité et à sa transformation, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Il faudra en effet enclencher un plan ambitieux de décarbonation et d’adaptation des activités et accompagner ces investissements de mesures de protection : quotas réduits d’importation sur l’acier extra-européen, mécanisme de taxation du carbone aux frontières réellement efficace, possibilité de privilégier l’acier local dans les marchés publics, etc. De cette manière, l’activité sera pérenne et rentable. La nationalisation est donc la condition de construction d’un projet pérenne et rentable.
Comparaison avec la montée au capital du groupe au niveau mondial
Il est moins coûteux pour l’État de nationaliser ArcelorMittal plutôt que d’en devenir seulement un actionnaire plus important ! Une prise de participation à hauteur de 33 % pour avoir une minorité de blocage coûterait en effet 7,6 milliards sur le papier.
En réalité, cela nécessite de passer par une OPA, ce qui pousse le prix à la hausse selon deux facteurs : la hausse du cours provoquée par l’annonce d’une OPA, puis la prime payée aux actionnaires pour accepter l’offre. En ajoutant 40 % de ce fait au cours de bourse et en incluant la prime de 30 % plus des frais de procédures, la facture totale s’élèverait à plus de 14 milliards d’euros. De même, devenir actionnaire majoritaire coûterait autour de 21 milliards d’euros.
Les coûts du laisser-faire
Le coût à court terme d’une nationalisation doit nécessairement être mis en regard des coûts engendrés par la poursuite du délitement d’ArcelorMittal.
Les économistes Tristan Auvray et Thomas Dallery reprennent les chiffres de la BPI indiquant que pour 1 emploi industriel, 1,5 emploi indirect et 3 emplois induits en sont dépendants. Nous pouvons sur cette base estimer grossièrement les coûts des plans de suppression d’emplois. Comme ils le rappellent, il est évident que l’intégralité des emplois supprimés ne va pas se traduire par un chômage équivalent mais les personnes qui resteront au chômage passeront par d’autres dispositifs coûteux pour l’État qu’il est difficile d’évaluer.
Un premier périmètre est celui des 1 000 suppressions d’emplois directs annoncées dans l’année. Sur la base des cotisations versées par ArcelorMittal France dans ses comptes sociaux, le manque à gagner s’élève à 25 millions d’euros par an. Les indemnités chômage coûteraient jusqu’à 12 millions d’euros par an en prenant la moyenne des indemnités nettes. En prenant en compte l’ensemble des emplois indirects et induits, le coût pourrait atteindre jusqu’à 230 millions d’euros par an.
Mais l’enjeu dépasse les suppressions de postes déjà annoncées. Dans un scénario catastrophe où les 15 000 emplois du groupe en France seraient en jeu, les coûts exploseraient pour les administrations publiques. En prenant en compte les emplois indirects et induits, l’impact s’élèverait potentiellement à 2,1 milliards d’euros pour les cotisations et 1 milliard d’euros pour le chômage par an.
À cela s’ajoutent les revenus dégagés par ArcelorMittal en France, en moyenne 300 millions de bénéfices par an sur les trois dernières années. Ce montant pourrait être plus élevé sans la manipulation des prix de transfert à des fins d’optimisation fiscale. Même s’il devra avant tout être employé à financer les investissements, cela représente un gain par rapport à la richesse exfiltrée vers le Luxembourg pour être versée aux actionnaires.
Quelles ressources mobiliser ?
Le débat sur la nationalisation d’ArcelorMittal se focalise uniquement sur l’impact direct sur les finances publiques, en période de déficit public significatif. Mais en réalité l’intégralité de cette somme n’a pas forcément vocation à être prise en charge directement par des administrations publiques. En particulier, la Banque publique d’investissement, qui consacre 4 milliards d’euros par an à des investissements directs, pourrait prendre au moins en partie en charge de l’investissement.
Pour le reste, si le recours à la dette constitue en soi une solution tout à fait adaptée puisqu’il s’agit d’un investissement, un certain nombre de pistes de financement peuvent être proposées. Il est évident qu’une réforme globale de la fiscalité faisant contribuer à une plus juste hauteur les plus riches et les multinationales dégagerait des ressources amplement suffisantes. Nous nous contenterons donc ici d’esquisser des mesures exceptionnelles correspondant à l’ordre de grandeur en jeu et susceptibles d’être mises en place rapidement.
Proposition n°1 : Renforcement de la taxe exceptionnelle sur les armateurs maritimes
Les armateurs maritimes bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire qui substitue à l’impôt sur les sociétés une taxe forfaitaire sur le poids des navires. Cela représente un cadeau fiscal massif depuis l’explosion des profits dans le sillage de la crise sanitaire. Près de 10 milliards d’euros ont été ainsi offerts sur les années 2022 et 2023. Le ralentissement de l’activité a réduit le montant du cadeau à environ 600 millions d’euros en 2024, mais il sera vraisemblablement plus élevé en 2025.
Nous pouvons aussi, dans le souci de proposer un financement exceptionnel, a minima passer par le renforcement de la taxe exceptionnelle sur les bénéfices instaurée sur 2025 et 2026. Le rehaussement de son taux, ou bien le déplacement de son assiette vers d’autres indicateurs, par exemple le chiffre d’affaires, permettrait de récupérer une partie des cadeaux extravagants faits ces dernières années et de financer la nationalisation d’ArcelorMittal.
Proposition n°2 : Réhausser la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Le dernier budget a instauré une contribution exceptionnelle des grandes entreprises sous forme de surtaxe d’impôt sur les sociétés qui porte sur 2025 puis est réduite de moitié en 2026 avant de s’éteindre. Bercy en estimait les recettes à 8,5 milliards d’euros en année pleine.
Il suffirait donc soit d’ajuster le montant en 2026 en maintenant le niveau de surtaxe de 2025, ou bien de retarder l’extinction de la moitié de surtaxe d’un an. Pour rappel, les taux d’impôt sur les sociétés finaux incluant la surtaxe la plus élevée restent inférieurs à celui qui était en vigueur avant la baisse décidée par Macron en 2017. La contribution ne touche de plus que les plus grands groupes, et avant tout ceux avec les meilleures performances économiques.
Proposition n°3 : Instaurer une contribution exceptionnelle sur les dividendes et rachats d’actions des grandes entreprises
Les grandes entreprises françaises battent chaque année des records de montants reversés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions : 100 milliards d’euros seulement pour les sociétés du CAC 40. Une loi de finances pourrait ainsi intégrer une taxation exceptionnelle de quelques pourcents sur les sommes versées aux actionnaires par les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
