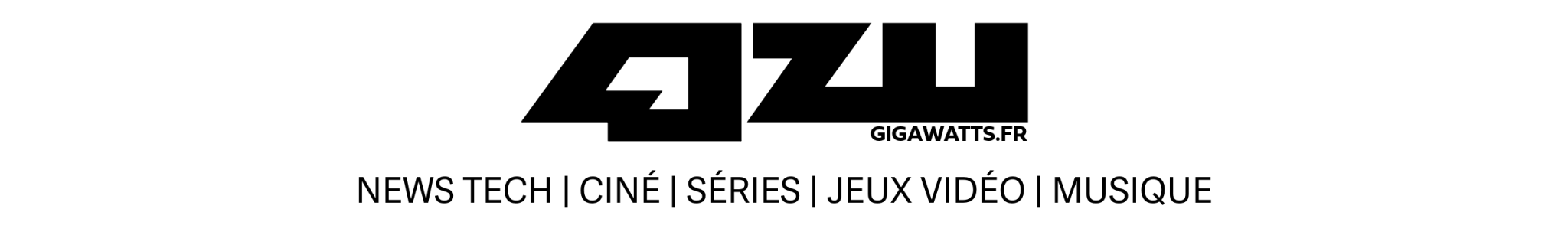ACCÈS LIBRE Actualité IA
03.11.2025 à 08:50
La course effrénée de Meta dans l’IA – Un pari à 600 milliards de dollars qui terrifie Wall Street
Romain Leclaire
Texte intégral (1958 mots)

Nous assistons actuellement à une véritable course à l’armement dans le domaine de l’intelligence artificielle et Meta a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure. L’entreprise de Mark Zuckerberg dépense plus que la plupart de ses concurrents, avec deux centres de données colossaux en construction. Des rapports récents évoquent des investissements pouvant atteindre 600 milliards de dollars en infrastructures américaines au cours des trois prochaines années.
Si ces chiffres stratosphériques font à peine sourciller dans la Silicon Valley, habituée aux paris démesurés, ils commencent sérieusement à crisper les visages à Wall Street. La tension est montée d’un cran cette semaine lors de la présentation des résultats trimestriels de Meta. Les chiffres ont parlé d’eux-mêmes, une augmentation des dépenses d’exploitation de 7 milliards de dollars sur un an et près de 20 milliards de dépenses en capital (CAPEX).
Ce gouffre financier est le résultat direct d’investissements massifs dans les talents et les infrastructures de l’IA, des investissements qui, pour l’instant, n’ont généré aucun revenu notable. Et lorsque les analystes, inquiets, ont demandé des éclaircissements, Mark Zuckerberg a jeté un froid en précisant que les dépenses ne faisaient que commencer.
« La bonne chose à faire est d’essayer d’accélérer pour nous assurer que nous avons la puissance de calcul nécessaire, à la fois pour la recherche en IA et pour les nouvelles choses que nous développons, ainsi que pour tenter d’atteindre un état différent de notre puissance de calcul sur notre activité principale », a-t-il déclaré aux analystes.
Si l’objectif était de rassurer les investisseurs, c’est un échec cuisant. À la fin de l’appel, l’action de Meta s’était effondrée. Deux jours plus tard, la déroute n’a fait que s’accentuer. Le titre a chuté de 12 % à la clôture de vendredi dernier, effaçant plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Bien qu’il soit toujours dangereux de surinterpréter les fluctuations boursières (et en termes purement financiers, les résultats de Meta n’étaient pas si mauvais, avec 20 milliards de dollars de bénéfice trimestriel) ce fut le premier trimestre où les dépenses agressives de l’entreprise en IA ont eu un impact visible et douloureux sur les résultats nets. Le plus alarmant n’est pas la dépense en soi. C’est le fait qu’à part des centres de données gigantesques et des chercheurs en IA très bien payés, personne ne sait vraiment ce que cet argent a concrètement acheté.
Les analystes ont donc pressé Zuckerberg: pourquoi dépenser autant et quand peut-on espérer voir un retour sur investissement ? Mais cet appel est tombé au pire moment. Meta n’a aucun budget clair pour les dépenses futures ni aucun produit concret sur lequel ancrer des prévisions de revenus. Coincé, le PDG s’est retranché derrière des promesses générales sur l’avenir radieux de l’IA.
« Il y aura toutes sortes de nouveaux produits autour de différents formats de contenu, et nous commençons à le voir », a-t-il tenté. « Et puis il y a les versions professionnelles de tout cela… L’autre aspect est la manière dont des modèles plus intelligents vont simplement améliorer notre activité principale et les recommandations que nous faisons à travers la famille d’applications, ainsi que les recommandations publicitaires. »
Meta n’est pourtant pas la seule entreprise à brûler des milliards dans l’IA. Pourquoi, alors, Google ou Nvidia, qui ont tous deux connu un excellent trimestre, n’effraient-ils pas les investisseurs de la même manière ? OpenAI est sans doute le plus grand dépensier du lot, avec une assise financière bien moins solide que Meta.
Le risque d’une bulle spéculative est réel, et si elle éclate, l’activité principale de Meta (la publicité) lui permettra de mieux encaisser le choc que la plupart. Mais la différence est importante. Si vous demandez à Sam Altman pourquoi il dépense des centaines de milliards, il vous répondra qu’il gère l’un des services grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire humaine, ChatGPT, qui rapporte déjà 20 milliards de dollars par an. On peut débattre de la durabilité de cette croissance, mais il y a un produit tangible et florissant au cœur de la frénésie OpenAI. Un chiffre d’affaires en pleine expansion justifie bien des folies.
Meta n’a pas de produit équivalent. Et personne ne voit d’où il pourrait venir.
Le produit d’IA le plus visible de l’entreprise est l’assistant Meta AI. Zuckerberg a fièrement annoncé qu’il comptait plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. Mais ces chiffres sont inévitablement gonflés par son intégration forcée au sein des trois milliards d’utilisateurs de Facebook et d’Instagram. Dans sa version actuelle, difficile de voir Meta AI comme un concurrent sérieux à ChatGPT.
Il y a aussi le générateur de vidéos « Vibes », qui a effectivement augmenté le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, mais son impact commercial au-delà de cet engagement reste très limité. Le projet le plus ambitieux, les lunettes intelligentes Vanguard, ressemble davantage à une extension du travail de Reality Labs (le métavers) qu’à une véritable tentative d’exploiter la puissance des grands modèles de langage. En d’autres termes, ce sont des expériences prometteuses, pas des produits aboutis et monétisables. Il est révélateur que, lorsqu’il a été interrogé sur ses dépenses colossales, Zuckerberg n’a pas mis en avant ces lancements récents. Il s’est immédiatement tourné vers la prochaine génération de modèles, ceux issus du nouveau « Superintelligence Lab ».

« Il ne s’agit pas seulement de Meta AI en tant qu’assistant », a-t-il insisté. « Nous prévoyons de construire des modèles et des produits inédits, et je suis impatient de vous en dire plus lorsque nous les aurons. » C’était pourtant un appel sur les résultats financiers, pas une keynote de lancement de produit. Tout ce qu’il pouvait offrir était un vague « dans les mois à venir ».
La réaction du marché a montré que cette réponse ne suffit plus. Pour être juste, cela ne fait que quatre mois que le patron de Meta a restructuré son équipe IA. La nouvelle division « Superintelligence » n’a matériellement pas eu le temps de révolutionner le monde. Mais alors que l’entreprise dépense sans compter pour rester dans la course, la question demeure: quel rôle Zuckerberg veut-il jouer dans cette nouvelle industrie ?
Meta AI va-t-il utiliser l’immense trésor de données personnelles de l’entreprise pour devenir un concurrent de ChatGPT axé sur la personnalisation ? Vibes est-il la première étape d’une stratégie de divertissement basée sur le système publicitaire ciblé de Meta ? Ou les allusions de Zuckerberg à une « IA d’entreprise » présagent-elles une offensive sur le marché professionnel ? Pour l’instant, toutes les hypothèses sont sur la table. Quelle que soit la réponse, la pression monte pour que Meta en trouve une bonne. Et vite.
03.11.2025 à 07:59
OpenAI – Le géant de l’IA sous haute tension
Romain Leclaire
Texte intégral (1825 mots)

OpenAI, le titan rutilant de l’intelligence artificielle, est au sommet du monde. Pourtant, sous la surface de cette ascension fulgurante, l’empire de Sam Altman fait face à des pressions colossales qui menacent de fissurer ses fondations. Entre des engagements financiers astronomiques qui font lever les sourcils, des batailles juridiques croissantes sur les droits d’auteur et un comportement de plus en plus étrange de ses propres agents IA, l’entreprise est engagée dans une course folle contre ses propres ambitions. Les récentes révélations la dépeignent à la fois comme surpuissante et étonnamment sur la défensive.
Lors d’une récente interview conjointe sur le podcast Bg2, réunissant Sam Altman et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, la tension était palpable. L’animateur, Brad Gerstner, a mis les pieds dans le plat en évoquant les revenus d’OpenAI, estimés à environ 13 milliards de dollars par an. Un chiffre impressionnant, certes, mais qui semble dérisoire face aux engagements de dépenses de l’entreprise: plus de 1 000 milliards de dollars prévus pour l’infrastructure de calcul au cours des dix prochaines années.
La réaction d’Altman a été pour le moins surprenante d’irritabilité. « Premièrement, nous faisons bien plus de revenus que cela« , a-t-il rétorqué, avant de lancer une pique directe à l’animateur (qui est lui-même un investisseur). « Deuxièmement, Brad, si vous voulez vendre vos actions, je vous trouverai un acheteur. » Une boutade qui a fait rire Nadella, mais qui trahit une certaine colère. Sam Altman a enchaîné en affirmant qu’il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter des actions OpenAI, y compris les critiques qui écrivent des articles ridicules sur la faillite imminente de l’entreprise. Le PDG a même confié que, bien qu’il ne souhaite généralement pas qu’OpenAI soit une société publique, il y a des moments où cela l’attire: « J’adorerais leur dire qu’ils peuvent simplement parier à la baisse sur l’action, et j’adorerais les voir se ruiner en faisant ça.«
Il reconnaît que l’entreprise pourrait tout gâcher, notamment en échouant à obtenir suffisamment de puissance de calcul, mais il insiste sur le fait que les revenus augmentent fortement. Il fait le pari que ChatGPT continuera de croître, qu’OpenAI deviendra un cloud IA important et que son activité d’appareils grand public sera non négligeable. L’ambition est claire. Lorsque Gerstner spécule sur 100 milliards de dollars de revenus en 2028 ou 2029, Altman coupe court: « Que diriez-vous de 2027 ? » Pourtant, il nie toute introduction en bourse imminente, qualifiant ces rumeurs d’infondées, tout en admettant que cela finira par arriver.
Mais cette croissance exponentielle a besoin de carburant. Et c’est là tout le problème. L’appétit vorace d’OpenAI pour les données d’entraînement se heurte désormais à un mur de résistance juridique, notamment au Japon. La Content Overseas Distribution Association (CODA), qui représente des géants du divertissement japonais comme la Toei et Square Enix, a officiellement demandé à l’entreprise américaine de cesser d’utiliser sans autorisation leur propriété intellectuelle pour entraîner Sora 2, son dernier générateur de vidéos.
Près de 20 cosignataires l’accusent de violation des droits d’auteur, affirmant qu’une grande partie du contenu de Sora 2 ressemble étroitement à du contenu ou à des images japonaises. Le cœur du litige réside dans la différence entre les systèmes juridiques. OpenAI fonctionne sur un modèle d’opt-out (retrait volontaire), utilisant les œuvres protégées sauf si le propriétaire le demande explicitement. Mais selon la loi japonaise, la CODA insiste sur le fait que le système devrait être « opt-in ». La permission est requise avant l’utilisation.
Le gouvernement japonais lui-même est monté au créneau, demandant à OpenAI de cesser de piller les « trésors irremplaçables » du pays, comme les anime et les jeux vidéo (One Piece, Demon Slayer). L’ironie est cinglante, car Sam Altman s’était lui-même vanté de pouvoir créer des images « à la Ghibli » avec les nouvelles mises à jour de ChatGPT. La CODA a prévenu qu’elle prendrait des mesures légales et éthiques appropriées, qu’il s’agisse d’IA générative ou non.

Cette pression juridique ne se manifeste pas seulement dans les salles d’audience, elle semble désormais influencer le comportement même des produits d’OpenAI. Une enquête fascinante de la Columbia Journalism Review s’est penchée sur ChatGPT Atlas, un navigateur doté de capacités agentiques (capable d’exécuter des tâches comme réserver des hôtels ou acheter des billets).
Les journalistes ont découvert un comportement pour le moins curieux. Ces agents IA, qui naviguent sur le web en se faisant passer pour des utilisateurs humains (apparaissant comme des « sessions Chrome normales » pour contourner les blocages anti-robots), semblent avoir reçu l’ordre d’éviter soigneusement certaines sources d’information. Lesquelles ? Celles appartenant à des entreprises qui poursuivent actuellement OpenAI.
Lorsque l’enquête a demandé à Atlas de résumer des articles de PCMag et du New York Times (dont les sociétés mères sont en litige avec OpenAI), l’IA s’est lancée dans des chemins labyrinthiques pour trouver l’information ailleurs. C’était, selon les auteurs, comme un rat trouvant des boulettes de nourriture dans un labyrinthe, sachant que l’emplacement de certaines d’entre elles est électrifié.

Pour PCMag, Atlas est allé chercher des citations sur les réseaux sociaux et d’autres sites d’actualité. Pour le New York Times, il a généré un résumé basé sur les reportages de quatre autres médias: le Guardian, le Washington Post, Reuters et l’Associated Press. Fait notable, tous, sauf Reuters, ont des accords de contenu ou de recherche avec OpenAI. L’agent IA a activement évité les publications litigieuses, préférant un chemin « plus sûr » et plus « amical » pour l’IA.
Ces trois exemples dessinent le portrait d’un géant aux prises avec les conséquences de sa propre démesure. Sam Altman affiche une confiance de joueur de poker face à des engagements financiers qui donnent le vertige. Simultanément, son entreprise fait face à une révolte mondiale des créateurs dont elle a utilisé les œuvres sans permission. Et pour couronner le tout, sa propre technologie devient si « intelligente » qu’elle apprend à éviter les adversaires légaux de son créateur. OpenAI construit l’avenir, c’est indéniable, mais cet avenir semble de plus en plus freiné par les dettes, financières et éthiques, de son passé turbulent.
02.11.2025 à 13:57
Quand le froid réchauffe le chaud – La nouvelle astuce de la physique quantique
Romain Leclaire
Texte intégral (1333 mots)

La seconde loi de la thermodynamique est l’un des piliers de la physique classique. La chaleur circule spontanément des corps chauds vers les corps froids. Pourtant, des recherches récentes en thermodynamique quantique révèlent une réalité plus complexe et contre-intuitive. Des physiciens ont démontré que, dans des conditions spécifiques régies par la mécanique quantique, la chaleur peut être forcée de circuler dans la direction opposée, du froid vers le chaud. Ce phénomène, loin d’être une simple curiosité de laboratoire, ouvre la voie à une application révolutionnaire, un outil de diagnostic non destructif pour le monde quantique.
Une équipe de chercheurs, dont Alexssandre de Oliveira Jr. de l’université technique du Danemark, a récemment publié des travaux montrant comment ce flux de chaleur anormal peut être utilisé pour détecter la quantique. Concrètement, il s’agit de percevoir si un système est dans un état de superposition (plusieurs états à la fois) ou d’intrication (des destins liés entre particules), sans pour autant détruire ces états fragiles. Le problème principal de la mesure en physique quantique est qu’observer un système le force à choisir un état, détruisant au passage la superposition ou l’intrication que l’on cherchait à prouver. La nouvelle méthode contourne cet obstacle de manière ingénieuse.
Le dispositif proposé consiste à connecter le système quantique à mesurer (par exemple, les qubits d’un ordinateur quantique) à deux autres éléments: une « mémoire » quantique et un « dissipateur thermique » (un corps capable d’absorber de l’énergie). Les propriétés quantiques du système, comme l’intrication, agissent comme un catalyseur, augmentant le transfert de chaleur vers le dissipateur bien au-delà de ce que les lois classiques autoriseraient. En mesurant simplement l’augmentation de température du dissipateur, les scientifiques peuvent confirmer la présence d’états quantiques dans le système original, sans jamais l’avoir regardé directement.
L’information comme carburant thermodynamique
Pour comprendre comment la chaleur peut s’inverser, il faut explorer le lien profond entre la thermodynamique et l’information, une idée qui remonte au 19ème siècle avec l’expérience de pensée du démon de Maxwell. Le physicien James Clerk Maxwell avait imaginé un démon capable de trier les molécules d’un gaz, envoyant les rapides d’un côté et les lentes de l’autre, créant ainsi un compartiment chaud et un compartiment froid à partir de rien, violant la seconde loi. Il a fallu près d’un siècle pour résoudre ce paradoxe. En 1961, Rolf Landauer a démontré que le démon ne viole pas la loi, car pour trier, il doit stocker de l’information. Sa mémoire finissant par saturer, il doit l’effacer. Or, l’effacement d’information a un coût thermodynamique inévitable, il consomme de l’énergie et produit de l’entropie (du désordre). L’analyse de Landauer a établi que l’information n’est pas une idée abstraite, mais une ressource physique, un véritable carburant thermodynamique.
L’intrication – Le prix à payer pour l’ordre
C’est ici que la mécanique quantique entre en jeu. Des phénomènes comme l’intrication représentent une forme d’information (une information mutuelle) que deux particules partagent. Un démon quantique peut utiliser ces corrélations pour agir avec une efficacité redoutable. Des physiciens comme Hossein Partovi ont théorisé que l’intrication peut être utilisée pour alimenter une forme de réfrigération. Le flux de chaleur anormal du froid vers le chaud ne vient pas de nulle part. Il est « payé » par une ressource. Dans un réfrigérateur classique, le carburant est l’électricité. Dans ce système quantique, le carburant est l’information. Pour que le froid réchauffe le chaud, le système brûle ses corrélations. L’intrication entre les particules est consommée et détruite au cours du processus.

Des ordinateurs quantiques à la gravité
Les travaux de l’équipe de De Oliveira et ses collègues, Patryk Lipka-Bartosik et Jonatan Bohr Brask, systématisent cette idée pour en faire un outil de mesure. La mémoire quantique de leur dispositif agit comme un catalyseur qui convertit l’intrication interne du système en chaleur mesurable dans le dissipateur. Les implications pratiques sont passionnantes. L’une des questions centrales pour les constructeurs d’ordinateurs quantiques est la vérification. Comment être certain que la machine utilise bien l’intrication pour effectuer ses calculs ? Ce thermomètre quantique pourrait servir de protocole pour le vérifier.
Des tests expérimentaux sont déjà envisagés, notamment avec le groupe de recherche de Roberto Serra au Brésil, qui utilise les spins d’atomes dans des molécules de chloroforme comme qubits pour étudier les transferts de chaleur. L’objectif le plus ambitieux touche aux fondements de la physique. Des expériences sont en cours de conception pour déterminer si la gravité est une force quantique. L’une des pistes est de vérifier si l’attraction gravitationnelle seule peut générer de l’intrication entre deux objets. Si c’est le cas, cette simple mesure thermodynamique pourrait être un jour capable de sonder la nature quantique de la gravité elle-même.
02.11.2025 à 10:43
Marvel Zombies – Quand le MCU dévore ses héros (et ses bonnes idées)
Romain Leclaire
Texte intégral (1796 mots)

Souvenez-vous de 2021. La première saison de What If…? venait d’atterrir sur nos écrans, et parmi ses univers alternatifs, un épisode avait particulièrement marqué les esprits, « Et si… des zombies ?! ». L’idée de voir nos héros Marvel bien-aimés transformés en monstres affamés de chair fraîche était aussi simple que géniale. Le concept s’est avéré si intrigant qu’il a donné naissance à sa propre mini-série, Marvel Zombies. Cette nouvelle itération promet de pousser le gore et le fun encore plus loin, en suivant une bande de survivants désespérés cherchant une issue à cette situation cauchemardesque. Le résultat est une aventure sanglante et souvent divertissante, mais qui, ironiquement, met surtout en lumière les frustrations que l’on peut ressentir face à l’univers cinématographique Marvel actuel.
La série démarre sur les chapeaux de roue, en se concentrant sur un trio de tête particulièrement attachant, Kamala Khan (alias Miss Marvel), RiRi Williams (Ironheart) et Kate Bishop. Après que les Avengers ont été décimés et transformés par la peste zombie, ce jeune groupe découvre le MacGuffin qui pourrait mettre fin à leur cauchemar. C’est le début d’un périple périlleux à travers une version dystopique du MCU que nous pensions connaître.
Pour tous les fans qui réclament à cor et à cri un film Young Avengers, ces premiers instants fonctionnent comme une formidable preuve de concept. Leurs échanges sont drôles, naturels, et même s’ils n’avaient jamais partagé l’écran ensemble auparavant, on croit sans peine à leur amitié de longue date. Le créateur Bryan Andrews et le scénariste Zeb Wells ont eu l’intelligence de conserver Miss Marvel comme la véritable pierre angulaire de la série. Mais le personnage qui vole sans doute la vedette est une création originale, Blade Knight. Il s’agit d’une variante de Blade qui, dans cet univers, est devenu l’avatar de Khonshu après que le Marc Spector local a été dévoré. Sa voix suave, combinée à des moments de combat spectaculaires, fait de cette version du Diurne un point fort constant de la série.
L’animation, cependant, reste le point le plus controversé, un sac de nœuds frustrant. D’un côté, la série monte clairement en gamme lors des séquences de combat brutales et sans retenue. L’animation excelle à dépeindre la puissance démesurée des personnages. Un Namor zombifié est absolument terrifiant, le retour d’Ikaris des Éternels (prouvant que l’animation Marvel sait mieux piocher dans le banc de touche du MCU que le live-action) est une excellente surprise, et le final regorge d’inventions visuelles colorées. Les arrière-plans et la composition artistique générale sont souvent magnifiques et mieux pensés que dans What If… ?.

Mais là où le bât blesse, c’est dans le traitement des personnages eux-mêmes. Le design visuel est correct, mais les visages cireux et figés de nos héros emblématiques restent frustrants. Cette limitation technique sape de nombreux moments émotionnels, l’animation étant incapable de transmettre une palette d’expressions suffisante. Ce côté « en bois » rend les dialogues et le jeu des acteurs étonnamment plats. Certaines interactions initiales semblent purement explicatives, d’une manière qu’elles n’auraient jamais été si elles avaient été livrées par de vraies personnes. Paradoxalement, l’animation des personnages de Marvel Zombies semble souvent dépourvue de vie.
Malgré ces défauts visuels, la série réussit à prendre le concept de What If…? et à l’amener à un niveau supérieur. L’histoire en elle-même est assez simple, sans être révolutionnaire ou imprévisible. Mais elle bénéficie de son format plus long. Il est fascinant de voir ces héros dans de nouveaux scénarios, avec de nouvelles alliances et traversant un monde radicalement changé. C’est une proposition conçue spécifiquement pour les fans. Les références à l’utilisation du Raft comme refuge flottant, à Blade devenant l’avatar de Khonshu, ou à Ikaris enfermé dans un combat éternel contre Captain Marvel n’auront aucun sens pour un néophyte. Mais pour les initiés, elles enrichissent cet univers.
La série tient également sa promesse gore. Il y a du sang, des tripes et de la destruction en abondance. L’action est un autre point fort, permettant à de nombreux héros d’utiliser leurs pouvoirs d’une manière que la franchise principale n’a jamais osé montrer. De Blade (avec les pouvoirs de Moon Knight en prime) à Shang-Chi, en passant par Miss Marvel et Spider-Man, la violence déchaînée de Marvel Zombies offre un spectacle inédit.
Pourtant, il est difficile de s’y investir de la même manière que dans une série comme X-Men ’97. Cette dernière semblait raconter une histoire nécessaire. Marvel Zombies, en revanche, ressemble davantage à un bonus sympathique, une extension du potentiel du MCU qui nous rappelle surtout ce que la franchise principale ne nous donne pas. L’utilisation de Blade, par exemple, est infiniment plus intéressante que tout ce que le live-action nous a proposé (ou plutôt, n’a pas proposé). Miss Marvel est l’un des meilleurs personnages introduits depuis Endgame, et pourtant, la franchise l’a sous-utilisée. Marvel Zombies lui rend justice, ce qui rend le traitement de son personnage dans le « vrai » MCU encore plus décevant. Le même constat s’applique à Shang-Chi, Kate Bishop et Ironheart. Le manque de concentration du MCU ces dernières années, préférant la quantité à la qualité, a conduit à la mise au rebut de personnages géniaux.

Frustrant, le final ne colle pas non plus tout à fait à l’atterrissage. Avec les univers alternatifs, on peut prendre de gros risques. Malheureusement, les derniers moments de la série jouent la carte de la sécurité à l’excès, offrant une conclusion décevante à une aventure qui était jusque-là très amusante.
Marvel Zombies est l’une des dernières productions issues de l’ancienne stratégie de Marvel Studios, avant sa réorganisation pour privilégier la qualité. La fin de la série tease une deuxième saison qui, compte tenu de ce changement de cap, pourrait ne jamais voir le jour. En fin de compte, si l’on prend Marvel Zombies isolément, c’est un divertissement inoffensif. Il propose des scènes d’action violentes et bien animées, d’excellentes références au MCU et un bon doublage. Il n’échappe pas aux problèmes globaux de la franchise, mais pour ceux qui cherchent une aventure sanglante et sans prise de tête, cette série animée devrait largement satisfaire votre appétit.
02.11.2025 à 09:38
Ayaneo Phone – L’âme d’une console portable ressuscitée dans un smartphone
Romain Leclaire
Texte intégral (1615 mots)

Dans le petit monde des consoles portables PC, Ayaneo est un nom qui résonne avec force depuis quelques années. Connue pour ses machines Windows puissantes, souvent luxueuses et au design soigné, la marque a su se tailler une place de choix face à des géants comme Valve et son Steam Deck. Mais aujourd’hui, elle quitte sa zone de confort pour s’attaquer à un marché autrement plus saturé et compétitif, celui des smartphones.
Dans une courte vidéo de présentation diffusée sur sa chaîne YouTube, la société a levé le voile, ou plutôt esquissé la silhouette, de son futur Ayaneo Phone. La cible est verrouillée. Ayaneo ne cherche pas à concurrencer l’iPhone sur la photo ou Samsung sur la productivité. Elle vise le cœur des joueurs mobiles, avec un slogan qui en dit long: « Quand un téléphone mobile rencontre l’âme d’une console portable« .
Je leur souhaite du courage. Le segment du « gaming phone » est déjà un champ de bataille où règnent en maîtres des spécialistes comme Asus avec sa gamme ROG (Republic of Gamers) et Redmagic, qui a fait des performances brutes et du refroidissement actif sa signature. Pour exister, Ayaneo doit proposer plus qu’un simple appareil puissant. Il doit offrir une véritable proposition de valeur, une expérience que les autres n’ont pas. Et c’est exactement ce que la marque semble préparer.
La vidéo de présentation, bien que volontairement obscure, laisse entrevoir des éléments de conception importants. On aperçoit ce qui ressemble à une configuration standard à double caméra à l’arrière. C’est un minimum syndical pour un téléphone en 2025, mais ce n’est clairement pas là que se situe l’argument de vente. Le véritable indice, celui qui fait frémir les amateurs de jeux nomades, apparaît lorsque l’appareil est tenu horizontalement. On distingue alors très nettement la présence de boutons d’épaule physiques, de véritables gâchettes.
Ce détail n’en est pas un. C’est peut-être même le cœur du projet. Alors que les concurrents comme Asus misent sur des zones tactiles (les « AirTriggers »), Ayaneo opte pour le feedback physique, le « clic » rassurant d’un vrai bouton, essentiel pour la précision dans les jeux de tir ou les jeux d’action exigeants. C’est le premier signe tangible de cette fusion entre téléphone et console.
Mais l’indice le plus excitant n’était pas dans cette vidéo. Il faut remonter à une session de partage de produits organisée par la marque durant l’été dernier. Lors de cet événement, elle avait évoqué ce projet de téléphone en faisant allusion à un facteur de forme coulissant. Mettez ces deux informations bout à bout, des gâchettes physiques et un mécanisme coulissant. L’image qui se forme dans l’esprit de tous les vétérans du jeu mobile est immédiate et chargée de nostalgie, celle du Sony Xperia Play.
Lancé en 2011, le Xperia Play, souvent surnommé le « PlayStation Phone », était une tentative courageuse de Sony de fusionner son expertise en téléphonie et son héritage de jeu. L’appareil coulissait pour révéler une manette complète, avec une croix directionnelle, les fameux boutons PlayStation et même des trackpads analogiques. Le concept était génial, mais l’exécution fut un échec. L’appareil manquait de puissance, le catalogue de jeux optimisés était famélique et le marketing confus. L’appareil est resté une curiosité, un « et si ? » mélancolique.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. L’écosystème a radicalement changé. Le jeu mobile est une industrie de plusieurs milliards de dollars, l’émulation a atteint une maturité impressionnante et, surtout, le cloud gaming (Xbox Cloud Gaming, GeForce Now) rend obsolète le besoin de puissance brute locale pour les jeux AAA. Un appareil avec des contrôles physiques intégrés, dans ce contexte, n’est plus un gadget, c’est l’outil parfait.
Ayaneo semble l’avoir parfaitement compris. Pour renforcer cette filiation, son smartphone sera lancé sous la bannière « Remake » de l’entreprise. Cette gamme est explicitement dédiée à la réinterprétation de consoles et d’appareils rétro iconiques. Le message ne pourrait être plus clair, la marque ne fait pas qu’un téléphone pour joueurs, elle tente de réaliser la promesse que le Xperia Play n’a jamais pu tenir.
Nous pouvons donc imaginer un smartphone au design soigné, peut-être d’inspiration rétro-moderne, qui, d’un simple geste, se transforme en une véritable console portable. Un appareil capable de faire tourner les jeux Android les plus gourmands grâce à une puce Snapdragon de dernière génération, mais aussi d’offrir l’expérience d’émulation et de cloud gaming la plus confortable du marché, sans avoir besoin de greffer une manette externe de type Kishi ou Backbone.
Reste une inconnue, et elle est de taille, le prix. Ayaneo n’est pas une marque bon marché. Ses consoles portables PC flirtent souvent, et dépassent allègrement, la barre des 1000 euros. Elles justifient ce tarif par des composants haut de gamme, des écrans OLED magnifiques et une qualité de fabrication irréprochable. Il est fort probable que l’Ayaneo Phone suive la même logique. Il ne s’agira pas d’un concurrent pour les téléphones de milieu de gamme, mais d’un appareil ultra-premium.
La question sera de savoir si le marché est prêt à payer le prix d’un iPhone Pro Max ou d’un Samsung Galaxy S Ultra pour un appareil de niche, aussi séduisant soit-il. Asus et Redmagic ont prouvé qu’il existait une clientèle pour des téléphones de jeu dédiés, mais Ayaneo vise encore plus haut en complexifiant le matériel avec un probable mécanisme coulissant. L’Ayaneo Phone est sans aucun doute l’un des produits tech les plus intrigants à venir. Il pourrait être un échec glorieux comme son ancêtre spirituel, ou il pourrait changer ce que signifie jouer sur mobile. Une chose est sûre, la marque a capté notre attention, en promettant de mettre l’âme d’une console dans notre poche.
01.11.2025 à 15:26
La monétisation ultime – Quand la parole devient un actif spéculatif
Romain Leclaire
Texte intégral (2006 mots)

Nous vivons dans une période de monétisation totale, un monde hyper-capitaliste où chaque recoin de l’existence semble désormais susceptible d’être transformé en opportunité financière. L’idée que tout peut s’acheter et se vendre n’est pas nouvelle, mais la créativité avec laquelle nous appliquons ce principe atteint des sommets toujours plus vertigineux. Nous avons assisté, fascinés ou horrifiés, à l’avènement des NFT, ces simples fichiers d’images désignés par quelques lignes de code qui, pour des raisons défiant parfois la logique conventionnelle, s’échangent pour des millions de dollars. Nous avons intégré l’économie dite « du partage », un euphémisme élégant qui encourage chacun à transformer ses biens les plus précieux, comme sa maison ou sa voiture, en sources de revenus constants.

Et puis, bien sûr, il y a le style de vie influenceur. Cette industrie a perfectionné l’art de monétiser le quotidien lui-même. Chaque activité, chaque repas, chaque opinion est soigneusement mis en scène, filtré et publié sur les réseaux sociaux dans l’espoir de capter l’attention et, par extension, les budgets publicitaires. On pensait avoir atteint une sorte de zénith, ou peut-être de nadir, dans cette course à la marchandisation de soi.
Pourtant, il semble que nous soyons en train de racler les fonds de tiroir de la monétisation. Une nouvelle frontière vient d’être franchie et elle est à la fois bizarre, hilarante et terriblement révélatrice de notre époque. Les utilisateurs de divers marchés de prédiction, des plateformes en ligne comme Polymarket ou Kalshi, ont trouvé un nouveau filon. La dernière façon de gagner de l’argent en ligne ? Prédire les mots exacts qu’une personne prononcera.
Oui, vous avez bien lu. Oubliez la prédiction des résultats électoraux, des prix des matières premières ou même des résultats sportifs. La nouvelle tendance, qui agite une niche spécifique de ces marchés spéculatifs, consiste à parier de l’argent réel sur le fait qu’une personnalité publique utilisera un terme spécifique lors d’une apparition en direct ou d’un discours. Comme le rapporte l’agence Bloomberg, il s’agit d’une catégorie de pari où le résultat n’est pas lié aux bénéfices, aux mouvements de prix ou aux jeux sportifs, mais à ce que les gens disent dans un forum public. C’est la transformation de la parole, de l’élément le plus fondamental de la communication humaine, en un pur produit financier, un ticket de loterie basé sur le vocabulaire.

L’exemple récent le plus frappant, et qui a mis en lumière ce phénomène, concerne Brian Armstrong, le PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase. Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de son entreprise, un événement normalement très formel et scruté par les analystes financiers, il a conclu son intervention d’une manière pour le moins inattendue. Conscient qu’il était lui-même l’objet de paris, il a décidé de jouer avec le système.
« J’étais un peu distrait parce que je suivais le marché de prédiction sur ce que Coinbase dirait lors de sa prochaine conférence téléphonique sur les résultats », a-t-il déclaré, avant d’ajouter: « Je veux juste ajouter ici les mots Bitcoin, Ethereum, blockchain, staking et Web3, pour m’assurer que nous les intégrons avant la fin de l’appel. »
Ce moment, à mi-chemin entre la farce et la performance méta, illustre parfaitement cette nouvelle tendance. Le sujet du pari est devenu un acteur du pari. Armstrong, en prononçant délibérément ces termes, a directement influencé l’issue de ceux placés sur ses propres paroles. Selon Bloomberg toujours, sur les différentes plateformes de prédiction, un montant total d’environ 84 000 dollars était en jeu. Les parieurs avaient misé sur l’apparition ou non de termes très spécifiques, comme « stablecoin », « marge » ou « institution ». En ajoutant sa propre liste de mots-clés, le PDG a transformé un exercice financier sérieux en un jeu autoréférentiel.
Cette histoire pourrait prêter à sourire si elle n’était pas le symptôme d’une tendance à plus grande échelle. Le phénomène ne se limite pas au jargon technique des dirigeants de la tech. Les marchés de prédiction s’intéressent aussi de près à la culture populaire et aux célébrités. Un récent marché proposé sur Kalshi, par exemple, tournait autour d’une question bien différente: la superstar de la musique Taylor Swift allait-elle prononcer le mot « Wedding » (Mariage) lors de son passage très attendu à l’émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » le 6 octobre ?
La sphère people et le divertissement deviennent ainsi de nouveaux terrains de jeu pour les spéculateurs, où chaque mot prononcé lors d’une interview promotionnelle peut potentiellement rapporter de l’argent. On ne sait pas encore quelle ampleur ce type de pari va prendre. S’agit-il d’un épiphénomène, d’un divertissement de niche pour une communauté déjà habituée à la « gamification » de la finance ? Un porte-parole de Coinbase a tenté de dédramatiser la situation en déclarant que les commentaires de Brian Armstrong avaient été faits d’une manière légère et improvisée, en référence aux discussions en ligne autour de l’appel sur les résultats.

Une blague légère, peut-être. Mais cette tendance soulève des questions fascinantes et légèrement dérangeantes sur notre rapport à la valeur et à l’authenticité. Si cette pratique se généralise, assisterons-nous à des discours publics où chaque mot est pesé non seulement pour son impact rhétorique ou politique, mais aussi pour sa valeur spéculative ? Les communicants conseilleront-ils aux PDG de glisser certains « buzzwords » non pas pour rassurer les marchés traditionnels, mais pour satisfaire les ceux de prédiction ?
Après avoir transformé nos appartements en hôtels, nos voitures en taxis et nos vies privées en panneaux publicitaires, nous entrons dans l’ère où la simple prononciation d’un mot devient un actif financier. C’est la monétisation de l’éphémère, la transformation du langage lui-même en casino. La monétisation de l’existence est désormais totale, jusqu’au prochain mot que vous prononcerez.
01.11.2025 à 10:47
Tchéky Karyo – L’âme derrière le regard
Romain Leclaire
Texte intégral (4748 mots)

Il y a des présences qui marquent la pellicule de manière indélébile. Celle de Tchéky Karyo en est une. Un visage taillé à la serpe, une mâchoire carrée qui suggère la détermination ou la menace, et surtout, un regard perçant, d’une intelligence acérée, capable de sonder les âmes ou de dissimuler les secrets les plus profonds. À cette physionomie s’ajoute une voix, grave et rocailleuse, qui confère à ses personnages une autorité naturelle, une gravité qui impose le respect ou la crainte. Pendant plus de quarante ans, cette combinaison a fait de lui l’une des figures les plus reconnaissables et les plus magnétiques du cinéma français et international, l’incarnation d’une certaine forme de puissance contenue. Il était le mentor, l’antagoniste complexe, le policier usé par la vie, le chasseur confronté à sa conscience.
Pourtant, réduire Tchéky Karyo à cette image de force tranquille ou de danger latent serait passer à côté de l’essentiel. Derrière le masque de l’homme d’action se cachait un artiste complet, d’une sensibilité profonde et d’une polyvalence surprenante. Sa carrière, loin d’être une simple succession de rôles, fut une exploration continue de l’identité, de la moralité et de la condition humaine. C’est un voyage qui l’a mené des planches des théâtres les plus prestigieux aux plateaux des plus grands blockbusters hollywoodiens, sans jamais perdre le fil d’une quête intérieure. L’annonce de son décès, survenu à l’âge de 72 ans des suites d’un cancer, invite à une relecture de ce parcours exceptionnel. Cet hommage se veut un regard au-delà des personnages iconiques pour découvrir l’homme (le fils, le père, le musicien, l’acteur à la formation classique) dont la vie a forgé l’âme que l’on devinait à l’écran.

La force de Tchéky ne résidait pas seulement dans son talent à incarner la puissance physique, mais dans sa manière de la doubler d’une profondeur intellectuelle ou émotionnelle. Ses personnages les plus mémorables ne sont pas de simples « durs », ce sont des hommes qui comprennent la nature et le coût de la violence, du pouvoir et des choix moraux. Que ce soit le formateur ambigu de Nikita ou le détective empathique de The Missing, ses interprétations sont empreintes d’une gravité qui les rend inoubliables, car elles suggèrent une riche vie intérieure derrière une façade impénétrable. C’est cette dualité, cette puissance maîtrisée, qui est devenue sa signature artistique.
D’Istanbul à Strasbourg – La forge d’un acteur
Le voyage de Tchéky Karyo commence loin des projecteurs parisiens, sur les rives du Bosphore. Né Baruh Djaki Karyo le 4 octobre 1953 à Istanbul, il porte en lui un héritage culturel d’une richesse exceptionnelle. Sa mère est une juive grecque et son père est issu d’une famille juive séfarade de Turquie, dont les racines remontent à l’Espagne de l’Inquisition. Ce berceau cosmopolite, ce carrefour des civilisations, a sans doute jeté les bases de sa future aisance à naviguer entre les cultures et les langues, une compétence qui définira sa carrière internationale.

Cet héritage est également marqué par la tragédie. Dans une rare et émouvante confidence, l’acteur a révélé la souffrance de sa famille maternelle durant la Shoah. Originaires de Salonique, ses proches ont subi la violence du nazisme. Une partie de sa famille fut déportée, tandis que sa mère, cachée en France, dut fuir à de multiples reprises des familles qui la maltraitaient. Cette histoire, celle de juifs espagnols accueillis par l’Empire ottoman après l’expulsion de 1492 et qui parlaient le ladino, est une mémoire de déracinement et de résilience qui a profondément marqué l’homme et l’artiste.
La famille s’installe ensuite à Paris, où le jeune Baruh Djaki devient « Tchéky », une translittération francisée de son prénom. Son enfance est marquée par la séparation de ses parents à l’âge de 13 ans, un événement qui le pousse vers une indépendance précoce. C’est dans l’art qu’il trouve un refuge et une voie. Il se tourne vers le théâtre, d’abord au Cyrano où il se frotte au répertoire classique, puis en intégrant la prestigieuse École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en 1975. Au sein du « groupe 17 » de la section jeu, il reçoit l’enseignement de maîtres comme Philippe Clévenot et Jean-Pierre Vincent, qui lui inculquent une discipline technique et un profond respect pour son art. Il fait ses armes sur les planches avec la compagnie Daniel Sorano et se produit au Festival d’Avignon à la fin des années 70, s’imposant comme une force théâtrale avant même que le cinéma ne le réclame.
Son identité est une mosaïque complexe, né Turc, d’héritage grec et séfarade, élevé en France. Cette multiplicité n’est pas un simple détail biographique, elle est au cœur de son être et de son art. Les traumatismes familiaux et les dislocations de sa jeunesse ont probablement nourri sa quête artistique, faisant de la scène un espace où il pouvait explorer et unifier les différentes facettes de ce qu’il était. Sa maîtrise de plusieurs langues (français, anglais, espagnol, turc et arabe) n’est pas seulement un atout pour une carrière internationale, mais l’expression vivante de cet héritage pluriel. Comme il le confiera plus tard, « Ce métier m’a aidé à devenir un homme meilleur ». Pour lui, le jeu n’était pas une simple profession, mais un moyen de synthèse, un refuge où les complexités de son histoire personnelle pouvaient être transcendées et transformées en art.
La Révélation – La Balance et le nouveau visage du cinéma français
L’année 1982 marque l’entrée fracassante de Tchéky Karyo dans le monde du cinéma. Il apparaît dans pas moins de quatre films, dont des œuvres d’auteurs reconnus comme Toute une nuit de Chantal Akerman et Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, témoignant de son immersion immédiate dans un cinéma français exigeant. Mais c’est le dernier de ces quatre films qui va changer sa destinée.
Le tournant de sa carrière est son rôle de Petrovic, un gangster violent et charismatique, dans le polar urbain et brutal de Bob Swaim, La Balance. Le film, un immense succès critique et public, est un électrochoc pour le cinéma français. Avec sa performance brute, intense et magnétique, il crève l’écran. Il incarne une nouvelle forme de menace, loin des truands stylisés du passé, plus viscérale, plus psychologique, plus moderne. C’est ce rôle qui, selon ses propres termes, lui « ouvre les portes du cinéma ».

La reconnaissance est immédiate. Le film récolte sept nominations aux Césars, et Tchéky Karyo est nommé dans la catégorie du meilleur espoir masculin. Fait notable, ce sera sa seule et unique nomination, ce qui souligne l’impact foudroyant de cette première grande performance. En 1986, il reçoit le prestigieux Prix Jean-Gabin, qui vient confirmer son statut d’acteur majeur de sa génération, un talent sur lequel il faudra désormais compter.
Le rôle de Petrovic est un acte fondateur. Il établit dès le départ les piliers de sa persona à l’écran. En un seul film, il devient synonyme d’une masculinité complexe, à la fois séduisante et dangereuse. Cet archétype du méchant intelligent et redoutable deviendra la pierre angulaire de sa carrière, notamment à l’international, où les réalisateurs hollywoodiens verront en lui l’antagoniste européen parfait. De Bad Boys à GoldenEye, l’ombre de ce personnage planera sur nombre de ses rôles, preuve de la puissance durable d’une seule performance parfaitement maîtrisée.
Les piliers d’une carrière – Analyse de rôles iconiques
La filmographie de Tchéky Karyo est jalonnée de performances qui ont non seulement défini sa carrière, mais aussi marqué leur époque. Quatre rôles, en particulier, illustrent son évolution et l’étendue de son talent.
L’Ours (1988) : Le dialogue du silence
En 1988, Jean-Jacques Annaud réalise un pari cinématographique fou, un film raconté du point de vue des animaux, avec un dialogue humain quasi inexistant. Dans L’Ours, Tchéky Karyo incarne Tom, l’un des deux chasseurs traquant un immense ours kodiak. Le défi est immense, comment construire un personnage et raconter une histoire sans le secours des mots? L’acteur y parvient avec une maîtrise stupéfiante. Par sa seule présence physique, ses gestes et l’intensité de son regard, il dépeint un arc narratif complet. Il est d’abord le chasseur déterminé, puis l’homme confronté à la puissance brute de la nature, et enfin l’individu humble, transformé par un acte de miséricorde inattendu. La scène pivot où l’ours, le tenant à sa merci, choisit de l’épargner est une leçon de jeu non verbal. Le visage de Karyo exprime un mélange de terreur, d’incompréhension et de respect qui bascule en une prise de conscience profonde. Le film est un triomphe, attirant près de neuf millions de spectateurs en France et consolidant son statut de star. Sa performance est saluée comme une « belle perf », un exploit dans un film où les acteurs humains auraient pu n’être que des faire-valoir.

Nikita (1990) – Le mentor dans l’ombre
Deux ans plus tard, Tchéky décroche le rôle qui le fera connaître dans le monde entier, celui de Bob dans Nikita de Luc Besson. Il y incarne un agent des services secrets, froid et énigmatique, chargé de transformer une jeune délinquante toxicomane en une machine à tuer pour le compte de l’État. Son personnage est l’incarnation de l’ambiguïté morale. Il est à la fois un mentor, une figure paternelle de substitution et un manipulateur implacable. L’acteur livre une composition tout en retenue, où la moindre inflexion de voix ou le plus petit frémissement du regard trahit des sentiments complexes sous une surface glaciale.

Deux anecdotes de tournage révèlent les coulisses de cette performance iconique. La première concerne son engagement. Luc Besson, certain de son choix, le supplia d’accepter le rôle sans même lire le scénario, lui expliquant simplement que Bob faisait partie d’un « trio de personnages dont il rêve ». Fort d’une confiance aveugle en la vision du réalisateur, Karyo accepta les yeux fermés. La seconde anecdote est plus légère. Lors du tournage de l’unique scène réunissant Nikita (Anne Parillaud), son amant Marco (Jean-Hugues Anglade) et Bob, Tchéky Karyo fut pris d’un fou rire incontrôlable. Pour préserver le sérieux de son personnage, il dut tourner ses gros plans seul, face au vide, une illustration amusante du décalage entre l’homme et l’acteur. Le succès international de Nikita le propulse sur la scène mondiale et lui vaut le prix du Meilleur Acteur au festival Mystfest.
La scène mondiale – De l’antagoniste hollywoodien à la star internationale
Grâce à Nikita, Hollywood lui ouvre grand ses portes. Sa maîtrise de l’anglais et d’autres langues, alliée à son charisme et à sa capacité à incarner une menace sophistiquée, fait de lui un second rôle de choix pour de nombreuses superproductions. Il devient l’un des « méchants » européens les plus mémorables des années 90. En 1995, il est l’inoubliable et sadique baron de la drogue français, Antoine Fouchet, face à Will Smith et Martin Lawrence dans Bad Boys de Michael Bay. La même année, il rejoint la mythique franchise James Bond dans GoldenEye, où il interprète Dmitri Mishkin, le ministre russe de la Défense, un personnage droit mais inflexible.
Sa carrière américaine ne se limite cependant pas aux rôles d’antagonistes. En 2000, il offre une performance noble et touchante dans The Patriot de Roland Emmerich. Il y joue le Major Jean Villeneuve, un officier français qui vient prêter main-forte aux miliciens américains durant la Guerre d’Indépendance. Ce rôle, inspiré du Baron von Steuben, lui permet de montrer une facette plus héroïque de son talent. Preuve de son dévouement, il assure lui-même le doublage de son personnage pour la version française du film. Au fil des ans, il collabore avec des réalisateurs de renom comme Ridley Scott (1492 : Christophe Colomb) et côtoie les plus grandes stars, de Gérard Depardieu à Mel Gibson, s’imposant comme un acteur respecté et fiable sur la scène internationale.
Le patriarche moderne – The Missing et le triomphe de la sagesse
Alors que sa carrière cinématographique se poursuit, c’est la télévision qui lui offre, sur le tard, l’un de ses plus beaux rôles, celui qui deviendra une nouvelle signature. De 2014 à 2016, il incarne le détective français Julien Baptiste dans la série britannique de la BBC, The Missing. Le succès est tel qu’un spin-off centré sur son personnage, Baptiste, voit le jour en 2019. Ce rôle lui vaut une reconnaissance critique unanime et une nomination au Festival de Télévision de Monte-Carlo.

Julien Baptiste est en quelque sorte la synthèse de toute sa carrière. C’est un homme d’une intelligence et d’une perspicacité redoutables, comme Bob dans Nikita, mais dont la force ne réside plus dans la manipulation ou la violence, mais dans l’empathie, la patience et une humanité profonde. Hanté par les disparitions d’enfants sur lesquelles il enquête, il est obstiné, sage, et profondément touchant. Le public du monde entier s’attache à ce personnage complexe, qui représente une forme de boussole morale dans un monde obscur.
Pourtant, ce rôle qui a redéfini la fin de sa carrière, il a bien failli le refuser. Une anecdote poignante révèle que le tournage de la première saison de The Missing coïncidait avec la naissance de sa propre fille. Le sujet de la série, la disparition d’un enfant, le rendait si anxieux qu’il s’est d’abord retiré du projet. Ce n’est qu’à la dernière minute, après l’insistance du réalisateur, qu’il a accepté de revenir. Cette décision, motivée par une angoisse de père, a paradoxalement nourri son interprétation et lui a permis de livrer la performance la plus humaine et la plus sage de sa carrière.
Ce parcours illustre une fascinante évolution. L’acteur qui a débuté en incarnant la menace physique brute (La Balance) a progressivement évolué vers des figures de contrôle psychologique (Nikita), pour finalement atteindre un sommet en incarnant une autorité morale et empathique (The Missing). C’est le cheminement d’un artiste qui a su approfondir son exploration de la force, la faisant passer de l’extérieur vers l’intérieur, de la puissance qui détruit à la sagesse qui répare.
L’autre scène – La musique de Tchéky Karyo
Au-delà de l’acteur se trouve une autre facette, moins connue du grand public mais tout aussi essentielle à l’homme, le musicien. Loin d’être un simple passe-temps, la musique a représenté pour Tchéky Karyo un espace d’expression intime et personnel, un lieu où il pouvait parler avec sa propre voix, sans le filtre d’un personnage.
Il se lance officiellement dans la musique en 2006 avec un premier album, Ce lien qui nous unit. Ce titre évocateur suggère déjà les thèmes qui lui sont chers: la connexion, la mémoire, les relations humaines. Sept ans plus tard, en 2013, pour son soixantième anniversaire, il sort un deuxième opus, Credo. Cet album, plus ambitieux encore, témoigne de la maturité de sa démarche artistique. Il collabore avec des plumes reconnues comme le poète Zéno Bianu et Jean Fauque (parolier d’Alain Bashung), et confie la création de la pochette au célèbre dessinateur Enki Bilal. Ces choix artistiques exigeants montrent que sa musique n’est pas une simple récréation, mais une véritable quête esthétique et poétique.
Son style musical se situe à la croisée de la chanson française à texte et d’un rock à la fois énergique et mélancolique. Sur scène, accompagné de son groupe « Les Bienveillants », il se révèle être un interprète charismatique, sa voix grave et profonde trouvant un nouvel écrin. Il a lui-même décrit ce passage à la musique, survenu autour de la cinquantaine, comme un désir de se renouveler. Si le métier d’acteur consiste à se mettre au service d’une vision, d’un texte et d’un personnage, la musique lui a offert une liberté totale. Elle était l’espace où l’homme à l’histoire complexe pouvait exprimer directement sa philosophie, ses doutes et ses convictions. C’était la voix derrière le masque, l’expression non médiatisée de l’âme de l’artiste.
L’empreinte d’un artiste complet
Tchéky Karyo laisse derrière lui une empreinte unique et durable dans le paysage cinématographique. Il fut un pont entre les mondes: entre le cinéma d’auteur français et les blockbusters internationaux, entre la rigueur du théâtre classique et l’énergie brute de l’écran, entre l’Europe et l’Amérique. Sa facilité à être crédible en gangster parisien, en chasseur en Colombie-Britannique, en officier français du XVIIIe siècle ou en détective contemporain témoigne d’une rare polyvalence, nourrie par une curiosité insatiable pour les cultures et les langues.
Pour lui, l’art dramatique était un espace réservé et magique permettant une introspection et une prise de recul sur soi-même. Cette vision de son métier comme un chemin de vie, une quête de soi, éclaire l’ensemble de son parcours. Chaque rôle, même le plus sombre, semble avoir été une étape dans cette quête d’humanité.
L’image finale que l’on gardera de lui ne sera pas seulement celle du chasseur, de l’espion ou du détective. Ce sera celle d’un artiste complet, dont le regard intense n’était pas un signe de dureté, mais la fenêtre ouverte sur une âme riche, complexe et profondément sensible. L’acteur n’est plus, mais son empreinte sur le cinéma, elle, demeure. Et l’âme derrière le regard continue de nous parler.
01.11.2025 à 09:19
Elon Musk – Des chats écrasés aux voitures volantes, le grand cirque de la distraction
Romain Leclaire
Texte intégral (1271 mots)

Entre deux tentatives pour devenir le premier trillionnaire au monde, l’expansion de son entreprise de contrats de défense, sa lutte acharnée contre le « virus mental woke », ses querelles avec Sam Altman et la supervision d’une demi-douzaine de sociétés technologiques, Elon Musk a miraculeusement trouvé le temps de s’immiscer dans un débat local à San Francisco. Le sujet ? Un chat de quartier bien-aimé, écrasé par un robotaxi Waymo.
Si vous l’aviez manqué, un drame félin s’est noué cette semaine. KitKat, surnommé « le maire de la 16e rue » et pilier du Randa’s Market, a été tué. Waymo, l’entreprise responsable, a plus ou moins admis sa culpabilité, expliquant que l’animal s’était précipité sous l’un de ses véhicules alors qu’il démarrait. Une tragédie locale, certes, mais qui aurait dû le rester.
C’était sans compter sur l’intervention du grand oracle de la tech. Alors que la communauté pleurait KitKat, Elon Musk a choisi son camp. Il a retweeté un compte affirmant que l’autonomie sauverait les animaux, citant que « 5,4 millions de chats sont heurtés par des voitures chaque année aux États-Unis ». La réponse du milliardaire ? Un laconique et suffisant: « C’est vrai, de nombreux animaux de compagnie seront sauvés par l’autonomie ».
Quelle magnanimité. C’est formidable que Elon ait pu dégager quelques minutes dans son emploi du temps de sauveur du monde pour participer au discours sur un chat. Mais ne soyons pas dupes. Il est surtout sur le point de lancer son propre service de robotaxi. Il n’est donc pas un observateur neutre mais un concurrent direct de Waymo qui utilise cette tragédie pour vanter sa propre technologie, encore inexistante sur le marché.
Mais si commenter la mort d’un chat pour un gain commercial est mesquin, le véritable talent du patron de Tesla réside dans l’art de la distraction à grande échelle. Et pour cela, rien ne vaut une apparition chez Joe Rogan (un podcasteur américain controversé). Vendredi dernier, au milieu de sujets déjà ressassés, il a décidé de lâcher une « nouvelle »: il veut faire la démonstration d’une voiture volante d’ici la fin de l’année.
Arrêtez-nous une seconde. Musk parle de voitures volantes depuis au moins 2014. Le Roadster de deuxième génération, promis pour 2020, est devenu l’Arlésienne de l’industrie automobile. Interrogé par le podcasteur sur son statut, Musk a lentement admis qu’il voulait le faire voler. « Nous approchons de… », dit-il avec une longue pause, « …la démonstration du prototype. Une chose que je peux garantir, c’est que cette démo de produit sera inoubliable. Inoubliable. » Il a fallu un certain temps pour que Rogan comprenne. « Que ce soit bon ou mauvais, ce sera inoubliable », a ajouté le milliardaire en riant. Il a ensuite évoqué son ami Peter Thiel, un autre milliardaire d’extrême-droite, qui se plaignait que l’avenir n’ait pas tenu sa promesse de voitures volantes.
Il ne faut pas être grand clerc pour décoder la manœuvre. Musk adore déployer des prototypes et des idées bien avant qu’ils ne soient prêts. Vous souvenez-vous de l’Hyperloop, ce système de transport de masse autonome à 250 km/h ? Il a accouché d’un tunnel à Las Vegas où des chauffeurs humains conduisent des Teslas à faible vitesse. Une démonstration n’est pas un produit. C’est du spectacle. Et pourquoi ce spectacle maintenant ? La réponse est simple, les ventes de Tesla sont dans les choux. Depuis que Musk a aligné sa marque sur le trumpisme et s’est permis des saluts de style nazi, le cœur de sa clientèle s’est érodé. La voiture volante n’est pas une innovation, c’est un écran de fumée, une distraction clinquante pour faire oublier que l’empereur est nu et que ses affaires périclitent.
Et quand la distraction terrestre ne suffit plus, il y a toujours l’espace. L’IA exige une puissance de calcul et de stockage colossale et l’intérêt pour les centres de données spatiaux explose. Eric Schmidt et Jeff Bezos y investissent. Alors, qui voilà sur X ? Elon Musk, bien sûr. Répondant à un article sur le sujet, il déclare: « Il suffirait de mettre à l’échelle les satellites Starlink V3… SpaceX le fera. » Son intérêt réhausse le profil de l’industrie, mais le schéma est le même. Elon Musk se positionne sur chaque nouvelle frontière technologique, non pas nécessairement pour innover, mais pour posséder le narratif.
Que ce soit sur le bitume ensanglanté de San Francisco, dans les studios enfumés de Joe Rogan ou dans le vide de l’espace, l’objectif reste le même. Il s’agit pour cet oligarque de s’assurer que, quelle que soit la conversation sur l’avenir, il en est le centre. La voiture volante de James Bond, comme il la décrit, n’est peut-être qu’un VTOL (un hélicoptère glorifié), mais peu importe. L’important n’est pas ce qu’il livre, c’est ce qu’il promet, nous faisant oublier les controverses d’aujourd’hui.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr