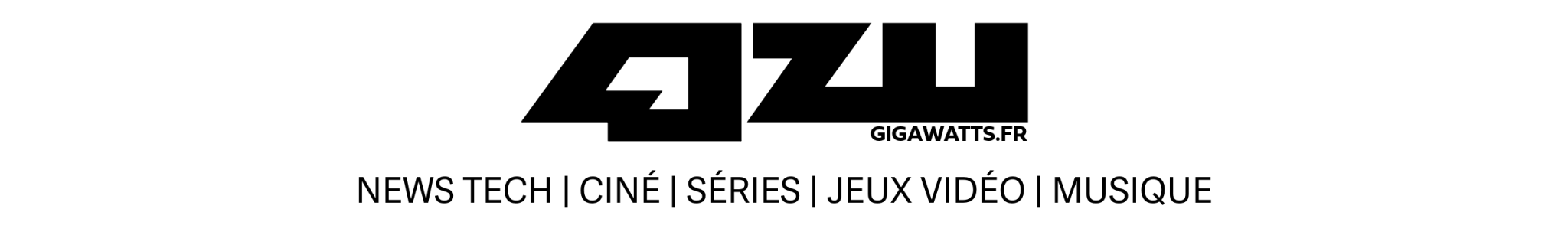ACCÈS LIBRE Actualité IA
01.11.2025 à 08:18
Bluesky réinvente ses conversations – Le bouton « J’aime pas » et le « quartier social »
Romain Leclaire
Texte intégral (1679 mots)

Bluesky, l’alternative décentralisée, vient de franchir fièrement le cap des 40 millions d’utilisateurs. Loin de se contenter de sa croissance, elle est en pleine phase d’expérimentation, cherchant activement à améliorer la qualité des conversations en son sein. L’annonce la plus surprenante ? L’introduction imminente d’un bouton « Je n’aime pas » (dislike).
Mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de céder à la tentation d’un indicateur de popularité négative. Ce nouvel outil, qui sera testé en version bêta, vise à redéfinir la manière dont nous interagissons en ligne. Bluesky ne veut pas seulement que vous voyiez moins de publications indésirables, l’entreprise veut que vous vous sentiez chez vous. Cette nouvelle option fait suite à une période de troubles où certains utilisateurs ont vivement critiqué la plateforme pour sa gestion de la modération, lui reprochant de ne pas bannir assez fermement les « mauvais acteurs » ou les personnalités controversées qui enfreindraient les directives de la communauté.
Fidèle à sa philosophie décentralisée, elle ne répond pas par une modération centralisée accrue, à la manière de l’ancien Twitter. Elle préfère se concentrer sur les outils qu’elle fournit à ses utilisateurs pour leur permettre de contrôler leur propre expérience. L’objectif affiché est de cultiver un espace propice aux échanges amusants, authentiques et respectueux.

La pierre angulaire de cette nouvelle vision est un concept fascinant que Bluesky nomme la « proximité sociale », ou plus poétiquement, le « quartier social » (social neighborhood). L’idée est simple en théorie mais complexe en pratique: cartographier votre place au sein d’un écosystème d’interactions. Le système cherche à comprendre qui sont les gens avec qui vous interagissez déjà ou que vous aimeriez probablement connaître.
Une fois ce « quartier » défini, l’algorithme s’efforcera de donner la priorité aux réponses et aux publications provenant des personnes qui en font partie. L’entreprise est convaincue qu’en favorisant la familiarité, les conversations deviendront plus pertinentes, plus agréables et, surtout, moins sujettes aux malentendus qui naissent souvent d’interactions hors contexte avec de parfaits inconnus.
C’est ici que le fameux bouton « J’aime pas » entre en scène. Bluesky précise qu’il s’agira d’un signal privé, non visible publiquement par les autres utilisateurs. Son rôle premier sera d’aider le système à comprendre ce que vous ne voulez pas voir, affinant ainsi la personnalisation de votre fil principal « Discover ». Mais son influence ne s’arrête pas là. Ce signal pourrait également affecter le classement des réponses, non seulement dans vos propres fils de discussion, mais aussi dans ceux des autres membres de votre quartier social. C’est une manière douce et collective de réguler le ton des échanges au sein d’une communauté connectée.
D’autres ajustements viennent renforcer cette logique. Bluesky s’attaque par exemple à la réponse impulsive. Nous avons tous déjà répondu à une publication sans lire l’intégralité de la conversation. Pour y remédier, le bouton « Répondre » va être modifié. Désormais, un clic sur ce dernier vous présentera d’abord l’intégralité du fil de discussion, plutôt que de vous jeter directement dans un écran de composition vide. L’objectif est d’encourager la lecture avant l’écriture, afin de réduire l’effondrement du contexte et les réponses redondantes, un fléau bien connu des réseaux de microblogging. Parallèlement, un nouveau modèle de détection est en cours de déploiement pour identifier plus efficacement les réponses toxiques, relevant du spam, hors sujet ou postées de mauvaise foi. Ces commentaires indésirables seront automatiquement déclassés dans les fils, les résultats de recherche et les notifications.
Bien entendu, cette approche soulève un débat fondamental. D’un côté, on peut y voir une interprétation charitable: Bluesky continue d’étendre sa philosophie de contrôle utilisateur. La plateforme offre déjà des listes de modération, des filtres de contenu, des mots masqués et même la possibilité de détacher les citations pour limiter le « dunking » toxique. D’un autre côté, une lecture moins charitable y voit le risque de renforcer les bulles de filtre. Ce concept de quartier social, s’il est mal équilibré, pourrait se transformer en un moyen d’enfermer les utilisateurs dans leur propre chambre d’écho, plutôt que de s’attaquer aux problèmes de modération à la racine. Dans un quartier socialement homogène et protégé, les critiques ne verraient plus les publications problématiques et les auteurs de ces publications ne seraient plus confrontés à leurs critiques. Si cela peut effectivement réduire le niveau de conflit apparent, cela risque aussi d’étouffer les désaccords productifs et la confrontation d’idées, pourtant essentiels à la vitalité d’un espace public.

Cette stratégie de quartier vise aussi à résoudre un problème qui handicape Threads de Meta, son concurrent direct. Le fil de Threads peut être incroyablement déroutant, jetant les utilisateurs au milieu de conversations sans aucun contexte. Il est souvent impossible de savoir qui répond à qui et pourquoi vous voyez certains messages. Le système de cartographie sociale de Bluesky, s’il est bien exécuté, pourrait élégamment résoudre ce problème de pertinence à grande échelle.
Face à la crise de la modération qui secoue l’ensemble du web social, Bluesky choisit de ne pas être l’arbitre suprême. Il préfère se positionner comme un fournisseur d’outils sophistiqués, donnant à ses 40 millions d’utilisateurs les clés pour construire leurs propres clôtures, leurs propres places publiques et, désormais, leurs propres quartiers. L’avenir dira si ces derniers deviendront des communautés florissantes ou des ghettos idéologiques.
31.10.2025 à 16:32
Course vers la Lune – SpaceX peut-il tenir sa promesse face à la pression chinoise ?
Romain Leclaire
Texte intégral (1670 mots)

La tension est palpable dans le monde de l’exploration spatiale. Alors que le sentiment grandit que la Chine pourrait bien coiffer les États-Unis au poteau pour le retour des humains sur la Lune, SpaceX vient de briser un silence de près de deux ans. La société d’Elon Musk a publié une mise à jour détaillée de son contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA pour l’alunissage des astronautes du programme Artemis. Dans une longue déclaration, l’entreprise américaine se positionne comme le catalyseur central qui réalisera la vision du projet, établir une présence durable sur la Lune et, à terme, ouvrir la voie vers Mars.
Cette distinction a son importance. L’objectif ultime de SpaceX, martelé par son PDG depuis la création de l’entreprise, a toujours été la planète rouge. La Lune, dans cette optique, est une étape. Elon Musk a d’ailleurs parfois critiqué le programme Artemis de la NASA, le jugeant peu ambitieux et trop dépendant des contractants aérospatiaux traditionnels. Lorsque le milliardaire parle de Starship, son véhicule de nouvelle génération, c’est presque toujours avec Mars en ligne de mire, la Lune n’obtenant que peu de temps d’antenne.
Pourtant, en coulisses, les ingénieurs de SpaceX travaillent d’arrache-pied sur une version lunaire du Starship. Le plan actuel de la NASA est complexe, les astronautes décolleront de la Terre à bord de la capsule Orion de Lockheed Martin. Une fois en orbite lunaire, ils s’amarreront au Starship qui les attendra pour descendre vers le pôle sud de la Lune. Après leur mission, ils utiliseront ce même Starship comme ascenseur pour remonter vers Orion et rentrer chez eux.

Mais il y a un obstacle technique notable, le ravitaillement, un véritable éléphant dans l’orbite. Le Starship est une bête colossale, mais il consomme tout son carburant simplement pour atteindre l’orbite terrestre basse. Pour aller plus loin, il doit être ravitaillé dans l’espace. Le plan lunaire exige que SpaceX lance d’abord un dépôt de carburant en orbite, puis le remplisse à l’aide d’une flotte de Starships « tankers » (peut-être une douzaine de vols ou plus) avant que le vaisseau lunaire ne puisse faire le plein et partir. C’est cette manœuvre, que Blue Origin avait qualifiée d’immensément complexe et à haut risque lors de sa protestation contre l’attribution du contrat initial, qui constitue le goulot d’étranglement du programme.
SpaceX affirme avoir franchi plusieurs étapes en avance sur le calendrier, notamment sur les systèmes de survie, l’adaptateur d’amarrage avec Orion et les tests de train d’atterrissage. Mais le plus dur reste à faire. Le premier test de transfert de propergol cryogénique entre deux Starships en orbite, prévu au départ pour fin 2025, est désormais repoussé à l’année prochaine. Si l’entreprise surmonte cet obstacle, la récompense est transformationnelle. Le Starship lunaire est gigantesque, offrant un volume habitable de plus de 600 mètres cubes, soit les deux tiers de la Station Spatiale Internationale. Il sera doté d’un ascenseur pour descendre les astronautes et le matériel du haut de la cabine (perchée à 15 étages) jusqu’au sol lunaire. En mode cargo, il pourrait livrer 100 tonnes de matériel (des rovers, des habitats, voire des réacteurs nucléaires) en un seul voyage.
Mais le temps presse. Les échecs répétés des premiers vols d’essai cette année, bien que faisant partie de la méthode de développement itératif de SpaceX, ont accumulé les retards. Ces revers, couplés à l’ampleur de la tâche, font craindre que le programme Artemis ne prenne un retard irrattrapable sur l’initiative chinoise, qui vise un alunissage d’ici 2030 avec une architecture plus traditionnelle, ressemblant à Apollo.

Le calendrier officiel de la NASA pour Artemis III, le premier alunissage américain, est fixé à 2027. Cependant, plus personne n’y croit. Le Starship et les nouvelles combinaisons spatiales (développées par Axiom Space) ne seront tout simplement pas prêts. Le chœur des voix affirmant que les États-Unis vont perdre cette seconde course à la Lune s’amplifie. Jim Bridenstine, l’ancien administrateur de la NASA sous Trump, a déclaré au Congrès américain que la défaite était probable. Charlie Bolden, son prédécesseur sous Obama, partage ces doutes, tout en tempérant: « Ce n’est pas grave si nous arrivons en 2031, tant que nous le faisons mieux qu’eux.«
Cette perspective ne satisfait pas l’administration actuelle. Sean Duffy, l’administrateur par intérim de la NASA, a récemment lancé un appel aux contractants pour trouver des moyens d’accélérer le calendrier. SpaceX et Blue Origin ont confirmé avoir soumis de nouveaux plans. Blue Origin, qui développe son propre atterrisseur (le Blue Moon) pour une mission ultérieure (Artemis V), propose désormais une approche incrémentale utilisant une version modifiée de son plus petit atterrisseur, le Mark 1, qui n’a pas besoin de ravitaillement en orbite.
De son côté, SpaceX a également proposé une architecture simplifiée, sans en dévoiler les détails. La société se dit constamment réactive aux changements d’exigences de la NASA, tout en réaffirmant que le Starship reste la voie la plus rapide pour retourner sur la Lune. L’entreprise a bâti sa réputation sur sa rapidité, et elle a récemment enchaîné les succès avec son vaisseau, réalisant des exploits comme le transfert de propergol dans l’espace et des rallumages de moteurs Raptor. La course est lancée, mais la route est encore longue et le principal adversaire n’est peut-être pas Pékin, mais la complexité vertigineuse du ravitaillement en orbite.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr