
12.11.2025 à 11:56
Réforme des retraites : quand la Macronie tend le piège, la gauche cherche la sortie
la Rédaction
Texte intégral (1514 mots)
La newsletter du 12 novembre 
par Catherine Tricot
À l’Assemblée, la Macronie invente le « décalage » de la réforme des retraites et la gauche se déchire entre promesse de victoire et refus du piège.
C’est acquis. Les députés socialistes vont voter cet après-midi « pour » le « décalage » de la réforme des retraites qu’ils tiennent pour une « suspension », dès l’instant où ce décalage va au-delà de 2027 (c’est-à-dire de la prochaine élection présidentielle). Il sera alors temps de voter pour le maintien ou pour une autre réforme des retraites. Les socialistes veulent y voir une victoire arrachée à la Macronie quand les victoires sociales ne sont pas si courantes. Comme le dit Sophie Binet, il s’agit d’une « brèche dans un totem du macronisme ».
Acquis aussi le vote des députés insoumis : ce sera un vote « contre ». Évidemment pas parce qu’ils veulent que les salariés en suent trois mois de plus mais parce qu’ils veulent qu’on nomme un chat un chat : il s’agit d’un « décalage » conformément à la mise au point faite par Emmanuel Macron, en aucune façon d’une « suspension sine die » et encore moins d’une abrogation, réclamée depuis trois ans. Mais, dans ce vote insoumis, il y a davantage : ils ne veulent pas entrer dans l’engrenage d’une validation par consentement tacite de l’âge de départ à 64 ans. La secrétaire générale de la CGT demande, ce matin encore, de ne pas valider ces 64 ans et de faire évoluer le texte. Les insoumis ne veulent pas alimenter le récit loufoque que les députés se seraient enfin prononcés sur une réforme passée au 49.3. C’est aussi le sens du piège tendu par la Macronie : obtenir une validation du recul de l’âge de départ pour le prix modique d’un « décalage » voire d’une prise en compte des carrières longues… le tout payé par des coupes supplémentaires dans le budget de la Sécu. Catastrophique.
Cohérents, les insoumis s’opposent frontalement à la politique macroniste. En votant « contre », ils prennent le risque de se faire mal comprendre, de passer pour des jusqu’au-boutistes et qu’à l’arrivée, il ne se trouve pas de majorité pour rejeter ce décalage… Alors le choix de la clarté politique se fracasserait sur la réalité de la perte d’un petit gain immédiat pour ceux qui auraient pu profiter de ce décalage – c’est-à-dire pour la génération née en 1964 et 1965.
Les députés RN voteront « pour ». Les députés LR et Horizons voteront « contre ». Les Renaissance devraient se diviser entre votes « contre » et une majorité d’abstentions.
Que feront les députés communistes, écologistes, ceux de l’Après ? Ils se retrouvent pris en tenaille. Ils voient bien la difficulté de s’opposer à cette maigre avancée mais ils n’ont pas envie de la faire passer pour ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire une victoire. Engagés dans le combat contre l’éclatement des gauches, ils sont aussi soucieux de ne pas creuser davantage les tranchées entre les députés de gauche.
Comment ne pas partager cette hésitation ? Un vote à l’Assemblée doit avoir une portée politique et être compris. Quel vote aura du sens pour les salariés ? On peut douter que, ce soir, des défilés de la victoire s’organisent dans les rues. Chacun mesure que la réforme Borne-Touraine-Macron ne sera pas défaite.
On ne peut pas non plus ignorer la suite de l’histoire : Gérard Larcher, le chef de la droite au Sénat – en attendant le retour, prévu pour aujourd’hui, de Bruno Retailleau –, a promis de rétablir la réforme dans son intégralité et il en a les moyens. Puis viendra la commission mixte paritaire, où droite et macronistes sont majoritaires, pour arbitrer entre les textes des deux chambres. Puis ce sera, pour la première fois, un possible usage des ordonnances par le gouvernement. La promesse d’un gain, même ténu, paraît fragile voire illusoire.
Alors que faire ? Voter contre ou s’abstenir ? Au moins, que chacun à gauche rende lisible son vote. Sortons des billevesées sur le « retour du parlementarisme » et des discours débiles sur la nécessité de « faire des compromis », toujours mauvais sur la base d’un projet de droite profondément nocif.
 PANIQUES DU JOUR
PANIQUES DU JOUR
Gerbe pour le 11-Novembre, colloque sur la Palestine au Collège de France : les nerfs à vif du pouvoir

À Reims, ce 11 novembre, le responsable du protocole de la mairie a jugé bon de faire retirer le ruban de la gerbe déposée par le député européen LFI Anthony Smith. Motif : on y lisait ce slogan pacifiste historique, jugé trop subversif pour honorer les morts de 14-18 : « Maudite soit la guerre ». À Paris, dans le même élan de dinguerie institutionnelle, le Collège de France a annulé, sur incitation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, un colloque scientifique sur la Palestine initié par Henry Laurens. Prétexte : la polémique, nourrie par Le Point et la Licra, menaçait la sérénité du lieu. D’un côté, on censure un message pacifiste vieux d’un siècle ; de l’autre, on bâillonne la recherche au nom d’une neutralité mal comprise. Dans les deux cas, c’est le même réflexe de crispation qui s’exprime : des autorités qui perdent leur sang-froid et confondent ordre avec autorité, symbole avec scandale, débat avec menace. La République de 2025 serait une vieille dame crispée sur ses symboles, entrant dans chaque polémique comme on entre en transe. On la rêvait ferme et lumineuse, fière de la raison et du courage ; la voilà réduite à participer, chaque jour un peu plus, à ce grand concours de panique nationale.
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…
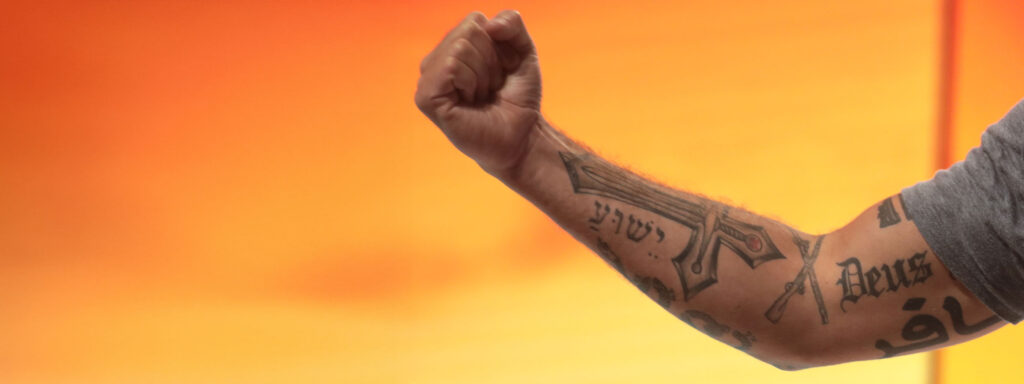
Encore une traduction importante sur le site du Grand Continent : aux États-Unis, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a présenté une stratégie visant à « libérer » l’armée américaine de sa propre bureaucratie. En s’en prenant aux lourdeurs administratives et aux règles d’achat du Pentagone, il veut accélérer la production d’armes et rapprocher l’industrie privée du champ militaire. Sous couvert d’efficacité, cette réforme, fidèle à la vision de Donald Trump, consacre un tournant : moins de contrôle public, plus de pouvoir aux industriels, et une armée américaine restructurée autour d’un pacte assumé entre guerre, profit et patriotisme. Flippant.
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
11.11.2025 à 11:21
Dans l’ombre de la guerre
Pablo Pillaud-Vivien
Texte intégral (642 mots)
Derrière le culte de la mémoire de la Grande Guerre, un présent belliqueux s’installe. La guerre est redevenue la langue du pouvoir.
Il y a cent sept ans, l’Europe célébrait l’armistice de la « der des ders ». Aujourd’hui, dans les discours officiels, la même solennité résonne : hommage aux morts, leçon d’histoire, promesse de paix. Mais sous les drapeaux et les trompettes, l’air a changé. Le silence des monuments ne couvre plus le grondement du monde. Partout, la guerre rôde, déjà présente, déjà future.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Dans l’avant-guerre, le dossier du dernier numéro de la revue, nous montrons comment l’idée même de guerre ne s’est jamais aussi bien portée. La guerre, aujourd’hui, est devenue la forme générale du pouvoir : elle s’infiltre dans nos mots, nos budgets, nos imaginaires. Guerre contre la dette, contre le terrorisme, contre le virus, contre les pauvres. Guerre économique, climatique, culturelle. Guerre à distance, par drones, par sanctions, par algorithmes.
Pendant que les présidents déposent des gerbes, d’autres s’arment. Le Pentagone a retrouvé son vrai nom : « ministère de la guerre ». L’Europe promet d’y consacrer 5% de son PIB. La France vend ses Rafale comme d’autres exportaient du blé. En 2022, elle est devenue le deuxième marchand d’armes au monde. Et pendant que les profits explosent, Gaza continue de brûler, l’Ukraine continue de saigner, le Soudan s’effondre. Plus de cent millions d’humains ont du fuir leur foyer… et nous, en Europe, feignons d’être encore en paix.
Quoique… La paix n’est plus l’horizon de nos politiques. Emmanuel Macron l’a dit : il faut « assumer la guerre ». La formule, glaçante, dit tout : le militarisme est redevenu la grammaire de la puissance. La gauche cherche encore les mots pour s’y opposer. Comment nommer la guerre sans la reproduire ? Comment refuser la logique de la force sans passer pour naïf ? Comment, surtout, redonner un sens politique à la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme un projet de justice et d’égalité ?
« La guerre n’est plus ce qu’elle était », rappelle Bertrand Badie dans notre dossier : elle ne se joue plus seulement entre États, mais entre sociétés. Elle traverse les peuples, les réseaux, les consciences. Elle s’invite chez nous, dans nos villes, sur nos écrans, au tréfond de nos peurs. Et c’est peut-être cela, le plus dangereux : que la guerre ne soit plus un événement mais un climat. Un état du monde, et de l’esprit.
Alors, en ce 11 novembre, souvenons-nous non seulement des morts de 14-18 mais de ceux qui meurent aujourd’hui, dans les guerres que l’on ne veut pas voir. Ou celles que l’on voit sans rien y faire. Et souvenons-nous surtout de ce que voulait dire « plus jamais ça ». Non pas un serment passé mais une tâche présente. Car si l’avant-guerre est déjà là, il nous revient d’en écrire l’après.
11.11.2025 à 11:13
Dans l’ombre de la guerre
la Rédaction
Texte intégral (1399 mots)
La newsletter du 11 novembre 
Derrière le culte de la mémoire de la Grande Guerre, un présent belliqueux s’installe. La guerre est redevenue la langue du pouvoir.
Il y a cent sept ans, l’Europe célébrait l’armistice de la « der des ders ». Aujourd’hui, dans les discours officiels, la même solennité résonne : hommage aux morts, leçon d’histoire, promesse de paix. Mais sous les drapeaux et les trompettes, l’air a changé. Le silence des monuments ne couvre plus le grondement du monde. Partout, la guerre rôde, déjà présente, déjà future.
Dans l’avant-guerre, le dossier du dernier numéro de la revue, nous montrons comment l’idée même de guerre ne s’est jamais aussi bien portée. La guerre, aujourd’hui, est devenue la forme générale du pouvoir : elle s’infiltre dans nos mots, nos budgets, nos imaginaires. Guerre contre la dette, contre le terrorisme, contre le virus, contre les pauvres. Guerre économique, climatique, culturelle. Guerre à distance, par drones, par sanctions, par algorithmes.
Pendant que les présidents déposent des gerbes, d’autres s’arment. Le Pentagone a retrouvé son vrai nom : « ministère de la guerre ». L’Europe promet d’y consacrer 5% de son PIB. La France vend ses Rafale comme d’autres exportaient du blé. En 2022, elle est devenue le deuxième marchand d’armes au monde. Et pendant que les profits explosent, Gaza continue de brûler, l’Ukraine continue de saigner, le Soudan s’effondre. Plus de cent millions d’humains ont du fuir leur foyer… et nous, en Europe, feignons d’être encore en paix.
Quoique… La paix n’est plus l’horizon de nos politiques. Emmanuel Macron l’a dit : il faut « assumer la guerre ». La formule, glaçante, dit tout : le militarisme est redevenu la grammaire de la puissance. La gauche cherche encore les mots pour s’y opposer. Comment nommer la guerre sans la reproduire ? Comment refuser la logique de la force sans passer pour naïf ? Comment, surtout, redonner un sens politique à la paix, non pas comme une absence de conflit, mais comme un projet de justice et d’égalité ?
« La guerre n’est plus ce qu’elle était », rappelle Bertrand Badie dans notre dossier : elle ne se joue plus seulement entre États, mais entre sociétés. Elle traverse les peuples, les réseaux, les consciences. Elle s’invite chez nous, dans nos villes, sur nos écrans, au tréfond de nos peurs. Et c’est peut-être cela, le plus dangereux : que la guerre ne soit plus un événement mais un climat. Un état du monde, et de l’esprit.
Alors, en ce 11 novembre, souvenons-nous non seulement des morts de 14-18 mais de ceux qui meurent aujourd’hui, dans les guerres que l’on ne veut pas voir. Ou celles que l’on voit sans rien y faire. Et souvenons-nous surtout de ce que voulait dire « plus jamais ça ». Non pas un serment passé mais une tâche présente. Car si l’avant-guerre est déjà là, il nous revient d’en écrire l’après.
 VOILE DU JOUR
VOILE DU JOUR
Un foulard peut en cacher un autre

Un autre jour en France et une nouvelle polémique sur le voile. Le 5 novembre, des écoliers sont venus assister à une séance parlementaire. Une classe de CM2 et une classe de bac professionnel venues découvrir la machine politique, en tribune, juste au-dessus de l’hémicycle, à l’invitation du député Modem Marc Fesneau. Un événement comme il en existe tous les jours à l’Assemblée. Et nos braves enfants ont pu découvrir les lubies de l’extrême droite. Car parmi eux, certaines portaient un voile. Une « infâme provocation » pour le député RN Julien Odoul qui, pour rappel, s’est fait connaître du grand public exactement pour les mêmes faits, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2019. « Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée ? », demande un autre parlementaire d’extrême droite ? Et Yaël Braun-Pivet de se mettre dans le rang : « Au cœur même de l’hémicycle, où a été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes », écrit-elle. Or l’Assemblée n’est pas une extension de l’école, les élèves ne sont pas des agents de la République et la loi n’est pas transgressée. Mince ! Rapidement, les islamophobes ont trouvé la parade : dans le règlement du Palais-Bourbon, il est stipulé que « pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence ». Le mot est là : « découvert ». Il a sûrement été inscrit pour des chapeaux ou des casquettes, mais qu’importe, il fera l’affaire. On se demande si des bonnes sœurs seraient concernées par une telle polémique. Ou des jeunes élèves d’une école juive arborant des kippas. Et avait-on obligé Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer colère, de se « découvrir » avant d’hurler sa rage lors du vote de la loi Duplomb ?
L.L.C.
ON VOUS RECOMMANDE…

« De Gaulle, le commencement » : une fiction documentaire de France Télévisions. Elle retrace une période méconnue de la vie de Charles de Gaulle, jeune officier fait prisonnier des Allemands au cœur de la Première Guerre mondiale. Un poil hagiographique mais passionnant.
C’EST CADEAU 


ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
