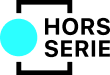19.12.2025 à 16:27
Militer depuis l’Assemblée : entretien avec Arnaud Saint-Martin
Manuel CERVERA-MARZAL
Texte intégral (8365 mots)
Manuel Cervera-Marzal (MCM) : Vous êtes sociologue des sciences. Votre thèse porte sur l’histoire de l’astronomie française au début du XXe siècle. Comment en êtes-vous arrivé à ce métier de sociologue, et pourquoi avoir choisi d’étudier l’astronomie ?
Arnaud Saint-Martin (ASM) : La sociologie s’est imposée pour moi dès le lycée. J’étais un cancre, soyons clair, mais c’était une des rares matières que j’aimais ; avec le sport (rires). J’ai découvert Bourdieu en première, à travers l’affrontement Bourdieu/Boudon1 : il y avait un côté un peu héroïque. Ça m’a passionné et ça m’a amené à m’interroger sur moi-même, comme produit de déterminismes sociaux, moi qui avais été socialisé dans un milieu populaire de droite.
Et sur un malentendu, je me suis inscrit en licence de sociologie à l’université de Rouen après un bac ES péniblement obtenu (avec mention « passable »). Le cancre est devenu un passionné : à la façon de l’autodidacte de Sartre, je passais mes journées à la bibliothèque de Rouen. Ça m’a dévoré. J’ai découvert l’anthropologie, l’histoire, la philosophie : ça m’a ouvert plein de portes.
Rouen avait l’avantage d’une formation très généraliste. Puis, à Paris 5, j’ai basculé vers la sociologie des sciences grâce à Jean-Michel Berthelot. Les débats sur la vérité, l’objectivité, les querelles épistémologiques, ça m’a happé. J’ai fait un mémoire sur la vulgarisation de l’astronomie, en 1999, puis, l’année suivante, un travail sur l’affaire Sokal.
MCM : Impostures intellectuelles, de Bricmont et Sokal2…
ASM : Oui, le canular de Sokal… C’était mon sujet de maîtrise en sociologie des sciences, en 2000. À l’époque, c’était une spécialité de niche : il y avait plus de philosophes et d’historiens des sciences que de sociologues des sciences. La sociologie était la portion congrue. Mais il existait quand même des foyers : Paris 5, EHESS, Nanterre, Nantes, Strasbourg… Et c’est le moment où le domaine se structure, avec des débats intenses sur le constructivisme, sur le statut des énoncés scientifiques, leur inscription dans l’histoire, les études de laboratoire. Avec aussi les discussions critiques autour de l’anthropologie des savoirs de Bruno Latour. Ça, ça a été ma formation.
MCM : Et pourquoi avoir pris l’astronomie pour objet d’étude ? Pourquoi pas la biologie, ou la physique ?
ASM : Parce que la physique et la biologie étaient déjà très défrichées. Moi, l’astronomie m’attirait. Mon DEA portait sur la vulgarisation de l’astronomie : j’y analysais le marché de la diffusion des sciences, à partir d’entretiens avec des cosmologistes et des astrophysiciens qui écrivaient des livres ou donnaient des conférences, mais aussi des éditeurs et des journalistes scientifiques. C’était une façon d’observer concrètement la frontière entre science et société, sous l’angle de la diffusion des savoirs.
En thèse à Paris 4, j’ai ensuite quitté la vulgarisation pour faire une sociologie historique de l’astronomie entre 1880 et 1940. Je me suis intéressé aux effets de l’émergence de la théorie de l’expansion de l’univers sur la communauté des astronomes, et aux résistances – épistémologiques et culturelles – qu’elle a suscitées. Ça ne s’est pas fait « en douceur ».
Le travail reposait surtout sur des archives : observatoires, correspondances, documents administratifs. Certaines archives n’étaient même pas classées. C’était une sociologie historique d’un champ professionnel et de ses organisations.
Ce que j’ai trouvé passionnant, c’est de voir ce que signifiait concrètement « faire de l’astronomie » vers 1900. C’était par exemple… donner l’heure ! Les astronomes étaient chargés de l’heure civile, via l’Observatoire de Paris, et aussi de la météorologie, alors intégrée à l’astronomie. On voit alors se jouer la professionnalisation du métier, avec l’exigence progressive de diplômes, mais aussi les réactions qu’elle suscite, notamment à travers l’astronomie populaire et la vulgarisation. C’est tout cela que j’ai mis au jour dans cette thèse, soutenue en 2008 en Sorbonne.

MCM : Le 8 juillet 2024, vous entrez à l’Assemblée nationale. Vous vous mettez en disponibilité du CNRS. Comment avez-vous vécu ce passage du métier de sociologue à celui de député ? Est-ce une manière de passer de la théorie à l’action ?
ASM : C’est une question difficile, j’y réfléchis encore. Ça fait une dizaine d’années que je fais de la politique “un peu sérieusement”, c’est-à-dire au-delà du canapé et du bulletin de vote. Et assez vite, j’ai vu que ce n’était pas du tout la même chose de faire de la politique et de faire mon boulot de sociologue au CNRS. Pour moi, ces deux répertoires d’action sont disjoints et je fais tout pour les maintenir à distance. J’ai été conseiller municipal d’opposition à Melun, avant d’être député, pendant quatre ans. Et je me suis rendu compte, comme le dit Goffman, qu’il y a des ruptures de cadre. Ça m’est arrivé de faire des argumentations académiques en conseil municipal : je déroulais un truc pendant dix minutes, “Savez-vous ce que la science politique nous apprend sur cette question, Monsieur le Maire ?” Et je voyais les gens : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” (rires)
Ce n’était pas du tout efficace. Le conseil municipal n’a rien à voir avec la science : il faut convaincre, élaborer une ligne, on est dans le registre normatif, dans la bataille souvent. Le travail de diagnostic me sert, oui : je continue à lire les sciences sociales, c’est un réflexe quand j’ai un problème. Même en commission Défense nationale et des forces armées, où je siège : je vais voir ce que produisent les collègues sociologues sur le fait militaire, je lis les war studies. Ça m’aide à comprendre. Mais à un moment, tu fais de la politique : tu prends position, avec tout le vertige de la prise de position. La politique, c’est moins subtil. Elle a ses formats propres. Et ici à l’Assemblée, c’est encore pire : les cadres s’imposent à toi via le règlement intérieur et la bienséance ordinaire. Dans l’hémicycle ou en commission, tu as en général deux minutes pour les interventions ; sur une défense d’amendement, parfois juste une minute. Si tu dépasses, micro coupé, souvent sans possibilité de rebond. Donc non : tu ne fais pas une argumentation ultra sophistiquée avec notes de bas de page. Il y a un format.
Par ailleurs, tu fais partie d’un groupe parlementaire, qui se caractérise par une sociabilité, une ligne politique. Moi j’y contribue sur mes secteurs de compétence. Mais j’importe aussi des éléments de ma socialisation professionnelle : capacité à analyser vite, comprendre les textes. Et parfois ramener de la littérature scientifique quand on en a besoin – c’est fréquent, y compris sur l’environnement.
Je suis aussi membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST. Instance bicamérale : 18 députés, 18 sénateurs, depuis 1983. On se réunit tous les jeudis. On auditionne des spécialistes, on fait des notes. Là, ma formation est utile. J’ai fait une note sur les neurosciences avec une sénatrice. Et j’ai eu entre autres une audition assez serrée avec Stanislas Dehaene, le neuroscientifique qui préside le conseil scientifique de l’Éducation nationale. Il y a d’ailleurs pas mal de parlementaires scientifiques : physiciens, biologistes… Les débats, sur ces questions-là, sont souvent de bonne tenue.
Ensuite, le travail ordinaire au Parlement, c’est deux grandes compétences : la production de la loi, et l’évaluation des politiques publiques – commissions d’enquête, missions d’information. Cette année, j’ai fait une mission d’information avec une députée macroniste, Corinne Vignon, sur l’industrie des satellites. Là, on auditionne, on évalue. Et évidemment, j’ai amené mon expérience de sociologie du spatial dans l’analyse. Ça a beaucoup servi la compréhension des enjeux. Après, il y a la recommandation, et là on revient au politique.
MCM : Il y a aussi d’autres sociologues à l’Assemblée, surtout dans votre groupe…
ASM : Oui : Hadrien Clouet, Marie Mesmeur, les politistes Claire Lejeune et Pierre-Yves Cadalen… On a des gens formés aux sciences sociales et ça infuse dans nos prises de position. C’est important : ça donne une attention à la déconstruction des prénotions, qui sont très fréquentes au Parlement.
MCM : Avez-vous encore le temps de lire ? Et d’écrire ?
ASM : Il y a un épuisement cognitif et physique de la fonction. On est coincé en séance ou en commission, et sinon on est en circonscription : marchés, inaugurations, rendez-vous en permanence parlementaire, repas des aînés… C’est matériel, tu ne peux pas consacrer ce temps à autre chose. Pendant l’examen budgétaire, on est retenu 15 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Moi je vis à une heure porte à porte, donc je peux rentrer voir ma famille, mais c’est bref et pour tout dire frustrant.
Lire, c’est devenu plus difficile. J’ai des collègues qui lisent dans l’hémicycle – souvent de la sociologie, d’ailleurs – moi je n’y arrive pas. Il y a un brouhaha permanent. Donc je lis moins qu’avant ce genre de littérature, alors que c’était mon métier. Je lis surtout des textes qui servent directement mon travail parlementaire. C’est très instrumental. L’écriture en revanche, je la maintiens à fond, je m’oblige : tribunes, une ou deux par mois. J’en ai publié une dizaine à L’Obs depuis mon élection, sur des sujets divers. Et puis il y a le livre Les astrocapitalistes que j’ai publié au printemps dernier : je l’ai fini pendant les vacances de fin d’année 2024, en étant déjà député. Je n’avais pas le choix, j’avais déjà repoussé la parution.

Mais je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à écrire “en sociologue” : argumenter, prendre le temps, mettre des points-virgules, ne pas mettre des points d’exclamation partout… (rires) Pendant trois-quatre jours, tout ce que j’ai écrit était franchement nul. J’ai tout jeté. Puis d’un coup, c’est revenu. Et j’ai conscientisé à quel point j’avais perdu l’habitude de l’écriture sociologique. À tel point que la conclusion du livre est assumée comme très politique. Je l’ai écrite le 20 janvier 2025 – jour de l’investiture de Trump et du double salut nazi de Musk – et pour moi, c’était une confirmation de ce que j’avais anticipé. Là, j’ai matérialisé la distinction sociologie/politique : j’avais du mal à revenir à ce que je faisais avant.
Par exemple, je suis officiellement toujours co-directeur de la revue Zilsel. On sort un nouveau gros numéro de plus de 400 pages. Et c’est une douleur de ne pas être de l’aventure : j’ai reçu le PDF, mais je n’ai rien fichu. C’est notre bébé commun avec Jérôme Lamy, mon frère d’arme intellectuel, et je n’ai même pas relu les épreuves. Le pire, c’est que ça ne m’intéresse même pas sur le moment, tellement j’ai de trucs sur le feu. On est pris par le métier de député. Il y a toujours un coup politique à faire, une réunion, un débat… et c’est beaucoup de stress. Et c’est ça tous les jours : tu joues ta vie politiquement. À la fin, évidemment, tu oublies la sociologie.
Raphaël Schneider (RS) : Vous avez parlé d’une mission d’information que vous avez menée avec une députée macroniste. Comment ça se passe ? Vous travaillez ensemble malgré les désaccords ?
ASM : Oui, ça s’est bien passé. Corinne Vignon fait partie des députés avec qui on peut travailler. Il faut préciser : il y a un droit de tirage. Elle avait suggéré l’idée d’une mission pour faire un état des lieux de l’industrie satellite. Mon groupe a proposé d’en être, mon nom a été suggéré, validé par le bureau de la commission de la Défense où nous ne sommes pas majoritaires. La commission est présidée par un collègue macroniste, Jean-Michel Jacques. Donc on s’est rencontrés. Sa circonscription, à Corinne Vignon, est à Toulouse, elle couvre le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Airbus… donc elle a un enjeu électoral, de relais des inquiétudes industrielles. Moi, j’avais un intérêt presque “de recherche”, en plus de la nécessité de faire le point politique sur la crise des satellites, mais avec des accès que je n’avais pas avant.
MCM : Des portes qui s’ouvrent ?
ASM : Oui. Beaucoup plus facilement. Maintenant ce sont les PDG qui frappent à ma porte. C’est le jour et la nuit. En tant que sociologue, j’avais un mal fou à ouvrir certaines portes. Là, les gens viennent, invitent, proposent.
On a fait une réunion de cadrage, sur la problématisation. J’ai dit ce que j’attendais, et on était assez d’accord. Et sur la critique de la stratégie industrielle de Macron – un des axes – j’ai trouvé mon homologue macroniste finalement assez offensive : dans les auditions, elle fut critique du programme “France 2030”.
On a été très gourmands. Normalement une mission d’information, c’est trois mois. Les administrateurs de l’Assemblée bossent énormément : invitations, questionnaires, rédaction du rapport… nous on amende. Moi, j’ai copieusement amendé, mais tu peux aussi rester “sur des rails”. De mon côté, je ne suivais pas toujours les questions préparées. Et surtout j’ai invité beaucoup de gens que je voulais entendre : experts de politique spatiale, économistes de l’innovation, sociologues… J’ai amené un cadrage par la science, et ça a “biaisé favorablement” la mission dans ce sens-là. On a réussi à obtenir deux mois de plus. On a rencontré 85 personnes – c’est énorme. Et malgré tout, le rapport est plutôt court.
On a réussi à poser un diagnostic commun. Il y a une cinquantaine de recommandations, et seulement une dizaine sur lesquelles on n’est pas d’accord. On a été reçus à Toulouse, au ministère des Armées, par des généraux… J’ai appris plein de choses. Et je n’aurais jamais eu ces accès comme sociologue. Il y a une rétroaction, clairement.
On a présenté le rapport en commission de la Défense, salle remplie, deux anciens ministres… discussion longue. J’ai pu dire des trucs importants, notamment sur la soutenabilité des activités spatiales. Et le mois suivant, j’ai participé aux assises du spatial de la CGT à Toulouse, avec des camarades syndicalistes de Thales, Airbus, ArianeGroup. J’ai pu rappeler que la politique spatiale, ce n’est pas que les PDG, c’est aussi la base, les travailleurs. Et ça, je l’ai aussi dit en commission. Aujourd’hui, certaines recommandations comptent. On a même fait des recommandations très techniques sur des capacités radar, des “trous” capacitaires… qui se retrouveront prochainement discutées dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire.
Donc oui, on a travaillé en transpartisan. Je n’aurais pas accepté si c’était avec le RN – hors de question, la répulsion est aussi politique que physique. Là, ça a été passionnant. Et on continue d’échanger sur les actualités du spatial.
RS : Vous dites que vous n’avez plus le temps de lire de livres, mais est-ce que vous lisez la presse ? Comment vous informez-vous ?
ASM : On est saturés d’informations. On a une revue de presse quotidienne faite par le groupe insoumis : sur l’actualité, sur ce qui circule, et aussi une veille pour la semaine le lundi matin. Et il y a des boucles Telegram où tu peux demander tel ou tel article. Ensuite, selon nos spécialisations, on reçoit les infos des commissions. On est bombardés. Et après, il y a les abonnements : j’ai Le Monde, Libération, Le Parisien, Mediapart, et des revues de sciences (Cosmos, Epsilon, Ciel & Espace, L’Astronomie, La Recherche, Air & Cosmos,etc.). Je me fais ma revue de presse.
RS : Et les réseaux sociaux ?
ASM : Oui, je passe beaucoup de temps dessus, comme tous les députés. Ça pop-up tout le temps, il y a toujours un truc à partager, et nous on produit aussi des contenus. On participe de la bulle.
Je donne un exemple : récemment j’ai présenté à l’Institut La Boétie notre stratégie spatiale, en réponse à celle de Macron. J’ai proposé ça aux camarades députés, et ça intéressait aussi Jean-Luc Mélenchon. Et au même moment, j’étais auditionné à Matignon dans le prolongement de la mission d’information. Donc j’ai commencé à écrire en mai dernier, et j’ai publié une tribune dans L’Obs : “Misère du macronisme spatial”. Je désosse la stratégie très paresseuse de Macron.
On a élaboré notre document : 30 pages, mais pensé à la ligne près. Et ça a été de la politique pure : arbitrages, formulations, ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas. Par exemple, sur le vol habité : Jean-Luc Mélenchon et Bastien Lachaud y tiennent, moi pas du tout. On a eu des discussions longues et passionnées là-dessus. Et finalement, on a décidé que pour l’instant, on n’en parlait plus : pas parce que ce n’est pas intéressant (au contraire, c’est un révélateur très instructif sur le passé et le devenir du spatial), mais parce qu’il y a d’autres priorités. Sauf que cette absence, c’est des mois de discussion. Ça aussi, c’est de la politique : prendre très au sérieux des questions doctrinales, arbitrer sur des fins, etc.
Et évidemment, dès qu’un journaliste attrape une divergence interne, ça devient “la crise”. Quand on est tous d’accord : “secte”. Quand on discute : “schisme”. Moi, j’ai découvert cette écriture politique, doctrinale, où il faut produire de l’adhésion, de l’inspiration. Sur l’espace, on en fait une “nouvelle frontière de l’humanité” avec la mer et le numérique. Et j’assume aussi des passages plus inspirés : on a une page sur les exoplanètes, la recherche de la vie dans l’univers… c’est à la fois scientifique et politique.
RS : Pourquoi publiez-vous dans L’Obs ?
ASM : J’y ai des contacts. Xavier de La Porte, et Rémi Noyon, qui me donnent carte blanche : j’envoie des textes parfois assez durs, ils me disent “parfait”, ils ne corrigent quasiment rien. En ce moment, c’est presque tous les mois.
MCM : Question qui fâche : comment fait-on pour ne pas se couper du monde réel lorsqu’on gagne 5000 euros par mois, voire plus ? Raoul Hedebouw dit : “quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit”. À LFI, les salaires des députés ne sont pas plafonnés, contrairement au Parti du Travail de Belgique.
ASM : C’est une question que je me pose. On entend souvent que les députés gagnent 7000, mais c’est du brut. Moi je suis à environ 5000 net une fois retranchés les impôts sur le revenu, et ensuite il y a la cotisation au parti, aux assos, les contributions quand il y a des caisses de grève… Au final, je suis à peu près à l’équivalent de ce que je gagnais avant en cumulant CNRS, édition, droits d’auteur. J’étais arrivé à 4000, et là je suis autour de 4500. C’est beaucoup, j’en suis conscient. Je ne sais pas jusqu’à quel point c’est justifiable, mais c’est comme ça. Et moi ce que j’observe, c’est l’investissement dans le travail : parfois j’ai envie de dire “mais vas-y… prends le salaire, fais pareil”. Je ne dis pas ça pour héroïser : juste, il faut mesurer l’intensité.
Pour moi, la politique n’est pas une carrière. J’y passerai le temps qu’il faudra, mais je ne vais pas y faire ma vie. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et je n’ai même pas le temps de dépenser l’argent : le peu que j’économise, c’est du matériel d’astronomie, d’ailleurs j’ai tout déclaré – j’ai vérifiable sur le site de la HATVP dans la section patrimoine.

Je ne fais pas ça pour l’argent et je ne vois personne faire ça pour l’argent dans mon groupe. Ce que je vois, c’est surtout l’usure physique, les sacrifices personnels et familiaux. Quand tu es là 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et que tu n’as pas vu ta fille de douze ans depuis quinze jours… ambiance. Ce n’est pas pour faire pleurer, mais la critique du parlementarisme peut être démagogique. Oui, il y a des députés qui n’en foutent pas une. Mais moi, je ne cumule pas. J’aurais pu garder des mandats locaux, 500 euros de plus : je les ai confiés à des camarades insoumis qui ont pris le relais – avec efficacité en plus. Je suis en disponibilité du CNRS : carrière gelée. J’aurais pu demander un détachement. Et je continue à diriger des thèses, à participer à des comités, gratuitement. Donc ce n’est pas à moi qu’on fera la critique d’un investissement intéressé !
RS : Mais est-ce que le problème n’est pas mal posé ? On sent que vous n’êtes pas un individu cupide… Mais est-ce que des gens comme vous ne sont pas conduits à se dire qu’ils y passent trop de temps, que l’organisation de la vie de député n’est pas normale, trop chronophage, et donc veulent lâcher l’affaire ?
ASM : En effet, on nous en demande beaucoup. C’est un boulot pas possible. On attend de moi que je sois en circonscription samedi, dimanche : je suis allé au marché. Les administrés sont contents de me voir, mais aussi : “Ah, ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu… Ah, vous êtes là ?” On te demande d’être partout. Et moi je réponds : “Vous m’avez élu pour quoi ? Pour voter des lois ! Pour être au Parlement !”
Et à La France insoumise, on s’en colle un peu plus : il y a le travail parlementaire, mais il y a aussi tout ce qu’on se colle à côté. Je suis par exemple député référent dans le Cher. Je dois développer le mouvement à Vierzon, Bourges, dans des villages. J’ai fait ma tournée cet été en voiture. Et en même temps, je suis député de Seine-et-Marne. Donc oui, c’est très haché, il y a des urgences permanentes. L’agenda parlementaire évolue tout le temps. On a des votes solennels, il faut être là pour presser le bouton. J’ai des rendez-vous que j’ai décalés quatre fois. L’agenda est constamment réactualisé.
Et puis il y a l’organisation matérielle. J’ai l’enveloppe de 12 000 euros pour constituer mon cabinet : une directrice de cabinet, une attachée en circo, un attaché com, un alternant… mais ce n’est jamais suffisant. Quand c’est le PLF (projet de loi de finances), on reçoit 400 mails par jour. Tous les lobbys écrivent, tout le monde sollicite. Et en circo tu reçois aussi des demandes de rendez-vous, souvent sur des sujets qui ne relèvent pas de ta compétence : régularisations, logement, dossiers inextricables. On intervient auprès du préfet, on écrit à la région pour aider un maire à obtenir une subvention… tout un travail de coulisses.
Et puis il y a la représentation : être sur les marchés, les cérémonies… Moi je le fais, j’adore même aller sur les marchés avec mon écharpe : je sors la table, les tracts, je vais parler aux gens. Mais c’est du temps que je ne consacre pas aux tâches ici à l’Assemblée. Il faut arbitrer en permanence. Et le danger, c’est de se faire aspirer : burn-out. Il y en a. Ou alors les substances dopantes pour tenir – je n’y ai pas recours. Il y a une usure physique du mandat.
Aujourd’hui on est aspirés par des flux d’informations : on est constamment “sur le grill”. Injonction à être présent, à être pertinent, à rendre des comptes. Moi je le fais : j’ai une page Facebook qui est un journal de bord, j’écris tous les jours ce que j’ai fait. Certains disent que je “tartine” trop, mais je préfère ça à l’inverse.
RS : Ça, c’est votre effet chercheur, votre capital culturel.
ASM : Oui, peut-être. Mais je vois aussi que des gens aiment qu’on prenne la politique au sérieux. Je me souviens des discussions avec un militant qui a connu Solférino dans les années 80. Il me dit : “Tout ce que tu fais, tout ce que tu écris…” Il m’encourage et ça fait plaisir – notamment dans les moments de doute, parce qu’il y en a. Les “initiés” voient quand tu fais un travail sérieux, quand tu endosses le rôle à fond et avec une certaine sincérité d’engagement. Pour moi, c’est un ressort fondamentalement éthique. Je suis élu pour servir l’intérêt général : je pèse mes mots.
Et je ne vais pas faire semblant : je suis député, je suis dans la classe politique. Et si on veut faire bien le boulot, c’est impossible et ingrat. Et oui, j’en vois qui font un travail de fond énorme depuis des années, au point d’y laisser parfois leur famille.
MCM : Comment votre milieu professionnel a accueilli votre élection ? En tant qu’insoumis ? La bourgeoisie culturelle aime bien critiquer Mélenchon, mais finalement elle vote pour lui : il y a quelque chose d’hypocrite…
ASM : Déjà, ça fait longtemps que je fais de la politique : conseiller municipal, je ne l’ai jamais caché. Mon employeur le savait. J’ai toujours porté les couleurs de LFI, sans dissimulation. Et surtout, j’ai toujours travaillé une division claire entre science et politique, par honnêteté : ça nuit au mouvement politique si tu mélanges tout, et ça nuit à la science aussi. Quand je fais de l’expertise, des débats publics, c’est le sociologue qui intervient – ce que Michael Burawoy appelle la sociologie publique. Et quand j’étais sur un plateau de France Culture ou Inter (enfin, ça c’était avant : je ne suis hélas plus invité), je reformulais souvent : “Vous vous adressez à qui ? Au sociologue ?” Et selon ça, j’aménageais ma réponse.
Ce qui me frappe, dans les discussions avec des collègues et amis, c’est le niveau de méconnaissance du champ politique. Y compris chez des gens dont c’est le métier d’étudier la politique ! Il y a des approximations, des projections… une méconnaissance de la matérialité politique. Plus je m’approche des cercles du pouvoir, plus ça “dédramatise” la politique. Tu vas à la buvette, et tu as Marine Le Pen à un mètre : coprésence vertigineuse. Interagir avec un ministre, je sais faire désormais, ça ne m’impressionne plus. Matignon, je vois ce que c’est. L’Élysée aussi.
Et il y a des lieux où c’est encore plus frappant : l’IHEDN par exemple (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) où je suis auditeur cette année. Je fréquente des colonels, des généraux, des gens qui ont pris de grandes décisions. Franchement, ça dédramatise complètement. À l’école militaire, ça a “défrisé” d’avoir un député insoumis dans une section souvent perçue comme à droite : je suis devenu une sorte de curiosité, voire de mascotte (rires). On passe de bons moments, et il y a des gens passionnants.
Donc j’ai maintenant une connaissance approchée du pouvoir, très empirique, mais pas comme un sociologue qui ferait un terrain : comme quelqu’un qui est dans le game. Et quand j’entends certains universitaires parler de politique, je me dis parfois : “bof”. Ils n’ont pas les éléments d’un insider. Moi, par exemple, le mardi à 11h, j’ai la réunion du groupe parlementaire LFI. Je sais ce qu’il s’y passe, et je ne dirai pas ce qu’il s’y passe, évidemment : c’est le fight club (rires). Mais de l’intérieur, ce n’est pas ce que racontent certains dans des essais mal fichus et mensongers sur une inscrutable “meute”. Et tant mieux si ça ne sort plus. Parce que parmi les points communs entre science et politique, il y a la discipline. Pas au sens autoritaire : au sens de ce qu’on construit ensemble, avec de la confiance, pour pouvoir se dire les choses franchement sans que ça se retrouve dans la presse, et pour avancer ensemble selon une ligne travaillée collectivement.
MCM : Parce qu’il n’y a pas la crainte que ça se retrouve dans les colonnes du Canard enchaîné ou du Monde…
ASM : Exactement. Et donc on peut avoir des débats durs, des débats de fond. Sur la stratégie spatiale, ça a été sportif : on n’était pas toujours d’accord sur tel ou tel point, ou à tout le moins il fallait préciser. Ça a pris du temps. Et moi j’ai bougé sur ma ligne, j’ai accueilli celle d’autres camarades. La ligne finale est bien plus intéressante que ce que j’avais proposé initialement. La friction produit de bonnes choses !
Et puis il y a aussi des cadres très concrets : quand tu es briefé DGSE ou DGSI, ou avec l’état-major, ton téléphone reste à l’entrée. Ça, en tant que sociologue, je n’y avais pas accès. Comme député, ma connaissance est plus fine.
Donc oui : ça donne envie d’écrire une sociologie de l’intérieur. C’est en négociation avec un éditeur, je n’en dis pas plus. Mais évidemment que je vais mettre à profit cette connaissance.
MCM : Il y a régulièrement des attaques contre Mélenchon : antidémocratisme, antisémitisme supposé… Mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui l’argument principal, ce n’est même plus le fond : c’est le sondage. Et l’idée qu’il perdrait automatiquement face à Bardella au second tour. Qu’en pensez-vous ?
ASM : C’est le bruit de fond médiatique, on ne va pas faire semblant que ça n’existe pas. Moi je vais répondre de façon empirique, donc forcément biaisée. Je le connaissais de loin avant d’être député, comme militant insoumis depuis 2017, j’avais déjeuné avec lui une fois en 2023. Depuis que je suis à l’Assemblée, on s’est vus plusieurs fois. Je l’ai fait venir à Toulouse pour un colloque de l’Institut La Boétie sur l’espace. Je l’ai fait venir aussi aux Rencontres du Ciel et de l’Espace. On échange beaucoup sur l’astronomie, la science, le spatial. Il me demande mon avis. On a des discussions riches sur les trous noirs, l’univers, les technologies spatiales… C’est rare chez un responsable politique !
Moi, je l’admire très sincèrement : sa capacité de travail, sa curiosité, sa capacité d’étonnement. Quand j’écris une tribune, il veut qu’on lui envoie : ça l’intéresse. Et il fait ça avec beaucoup de députés et de militants. Il avance, y compris sur sa propre ligne.
À Toulouse, c’était la première fois que j’organisais un colloque en tant que député : il y avait du monde, beaucoup de panels J’ai mis l’événement sur notre plateforme Action Populaire le mardi pour le samedi : la salle était blindée. Juste avant, on a parlé une heure d’astronomie. Et la “Nuit des étoiles” aux Amfis d’été en août 2025 : c’est son idée, moi je l’ai mise en œuvre. Il a une vraie appétence intellectuelle.
Et ensuite, tu le ramènes dans la salle : tu vois l’effet Mélenchon. Je n’ai pas vu ça avec d’autres. Aux Rencontres du Ciel et de l’Espace, à la Villette, je lui dis : “Viens, je vais te montrer l’astronomie amateur.” Il reste cinq heures, je lui fais rencontrer tout le monde : Association Française d’Astronomie, Société astronomique de France, rédactions, astronomes amateurs, vendeurs d’instruments… Il trouve ça génial. Et personne ne s’est plaint. Au contraire : selfies en continu !
Après, oui, on tracte souvent vent de face. En 2021, tout le monde disait qu’il fallait qu’il se retire, qu’il avait fait son temps… Et au premier meeting présidentiel, c’était énorme. Personne ne fait ça à gauche. Je discute avec des socialistes, des écolos : ils voient l’Institut La Boétie, ils jalousent. Ils copient même : l’académie Léon Blum du PS, c’est une copie conforme, mais sans les intellos (rires).
Jean-Luc Mélenchon, c’est un chef d’orchestre. Je vais souvent au “moment politique”, je suis bluffé : 1h30, il met en intrigue, il fait de l’éducation populaire, il commence large, resserre, redécolle, finit sur l’espoir, avec de l’humour, beaucoup de savoir, des références savantes. À son âge, quelle machine ! Moi, quand je fais des meetings je m’épuise au bout d’une demi-heure.
Et Bardella… comment dire… pour moi c’est une tranche de jambon sous cellophane. Comme Glucksmann. À gauche, il n’y a pas de concurrence à ce niveau-là : ils se feront atomiser. Et en plus, il y a une relève très forte à LFI : Bompard, Guetté, Clouet… des valeurs sûres et un énorme potentiel. Et il y a aussi des gens pas encore visibles : des collaborateurs du groupe parlementaire qui se forment, des militants partout dans les groupes d’action, beaucoup d’envie et de savoir-faire. Si on gagne en 2027, il faudra un gouvernement, un groupe 2.0… tout ça se prépare. Nous y sommes prêts.
Donc je refuse l’effet “oracle”, le fatalisme, les prophéties autoréalisatrices neurasthéniques (j’ai trop lu Merton pour m’y faire prendre). Moi, je ne devais pas être député : ma circo était à droite depuis 40 ans. Campagne dure, triangulaire… et j’ai gagné. Je n’ai pas dormi pendant des semaines. Si j’avais écouté les oiseaux de mauvais augure, je n’y serais pas allé. Donc aujourd’hui, quand on me dit : “en cas de dissolution ça va être compliqué”… je réponds : forcément ! Livrons bataille de bon cœur et en conviction ! Quoi qu’il arrive, il va falloir venir nous chercher. C’est le couteau entre les dents.
MCM : Avant la présidentielle, il y a d’abord les municipales en mars prochain. En 2020, les insoumis avaient enjambé ces élections. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Et il y a des victoires de gauche dans des métropoles états-uniennes : Zohran Mamdani à New York, Katie Wilson à Seattle… Est-ce que ça nous apprend quelque chose ou le contexte est trop différent ?
ASM : Je pense que c’est “bon à penser”. Ça existe. Et c’est une mine radicale et joyeuse. Ça donne envie – et ça, c’est la clé. Il ne suffit pas de produire de l’adhésion rationnelle, de l’adhésion sur le fond : il faut que les gens aient envie d’y aller, qu’ils puissent convaincre autour d’eux. Il faut élargir et susciter de l’enthousiasme.
Moi, les campagnes qui marchent chez moi, c’est des campagnes offensives, combatives et joyeuses. Je chambre les adversaires, et je fonctionne beaucoup à l’auto-dérision. Les militants ne se privent pas de se moquer de moi quand je fais une connerie. Hier, j’ai reçu un détournement où j’apparais en curé sur une photo, parce que j’avais pris en photo la crèche de Melun. Une copine a fait un montage, je l’ai relayé. Ça participe de la distance au rôle. Le jour où je n’arrive plus à rire de moi, ce sera mauvais signe. Je déteste l’esprit de sérieux.
MCM : Vous faites beaucoup de porte-à-porte aussi.
ASM : Oui. Et beaucoup pensent que tout se passe sur les réseaux. Mais là, par exemple, j’accompagne Rémy Béhagle, le candidat LFI aux municipales à Melun : samedi après-midi, porte-à-porte dans un quartier populaire où je suis bien reçu, où les gens me connaissent, parce que j’ai mené des combats “en désintéressement”. J’ai fait le lien entre journalistes et habitants, avec les autorités administratives, sans apparaître : je ne fais pas ma retape. Et les gens le voient : ils me disent que je n’instrumentalise pas. Pour moi, c’est un critère moral important.
J’adore le porte-à-porte. Tu entres dans la vie des gens. Certains ouvrent en short, claquettes. Moi j’y vais en cravate : je suis député (rires). Et tu as de tout : des sourires, des discussions, du désarroi, de la souffrance. Quand tu visites une tour de 15 étages, c’est long et fastidieux, mais tu auras vu tout le monde. Et surtout, ça produit des effets durables. Il y a des gens aujourd’hui militants à Melun qui ont découvert LFI comme ça, parce qu’on a toqué chez eux. On a un jeune de 19 ans, génial : des Insoumis ont toqué chez lui pendant ma campagne, c’était la première fois qu’une force politique venait jusqu’à lui. La politique est venue à lui. Et maintenant il est dans l’équipe. Donc oui, on amène des gens à la politique et on en est fiers. Pas à des fins électoralistes : il faut construire au ras du sol un lien politique, parce qu’on croit à une cause, et entretenant le lien. C’est de la haute couture politique.
Et on ne va pas seulement dans les endroits où c’est facile. Ma circo c’est 130 000 habitants. À Melun je fais des scores… très hauts. À Barbizon, je fais 16 voix. Eh bien j’y vais. Je vois les maires, souvent de droite. Et on parle service public, transport scolaire, etc. Tu peux parfois atténuer des problèmes concrets.
Sur les municipales, il y a un enjeu : on a fait la convention LFI à Aubervilliers. J’ai trouvé ça super beau. Et le mouvement réfléchit : on a théorisé le communalisme insoumis, on travaille avec des politistes – des collègues que je côtoyais naguère à l’EHESS où j’ai mon bureau. On actualise le programme. Et localement, c’est à géométrie variable : parfois on y va seuls, parfois en alliance, selon les configurations. Quand on peut y aller seuls, on met la pression en “mouillant la chemise”. Les habitants nous voient faire.
Moi, ce que je constate, c’est que d’autres partis de gauche ne savent plus militer. J’ai fait des négociations interpartis : “Vous amenez quoi ?” À part la soupe de logos, ta place sur la liste… c’est quoi votre plus-value en termes d’actions et d’apport d’idées ? Souvent, rien : tambouille. Ça me déprime et c’est la raison pour laquelle je ne m’étais pas mouillé en politique. Le PS et le PCF, comme j’ai pu le constater dans des négociations, ne veulent qu’une place pour pouvoir peser aux sénatoriales… Bon. Après, il y a aussi des endroits où ça se passe bien : à Dammarie-les-Lys, dans ma circo, on est derrière le PCF, et je l’ai fait valider par notre comité électoral.
Mais une chose est sûre : il faut se développer dans les mairies. En tant qu’ancien élu local, je peux dire que c’est passionnant : éducation, voirie… La voirie, ça paraît chiant, mais c’est super intéressant : pistes cyclables, bancs, éclairage, maintenance – c’est hyper politique, en fait. J’ai même déposé une proposition de loi pour préserver l’environnement nocturne. Et j’ai fait venir à l’Assemblée Patrick Proisy, le maire de Faches-Thumesnil, une des rares mairies insoumises. Ils font l’extinction partielle, ils appellent ça des “radicalités concrètes”. Dans une ville de 20 000 habitants, ils font des trucs super.
Et c’est dommage de laisser toutes ces communes aux socialistes qui font une gestion interchangeable avec la droite. Moi je l’ai vu dans les structures intercommunales, les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) : le clivage droite-gauche s’efface, on fait de l’“attractivité économique”, des compétences techniques, des acronymes… et ça tue la politique. Ça a puissamment détruit le lien des citoyens avec la chose publique au niveau local.
Quand j’étais élu d’opposition, je prenais la parole pour dire : “si j’étais au pouvoir, on démonterait cette structure”, et j’argumentais. Il faut repolitiser ces espaces, remettre les pieds dans le plat, conquérir des mairies, pour transformer concrètement la vie des gens.
C’est aussi pour ça qu’on n’enjambe pas les municipales cette fois-ci : on a affiné la ligne, y compris sur des sujets très techniques. La gestion d’une commune peut être chiantissime, le défi c’est de rendre ça intéressant — et de faire revenir les gens en politique.

Entretien réalisé par Manuel Cervera-Marzal et Raphaël Schneider, à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 2025.
Pour prolonger
- Pour Bourdieu, beaucoup de choix « personnels » (école, goûts, culture) sont en réalité socialement fabriqués et reproduisent des hiérarchies ; pour Boudon, ces choix s’expliquent par des calculs raisonnables dans une situation donnée. En simplifiant, Bourdieu décrit la façon dont le social façonne les individus, quand Boudon montre comment les individus raisonnables façonnent du social – et la querelle tourne autour du poids relatif de ces deux niveaux.
 ︎
︎ - En 1996, le physicien Alan Sokal publie un article volontairement absurde dans la revue Social Text. Truffé de références savantes mal comprises et de jargon postmoderniste, le texte visait à montrer que certains discours relativistes pouvaient être acceptés sans véritable contrôle scientifique, dès lors qu’ils flattaient une orientation idéologique. Dans la foulée, Sokal publie avec le physicien Jean Bricmont le livre Impostures intellectuelles (1997). L’ouvrage critique l’usage abusif ou métaphorique de concepts issus des sciences dures (mathématiques, physique) par certains intellectuels français (Lacan, Kristeva, Deleuze, Baudrillard, etc.). Leur thèse centrale est que cet usage confus brouille la frontière entre rigueur scientifique et rhétorique, et affaiblit la crédibilité des sciences humaines et sociales.
 ︎
︎
17.12.2025 à 17:34
Les états désunis du dollar
Laurent BARONIAN
Texte intégral (5663 mots)
« Dans les événements historiques, écrivait Tolstoï, les prétendus grands hommes ne sont que des étiquettes qui doivent leur nom à l’événement ». C’est aussi vrai des hommes grotesques que l’histoire appelle parfois à la rescousse lorsque les grandes issues sont bouchées. Ainsi la publication en novembre 2024 du Guide de l’utilisateur pour la restructuration du commerce mondial1par Stephen Miran, futur conseiller économique de Donald Trump, nous révèle qu’avec sa personnalité brutale et imprévisible, l’homme d’affaires est, avant de provoquer des situations politiques nouvelles, l’homme de la situation. Car dans la conduite d’une guerre tarifaire débutée déjà de longue date par les États-Unis, « l’incertitude quant à savoir si, quand et dans quelle mesure cela se produira renforce le pouvoir de négociation en suscitant la peur et le doute »2. Mais de quelle négociation s’agit-il ?
Le dollar : du privilège exorbitant au fardeau exorbitant
Le rapport de Miran s’appuie sur un constat désormais classique sur la position commerciale des États-Unis. Le dollar étant demandé comme monnaie de réserve internationale en plus de ses fonctions domestiques, il est surévalué relativement à l’état de la balance commerciale des États-Unis. Or cette surévaluation ne cesse d’aggraver son déséquilibre avec le reste du monde, étant donné qu’un dollar fort grève la compétitivité de l’industrie domestique et rend meilleur marché les produits importés. C’est pourquoi le privilège exorbitant du dollar, qui permet à son émetteur de financer indéfiniment ses déficits courants – par l’émission de bons du Trésor –, s’est transformé selon Miran en un fardeau exorbitant, à mesure que décline la part des États-Unis dans la croissance du PIB mondial.

Car plus cet écart de croissances s’élargit, plus la demande de dollar comme monnaie de réserve augmente relativement à la part déclinante des États-Unis dans le commerce mondial, et plus aussi se creusent les déficits courants3. Or avec cet écart, augmente du même coup le risque d’une perte de confiance dans le dollar, et surtout dans le bon du Trésor, placement favori de l’épargne mondiale, grâce auquel l’État finance son déficit. Il s’agit donc de prendre les mesures qui restaurent la compétitivité des États-Unis, mais sans affaiblir le dollar dans son statut d’actif de réserve. Bref : un dollar fort pour sa fonction de réserve de valeur, et faible pour sa fonction de moyen d’échange.
L’impossible répétition de l’Accord Plaza
N’est-ce pas ce qu’avait su faire Reagan en 1985, en faisant signer à l’hôtel Plaza de New York un accord des pays du G5 sur une action concertée de dépréciation du dollar sur le marché des changes ? Le dollar pouvait bien baisser, il était en ce temps-là la monnaie de réserve incontestée du capitalisme mondial. Mais surtout, Miran sait bien que la Chine de 2025 n’a pas les dispositions conciliantes du Japon de 1985, que l’UE n’a plus l’aisance commerciale de l’Allemagne d’hier.
À défaut de nouveaux Accords du Plaza4 avec les grandes puissances économiques du moment, Miran appelle au lancement d’une guerre commerciale ouverte frappant leurs exportations, et les forçant à s’ouvrir aux produits états-uniens. Bien plus, cette offensive tiendrait lieu de guerre préventive avant la signature d’un nouvel accord, cette fois sous les ornements douteux de la résidence floridienne de Trump à Mar-a-lago. Les experts ont beaucoup ironisé sur la malheureuse comparaison entre les Accords du Plaza et d’hypothétiques Accords de Mar-a-Lago : non seulement les États-Unis ne sont plus entourés de leurs bons alliés de l’après seconde-guerre mais, surtout, Reagan voulait justement éviter, par ses Accords, des mesures tarifaires agressives que les Démocrates du Congrès réclamaient contre le Japon et l’Europe. En 1985, les États-Unis ménageaient leurs alliés pour consolider un marché mondial dont ils étaient le grand commissaire-priseur : quelques jours après leur signature, Reagan lançait en effet les négociations de l’Uruguay Round dans le cadre du GATT, en vue d’abaisser les barrières douanières dans la perspective de la création de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Quarante ans plus tard, c’est avec le pistolet commercial sur la tempe que les États-Unis arracheraient un accord, avec cette fois l’OTAN comme institution d’appui : « Supposons que les États-Unis imposent des droits de douane à leurs partenaires de l’OTAN et menacent d’affaiblir leurs obligations de défense commune au sein de l’OTAN s’ils sont frappés par des droits de douane de rétorsion »5. Si bien que les motifs avancés pour une guerre des douanes se contredisent entre eux : les taxes doivent servir tantôt de moyen de pression, voire de rétorsion, contre les partenaires commerciaux des États-Unis, tantôt à financer durablement les déficits budgétaires et les réductions d’impôts aux entreprises, et l’abaissement des charges sociales, qui sont pour Trump les deux piliers du MAGA. Or avec des droits de douane sur les importations, il faudra s’attendre à une hausse de l’inflation du fait du renchérissement des biens étrangers (les derniers chiffres le confirment6) qui poussera la Fed à relever les taux d’intérêt. Mais des taux élevés stimulent la demande de dollar et donc la hausse du taux de change – et un dollar plus fort qui s’ensuivra augmentera à son tour le déficit commercial des États-Unis.
Et si l’on imagine un instant que les mesures produisent l’effet attendu d’une baisse du dollar, Miran admet qu’elle entraînerait une baisse massive de la valeur de l’épargne mondiale investie en bons du Trésor et donc aussi une vente massive de ces titres qui précipitera davantage encore la baisse de leur valeur. Comme cette vente entraînera une hausse des taux d’intérêt sur ces bons7 et donc une hausse du déficit courant, on forcera les détenteurs étrangers à les échanger contre des obligations à cent ans « zéro coupon », c’est-à-dire ne portant pas intérêt. « Afin d’atténuer les conséquences financières indésirables potentielles (telles que la hausse des taux d’intérêt), la vente de réserves peut s’accompagner d’un allongement de la durée des réserves restantes. La demande accrue de dette à long terme par les gestionnaires de réserves contribuera à maintenir les taux d’intérêt à un niveau bas […] Si l’allongement de la durée se fait sous la forme d’obligations spéciales à cent ans, […] la pression financière sur les contribuables américains pour le financement de la sécurité mondiale s’en trouve considérablement allégée. Le Trésor américain peut effectivement racheter la durée sur le marché et remplacer cet emprunt par des obligations à cent ans vendues au secteur officiel étranger [banques centrales, agences publiques, fonds souverains, etc.]. De tels accords de Mar-a-Lago donnent forme à une version du XXIe siècle d’un accord monétaire multilatéral »8. Mais il faudrait d’abord prendre la mesure XXIe siècle où ce ne sont pas seulement les supposés signataires des accords, mais le dollar lui-même qui a changé de résidence. Aujourd’hui seuls 16 % des réserves en dollars sont entre les mains des banquiers centraux étrangers, contre plus de 60 % circulant entre les comptes des institutions privées du système financier international9. C’est que le dollar n’est plus seulement la grande devise des réserves des institutions officielles de l’axiomatique capitaliste, il s’impose comme le premier véhicule du capitalisme mondial.
Le nouveau dilemme de Triffin
On a beaucoup critiqué Miran pour ses incohérences et simplifications10. Mais ses détracteurs lui font un mauvais procès, car il se débat au milieu d’une contradiction plus profonde, qu’ils feignent d’ignorer plus que lui encore, entre le degré d’autonomie relative du dollar par rapport à son pays émetteur et le niveau de déclin relatif du rôle économique des États-Unis eux-mêmes. En un sens, le dollar est devenu le problème des États-Unis parce qu’il n’est plus seulement, et depuis longtemps, la monnaie des États-Unis. Ainsi dans le commerce, 54 % des transactions sont toujours facturées en dollars, soit 5 fois plus que la part des États-Unis dans le commerce mondial, tandis que sa part dans le PIB mondial n’est plus que de 15 %. Dans les coffres des banques centrales, plus de 60 % des réserves sont déclarées en dollars et ces chiffres sous-estimeraient la réalité du phénomène selon le FMI. En outre, plus de la moitié des pays de notre globe ancrent leur monnaie au dollar et 50 % environ du PIB mondial est ancré au dollar11. Par cet arrimage universel, que le marché des changes manifeste par l’usage du dollar dans près de 90 % des transactions, le dollar jouit plus d’un privilège d’insularité (privileged insularity) que d’un privilège exorbitant : une variation du taux de change n’affecte pas les prix des biens importés libellés dans des monnaies ancrées au dollar. C’est bien cette autonomie qui explique la tournure embarrassée du plaidoyer de Miran, c’est elle qui joue comme un retour du refoulé à chaque objection qu’il fait à ses propres propositions. Il le reconnaît en un sens, en qualifiant la situation des États-Unis de « monde de Triffin » dans lequel « les actifs de réserve constituent une espèce de masse monétaire mondiale, et leur demande dépend du commerce mondial et de l’épargne mondiale, et non de la balance commerciale intérieure ou des caractéristiques de rendement du pays détenteur des réserves »12.
Mais que ce monde a changé depuis que l’économiste Robert Triffin a énoncé son fameux dilemme en 196013 ! Il remarquait que le système monétaire international ne pouvait fonctionner que si le pays émetteur de la monnaie de réserve, les États-Unis donc, créait une quantité suffisante de liquidités pour le commerce mondial. Mais créer de la liquidité, cela revient à financer son commerce sans contrepartie, c’est donc créer des déficits extérieurs (c’est-à-dire des déficits commerciaux et plus généralement des déficits de la balance des paiements du pays émetteur) en alimentant le marché mondial en dollars créés par la planche à billets. Or ces déficits continuels risquaient de saper la confiance dans la monnaie de réserve, car les autres pays se mettraient à douter de la capacité de l’émetteur à garantir la convertibilité du billet vert en or (sur laquelle reposait la valeur du dollar, en tant que monnaie pivot du système de Bretton Woods). Donc, si le pays émetteur ne fournit pas assez de liquidités, le commerce et la croissance mondiaux sont freinés ; s’il en fournit trop en accumulant des déficits, la valeur et la stabilité de sa monnaie sont remises en cause.
La variable ultime : le travailleur états-unien
Triffin ne craignait donc pas tant les déficits (la balance commerciale des États-Unis était excédentaire à son époque) que la convertibilité d’un dollar surabondant sur les marchés mondiaux. Pourtant, la fin de la convertibilité du dollar décidée par Nixon en 1971 n’a pas fait disparaître le dilemme : elle l’a déplacé au niveau de la capacité fiscale des États-Unis à soutenir leur dette publique, et honorer leurs obligations vis-à-vis de ses créanciers. Et ce déplacement tient au rôle nouveau des obligations du Trésor des États-Unis. C’est que, non seulement les banques centrales conservent des dollars sous la forme de bons du Trésor, mais cette quasi-monnaie portant intérêt constitue désormais l’actif sûr pour toutes les opérations financières intervenant aussi bien sur les marchés financiers que dans les systèmes de paiements des banques onshore et offshore dans lesquels le dollar est la monnaie véhiculaire. Aussi le dilemme de Triffin trouve-t-il à s’exprimer désormais dans la contradiction entre l’accroissement des déficits de la balance des paiements (nécessaire à la fourniture de liquidité en dollars pour le reste du monde), et la capacité fiscale des États-Unis à émettre de la dette (pour garantir au dollar sa fonction de réserve de valeur).
D’où l’équation impossible de Miran : baisser la valeur du dollar, c’est affaiblir le statut d’actif sûr qu’est le bon du Trésor, c’est donc augmenter son prix et par là-même le déficit budgétaire des États-Unis. Mais augmenter le déficit, c’est provoquer plus d’inflation et donc baisser la compétitivité des produits domestiques. Miran reconnaît ces difficultés et, devant la fragilité de ses propres mesures, finit toujours par recourir à la seule variable économique encore aux mains du politique en matière de dollar : la force de travail. Si le taux de change augmente par suite de la hausse des tarifs – du fait de la hausse de la demande de dollar qui s’ensuivra, « [l]es décideurs politiques peuvent en partie atténuer les freins aux exportations par un programme de déréglementation agressif, qui contribue à rendre la production américaine plus compétitive »14. Et même si, comme l’espère Miran, le taux de change n’augmente pas, ce sera au travailleur américain de payer pour la hausse des tarifs en achetant plus cher ses biens de consommation, d’où, là aussi, une baisse de son salaire réel.
Les fissures chinoises du mur tarifaire
Jusqu’ici nous avons à peine évoqué la Chine. C’est elle pourtant qui justifie la tournure martiale du commerce extérieur voulue par Miran : « Les pays qui souhaitent bénéficier du parapluie militaire doivent être aussi sous le parapluie du commerce équitable. Un tel outil peut être utilisé pour faire pression sur d’autres nations afin qu’elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale en matière de droits de douane »15. Dix-huit siècles après que la Chine a débuté la construction de la Grande Muraille pour repousser les menaces de ses voisins barbares, c’est au tour de ces derniers d’ériger autour d’elle un « Mur tarifaire mondial ». On dirait que l’administration Trump a inventé une nouvelle variante de la formule de Clausewitz qui fait du commerce l’anticipation de la guerre par d’autres moyens que la politique. Pour le secrétaire au Trésor Scott Bessent, une segmentation plus claire de l’économie internationale en zones fondées sur des systèmes économiques et de sécurité communs contribuerait à mettre en évidence la persistance des déséquilibres et à introduire davantage de points de friction pour y remédier »16. C’est au fond la seule certitude de Miran : quels qu’en soient les effets, ses mesures dessineront une démarcation plus nette entre amis et ennemis, et élèveront les risques de sécurité.

Mais Miran s’attend aussi à ce que ces grandes manœuvres précipitent la recherche d’alternatives au dollar, déjà en marche avec le yuan qui, même s’il ne représente encore que 4% des paiements internationaux et 2% des réserves de change mondiales, a vu sa part doubler depuis 2022. Dans le commerce chinois, son usage dans le règlement des transactions est passé de 14% en 2019 à plus de 30% aujourd’hui, et plus de 50% des flux transfrontaliers sont désormais effectués dans cette devise, contre moins de 1% en 2010. Si l’on veut savoir pourquoi Trump cherche à sortir du bourbier ukrainien, il faut moins consulter les chiffres du Trésor états-unien que les statistiques du système bancaire chinois : la Banque centrale chinoise a fourni 4,5 trillions de yuans (environ 630 milliards de dollars) de lignes de swap à 32 banques centrales, et le système de paiement CIPS, l’équivalent chinois de SWIFT, accueille désormais plus de 1 700 banques, soit une augmentation de 3% depuis 2022 et gère un volume de paiements qui ont grimpé de 43% en 2024, atteignant 175 trillions de yuans (environ 24 trillions de dollars). Quant aux prêts extérieurs des banques chinoises en yuan, ils ont triplé depuis 202217. La Chine ne s’oppose pas à la mondialisation par une réorganisation sino-centrée du marché mondial18, elle relance la mondialisation de tous les marchés en renouvelant les institutions de la finance mondialisée.
Le retour du réel après le Liberation Day
Près de huit mois après le « Liberation Day » dont Trump espérait surtout qu’il libèrerait les États-Unis des lois du commerce international, son administration semble admettre au moins que, si la hausse des droits de douanes a des effets incertains sur les prix, une baisse de ces droits doit assurément diminuer les prix des biens concernés. Aussi face à un pouvoir d’achat qui ne cesse de s’éroder, elle s’est résolue à une baisse drastique des droits de douane sur certains produits alimentaires, textiles, et même pharmaceutiques, importés d’Amérique latine.
Mais ce n’est pas tout : le « Liberation Day » devait aussi, grâce au recours à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEA), libérer Trump du droit de regard du Congrès dans la conduite de sa guerre commerciale. Il a sans doute touché ici aux limites institutionnelles que même ses plus fervents partisans à la Cour suprême ne sont pas prêts à voir repousser. Ainsi la Cour a récemment émis un avis plus que réservé sur cet expédient, manière de mettre en doute l’urgence sécuritaire de la balance commerciale de la première puissance mondiale19. C’est pourtant bien à l’Est de l’Occident que se découvrent les grandes différences avec l’époque des Accords du Plaza : en 1985, Gorbatchev jetait, avec la perestroïka, l’URSS dans les bras sauvages du capitalisme ; en 2025, Xi Jinping invite tous les chefs d’État du Sud Global à contempler la grande armée chinoise qui bientôt montera la garde partout où transitera son commerce universel. Tandis qu’à la Maison Blanche, aujourd’hui, la spéculation immobilière a remplacé la conquête du Far West.
- Stephen Miran, « A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System », Hudson Bay Capital, Novembre 2024 : https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 22.
 ︎
︎ - Un déficit courant signifie qu’un pays importe plus qu’il n’exporte de biens et services, même s’il faut inclure dans la balance courante les revenus nets comme les intérêts et dividendes, ainsi que l’aide à l’étranger.
 ︎
︎ - Les pays signataires des Accords du Plaza s’étaient engagés à stimuler la demande intérieure pour favoriser leurs importations et à intervenir sur le marché des changes par des ventes de dollars et des achats d’autres devises.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 26.
 ︎
︎ - https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
 ︎
︎ - Les rendements obligataires étant fixes, une baisse du cours des obligations fait monter le taux d’intérêt et inversement.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 29.
 ︎
︎ - Michael Bordo et Robert McCauley, “Miran, we’re not in Triffin land anymore”, VoxEU.org, 7 avril 2025 : https://cepr.org/voxeu/columns/miran-were-not-triffin-land-anymore
 ︎
︎ - Kenneth Rogoff, « Trump’s Misguided Plan to Weaken the Dollar », Project Syndicate, 6 Mai 2025 : https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-administration-mar-a-lago-plan-to-weaken-dollar-is-deeply-flawed-by-kenneth-rogoff-2025-05
 ︎
︎ - https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 6.
 ︎
︎ - Robert Triffin, The gold and the dollar crisis: the future of convertibility, Princeton University Press, 1960.
 ︎
︎ - Stephen Miran, Op. Cit., p. 17.
 ︎
︎ - Ibid., p. 23.
 ︎
︎ - Ibidem.
 ︎
︎ - https://www.economist.com/china/2025/09/10/china-is-ditching-the-dollar-fast
 ︎
︎ - Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, 2024.
 ︎
︎ - https://www.ft.com/content/f4420b48-0ed3-4f32-9b72-7ff90365ff93
 ︎
︎
10.12.2025 à 17:41
Pourquoi Mélenchon va gagner en 2027
Manuel CERVERA-MARZAL
Texte intégral (5105 mots)
Jean-Luc Mélenchon constitue, pour l’ordre établi, une menace d’une rare intensité. Les grandes fortunes, dont l’influence s’exerce bien au-delà de leurs entreprises, voient dans ses propositions fiscales et sociales une remise en cause frontale de leurs intérêts. Bernard Arnault ou Vincent Bolloré comprennent parfaitement qu’un gouvernement appliquant la lutte contre les oligopoles, la taxation massive des dividendes et la démocratisation des médias porterait atteinte à des positions héritées depuis des décennies. Les forces de l’ordre savent également que Mélenchon est l’un des rares responsables politiques à dénoncer explicitement les violences policières et à proposer des mécanismes institutionnels pour les prévenir et les sanctionner. Les tenants du productivisme et ceux qui profitent de l’écocide redoutent la planification écologique des insoumis, pensée pour rompre avec l’impunité climatique. Enfin, les partisans du macronisme – qu’il s’agisse des élites politiques qui ont bénéficié du quinquennat ou de ceux qui profitent de la casse sociale menée au nom de la raison – identifient en lui le seul adversaire capable de renverser l’ordre qu’ils ont patiemment construit.

Le candidat qui dérange
C’est pour ces raisons qu’il est depuis dix ans la cible de tentatives de disqualification systématiques : tantôt présenté comme un chef autoritaire, tantôt comme un agent d’influence poutinien, tantôt comme un antisémite qui s’ignore, il est aujourd’hui attaqué sur un tout autre terrain. On ne conteste plus ses idées, son programme, ni même sa stratégie. On affirme simplement qu’il serait battu d’avance au second tour face à Jordan Bardella.
Cet argument révèle moins la faiblesse supposée de Mélenchon qu’il ne dévoile la vacuité doctrinale de ses rivaux, incapables d’articuler une critique de fond et condamnés à répéter les prophéties de cabinets de sondage appartenant à des groupes possédés par des milliardaires ou par des individus dont l’accointance avec l’extrême droite est dûment documentée. Ces instituts se sont lourdement trompés pour les législatives de 2024 – sur 31 sondages réalisés, 31 donnaient le Rassemblement national vainqueur, devant le Nouveau Front Populaire. Aucun d’entre eux n’a présenté le début d’une excuse. Aucun n’a procédé à la moindre réforme de ses « méthodes » (les guillemets s’imposent à la lecture de la récente enquête d’Hugo Touzet, qui dévoile le vide abyssal sur lequel repose leurs données). Il serait naïf, et coupable, de leur accorder une autorité prédictive sur une configuration aussi inédite qu’un duel entre la gauche radicale et l’extrême droite.
Une progression électorale continue mais sous-estimée
Pour comprendre pourquoi l’hypothèse d’une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027 est la plus probable, il faut revenir à la réalité des dynamiques électorales. En trois candidatures présidentielles, Mélenchon a constamment progressé, en nombre absolu de voix comme en pourcentage. De 11 % en 2012, il est passé à près de 20 % en 2017 puis 22 % en 2022, manquant le second tour d’un cheveu : 420 000 voix. Cette trajectoire ascendante résulte certes de facteurs exogènes – l’affaissement historique du Parti socialiste, la crispation identitaire du Parti communiste, l’absence de cohérence au sein d’EELV – mais aussi d’un travail stratégique extrêmement structuré. En 2017 comme en 2022, la majorité des électeurs se déclarant plus à gauche ou plus à droite que Mélenchon ont pourtant voté pour lui. Pour de vastes pans de l’électorat, Mélenchon est devenu le point d’agrégation, la figure centrale autour de laquelle se recompose l’espace de la gauche.
Ce phénomène, observé ailleurs en Europe, répond à une double dynamique : le discrédit des partis de gouvernement incapables de proposer une issue sociale à la crise économique, et la montée de nouvelles mobilisations syndicales, féministes, écologistes, populaires et antiracistes dont les revendications infusent aujourd’hui l’agenda politique. La France insoumise a capté cette énergie, elle a construit un corpus doctrinal et programmatique compatible avec ces attentes.

Le spécialiste de la remontada
À cette évolution structurelle s’ajoute un phénomène récurrent des campagnes mélenchonistes : sa montée en puissance tardive. Ce qu’il a lui-même théorisé sous le nom de « tortue sagace », et que les fans de football qualifient de remontada. Historiquement, Jean-Luc Mélenchon réalise l’essentiel de sa progression dans les six derniers mois précédant l’élection. Les courbes de 2017 et de 2022 montrent des hausses de quinze points sur cette période – ce que ne fait aucun autre candidat. Dans le dernier mois, il peut engranger presque dix points. Les ressorts sont connus : ses talents de débatteur, sa capacité à créer des contrastes nets lors des grands rendez-vous télévisés, l’inventivité et l’ampleur de ses meetings, et le recours au porte-à-porte de ses nombreux groupes d’action produisent une dynamique cumulative unique en France. Déjà en 2017, chaque débat majeur lui apportait deux à trois points. En 2022, malgré une concurrence accrue due à la candidature de Fabien Roussel, les tendances furent similaires. Les meetings ont été des dispositifs de mobilisation massifs et spectaculaires, de l’hologramme aux meetings olfactifs, répliquant une mécanique parfaitement maîtrisée.
Cette montée tardive s’explique aussi par la sociologie de son électorat. Les jeunes, les classes populaires, les abstentionnistes intermittents, n’apparaissent dans les sondages qu’à partir du moment où ils commencent à s’intéresser aux débats. Leur intensité participative est faible hors période électorale. Les enquêtes d’opinion les sous-représentent systématiquement. Ainsi, les mêmes enquêtes surestiment l’extrême droite et sous-estiment le vote insoumis. Rien d’étonnant donc à ce que Mélenchon démarre bas : son électorat est, en dehors des échéances électorales, statistiquement invisible. De là découle une évidence analytique : les sondages de décembre 2025 ne nous apprennent rien sur les dynamiques de mars-avril 2027.
Mélenchon est aujourd’hui placé à 13% par les sondeurs. A la même période, pour les deux précédentes présidentielles (c’est-à-dire 18 mois avant les scrutins de 2017 et de 2022), il était mesuré à 8% – soit cinq points de moins. Si sa trajectoire des dix-huit prochains mois suit la même courbe ascendante qu’en 2017 et 2022, il finira à environ 26% en mai 2027, un score synonyme de qualification assurée pour le second tour.
Au même (ca)niveau que les sondages erronés, il convient de rappeler les fausses prophéties journalistiques, qui sont moins des prévisions fondées sur des faits que l’expression de désirs à moitié avoués. Après l’épisode des perquisitions au siège de la France insoumise, en octobre 2018, les grands médias ont répété durant deux ans que la carrière politique de l’intéressé était définitivement enterrée ; à la présidentielle suivante, il surclassait une nouvelle fois le reste de la gauche. La même « mort » lui avait été annoncée lorsqu’avant la présidentielle de 2017 il avait émis l’hypothèse d’une sortie de l’UE.
La fragmentation du bloc macroniste, une fenêtre d’opportunité historique
Un autre élément, rarement analysé à sa juste mesure dans les prévisions actuelles, concerne la conjoncture politique, et plus précisément l’état d’effritement avancé du bloc central construit autour d’Emmanuel Macron depuis 2017. Ce bloc, qui avait rassemblé une partie de la droite, le centre et l’aile gestionnaire du Parti socialiste, n’a jamais constitué une force idéologiquement unifiée. Il reposait sur la conjonction improbable entre un rejet momentané des partis traditionnels, l’adhésion des élites économiques à un projet néolibéral décomplexé et la personnalisation extrême du pouvoir autour de la figure d’un président jeune, disruptif et au capital symbolique alors intact. Or ce capital s’est plus que dégradé. Il s’est abaissé à un niveau record dans l’histoire du pays : 11% de confiance en novembre 2025. Et contrairement à l’idée que cette usure serait simplement le produit d’une décennie d’exercice du pouvoir, tout indique que la fragmentation actuelle résulte aussi d’un calcul stratégique du président sortant.
Il est désormais établi – par une série d’enquêtes journalistiques convergentes – qu’Emmanuel Macron a souhaité et encouragé, directement ou indirectement, la victoire du Rassemblement national lors des législatives de 2024. La dissolution a été décidée dans des conditions qui, de l’aveu même de certains proches du président, avaient moins pour objectif de clarifier la situation parlementaire que de provoquer un choc politique dont le RN sortirait vainqueur. Les appels passés à des candidats pour qu’ils retirent leur candidature dans certaines circonscriptions stratégiques, la passivité assumée de la majorité présidentielle face aux triangulaires défavorables au camp progressiste, et les consignes contradictoires envoyées aux fédérations locales ont construit un scénario où le RN devenait le maillon d’une stratégie de long terme. L’hypothèse la plus plausible est désormais la suivante : Macron ne souhaite pas qu’un héritier naturel s’impose à la tête de son camp, que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou François Bayrou. Il sait que toute figure trop solide, trop autonome, qui s’installerait à l’Elysée, serait susceptible de lui fermer la porte d’un retour. En favorisant l’éparpillement et l’affaiblissement de son propre bloc, il laisse ouverte la possibilité d’une recomposition ultérieure (en 2032) où il reviendrait comme recours face à une droite extrême arrivée au pouvoir mais en situation d’échec.
Dans ce contexte, l’extrême centre est plus fragmenté que jamais. Édouard Philippe, malgré une image d’homme d’État, n’a ni parti structuré ni base militante ; Gabriel Attal est prisonnier de son identification au macronisme ; Gérald Darmanin mise sur un électorat réactionnaire qui lui préfère déjà le RN ; et François Bayrou ne dispose plus d’aucun crédit depuis son passage à Matignon. Aucun de ces prétendants n’est en mesure d’incarner un pôle suffisamment large pour empêcher leur dispersion et forcer ses rivaux à se retirer. Le bloc central se présentera désuni en 2027, s’annihilant mutuellement et rendant extrêmement improbable la présence d’un candidat macroniste au second tour. Ajoutons à cela que tout candidat de ce camp portera le fardeau de son prédécesseur, désormais désavoué par ses soutiens les plus fidèles et, surtout, par les segments de la population qui constituèrent pourtant sa base électorale en 2017 et 2022. Cette absence d’un pôle centriste crédible et unifié constitue une des données les plus déterminantes pour l’élection à venir : elle ouvre mécaniquement un espace pour un duel Mélenchon–Bardella (ou Mélenchon – Le Pen).
Une concurrence inconsistante
Du côté de la gauche, les candidatures alternatives – Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Autain – ou celles de fossiles que certains rêvent encore de ressusciter – Hollande, Cazeneuve, Royal, Duflot – bénéficieront d’une visibilité et d’une bienveillance médiatique certaines. Les grands groupes de presse, appartenant à des puissances économiques hostiles à LFI, ont tout intérêt à fabriquer une « gauche raisonnable », rassurante pour les marchés, inoffensive pour les oligarques, et docile sur les sujets européens et géopolitiques. Ce scénario n’est pas nouveau : on l’a vu en 2017 avec Benoît Hamon, porté un temps comme incarnation d’une social-démocratie combative avant de s’effondrer ; en 2022, avec Yannick Jadot ou Christiane Taubira, dont les dynamiques médiatiques n’ont jamais trouvé de traduction populaire. Les raisons sont les mêmes : ces candidatures manquent d’un programme structuré, d’un appareil militant robuste, d’une cohérence idéologique, et surtout de l’ancrage social nécessaire pour dépasser un public composé essentiellement de diplômés urbains. Elles ne disposent pas de l’infrastructure indispensable pour mener une campagne présidentielle dans la durée : pas de réseau territorial significatif, pas de corpus doctrinal travaillé, pas de capacité de mobilisation numérique ou physique. Même portées artificiellement par les médias mainstream, ces figures ne parviennent pas à transformer l’essai dans la durée.
En face, Mélenchon s’appuie sur un appareil qui, depuis 2016, a acquis une solidité sans équivalent dans le champ politique français. LFI n’est plus le mouvement « gazeux » des premiers temps, ni le parti en manque d’implantation territoriale qui enjambait à contre-cœur les élections municipales de 2020 : c’est désormais une organisation structurée, dotée d’un groupe parlementaire nombreux, d’équipes d’assistants rodées à la production législative et communicationnelle, d’un outil intellectuel – l’Institut La Boétie – capable de produire des notes doctrinales et programmatiques de haute qualité (outil que d’autres, à gauche, tentent d’imiter), d’un réseau de cadres formés, d’une stratégie numérique maîtrisée, et d’une capacité logistique impressionnante. L’élaboration du programme L’Avenir en commun, travaillée depuis dix ans et enrichie par des consultations régulières avec experts, ONG, associations et professionnels, a donné naissance à un document cohérent, reconnu y compris par ses adversaires comme le plus complet, le mieux chiffré, le plus sérieux de l’offre politique française. Cette base programmatique, pensée pour durer, assortie d’une quarantaine de livrets thématiques, confère à Mélenchon une longueur d’avance que ses concurrents auront du mal à combler.
Dans ces conditions, la qualification de Mélenchon pour le second tour apparaît comme un scénario très probable. L’impopularité et la fragmentation du centre, l’absence d’assise populaire de la gauche décaféinée et le savoir-faire accumulé par les insoumis offrent à leur leader un boulevard.
Reste la question du second tour lui-même.
Un second tour inédit et une dynamique démographique favorable
Les sondeurs affirment que Mélenchon serait écrasé par Bardella. Mais ces prédictions n’ont aucune validité scientifique. Les instituts se trompent régulièrement sur des élections simples, dans des configurations connues et maintes fois répétées. Ils seront encore plus démunis face à un duel totalement inédit : jamais dans l’histoire de la Ve République un candidat de gauche radicale n’a affronté un candidat d’extrême droite au second tour. Les comportements électoraux dans une telle situation ne relèvent d’aucune loi préexistante.
On peut craindre que les électeurs LR basculent massivement vers le RN : c’est déjà le cas aujourd’hui. On peut anticiper qu’une partie des dirigeants macronistes se rallient à Bardella ou appelle à « faire barrage à Mélenchon » ; ce qui revient au même. Mais les électeurs centristes sont moins alignés sur leurs élites qu’on ne le croit. Une part d’entre eux demeure attachée à l’État de droit, à la séparation des pouvoirs, à l’indépendance de la justice et aux libertés individuelles. Pour ces électeurs, Mélenchon représente, malgré la longue liste de reproches qu’ils lui adressent, une menace moins grande que l’arrivée au pouvoir d’un parti ouvertement illibéral. Quant à l’électorat social-démocrate ou libéral-libéral (culturellement et économiquement), celui qui se reconnaît dans Glucksmann, il peut détester Mélenchon, il peut le vouer aux gémonies lors des diners de famille et des afterworks entre collègues, mais dans l’isoloir, seul avec lui-même, face au risque d’un basculement autoritaire, il se comportera rationnellement : il votera pour la gauche, fût-elle bruyante, radicale, populiste ou même « poutinienne » ; il le fera par prudence autant que par intérêt.
Mélenchon devra impérativement recentrer son discours, peut-être aussi son programme, pour conquérir au second tour les orphelins de Glucksmann et de Macron. Ce recentrage, il l’a déjà amorcé. Le « bruit et la fureur » de 2010 se sont progressivement atténuées. Le dialogue a été renoué avec des représentants du patronat, l’attache a été prise avec des gradés de l’armée, des collaborations peu visibles mais bien réelles sont à l’œuvre avec un bataillon de hauts fonctionnaires. Mélenchon et ses lieutenants misent désormais sur le sérieux institutionnel, la compétence technique et la respectabilité étatique, tout en conservant la capacité à incarner la radicalité impulsée par les mouvements sociaux et désirée par leur électorat populaire. Concilier ces deux registres n’est pas chose facile. L’art de préserver l’ambiguïté n’est pas donné à tout le monde. Mais cet art caractérise la trajectoire politique du leader insoumis, ex-militant mitterrandien, ex-sénateur socialiste et ex-ministre de Jospin d’un côté, mais aussi tribun de la révolution citoyenne, théoricien du dégagisme et désormais pourfendeur des violences policières et du génocide à Gaza. La faculté caméléonesque de Jean-Luc Mélenchon – chacun voit en lui ce qu’il veut y voir – est un atout considérable.
Enfin, si la victoire de Mélenchon apparait plus probable que jamais, cela tient aussi au fait que la France ne s’est pas droitisée, en tout cas pas dans les proportions que la droite tente de nous faire croire. Les jeunes générations penchent massivement à gauche, et les valeurs de tolérance et d’égalité progressent y compris chez les segments les plus âgés dont le vote va pourtant à Macron ou Fillon. Mélenchon est le seul candidat dont la base s’appuie sur les classes d’âge en expansion démographique. Le temps joue pour lui.
Une France politiquement de droite mais sociologiquement de gauche
Depuis plusieurs décennies, un paradoxe travaille la France : le pays vote majoritairement à droite mais sa population pense de plus en plus à gauche. Si l’on se limite aux résultats électoraux et aux sondages mis en scène sur les plateaux télé, on croit assister à une inexorable droitisation du pays. Mais dès qu’on quitte ce regard myope pour observer les évolutions de long terme des valeurs – génération par génération, en suivant des dizaines d’enquêtes accumulées depuis les années 1980 – le décor se renverse. Sous la surface d’un paysage institutionnel et médiatique monopolisé par la droite, on voit se déployer une lente et puissante dynamique de « gauchisation par le bas » : l’attachement à l’égalité, à la redistribution, à la protection sociale, à la tolérance, aux libertés publiques progresse doucement mais surement. C’est l’enseignement principal du livre que le politiste Vincent Tiberj a consacré au mythe de la droitisation.
Sur le plan socio-économique, les données longitudinales produites par mon collègue montrent qu’une majorité de Français restent durablement favorables aux services publics et à la protection sociale. Si l’on construit un indice de préférences sociales allant de 0 (libéralisme pur, marché roi) à 100 (égalitarisme maximal), la moyenne ne bascule dans la moitié la plus libérale que sur une courte période, au milieu des années 1980, au moment du tournant austéritaire et de la contre-offensive idéologique menée contre le bref épisode social du début du mitterrandisme. Depuis le début des années 2000, la courbe remonte nettement : les préférences redistributives se renforcent, l’adhésion à l’État social se stabilise à un niveau élevé et la demande de régulation augmente après chaque crise financière ou sociale. Autrement dit, malgré quarante ans de propagande néolibérale, la population n’a pas intériorisé la doxa du « trop d’impôts », « trop de fonctionnaires », « trop d’État ». Elle reste, en moyenne, plus proche d’un imaginaire social-démocrate que du catéchisme patronal.
Extension du domaine progressiste
Sur le plan culturel, le mouvement est encore plus spectaculaire. L’indice d’ouverture sur les questions de mœurs et de libertés publiques qu’a créé Vincent Tiberj montre une progression continue depuis la fin des années 1970 : ce qui semblait minoritaire, voire scandaleux, à l’époque (égalité femmes-hommes, droits des minorités sexuelles, lutte contre l’antisémitisme et le racisme) est devenu, pour une large majorité, un horizon de normalité. L’exemple le plus parlant est celui de l’homosexualité. Au début des années 1980, moins d’un tiers des personnes interrogées considéraient que c’était une manière acceptable de vivre sa vie ; aujourd’hui, cette proportion frôle les 90 %. De même, sur les questions d’immigration, un indice de tolérance élargie montre une progression régulière de l’acceptation des étrangers et de leurs descendants. La part de ceux qui estiment qu’« il y a trop d’immigrés » baisse, tandis que progresse celle de ceux qui voient dans l’immigration un facteur d’enrichissement culturel et jugent légitime la revendication d’égalité des droits. Loin de la fable d’un pays saisi par une obsession identitaire, une majorité silencieuse accepte la diversité, rejette les politiques ouvertement discriminatoires et se montre réceptive à un discours d’hospitalité encadrée plutôt qu’à la rhétorique de la forteresse assiégée. Ces données sont confirmées par les travaux d’une autre politiste de renom, Nonna Mayer.

D’où vient alors cette impression oppressante d’une France « passée à droite » ? D’abord d’une droitisation « par le haut ». Le petit monde des responsables politiques, des fast thinkers et des grands groupes médiatiques exerce une guerre psychologique : il martèle, sondage après sondage, chronique après chronique, que le camp de l’égalité serait minoritaire, ringard, coupé du réel. Les sondages les plus anxiogènes – sur l’« insécurité culturelle », le « sentiment de submersion migratoire », la supposée lassitude face au féminisme ou au « wokisme » – sont commandés, mis en forme et commentés par des groupes qui ont tout intérêt à naturaliser l’idée d’une France droitisée. Cette mise en scène produit un effet d’optique : une minorité réactionnaire, mieux équipée médiatiquement, crie très fort et apparaît comme majoritaire, tandis qu’une majorité plus ouverte, plus égalitaire, moins bruyante, est reléguée à l’arrière-plan. L’extrême droite et l’extrême centre se servent de ce récit pour s’octroyer une légitimité démocratique ; la gauche molle s’en empare pour justifier ses renoncements ; et certains militants radicaux s’y réfugient pour expliquer leurs échecs sans avoir à interroger leur stratégie.
Majorité électorale et minorité sociale
Le cœur du paradoxe réside dans ce que les politistes appellent l’« abstention différenciée ». Le résultat des scrutins ne reflète pas ce que pense l’ensemble de la société, mais ce que pense une fraction socialement privilégiée et générationnellement située. Les bourgeois et les baby-boomers sont les fractions sociales les plus politisées au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire les plus assidues pour se rendre aux urnes. Les générations plus jeunes, plus diplômées, plus précaires, plus tolérantes, plus égalitaristes, s’éloignent massivement du vote sans forcément décrocher de la politique. Elles se mobilisent sur les réseaux, sur les places publiques, sur les rond-point, dans les mobilisations féministes, écologistes ou antiracistes, mais boudent des élections perçues comme inutiles et/ou déconnectées de leurs préoccupations. Comment leur donner tort lorsqu’on voit comment le président traite le résultat des urnes en 2024, et lorsqu’on se souvient du sort qui a été fait au « non » du referendum de 2005 ? Résultat : la majorité électorale ne représente plus qu’une minorité sociale. Les partis qui dominent l’offre politique se calent sur les peurs et les intérêts de ce segment restreint. Les classes populaires, quant à elles, se réfugient dans l’abstention intermittente ou systématique. On obtient ainsi une configuration où des valeurs globalement de gauche cohabitent avec des institutions verrouillées par différentes nuances de droite.
Sur cet arrière-plan paradoxal, la possibilité d’une victoire mélenchoniste prend une autre portée. Elle ne serait pas le triomphe improbable d’une gauche « extrême » sur un pays massivement droitisé mais la résolution d’un paradoxe devenu intenable : celui d’une France sociologiquement de gauche mais politiquement gouvernée par la droite. En rassemblant les cohortes les plus jeunes, les classes populaires encore prêtes à voter, les secteurs attachés à l’État social et aux libertés publiques, Mélenchon a compris cette réalité que les élites préfèrent ne pas voir. Sa victoire en 2027 serait moins une rupture qu’un rattrapage. Pour la première fois depuis longtemps, les valeurs majoritaires – égalité, protection sociale, tolérance, démocratie – trouveraient enfin leur traduction dans les urnes.

Transformer l’essai
Au regard de ces éléments – progression constante de Mélenchon depuis quinze ans, savoir-faire inégalé pour les campagnes, les débats et les meetings, sous-évaluation systématique de son électorat par les sondeurs, usure du pouvoir, impopularité et fragmentation du bloc central, absence d’alternative crédible à gauche, supériorité organisationnelle, faculté caméléonesque du candidat, dynamique démographique favorable et gauchisation par le bas du pays – un constat s’impose : la victoire de Jean-Luc Mélenchon le 25 avril 2027 n’est pas seulement possible ; elle constitue le scénario le plus plausible.
Je ne le dis ni par volontarisme ni par militantisme, mais par analyse froide des tendances qui travaillent en profondeur la société française. Les seules certitudes auxquelles s’accrochent ses opposants – les sondages prématurés et les emballements médiatiques – relèvent de la panique plus que de la raison. Les faits, eux, dessinent un autre horizon. Mélenchon a déjà approché la victoire. Les conditions politiques, sociologiques et historiques sont plus alignées que jamais pour qu’il l’atteigne.
Pour prolonger :
Trois livres :
- Yves Déloye, Nonna Mayer (dir.), Analyses électorales, Bruxelles, Bruylant, 2017
- Vincent Tiberj, La droitisation française. Mythes et réalités, Paris, PUF, 2024
- Hugo Touzet, Produire l’opinion. Enquête sur le travail des sondeurs, Paris, Editions de l’EHESS, 2025
Trois émissions à (re)voir sur notre site :
- Enquête sur la France insoumise, émission Dans le texte, 20 septembre 2021
- Touche pas à Mélenchon, émission Dans le texte, 18 mars 2022
- Mélenchon à Matignon, émission Aux sources, 18 mars 2022
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie