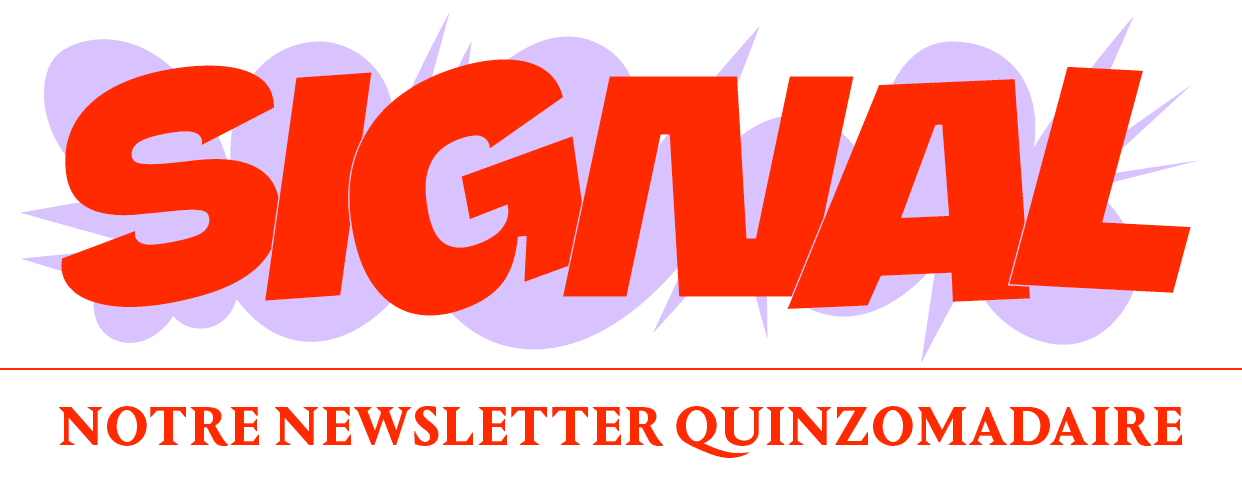Accès libreLe média des combats écologiques
Philippe Vion-Dury
Texte intégral (674 mots)
Sous le règne de l’industrie, en régime capitaliste, produire des biens et services présente toujours des dangers. Les infrastructures sont accidentogènes, les matériaux utilisés polluants, les « externalités » négatives. En somme, la production sociale des richesses (croissante) va de pair avec la production sociale du risque (croissant), tandis que les technologies requises pour maintenir cette dynamique tout en atténuant les dégâts se font de plus en plus complexes et opaques. Ce constat n’a rien de neuf. Et pourtant, la situation n’a jamais été aussi critique.
Pour se maintenir, la société du risque, ou plutôt l’État industriel, a besoin de produire de la sécurité, de l’ignorance, de l’invisibilité. Il faut rassurer les populations par des seuils (souvent fictifs), des contrôles (sous-dimensionnés), de la résignation (par le chantage), et parfois, du mensonge. Et pour éviter toute contestation de masse, une autre réalité doit être dissimulée : l’inégale répartition des menaces. Quelles sont les personnes les plus assujetties au risque industriel ? L’ouvrier de la chimie, l’agricultrice en élevage porcin, la contrôleuse de centrales, l’agent de maintenance. Et toutes les populations pauvres, racisées, qu’on oblige à habiter au contact des usines et qui meurent plus tôt que les autres. Et leurs enfants avec eux, qui souffrent de maladies pédiatriques. Et les gens du voyage, qu’on parque dans des endroits dangereux. Et les anciennes colonies enchaînées à cet héritage : on meurt encore des radiations en Polynésie, comme on meurt encore du chlordécone en Martinique.
Qu’a fait l’écologie médiatique ces dernières décennies ? Pas grand chose. Il faut reconnaître que sa position est délicate. Qu’elle dénonce la présence de telle ou telle installation polluante, voilà qu’on l’accuse de verser dans le « Nimby », le « pas dans mon jardin », et donc de néo-colonialisme : plutôt dans les pays pauvres que chez nous. Qu’elle s’oppose à telle ou telle installation accidentogène, et la voilà accusée de détruire de l’emploi, d’être bourgeoise. Parfois à raison, mais la critique reste facile.
Un espoir renaît toutefois, et il vient d’en bas. À Grandpuits, à Salindres, à Fos-sur-Mer, dans les raffineries comme dans les usines à PFAS ou les hauts- fourneaux, travailleurs et travailleuses exigent qu’on protège leur emploi, mais leur santé aussi, et celle de leur famille, de leurs forêts, de leur territoire, et même de la planète. Celles et ceux pour qui la catastrophe environnementale n’est pas qu’une question de pics de pollution et de degrés Celsius commencent à se soulever et exiger que l’on fabrique autre chose, que l’on produise différemment. Des écolos répondent à l’appel, des nouveaux venus des Soulèvements de la terre aux vétérans des Amis de la terre. Des habitants aussi, organisés en collectifs, et même parfois en syndicats, comme Riverains ensemble, qui demandent de protéger les habitants des pesticides en sauvant du même coup la paysannerie. Ou encore le Syndicat de la montagne limousine qui, à l’initiative d’habitants et d’habitantes, entend s’attaquer aux problèmes du territoire en liant entre elles les demandes écologiques, économiques et sociales.
C’est bien dans ces vastes coalitions hétérogènes que renaît l’espoir d’un bloc social écologique capable de désamorcer la bombe à retardement.
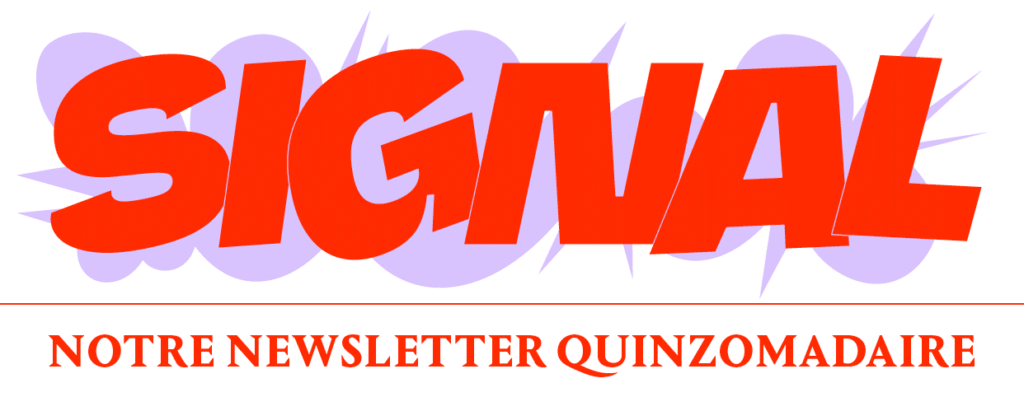
L’article Comment tout peut exploser : l’édito est apparu en premier sur Fracas.
Fracas Media
Texte intégral (2645 mots)
Cuisiniers, employés techniques, magasiniers… 300 000 personnes travaillent chaque jour pour cuisiner et servir les repas de millions de Français, grands et petits, « à la cantine ». Des métiers au cœur d’un secteur en pleine mutation, pris en étau entre des baisses de dotations publiques, des attentes sociétales, et les intérêts financiers d’acteurs moins gourmets que gourmands.
Cet article de Christelle Granja est issu du numéro 3 de Fracas. Photos : Blandine Soulage
Au RIL, le Restaurant Inter-Administratif de Lyon, à deux pas de la gare Part-Dieu, ils sont 40 pour préparer les repas de 1200 « convives » – c’est comme ça qu’on appelle, dans la restauration collective, les clients qui passent à table. Cuisiniers, chefs de partie, seconds ou employés techniques composent la « brigade », et suivent une organisation au cordeau. 6h30, le soleil n’est pas encore levé, la première équipe s’active. Il faut être prêt pour l’arrivée des agents ministériels affamés, dès 11h30, et pour le café du matin. Franck travaille ici depuis 28 ans en tant que magasinier. Un fait rare, relève Philippe Muscat, le directeur de ce restaurant pas comme les autres : « Aujourd’hui, si j’arrive à garder un salarié quatre ou cinq ans, c’est bien. L’avantage des soirées et week-end libres ne suffit plus ».
Au rez-de-chaussée du RIL, Franck pointe et vérifie la marchandise que lui livrent les fournisseurs ; il réceptionne certains matins plus d’un quart de tonne de fruits et légumes. La plonge, la cuisine, il a « tout fait ». Magasinier n’est pas pour lui déplaire, bien que le métier reste physique : le gerbeur, outil de levage motorisé, aide bien, mais les cagettes et les sacs de frites, il faut malgré tout les porter pour les ranger. Un coup de fil du pâtissier : a-t-il reçu la pectine ? Tandis que Franck s’affaire, chacun, dans les étages du RIL, a rejoint son poste, équipé d’une blouse et d’une charlotte.

Dans une salle, Hervé et Baptiste lavent des kilos de pommes et de carottes, les épluchent et les découpent à l’aide de machines. À quelques mètres, une salle est consacrée à la pâtisserie, une autre aux plats principaux, une autre encore à la préparation des entrées. Là, Mariam, seconde de production, s’applique à remplir des centaines de verrines d’un risotto aux champignons. Autour d’elle, la cuisine est une ruche encombrée de chariots et d’étagères inox (on y rentre à peine une journaliste et une photographe !), où ses collègues s’affairent. « Cette semaine j’ai fait 60 litres de mayo et 40 litres de vinaigrette. Hier on a servi 1200 entrées… », détaille avec entrain Mahmoud, chef de partie de production froide.
Malgré l’agitation, mieux vaut être couvert ici : il fait 6°C en début de journée, et la température monte péniblement jusqu’à 10°C. Ce n’est pas pour rien que Gaye, en CDI et diplômé d’un CAP de cuisine, préfère être à la plonge (il alterne, une semaine sur deux, avec un collègue) : il y fait plus chaud, et il y est seul. « Mon propre patron », sourit-il en maniant la vaisselle de ses grands gants bleus.
Cauchemar en cuisine
Le RIL est l’un des 90 restaurants inter-administratifs en exercice en France. Destiné à nourrir les agents publics d’État, il fait partie de la famille de la restauration collective. Une grande famille, avec ses lignées plus ou moins recommandables, ses oncles véreux et ses gendres idéaux. 80 000 lieux assurent chaque jour quatre repas sur dix sont pris hors du foyer, soit 11 millions d’assiettes servies à des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants (près de 40%), mais aussi à des personnes âgées en Ehpad et des bébés en crèche, des malades et des soignants, des salariés et des agents publics…
Difficile de ne pas voir là un formidable outil de santé publique, alors que 13% des Français souffrent de précarité alimentaire, mais aussi un levier de transformation des modes d’alimentation (moins carbonés, moins polluants) et des filières agricoles (plus locales, plus responsables). Dans les faits, le secteur, « en pleine mutation » selon le directeur du RIL, est très contrasté, pris en étau entre des baisses de dotations publiques, des attentes sociétales, et les intérêts financiers d’acteurs moins gourmets que gourmands. Malbouffe, conditions de travail dégradées et exemplarité s’y côtoient.

Ce vaste marché, qui emploie 300 000 personnes selon Restau’co (1) et génère 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est à 60% en régie directe. Pour le reste, la gestion dite « concédée » (déléguée à un prestataire), trois multinationales, Sodexo, Elior et Compass (qui n’ont pas souhaité répondre à nos sollicitations) se partagent l’essentiel du gâteau, soit 70 % du chiffres d’affaires, détaillent Geneviève Zoïa et Laurent Visier dans leur ouvrage Les Cuisines de la Nation (Wildproject, 2025). Des géants peu scrupuleux, bons fournisseurs en scandales alimentaires : viandes dopées à l’eau, lardons bio et végétariens présentés comme sains, mais composées de sucre, d’huile et d’amidon, sans oublier des intoxications massives d’enfants à la gastro-entérite, rappelle Jean Songe dans Sodexo La gloutonne (Seuil, 2021).
Les conditions d’emploi ne sont guère plus réjouissantes : temps partiels subis, rémunérations au plancher, gestes répétitifs avec troubles-musculo-squelettiques à la clé. La faute, entre autres, à une organisation autour de cuisines centrales, qui préparent des milliers voire des dizaines de milliers de repas « prêts à manger » pour des sites distants de plusieurs kilomètres. A la fin du XXe siècle, de nombreuses cuisines locales, et les emplois qui vont avec, souvent féminins, disparaissent au profit du développement de ces grandes unités centrales. Aujourd’hui, on en compte environ 800 dans l’Hexagone.
Ces cuisines XXL apparaissent à la fin des années 1980, en réponse à des impératifs sanitaires et à la quête d’optimisation des coûts. Elles reposent sur un procédé très règlementé : la « liaison froide ». Il consiste à préparer des plats à l’avance, à les réfrigérer, à les stocker, puis à les transporter entre 0°C et 3 °C dans des camions réfrigérés ou des containers isothermes jusqu’au lieu de restauration, où ils sont réchauffés sur place (à plus de 63°C, risque sanitaire oblige). Avantage : le plat peut se conserver de trois à six jours. Temps, espace, personnes : la consommation du repas est « libérée » de sa préparation, à laquelle plus rien ne la rattache. Côté chaleur humaine, on repassera.
Des coquillettes à la sauce tech
À Paris, dans le XVIIIe, dix employés d’une filiale de Sodexo fournissent quotidiennement 16 000 repas d’écoliers, et plusieurs centaines aux résidents d’un Ehpad. À Vitry-sur-Seine, ils sont 40 à préparer, dans la nouvelle cuisine centrale Eugénie Brazier (dont les responsables n’ont pas non plus souhaité nous recevoir), les repas de 4 500 collégiens et 2 600 bébés en crèches, aidés d’un robot armé de trois bras qui remplit les bacs où est placée la nourriture, les referme et les empile. À Bordeaux, le « Sivu » compte une équipe de chauffeurs qui livre 180 sites à bord d’une flotte de 17 camions, équipés d’appareils de géolocalisation par satellite pour tracer le suivi de la chaîne du froid en temps réel.
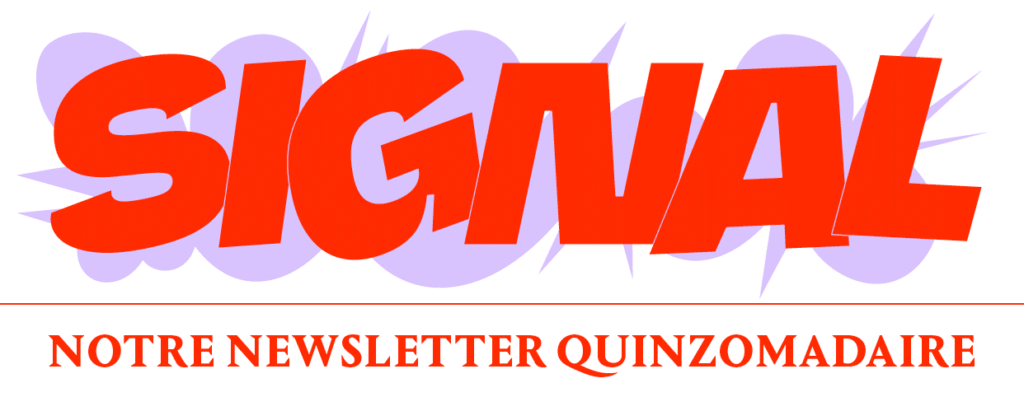
La tech au service des coquillettes. « Apprendre aux enfants à consommer des aliments fabriqués en usine à plusieurs kilomètres trois jours plus tôt et livrés par camion en barquettes individuelles à l’école, c’est former des adultes à devenir des clients de Uber Eats ou de Deliveroo », dénoncent Geneviève Zoïa et Laurent Visier (Les Cuisines de la Nation, Wildproject, 2025). Le constat vaut pour tous : en déconnectant la fabrication du repas du lieu de consommation, le modèle de la cuisine centrale est associé à un mode de production industriel. Finies les odeurs et les bruits de cuisine à la cantoche !
Fini le lien entre les « mangeurs » et les cuisiniers, entre ceux qui servent, ceux qui savourent, et les produits bruts. « À la faveur de ces circuits, des métiers techniques s’inventent (diététiciennes, qualiticiennes, managers…) quand d’autres, artisanaux et centrés sur la relation et la proximité, se raréfient (cuisiniers sur place) jusqu’à disparaître (cantinières) », regrettent Geneviève Zoïa et Laurent Visier, qui voient dans ce développement de cuisines centrales hors-sol un véritable choix de société.
Face à ce modèle, plusieurs acteurs font de la résistance, malgré les difficultés conjuguées des baisses des dotations publiques et de l’inflation. À Châteauroux, la mairie abandonne sa cuisine centrale pour créer cinq petites unités de restauration scolaire avec de la cuisine bio et locale, via l’association Cuisines nourricières, rapporte Ici Berry. Plusieurs communes, de Mouans-Sartoux à Vannes, vont même plus loin, en créant des régies agricoles pour alimenter leurs cantines en produits frais et locaux.
Se confronter au RIL
Au RIL, notre cantine d’État lyonnaise, l’équipe cuisine également des produits frais, de saison, souvent bio et locaux. Même les pâtes, les pizzas et depuis peu le jambon sont élaborés sur place. Surtout, quelques mètres séparent la fabrication du repas de sa dégustation. À 11h, l’équipe déjeune rapidement sur les mêmes tables qui accueilleront bientôt les convives, et se met en place pour le service des plats qu’elle vient de mitonner, au premier étage du bâtiment.
« Les gens ont une conscience accrue de l’importance de la restauration collective. Mais les points de blocage sont dans les moyens alloués », regrette le directeur du RIL, pas très rassuré par l’état des finances publiques, tout comme Agnès, la responsable financière, qui doit composer avec les retards de paiement du premier employeur français, l’État. La marge de manœuvre est faible. Dans la restauration collective, de nombreux indicateurs sont inscrits dans la loi : la tarification des repas, le pourcentage de bio, de local, de produits « fait maison ».

Depuis 2022, la loi Egalim exige pour le secteur public au moins 50 % de produits durables ou de qualité, dont 20 % de bio. Et un nouvel objectif a été introduit pour la viande et le poisson : 60 % de produits de qualité et durables, et 100 % pour les restaurants nourrissant les agents d’Etat. « En décembre, on était déjà à 90 % sur les produits carnés, sous peu on devrait être bons », pronostique Philippe Muscat. Le RIL, structuré en association, fait figure de bon élève. Car en France, Egalim n’est guère respectée.
Question de temps ? D’argent plutôt. En 2023, les cantines n’auraient consacré que 27,5 % de leurs achats à des produits durables et de qualité, dont seulement 13 % en bio (2). Mais si le bon élève est à l’équilibre, il reste sur le fil. Les salaires avoisinent le Smic pour une partie des employés les moins qualifiés, quand la restauration dite « commerciale » a relevé ses salaires de 16% après le Covid – augmentation que le RIL, contraint à des tarifs bas de cantine, n’a pas pu suivre, regrette son directeur, qui voit certains de ses salariés confrontés à des situations de précarité.
On ne s’étonnera guère que le secteur peine à recruter et à fidéliser. Romain, pâtissier passionné, énumère les inconvénients du métier, tout en travaillant avec délicatesse une pâte de noisettes torréfiées : la station debout, le port de charges lourdes, la répétition des gestes, les écarts de température… Et sans surprise, la rémunération. « Mais je commence mes journées à 6h30 et j’ai mes week-ends : pour un pâtissier, c’est du luxe », conclut le diplômé en chocolaterie, qui a commencé sa carrière dans l’artisanat, et ne regrette pas d’être passé à la restauration collective. Il y trouve des normes d’hygiène et de sécurité mieux appliquées, mais aussi, à rebours des clichés, davantage de créativité. « Faire notre propre noisetine, notre jambon… : en 2015, on était des extraterrestres, mais les choses se mettent en place », veut croire le directeur.
Notes de bas de page :
- Réseau interprofessionnel de la restauration collective.
- « Objectifs EGAlim en produits durables et de qualité en restauration collective : le bilan de l’année 2022 publié, la collecte des données 2023 bientôt clôturée », ministère de l’Agriculture, 12 mars 2024.
L’article La restauration du nouveau régime est apparu en premier sur Fracas.
Fracas Media
Texte intégral (2526 mots)
Reconsidérer notre relation à la chasse conduit à remettre au centre une question souvent occultée en écologie : le rapport à la mise à mort d’autres espèces. Ce qui interroge notre relation à notre propre finitude, dont certaines pensées de l’écologie font le moteur de la condition terrestre.
Cet article de Youness Bousenna est issu du numéro 3 de Fracas. Illustrations : Ben O’Neil.
Les livres sont parfois signifiants par ce qu’ils ne contiennent pas. Ainsi du Dictionnaire critique de l’anthropocène (CNRS Éditions, 2020), somme de référence pour qui veut se renseigner sur les enjeux écologiques, mais ne comporte aucune notice sur la mort. Le pavé dispose tout de même d’une entrée « Finitude », laquelle évacue en quelques lignes la question mortelle, pour se focaliser sur « l’espace fini et limité de la surface terrestre ». Comme si, en écologie, on réfléchissait à toutes les fins – du capitalisme, de la Terre, de l’humanité – mais jamais à celle qui concerne chacun : la mort.
Ce constat a aussi marqué l’essayiste et traducteur Pierre Madelin, auteur d’une des rares réflexions d’écologie abordant frontalement le sujet. La Terre, les corps, la mort. Essai sur la condition terrestre (Dehors, 2022) s’ouvrait sur ce paradoxe : la question de la mort est « rarement abordée dans la pensée écologiste », alors même que son lexique est saturé de termes renvoyant à l’extinction, à la disparition, aux dévastations.
Cet « angle mort » dépasse la seule écologie. Jean-Pierre Luzi en fait même l’un des principaux traits de la modernité industrielle. Là est le point de départ de son essai Au rendez-vous des mortels. Le déni de la mort dans la culture moderne, de Descartes au transhumanisme (La Lenteur, 2019). « La société industrielle est structurée par un double déni de la mort : le fait que tous les êtres sont amenés à mourir, et que tout vivant est amené à tuer pour vivre », explique le maître de conférences en économie à l’université Bretagne Sud.
Cette disparition de la mort a stupéfié plusieurs penseurs. Dans ses Essais sur l’histoire de la mort en Occident (1975), l’historien Philippe Ariès retraçait une longue trajectoire où la mort, de familière et apprivoisée, serait devenue « sauvage » à partir du XVIIIᵉ siècle. Celle-ci s’est trouvée évincée de notre société : les cimetières et les abattoirs ont été éloignés du centre des villes, tout comme les institutions de la marge – Ehpad, asiles, hôpitaux. Le signe que la mort serait devenue un « objet de répulsion », écrivait le sociologue Norbert Elias dans La Solitude des mourants (1987). Jusqu’à remplacer le sexe comme tabou suprême de nos sociétés, affirmait même l’anthropologue Geoffrey Gorer dans un article célèbre, « La pornographie de la mort » (Encounter, 1955).
Cachez ces boucheries que je ne saurai voir
Le constat n’est pas neuf, donc, mais permet d’approfondir un point aveugle : la marginalité de la mort dans la pensée écologique hérite de cette éviction plus large, qui concerne toute la culture moderne. L’aversion de ce courant pour la chasse semble ainsi entretenir un lien avec cette répulsion tant avec la mort qu’avec la mise à mort. Tout comme les abattoirs, les fronts guerriers sont lointains et invisibles. « La puissance du monde occidental repose sur une division du travail et une domination militaire du monde, qui lui permet de donner la mort aux autres et à la nature pour pouvoir vivre », prolonge Jacques Luzi. « La société industrielle […], résolument nécrophobe dans ses principes, est devenue une société mortifère », résume dans Mort et Pouvoir (1978) Louis-Vincent Thomas, anthropologue méconnu sur lequel s’appuie Jacques Luzi.

Si la mort reste un thème marginal au sein de la pensée de l’écologie, deux traditions intellectuelles fort éloignées l’une de l’autre s’en sont emparé : l’une y arrive par l’esprit, l’autre via la matière. C’est depuis la cosmologie et l’Australie que la philosophe écoféministe Val Plumwood (1939-208) et l’anthropologue Deborah Bird Rose (1946-2018) ont reformulé la question de la mort. Et c’est depuis l’Europe et la pensée technocritique que des auteurs – dont Jacques Luzi hérite – s’attaquent à la dissimulation de la mort dans la société industrielle. Ainsi du penseur de la convivialité Ivan Illich (1926-2002), qui déployait une réflexion radicale dans Némésis Médicale. L’expropriation de la santé (1974), sur « la colonisation médicale de la vie quotidienne » et son caractère toxique. Pour ce prêtre et penseur, « l’appareil biomédical du système industriel ôte au citoyen tout pouvoir de maîtriser politiquement ce système » voué à « maintenir en état de fonctionnement l’homme usé par une production inhumaine », jusqu’à changer la conception de la mort. D’une part, cette médicalisation a mis fin à « l’ère de la mort naturelle » ; de l’autre, elle a pour effet psychologique de décupler l’angoisse de la mort, jusqu’à la rendre insupportable – Ivan Illich lui-même mourra d’un cancer qu’il refusera de faire soigner.
« Vivre réclame tuer »
Cette mort capturée par la puissance industrielle a aussi inspiré le penseur de l’autonomie politique Cornelius Castoriadis, ou encore l’écrivain Elias Canetti, auteur du célèbre essai Masse et puissance (1960), mais aussi du posthume Livre contre la mort. Au total, cette galaxie plus ou moins technocritique converge vers un constat : « La société industrielle est mue par une volonté de puissance qui a été, dès l’origine, pensée comme un moyen de se délivrer de tous les fardeaux de la condition humaine, dont le premier est la mort », résume Jacques Luzi, qui voit dans le mantra du transhumanisme « Tuer la mort » un aboutissement de cette logique. Pour cet universitaire, les « technologies d’éloignement de la mort » de nos vies modernes produisent un effet très concret sur l’aversion pour toutes les pratiques liées à la mort et à la mise à mort. « Plutôt que se considérer comme extérieur à la nature, l’enjeu actuel est de se réapproprier le rapport à la mort en acceptant non seulement l’idée de mourir, mais celle que vivre réclame de tuer », plaide ce membre du comité de rédaction de la revue Écologie & Politique.
Or, la tentation d’échapper à cette réalité constitue le travers philosophique de certains mouvements animalistes ou végans à ses yeux : « S’habiller sans animaux réclame de déforester pour créer des usines de vêtements synthétiques, et donc de tuer des animaux. La question n’est donc pas de tuer ou de ne pas tuer, mais comment on va tuer », estime Jacques Luzi, pour qui « on ne peut pas échapper à la condition terrestre ».
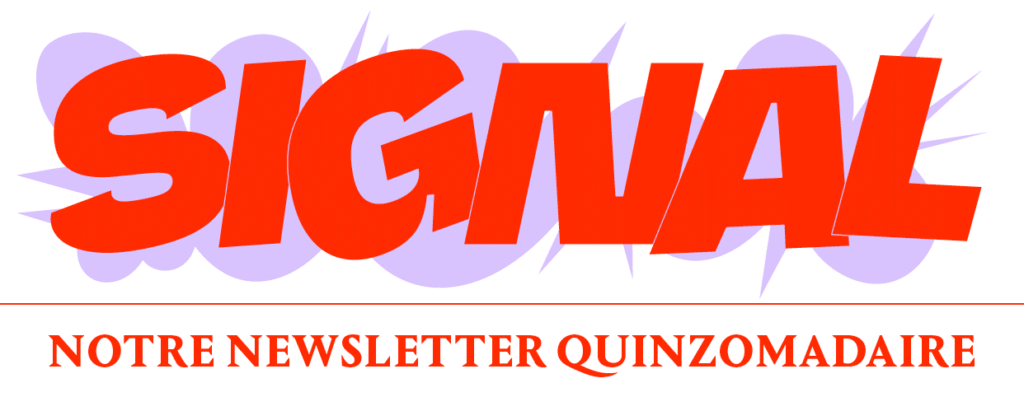
La condition terrestre, voilà justement le cœur de la réflexion de Pierre Madelin. Dans La Terre, les corps, la mort, il souligne un trait fondamental des grandes pensées philosophiques et spirituelles produites par l’Occident depuis l’Antiquité : « Celles-ci n’ont jamais cessé de considérer la Terre non comme un foyer mais, au contraire, comme le lieu de notre exil » parce que notre planète est justement assimilée au « lieu du vieillissement et de la mort ». Nous ne serions pas de ce monde, où nous ne faisons que passer pour une destination plus haute et inaccessible ici-bas. Cette idée traverse autant la philosophie de Platon que la théologie chrétienne ou la technoscience moderne. Et trouve un prolongement dans les desseins de colonisation du système solaire et du transhumanisme, deux fantasmes poursuivis par les mêmes acteurs, tels qu’Elon Musk ou Jeff Bezos.
Ce refoulement est au cœur de deux processus aux effets écocidaires majeurs : la quête d’un « triomphe sur la mort » a été centrale dans la genèse de l’anthropocentrisme occidental, qui rend possible un mépris pour le reste du vivant, tout en alimentant une « volonté de se libérer ou de « s’arracher » de notre condition terrestre », analyse Pierre Madelin, dont la réflexion assume une inspiration puisée chez Val Plumwood. La pensée de cette philosophe australienne s’appuie sur une expérience extrême, qui la conduira à la lisière de la mort.
En février 1985, alors qu’elle faisait du kayak dans un parc naturel, Val Plumwood est saisie par un crocodile qui lui fait subir trois rouleaux de la mort – une technique visant à tuer la proie bloquée dans sa mâchoire – avant de la relâcher, inexplicablement. Ce jour-là, elle ne fut pas un prédateur, mais une proie. Et cette expérience constituera un bouleversement cosmologique pour la philosophe. « L’œil du crocodile me fit plonger dans ce que je considère désormais comme un univers parallèle, régi par des règles entièrement différentes : l’univers héraclitéen où tout coule, où nous vivons la mort de l’autre et mourons sa vie », témoigne-t-elle dans l’essai Dans l’œil du crocodile. L’humanité comme proie (Wildproject, 2021).
Existentialisme écologique
Cette proximité de la mort la conduit à remettre en cause les fondements éthiques de la modernité occidentale au profit d’un animisme philosophique. S’opposant au double dualisme (1) opposant l’humain à une nature réduite à une vision mécanique, et l’esprit à une matière dévalorisée, Val Plumwood repense notre situation depuis cette condition : « Nous sommes de la nourriture et nous nourrissons d’autres êtres à travers la mort. » Cette vision la conduit à rejeter le véganisme, qui perpétue un refus de s’inscrire dans la chaîne éternelle de la vie et de la mort, pour prôner un « animalisme écologique », où la mise à mort est réinsérée dans une relation d’empathie à l’animal – ce qui passe par un rejet de l’élevage industriel et une « réduction massive » de la consommation de viande, précise-t-elle.

C’est d’Australie, encore, que parvient une autre proposition philosophique pensée depuis notre condition mortelle : l’existentialisme écologique de Deborah Bird Rose. Cette anthropologue, qui côtoya Val Plumwood, partage un même constat. « La modernité est incapable d’offrir un récit sur la mort susceptible de célébrer la vie », écrit-elle dans Le Rêve du chien sauvage (La Découverte, 2020). Le contact avec les Aborigènes bouleversa son approche de l’écologie et de la vie. Deborah Bird Rose puise sa pensée dans la notion aborigène de pays, cette « unité spatiale » où se croisent les êtres vivants la partageant, dans laquelle elle voit la « matrice de tous les êtres ». Nous sommes insérés dans une seule et même communauté de vie où circulent la vie et la mort : en ingurgitant un animal, celui-ci « devient une partie de mon corps et me donne l’occasion de vivre un jour de plus. Et, tant que je vis, la conscience de sa mort et de son sang se perpétue dans le monde », souligne Deborah Bird Rose.
Dans la mise à mort, se joue une solidarité existentielle. « Cette intimité d’une intériorité interchangeable nourrit un genre particulier d’empathie fondé sur la reconnaissance tactile de notre parenté mammifère et sur notre condition commune de créatures nées pour mourir. Cette dépouille d’animal, ce pourrait être moi ; un jour, oui, j’en serai une à mon tour », écrit l’anthropologue. Cette articulation entre dette et empathie est au fondement de la proposition d’existentialisme écologique qu’elle formule, prolongeant le courant rattaché à Jean-Paul Sartre (1905-1980) pour le réenraciner dans la condition terrestre. Comme un moyen de rappeler que les idées s’incarnent dans des chairs, que ces chairs vivent en tuant, et que cette condition oblige à composer avec la mort.
Note de bas de page :
- Par dualisme, l’autrice n’entend pas nier la distinction des deux, mais exprimer la domination de l’un sur l’autre.
L’article Tuer pour vivre : notre condition terrestre est apparu en premier sur Fracas.
Philippe Vion-Dury
Texte intégral (5722 mots)
Montée de l’extrême droite, percée de l’abstention, négation des résultats de référendums… Depuis près de deux décennies, la démocratie serait « en crise ». Avec la récente accélération de la décomposition politique, en France et en Occident, c’est tout l’édifice institutionnel bâti depuis le XVIIᵉ siècle qui chancelle. Pour la politologue et constitutionnaliste Eugénie Mérieau, la convergence des régimes libéraux et autoritaires dans une même zone grise nous commande d’imaginer d’autres formes démocratiques.
Biographie : Eugénie Mérieau est maître de conférence en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste du constitutionnalisme autoritaire. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La dictature, une antithèse de la démocratie ? (Le Cavalier bleu, 2019, revu et augmenté en 2024) et Géopolitique de l’état d’exception : les mondialisations de l’état d’urgence (Le Cavalier bleu, 2024), où elle analyse de manière critique les contentieux constitutionnels et la mondialisation de l’état d’urgence.
Cet entretien est issu du numéro 3 de Fracas. Photos : Marie Rouge.
Crise politique, crise de régime, crise de la démocratie… Comment distinguer ces termes, et lequel est pertinent pour décrire la situation présente ?
Lorsqu’on emploie l’expression « crise de la démocratie libérale », on désigne avant tout la crise du caractère libéral de la démocratie. L’idéal de la démocratie se porte plutôt bien au niveau global : le monde entier s’en réclame, y compris la Corée du Nord ou la Chine. C’est la façon de traduire cet idéal dans un gouvernement représentatif et libéral qui est aujourd’hui en crise. Elle est remise en cause à la fois par les idéologies libertariennes aux États-Unis et en Amérique du Sud, et par les mouvements nationalistes en Europe. Elle l’est également par les mouvements citoyens, qui découvrent subitement que la démocratie libérale est une vaste supercherie. À droite, on va considérer la démocratie libérale comme un obstacle à la liberté, et à gauche, à l’égalité. La fiction sur laquelle était fondée la démocratie libérale, c’est-à-dire le mariage entre Locke et Rousseau, entre l’égalité constituante du peuple et la liberté protégée par le constitutionnalisme, s’écroule sous nos yeux, et cela entraîne une vaste convergence entre régimes autoritaires et régimes libéraux.
Ce phénomène est-il réellement neuf ?
Cela fait longtemps que la crise de la démocratie représentative est identifiée. Ce qui est nouveau, c’est que la critique se radicalise de part et d’autre. Après un moment de relatif consensus sur ce modèle, à partir de la période où les partis communistes et d’extrême droite se sont effondrés après les « Trente Glorieuses », on assiste de nouveau à un bouillonnement et à une demande de changement radical. En cela, pour la gauche, même si la situation est dangereuse, la crise est une opportunité pour tout repenser, qu’il s’agisse de la forme représentative qu’a pris la démocratie ou de l’État lui-même. L’impératif pour les citoyens comme pour les intellectuels est aujourd’hui de proposer de nouveaux imaginaires, de nouvelles formes institutionnelles, et d’ouvrir des espaces pour les expérimenter. L’avancée de l’extrême droite sur le même terrain nous y contraint.
Ce qu’on appelle l’illibéralisme est-il vraiment quelque chose d’inédit ? Ou bien est-ce un « retour aux sources » des régimes libéraux ?
Si l’on en croit Samuel Huntington, la démocratie libérale a progressé dans le monde par vagues, avec des flux et des reflux. La première vague a lieu à la fin du XVIIIᵉ siècle, avec les révolutions française et américaine. Le monde connaît ensuite un long reflux qui nous amène jusqu’aux années 1930. Une seconde vague débute ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, avant de marquer le pas et de connaître un nouveau reflux dans les années 1960. La troisième et dernière vague prend sa source dans les années 1970, avec la Révolution des œillets au Portugal pour point de départ.
Aujourd’hui, nous sommes clairement dans le reflux de cette troisième vague, après qu’elle a connu un « pic » démocratique en 2006. Cela se traduit par des démocraties qui basculent dans la dictature au gré de coups d’État militaires, mais avant tout par un reflux des droits et libertés généralisé et mondial, auquel l’Occident n’échappe pas. En témoigne la situation aux États-Unis, où l’on voit la Cour suprême remettre en question des acquis tels que l’avortement, ou étendre de manière quasi-absolue l’immunité du Président.
La France non plus n’y échappe pas. Nous sommes en train de revenir très nettement sur tous les acquis de la IIIᵉ République : la liberté d’association, la laïcité, la liberté de la presse… la liste est longue. Aujourd’hui, on revient sur les grandes libertés, mais cette restriction concernait jusqu’ici essentiellement les musulmans, toujours suspects de terrorisme. Cela n’est pas sans rappeler la période du code de l’indigénat sous la IIIᵉ République. Mais la catégorie est en train de s’élargir pour y ajouter de nouvelles franges de la population : les « écoterroristes », les Gilets jaunes, etc.
« Le niveau de violence et de répression d’un État ne dépend pas de sa nature libérale ou autoritaire : ce qui définit le niveau de violence, c’est le degré de menace que fait peser sur le régime une contestation »
À quoi est dû ce reflux ?
La thèse que je développe dans mon dernier livre, Géopolitique de l’état d’exception, est que ce reflux a toujours partie liée à la mondialisation de l’état d’urgence. Les trois grandes vagues que j’ai décrites correspondent également à l’invention de nouveaux droits : droits civils et politiques pour la première, droits sociaux et économiques pour la seconde, droits environnementaux pour la dernière. Après chaque vague de mondialisation des libertés, une vague d’états d’urgence leur a succédé et est venue les suspendre. Et lorsque ces états d’urgence ont fini par se mondialiser, on a assisté au reflux généralisé de la démocratie.
Comment cela s’est-il passé ?
Au XVIIIᵉ siècle, alors qu’on proclame l’universalisme des droits humains, on invente l’état d’urgence pour suspendre cette protection dans l’empire colonial sans fragiliser la fiction de leur universalité. Pendant la Première Guerre mondiale puis dans les années 1930, cette suspension des droits a connu un mouvement de retour de la « périphérie » coloniale vers le « centre ». Et on a fini, partout en Europe, par retirer au Parlement sa capacité à légiférer en gouvernant massivement par décrets. On ne parle pas encore alors d’état d’urgence en France – pas avant 1955 – mais de « circonstances exceptionnelles » qui justifient que l’administration s’affranchisse de l’État de droit. C’est ce qui va préparer le terrain au régime de Vichy.
En Allemagne, la situation est tout à fait similaire. On y légifère presque uniquement par décrets-lois sur la base de l’article 48 de la Constitution de Weimar – Constitution sur laquelle est d’ailleurs décalquée celle de la Vᵉ République. Lorsque le régime d’état d’urgence est décrété en 1933, il s’inscrit dans la continuité de l’utilisation à répétition de l’article 48, et c’est ce qui finit par plonger l’Allemagne dans le nazisme. Le même phénomène est observable en Italie et ailleurs en Europe.
Lors de la seconde vague, la même chose se reproduit. Les communistes sont alors très puissants et les idées socialistes ont fait leur chemin, de même que le désir d’indépendance des colonies. La loi d’état d’urgence de 1955 va venir suspendre les droits des Algériens pendant la guerre et permettre de se soustraire au droit international de la guerre. Certes, la France n’a pas connu le grand plongeon dans la dictature qui s’est produit dans le reste du monde à cette période, particulièrement en Amérique latine, mais on observe néanmoins des choses qui s’en approchent. De Gaulle, en 1961, déclare l’état d’urgence et se sert de l’article 16 de la Constitution pour le prolonger indéfiniment, ce qui est, en temps normal, la définition d’un coup d’État. Lorsqu’on change de régime pour passer à l’élection du Président au suffrage universel en 1962, on est encore sous état d’urgence, sans validation du Parlement. Si cela s’était passé ailleurs dans le monde, on aurait affirmé que ces élections n’étaient pas libres. L’article 16 a également été employé pour mettre en place des tribunaux d’exception avec peine de mort, sans possibilité de faire appel devant une juridiction, ce qui est contraire au principe de jus cogens, c’est-à-dire une norme impérative du droit international à laquelle il est interdit de déroger même sous état d’urgence…
Qu’en est-il de la troisième vague ?
Le reflux actuel se caractérise également par une succession d’états d’urgence et par leur mondialisation. Je précise que Donald Trump, le jour de son investiture, a déclaré la loi martiale, à la frontière avec le Mexique, alors qu’il ne se passait absolument rien d’exceptionnel. J’ai écrit Géopolitique de l’état d’exception il y a deux ans et, à vrai dire, je n’aurais jamais cru qu’on en serait déjà là en 2025… Il devient de plus en plus manifeste que le libéralisme, que l’on voit ici sous sa forme radicale dans l’imaginaire libertarien aux États-Unis, porte en lui l’état d’urgence et la dictature.
Trois dates me semblent parlantes pour identifier les moments de bascule de ce troisième reflux. En 2001, les attentats du 11 septembre ont été l’occasion de mondialiser l’état d’urgence antiterroriste ; ce qui a montré à tous que la démocratie libérale n’était ni la paix ou la sécurité, ni le respect du droit international. En 2008, la crise des subprimes a permis la mise en place d’un état d’urgence économique, c’est-à-dire l’austérité, montrant par la même occasion que la démocratie libérale, ce n’est ni la prospérité, ni le respect de la démocratie – les Grecs en savent quelque chose. Enfin, en 2020, le Covid a justifié la mondialisation d’un état d’urgence sanitaire, montrant que la démocratie libérale n’est même plus la liberté d’aller et venir. Ces trois moments ont fendillé la fiction libérale et accéléré sa décomposition.
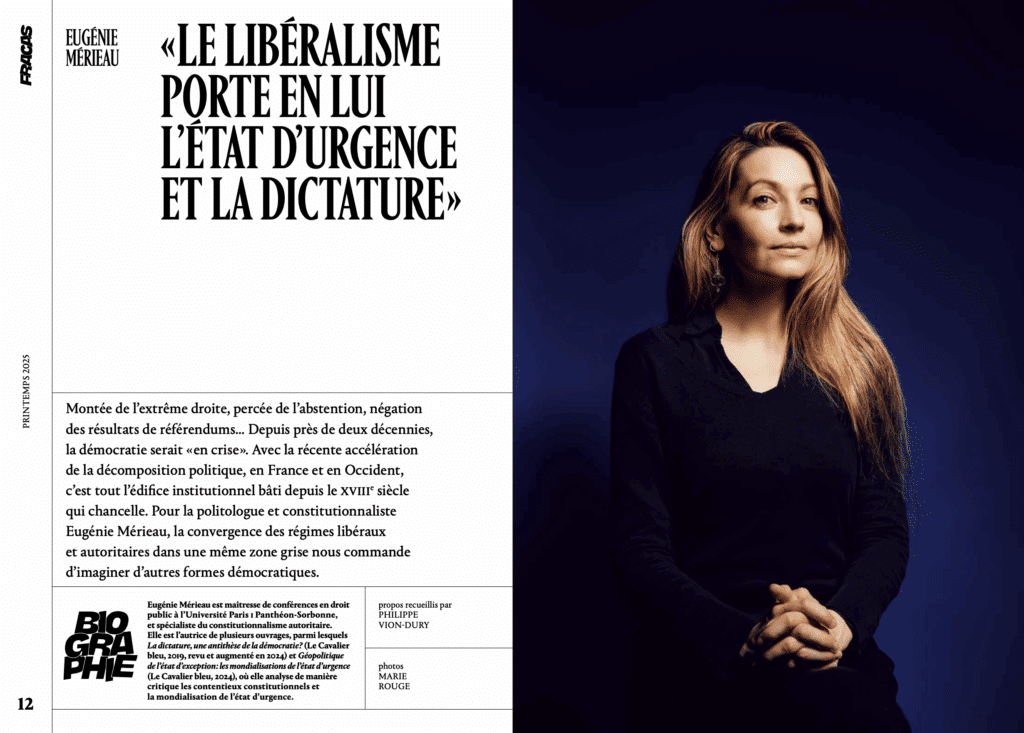
L’effarement d’une partie de la population devant la tournure que prennent nos systèmes vient-il du fait que ce ne sont plus seulement des groupes minoritaires ou marginalisés qui sont pris pour cible ?
En France, les Gilets jaunes ont marqué le moment où des techniques coloniales ont été utilisées sur des Blancs. Historiquement, l’état d’urgence avait été utilisé essentiellement sur le sol algérien, calédonien… En 2018, les LBD sont braqués sur des Français blancs, métropolitains, et l’on voit même l’impensable se produire lorsque des blindés font irruption sur les Champs Élysées. La prise de conscience de la dimension coloniale du pouvoir et du fait que la police est au service d’intérêts de classes a été brutale, effritant la croyance en un État neutre, au service de l’intérêt général. Pendant toute cette période, par ailleurs, l’Union européenne a vraiment incarné le libéralisme autoritaire, c’est-à-dire la suppression de mécanismes démocratiques au service du néolibéralisme, au service du marché.
Si la fiction s’est effondrée, si le masque démocratique est tombé, que reste-t-il ?
Les intérêts économiques, les propriétaires, l’oligarchie. Les droits socio-économiques ou environnementaux (dits de deuxième et de troisième génération) resteront toujours inféodés au droit de propriété, ils n’ont aucune espèce d’effectivité, comme en témoignent les jurisprudences des pays occidentaux. Ils ne sont qu’un alibi pour légitimer les droits civils et politiques des propriétaires (les droits de première génération), c’est-à-dire le droit de jouir égoïstement de ses propriétés. Depuis John Locke, les libertés et les droits de l’homme sont conçus à partir du droit de propriété, des droits subjectifs attachés à des individus supposés autonomes et rationnels. On oppose à l’État notre liberté quand celui-ci vient nous la retirer, et les libertés sont pensées comme des relations du propriétaire sur sa chose, sa liberté. C’est la critique marxiste classique.
D’ailleurs, on assiste ces temps-ci à un vrai retour de la critique marxiste du droit, et en particulier des droits subjectifs, qui a pendant un temps été quelque peu évincée par d’autres lectures plus « réformistes » en termes de genre, de race. Mais il faut réussir à mobiliser l’ensemble de ces critiques pour comprendre ce qui se joue au cœur de l’idéologie libérale depuis sa genèse. La liberté telle que définie et protégée par le contrat social-libéral n’est autre que l’intérêt individuel et ne peut s’exercer que via la domination d’une classe sur une autre.
Dans ce cas, avons-nous affaire non pas à une « dérive autoritaire » des régimes démocratiques, mais à la fin d’une « dérive démocratique » des régimes libéraux ?
Je le pense. Je me rappelle qu’il y a 20 ans, pendant mes études à Sciences Po, on interprétait déjà l’abstention comme un signe de la crise de la démocratie représentative. Or, on peut considérer que l’abstention est le socle même de la démocratie représentative. Si le vrai objectif de la démocratie représentative est de confisquer une part du pouvoir et le remettre aux mains d’une élite, alors l’abstention remplit bien sa fonction.
Au départ, la démocratie représentative se fonde sur un suffrage censitaire, réservé au seul propriétaire, qui s’est peu à peu universalisé. Et on y revient, de facto, puisque aujourd’hui, plus on est propriétaire, plus on vote. L’abstention ne doit pas être interprétée comme le symptôme d’une crise, mais plutôt comme le signe que le système fonctionne bien et parvient à exclure les intérêts des plus défavorisés de la représentation nationale ! C’était déjà l’objectif de Sieyès, à la fin du XVIIIᵉ siècle. C’est lui qui invente l’idée d’un « pouvoir constituant » supposément illimité, et en même temps, il affirme aussi que la France ne doit en aucun cas devenir une démocratie, mais bien un régime représentatif, à rebours des idées de Rousseau qui critiquait le principe électif comme une dénaturation de l’idée de démocratie, qui ne pouvait être que directe, avec non pas des représentants mais des commissaires. Sieyès insiste bien sur le fait que le mandat ne doit surtout pas être impératif pour que les représentants ne rendent pas de comptes au peuple qui les a élus. Aujourd’hui, c’est inscrit à l’article 27 de notre Constitution : « tout mandat impératif est nul ».
Certains historiens influents comme François Furet feront ensuite des démocrates de la Révolution française comme Robespierre, voire pour certains Rousseau, les précurseurs du totalitarisme. La Révolution française, associée à la « Terreur », est devenue la « preuve » que le gouvernement représentatif est le seul système possible. L’Histoire et l’histoire des idées telles qu’on nous les enseigne sont une fable visant à nous empêcher de penser des alternatives à cette forme de gouvernement qu’est le gouvernement représentatif.
Le Conseil constitutionnel ou l’État de droit nous étaient présentés comme des « garde-fous » du caractère démocratique de nos systèmes. Or, ceux-ci sont maintenant attaqués par un pouvoir exécutif, qui ne fait même plus semblant de les respecter. Mais ce faisant, il affaiblit d’autant plus la fiction de la démocratie libérale… N’est-ce pas paradoxal ?
Effectivement, les attaques viennent de tous les côtés. La droite dénonce le « gouvernement des juges », la gauche voit en eux des « leurres » démocratiques et des fictions, et même l’extrême centre s’y met en n’essayant même plus de cacher qu’elle ne les respecte pas. Mais difficile de savoir si c’est une démonstration de force ou une preuve de faiblesse… ou les deux ! En tous cas, le parallèle avec les années 1930 se justifie pleinement. Plus personne ne respectait la république de Weimar et le parlementarisme, ni la droite qui la jugeait faible et stérile, ni la gauche qui la jugeait anti-démocratique, ni dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’extrême centre qui la jugeait un peu trop sociale et pas assez ordonnée. On a vu alors comment les libéraux ont jeté la république de Weimar en pâture aux nazis, par pures manœuvres électorales court-termistes et par intérêt de classe.
La France est-elle devenue une démocratie illibérale ?
On peut comparer la trajectoire d’Emmanuel Macron à celle de Viktor Orbán. On a, dans les deux cas, un parcours qui commence à « gauche » dans la jeunesse et qui dérive vers la droite, jusqu’à doubler la droite sur sa droite. On se souvient de Gérald Darmanin accusant Marine Le Pen d’être trop « molle ». Le parti d’extrême droite hongrois historique Jobbik est aujourd’hui davantage au centre de l’échiquier politique que le parti d’Orbán. Les derniers mois ont été, en France, marqués par plusieurs violations – qu’on appelle poliment « détournements » ou « interprétations contestées » de la Constitution. On a tout de même gouverné par gouvernement démissionnaire pendant 51 jours ! Les constitutionnalistes n’osent pas dire qu’on est dans un pays où il est devenu banal de violer la Constitution, car cela fait s’écrouler la fiction : la Constitution en sortirait désacralisée, et il deviendrait encore plus facile de la violer. On a donc tendance à toujours vouloir interpréter les actes politiques comme étant en accord avec une « certaine lecture » de la Constitution. C’est à peine si la proposition de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel (1) provoque quelques tribunes…
« Notre problème, c’est que nous n’avons pas de contre-modèle aujourd’hui. Si la France et la Russie sont gouvernées sur le même modèle, où aller en chercher un autre ? »
Qu’est-ce qui nous sépare, en définitive, des régimes que l’on considère comme dictatoriaux ou autoritaires ?
J’essaie de montrer dans mes travaux que la manière dont on pense la Vᵉ République, à l’image de la manière dont on pense la démocratie libérale, est construite par une autre fiction, son miroir inverse : la dictature. Or, la Vᵉ République est un copier-coller de Weimar avec encore moins de contreseings, et des pouvoirs propres pour le Président, chose qu’on ne retrouve aujourd’hui qu’en Russie et dans quelques autres pays. L’architecture de notre régime est plus proche de celle de la Russie que de n’importe quel système parlementaire dans le monde. Nous vivons dans le déni de ce fait – ce qu’on me fait généralement remarquer dans les colloques internationaux.
Pour ce qui est de la dictature, on a inventé une image de celle-ci qui nous permet de nous figurer que nous sommes l’exact contraire. Or, comme dans les démocraties, on y retrouve des constitutions, des élections et des manipulations électorales, des suspensions de droits et libertés par états d’urgence, etc. Une différence marquée entre les deux se situe généralement au niveau de la liberté d’expression : mais ce mythe est en train de voler en éclats en France, alors que la critique se fait de plus en plus radicale. Comme le disait Rosa Luxemburg : « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. » Depuis qu’on commence à bouger et à remettre en question le consensus libéral, on découvre qu’il y a des chaînes… La liberté d’expression est bien un marqueur de distinction, qui m’intéresse en tant qu’anthropologue du droit ou « comparatiste », mais non pas pour discriminer entre bons et mauvais régimes, mais en ce qu’il montre que, d’une société à l’autre, les « chaînes » ne sont simplement pas au même endroit.
Par exemple ?
En Thaïlande, un pays sur lequel j’ai beaucoup travaillé, vous ne pouvez pas critiquer le roi, mais vous pouvez insulter le gouvernement sans problème. Vous pouvez aussi dire que le Hamas est un mouvement de résistance, soutenir la Palestine sans être inquiété pour apologie du terrorisme… il n’y a aucune loi mémorielle. En Europe, on a interdit Russia Today ou Spoutnik sur la base d’une décision de la Commission européenne sans aucun fondement juridique – protéger de la « désinformation » ? Dans le même temps, l’infraction d’apologie du terrorisme est utilisée pour interdire de façon préventive les manifestations et criminaliser tout soutien à la Palestine.
En réalité, le niveau de violence et de répression d’un État ne dépend pas de sa nature libérale ou autoritaire : ce qui définit le niveau de violence, c’est le degré de menace que fait peser sur le régime une contestation. Le niveau de violence physique peut être très faible dans des États autoritaires qui rencontrent peu de contestation interne, et très fort dans des régimes libéraux qui prennent peur face à la rue. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été réprimée sévèrement pour cela : elle ouvrait un imaginaire hors de l’État, et a provoqué une réponse étatique complètement disproportionnée.
Si le couple dictature-démocratie libérale s’apparente davantage à un spectre tout en nuances, en degrés, plutôt qu’à une opposition franche, de nature, il y a quand même eu des régimes totalitaires…
Il ne s’agit pas de minimiser la violence des régimes staliniens ou nazis. Hannah Arendt a créé cette catégorie de totalitarisme pour définir un régime fondé sur la terreur, ce qui paraît essentialisant et forcément réducteur. Elle est assez ambivalente, mais elle fait partie, dans une certaine mesure, de ceux qui établissent une filiation entre la « Terreur » de la Révolution française et les totalitarismes. Ce qui me gêne dans son approche – et peu de gens travaillent encore avec ses outils aujourd’hui –, c’est qu’elle ôte deux régimes de la matrice du comparatisme. C’est le même procédé que pour démocratie-dictature : cela permet de ne pas les comparer. Ils deviennent des impensables, des parenthèses inexplicables. Pourtant, comme l’écrivait Aimé Césaire, le caractère exceptionnel du crime des nazis n’a pas été l’invention du génocide, mais la mise en pratique du génocide contre des Blancs.
Y a-t-il une voie de sortie de ce dualisme libéral-autoritaire ?
C’est à nous d’inventer quelque chose de radicalement différent. Quand Montesquieu, dans L’Esprit des lois, décrit la Chine comme « un État despotique, dont le principe est la crainte », une monarchie sans légalité où « un seul gouverne, mais sans règles préétablies, donc par ses caprices et sa propre volonté », il tend en réalité un miroir à la monarchie absolue en France. C’est le même procédé que celui qu’il avait utilisé auparavant dans les Lettres Persanes. Son modèle à lui, c’est le Royaume-Uni, et c’est ce qu’il propose en contre-modèle de la Chine. Notre problème, c’est que nous n’avons pas de contre-modèle aujourd’hui. Si la France et la Russie sont gouvernées sur le même modèle, où aller en chercher un autre ?
En France, l’analyse répandue, y compris à gauche et même à la France insoumise, est qu’on a plutôt affaire à une crise de régime, la crise de la Vᵉ République, c’est-à-dire d’un régime libéral semi-présidentiel… Et on peut avoir l’impression que du point de vue institutionnel, les partis de gauche ne désirent pas autre chose qu’un système parlementaire « à l’allemande », pourtant lui aussi en crise (2)…
Le parti-pris de la France insoumise est de simplement demander une assemblée constituante, composée par des élus ou issue du tirage au sort, et que c’est à elle de décider. Mais il est vrai qu’on perçoit plutôt un désir de régime parlementaire, et c’est dommage.
Sans s’en référer à un modèle clé en main, y a-t-il des pistes auxquelles on devrait prêter davantage attention ?
Il y a la question du référendum. Nous n’avons pas en France de vocabulaire à ce propos. On a qu’un seul mot qui recouvre le référendum d’approbation, d’initiative, de révocation, de plébiscite, etc. La gauche a fait une erreur en laissant ce sujet à la droite qui, du RN à Emmanuel Macron, a commencé à l’investir.
La proposition de la France insoumise de lancer un processus constituant via l’article 11 est intéressante bien que problématique, car s’inscrivant dans les traces de la violation historique de la Constitution par le général de Gaulle en 1962, lorsqu’il fait adopter l’élection du Président au suffrage universel direct. Le pari est que, sans connaître exactement la destination, il s’agit déjà d’ouvrir un chemin, c’est-à-dire un espace d’expérimentation et de discussion collective. Comme l’écrit René Char dans Feuillets d’Hypnos, « l’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer » ! Mais ce n’est pas gage de réussite : le processus constituant chilien (3), qui était très ouvert, a pourtant échoué.
On peut aussi se demander s’il ne faut pas laisser tomber l’option de la Constituante et passer plutôt par des zones d’expérimentation, par le principe fédératif cher aux anarchistes, qui part d’en bas, à l’opposé d’un processus constituant, qui partirait d’en haut. L’Islande est parvenue à produire une Constitution au terme d’une écriture collective. Car le risque serait de voir le processus constituant confisqué par Macron, par le Rassemblement national, ou même par la France insoumise, où l’on se retrouverait avec un recommencement.
Qu’est-ce que l’écologie peut apporter dans tout ça ?
La nouvelle donne, par rapport au reflux des années 1960-1970, c’est l’écologie. Elle est venue mettre en cause tous les grands récits : le progrès, la science, la technique, l’État… Tous les fondements même de notre modernité. Et toutes les formes politiques qui vont avec. Mais il y a une contradiction entre les échéances : il faut à la fois ouvrir des imaginaires lointains, mais aussi réfléchir à ce qu’il va se passer demain.
Je mettrais aussi en garde les écologistes contre le désir de constitutionnalisation, c’est-à-dire de gagner des procès et inscrire dans la Constitution de nouvelles dispositions environnementales. Il ne faut pas oublier que ce que l’on confie au juge, on le retire de la délibération populaire. Lorsque l’on inscrit une chose dans la Constitution, on la confie au juge, qui va mettre en balance différents principes. Veut-on vraiment que le juge ait le dernier mot dans la conciliation entre le droit de propriété et le droit de l’environnement ? Aujourd’hui, il tranchera toujours en faveur du premier. Dès lors, les victoires ne sont plus que symboliques. Tout cela n’est-il pas, en définitive, de la diversion ? Une canalisation de l’énergie vers des fausses victoires pour empêcher un vrai combat écologique ?
Notes :
(1) En février 2025, l’ancien Président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, réputé proche d’Emmanuel Macron, a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel, malgré une modeste compétence juridique et une mise en examen pour « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne.
(2) Lors des législatives de février 2025, le parti d’extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AfD) a recueilli 20,8 % des suffrages et s’est imposé comme la deuxième force du pays. Le paysage politique allemand, à l’instar de la France, connaît une recomposition tripartite entre gauche, centre droit et extrême droite.
(3) Le Chili a connu un processus constituant de 2021 à 2023 qui s’est clôt par le rejet de la nouvelle Constitution soumise au référendum. Si les raisons de cet échec sont multiples, le processus constituant a fait l’objet d’une offensive politique massive dans un paysage médiatique largement détenu par la droite conservatrice.
L’article Eugénie Mérieau : « Le libéralisme porte en lui l’état d’urgence et la dictature » est apparu en premier sur Fracas.
Philippe Vion-Dury
Texte intégral (1240 mots)
Dans l’ombre du massacre des Gazaouis, que l’Élysée se refuse toujours à qualifier de génocide, un écocide méthodiquement opéré par le Tsahal pourrait avoir raison de toute vie sur le territoire palestinien. À un tel niveau de destruction, ce crime n’est pas seulement un crime contre l’humanité, mais contre l’avenir : l’écocide n’est plus seulement une arme dans le répertoire colonial mais un futuricide. Qui nous concerne tous, pour les temps présents et pour ce qu’ils augurent.
Emmanuel Macron vient de rejoindre une coalition de pays occidentaux pour forcer Israël à mettre fin à ce qui ne sera toujours pas qualifié de génocide par l’Élysée, mais d’« actions scandaleuses ». Il aura fallu les images de famine, que redoutait le gouvernement Netanyahu, et 53 000 victimes civiles palestiniennes – en réalité plusieurs centaines de milliers si l’on comptabilise les morts indirectes, selon les projections d’une étude parue dans la revue scientifique The Lancet – pour obtenir cette timide réponse. Trop peu, trop tard ?
Si les mâchoires du piège à loup tendu aux Palestiniens – partir ou mourir – par le gouvernement Netanyahu sont presque refermées, une lueur d’espoir vient peut-être de s’allumer pour empêcher l’extermination totale de la population gazaouie ou sa déportation massive. Cependant, les survivants auront-ils encore un avenir si les opérations militaires israéliennes s’arrêtent – ce qui est encore loin d’être assuré ? Dans l’ombre des massacres, l’écocide méthodique opéré par Tsahal pourrait avoir raison de toute vie sur le territoire palestinien.
Un écocide inédit
Dans un entretien donné à Reporterre, l’historienne et politiste Stéphanie Latte Abdallah, qui a dirigé l’ouvrage collectif Gaza, une guerre coloniale (Actes Sud, mai 2025), rappelle quelques données essentielles.
– Des bombes de deux tonnes ont été employées, ainsi que des bombes au phosphore, et ces tirs qui ont pénétré en profondeur ont généré une pollution durable ;
– Les bombardement ont généré cinquante millions de tonnes de gravats ;
– 70 % des zones agricoles ont été rasées (sans oublier les inondations des galeries souterraines à l’eau de mer qui nuiront à l’approvisionnement en eau et à la fertilité future des sols) ;
– entre 70 et 80 % des terres cultivables ont été détruites, de même que les fermes, les puits, les serres, les systèmes d’irrigation (certaines infrastructures ont été rasées méthodiquement, à l’aide de bulldozer) ;
– les infrastructures industrielles endommagées relâchent et continueront de relâcher des produits toxiques dans l’environnement ;
– Les usines de traitement de l’eau ne sont plus totalement fonctionnelles ;
– 83 % des végétaux ont été détruits ;
– L’intégralité du bétail a été décimée…
En résumé : les sols, les eaux et l’air sont pollués à des niveaux effarants, et continueront de l’être pour longtemps. La capacité à assurer une production vivrière a été quant à elle anéantie, notamment les plantations d’oliviers, symbole communautaire autant que pourvoyeuses de nourriture et de revenus pour les populations palestiniennes, condamnée à la déportation au risque de devoir errer sur des terres transformées en cauchemar, y survivre et plus certainement, y mourir.
La destruction des futurs
À un tel niveau de destruction, ce crime n’est pas seulement un crime contre l’humanité mais contre l’avenir, l’écocide n’est plus seulement une arme dans le répertoire colonial mais un futuricide. Dans cette perspective, l’écocide devient un outil au service de l’impérialisme : en déchirant le tissu vivant, en sapant les possibilités même de subsistance d’une population, il la prive de son autonomie, c’est-à-dire de sa capacité à écrire son propre avenir.
En cela, Andreas Malm a raison de dire que « la Palestine apparaît comme un signe des temps présents, mais aussi de l’avenir qui nous attend », et de tracer un parallèle entre la destruction de ce territoire et la destruction de la planète. Le capitalisme écocidaire n’est-il pas finalement une vaste entreprise de spoliation de l’avenir de l’espèce en sapant l’autonomie des sociétés, jusqu’à détruire complètement leur lien organique avec les écosystèmes vivants ?
Le président colombien Gustavo Petro n’a pas hésité à déclarer que ce qu’il se passe à Gaza est ce à quoi les pays du Sud seraient confrontés dans un futur très proche. On pourrait ajouter que les pays du Nord, dans une moindre mesure, partagent ce destin, chaque année plus artificialisés, aridifiés, stérilisés, transformés en hinterlands pour servir l’économie-monde.
Pour la Palestine comme pour la Terre
De la même manière que le colonialisme de peuplement emploie l’écocide pour détruire avant de reconstruire selon les objectifs qu’il s’est fixés, le capitalisme, organiquement et historiquement colonial, emploie l’écocide pour redessiner les terres, la Terre, selon ses besoins. La projet de Trump de transformer la Palestine en « Riviera » prend ici tout son sens : la création de toute pièce d’un territoire spécialisé, mort, sans histoire, sans vie, animé seulement du mouvement des capitaux.La lutte écologique n’est pas seulement une lutte contre le capitalisme, elle est un combat à mort entre nos futurs et le Futur qui voudrait nous être imposé. Entre l’infatigable recherche du « comment nous pourrions vivre » et l’injonction impitoyable « comment nous devons vivre », si tant est qu’il nous est encore autorisé de vivre. Alors que la bourgeoisie verte se rêve déjà en arme contre les ennemis qu’elle se choisit opportunément, elle ferait bien de tourner son regard vers la Palestine et d’en soutenir la vue, car elle est bien un signe de l’avenir qui nous attend, le Capitalocène parachevé.
L’article La Palestine, stade terminal du Capitalocène est apparu en premier sur Fracas.
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène