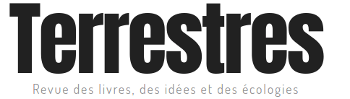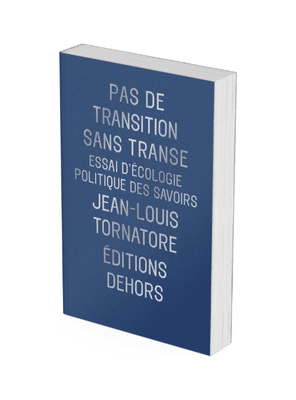Introduction à l’ouvrage de Christian Laval, Marx en Amérique (Champ Vallon, 2025), suivie d’un extrait.
Voici un livre étonnant, hors du commun. À la fois roman, récit ethnographique et manifeste politique, il nous propose un autre Marx, un Marx communiste, certes, mais très éloigné du partisan du progrès et des forces productives de certains écrits très (trop) connus. L’auteur s’appuie, certes, sur ses Cahiers de Notes Ethnographiques, sur ses dernières lettres sur la Russie, mais il s’agit quand même d’un Marx inconnu, produit de l’imagination romancière.
Marx se rend aux États-Unis et devient l’ethnologue d’une communauté indienne
Le sociologue Christian Laval nous propose un Marx, qui, après avoir organisé en 1883 un faux enterrement, avec la complicité de ses filles et de Friedrich Engels, part en Amérique pour rencontrer les Iroquois dont parlait si bien l’anthropologue américain Lewis Morgan (1818-1881). Déguisé en George Tullok, ethnologue anglais d’origine germanique, il découvre au village de Tecumseh, dans l’État de New York, une communauté de Senecas, derniers descendants de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires. Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans cette communauté, par épouser White Wing, une institutrice veuve, et par prendre une nouvelle identité : le Seneca Clever Fox. Sa solidarité avec les Iroquois va même le conduire à faire sauter le bureau d’une entreprise de spéculation foncière responsable de l’expropriation des terres indigènes : « la dynamite, voilà l’ultime arme de la critique »…
Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans une communauté issue de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires.
Ce nouveau Marx reçoit après quelques années la visite de son ami Engels, qui l’accuse d’être devenu rousseauiste, et de sa fille Eleanor (« Tussy ») qui le compare à son ami William Morris. Devant sa fille, « Clever Fox » se livre à un bilan auto-critique : j’ai cru, dit-il, que la liberté passait par l’esclavage du capital, j’ai même osé parler de la « grande influence civilisatrice du capital » et du rôle révolutionnaire de la colonisation anglaise de l’Asie. Sa nouvelle conception de l’histoire est inspirée d’un célèbre passage de Morgan : « la nouvelle société de l’avenir sera une résurrection, sous une forme supérieure, de la liberté, égalité, fraternité des anciennes gentes ».
Rêvant d’une nouvelle Confédération de tous les autochtones de l’Amérique du Nord, et, pourquoi pas, de toutes les nations du monde, le vieux Clever Fox décide, à la fin du siècle, de mettre fin à ses jours en plongeant dans les chutes du Niagara. Dans un « Cahier de notes » (imaginaire) à la fin du livre, Marx explique sa nouvelle conception dialectique de l’histoire, en rupture avec l’idéologie bourgeoise du progrès : on doit revenir en arrière pour aller de l’avant. Le communisme est un mouvement backforward, un principe antérieur élevé à un niveau supérieur.
Un des aspects les plus intéressants – et actuels – du livre sont les réflexions de Marx sur la dimension « écologique » du mode de vie des Iroquois : le respect pour la nature, l’amour pour la Terre mère, un rapport non-propriétaire au monde, la solidarité avec tous les êtres vivants, bref, un « communisme du vivant » aux antipodes de la culture de la rapine, du gaspillage et du vandalisme de la modernité capitaliste.
Comment passer de l’expérience de vie de cette petite communauté seneca (300 âmes) à une transformation de toute la société ? Marx, ou « Clever Fox », n’a pas de réponse, mais suggère que les tentatives communistes doivent se concevoir comme des éléments d’une stratégie d’ensemble, qui combine l’expérimentation locale et la révolution.
Lire aussi sur Terrestres : Michael Löwy, « Marx, prophète de la décroissance ? », décembre 2024.
« On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir »
Le passage qui suit est un extrait de « Marx en Amérique » (pp. 355-357). L’ouvrage se termine par un cahier imaginaire de Marx intitulé « Notes sur la démocratie communiste des Iroquois ». Dans ces pages, Marx reconnaît s’être trompé dans sa philosophie de l’histoire, linéaire et téléologique, et esquisse une auto-critique de ses propres thèses à la lumière des travaux de l’anthropologue américain Lewis Morgan qu’il avait lu attentivement.
L’erreur partait d’une idée juste selon laquelle le capital dans son développement continu allait détruire toutes les bases antérieures de la société en les intégrant dans son propre mouvement, et par cette intégration, les transformer radicalement en conditions de son propre développement. Car telle est sa force, qui est de poser sans cesse les conditions de son propre élargissement en disposant de ce qui existe et en le rendant « utile ». L’ancien monde était conservé parfois, mais rarement, comme vestige inutile et plus souvent comme dimension de l’accumulation du capital mais sous une forme méconnaissable.
À cela, j’ajoutais le point décisif, qui tranchait avec toute la pensée bourgeoise du progrès, que ce mouvement même qui consiste à poser les conditions d’une accumulation toujours plus vaste n’était jamais en même temps que le mouvement de poser les conditions de sa propre fin, pas seulement par la répétition de crises toujours plus profondes mais par l’existence d’un prolétariat toujours plus nombreux et conscient qui porterait en lui, comme le capital de l’autre côté, la puissance de poser les conditions de sa victoire. Tout ceci passait par pertes et profits ce qui dans les anciennes sociétés était pourtant comme le dit Morgan le germe de la démocratie souhaitable. Mais comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur, alors que tout laisse à penser maintenant qu’il ne peut donner qu’un monde bien pire sous beaucoup d’aspects ? Il ne s’agit d’ailleurs pas ici de plus et de moins, ni de bien et de mal. Mais d’être et de non être. C’est bien ce que dit Morgan si on le lit bien. La propriété dissout la société, elle conduit au pur et simple chaos, à la destruction de ce qui fait l’humanité.
Comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur ?
Morgan remet tout en place quand il écrit que la société future naîtra d’une « reviviscence » des anciens modes de vie. C’est lumineux. Ce n’est pas la propriété qui engendre la non- propriété directement, c’est la non-propriété qui engendrera la non-propriété par un sursaut révolutionnaire de ce qui ne veut pas mourir.
L’histoire ne va pas en ligne droite, pas en zigzag non plus, elle suit un étrange mouvement, assez complexe il faut bien le dire : on doit revenir en arrière pour aller plus loin en avant. Avant-arrière, arrière-avant. C’est le « retour-avant », le « Fore-return » ou le « Vor-Rückkehr ». C’est une dialectique qui n’a rien à voir avec les jeux de mots à la Hegel, ce n’est pas de la spéculation, ce sont les processus réels. J’avais vu ça il y a longtemps lorsque j’avais écrit quelques pages sur la Révolution française, je m’étais surtout moqué de ces bourgeois qui se prenaient pour Périclès, Caton ou Cicéron. Je n’avais pas com- pris encore la nécessité et l’universalité du « retour-avant ». Les Russes me l’ont fait comprendre par leurs questionnements et leurs angoisses : « faut-il attendre le plein développe- ment du capitalisme pour espérer une révolution socialiste ? » Malheureusement en dépit de ce que j’ai un peu maladroitement essayé de leur expliquer, les meilleurs se sont ralliés à un « marxisme » amoureux du capital ! Engels me l’a confirmé.
Il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, ce qu’il y avait de mieux dans le passé.
Échec donc. Mais en y réfléchissant plus longuement, je me suis aperçu que les héros de la Commune de Paris avaient aussi suivi la dialectique du « retour-avant », en se replongeant dans les vieilles traditions de l’autonomie communale contre l’État centralisateur, ils ont réellement inventé quelque chose de nouveau. Tout colle : il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, « supérieure » dit Morgan, ce qu’il y avait de mieux dans le passé, ce qu’on veut sauver, ce qu’on veut prolonger et étendre. On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir. Avancer en régressant, marcher en reculant. Hegel avait eu l’intuition de ça sans doute, comme de bien d’autres choses, mais il n’a pas été jusqu’à faire l’analyse des « retours- avant » comme il faudrait la faire. C’est ce que font les Red Guns [les indiens], certes dans les conditions les plus défavorables : un « retour-avant », concept clé de la dialectique du temps, si j’ai le temps de la rédiger (ce qui m’étonnerait car j’ai bien d’autres choses à faire ou à ne pas faire !). […] »
Lire aussi sur Terrestres : Kai Heron, « La sortie du capitalisme en débat chez les écosocialistes», mai 2024.
Photo d’ouverture : réplique d’une maison sénéca en construction sur le site historique de l’État de Ganondagan New York, 1997. Crédits : Peter Flass, CC BY 4.0.
SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Soutenir la revue Terrestres