03.09.2022 à 02:00
Bifurquer avant l’impact : l’impasse du capitalisme de surveillance
La chaleur de l’été ne nous fait pas oublier que nous traversons une crise dont les racines sont bien profondes. Pendant que nos forêts crament, que des oligarques jouent aux petits soldats à nos portes, et vu que je n’avais que cela à faire, je lisais quelques auteurs, ceux dont on ne parle que rarement mais qui sont Ô combien indispensables. Tout cela raisonnait si bien que, le temps de digérer un peu à l’ombre, j’ai tissé quelques liens avec mon sujet de prédilection, la surveillance et les ordinateurs. Et puis voilà, paf, le déclic. Dans mes archives, ces mots de Sébastien Broca en 2019 : « inscrire le capitalisme de surveillance dans une histoire plus large ». Mais oui, c’est là dessus qu’il faut insister, bien sûr. On s’y remet.
Je vous livre donc ici quelques réflexions qui, si elles sont encore loin d’être pleinement abouties, permettront peut-être à certains lecteurs d’appréhender les luttes sociales qui nous attendent ces prochains mois. Alimentons, alimentons, on n’est plus à une étincelle près.
(Article paru dans le Framablog le 29/08/2022)
Table des matières
Le capitalisme de surveillance est un mode d’être du capitalisme aujourd’hui dominant l’ensemble des institutions économiques et politiques. Il mobilise toutes les technologies de monitoring social et d’analyse de données dans le but de consolider les intérêts capitalistes à l’encontre des individus qui se voient spoliés de leur vie privée, de leurs droits et du sens de leur travail. L’exemple des entreprises-plateformes comme Uber est une illustration de cette triple spoliation des travailleurs comme des consommateurs. L’hégémonie d’Uber dans ce secteur d’activité s’est imposée, comme tout capitalisme hégémonique, avec la complicité des décideurs politiques. Cette complicité s’explique par la dénégation des contradictions du capitalisme et la contraction des politiques sur des catégories anciennes largement dépassées. Que les décideurs y adhèrent ou non, le discours public reste campé sur une idée de la production de valeur qui n’a plus grand-chose de commun avec la réalité de l’économie sur-financiarisée.
Il est donc important d’analyser le capitalisme de surveillance à travers les critiques du capitalisme et des technologies afin de comprendre, d’une part pourquoi les stratégies hégémoniques des multinationales de l’économie numérique ne sont pas une perversion du capitalisme mais une conséquence logique de la jonction historique entre technologie et finance, et d’autre part que toute régulation cherchant à maintenir le statu quo d’un soi-disant « bon » capitalisme est vouée à l’échec. Reste à explorer comment nous pouvons produire de nouveaux imaginaires économiques et retrouver un rapport aux technologies qui soit émancipateur et générateur de libertés.
Situer le capitalisme de surveillance dans une histoire critique du capitalisme
Dans la Monthly Review en 2014, ceux qui forgèrent l’expression capitalisme de surveillance inscrivaient cette dernière dans une critique du capitalisme monopoliste américain depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, lorsqu’on le ramène à l’histoire longue, qui ne se réduit pas aux vingt dernières années de développement des plus grandes plateformes numériques mondiales, on constate que le capitalisme de surveillance est issu des trois grands axes de la dynamique capitaliste de la seconde moitié du XXᵉ siècle. Pour John B. Foster et Robert W. McChesney, la surveillance cristallise les intérêts de marché de l’économie qui soutient le complexe militaro-industriel sur le plan géopolitique, la finance, et le marketing de consommation, c’est-à-dire un impérialisme sur le marché extérieur (guerre et actionnariat), ce qui favorise en retour la dynamique du marché intérieur reposant sur le crédit et la consommation. Ce système impérialiste fonctionne sur une logique de connivence avec les entreprises depuis plus de soixante ans et a instauré la surveillance (de l’espionnage de la Guerre Froide à l’apparition de l’activité de courtage de données) comme le nouveau gros bâton du capitalisme.
Plus récemment, dans une interview pour LVSL, E. Morozov ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme qu’aujourd’hui l’enjeu des Big Tech aux États-Unis se résume à la concurrence entre les secteurs d’activités technologiques sur le marché intérieur et « la volonté de maintenir le statut hégémonique des États-Unis dans le système financier international ».
Avancées technologiques et choix sociaux
Une autre manière encore de situer le capitalisme de surveillance sur une histoire longue consiste à partir du rôle de l’émergence de la microélectronique (ou ce que j’appelle l’informatisation des organisations) à travers une critique radicale du capitalisme. C’est sur les écrits de Robert Kurz (et les autres membres du groupe Krisis) qu’il faut cette fois se pencher, notamment son travail sur les catégories du capitalisme.
Ici on s’intéresse à la microélectronique en tant que troisième révolution industrielle. Sur ce point, comme je le fais dans mon livre, je préfère maintenir mon approche en parlant de l’informatisation des organisations, car il s’agit surtout de la transformation des processus de production et pas tellement des innovations techniques en tant que telles. Si en effet on se concentre sur ce dernier aspect de la microélectronique, on risque d’induire un rapport mécanique entre l’avancement technique et la transformation capitaliste, alors que ce rapport est d’abord le résultat de choix sociaux plus ou moins imposés par des jeux de pouvoirs (politique, financier, managérial, etc.). Nous y reviendrons : il est important de garder cela en tête car l’objet de la lutte sociale consiste à prendre la main sur ces choix pour toutes les meilleures raisons du monde, à commencer par notre rapport à l’environnement et aux techniques.
Pour expliquer, je vais devoir simplifier à l’extrême la pensée de R. Kurz et faire des raccourcis. Je m’en excuse par avance. R. Kurz s’oppose à l’idée de la cyclicité des crises du capitalisme. Au contraire ce dernier relève d’une dynamique historique, qui va toujours de l’avant, jusqu’à son effondrement. On peut alors considérer que la succession des crises ont été surmontées par le capitalisme en changeant le rapport structurel de la production. Il en va ainsi pour l’industrialisation du XIXᵉ siècle, le fordisme (industrialisation moderne), la sur-industrialisation des années 1930, le marché de consommation des années 1950, ou de la financiarisation de l’économie à partir des années 1970. Pour R. Kurz, ces transformations successives sont en réalité une course en avant vers la contradiction interne du capitalisme, son impossibilité à renouveler indéfiniment ses processus d’accumulation sans compter sur les compensations des pertes de capital, qu’elles soient assurées par les banques centrales qui produisent des liquidités (keynésianisme) ou par le marché financier lui-même remplaçant les banques centrales (le néolibéralisme qui crée toujours plus de dettes). Cette course en avant connaît une limite indépassable, une « borne interne » qui a fini par être franchie, celle du travail abstrait (le travail socialement nécessaire à la production, créant de la valeur d’échange) qui perd peu à peu son sens de critère de valeur marchande.
Cette critique de la valeur peut être vue de deux manières qui se rejoignent. La première est amenée par Roswitha Scholz et repose sur l’idée que la valeur comme rapport social déterminant la logique marchande n’a jamais été critiquée à l’aune tout à fait pratique de la reproduction de la force de travail, à savoir les activités qu’on détermine comme exclusivement féminines (faire le ménage, faire à manger, élever les enfants, etc.) et sont dissociées de la valeur. Or, cette tendance phallocrate du capitalisme (comme de la critique marxiste/socialiste qui n’a jamais voulu l’intégrer) rend cette conception autonome de la valeur complètement illusoire. La seconde approche situe dans l’histoire la fragilité du travail abstrait qui dépend finalement des processus de production. Or, au tournant des années 1970 et 1980, la révolution informatique (la microélectronique) est à l’origine d’une rationalisation pour ainsi dire fulgurante de l’ensemble des processus de production en très peu de temps et de manière mondialisée. Il devient alors plus rentable de rationaliser le travail que de conquérir de nouveaux espaces pour l’accumulation de capital. Le régime d’accumulation atteint sa limite et tout se rabat sur les marchés financiers et le capital fictif. Comme le dit R. Kurz dans Vies et mort du capitalisme1 :
C’est le plus souvent, et non sans raison, la troisième révolution industrielle (la microélectronique) qui est désignée comme la cause profonde de la nouvelle crise mondiale. Pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, en effet, les potentiels de rationalisation dépassent les possibilités d’une expansion des marchés.
Non seulement il y a la perte de sens du travail (la rationalisation à des échelles inédites) mais aussi une rupture radicale avec les catégories du capitalisme qui jusque-là reposaient surtout sur la valeur marchande substantiellement liée au travail abstrait (qui lui-même n’intégrait pas de toute façon ses propres conditions de reproduction).
Très voisins, les travaux d’Ernst Lohoff et de Norbert Trenkle questionnent la surfinanciarisation de l’économie dans La grande dévalorisation2. Pour eux, c’est la forme même de la richesse capitaliste qui est en question. Ils en viennent aux mêmes considérations concernant l’informatisation de la société. La troisième révolution industrielle a créé un rétrécissement de la production de valeur. La microélectronique (entendue cette fois en tant que description de dispositifs techniques) a permis l’avancée de beaucoup de produits innovants mais l’innovation dans les processus de production qu’elle a induits a été beaucoup plus forte et attractive, c’est-à-dire beaucoup plus rentable : on a préféré produire avec toujours moins de temps de travail, et ce temps de travail a fini par devenir une variable de rentabilité au lieu d’être une production de valeur.
Si bien qu’on est arrivé à ce qui, selon Marx, est une incompatibilité avec le capitalisme : l’homme finit par se situer en dehors du processus de production. Du moins, il tend à l’être dans nos économies occidentales. Et ce fut pourtant une sorte d’utopie formulée par les capitalistes eux-mêmes dans les années 1960. Alors que les industries commençaient à s’informatiser, le rêve cybernéticien d’une production sans travailleurs était en plein essor. Chez les plus techno-optimistes on s’interrogeait davantage à propos des répercussions de la transformation des processus de production sur l’homme qu’à propos de leur impact sur la dynamique capitaliste. La transformation « cybernétique » des processus de production ne faisait pas vraiment l’objet de discussion tant la technologie était à l’évidence une marche continue vers une nouvelle société. Par exemple, pour un sociologue comme George Simpson3, au « stade 3 » de l’automatisation (lorsque les machines n’ont plus besoin d’intervention humaine directe pour fonctionner et produire), l’homme perd le sens de son travail, bien que libéré de la charge physique, et « le système industriel devient un système à boutons-poussoirs ». Que l’automatisation des processus de production (et aussi des systèmes décisionnels) fasse l’objet d’une critique ou non, ce qui a toujours été questionné, ce sont les répercussions sur l’organisation sociale et le constat que le travail n’a jamais été aussi peu émancipateur alors qu’on en attendait l’inverse4.
La surveillance comme catégorie du capitalisme
Revenons maintenant au capitalisme de surveillance. D’une part, son appellation de capitalisme devient quelque peu discutable puisqu’en effet il n’est pas possible de le désincarner de la dynamique capitaliste elle-même. C’est pour cela qu’il faut préciser qu’il s’agit surtout d’une expression initialement forgée pour les besoins méthodiques de son approche. Par contre, ce que j’ai essayé de souligner sans jamais le dire de cette manière, c’est que la surveillance est devenue une catégorie du capitalisme en tant qu’elle est une tentative de pallier la perte de substance du travail abstrait pour chercher de la valeur marchande dans deux directions :
- la rationalisation à l’extrême des processus productifs qu’on voit émerger dans l’économie de plateformes, de l’esclavagisme moderne des travailleurs du clic à l’ubérisation de beaucoup de secteurs productifs de services, voire aussi industriels (on pense à Tesla). Une involution du travail qui en retour se paie sur l’actionnariat tout aussi extrême de ces mêmes plateformes dont les capacités d’investissement réel sont quasi-nulles.
- L’autre direction est née du processus même de l’informatisation des organisations dès le début, comme je l’ai montré à propos de l’histoire d’Axciom, à savoir l’extraction et le courtage de données qui pillent littéralement nos vies privées et dissocient cette fois la force de travail elle-même du rapport social qu’elle implique puisque c’est dans nos intimités que la plus-value est recherchée. La financiarisation de ces entreprises est d’autant plus évidente que leurs besoins d’investissement sont quasiment nuls. Quant à leurs innovations (le travail des bases de données) elles sont depuis longtemps éprouvées et reposent aussi sur le modèle de plateforme mentionné ci-dessus.
Mais alors, dans cette configuration, on a plutôt l’impression qu’on ne fait que placer l’homme au centre de la production et non en dehors ou presque en dehors. Il en va ainsi des livreurs d’Uber, du travail à la tâche, des contrats de chantiers adaptés à la Recherche et à l’Enseignement, et surtout, surtout, nous sommes nous-mêmes producteurs des données dont se nourrit abondamment l’industrie numérique.
On comprend que, par exemple, certains ont cru intelligent de tenter de remettre l’homme dans le circuit de production en basant leur raisonnement sur l’idée de la propriété des données personnelles et de la « liberté d’entreprendre ». En réalité la configuration du travail à l’ère des plateformes est le degré zéro de la production de valeur : les données n’ont de valeur qu’une fois travaillées, concaténées, inférées, calculées, recoupées, stockées (dans une base), etc. En soi, même si elles sont échangeables sur un marché, il faut encore les rendre rentables et pour cela il y a de l’Intelligence Artificielle et des travailleurs du clic. Les seconds ne sont que du temps de travail volatile (il produit de la valeur en tant que travail salarié, mais si peu qu’il en devient négligeable au profit de la rationalisation structurelle), tandis que l’IA a pour objectif de démontrer la rentabilité de l’achat d’un jeu de données sur le marché (une sorte de travail mort-vivant5 qu’on incorporerait directement à la marchandisation). Et la boucle est bouclée : cette rentabilité se mesure à l’aune de la rationalisation des processus de production, ce qui génère de l’actionnariat et une tendance au renforcement des monopoles. Pour le reste, afin d’assurer les conditions de permanence du capitalisme (il faut bien des travailleurs pour assurer un minimum de salubrité de la structure, c’est-à-dire maintenir un minimum de production de valeur), deux choses :
- on maintient en place quelques industries dont tout le jeu mondialisé consiste à être de plus en plus rationalisées pour coûter moins cher et rapporter plus, ce qui accroît les inégalités et la pauvreté (et plus on est pauvre, plus on est exploité),
- on vend du rêve en faisant croire que le marché de produits innovants (concrets) est en soi producteur de valeur (alors que s’accroît la pauvreté) : des voitures Tesla, des services par abonnement, de l’école à distance, un métavers… du vent.
Réguler le capitalisme ne suffit pas
Pour l’individu comme pour les entreprises sous perfusion technologique, l’attrait matériel du capitalisme est tel qu’il est extrêmement difficile de s’en détacher. G. Orwell avait (comme on peut s’y attendre de la part d’un esprit si brillant) déjà remarqué cette indécrottable attraction dans Le Quai de Wigan : l’adoration de la technique et le conformisme polluent toute critique entendable du capitalisme. Tant que le capitalisme maintiendra la double illusion d’une production concrète et d’un travail émancipateur, sans remettre en cause le fait que ce sont bien les produits financiers qui représentent l’essentiel du PIB mondial6, les catégories trop anciennes avec lesquelles nous pensons le capitalisme ne nous permettront pas de franchir le pas d’une critique radicale de ses effets écocides et destructeurs de libertés.
Faudrait-il donc s’en accommoder ? La plus importante mise en perspective critique des mécanismes du capitalisme de surveillance, celle qui a placé son auteure Shoshana Zuboff au-devant de la scène ces trois dernières années, n’a jamais convaincu personne par les solutions qu’elle propose.
Premièrement parce qu’elle circonscrit le capitalisme de surveillance à la mise en œuvre par les GAFAM de solutions de rentabilité actionnariale en allant extraire le minerai de données personnelles afin d’en tirer de la valeur marchande. Le fait est qu’en réalité ce modèle économique de valorisation des données n’est absolument pas nouveau, il est né avec les ordinateurs dont c’est la principale raison d’être (vendables). Par conséquent ces firmes n’ont créé de valeur qu’à la marge de leurs activités principales (le courtage de données), par exemple en fournissant des services dont le Web aurait très bien pu se passer. Sauf peut-être la fonction de moteur de recherche, nonobstant la situation de monopole qu’elle a engendrée au détriment de la concurrence, ce qui n’est que le reflet de l’effet pervers du monopole et de la financiarisation de ces firmes, à savoir tuer la concurrence, s’approprier (financièrement) des entreprises innovantes, et tuer toute dynamique diversifiée d’innovation.
Deuxièmement, les solutions proposées reposent exclusivement sur la régulation des ces monstres capitalistes. On renoue alors avec d’anciennes visions, celles d’un libéralisme garant des équilibres capitalistes, mais cette fois presque exclusivement du côté du droit : c’est mal de priver les individus de leur vie privée, donc il faut plus de régulation dans les pratiques. On n’est pas loin de renouer avec la vieille idée de l’ethos protestant à l’origine du capitalisme moderne selon Max Weber : la recherche de profit est un bien, il s’accomplit par le travail et le don de soi à l’entreprise. La paix de nos âmes ne peut donc avoir lieu sans le capitalisme. C’est ce que cristallise Milton Friedman dans une de ses célèbres affirmations : « la responsabilité sociale des entreprises est de maximiser leurs profits »7. Si le capitalisme est un dispositif géant générateur de profit, il n’est ni moral ni immoral, c’est son usage, sa destination qui l’est. Par conséquent, ce serait à l’État d’agir en assumant les conséquences d’un mauvais usage qu’en feraient les capitalistes.
Contradiction : le capitalisme n’est pas un simple dispositif, il est à la fois marché, organisation, choix collectifs, et choix individuels. Son extension dans nos vies privées est le résultat du choix de la rationalisation toujours plus drastique des conditions de rentabilité. Dans les années 1980, les économistes néoclassiques croyaient fortement au triptyque gagnant investissement – accroissement de main d’œuvre – progrès technique. Sauf que même l’un des plus connus des économistes américains, Robert Solow, a dû se rendre à une évidence, un « paradoxe » qu’il soulevait après avoir admis que « la révolution technologique [de l’informatique] s’est accompagnée partout d’un ralentissement de la croissance de la productivité, et non d’une augmentation ». Il conclut : « Vous pouvez voir l’ère informatique partout, sauf dans les statistiques de la productivité »8. Pour Solow, croyant encore au vieux monde de la croissance « productrice », ce n’était qu’une question de temps, mais pour l’économie capitaliste, c’était surtout l’urgence de se tourner vers des solutions beaucoup plus rapides : l’actionnariat (et la rationalisation rentable des process) et la valorisation quasi-immédiate de tout ce qui pouvait être valorisable sur le marché le plus facile possible, celui des services, celui qui nécessite le moins d’investissements.
La volonté d’aller dans le mur
Le capitalisme à l’ère numérique n’a pas créé de stagnation, il est structurellement destructeur. Il n’a pas créé de défaut d’investissement, il est avant tout un choix réfléchi, la volonté d’aller droit dans le mur en espérant faire partie des élus qui pourront changer de voiture avant l’impact. Dans cette hyper-concurrence qui est devenue essentiellement financière, la seule manière d’envisager la victoire est de fabriquer des monopoles. C’est là que la fatuité de la régulation se remarque le plus. Un récent article de Michael Kwet9 résume très bien la situation. On peut le citer longuement :
Les défenseurs de la législation antitrust affirment que les monopoles faussent un système capitaliste idéal et que ce qu’il faut, c’est un terrain de jeu égal pour que tout le monde puisse se faire concurrence. Pourtant, la concurrence n’est bonne que pour ceux qui ont des ressources à mettre en concurrence. Plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 7,40 dollars [7,16 euros] par jour, et personne ne s’arrête pour demander comment ils seront “compétitifs” sur le “marché concurrentiel” envisagé par les défenseurs occidentaux de l’antitrust. C’est d’autant plus décourageant pour les pays à revenu faible ou intermédiaire que l’internet est largement sans frontières.
À un niveau plus large […] les défenseurs de l’antitrust ignorent la division globalement inégale du travail et de l’échange de biens et de services qui a été approfondie par la numérisation de l’économie mondiale. Des entreprises comme Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Netflix, Nvidia, Intel, AMD et bien d’autres sont parvenues à leur taille hégémonique parce qu’elles possèdent la propriété intellectuelle et les moyens de calcul utilisés dans le monde entier. Les penseurs antitrust, en particulier ceux des États-Unis, finissent par occulter systématiquement la réalité de l’impérialisme américain dans le secteur des technologies numériques, et donc leur impact non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans les pays du Sud.
Les initiatives antitrust européennes ne sont pas meilleures. Là-bas, les décideurs politiques qui s’insurgent contre les maux des grandes entreprises technologiques tentent discrètement de créer leurs propres géants technologiques.
Dans la critique mainstream du capitalisme de surveillance, une autre erreur s’est révélée, en plus de celle qui consiste à persister dans la défense d’un imaginaire capitaliste. C’est celle de voir dans l’État et son pouvoir de régulation un défenseur de la démocratie. C’est d’abord une erreur de principe : dans un régime capitaliste monopoliste, l’État assure l’hégémonie des entreprises de son cru et fait passer sous l’expression démocratie libérale (ou libertés) ce qui favorise l’émergence de situations de domination. Pour lutter contre, il y a une urgence dans notre actualité économique : la logique des start-up tout autant que celle de la « propriété intellectuelle » doivent laisser place à l’expérimentation collective de gouvernance de biens communs de la connaissance et des techniques (nous en parlerons plus loin). Ensuite, c’est une erreur pratique comme l’illustrent les affaires de lobbying et de pantouflage dans le petit monde des décideurs politiques. Une illustration parmi des centaines : les récents Uber Files démontrant, entre autres, les accords passés entre le président Emmanuel Macron et les dirigeants d’Uber (voir sur le site Le Monde).
Situer ces enjeux dans un contexte historique aussi général suppose de longs développements, rarement simples à exposer. Oui, il s’agit d’une critique du capitalisme, et oui cette critique peut être plus ou moins radicale selon que l’on se place dans un héritage marxiste, marxien ou de la critique de la valeur, ou que l’on demeure persuadé qu’un capitalisme plus respectueux, moins « féodal » pourrait advenir. Sans doute qu’un mirage subsiste, celui de croire qu’autant de bienfaits issus du capitalisme suffisent à le dédouaner de l’usage dévoyé des technologies. « Sans le capitalisme nous en serions encore à nous éclairer à la bougie…» En d’autres termes, il y aurait un progrès indiscutable à l’aune duquel les technologies de surveillance pourraient être jugées. Vraiment ?
Situer le capitalisme de surveillance dans notre rapport à la technique
C’est un poncif : les technologies de surveillance ont été développées dans une logique de profit. Il s’agit des technologies dont l’objectif est de créer des données exploitables à partir de nos vies privées, à des fins de contrôle ou purement mercantiles (ce qui revient au même puisque les technologies de contrôle sont possédées par des firmes qui achètent des données).
Or, il est temps de mettre fin à l’erreur répandue qui consiste à considérer que les technologies de surveillance sont un mal qui pervertit le capitalisme censé être le moteur de la démocratie libérale. Ceci conduit à penser que seule une régulation bien menée par l’État dans le but de restaurer les vertus du « bon » capitalisme serait salutaire tant nos vies privées sont sur-exploitées et nos libertés érodées. Tel est le credo de Shoshana Zuboff et avec elle bon nombre de décideurs politiques.
Croire qu’il y a de bons et de mauvais usages
L’erreur est exactement celle que dénonçait en son temps Jacques Ellul. C’est celle qui consiste à vouloir absolument attribuer une valeur à l’usage de la technique. Le bon usage serait celui qui pousse à respecter la vie privée, et le mauvais usage celui qui tend à l’inverse. Or, il n’y a d’usage technique que technique. Il n’y a qu’un usage de la bombe atomique, celui de faire boum (ou pas si elle est mal utilisée). Le choix de développer la bombe est, lui, par contre, un choix qui fait intervenir des enjeux de pouvoir et de valeurs.
Au tout début des années 1970, à l’époque où se développaient les techniques d’exploitation des bases de données et le courtage de données, c’est ce qu’ont montré James Martin et Adrian Norman pour ce qui concerne les systèmes informatiques10 : à partir du moment où un système est informatisé, la quantification est la seule manière de décrire le monde. Ceci est valable y compris pour les systèmes décisionnels. Le paradoxe que pointaient ces auteurs montrait que le traitement de l’information dans un système décisionnel – par exemple dans n’importe quelle organisation économique, comme une entreprise – devait avoir pour objectif de rationaliser les procédures et les décisions en utilisant une quantité finie de données pour en produire une quantité réduite aux éléments les plus stratégiques, or, l’informatisation suppose un choix optimum parmi une grande variété d’arbres décisionnels et donc un besoin croissant de données, une quantité tendant vers l’infini.
Martin et Norman illustraient ce qu’avait affirmé Jacques Ellul vingt ans auparavant : la technique et sa logique de développement seraient autonomes. Bien que discutable, cette hypothèse montre au moins une chose : dans un monde capitaliste, tout l’enjeu consisterait comme au rugby à transformer l’essai, c’est-à-dire voir dans le développement des techniques autant d’opportunités de profit et non pas d’investissements productifs. Les choix se posent alors en termes d’anti-productivité concrète. Dans le monde des bases de données et leur exploitation la double question qui s’est posée de 1970 à aujourd’hui est de savoir si nous sommes capables d’engranger plus ou moins de données et comment leur attribuer une valeur marchande.
Le reste n’est que sophismes : l’usine entièrement automatisée des rêves cybernéticiens les plus fous, les boules de cristal des statistiques électorales, les données de recouvrement bancaires et le crédit à la consommation, les analyses marketing et la consommation de masse, jusqu’à la smart city de la Silicon Valley et ses voitures autonomes (et ses aspirateurs espions)… la justification de la surveillance et de l’extraction de données repose sur l’idée d’un progrès social, d’un bon usage des technologies, et d’une neutralité des choix technologiques. Et il y a un paralogisme. Si l’on ne pense l’économie qu’en termes capitalistes et libéraux, cette neutralité est un postulat qui ne peut être remis en cause qu’à l’aune d’un jugement de valeur : il y aurait des bons et des mauvais usages des technologies, et c’est à l’État d’assurer le rôle minimal de les arbitrer au regard de la loi. Nul ne remet alors en question les choix eux-mêmes, nul ne remet en question l’hégémonie des entreprises qui nous couvrent de leurs « bienfaits » au prix de quelques « négligeables » écarts de conduite, nul ne remet en question l’exploitation de nos vies privées (un mal devenu nécessaire) et l’on préfère nous demander notre consentement plus ou moins éclairé, plus ou moins obligé.
La technologie n’est pas autonome
Cependant, comme nous le verrons vers la fin de ce texte, les études en sociologie des sciences montrent en fait qu’il n’y a pas d’autonomie de la technique. Sciences, technologies et société s’abreuvent mutuellement entre les usages, les expérimentations et tous ces interstices épistémiques d’appropriation des techniques, de désapprentissage, de renouvellement, de détournements, et d’expression des besoins pour de nouvelles innovations qui seront à leur tour appropriées, modifiées, transformées, etc. En réalité l’hypothèse de l’autonomie de la technique a surtout servi au capitalisme pour suivre une course à l’innovation qui ne saurait être remise en question, comme une loi naturelle qui justifie en soi la mise sur le marché de nouvelles technologies et au besoin faire croire en leur utilité. Tel est le fond de commerce du transhumanisme et son « économie des promesses ».
L’erreur consiste à prêter le flanc au solutionnisme technologique (le même qui nous fait croire que des caméras de surveillance sont un remède à la délinquance, ou qu’il faut construire des grosses berlines sur batteries pour ne plus polluer) et à se laisser abreuver des discours néolibéraux qui, parce qu’il faut bien rentabiliser ces promesses par de la marchandisation des données – qui est elle-même une promesse pour l’actionnariat –, nous habituent petit à petit à être surveillés. Pour se dépêtrer de cela, la critique du capitalisme de surveillance doit être une critique radicale du capitalisme et du néolibéralisme car la lutte contre la surveillance ne peut être décorrélée de la prise en compte des injustices sociales et économiques dont ils sont les causes pratiques et idéologiques.
Je vois venir les lecteurs inquiets. Oui, j’ai placé ce terme de néolibéralisme sans prévenir. C’est mettre la charrue avant les bœufs mais c’est parfois nécessaire. Pour mieux comprendre, il suffit de définir ce qu’est le néolibéralisme. C’est l’idéologie appelée en Allemagne ordolibéralisme, si l’on veut, c’est-à-dire l’idée que le laissez-faire a démontré son erreur historique (les crises successives de 1929, 1972, 2008, ou la crise permanente), et que par conséquent l’État a fait son grand retour dans le marché au service du capital, comme le principal organisateur de l’espace de compétition capitaliste et le dépositaire du droit qui érige la propriété et le profit au titre de seules valeurs acceptables. Que des contrats, plus de discussion, there is no alternative, comme disait la Margaret. Donc partant de cette définition, à tous les niveaux organisationnels, celui des institutions de l’État comme celui des organisations du capital, la surveillance est à la fois outil de contrôle et de génération de profit (dans les limites démontrées par R. Kurz, à savoir : pas sans compter presque exclusivement sur l’actionnariat et les produits financiers, cf. plus haut).
Le choix du « monitoring »
La course en avant des technologies de surveillance est donc le résultat d’un choix. Il n’y a pas de bon ou de mauvais usage de la surveillance électronique : elle est faite pour récolter des données. Le choix en question c’est celui de n’avoir vu dans ces données qu’un objet marchand. Peu importe les bienfaits que cela a pu produire pour l’individu, ils ne sont visibles que sur un court terme. Par exemple les nombreuses applications de suivi social que nous utilisons nous divertissent et rendent parfois quelque service, mais comme le dit David Lyon dans The Culture of Surveillance, elle ne font que nous faire accepter passivement les règles du monitoring et du tri social que les États comme les multinationales mettent en œuvre.
Il n’y a pas de différence de nature entre la surveillance des multinationales et la surveillance par l’État : ce sont les multinationales qui déterminent les règles du jeu de la surveillance et l’État entérine ces règles et absorbe les conditions de l’exercice de la surveillance au détriment de sa souveraineté. C’est une constante bien comprise, qu’il s’agisse des aspects techniques de la surveillance sur lesquels les Big Tech exercent une hégémonie qui en retour sert les intérêts d’un ou plusieurs États (surtout les États-Unis aujourd’hui), ou qu’il s’agisse du droit que les Big Tech tendent à modifier en leur faveur soit par le jeu des lobbies soit par le jeu des accords internationaux (tout comme récemment le nouvel accord entre l’Europe et les États-Unis sur les transferts transatlantiques de données, qui vient contrecarrer les effets d’annonce de la Commission Européenne).
Quels espaces de liberté dans ce monde technologique ?
Avec l’apparition des ordinateurs et des réseaux, de nombreuses propositions ont vu le jour. Depuis les années 1970, si l’on suit le développement des différents mouvements de contestation sociale à travers le monde, l’informatique et les réseaux ont souvent été plébiscités comme des solutions techniques aux défauts des démocraties. De nombreux exemples d’initiatives structurantes pour les réseaux informatiques et les usages des ordinateurs se sont alors vus détournés de leurs fonctions premières. On peut citer le World Wide Web tel que conçu par Tim Berners Lee, lui même suivant les traces du monde hypertextuel de Ted Nelson et son projet Xanadu. Pourquoi ce design de l’internet des services s’est-il trouvé à ce point sclérosé par la surveillance ? Pour deux raisons : 1/ on n’échappe pas (jamais) au développement technique de la surveillance (les ordinateurs ont été faits et vendus pour cela et le sont toujours11) et 2/ parce qu’il y a des intérêts de pouvoir en jeu, policiers et économiques, celui de contrôler les communications. Un autre exemple : le partage des programmes informatiques. Comme chacun le sait, il fut un temps où la création d’un programme et sa distribution n’étaient pas assujettis aux contraintes de la marchandisation et de la propriété intellectuelle. Cela permettait aux utilisateurs de machines de partager non seulement des programmes mais des connaissances et des nouveaux usages, faisant du code un bien commun. Sous l’impulsion de personnages comme Bill Gates, tout cela a changé au milieu des années 1970 et l’industrie du logiciel est née. Cela eut deux conséquences, négative et positive. Négative parce que les utilisateurs perdaient absolument toute maîtrise de la machine informatique, et toute possibilité d’innovation solidaire, au profit des intérêts d’entreprises qui devinrent très vite des multinationales. Positive néanmoins, car, grâce à l’initiative de quelques hackers, dont Richard Stallman, une alternative fut trouvée grâce au logiciel libre et la licence publique générale et ses variantes copyleft qui sanctuarisent le partage du code. Ce partage relève d’un paradigme qui ne concerne plus seulement le code, mais toute activité intellectuelle dont le produit peut être partagé, assurant leur liberté de partage aux utilisateurs finaux et la possibilité de créer des communs de la connaissance.
Alors que nous vivons dans un monde submergé de technologies, nous aurions en quelque sorte gagné quelques espaces de liberté d’usage technique. Mais il y a alors comme un paradoxe.
À l’instar de Jacques Ellul, pour qui l’autonomie de la technique implique une aliénation de l’homme à celle-ci, beaucoup d’auteurs se sont inquiétés du fait que les artefacts techniques configurent par eux-mêmes les actions humaines. Qu’on postule ou pas une autonomie de la technique, son caractère aliénant reste un fait. Mais il ne s’agit pas de n’importe quels artefacts. Nous ne parlons pas d’un tournevis ou d’un marteau, ou encore d’un silex taillé. Il s’agit des systèmes techniques, c’est-à-dire des dispositifs qu’on peut qualifier de socio-techniques qui font intervenir l’homme comme opérateur d’un ensemble d’actions techniques par la technique. En quelque sorte, nous perdons l’initiative et les actions envisagées tendent à la conformité avec le dispositif technique et non plus uniquement à notre volonté. Typiquement, les ordinateurs dans les entreprises à la fin des années 1960 ont été utilisés pour créer des systèmes d’information, et c’est à travers ces systèmes techniques que l’action de l’homme se voit configurée, modelée, déterminée, entre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Dans son article « Do artefacts have politics ? », Langdon Winner s’en inquiétait à juste titre : nos objectifs et le sens de nos actions sont conditionnés par la technique. Cette dernière n’est jamais neutre, elle peut même provoquer une perte de sens de l’action, par exemple chez le travailleur à la chaîne ou le cadre qui non seulement peuvent être noyés dans une organisation du travail trop grande, mais aussi parce que l’automatisation de la production et de la décision les prive de toute initiative (et de responsabilité).
La tentation du luddisme
Pour lutter contre cette perte de sens, des choix sont envisageables. Le premier consiste à lutter contre la technique. En évacuant la complexité qu’il y a à penser qu’un mouvement réfractaire au développement technique puisse aboutir à une société plus libre, on peut certes imaginer des fronts luddites en certains secteurs choisis. Par exemple, tel fut le choix du CLODO dans la France des années 1980, prétendant lutter contre l’envahissement informatique dans la société. Concernant la surveillance, on peut dire qu’au terme d’un processus de plus de 50 ans, elle a gagné toutes les sphères socio-économiques grâce au développement technologique. Un front (néo-)luddite peut sembler justifié tant cette surveillance remet en cause très largement nos libertés et toutes les valeurs positives que l’on oppose généralement au capitalisme : solidarité et partage, notamment.
Pour autant, est-ce que la lutte contre le capitalisme de surveillance doit passer par la négation de la technique ? Il est assez évident que toute forme d’action directe qui s’oppose en bloc à la technique perd sa crédibilité en ce qu’elle ne fait que proposer un fantasme passéiste ou provoquer des réactions de retrait qui n’ont souvent rien de constructif. C’est une critique souvent faite à l’anarcho-primitivisme qui, lorsqu’il ne se contente pas d’opposer une critique éclairée de la technique (et des processus qui ont conduit à la création de l’État) en vient parfois à verser dans la technophobie. C’est une réaction aussi compréhensible que contrainte tant l’envahissement technologique et ses discours ont quelque chose de suffoquant. En oubliant cette question de l’autonomie de la technique, je suis personnellement tout à fait convaincu par l’analyse de J. Ellul selon laquelle nous sommes à la fois accolés et dépendants d’un système technique. En tant que système il est devenu structurellement nécessaire aux organisations (qu’elles soient anarchistes ou non) au moins pour communiquer, alors que le système capitaliste, lui, ne nous est pas nécessaire mais imposé par des jeux de pouvoirs. Une réaction plus constructive consiste donc à orienter les choix technologiques, là où l’action directe peut prendre un sens tout à fait pertinent.
Prenons un exemple qui pourrait paraître trivial mais qui s’est révélé particulièrement crucial lors des périodes de confinement que nous avons subies en raison de l’épidémie Covid. Qu’il s’agisse des entreprises ou des institutions publiques, toutes ont entamé dans l’urgence une course en avant vers les solutions de visio-conférence dans l’optique de tâcher de reproduire une forme présentielle du travail de bureau. La visio-conférence suscite un flux de données bien plus important que la voix seule, et par ailleurs la transmission vocale est un ensemble de techniques déjà fort éprouvées depuis plus d’un siècle. Que s’est-il produit ? Les multinationales se sont empressées de vendre leurs produits et pomper toujours plus de données personnelles, tandis que les limites pratiques de la visio-conférence se sont révélées : dans la plupart des cas, réaliser une réunion « filmée » n’apporte strictement rien de plus à l’efficacité d’une conférence vocale. Dans la plupart des cas, d’ailleurs, afin d’économiser de la bande passante (croit-on), la pratique courante consiste à éteindre sa caméra pendant la réunion. Où sont les gains de productivité tant annoncés par les GAFAM ? Au lieu de cela, il y a en réalité un détournement des usages, et même des actes de résistance du quotidien (surtout lorsqu’il s’agit de surveiller les salariés à distance).
Les choix technologiques doivent être collectifs
Une critique des techniques pourrait donc consister à d’abord faire le point sur nos besoins et en prenant en compte l’urgence climatique et environnementale dans laquelle nous sommes (depuis des décennies). Elle pourrait aussi consister à prendre le contrepoint des discours solutionnistes qui tendent à justifier le développement de techniques le plus souvent inutiles en pratique mais toujours plus contraignantes quant au limites éthiques vers lesquelles elles nous poussent. Les choix technologiques doivent donc d’abord être des choix collectifs, dont l’assentiment se mesure en fonction de l’économie énergétique et de l’acceptabilité éthique de la trajectoire choisie. On peut revenir à une technologie ancienne et éprouvée et s’en contenter parce qu’elle est efficace et on peut refuser une technologie parce qu’elle n’est pas un bon choix dans l’intérêt collectif. Et par collectif, j’entends l’ensemble des relations inter-humaines et des relations environnementales dont dépendent les premières.
Les attitudes de retraits par rapports aux technologies, le refus systématique des usages, sont rarement bénéfiques et ne constituent que rarement une démarche critique. Ils sont une réaction tout à fait compréhensible du fait que la politique a petit à petit déserté les lieux de production (pour ce qu’il en reste). On le constate dans le désistement progressif du syndicalisme ces 30 ou 40 dernières années et par le fait que la critique socialiste (ou « de gauche ») a été incapable d’intégrer la crise du capitalisme de la fin du XXᵉ siècle. Pire, en se transformant en un centre réactionnaire, cette gauche a créé une technocratie de la gestion aux ordres du néolibéralisme : autoritarisme et pansements sociaux pour calmer la révolte qui gronde. Dès lors, de désillusions en désillusions, dans la grande cage concurrentielle de la rareté du travail rémunéré (rentable) quelle place peut-il y avoir pour une critique des techniques et de la surveillance ? Peut-on demander sérieusement de réfléchir à son usage de Whatsapp à une infirmière qui a déjà toutes les difficultés du monde à concilier la garde de ses enfants, les heures supplémentaires (parfois non payées) à l’hôpital, le rythme harassant du cycle des gardes, les heures de transports en commun et par dessus le marché, le travail domestique censé assurer les conditions de reproduction du travail abstrait ? Alors oui, dans ces conditions où le management du travail n’est devenu qu’une affaire de rationalisation rentable, les dispositifs techniques ne font pas l’objet d’usages réfléchis ou raisonnés, il font toujours l’objet d’un usage opportuniste : je n’utilise pas Whatsapp parce que j’aime Facebook ou que je me fiche de savoir ce que deviennent mes données personnelles, j’utilise Whatsapp parce que c’est le moyen que j’ai trouvé pour converser avec mes enfants et m’assurer qu’ils sont bien rentrés à la maison après l’école.
Low tech et action directe
En revanche, un retrait que je pourrais qualifier de technophobe et donc un minimum réfléchi, laisse entier le problème pour les autres. La solidarité nous oblige à créer des espaces politiques où justement technologie et capitalisme peuvent faire l’objet d’une critique et surtout d’une mise en pratique. Le mouvement Low Tech me semble être l’un des meilleurs choix. C’est en substance la thèse que défend Uri Gordon (« L’anarchisme et les politiques techniques ») en voyant dans les possibilités de coopérations solidaires et de choix collectivement réfléchis, une forme d’éthique de l’action directe.
Je le suivrai sur ce point et en étendant davantage le spectre de l’action directe. Premièrement parce que si le techno-capitalisme aujourd’hui procède par privation de libertés et de politique, il n’implique pas forcément l’idée que nous ne soyons que des sujets soumis à ce jeu de manière inconditionnelle. C’est une tendance qu’on peut constater dans la plupart des critiques du pouvoir : ne voir l’individu que comme une entité dont la substance n’est pas discutée, simplement soumis ou non soumis, contraint ou non contraint, privé de liberté ou disposant de liberté, etc. Or il y a tout un ensemble d’espaces de résistance conscients ou non conscients chez tout individu, ce que Michel de Certeau appelait des tactiques du quotidien12. Il ne s’agit pas de stratégies où volonté et pouvoir se conjuguent, mais des mouvements « sur le fait », des alternatives multiples mises en œuvre sans chercher à organiser cet espace de résistance. Ce sont des espaces féconds, faits d’expérimentations et d’innovations, et parfois même configurent les techniques elles-mêmes dans la différence entre la conception initiale et l’usage final à grande échelle. Par exemple, les ordinateurs et leurs systèmes d’exploitations peuvent ainsi être tantôt les instruments de la surveillance et tantôt des instruments de résistance, en particulier lorsqu’ils utilisent des logiciels libres. Des apprentissages ont lieu et cette fois ils dépassent l’individu, ils sont collectifs et ils intègrent des connaissances en commun.
En d’autres termes, chaque artefact et chaque système technique est socialement digéré, ce qui en retour produit des interactions et détermine des motivations et des objectifs qui peuvent s’avérer très différents de ceux en fonction desquels les dispositifs ont été créés. Ce processus est ce que Sheila Jasanoff appelle un processus de coproduction épistémique et normatif13 : sciences et techniques influencent la société en offrant un cadre tantôt limitatif, tantôt créatif, ce qui en retour favorise des usages et des besoins qui conditionnent les trajectoires scientifiques et technologiques. Il est par conséquent primordial de situer l’action directe sur ce créneau de la coproduction en favorisant les expériences tactiques individuelles et collectives qui permettent de déterminer des choix stratégiques dans l’orientation technologique de la société. Dit en des mots plus simples : si la décision politique n’est plus suffisante pour garantir un cadre normatif qui reflète les choix collectifs, alors ce sont les collectifs qui doivent pouvoir créer des stratégies et au besoin les imposer par un rapport de force.
Créer des espaces d’expérimentations utopiques
Les hackers ne produisent pas des logiciels libres par pur amour d’autrui et par pure solidarité : même si ces intentions peuvent être présentes (et je ne connais pas de libristes qui ne soient pas animés de tels sentiments), la production de logiciel libre (ou open source) est d’abord faite pour créer de la valeur. On crée du logiciel libre parce que collectivement on est capable d’administrer et valoriser le bien commun qu’est le code libre, à commencer par tout un appareillage juridique comme les licences libres. Il en va de même pour toutes les productions libres qui emportent avec elles un idéal technologique : l’émancipation, l’activité libre que représente le travail du code libre (qui n’est la propriété de personne). Même si cela n’exempte pas de se placer dans un rapport entre patron (propriétaire des moyens de production) et salarié, car il y a des entreprises spécialisées dans le Libre, il reste que le Libre crée des espaces d’équilibres économiques qui se situent en dehors de l’impasse capitaliste. La rentabilité et l’utilité se situent presque exclusivement sur un plan social, ce qui explique l’aspect très bigarré des modèles d’organisations économiques du Libre, entre associations, fondations, coopératives…
L’effet collatéral du Libre est aussi de créer toujours davantage d’espaces de libertés numériques, cette fois en dehors du capitalisme de surveillance et ses pratiques d’extraction. Cela va des pratiques de chiffrement des correspondances à l’utilisation de logiciels dédiés explicitement aux luttes démocratiques à travers le monde. Cela a le mérite de créer des communautés plus ou moins fédérées ou archipélisées, qui mettent en pratique ou du moins sous expérimentation l’alliance entre les technologies de communication et l’action directe, au service de l’émancipation sociale.
Il ne s’agit pas de promettre un grand soir et ce n’est certes pas avec des expériences qui se complaisent dans la marginalité que l’on peut bouleverser le capitalisme. Il ne s’agit plus de proposer des alternatives (qui fait un détour lorsqu’on peut se contenter du droit chemin?) mais des raisons d’agir. Le capitalisme est désuet. Dans ses soubresauts (qui pourraient bien nous mener à la guerre et la ruine), on ressort l’argument du bon sens, on cherche le consentement de tous malgré l’expérience que chacun fait de l’exploitation et de la domination. Au besoin, les capitalistes se montrent autoritaires et frappent. Mais que montrent les expériences d’émancipation sociales ? Que nous pouvons créer un ordre fait de partage et d’altruisme, de participation et de coopération, et que cela est parfaitement viable, sans eux, sur d’autres modèles plus cohérents14. En d’autres termes, lutter contre la domination capitaliste, c’est d’abord démontrer par les actes que d’autres solutions existent et sans chercher à les inclure au forceps dans ce système dominant. Au contraire, il y a une forme d’héroïsme à ne pas chercher à tordre le droit si ce dernier ne permet pas une émancipation franche et durable du capitalisme. Si le droit ne convient pas, il faut prendre le gauche.
La lutte pour les libertés numériques et l’application des principes du Libre permettent de proposer une sortie positive du capitalisme destructeur. Néanmoins on n’échappera pas à la dure réalité des faits. Par exemple que l’essentiel des « tuyaux » des transmissions numériques (comme les câbles sous-marins) appartiennent aux multinationales du numérique et assurent ainsi l’un des plus écrasants rapports de domination de l’histoire. Pourtant, on peut imaginer des expériences utopiques, comme celle du Chaos Computer Club, en 2012, consistant à créer un Internet hors censure via un réseau de satellite amateur.
L’important est de créer des espaces d’expérimentation utopiques, parce qu’ils démontrent tôt ou tard la possibilité d’une solution, il sont préfiguratifs15. Devant la décision politique au service du capital, la lutte pour un réseau d’échanges libres ne pourra certes pas se passer d’un rapport de force mais encore moins de nouveaux imaginaires. Car, finalement, ce que crée la crise du capitalisme, c’est la conscience de son écocide, de son injustice, de son esclavagisme technologique. Reste l’espoir, première motivation de l’action.
-
R. Kurz, Vies et mort du capitalisme, Nouvelles Éditions Ligne, 2011, p. 37. ↩︎
-
Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, La grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la crise, Paris, Post-éditions, 2014. ↩︎
-
Georges Simpson, « Western Man under Automation », International Journal of Comparative Sociology, num. 5, 1964, pp. 199-207. ↩︎
-
Comme le dit Moishe Postone dans son article « Repenser Le Capital à la lumière des Grundrisse » : « La transformation radicale du processus de production mentionnée plus haut n’est pas le résultat quasi-automatique du développement rapide des savoirs techniques et scientifique et de leurs applications. C’est plutôt une possibilité qui naît d’une contradiction sociale intrinsèque croissante. Bien que la course du développement capitaliste génère la possibilité d’une structure nouvelle et émancipatrice du travail social, sa réalisation générale est impossible dans le capitalisme. » ↩︎
-
Là je reprends une catégorie marxiste. Marx appelle le (résultat du -) travail mort ce qui a besoin de travail productif. Par exemple, une matière comme le blé récolté est le résultat d’un travail déjà passé, il lui faut un travail vivant (celui du meunier) pour devenir matière productive. Pour ce qui concerne l’extraction de données, il faut comprendre que l’automatisation de cette extraction, le stockage, le travail de la donnée et la marchandisation sont un seul et même mouvement (on ne marchande pas des jeux de données « en l’air », ils correspondent à des commandes sur une marché tendu). Les données ne sont pas vraiment une matière première, elles ne sont pas non plus un investissement, mais une forme insaisissable du travail à la fois matière première et système technique. ↩︎
-
On peut distinguer entre économie réelle et économie financière. Voir cette étude de François Morin, juste avant le crack de 2008. François Morin, « Le nouveau mur de l’argent », Nouvelles Fondations, num. 3-4, 2007, p. 30-35. ↩︎
-
The New York Times Magazine, 13 septembre 1970. ↩︎
-
Robert Solow, « We’d better watch out », New York Times Book Review, 12 juillet 1987, page 36. ↩︎
-
Mike Kwet, « Digital Ecosocialism Breaking the power of Big Tech » (ROAR Magazine), trad. Fr. Louis Derrac, sous le titre « Écosocialisme numérique – Briser le pouvoir des Big Tech », parue sur Framablog.org. ↩︎
-
James Martin et Adrian R. D. Norman, The Computerized Society. An Appraisal of the Impact of Computers on Society over the next 15 Years, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1970, p. 522. ↩︎
-
c’est ce que je tâche de montrer dans une partie de mon livre Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance : pourquoi fabriquer et acheter des ordinateurs ? Si les entreprises sont passées à l’informatique c’est pour améliorer la production et c’est aussi pourquoi le courtage de données s’est développé. ↩︎
-
Sur les « tactiques numériques », on pourra lire avec profit l’article de Beatrice Latini et Jules Rostand, « La libre navigation. Michel de Certeau à l’épreuve du numérique », Esprit, 2022/1-2 (Janvier-Février), p. 109-117. ↩︎
-
Sheila Jasanoff, « Ordering Knowledge, Ordering Society », dans S. Jasanoff (éd.), States of knowledge. The co-production of science and social order, Londres, Routledge, 2004, pp. 13-45. ↩︎
-
Sur ce point on peut lire avec intérêt ce texte de Ralph Miliband, « Comment lutter contre l’hégémonie capitaliste ? », paru initialement en 1990 et traduit sur le site Contretemps. ↩︎
-
Voir David Graeber, et Alexie Doucet, Comme si nous étions déjà libres, Montréal, Lux éditeur, 2014. La préfiguration est l’« idée selon laquelle la forme organisationnelle qu’adopte un groupe doit incarner le type de société qu’il veut créer ». Voir aussi Marianne Maeckelbergh, « Doing is Believing: Prefiguration as Strategic Practice in the Alterglobalization Movement », Social Movement Studies, vol. 10, num. 1, 2011, pp. 1‑20. ↩︎
11.06.2022 à 02:00
Qu'est-ce que le radicalisme ?
« Le pouvoir n’admet jamais son propre extrémisme, sa propre violence, son propre chaos, sa propre destruction, son propre désordre. Le désordre de l’inégalité, le chaos de la dépossession, la destruction des communautés et des relations traditionnelles ou indigènes – l’extermination de la vie, de la planète elle-même. Ce sont de véritables comportements extrémistes. » (Jeff Shantz)
Avant propos
Je propose dans ce billet une traduction d’un texte de 2013 écrit par Jeff Shantz. Les travaux de ce dernier appartiennent au courant de la criminologie anarchiste (voir ici ou là). Pour faire (très) court, il s’agit de s’interroger sur les causes de la criminalité et de la violence à partir d’une critique des actions de l’État et leurs effets néfastes (y compris la violence d’État).
Pour être tout à fait clair ici, je ne partage pas d’un bloc l’approche de la criminologie anarchiste, à cause des achoppements logiques auxquels elle doit se confronter. En particulier le fait qu’un mouvement de violence peut certes aller chercher ses causes dans un enchaînement d’effets du pouvoir institutionnel, il n’en demeure pas moins que, en tant qu’historien, il m’est difficile de ne jamais fouiller qu’à un seul endroit. Je crois qu’il y a toujours un faisceaux de causalités, toutes plus ou moins explicables, avec des déséquilibres qui peuvent faire attribuer l’essentiel à une partie plutôt qu’une autre. La criminologie anarchiste remet assez abruptement en cause la théorie du contrat social (surtout dans son rapport droit/crime/pouvoir), ce qui est plutôt sain. Mais si le pouvoir institutionnel est bien entendu en charge de lourdes responsabilités dans la révolte légitime (en particulier dans un contexte néolibéral autoritaire où la violence est la seule réponse faite au peuple), tous les mouvements de résistance font toujours face, à un moment ou un autre, à leurs propres contradictions, c’est humain. C’est ce qui justement les fait grandir et leur donne leur force et d’autant plus de légitimité, ou au contraire contribue à leur extinction (qu’on peut certes attribuer à l’une ou l’autre stratégie de pouvoir, bref…).
D’ailleurs, c’est justement l’un des objets de ce texte à propos du radicalisme. C’est un avertissement aux mouvements de résistance qui ne comprennent pas, d’une part, que le radicalisme est une méthode et, d’autre part, que son emploi galvaudé est une stratégie de défense (et d’offensive) du capital, en particulier via la communication et l’exercice du pouvoir médiatique. En cela il vise assez juste. En tout cas, c’est à garder en tête lorsque, sur un plateau TV, on interroge toujours : « Mais… vous condamnez ces violences de la part des ces jeunes radicalisés ? »
Plaidoyer pour le radicalisme
Par Jeff Shantz
— Article paru dans la revue Radical Criminology, num. 2, 2013, Éditorial (source), Licence CC By-Nc-Nd. Traduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.
Aujourd’hui, peu de termes ou d’idées sont autant galvaudés, déformés, diminués ou dénaturés que « radical » ou « radicalisme ». Cela n’est sans doute pas très surprenant, étant donné que nous vivons une période d’expansion des luttes contre l’État et le capital, l’oppression et l’exploitation, dans de nombreux contextes mondiaux. Dans de tels contextes, la question du radicalisme, des moyens efficaces pour vaincre le pouvoir (ou étouffer la résistance) devient urgente. Les enjeux sont élevés, les possibilités d’alternatives réelles sont avancées et combattues. Dans de tels contextes, les militants et les universitaires doivent non seulement comprendre le radicalisme de manière appropriée, mais aussi défendre (et faire progresser) les approches radicales du changement social et de la justice sociale.
La première utilisation connue du terme radical remonte au XIVe siècle, 1350-1400 ; le moyen anglais venant du latin tardif rādīcālis, avoir des racines1. Il est également défini comme étant très différent de ce qui est habituel ou traditionnel. Le terme radical signifie simplement de ou allant vers les racines ou l’origine. Rigoureux. En clair, cela signifie aller à la racine d’un problème.
Le radicalisme est une perspective, une orientation dans le monde. Ce n’est pas, comme on le prétend souvent à tort, une stratégie. Être radical, c’est creuser sous la surface des certitudes, des explications trop faciles, des réponses insatisfaisantes et des panacées qui se présentent comme des solutions aux problèmes. Le radicalisme conteste et s’oppose aux définitions du statu quo - il refuse les justifications intéressées que fournissent l’autorité et le pouvoir.
Plutôt qu’un ensemble d’idées ou d’actions, il s’agit d’une approche cruciale de la vie. Comme l’a suggéré l’analyste existentialiste marxiste Erich Fromm dans un contexte de lutte antérieure :
En premier lieu, cette approche peut être caractérisée par la devise : de omnibus dubitandum ; tout doit être mis en doute, en particulier les concepts idéologiques qui sont quasiment partagés par tous et qui sont devenus par conséquent des axiomes incontournables du sens commun… Le doute radical est un processus ; un processus de libération de la pensée idolâtre ; un élargissement de la conscience, de la vision imaginative et créative de nos opportunités et possibilités. L’approche radicale ne se déploie pas dans le vide. Elle ne part pas de rien, elle part des racines. (1971, vii)
Comme c’est le cas pour la plupart des opinions et des pratiques dans la société capitaliste de classes, il y a deux approches distinctes du radicalisme, deux significations. Selon la première, celle qui consiste à aller aux racines – à la source des problèmes –, la nature du capital doit être comprise, abordée, affrontée – vaincue. Mettre fin à la violence du capital ne peut se faire qu’en mettant fin aux processus essentiels à son existence : l’exploitation, l’expropriation, la dépossession, le profit, l’extraction, l’appropriation des biens communs, de la nature. Et comment y parvenir ? Le capital et les États savent – ils comprennent. Voilà qui explique la reconnaissance des actes décrits plus haut – reconnus, précisément, comme radicaux.
Le radicalisme, vu d’en bas, est sociologique (et devrait être criminologique, bien que la criminologie soit parfois à la traîne). Il exprime cette ouverture sur le monde que C. Wright Mills appelle l’imagination sociologique (1959). Le radicalisme dans son sens premier relie l’histoire, l’économie, la politique, la géographie, la culture, en cherchant à aller au-delà des réponses faciles, rigidifiées de façon irréfléchie en tant que « sens commun » (qui n’est souvent ni commun ni sensé). Il creuse sous les conventions et le statu quo. Pour Fromm :
« Douter », dans ce sens, ne traduit pas l’incapacité psychologique de parvenir à des décisions ou à des convictions, comme c’est le cas dans le doute obsessionnel, mais la propension et la capacité à remettre en question de manière critique toutes les hypothèses et institutions qui sont devenues des idoles au nom du bon sens, de la logique et de ce qui est supposé être « naturel ». (1971, viii)
Plus encore, le radicalisme ne cherche ni se conforte dans le moralisme artificiel véhiculé par le pouvoir – par l’État et le capital. Une approche radicale n’accepte pas le faux moralisme qui définit la légitimité des actions en fonction de leur admissibilité pour les détenteurs du pouvoir ou les élites (la loi et l’ordre, les droits de l’État, les droits de propriété, et ainsi de suite). Comme l’a dit Fromm :
Cette remise en question radicale n’est possible que si l’on ne considère pas comme acquis les concepts de la société dans laquelle on vit ou même de toute une période historique – comme la culture occidentale depuis la Renaissance – et si, en outre, on élargit le périmètre de sa conscience et on pénètre dans les aspects inconscients de sa pensée. Le doute radical est un acte de dévoilement et de découverte ; c’est la prise de conscience que l’empereur est nu, et que ses splendides vêtements ne sont que le produit de son fantasme. (1971, viii)
Enfreindre la loi (des États, de la propriété) peut être tout à fait juste et raisonnable. De même que faire respecter la loi peut être (est, par définition) un acte de reconnaissance des systèmes d’injustice et de violence. Les affamés n’ont pas besoin de justifier leurs efforts pour se nourrir. Les démunis n’ont pas besoin d’expliquer leurs efforts pour se loger. Les personnes brutalisées n’ont pas besoin de demander la permission de mettre fin à la brutalité. Si leurs efforts sont radicaux – car ils savent que cela signifie de vraies solutions à de vrais problèmes – alors, qu’il en soit ainsi.
D’autre part, il y a la définition hégémonique revendiquée par le capital (et ses serviteurs étatiques). Dans cette vision, déformée par le prisme du pouvoir, le radicalisme est un mot pour dire extrémisme (chaos, désordre, violence, irrationalité). La résistance de la classe ouvrière, les mouvements sociaux, les luttes indigènes, les soulèvements paysans, les actions directes et les insurrections dans les centres urbains – toute opposition qui conteste (ou même remet en question) les relations de propriété, les systèmes de commandement et de contrôle, l’exploitation du travail, le vol des ressources communes par des intérêts privés – sont définis par l’État et le capital comme du radicalisme, par lequel ils entendent l’extrémisme, et de plus en plus, le terrorisme.
Tous les moyens de contrôle de l’autorité de l’État sont déployés pour juguler ou éradiquer ce radicalisme – c’est en grande partie la raison pour laquelle la police moderne, les systèmes de justice pénale et les prisons, ainsi que l’armée moderne, ont été créés, perfectionnés et renforcés. En outre, les pratiques « douces » de l’État et du capital, telles que les industries de la psy, qui ont longtemps inclus la rébellion parmi les maladies nécessitant un diagnostic et un traitement2, sont moins remarquées Comme le suggère Ivan Illich, théoricien de la pédagogie radicale : « Le véritable témoignage d’une profonde non-conformité suscite la plus féroce violence à son encontre » (1971, 16). C’est le cas dans le contexte actuel des luttes sociales, et de la répression déployée par l’État et le capital pour étouffer toute résistance significative (et effrayer les soutiens mous).
Pourtant, les opinions et les pratiques visées par cette construction du radicalisme sont tout bonnement celles qui défient et contestent les États et le capital et proposent des relations sociales alternatives. Même lorsque ces mouvements ne font pas ou peu de mal à qui que ce soit, même lorsqu’ils sont explicitement non-violents (comme dans les occupations des lieux de travail, les grèves, les revendications territoriales des indigènes), le pouvoir présente ces activités comme radicales et extrêmes (et, par association, violentes). C’est en réalité parce que de telles activités font planer le spectre de la première compréhension du radicalisme – celui qui vient d’en bas – celui qui parle des perspectives des opprimés et des exploités. Cette définition est, en fait, fidèle aux racines du mot et cohérente avec sa signification.
L’accusation de radicalisme par les détenteurs du pouvoir, la question du radicalisme elle-même, devient toujours plus importante dans les périodes de lutte accrue. C’est à ces moments que le capital étatique a quelque chose à craindre. Les efforts visant à s’attaquer aux racines ne sont plus relégués aux marges du discours social, mais ce que le pouvoir cherche à faire, c’est le ramener dans un lieu de contrôle et de réglementation. Dans les périodes de calme, la question du radicalisme est moins souvent posée. Cela en dit long sur la nature des débats au sujet du radicalisme.
Le radicalisme au sens premier n’est pas une réaction spontanée aux conditions sociales. Pour Illich, il faut apprendre à distinguer « entre la fureur destructrice et la revendication de formes radicalement nouvelles » (1971, 122). Là où il démolit, il démolit pour construire. Il faut « distinguer entre la foule aliénée et la protestation profonde » (1971, 122-123). Dans la perspective de Fromm :
Le doute radical signifie questionner, il ne signifie pas nécessairement nier. Il est facile de nier en posant simplement le contraire de ce qui existe ; le doute radical est dialectique dans la mesure où il appréhende le déroulement des oppositions et vise une nouvelle synthèse qui nie et affirme. (1971, viii)
Comme l’a suggéré l’anarchiste Mikhaïl Bakounine, la passion de détruire est aussi une passion créatrice.
Les problèmes d’extrémisme, introduits par les détenteurs du pouvoir pour servir leur pouvoir, sont une diversion, un faux-fuyant pour ainsi dire. Les actes supposés extrêmes ou scandaleux ne sont pas nécessairement radicaux, comme le suggèrent les médias de masse qui les traitent souvent comme des synonymes. Les actes extrêmes (et il faudrait en dire plus sur ce terme trompeur) qui ne parviennent pas à s’attaquer aux racines des relations entre l’État et le capital, comme les actes de violence malavisés contre des civils, ne sont pas radicaux. Ils ne s’attaquent pas aux racines de l’exploitation capitaliste (même si la frustration liée à l’exploitation les engendre). Les actes qui servent uniquement à renforcer les relations de répression ou à légitimer les initiatives de l’État ne sont pas radicaux.
En même temps, certains actes extrêmes sont radicaux. Ces actes doivent être jugés au regard de leur impact réel sur le pouvoir capitaliste d’État, sur les institutions d’exploitation et d’oppression.
Dans le cadre du capitalisme d’État, l’extrémisme est vidé de son sens. Dans un système fondé et subsistant sur le meurtre de masse, le génocide et l’écocide comme réalités quotidiennes de son existence, les concepts de l’extrémisme deviennent non pertinents, insensés. En particulier lorsqu’ils sont utilisés de manière triviale, désinvolte, pour décrire des actes mineurs d’opposition ou de résistance, voire de désespoir. Dans ce cadre également, la question de la violence (dans une société fondée et étayée par des actes quotidiens d’extrême violence) ou de la non-violence est une construction factice (favorable au pouvoir qui légitime sa propre violence ou fait passer pour non-violents des actes violents comme l’exploitation), un jeu truqué.
Le pouvoir n’admet jamais son propre extrémisme, sa propre violence, son propre chaos, sa propre destruction, son propre désordre. Le désordre de l’inégalité, le chaos de la dépossession, la destruction des communautés et des relations traditionnelles ou indigènes – l’extermination de la vie, de la planète elle-même. Ce sont de véritables comportements extrémistes. Ils sont, en fait, endémiques à l’exercice du pouvoir dans les sociétés capitalistes étatiques.
La destruction d’écosystèmes entiers pour le profit de quelques-uns est un acte férocement « rationnel » (contre l’irrationalité des approches radicales visant à mettre fin à ces ravages). L’extinction de communautés entières – le génocide des peuples – pour obtenir des terres et des ressources est une action indiciblement extrême, en termes écologiques et humains. Pourtant, le pouvoir n’identifie jamais ces actes comme étant radicaux – il s’agit toujours d’une simple réalité de la vie, du coût des affaires, d’un effet secondaire du progrès inévitable, d’un résultat malheureux de l’histoire (dont personne n’est responsable).
Et il ne s’agit même pas des extrêmes, ni de rares dérives du capitalisme – ce sont les actes fondateurs de l’être du capital –, ils sont la nature du capital. La conquête coloniale, par exemple, n’est pas un effet secondaire regrettable ou un excès du capitalisme – c’est sa possibilité même, son essence.
Les militants qui ne parviennent pas à aller à la racine des problèmes sociaux ou écologiques – qui ne comprennent pas ce que signifie le radicalisme d’en bas pour la résistance – peuvent être, et sont généralement, trop facilement enrôlés par le capital étatique dans le chœur dominant qui assaille et condamne, qui calomnie et dénigre le radicalisme. Nous le voyons dans le cas des mouvements de mondialisation alternative où certains activistes, revendiquant la désobéissance civile non-violente (DCNV) de manière anhistorique, sans contexte, comme s’il s’agissait d’une sorte d’objet fétiche, se joignent ensuite à la police, aux politiciens, aux firmes et aux médias de masse pour condamner l’action directe, les blocages, les occupations de rue, les barricades ou, bien sûr, les dommages infligés à la propriété, comme étant trop radicaux – en tant qu’actes de violence. Les voix des activistes anti-radicaux deviennent une composante de la délégitimation de la résistance elle-même, un aspect clé du maintien du pouvoir et de l’inégalité.
De tels désaveux publics à l’endroit de la résistance servent à justifier, excuser et maintenir la violence très réelle qui est le capital. Les approches, y compris celles des activistes, qui condamnent la résistance, y compris par exemple la résistance armée, ne font que donner les moyens d’excuser et de justifier la violence continuelle et extensible (elle s’étend toujours en l’absence d’une réelle opposition) du capital étatique.
La survie n’est pas un crime. La survie n’est jamais radicale. L’exploitation est toujours un crime (ou devrait l’être). L’exploitation n’est jamais que la norme des relations sociales capitalistes.
Les détenteurs du pouvoir chercheront toujours à discréditer ou à délégitimer la résistance à leurs privilèges. Le recours à des termes chargés (mal compris et mal interprétés par les détenteurs du pouvoir) comme le radicalisme sera une tactique à cet égard. On peut suivre la reconstruction du terme « terreur » pour voir un exemple de ces processus. Le terme « terreur » était initialement utilisé pour désigner la violence d’État déployée contre toute personne considérée comme une menace pour l’autorité instituée, pour l’État (Badiou 2011, 17). Ce n’est que plus tard – comme résultat de la lutte hégémonique – que la terreur en est venue (pour les détenteurs du pouvoir étatique) à désigner les actions des civils – même les actions contre l’État.
Et cela fonctionne souvent. Il est certain que cela a joué un rôle dans l’atténuation ou l’adoucissement des potentiels des mouvements alternatifs à la mondialisation, comme cela a été le cas dans les périodes de lutte précédentes. En cela, ces activistes anti-radicaux soutiennent inévitablement le pouvoir et l’autorité de l’État capitaliste et renforcent l’injustice.
Toutefois, nous devons également être optimistes. L’accusation de radicalisme venant d’en haut (affirmée de manière superficielle) est aussi un appel à l’aide de la part du pouvoir. C’est un appel du pouvoir aux secteurs non engagés, le milieu mou, pour qu’ils se démarquent des secteurs résistants et se rangent du côté du pouvoir (États et capital) pour réaffirmer le statu quo (ou étendre les relations et les pratiques qu’ils trouvent bénéfiques, un nouveau statu quo de privilèges) – les conditions de la conquête et de l’exploitation.
Le radicalisme (ou l’extrémisme, ou le terrorisme) est la méthode utilisée par le pouvoir pour réprimer l’agitation en attirant le public vers les intérêts dominants. En ce sens, il reflète un certain désespoir de la part des puissants – un désespoir dont il faut profiter, et non pas en faire le jeu ou le minimiser.
Dans les périodes de recrudescence des luttes de masse, la question du radicalisme se pose inévitablement. C’est dans ces moments qu’une orientation radicale brise les limites de la légitimation hégémonique – en proposant de nouvelles interrogations, de meilleures réponses et de réelles alternatives. S’opposer au radicalisme, c’est s’opposer à la pensée elle-même. S’opposer au radicalisme, c’est accepter les conditions fixées par le pouvoir, c’est se limiter à ce que le pouvoir permet.
L’anti-radicalisme est intrinsèquement élitiste et anti-démocratique. Il part du principe que tout le monde, quel que soit son statut, a accès aux canaux de prise de décision politique et économique, et peut participer de manière significative à la satisfaction des besoins personnels ou collectifs. Il ne tient pas compte des vastes segments de la population qui sont exclus des décisions qui ont le plus d’impact sur leur vie, ni de l’accès inégal aux ressources collectives qui nécessitent, qui exigent, des changements radicaux.
Les activistes, ainsi que les sociologues et les criminologues, doivent défendre le radicalisme d’en bas comme une orientation nécessaire pour lutter contre l’injustice, l’exploitation et l’oppression et pour des relations sociales alternatives. Les actions doivent être évaluées non pas en fonction d’un cadre moral légal établi et renforcé par le capital étatique (pour son propre bénéfice). Elles doivent être évaluées en fonction de leur impact réel sur la fin (ou l’accélération de la fin) de l’injustice, de l’exploitation et de l’oppression, et sur l’affaiblissement du capital étatique. Comme Martin Luther King l’a suggéré, une émeute est simplement le langage de ceux qui ne sont pas entendus.
La morale bien-pensante et la référence à l’autorité légale, en reprenant les voix du capital étatique, est pour les activistes une abdication de la responsabilité sociale. Pour les sociologues et les criminologues, c’est un renoncement à l’imagination sociologique qui, en mettant l’accent sur la recherche des racines des problèmes, a toujours été radicale (au sens non hégémonique du terme). Les penseurs et les acteurs critiques de tous bords doivent défendre ce radicalisme. Ils doivent devenir eux-mêmes radicaux.
Les débats devraient se concentrer sur l’efficacité des approches et des pratiques pour s’attaquer aux racines des problèmes sociaux, pour déraciner le pouvoir. Ils ne devraient pas être centrés sur la conformité à la loi ou à la moralité bourgeoise. Ils ne devraient pas être limités par le manque d’imagination des participants ou par le sentiment que le meilleur des mondes est celui que le pouvoir a proposé.
Encore une fois, le radicalisme n’est pas une tactique, un acte, ou un événement. Ce n’est pas une question d’extrêmes, dans un monde qui considère comme indiscutable que les extrêmes sont effroyables. C’est une orientation du monde. Les caractéristiques du radicalisme sont déterminées par, et dans, des contextes spécifiques. C’est le cas aujourd’hui pour les mobilisations de masse, voire des soulèvements populaires contre les offensives d’austérité étatiques au service du capitalisme néolibéral. Le radicalisme menace toujours de déborder les tentatives de le contenir. C’est parce qu’il fait progresser la compréhension – il met en évidence l’injustice sociale – qu’il est par nature re-productif. Il est, en termes actuels, viral.
Jeff Shantz, Salt Spring Island, été 2013
Bibliographie
Badiou, Alain. 2011. Polemics. London: Verso
Fromm, Erich. 1971. « Introduction ». Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution. New York: Doubleday Anchor
Illich, Ivan. 1971. Celebration of Awareness: A Call for Institutional Revolution. New York: Doubleday Anchor
Mills, C. Wright. 1959. The Sociological Imagination. London: Oxford University Press.
Rimke, Heidi. 2011. « The Pathological Approach to Crime: Individually Based Theories ». In Criminology: Critical Canadian Perspectives, ed. Kirsten Kramar. Toronto: Pearson Education Canada, 78–92.
—. 2003 « Constituting Transgressive Interiorities: C19th Psychiatric Readings of Morally Mad Bodies ». In Violence and the Body: Race, Gender and the State, ed. A. Arturo. Indiana: Indiana University Press, 403–28.
Notes
-
NdT : le terme vient effectivement du latin tardif, comme mentionné par A. Blaise dans son dictionnaire du latin chrétien, dont voici la définition complète : « qui tient à la racine, premier, fondamental » dérivé de radix, -icis « racine, origine première ». ↩︎
-
Pour une analyse plus approfondie de cette question, voir le travail en cours de Heidi Rimke (2011, 2003). ↩︎
07.06.2022 à 02:00
Scott Scale 950 : premières impressions
Application directe de mon billet précédent sur les VTT dans les Hautes Vosges, je vous propose le court retour d’expérience d’une première prise en main d’un VTT Scott Scale 950 édition 2022.
Le choix
Ce VTT fut commandé en fin 2021 (oui, oui!). Le temps de livraison des cycles s’est trouvé excessivement allongé en général ces deux dernières années. Les raisons sont connues. La mondialisation des échanges a rendu les flux largement dépendants de quelques grands pays producteurs de matières premières. La pénurie de celles-ci associée à la désorganisation de la production en raison du Covid ont crée des effets dominos dans beaucoup de filières. Dans le secteur Mountain Bike, si votre choix est spécifique et que ne pouvez pas vous contenter de ce qui se trouve déjà en stock magasin, il faut vous armer de patience.
Or donc, j’avais commandé un Scott Scale 950. Pourquoi ce choix ? D’abord parce que je suis habitué à cette fameuse marque Suisse, mais aussi parce que, depuis 2005, la gamme Scale n’a cessé de s’améliorer et a fini par devenir une référence. Peu de marques ont cette capacité de pouvoir allier la contrainte de qualité imposée en compétition et décliner toute une gamme sur une si longue période (16 ans !). D’autres marques ont certes su mobiliser leurs capacités industrielles pour décliner des modèles très célèbres et de bonne qualité. La différence avec les vélos Scale, c’est le large choix de matériaux et d’équipements à travers toute la gamme. Au regard des attentes du cycliste, c’est là que le bât peut blesser : trop bas de gamme, le vélo perd tout son intérêt, trop haut, il devient cher et c’est vers d’autres marques qu’on doit se tourner pour un modèle équivalent et plus abordable.
Le Scott Scale 950 édition 2022 présentait pour moi plusieurs avantages :
- semi-rigide. Après plusieurs années en tout-suspendu pour le cross-country, il me fallait néanmoins un semi-rigide à la hauteur de mes attentes et de mes chemins (très variés, du plus technique en montée comme en descente, jusqu’aux chemins forestiers larges pour travailler l’endurance).
- la géométrie. Cadre, angles, haubans et direction, tout est fait pour allier la maniabilité, l’agilité et la nervosité. Sur les premiers modèles d’entrée de gamme, selon la morphologie du cycliste, on sent déjà bien la différence par rapport à des géométries moins travaillées pour le rendement (je pense à Lapierre, mais bon… il ne faut pas nourrir le troll). Pour moi, cette géométrie est juste ce qu’il me fallait mais à condition…
- … d’avoir un choix d’équipements à la hauteur (Shimano et Syncros pour l’essentiel). Et là c’est tout un équilibre qu’il faut choisir, entre des coûts raisonnables pour l’entretien (changement de pièces, surtout la transmission), l’évolution de l’équipement, la fiabilité.
Aujourd’hui, le Scale 950 a pour ainsi dire renoué avec la géométrie sportive de départ, tout en utilisant des matériaux de grande qualité. En comparant le 950 (cadre aluminium ultra-léger) avec le 930 et le 940 (cadre carbone), la différence de poids est respectivement de +400 grammes et de -200 grammes (!!). Si on considère un instant la rigidité et la relative fragilité du carbone (surtout du carbone entrée de gamme) par rapport à la souplesse de l’aluminium, on peut désormais se poser franchement la question de l’intérêt de vouloir absolument du carbone. Mon choix a donc porté sur l’aluminium, d’autant plus que l’équipement (transmission, freins) du 950 est excellent. Pour le prix, il y avait 100 et 200 euros de différence : la comparaison ne se résume donc pas à une question de portefeuille.

Première impression
Le débutant VTT peut très bien acheter ce modèle d’emblée, mais il faut savoir que la première impression est celle d’une assez grande exigence. Autant l’ensemble est extrêmement maniable, même avec peu d’expérience de pilotage, autant le rendement en terme de rapport énergie / vitesse est assez exceptionnel. Les plus sportifs trouvent vraiment leur compte avec ce VTT que l’on peut pousser assez loin dans ses capacités. S’il s’agit d’un premier VTT, c’est un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement grâce à un bon pilotage, autant acheter un Scale plus bas de gamme, ou un Aspect (pour rester chez Scott) et moins cher quitte à changer plus tard.
Pour illustrer : sur un tronçon de parcours chronométré de 10 km / 400 Md+, habituellement emprunté avec d’autres VTT (en particulier mon – désormais – ancien Scott Spark), j’ai gratté 5 minutes sur mon temps habituel (même condition climatique et de terrain). Cela tient à deux choses : la légèreté et le rendement. On peut certes y associer l’excitation de la nouveauté, mais… 5 minutes, tout de même ! Tout le rendement qu’on a en moins dans un tout suspendu (même en rigidifiant les amortisseurs) est récupéré. Et non, bien évidemment, je ne parle pas des tout-suspendus à 10.000 euros, hein ?
Et la descente ? Et bien, j’ai largement confirmé mon expérience selon laquelle, pour la plupart des sentiers des montagnes vosgiennes, équiper un bon semi-rigide de roues 29 pouces est largement suffisant. La différence s’est fait à peine sentir, y compris grâce à la souplesse de l’aluminium. Certains obstacles, peu nombreux, ne sont évidemment pas pris de la même manière qu’avec un tout-suspendu1. Autrement dit : si on veut garder la même vitesse en présence d’obstacles, le Scott Scale fait parfaitement le job à condition de savoir bien piloter. C’est là qu’un débutant aura sans doute plus de difficulté, en montée comme en descente, surtout en présence de racines ou de gros dévers.
En revanche, un petit bémol pour Scott qui équipe les roues d’emblée avec des pneus Rekon Race : très valables sur terrains secs, ils sont très peu fiables dès qu’il y a de l’humidité. Or, m’étant concocté un parcours avec des terrains très variés pour ce premier test, je sais déjà qu’à la première occasion, je changerai les pneus.
Matériel
Il n’y a pas grand chose à dire sur l’équipement de ce VTT. Comme Scott sait le faire, le blocage triple position de la fourche est un atout non négligeable car il permet d’adapter la fourche au type de terrain. Mais là rien de nouveau.
Rien d’exceptionnel non plus concernant la transmission : mono-plateau (32), cassette arrière 12 vitesses (10-51), dérailleur Shimano Deore XT… Cette transmission fait vraiment le job, à voir sur la durée. Avantage de ces composants : ils sont connus, fiables, et les changer ne coûte pas un bras. On pourra monter en gamme à l’usage mais a priori je n’en vois pas la nécessité.
Les autres équipement Syncros, célèbres chez Scott, sont tout à fait classiques aussi. Petit plus pour la selle Belcarra que j’ai trouvée vraiment confortable. Mais là aussi, il faut l’envisager sur la durée : il y a mieux en matière de selle.
Quant aux freins, je réserve une mention spéciale : ils sont vraiment bons. Pourtant il s’agit des Shimano MT501 qui sont certes typés sportifs, mais ne figurent pas en haut de podium. Je pense que tout simplement l’innovation en la matière a rendu ces systèmes de freins de plus en plus performants : qu’il s’agisse du mordant ou de la souplesse des leviers, après quelques essais, on trouve très vite le point d’accroche qui permet de doser efficacement le freinage.
Un point important : les pédales. Bien sûr elles ne sont pas fournies mais sur un tel VTT les pédales automatiques ou semi-automatiques me semblent indispensables. Pour l’heure, j’ai reporté les pédales plates de mon ancien VTT, j’attends avec impatience de pouvoir tester des semi-automatiques magnétiques (marque Magped).
Esthétique
Et pour finir, je ne peux pas m’abstenir de mentionner l’aspect esthétique général de mon nouveau bijou… couleur émeraude chatoyant à l’aspect mat, associée à un beige que l’on trouve sur la selle et le choix des pneus. L’élégance de la géométrie associée à ces choix de couleurs (un peu kitsch peut-être) donne un ensemble très « smart ».
Pour autant Scott n’a pas oublié quelques points essentiels : les bases arrières sont enfin complètement protégées, en particulier du côté transmission avec une protection caoutchouc de bonne facture. Idem à l’avant du tube diagonal, un revêtement anti-adhérence présentant le nom de la marque, est censé protéger cette partie du cadre. Là, par contre, il faut voir sur la durée : cela semble protéger contre les salissures, mais pas forcément contre les pierres, donc je crois qu’un bon coup de film polyuréthane devra s’imposer tout de même.
Conclusion
Le Scott Scale 950 est un excellent compromis entre la randonnée sportive et la recherche de performance. Dédié au Cross-country, il est dédié aux sorties rythmées. La relance en haut de côte n’est plus vraiment un problème. Le pilotage est assez nerveux, ce qui fait que je le déconseille aux débutants : on se laisse vite griser par la vitesse indépendamment du terrain (le 29 pouce fait son effet) mais gare au freinage tardif ! Le choix des pneus est donc crucial selon votre géographie et les Rekon Race fournis par défaut ne feront certainement pas l’unanimité.
Notes
-
Ce que j’ai surtout remarqué, c’est que le tout-suspendu permet de jouer avec les obstacles, quitte à corriger des erreurs de pilotage, alors qu’en semi-rigide l’erreur se pardonne moins. Autrement dit, les sensations de pilotage sont beaucoup plus authentiques. Il y a toujours un côté snob à mentionner ce genre de choses, mais je comprends les pratiquants qui souhaitent parfois revenir à des « fondamentaux ». ↩︎
27.03.2022 à 01:00
Néolibéralisme et élections : le pari pascalien ?
Guerre en Ukraine… À l’heure où les gouvernements européens sont gentiment pressés de choisir l’impérialisme qu’ils préfèrent (disons le moins pire), le président des États-Unis Joe Biden est venu nous rendre une petite visite. Que de beaux discours. Ils firent passer le nouvel accord de principe américano-européen sur le transfert des données personnelles pour une simple discussion entre gens de bonne compagnie autour de la machine à café. Même si cet accord de principe a reçu un accueil mitigé.
Le gouvernement américain aurait en effet bien tort de s’en passer. Maintenant que l’Europe est en proie à la menace avérée d’une guerre nucléaire et risque d’être en déficit énergétique, Joe Biden ne fait qu’appliquer ce qui a toujours réussi aux entreprises multinationales américaines, c’est-à-dire la bonne vieille recette de l’hégémonie sur les marchés extérieurs appuyée par l’effort de guerre (voir cet article).
Après l’invalidation du Privacy Shield, les GAFAM (et autres sociétés assimilées, comme les courtiers de données tels Acxiom) n’auront plus cette épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes pour contrecarrer les pratiques d’extraction des données qu’elles opèrent depuis de longues années ou pour coopérer avec les agences de renseignement, de manière active, dans la surveillance de masse.
Il est intéressant, par ailleurs, de comparer le communiqué de presse de la Maison Blanche et le Discours de Ursula von der Leyen.
Du point de vue Américain, c’est surtout une affaire de pognon et de concurrence :
(…) l’accord permettra la fluidité du trafic de données qui représente plus de 1 000 milliards de dollars de commerce transfrontalier chaque année, et permettra aux entreprises de toutes tailles de se concurrencer sur leurs marchés respectifs.
et l’enjeu consiste à laisser les commandes aux agences de renseignement américaines :
Ces nouvelles politiques seront mises en œuvre par la communauté du Renseignement des États-Unis de manière à protéger efficacement ses citoyens, ainsi que ceux de ses alliés et partenaires, conformément aux protections de haut niveau offertes par ce Cadre.
Du point de vue Européen, on mélange tout, la guerre, l’énergie et le numérique. Et pour cause, la peur domine :
Et nous continuons à renforcer notre coopération dans de nombreux domaines stratégiques: en apportant de l’aide à l’Ukraine en matière humanitaire et sécuritaire; dans le domaine de l’énergie; en luttant contre tout ce qui menace nos démocraties; en résolvant les points en suspens dans la coopération entre les États-Unis et l’Union européenne, y compris en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée.
D’aucuns diraient que conclure des accords de principes en telle situation d’infériorité est à la fois prématuré et imprudent. Et c’est là que tout argument stratégique et rationnel se confronte au fait que c’est toute une doctrine néolibérale qui est à l’œuvre et affaibli toujours plus les plus faibles. Cette doctrine est révélée dans cette simple phrase d’U. von der Leyen :
Et nous devons également continuer à adapter nos démocraties à un monde en constante évolution. Ce constat vaut en particulier pour la numérisation (…)
Encore une fois on constate combien nos démocraties sont en effet face à un double danger.
Le premier, frontal et brutal, c’est celui de la guerre et la menace du totalitarisme et du fascisme. Brandie jusqu’à la nausée, qu’elle soit avérée (comme aujourd’hui) ou simplement supposée pour justifier des lois scélérates, elle est toujours employée pour dérouler la logique de consentement censée valider les modifications substantielles du Droit qui définissent le cadre toujours plus réduit de nos libertés.
Le second n’est pas plus subtil. Ce sont les versions plus ou moins édulcorées du TINA de Margareth Thatcher (vous vous souvenez, la copine à Pinochet). There is no alternative (TINA). Il n’y a pas d’alternative. Le monde change, il faut adapter la démocratie au monde et non pas adapter le monde à la démocratie. Les idéaux, les rêves, les mouvements collectifs, les revendications sociales, la soif de justice… tout cela n’est acceptable que dans la mesure où ils se conforment au monde qui change.
Mais qu’est-ce qui fait changer le monde ? c’est simplement que la seconde moitié du XXe siècle a fait entrer le capitalisme dans une phase où, considérant que le laissez-faire est une vaste fumisterie qui a conduit à la crise de 1929 et la Seconde Guerre, il faut que l’État puisse jouer le jeu du capitalisme en lui donnant son cadre d’épanouissement, c’est-à-dire partout où le capitalisme peut extraire du profit, de la force de travail humaine à nos intimités numériques, de nos santés à notre climat, c’est à l’État de transformer le Droit, de casser les acquis sociaux et nos libertés, pour assurer ce profit dans un vaste jeu mondialisé de la concurrence organisée entre les peuples. Quitte à faire en sorte que les peuples entrent en guerre, on organise la course des plus dociles au marché.
Le néolibéralisme est une doctrine qui imprègne jusqu’au moindre vêtement les dirigeants qui s’y conforment. Macron n’est pas en reste. On a beaucoup commenté son mépris de classe. L’erreur d’interprétation consiste à penser que son mépris est fondé sur la rationalité supposée du peuple. Dès lors, comment avoir du respect pour un peuple à ce point assujetti au capitalisme, plus avide du dernier smartphone à mode que des enjeux climatiques ? Mais que nenni. Premièrement parce que ce peuple a une soif évidente de justice sociale, mais surtout parce le mépris macroniste relève d’une logique bien plus rude : pour mettre en application la logique néolibérale face à un peuple rétif, il faut le considérer comme radicalement autre, détaché de sa représentation de soi, en dehors de toute considération morale.
Si nous partons du principe que dans la logique communicationnelle de Macron toute affirmation signifie son exact contraire1 on peut remonter au tout début dans sa campagne de 2017 où il se réclamait plus ou moins du philosophe Paul Ricoeur. C’est faire offense à la mémoire de cet éminent philosophe. Pour dire vite, selon Ricoeur, on construit le sens de notre être à partir de l’altérité : l’éthique, la sollicitude, la justice. Bref, tout l’exact opposé de Macron, ou plutôt de son discours (je me réserve le jugement sur sa personne, mais croyez bien que le vocabulaire que je mobilise dans cette optique n’aurait pas sa place ici).
Il n’y a donc aucune surprise à voir que pour le capitalisme, tout est bon dans le Macron. Lui-même, dans Forbes, répétait à deux reprises : « There’s no other choice », prenant modèle sur Thatcher. Il n’y a pas de politique, il n’y a pas d’idéologie, le parti sans partisan, la nation start-up en dehors du peuple. Il y a une doctrine et son application. Un appareillage économique et technocratique sans âme, tout entier voué à la logique extractiviste pour le profit capitaliste. Bien sûr on sauve les apparences. On se drape d’irréprochabilité lorsque le scandale est trop évident, comme de le cas du scandale des maisons de retraite Orpea. Mais au fond, on ne fait qu’appliquer la doctrine, on adapte la démocratie (ou ce qu’il en reste) au monde qui change… c’est-à-dire qu’on applique en bon élève les canons néolibéraux, jusqu’à demander à des cabinets d’audit comment faire exactement, de la coupe programmée du système éducatif à nos retraites, en passant par les aides sociales.
Comment comprendre, dans ces conditions pourtant claires, que Macron soit à ce point si bien positionné dans les sondages en vue des prochaines élections présidentielles ? C’est tout le paradoxe du vote dans lequel s’engouffre justement le néolibéralisme. Ce paradoxe est simple à comprendre mais ses implications sont très complexes. Si je vais voter, ce n’est pas parce que mon seul vote va changer quelque chose… mais si je n’en attends rien individuellement en retour, pourquoi vais-je voter ? Les idéalistes partent alors du principe de la rationalité du votant : si Untel va voter, c’est parce qu’il souhaite défendre un intérêt collectif auquel il adhère. Mais on peut alors retourner le problème : cela supposerait une complétude de l’information, un contexte informationnel suffisant pour que le vote au nom de cet intérêt collectif ne soit pas biaisé. Or, le principe d’un vote électoral est justement de diffuser de l’information imparfaite (la campagne de communication politique). En gros : bien malin celui qui est capable de dénicher toutes les failles d’un discours politique. De surcroît les techniques de communications modernes se passent bien de toute morale lorsqu’elles réussissent à faire infléchir le cours des votes grâce au profilage et à l’analyse psychographique (le scandale Cambridge Analytica a soulevé légèrement le voile de ces techniques largement répandues). Donc la raison du vote est presque toujours irrationnelle : on vote par conformité sociale, par pression familiale, par affinité émotionnelle, par influence inconsciente des médias, et cela même si une part rationnelle entre toujours en jeu.
Par exemple, comment comprendre que l’abstention soit toujours à ce point considérée comme un problème de réputation sociale et non comme un choix assumé ? Ne pas voter serait un acte qui nuit à la représentation de l’intérêt collectif que se font les votants. Rien n’est moins évident : on peut s’abstenir au nom de l’intérêt collectif, justement : ne pas entrer dans un jeu électoral qui nuit à la démocratie, donc à l’intérêt collectif. Il y a plein d’autres raisons pour lesquelles s’abstenir est une démarche très rationnelle (voir F. Dupuis-Déri, Nous n’irons plus aux urnes).
L’autre raison de l’abstention, beaucoup évidente, c’est la démonstration que le choix est biaisé. Une course électorale à la française qui se termine par un second tour opposant deux partisans de la même doctrine néolibérale. On a déjà vu cela plus d’une fois. Le scénario consiste à opposer le couple thatchérisme et mépris de classe au couple Pinochisme et racisme. Les deux contribuent à créer un contexte qui est de toute façon néo-fasciste. Soit un durcissement de la logique néolibérale au détriment des libertés et de la justice sociale (car il faudra bien satisfaire les électeurs du Front National), soit un durcissement de la logique néolibérale au détriment des libertés et de la justice sociale (parce qu’il faudra bien satisfaire les électeurs de Macron). Vous voyez la différence ? sans blague ? Bon, je veux bien admettre que dans un cas, on pourra plus clairement identifier les connards de fachos complotistes.
Bon, alors que faire ? Aller voter ou pas ?
Je me suis fait un peu bousculer dernièrement parce que j’affichais mon intention de m’abstenir. Il faut reconnaître qu’il y a au moins un argument qui fait un peu pencher la balance : la présence de la France Insoumise comme le seul mouvement politique qui propose une alternative au moment où l’effet TINA est le plus fort.
Il y aurait donc une utilité rationnelle au vote : en l’absence d’un contexte informationnel correct, au moins un élément rationnel et objectif entre en jeu : préserver le débat démocratique là où il a tendance à disparaître (au profit du racisme ou de l’anesthésie générale du néolibéralisme).
Comment un anarchiste peut-il aller tout de même voter ? ne rigolez pas, j’en connais qui ont voté Macron au second tour il y a 5 ans pour tenter le barrage aux fachos. C’est un vrai cas de conscience. En plus, il y a rapport avec Dieu ! si ! C’est le fameux pari de Pascal : je ne crois pas en Dieu, mais qu’il existe ou non, j’ai tout à gagner à y croire : s’il n’existe pas, je suis conforté dans mon choix, et s’il existe, c’est qu’il y a un paradis réservé au croyants et un enfer pour les non-croyants et dans lequel je risque d’être envoyé. Donc voter Mélenchon serait un acte rationnel fondé sur l’espérance d’un gain individuel… Zut alors.
On s’en sort quand même. L’acte rationnel repose sur une conviction et non une croyance : voter Mélenchon au premier tour consiste à un vote utile contribuant à l’émergence d’un débat démocratique qui opposerait deux visions du monde clairement opposées. Que Mélenchon soit finalement élu ou pas au second tour permettrait d’apporter un peu de clarté.
L’autorité et le pouvoir ne sont décidément pas ma tasse de thé. Je me méfie de beaucoup de promesses électorales de Mélenchon, à commencer par sa conception d’une VIe République qui n’entre pas vraiment dans mes critères d’une démocratie directe, ou encore sa tendance à l’autoritarisme (et j’ai du mal à voir comment il peut concilier l’un avec l’autre).
Que ferai-je au premier tour ? Joker !
notes
-
On peut prendre un exemple très récent dans sa campagne électorale : conditionner le RSA à un travail qui n’en n’est pas un, plutôt un accompagnement ou du travail d’intérêt général, bref tout ce qui peut produire sans être qualifié par un contrat de travail. ↩︎
29.12.2021 à 01:00
En finir avec Gérard d'Alsace
Il y a quelques années, je m’étais penché sur l’histoire du nom de la ville de Gérardmer. Mon approche consistait à utiliser l’historiographie et confonter les interprétations pour conclure que si l’appellation en mé relevait des différentes transformations linguistiques locales, le patronyme Gérard ne pouvait provenir avec certitude du Duc Gérard d’Alsace comme le veut pourtant le folklore local. À la coutume j’opposais le manque de fouilles archéologiques et surtout l’absence de précautions méthodologiques de la part des auteurs ; pour preuve je mentionnais la source de la confusion, à savoir le récit de Dom Ruinart, moine bénédictin rémois, décrivant sa journée du 2 octobre 1696… Dans cet article, je commenterai le récit de Dom Ruinart pour mieux mesurer sa place dans l’historiographie gérômoise. Pour cela, il me faudra auparavant exhumer les controverses à propos de Gérard d’Alsace et sa place dans l’histoire de Gérardmer.
Màj. 30/08/2022 : ce billet a fait l’objet d’un remaniement sous forme d’article publié en ligne désormais sur le site de la Société Philomatique Vosgienne.
L’hypothèse d’une tour
La solution m’a été soufflée par un gérômois fort connu, M. Pascal Claude, alors que je travaillais sur la réédition du livre de Louis Géhin Gérardmer à travers les âges. M. Claude1 avait trouvé un extrait des oeuvres de Dom Ruinart qui, si on le lit trop précipitamment, mentionne à un château là où la Jamagne (Ruisseau venant de Gérardmer) se jette dans la Vologne (nous verrons plus loin qu’il n’en est rien). M. Claude suggérait alors que la « Tour Gérard d’Alsace » dont fait mention la tradition ne pouvait justement pas être située à Gérardmer mais du côté d’Arches.
Cette hypothèse de travail est la bonne car elle pose directement les conditions de l’existence ou non d’une « Tour Gérard d’Alsace » à Gérardmer. Cette tour supposée est depuis longtemps dans la culture populaire une partie fondamentale de l’explication du patronyme Gérard dans le nom de la ville.
Une partie seulement, puisque dans un mouvement quelque peu circulaire du raisonnement, la signification du suffixe en mé serait une seconde clé : le mé ou mansus en latin. Cette question est importante. Alors que mer doit son étymologie à mare désignant l’étendue d’eau que l’on retrouve dans le nom de Longemer ou Retournemer (qui se prononcent mère même si le patois les prononce indifférement mé ou mô), le mé peut avoir une signification romane qui renvoie à la propriété, la tenure : mansus en latin tardif, mas en langue d’oc, meix en langue d’oil, et moué, mé ou mô en patois du pays vosgien. Or, si l’inteprétation est attribuée au sens latin, c’est-à-dire en référence à une propriété, la démarche consiste à rechercher les traces d’un édifice qui puisse l’attester physiquement à défaut d’une trace écrite.
En somme, s’il y a une « tour Gérard d’Alsace » ce serait parce qu’il y a une « propriété » d’un certain Gérard. Et comme on s’y attend, le duc Gérard d’Alsace (1030-1070) qui, comme son nom ne l’indique pas, était Duc de Lorraine2 devrait donc être ce fameux Gérard, heureux détenteur d’un mansus à Gérardmer. De qui d’autre pouvait-il s’agir ? Par cette attribution qui se justifie elle-même, la tradition locale affirmait ainsi avec force le rattachement Lorrain de la ville depuis une époque fort ancienne.
Et cela, même si le premier écrit connu qui atteste officiellement l’appartenance de Gérardmer au Duché de Lorraine date de 1285, bien longtemps après l’époque de Gérard d’Alsace. Comme l’écrit Louis Géhin, il s’agit d'« un acte de Mai 1285, par lequel le duc Ferry III concéda à Conrad Wernher, sire de Hadstatt, à son fils et à leurs héritiers, en fief et augmentation de fiefs, que le dit Hadstatt tenait déjà de lui, la moitié de la ville de La Bresse, qu’il les a associés dans les lieux appelés Gérameret Longemer en telle manière que lui et eux doivent faire une ville neuve dans ces lieux, où ils auront chacun moitié. »3
Il reste que l’existence d’une « Tour Gérard d’Alsace » à Gérardmer a toujours été imputée par les différents auteurs à une tradition, une légende issue de la culture populaire… sauf dans l’étude exhaustive la plus récente, celle de Marc Georgel, parue en 1958. Comparons-les.
Henri Lepage en 1877, dans sa « Notice Historique et Descriptive de Gérardmer »4 écrit ceci :
La tradition veut également que Gérard d’Alsace, […] ait […] fait de Gérardmer un rendez-vous pour la chasse et la pêche ; elle ajoute qu’il aurait fait édifier une tour (3), près du ruisseau de la Jamagne, pour perpétuer le souvenir de son séjour dans ces lieux déserts ; le lac d’où sort cette rivière ce serait dès lors appelé Gerardi mare, mer de Gérard, et par inversion Gérard-mer.
(En note de bas de page – 3 : Cette tour s’élevait, dit-on, sur une petite éminence, au milieu de la prairie du Champ, à l’endroit où se voit aujourd’hui l’église du Calvaire, et on en aurait retrouvé les fondations.
On notera les précautions qu’emploie H. Lepage : « la tradition veut », « dit-on », et l’usage du conditionnel.
Dans la même veine, un peu plus tard en 1893, Louis Géhin mentionne la construction de la première église de Gérardmer en 1540, et la situe sur l’emplacement « prétendu » de cette Tour :
Dès l’année 1540, les habitants de Gérardmer élevèrent, sur le bord de la Jamagne, non loin de l’emplacement prétendu de la Tour de Gérard d’Alsace, une chapelle dédiée à saint Gérard et saint Barthélemy5.
Et pourtant, en 1958, Marc Georgel ne prend plus aucune précaution ! Dans une somme impressionnante sur la La vie rurale et le folklore dans le canton de Gérardmer il écrit de manière péremptoire :
Chacun sait maintenant (depuis les nombreux ouvrages qui traitent de Gérardmer) que le duc Gérard se fit construire une tour près du « Champ », lieu-dit actuellement « Le Calvaire », sur la rive droite de la Jamagne, à quelques centaines de mètres du lac qui s’appelait encore au XVIe siècle « le lac Major » (une preuve de plus que le nom de la ville de Gérardmer doit son origine à la « tour » de Gérard et non pas au lac6). Quelle était la destination de cette construction de Gérard ? Tour de guet pour assurer plus facilement la garde de la petite agglomération de Champ ? Villa saisonnière ? La plupart des auteurs émettent l’hypothèse d’une sorte de pavillon de chasse.
Renouant ainsi avec la culture populaire, M. Georgel sacrifie la rigueur méthodologique à l’imagination des contes et légendes des Vosges. L’appellation du Lac en « lac Major » (dont il ne cite pas la source) ne prouve rien en soi. Quant aux hypothèses qu’il soulève à propos de la destination d’une telle construction sont quelque peu sujettes à caution :
- une tour de garde suppose… des gardes, donc des salaires et une économie locale suffisante, ce qui, au XIe siècle, est fortement improbable en ces vallées,
- un pavillon de chasse est plausible si l’on part du principe qu’effectivement depuis Charlemagne la noblesse allait chasser dans ces vallées… sauf que dans ce cas, il s’agirait d’un campement établi à la hâte, peut-être pour y revenir d’une saison à l’autre, soumis au gré du climat, sans fondations… sans traces tangibles, donc.
- quant à une villégiature… Marc Georgel a sans doute tendance à calquer la dynamique touristique de Gérardmer florissante depuis le XIXe siècle en la rendant parfaitement anachronique.
Pour conclure cette première partie, la cause doit être entendue : nous devons comprendre les origines de cette histoire de « Tour Gérard d’Alsace ». Entendons-nous bien : ce que nous allons démontrer n’est pas l’origine du folklore local à ce propos, qui peut remonter à une époque très lointaine, mais l’origine de la controverse qui permet de comprendre pour quelle raison il y a effectivement un débat à ce propos. Répondant à cette question, nous pourront montrer « d’où vient l’erreur ».
Histoires croisées de Gérardmer et Longemer : un patronyme indécidable
Durant de nombreux siècles, la vallée des lacs de Gérardmer et Xonrupt-Longemer était habitée de manière sporadique, avec des populations provenant tantôt des frontières germaniques et tantôt des autorités administratives lorraines, qu’il s’agisse de l’autorité ducale ou de l’autorité des abbesses de Remiremont. Ce double patronat est attesté en 970 pour ces « bans de la montagne » dont la zone de Gérardmer faisait partie. L’essentiel de l’économie locale étant composée de foresterie, d’élevage et de produit d’élevage marcaire (sur les chaumes), et un peu de pisciculture.
Les routes qui relient Gérardmer aux centres économiques lorrains sont praticables assez tôt. Les voies principales sont connues : Gérardmer-Bruyères en suivant le cours de la Vologne, Gérardmer-Remiremont en passant par le Col de Sapois, Gérardmer-Saint-Dié via le Col de Martimpré. Evidemment, pour rejoindre l’Alsace, Gérardmer ne figurait pas parmi les étapes des voyageurs lorrains, ceux-ci préférant passer par le col de Bussang, la vallée de Senones / territoire de Salm (col du Hantz) ou plus loin le col de Saverne. En somme, la vallée de Gérardmer était plus une destination qu’une étape.
Comme nous l’avons vu dans la première partie, si nous nous interrogeons sur l’origine du nom de Gérardmer, il faut pour en comprendre l’importance situer cette question dans le folklore local.
Les autorités lorraines étant lointaines, il reste que la culture locale attribue certains lieux-dits aux grands personnages qui ont fréquenté les contreforts vosgiens : Charlemagne et ses parties de chasse ou plus tard les ducs de Lorraine constructeurs de châteaux. Ces coutumes sont importantes à la fois parce qu’elles attestent de l’appartenance culturelle et juridique des lieux mais aussi pour des raisons spirituelles. Ainsi le moine Richer de Senones, au XIIIe siècle dans sa chronique mentionne la fondation d’une chapelle à Longemer en 1056 par Bilon, un serviteur de l’illustre Gérard d’Alsace7 :
Anno Domini mo lvio quidam Bilonus, Gerardi ducis servus, in saltu Vosagi qui Longum mare dicitur, locuns et capellam in honore beati Bartholomei privus edificavit.
L’an du Seigneur 1056, un certain personnage du nom de Bilon, serviteur du duc Gérard, construisit une chapelle en l’honneur de saint Barthélémy, dans une forêt de la Vosges, qu’on appelle Longe-mer (trad. L. Géhin).
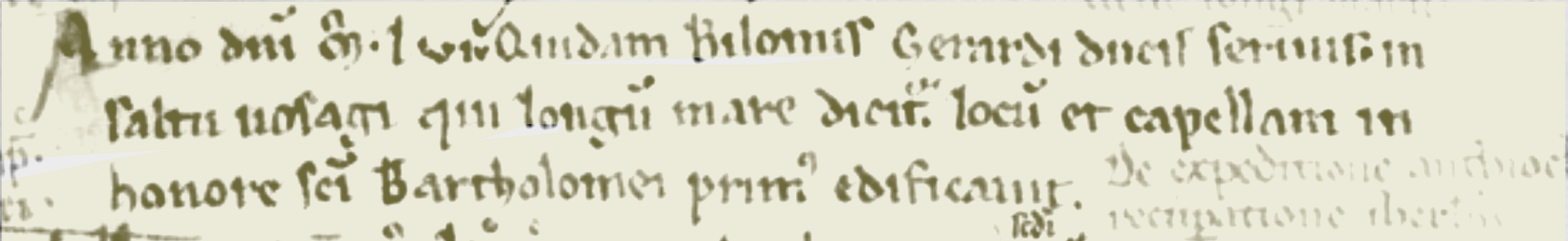
Si l’édification de la chapelle en question était surtout un ermitage (comme il y en aura plus d’un dans la vallée) la confusion entre les lieux (Longemer et Gérardmer8) a très certainement joué en faveur du double patronage de Saint Barthélémy et Saint Gérard, qui fut longtemps l’attribut de la nouvelle église du hameau de Gérardmer au XVIe siècle.
Cette question du patronage de l’église a toute son importance. Elle croise les histoires communes de Longemer et de Gérardmer. Cette approche doit être privilégiée pour comprendre les liens entre Gérardmer et son patronyme, car elle est l’objet d’une controverse célèbre.
En 1878, M. Arthur Benoît, correspondant de la Société d’émulation des Vosges, reprend les écrits du P. Hugo d’Étival et ceux du Père Benoît Picart, Capucin de Toul (ou Benoît de Toul). Au tout début du XVIIIe siècle, ces deux personnages hauts en couleurs étaient entrés dans une course politique dont le Duc Léopold de Lorraine devait en être l’arbitre. Le duel s’était cristallisé autour de l’histoire de la Maison de Lorraine que le P. Benoît Picart avait étudié et et dont il avait tiré un ouvrage (L’origine de la très illustre Maison de Lorraine) qui déplu finalement au Duc Leopold. Pour plaire à ce dernier le Père Hugo d’Etival eu la prétention d’écrire, sous un pseudonyme et une fausse maison d’édition, un traité sur la généalogie de la Maison de Lorraine. Répondant à cette supercherie, le Père Benoît Picard publia aussitôt deux tomes critiques du livre du P. Hugo, sous le titre de Supplément à l’histoire de la maison de Lorraine9.
Dans cette dispute, la question de l’attribution du patronyme au nom de Gérardmer ne fut pas épargnée et c’est justement à partir de l’histoire de Bilon à Longemer que l’on pose les prémisses du raisonnement.
En 1711, le père Hugo abbé d’Etival, mentionnant Bilon à l’image de Richer de Senones, suggère que c’est en l’honneur du Duc Gérard d’Alsace que Gérardmer porterait ce nom10 :
C’est apparemment du Duc Gérard que le village de Gerardmer à présent Geromé en Vosges, a emprunté son nom. Herculanus11 dit que, dans ce lieu se retira vers l’an 1065, Bilon officier de la cour de Gerard Duc de Lorraine et qu’il dressa une chapelle en l’honneur de S. Barthelemy, sur les bords du lac, appelé alors Longue-mer et qui est la source de la rivière de Vologne. Ce courtisant pénitent, ou les peuples d’alentour, auraient-ils changé le nom de ce lac, pour éterniser la mémoire du Duc ?
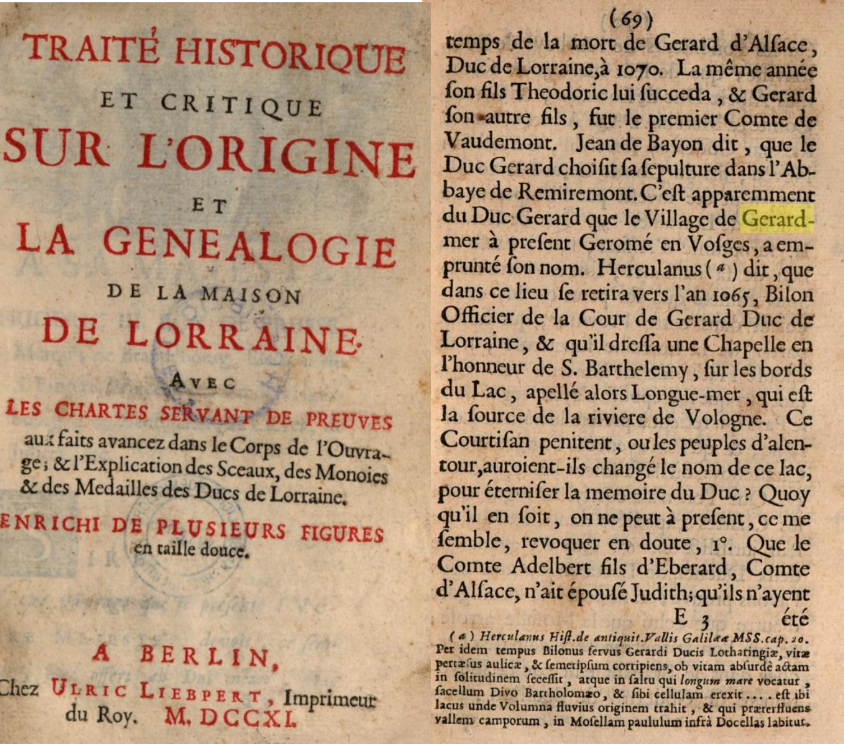
Extrait du Traité de Charles-Louis Hugo d'Étival
Et en 1712, le P. Benoît de Toul corrige le P. Hugo et écrit12 :
J’ai cru autrefois que le village de Gérardmer empruntait son nom au Duc Gérard, mais après plusieurs recherches que j’ai fait, pour l’éclaircissement de l’histoire de Toul et de Metz à laquelle je m’applique actuellement, je dis à présent que le Duc Gérard, suivi de Bilon, l’un de ses officiers, assista à la translation de l’évêque Saint Gérard faite à Toul le 22 octobre 1051. Cet officier touché de la sainteté de nos cérémonies et des miracles que le Bon Dieu fit paraître sur le tombeau de ce saint, et qui ont été écrits par un auteur contemporain, se retira dans les Vosges et fit bâtir une chapelle en l’honneur de Saint Gérard et de Saint Barthélémy, laquelle, à cause des biens qu’il y annexa, fut érigée en bénéfice dans l’église paroissiale ; dont ces deux saints devinrent les patrons et donnèrent lieu d’appeler les habitations proches du lac : Gerardme, sancti gerardi mare.
On saluera la tentative du P. Benoît de fournir à l’appui de son propos deux « preuves », à l’image de la rigueur habituelle qui le caractérisait (d’après ses commentateurs) mais aussi sans doute motivé par le fait de pouvoir à peu de frais contredire le P. Hugo. Néanmoins, si ces documents sont deux titres attestés des chanoinesses de Remiremont datant de 1449 et 1455, leur portée est très faible. Pour reprendre le commentaire qu’en fait M. Arthur Benoît (qui reproduit les textes en question dans son article), le premier prouve seulement qu’une chapelle existait à Longemer et dédié au deux saints Gérard et Barthélémy, et pour le second la chapelle ne porte plus que le patronage de Barthélémy.
À l’image de cette controverse, la recherche de l’attribution du patronyme a eu une postérité plutôt riche. L’essentiel des études s’accordent au moins sur un point : il ne s’agit que d’avis et d’opinions qui n’ont jamais été solidement étayés par des écrits tangibles. Les historiens du XVIIIe siècle avaient donc cette lourde charge de rechercher les titres, chartes et patentes qui auraient pu, une fois pour toute, résoudre cette question… en vain.
Les cartographes eux mêmes s’y perdaient depuis longtemps. Par exemple, Thierry Alix, président de la Chambre des Comptes du Duché de Lorraine, fait élaborer la carte des Hautes Chaumes entre 1575 et 1578. On y trace parfaitement les trois lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer, mais on attribue au village au bord du premier le nom de Saint Barthélémy (c’est le patronage attesté administrativement et non le nom vernaculaire qui l’a emporté)13.

Cartes des Hautes Chaumes, par T. Alix
Pourquoi une tour Gérard d’Alsace à Gérardmer ?
Les archives des Vosges furent fouillées à maintes reprises à la recherche de tout indice permettant d’attribuer à Gérardmer le patronyme de Gérard d’Alsace. Les auteurs régionaux avaient à leur disposition tout l’héritage des abbayes, à commencer par la chronique de Richer de (l’abbaye de) Senones (mort en 1266), l’histoire de Jean Herquel (Herculanus) chanoine de Saint-Dié (mort en 1572), les écrits de Jean Ruyr chanoine de Saint-Dié (1560-1645), les nombreux textes de Augustin (Dom) Calmet moine de Senones (1672-1757), les histoires de P. Benoît Picart de Toul (1663-1720), les écrits de Charles-Louis Hugo d’Étival (1667-1739), et la liste est longue.
En fin de compte, autant l’histoire de Bilon à Longemer trouve ses origines dans des textes du clergé forts anciens et fait l’objet de débats au détour desquels on s’interroge effectivement sur le patronyme de Gérardmer14, autant nous ne trouvons aucune mention claire du prétendu château de Gérard d’Alsace à Gérardmer.
Pour comprendre comment on en vint à supposer l’existence d’un tel édifice, il faut attendre le XIXe siècle et l’étude d’un médecin amateur d’histoire, pionner du genre qui occupera longuement la bourgeoisie locale férue d’histoire régionale. Il s’agit du docteur Jean-Baptiste Jacquot qui publia à Strasbourg sa thèse de médecine en 1826, assortie d’une notice historique sur Gérardmer15. C’est dans cette notice que l’on trouve pour la première fois dans la littérature régionale la mention d’un château ducal à Gérardmer.
Jean-Baptiste Jacquot avait déniché aux archives un texte du moine bénédictin champenois Dom (Thierry) Ruinart, au titre d’un récit de voyage à la toute fin du XVIIe siècle, durant lequel il était de passage dans les Vosges : le Voyage d’Alsace et de Lorraine effectué en 1696 et publié à titre posthume en 172416.
Notons toutefois : cette chronique de Dom Ruinart est fort connue depuis longue date des alsaciens, et sa première traduction en français fut publiée en 1829 à Strasbourg aussi17. C’est sans doute la raison pour laquelle J.-B. Jacquot s’est attardé sur ce document, facilement identifiable.
En lisant le texte en latin, J.-B. Jacquot, trouve un passage édifiant et selon lui de nature à éclairer la question du nom de Gérardmer. Dom Ruinart aurait mentionné le « vieux château (castellum) des ducs de Lorraine » rencontré au moment de franchir la Vologne « qui, réunie au ruisseau qui coule du lac de Gérardmer… Au sommet de la montagne qui domine cette rivière… ».
La traduction est incomplète mais pour J.-B. Jacquot, cela ne fait aucun doute : il s’agit de cette propriété du duc Gérard d’Alsace que Dom Ruinart, de passage à Gérardmer, aurait aperçu et mentionnée dans son compte-rendu. Un tel château serait situé dans les environs où le ruisseau de Gérardmer rencontre la Vologne, c’est-à-dire… à Gérardmer même. Le temps en aurait simplement effacé les traces.
Trop rapide, trop hâtif ? les lecteurs qui le suivront sur ce point ne reviendront finalement jamais au texte source de Dom Ruinart. Si bien qu’on a longtemps tenue pour acquise l’affirmation de J.-B. Jacquot (sauf dans les publications des différentes sociétés intellectuelles Lorraines et Vosgiennes qui mentionnent toujours la tradition). Il nous faut donc aller voir le texte de Dom Ruinart en entier.
Dom Ruinart, aventurier mal compris
On possède de Dom Ruinart plusieurs écrits consultables sur le site Gallica de la BNF. Le plus célèbre d’entre eux pour les études régionales reste le Voyage en Alsace traduit du latin par Jaques Matter en 1829 mais qui ne contient qu’une partie seulement du récit car il arrête la traduction au moment du retour en Lorraine au col de Bussang. LeVoyage d’Alsace et de Lorraine complet, lui, est paru en 1724 dans le recueil des Oeuvres posthumes de Dom Jean Mabillon et Dom Thierry Ruinart, Tome 3. Louis Jouve en a proposé une traduction exhaustive et plus moderne en 188118.
Dans la pure tradition du voyage d’étude qui fit le rayonnement des intellectuels européens à travers toute l’époque médiévale et bien au-delà, Dom Ruinart se lance lui aussi en 1696 dans un périple qui le mène de Paris jusqu’en Lorraine en passant par sa région champenoise natale, avec une itinérance importante en Alsace. Il fait halte d’un monastère à l’autre et lors de ses séjours, il parcours les environs visitant divers établissements, églises, chapelles et autres édifices d’intérêt. À défaut, il les cite et tâche d’en établir l’historique. Pour une compréhension contemporaine nous pouvons mentionner les grandes étapes : Paris - Lagny - Meaux - Reuil - Orbais l’Abbaye - Sainte-Menehould - Verdun - Toul - Nancy - Lunéville - Baccarat - Moyenmoutier - Senones - (Nieder-)Haslach - Molsheim - Marmoutier - Marlenheim - Wangen - Saverne - Strasbourg - Illkirch - Sélestat - Colmar - Munster - Soultzbach - Murbach - Guebwiller - Bussang - Remiremont - Champ-le-Duc - Bruyères - Moyenmoutier - Baccarat - Nancy - Pont-à-Mousson - Metz - Toul - Commercy - Verdun - Châlons - Reims - Lagny - Paris.
La lecture de ce récit est passionnante tant il recèle de nombreuses informations sur l’art, les usages monastiques et les connaissances en cette fin du XVIIe siècle. Il recèle aussi de haut faits. On notera en particulier le passage dangereux des crêtes vosgiennes entre Moyenmoutier et Haslach. Sur le retour en Lorraine, la journée du 2 octobre 1696 qui nous intéresse ici n’est pas aussi spectaculaire même si nous pouvons saluer l’endurance certaine des voyageurs qui entreprennent ce jour-là un périple d’environ 62 kilomètres à cheval.
Venant d’Alsace, via Guebwiller, après avoir franchi le Col de Bussang et séjourné quelques jours chez les chanoinesses de Remiremont, Dom Ruinart entreprend un trajet jusque Moyenmoutier. C’est dans l’extrait qui va suivre que J.-B. Jacquot a cru voir mentionné l’existence d’un château du Duc de Lorraine à Gérardmer. Or, il n’en est rien. Pour comprendre son erreur, il nous faut lire le texte et compléter par quelques informations géographiques et historiques. Toute l’interprétation réside dans la possibilité de retracer exactement le parcours sur la base du récit19 :
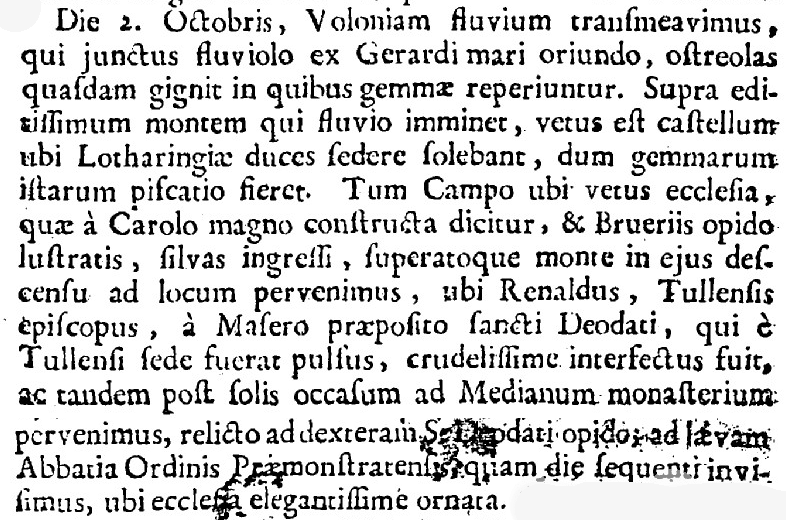
Extrait du récit de Dom Ruinart en 1696
Le 2 octobre, nous traversâmes la Vologne, qui, réunie au ruisseau sorti du lac de Gérardmer, nourrit de petites huîtres renfermant des perles. Sur le sommet de la montagne qui domine la rivière, se dresse le vieux château qu’habitaient les ducs de Lorraine, quand ils faisaient pêcher des perles. De là nous allâmes à Champ, remarquable par son ancienne Église, dont on attribue la construction à Charlemagne, et après avoir traversé Bruyères, nous entrâmes dans les forêts. Nous franchîmes la montagne au bas de laquelle Renaud, évêque de Toul, fut assassiné avec une cruauté inouïe par Maherus, prévôt de Saint-Dié, qui avait été chassé du siège épiscopal de Toul. Le soleil venait de se coucher quand nous arrivâmes à Moyenmoutier, laissant à droite la ville de Saint-Dié et à gauche l’abbaye de l’ordre des prémontrés, que nous visitâmes le landemain20.
À l’énoncé des lieux par Dom Ruinart, et sans avoir une idée précise de la géographie vosgienne, le fait de mentionner un ruisseau affluent de la Vologne et venant de Gérardmer peut induire en erreur et situer l’action (là où Dom Ruinart fanchi la Vologne) au Nord-ouest de Gérardmer, dans la vallée de Kichompré, à l’endroit où la Jamagne venant du lac de Gérardmer se jette dans la Vologne provenant, elle, du lac de Longemer.
Cependant, si nous nous en tenions à ce seul énoncé (et le texte renferme bien d’autres informations), il serait bien étonnant depuis ce lieu d’y voir une montagne dominante plus que les autres où serait situé un château ou même des ruines. L’encaissement des lieux ne permet pas d’identifier un sommet plus qu’un autre et, on en conviendra, le lieu lui-même est déjà fort éloigné du bourg de Gérardmer, qui plus est du centre où la chapelle Saint-Barthélémy est censée recouvrir les ruines de la soit-disant tour de Gérard d’Alsace… qui ne serait donc pas située sur une montagne, contrairement à ce que dit le texte, donc… on en perd son latin21.
Par ailleurs, en supposant que le trajet de Remiremont à Champ(-Le-Duc) et Bruyères passe par Gérardmer, il faut comprendre que Dom Ruinart préfère de loin les chemins les plus rapides, autrement dit, aménagés ou les plus empruntés (la leçon subie du côté de la vallée de la Bruche en Alsace lui aura appris cela). Donc le trajet depuis Remiremont devrait nécessairement passer par le Col de Sapois, qui est la route principale (on ne remonte pas à l’époque la Vallée de Cleurie même s’il devait bien y avoir quelques sentiers jusqu’au Tholy pour rejoindre le chemin de Gérardmer provenant d’Arches).
Décidément, Dom Ruinart n’était pas homme à franchir les montagnes sur des chemins difficiles alors que l’objectif du voyage est de rejoindre Moyenmoutier en se contentant, la majeure partie du trajet, de suivre les fonds de vallées. Quant à visiter Gérardmer… nous sommes en 1696 et l’attrait touristique des lieux n’était pas aussi irrésistible qu’aujourd’hui.
L’hypothèse du trajet via Gérardmer doit définitivement être abandonnée à l’énoncé des autres indices.
Le premier : les huîtres perlières de la Vologne. Si Dom Ruinart mentionne Gérardmer c’est par érudition afin de préciser que la Vologne est une rivière de montagne bien particulière : ses affluents lui apportent divers éléments enrichissants qui permettent la culture de molusques, de grandes moules perlières22. Cette particularité zoologique se retrouve dans d’autres vallées mais les bords de la Vologne avaient généré une activité économique suffisante pour que les Ducs de Lorraine y trouvent l’intérêt d’y établir un château servant de comptoir dédié à cette activité23. On s’accorde pour délimiter la zone où l’on rencontre le plus souvent ces molusques entre la zone d’affluence du Neuné près de Laveline-devant-Bruyères et le village de Jarménil, là où la Vologne se jette dans la Moselle.
Quant au château, il s’agit de Château-Sur-Perles situé entre Docelles et Cheniménil. La fondation du château par le duché de Lorraine est attestée. En effet, l’activité perlière dans cette région était clairement sous la responsabilité (et le profit) du duché de Lorraine ainsi qu’en témoignent les livres de comptes jusqu’à une époque tardive. Les Archives de Meurthe-et-Moselle tiennent le registre des lettres patentes de René II, duc de Lorraine (1473-1508). Elles recensent à Cheniménil l’autorisation d’y construire un château en 147424.
Ceci nous permet d’affirmer que Dom Ruinart et ses compagnons franchissent la Vologne juste avant Arches en venant de Remiremont, à l’emplacement de l’actuel village de Jarménil, avant de remonter la rivière où ils aperçoivent très peu de temps après à Cheniménil le Château des ducs de Lorraine fondé par René II.
Le second indice concerne le village de Champ, aujourd’hui nommé Champ-Le-Duc25 et le passage par Bruyères. Cette dernière ville figure à l’époque parmi les places de marché les plus actives. C’est par Bruyères que convergent de nombreux chemins, à cheval entre différentes prévôtés (Arches et Saint-Dié surtout). Toujours est-il qu’après avoir aperçu le château de Cheniménil, le chemin est tout tracé vers Bruyères et, de là par le massif forestier, un passage via le Col du Haut-Jacques pour redescendre ensuite au pied du massif de la Madeleine, là où Matthieu de Lorraine, alias Maherus, tendit une ambuscade funeste à Renaud de Senlis en 1217 (le château de Maherus, ou château de Clermont, se situait au lieu-dit la Chaise du Roi).
C’est une étape difficile pour Dom Ruinart et ses accompagnants : pas moins de 62 kilomètres séparent Remiremont de Moyenmoutier par les chemins les plus directs passant (pour reprendre des noms indentifiables aujourd’hui) par Jarménil, Cheniménil, Lépange, Champ-le-Duc, Bruyères, le Col du Haut-Jacques, Saint-dié, Étival (abbaye des chanoines de l’ordre de Prémontré), Moyenmoutier. On peut estimer un départ de grand matin pour arriver après la tombée de la nuit, tout en faisant une halte restauratrice à Champ-Le-Duc, soit à mi-chemin.
On peut voir sur cette carte le trajet tel que je l’ai estimé au regard des éléments du récit.
Pour se faire une idée de la représentation cartographique de l’époque, on peut aussi se reporter à cette carte du diocèse de Toul, par Guillaume De l’Isle, 1707, composée à l’occasion de la publication de l'Histoire ecclésiastique du diocèse par P. Benoît de Toul.
Conclusion
Il n’y a jamais eu de château ou de tour construite à l’initiative du duc Gérard d’Alsace à Gérardmer. De manière générale, aucune mention ultérieure à son règne dans les livres de patentes n’autorise la construction d’un château à Gérardmer sous l’autorité du duché de Lorraine. Encore moins sous l’autorité des chanoinesses de Remiremont. Les preuves archéologiques et archivistiques d’une telle construction sont inexistantes (jusqu’à aujourd’hui).
À rebours de la coutume locale, on peut même affirmer qu’aucun auteur n’a pouvé l’existence une telle construction. Les précautions d’usage n’ont cependant pas toujours été prises… tout en confrontant sans cesse la tradition du souvenir commémoratif de Gérard d’Alsace à la réalité des faits.
Nous avons montré qu’une erreur d’interprétation du texte de Dom Ruinart était à la source d’une méprise qui fit long feu. C’est la raison pour laquelle les plus rigoureux à l’instar d’Henri Lepage ou Louis Géhin se sont toujours référé à la tradition locale : il était important en effet de préciser cette particularité culturelle sans jamais l’affirmer comme une réalité. En revanche la répétition de cette tradition relatée dans les publications a provoqué certainement un effet d’amplification auquel a fini par succomber Marc Georgel qui affirma que « chacun sait maintenant (depuis les nombreux ouvrages qui traitent de Gérardmer) que le duc Gérard se fit construire une tour »…
Mais cette fameuse tradition locale est-elle pour autant dépréciée ? C’est une question que nous ne parviendrons pas à résoudre car elle est sans objet. Après tout, la légende demeure parfaitement logique. Les ducs de Lorraine ont contribué plus que significativement à la dynamique économique des Hautes Vosges et toutes les affaires juridiques de Gérardmer furent longtemps réglées par leur représentants ou directement à la cour du Duché. Si l’un ou l’autre Gérard, illustre ou parfaitement inconnu, a fini par donner son nom à Gérardmer, la tradition a construit une histoire autour de ce nom, une histoire qui a rassemblé la communauté villageoise autour d’une identité commune, celle de l’appartenance à la Lorraine. Cette construction permettait aussi une certaine indépendance des montagnards, loin des centres de pouvoir et des institutions, surtout avant le XVIIe siècle. Sans marque physique clairement identifiée sur le sol gérômois, les habitants pouvaient toujours se réclamer de l’autorité ducale… ou pas, selon l’intérêt du moment. Et cela est sans doute bien plus important qu’une vieille tour en ruine.

Carte du diocèse de Toul, 1707
Notes
-
Voir Pascal Claude, « Le mystère de la tour Gérard d’Alsace », dans Daniel Voinson, La chapelle du Calvaire, Gérardmer, 2013, p. 11-13. ↩︎
-
De la maison d’Alsace, alors que la Haute Lorraine est inféodée au Saint Empire Germanique. ↩︎
-
Le nom de Gérardmer est attesté par écrit pour la première fois en 1285 dans cet acte d’attribution de fief par le Duc de Lorraine Ferry III, soit 245 ans après que Gérard d’Alsace ai reçu le titre de Duc de Lorraine. Si l’on se réfère à l’acte de Ferry III, retranscrit in extenso par Louis Géhin, c’est bien une Ville Neuve que Ferry III fonde : non que que le hameau n’existât point encore à cette époque mais la réalité administrative est alors officielle et en aucun cas l’acte mentionne l’existence d’un édifice ducal préexistant. Par ailleurs, dans cet acte de Ferry III, c’est la forme Geramer qui est employée, sans le r : l’interprétation de ce fait peut varier, la première consiste à accuser la faute du copiste, la seconde consiste à se demander si le patronyme Gérard n’était pas une information négligeable à cette époque au point que même dans un acte officiel de l’autorité ducale on puisse en oublier cette référence en écrivant indistinctement Geramer à la place de Gerarmer. Le hameau n’est pas nouvellement habité, il est déjà ancien, parfaitement identifié par les parties, et se distingue bien de Longemer. Ceci aura son importance dans la suite de notre propos. Voir Louis Géhin, Gérardmer à travers les âges, 1877. ↩︎
-
Henri Lepage « Notice Historique et Descriptive de Gérardmer », dans Annales de la société d’émulation du département des Vosges, 1877, pp.130-232. ↩︎
-
Louis Géhin, Gérardmer à travers les âges. Histoire complète de Gérardmer depuis ses origines jusqu’au commencement du XIX^e siècle, Extrait du Bulletin de la société philomatique vosgienne, Saint Dié, Impr. Hubert. 1893. ↩︎
-
Nous préciserons plus loin : le suffixe en mé peut aussi bien provenir du latin mansus que de mare. La pronconciation du suffixe, à la différence de Longemère ou Retournemère force à retenir la première solution… sauf que le patois prononce indifféremment mer : meix, moix, mé, mère. D’autres exemples sont troublants : selon P. Marichal, on trouve à partir de 1285 plusieurs orthographes pour Gérardmer tels Geramer, Gerameix, ou Geroltsee, Giraulmoix… Alors : lac ou maison ? la question n’est pas tranchée. Voir Paul Marichal, Dictionnaire topographique du département des Vosges, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, Paris : Imprimerie nationale, 1941. ↩︎
-
En 1707, dans son Histoire Ecclesiastique de Toul le Père Benoit mentionne que la Vologne prend sa source au lac de Gérardmer. Il s’agit en fait du lac de Longemer (et en réalité au Haut-Chitelet) : l’erreur sur place n’est pas possible étant donné que l’affluent venant du lac de Gérardmer, la Jamagne, a un débit bien moindre. D’ailleurs en 1696, Dom Ruinart la mentionne sans la nommer comme nous le verrons plus loin. Voir Père Benoit de Toul, Histoire ecclesiastique et politique de la Ville et du Diocèse de Toul, Toul, A. Laurent Imprimeur, 1707, p. 54 (URL Archive.org). ↩︎
-
Sur ce sujet, voir Albert Denis, « Le R. P. Benoît Picart. Historien de Toul (1663-1720) », Bulletin de la Société Lorraine des Études Locales dans l’enseignement public, vol. 2, num. 5, 1930, p. 10-11. URL ↩︎
-
Charles-Louis Hugo, Traité historique et critique sur l’origine et la généalogie de la maison de Lorraine avec les chartes servant de preuves, Berlin, Ulric Liebpert impr., 1711. Voir Arthur Benoit « Les origines de Gérardmer, d’après le P. Benoît Picart de Toul », Annales de la Société d’Émulation du Département des Vosges, Épinal, Collot, 1878, p. 249-252. URL – Gallica BNF (p. 250). ↩︎
-
Il s’agit de Jean Herquel (Herculanus) chanoine de Saint-Dié, mort en 1572. ↩︎
-
P. Benoît Picart, Supplément à l’Histoire de la Maison de Lorraine, avec des remarques sur le Traité historique et critique de l’origine et la généalogie de cette illustre maison, Toul, Rollin, 1712, p. 46. ↩︎
-
Voir la carte sur le site des Archives de Meurthe et Moselle. ↩︎
-
Voir Louis-Antoine-Nicolas Richard, dit Richard des Vosges, « Notice sur un squelette retrouvé… », reproduite dans le Bulletin de la société philomatique vosgienne, vol. 21, 1895-96, p. 53 sq. ↩︎
-
Jean-Baptiste Jacquot, Essai de topographie physique et médicale du canton de Gérardmer. Précédé d’une notice historique, (dissertation à la faculté de médecine de Strasbourg, pour le grade de docteur en médecine, Strasbourg, impr. Levrault, 1826. ↩︎
-
Voir Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, tome III. Cocnernant la vie d’Urbain II, les Preuves et le Voyage d’Alsace et de Lorraine, par D. T. Ruinart, Paris, Vincent Thuillier éditeur, 1724, URL Gallica ↩︎
-
Il ne s’agissait alors que d’une partie du récit de voyage, celle concernant l’Alsace. Jacques Matter (trad.), Voyage littéraire en Alsace par Dom Ruinart, Strasbourg, Levrault, 1829. ↩︎
-
Louis Jouve, Voyages anciens et modernes dans les Vosges, 1500-1870, Epinal, Durand et fils, 1881 URL Gallica. ↩︎
-
Le texte original de Dom Ruinart dans le recueil des oeuvres posthumes se trouve sur le site Gallica de la BNF (le lien ci-contre renvoie à la page du passage dont il est question). Pour la traduction, voir Louis Jouve, op. cit.. ↩︎
-
Louis Jouve oublie de traduire : l’église du monastère est merveilleusement décorée. ↩︎
-
Oui, celle-là, elle était facile. ↩︎
-
On notera que récemment, en 2018, la société d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar a alerté les autorités à propos de la protection des moules perlières de la Vologne et du massif des Vosges en général. Il ne resterait que deux espèces en voie d’extinction. ↩︎
-
Chabrol (Marie), «Les perles de la Vologne, trésor des ducs de Lorraine», Le Pays lorrain, Vol. 94, num. 2, 2013, pp. 115-122. Pour une étude plus ancienne et néanmoins exhaustive, voir D. A. Godron, « Les Perles de la Vologne et le Château-sur-Perle », Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1869-1870, p. 10-30. URL Gallica. ↩︎
-
Voir le registre par nom de lieux à cette adresse, rechercher « Cheniménil ». ↩︎
-
Champ se rapporte à la ville de Champ-le-Duc ainsi qu’elle éteit dénomée depuis les chroniques racontant la vie de Charlemagne. Voir [histoire ecclesiastique… p. 85 du PDF] ↩︎
11.11.2021 à 01:00
Dernières news
Le temps passe et il fini par manquer. J’ai délaissé ce blog depuis la rentrée mais c’est pour livrer encore plus de lectures ! En vrac, voici quelques activités qui pourraient vous intéresser.
Publications
Commençons d’abord par les publications. Voici deux nouvelles références.
Un article court mais que j’ai voulu un peu percutant :
Christophe Masutti, « Encore une autre approche du capitalisme de surveillance », La Revue Européenne des Médias et du Numérique, num. 59.
Beaucoup plus long, et qui complète mon ouvrage sur la question de l’histoire du courtage de données :
Christophe Masutti, « En passant par l’Arkansas. Ordinateurs, politique et marketing au tournant des années 1970 », Zilsel – Science, Technique, Société, num. 9.
Ces textes seront versés dans HAL-SHS dans quelques temps.
Interventions
A part cela, je mentionne deux enregistrements.
Le premier à Radio Libertaire où j’ai eu le plaisir d’être interviewé par Mariama dans l’émission Pas de Quartier, du groupe Louise Michel, le 2 novembre 2021. On peut réécouter l’émission ici.
Le second est une conférence débat qui s’est tenue à Bruxelles au Festival des Libertés où j’ai eu l’honneur d’être invité avec Olivier Tesquet. Un débat organisé et animé par Julien Chanet. On peut l’écouter depuis le site ici.
Et une annonce.
Enfin, j’annonce mon intervention prochaine auprès des Amis du Monde Diplomatique dans le cadre de CitéPhilo à Lille, où j’ai le plaisir d’avoir été invité par Bertrand Bocquet le 22 novembre prochain. Plus d’information ici.
À bientôt !
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Blogs Mediapart
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD