Vigie de l’Anthropocène à l’École urbaine de Lyon. Un œil sur le Capitalocène & le Plantationocène, mon 3è œil sur le Patriarcalocène.
Texte intégral (1471 mots)
Don’t look up
🎧 Cliquez ici pour écouter cette chronique
Retrouvez les chroniques anthropocènes ainsi que les lectures sur toutes les plateformes de podcast: “La revue de presse A°”, “Chroniques anthropocènes” et “Lectures anthropocènes” sur Radio Anthropocène.
L’été dernier, alors que je contemplais le ciel étoilé, j’ai été prise de vertige lorsque les étoiles se sont soudain mises à danser. Non, je n’avais pris aucune substance licite ou illicite ! J’ai vu, de mes yeux vu, une vingtaine d’étoiles peut-être, qui se déplaçaient de manière synchronique, toutes dans la même direction, ni trop vite ni trop lentement. J’ai ressenti une angoisse vertigineuse, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Sauf que là c’est le ciel qui se dérobait au-dessus de ma tête ! Pendant un court instant, j’ai compris la sidération d’une dinosaure voyant l’astéroïde foncer sur elle (même si une étude publiée fin septembre dans Science retient plutôt l’hypothèse d’un déclin déjà bien entamé de nos reptiles géants préférés, 300 000 ans avant l’impact de l’astéroïde, en raison du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre émis par une activité volcanique très intense dans les trapps du Deccan, du côté de l’Inde actuelle).
Bref, revenons à mes étoiles qui dansent. L’expérience troublante a duré à peine plus d’une minute mais elle a proprement renversé ma représentation du monde. Comme si j’avais perdu le Nord, ou plutôt l’Etoile du Nord. Ce moment infime a fait basculer ma boussole interne en me rappelant à ma condition terrestre, c’est-à-dire une créature errant sans véritable raison sur un caillou habité qui tourne, suspendu dans la nuit intersidérale.

Heureusement Saint Google a su mettre fin instantanément à mes délires métaphysiques. Je venais simplement d’être témoin du déploiement par un fournisseur d’accès à Internet d’un train de satellites de télécommunications sur une orbite terrestre basse. Cette orbite basse qui offre l’avantage de réduire le temps de latence par rapport à l’orbite géostationnaire. Et alors, me direz-vous, à quoi ça sert ? Eh bien c’est primordial, notamment quand on veut regarder, n’importe où, n’importe quand et en toute fluidité, une série sur une plateforme de streaming. Et comme ce divertissement est devenu un besoin vital pour des centaines de millions d’abonné·es à travers le monde, les fournisseurs d’accès ont prévu de lancer dans les prochaines années plus de 500 000 satellites, selon un article paru dans Nature début octobre. Un article de Reporterre publié cette semaine relève le caractère vertigineux de ce chiffre, d’autant plus si on le met « en perspective avec l’histoire de l’aérospatial : entre le lancement du premier satellite artificiel, Spoutnik 1, en 1957, et 2017 — soit avant l’arrivée des premiers satellites Starlink –, l’humanité avait envoyé moins de 8000 objets dans l’espace, selon le décompte du Bureau des affaires spatiales des Nations unies ».
On ne connaît pas vraiment les conséquences de cette densification de l’orbite basse, elles ne sont pas encore toutes évaluées. Néanmoins une étude parue dans Nature en mai 2021 pointe d’ores et déjà 3 risques. Tout d’abord, la libération dans la haute atmosphère de grandes quantités d’aluminium, matériau qui compose principalement les satellites. En effet, la combustion des satellites en fin de vie lors de leur ré-entrée dans l’atmosphère dégage de l’oxyde d’aluminium qui menace directement la couche d’ozone, cette couche protectrice contre les rayons ultraviolets du soleil, comme l’indique l’archéologue de l’espace Alice Gorman.
2ème risque : la pollution lumineuse. La disparition de la nuit à cause de l’éclairage urbain est pointée du doigt depuis quelques années, notamment comme une menace pour la biodiversité. Avec ce qu’on appelle les « constellations de satellites », c’est le travail des scientifiques observant l’Univers qui est perturbé. En effet, de nouveaux satellites brillent plus intensément que les étoiles et rendent l’observation astronomique impossible. Une discussion est en cours avec les fabricants de satellites pour qu’ils réduisent leur luminosité en utilisant des matériaux antireflets.
Enfin 3ème risque, et pas des moindres : la prolifération des débris spatiaux — les lanceurs des fusées, les satellites inactifs ou encore les déchets provenant de l’explosion accidentelle ou de la collision d’engins spatiaux. En septembre 2023, l’Agence spatiale européenne recensait 36 500 débris spatiaux de plus de 10 cm, un million de débris mesurant entre 1 et 10 cm et 130 millions mesurant entre 1 mm et 1 cm. Ça paraît assez inoffensif un débris de 1 millimètre, mais rappelez-vous la scène inaugurale du film Gravity dans laquelle les deux protagonistes sont littéralement bombardés par une salve de déchets spatiaux. Interrogé par Le Monde, Christophe Bonnal, le président du comité débris orbitaux de l’Académie internationale d’astronautique, explique qu’« un objet en aluminium d’un millimètre de rayon, c’est l’équivalent d’une boule de bowling lancée à 100 km/h. A un centimètre, c’est une Renault Laguna roulant à 130 km/h et, à 10 centimètres, c’est une charge de 240 kg de TNT ». Avec la centaine de millions de déchets spatiaux orbitant autour de la Terre, le risque de collision est élevé et menace de déclencher une réaction en chaîne puisque chaque nouvelle collision ajoute d’innombrables débris et donc de nouveaux risques de collision.
Cette situation souligne la nécessité d’une régulation. Les pays du G7 se sont ainsi engagés en juin 2021 à « utiliser l’espace de manière sécuritaire et soutenable » en reconnaissant le « danger croissant des débris spatiaux et de la saturation de l’orbite ». Et Le Monde rapporte que le 2 octobre dernier, la Commission américaine des communications a infligé pour la première fois « une amende de 150 000 dollars à Dish Network pour avoir abandonné l’épave d’un satellite sur une orbite jugée dangereuse ».
Pourtant, un article publié en juin 2021 dans Science, Technology, & Human Values rappelle l’intérêt très récent que nous portons aux débris spatiaux, « un sous-produit autrefois accepté du progrès scientifique et technologique, des intérêts économiques et de la géopolitique ». La prise de conscience du risque qu’ils représentent coïncide, à vrai dire, avec le regain d’intérêt pour l’exploration spatiale interplanétaire. Ces débris spatiaux révèlent ainsi la dépendance de nos « techno-sociétés » à des infrastructures spatiales inextricablement liées aux infrastructures terrestres. Pour le dire plus simplement, maintenant, quand je regarde les étoiles, une question me turlupine : qui va descendre les poubelles ?
Chronique anthropocène - 11 octobre 2023 was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Texte intégral (1585 mots)
Le droit de respirer
🎧 Cliquez ici pour écouter cette chronique
Retrouvez les chroniques anthropocènes ainsi que les lectures sur toutes les plateformes de podcast: “La revue de presse A°”, “Chroniques anthropocènes” et “Lectures anthropocènes” sur Radio Anthropocène.
En cet après-midi consacré à la créativité du droit dans l’anthropocène, j’ai envie de revenir à un droit élémentaire : le droit de respirer. Sur mon profil Twitter (enfin X quoi !), vous trouverez un poster produit par la NASA avec une esthétique savamment vintage qui met en scène un couple d’astronautes hétéros ayant déposé leur casque pour s’enlacer en contemplant un paysage de forêt terrestre. La scène surplombe le slogan : « La Terre, votre oasis dans l’espace, où l’air est gratuit et respirer est facile ». Il est vrai que les cyanobactéries ont été redoutablement efficaces il y a 2,5 milliards d’années pour libérer dans les océans du dioxygène par photosynthèse et provoquer ainsi « la grande oxygénation de l’atmosphère terrestre ». Mais c’était compter sans la prouesse autrement plus redoutable de notre espèce bipède dont le mode de vie a, en quelques décennies seulement, modifié la composition de l’atmosphère en émettant toujours plus de dioxyde de carbone (le fameux CO2). Alors que sa concentration oscillait entre 180 et 280 parties par million pendant des centaines de milliers d’années, il dépasse aujourd’hui les 425 ppm, soit une augmentation de plus de 42% depuis les débuts de la période industrielle. Et le plus inquiétant c’est que cette augmentation s’accélère, passant de 0,5 ppm par an il y a 50 ans à plus de 2 ppm par an sur la dernière décennie. Un phénomène qui va jusqu’à transformer notre état civil puisqu’on en vient à ne plus demander l’année de naissance d’une personne mais la quantité de CO2 dans l’atmosphère à sa naissance. Pour incarner cette accélération vertigineuse, laissez-moi vous présenter ma dynastie matrilinéaire qui débute en 1901 : mon arrière-grand-mère donc est née à 294 ppm, ma grand-mère à 305, ma mère à 312, moi à 332, tandis que mes enfants — qui n’ont que 2 ans d’écart — sont nés à 400 et 407 ppm.
Au-delà du dioxyde de carbone, la qualité de l’air que nous respirons est fortement compromise par des particules fines et du dioxyde d’azote, principalement issus de la combustion dans les moteurs, de l’abrasion des freins et des pneus et de la combustion de bois, de fioul et de gaz. Selon les chiffres publiés en 2016 par Santé Publique France, la pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurées chaque année. De nombreuses pathologies sont également associées à l’air que nous respirons, des maladies respiratoires et cardio-vasculaires, aux AVC et aux cancers en passant par les troubles du développement chez l’enfant, les maladies neurodégénératives — comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson –, le diabète de type 2 ou encore les troubles de la fertilité.
A celles et ceux qui croiraient encore que nous autres Terriens et Terriennes respirons tous et toutes le même air, je poserai cette question : avez-vous déjà remarqué que dans la plupart des villes européennes, les quartiers pauvres se situent à l’Est ? Savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce qu’en Europe les vents dominants soufflent d’Ouest en Est. Une étude publiée en mai 2021 dans Journal of Political Economy montre qu’au début de l’époque industrielle, le vent soufflait ainsi généralement la pollution au charbon vers l’Est, incitant les plus fortunés à s’établir à l’Ouest des installations polluantes tandis que les terrains situés en plein courant d’air étaient les seuls abordables pour la classe ouvrière. Voilà comment la pollution de l’air a déterminé la morphologie même de nos villes modernes. Aujourd’hui encore, on ne respire pas le même air selon son statut social. Dans l’essai Pour une écologie pirate, paru début 2023 aux éditions La Découverte, la politologue Fatima Ouassak cite un rapport de 2021 publié par l’Unicef et le Réseau Action Climat « sur les liens entre pauvreté et vulnérabilité des enfants à la pollution de l’air. A Paris, les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d’un épisode de pollution que les habitants les plus riches ». Selon elle, « la pollution de l’air est une question de territoire, mais c’est aussi une question de classe et de race, notamment parce que les populations descendantes de l’immigration ouvrière et postcoloniale vivent concentrées dans les territoires les plus pollués, où l’exposition au bruit et à la chaleur est la plus forte, où l’alimentation est la plus industrielle et où l’accès aux soins est le plus discriminatoire ».
Et que dire de celles et ceux que nous autres les « gens-du-sur-place » appellons les « gens du voyage ». Dans son ouvrage Où sont les «gens du voyage»? Inventaire critique des aires d’accueil, paru en 2021 aux Editions du Commun, le juriste William Acker recense les aires d’accueil en France et dévoile leur fréquente proximité avec des zones à risque sanitaire ou écologique — centrale nucléaire, déchèterie, usine ou encore station d’épuration. Une situation qu’il résume ainsi : « Si tu ne trouves pas l’aire d’accueil, cherche la déchèterie ». Sur les 1 358 aires d’accueil répertoriées, plus de la moitié sont polluées. Pour le juriste, « contrairement aux aires d’accueil des camping-cars situées en bord de mer, ou des campings municipaux installés dans les zones touristiques, la localisation des aires d’accueil dans des terrains systématiquement relégués et donc souvent pollués est un choix de l’État et des collectivités publiques ».

I can’t breathe. J’arrive plus à respirer. Ce sont sans doute les dernières paroles d’Adama Traoré en 2016, de George Floyd en 2020 et de tant d’autres hommes perçus comme Noirs, comme non-Blancs ou comme non conformes à l’ordre dominant, tués par des policiers dans l’exercice de leur fonction en France, aux Etats-Unis et ailleurs. I can’t breathe, une expression devenue cri de ralliement contre les violences policières alors que le droit de respirer — le genre de droit qui ne devrait pouvoir être volé — est dénié à une partie de la population. I can’t breathe, le slogan de notre nouvelle ère ?
En avril 2020, alors qu’un virus s’attaquait à nos voies respiratoires, paraissait dans AOC — le quotidien d’idées en ligne –, un texte de l’historien et philosophe Achille Mbembe appelant à un « droit universel à la respiration », un droit inappropriable et fondamental pour le vivant dans son ensemble, c’est-à-dire « un droit originaire d’habitation de la Terre ». Dans un petit ouvrage qui vient de paraître chez Verdier et opportunément intitulé Respire, Marielle Macé postule que ce « droit universel à la respiration n’est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués ; non, c’est le droit à une vie respirable, c’est-à-dire désirable, une vie qui vaut la peine, une vie à laquelle tenir. C’est le droit d’attendre beaucoup de la vie : l’espoir de fraterniser dans la respiration, l’espoir de détoxiquer nos quotidiens et de respirer enfin avec les autres. Respirer avec, « conspirer » si l’on veut ».
Chronique anthropocène - 4 octobre 2023 was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Texte intégral (821 mots)
J’ai rassemblé ici les références que j’ai croisées au cours de ces 4 dernières années à veiller (sur) l’Anthropocène. J’ai tenté de rendre compte de l’ensemble des champs du savoir qui ont constitué notre démarche. Cette bibliographie est toute personnelle, mes choix sont donc éminemment contestables. Elle n’est pas exhaustive, bien entendu, et je vous invite à la compléter en partageant les références qui manquent sur l’Anthropocène, le changement global et tous les enjeux qu’ils soulèvent.
Bonnes lectures !
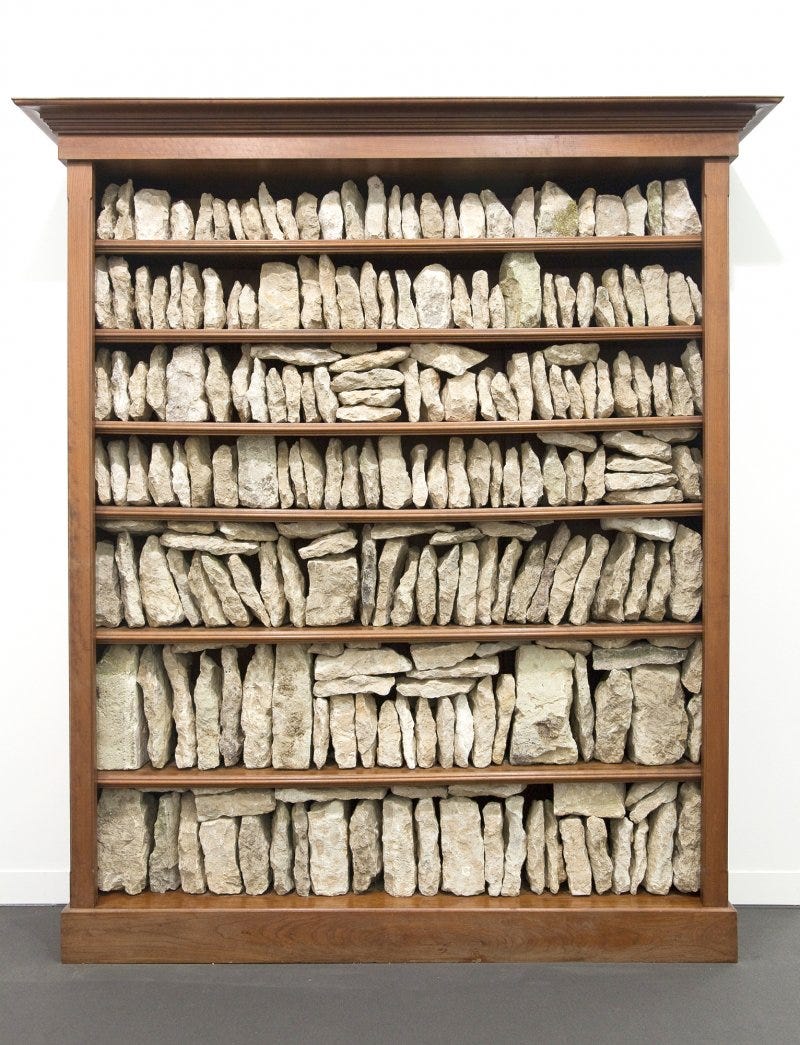
📢 Retrouvez également mes revues de presse radiophoniques, les veilles thématiques sur les limites à la croissance, l’eau, les nouveaux outils économiques et les sols urbains, la veille spéciale sur l’œuvre de Bruno Latour et des chroniques originales à écouter ou à lire.
⏯️ Régalez-vous avec les 6 cours publics 2023 (et les précédents) de l’Ecole urbaine de Lyon (en live ou en replay) et la Radio anthropocène (en live ou en replay) !
On se retrouve sur Twitter (enfin X quoi), LinkedIn et Instagram!
- AGRICULTURE & ALIMENTATION
- ARTS, DESIGN & CULTURE
- BD - ROMANS GRAPHIQUES
- BIODIVERSITÉ
- CLIMAT
- DROIT
- ÉCONOMIE
- ÉDUCATION
- ÉNERGIES & EXTRACTIVISMES
- ENJEUX POST & DÉCOLONIAUX
- GÉOGRAPHIE
- HISTOIRE
- JEUNESSE
- LITTÉRATURE
- NUMÉRIQUE & TECHNOLOGIE
- PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - IDÉES
- POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE
- SANTÉ
- SCIENCE
- SOCIÉTÉ
- URBAIN
LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023 was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Texte intégral (12779 mots)
LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023

De facto, « Les villes accueillantes » (n°16 | Février 2020).
Ce numéro dévoile la relation consubstantielle entre les mobilités et les villes comme asiles, refuges pour refonder des lieux et des communautés. La « ville accueillante » va au-delà d’une affaire de migration et intègre les notions de « vivre ensemble », de « ville inclusive » ou « interculturelle ». Avec : Pascal Dubourg Glatigny, historien ; Michel Agier, anthropologue ; Cyrille Hanappe, architecte ; Filippo Furri, anthropologue, et Thomas Lacroix, géographe ; Stéphanie Dadour, historienne de l’architecture.
Mouvements, « Vive les communes ! Des ronds-points au municipalisme » (n°101, La Découverte, mai 2020).
Le mouvement des Gilets jaunes a remis la question démocratique au cœur du débat public : les élections municipales peuvent-elles constituer un débouché aux aspirations à repenser le « local » comme un espace politique à investir ? Ce numéro propose une lecture des expérimentations qui se déroulent aux quatre coins du monde depuis des décennies, du municipalisme au communalisme, et qui dégagent d’autres façons d’envisager la répartition du pouvoir à l’échelle locale.
COLLECTIF, Désurbanisme. Détruire les villes avec poésie et subversion, fanzine de critique urbaine (2001–2006) (Editions Le monde à l’envers, 2022).
« Espace dominé et structuré par le Capital, la ville offre un terrain de lutte et de critique du capitalisme. Publié de 2001 à 2006, Désurbanisme est un fanzine d’amoureux des villes passionnés par leur destruction, une boite à outils mêlant pensées et expériences critiques dans laquelle la lutte peut puiser du combustible ».
COLLECTIF DROIT A LA VILLE DOUARNENEZ, Habiter une ville touristique. Une vue sur mer pour les précaires (Editions du Commun, 2023).
« Ouvrage inédit, qui s’attache à décrire les mécanismes de touristification des villes côtières, cet essai montre comment ceux-ci mettent au ban une partie importante et précarisée des populations locales. Par sa faculté à renouveler nos perceptions de l’habiter au sein des villes touristiques, et ce depuis la situation de celles et ceux qui en subissent les évolutions, ce texte constitue un outil important pour penser le droit à la ville, le droit au logement et le tourisme de manière générale ».
Matthieu ADAM, Emeline COMBY (dir.), Le Capital dans la cité. Une encyclopédie critique de la ville (Éditions Amsterdam, 2020).
Une encyclopédie qui propose des outils pour comprendre, penser et agir sur les transformations urbaines en cours : le capitalisme a transformé les politiques urbaines en « véhicule de logiques managériales et financières qui ont conduit à l’explosion des inégalités sociales et spatiales. Reconfigurées selon des critères d’attractivité, les villes sont transformées en objets marketing à valoriser, tandis que leurs populations précarisées semblent vouées à évoluer dans un espace public toujours plus restreint et aseptisé, au fil de ses privatisations successives ».
Matthieu ADAM, Nathalie ORTAR (dir.), Becoming Urban Cyclists: From Socialization to Skills (University of Chester Press, 2022).
« Devenir un cycliste urbain nécessite une diversité de compétences et de connaissances acquises grâce à différentes formes de socialisation ». Anthropologues, géographes, linguistes, sociologues et urbanistes analysent les pratiques cyclistes au regard des parcours de vie individuels et des inégalités sociales et de genre à travers l’usage de méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes et d’enquêtes de terrain menées en Australie, en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni « pour aider à comprendre les facteurs susceptibles de faciliter ou de freiner les pratiques cyclables urbaines ».
ADEME, Faire la ville dense, durable et désirable. Agir sur les formes urbaines pour répondre aux enjeux de l’étalement urbain (ADEME, 2022).
« Pour parvenir à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette à horizon 2050, « refaire la ville sur la ville » en favorisant la densification constitue un levier clé. Concilier densité des populations, des activités et des services, sous certaines conditions, en garantissant la qualité de vie des citoyens en première préoccupation, constitue une des réponses à la limitation de l’étalement urbain et aux enjeux de résilience de nos territoires. Ce guide illustre des leviers actionnables par les collectivités territoriales et les acteurs de l’aménagement ainsi que des exemples inspirants et de projets déjà déployés pour accompagner et poursuivre cette dynamique dans les territoires ».
Félix ADISSON, Sabine BARLES, Nathalie BLANC, Olivier COUTARD, Leïla FROUILLOU, Fanny RASSAT (dir.), Pour la recherche urbaine (CNRS éditions, 2020).
L’ouvrage collectif et pluridisciplinaire résulte des travaux des journées de prospective nationale de recherche urbaine pour identifier des chantiers de recherche dans ce domaine à 10 ans sur les villes des Nords et des Suds. « En articulant les dimensions sociales, écologiques, politiques et matérielles, les recherches actuelles apportent de nouvelles connaissances sur les théories et définitions de l’urbain, les populations urbaines et la production de leur cadre de vie ».
Peter S. ALAGONA, The Accidental Ecosystem. People and Wildlife in American Cities (University of California Press, 2022).
Un ouvrage qui explique pourquoi et comment les villes des États-Unis se sont remplies d’animaux sauvages jusqu’à en compter plus qu’à aucun autre moment au cours des 150 dernières années. « Pourquoi tant de villes — l’écosystème le plus artificiel et le plus dominé par l’humain de tous les écosystèmes de la Terre — se sont-elles enrichies en faune sauvage, alors que celle-ci a diminué dans la plupart des autres régions du monde ? Que signifie ce paradoxe pour les humains, la faune et la nature sur notre planète de plus en plus urbaine ? » Et comment créer des écosystèmes urbains dynamiques ?
Sylvain ALLEMAND, Demain, les villes ? Paroles de chercheuses et de chercheurs (Presses universitaires de Rennes, 2022). Photographies de Myr MURATET.
« Malgré l’expérience que l’humanité a faite du confinement dans le contexte de crise sanitaire, elle continuera très probablement à vivre dans des espaces urbains plus ou moins denses. Mais les villes seront-elles telles qu’on les imagine, avec leur centralité, la concentration des fonctions et leur périphérie ? Éléments de réponse dans cet ouvrage, organisé autour d’un glossaire et d’entretiens avec des chercheuses et des chercheurs de différents horizons disciplinaires, mais qui n’en partagent pas moins un point commun : ils œuvrent avec la nouvelle Université Gustave Eiffel, qui a vocation à contribuer à une meilleure connaissance des « villes de demain », de leurs défis et des manières d’y faire face ».
Charles ALTORFFER, Traité d’urbanisme enchanteur (Editions Libel, 2021).
Roman graphique pour réfléchir sur les villes de demain : « comment repenser l’architecture urbaine de façon plus collective ? Comment réinventer nos villes, et plus globalement l’habitat sur notre vieille planète Terre, face aux défis du changement climatique ? ».
Hillary ANGELO, How Green Became Good. Urbanized Nature and the Making of Cities and Citizens (University of Chicago Press, 2021).
La sociologue enquête sur le verdissement de la vallée de la Ruhr en Allemagne pour comprendre les origines et le sens de l’engouement pour les espaces verts urbains. Elle montre que les urbanistes ont longtemps pensé que la création d’espaces verts entraînerait un progrès social, l’introduction de la nature en ville étant supposée répondre à des changements sociaux pour transformer les citoyen·nes en habitant·es modèles de villes idéales. Elle conclut que la création d’espaces verts dépend plus de la façon dont nous imaginons la vie sociale que des bienfaits qu’ils procurent réellement.
Nadia ARAB, Yoan MIOT (dir.), La ville inoccupée. Enjeux et défis des espaces urbains vacants (Presses de l’Ecole Nationale Des Ponts et Chaussées, 2020).
Les sociologues et urbanistes proposent une étude transversale des espaces urbains vacants qui apparaissent comme un problème croissant dans un contexte de transition écologique imposant de plus en plus fortement une limitation de la consommation de ressources foncières. L’ouvrage analyse également les modalités de réactivation et de revalorisation de ces espaces sans usages, au-delà de l’urbanisme transitoire.
Mario Alejandro ARIZA, Disposable City: Miami’s Future on the Shores of Climate Catastrophe (Bold Type Books, 2020).
Le journaliste, résident de Miami, raconte l’histoire de la préparation de la ville à la montée du niveau de la mer qui la submergera probablement d’ici la fin du siècle, en mettant particulièrement l’accent sur son impact social et économique. L’auteur dépeint non seulement les effets du changement climatique sur le terrain aujourd’hui, mais aussi comment l’avenir de Miami a été façonné par son passé et son présent racistes.
Béatrice BARRAS, Une cité aux mains fertiles — Quand les habitants transforment leur quartier (éditions REPAS, 2019).
C’est l’histoire des militant·es du développement coopératif en milieu rural qui composent la SCOP Ardelaine et installent son atelier de confection dans une cité HLM de la périphérie de Valence. Dans cette Zone urbaine sensible, ils et elles décident de vivre sur place et de partager leurs valeurs coopératives avec les habitant.es de la proximité.
Isabelle BARAUD-SERFATY, Trottoirs. Une approche économique, historique et flâneuse (Apogée, 2023).
Le trottoir « existe à peine d’un point de vue juridique, les urbanistes lui préfèrent la notion d’« espace public », moins associé à la prostitution et à la vie dans la rue, et les « rez-de-chaussée », qui sont le plus souvent des « rez-de-trottoir », effacent jusqu’à son nom. Il est aujourd’hui urgent de reconnaître toute la valeur de cet espace qui se raréfie sous l’effet des transitions numérique, écologique et sociétale — il est par exemple de plus en plus convoité par les opérateurs de trottinettes électriques, livreurs de colis, fontaines rafraichissantes, points de collecte de déchets, etc., sans oublier les piétons et les riverains. Entre public et privé, entre marchand et non marchand, le trottoir cristallise ainsi les principaux changements à l’œuvre dans la ville, et les « batailles du trottoir » qui se multiplient sont plus largement l’écho des débats sur le futur des villes ».
Rémi BARBIER, Philippe HAMMAN, La Fabrique contemporaine des territoires (Le Cavalier Bleu éditions, 2021).
« La référence au territoire est omniprésente dans le discours contemporain. Élus, acteurs politiques, médias… tous s’accordent à parer le « territorial » de toutes les vertus, sans pour autant définir clairement ce qui le constitue. C’est ce à quoi s’attachent les auteurs de cet ouvrage qui livrent ici un panorama circonstancié des problématiques contemporaines auxquelles les acteurs des territoires sont confrontés ou dont ils sont parties prenantes ».
Sabine BARLES, Marc DUMONT, Métabolisme et métropole. La métropole lilloise, entre mondialisation et interterritorialité (autrement, Les cahiers POPSU, 2021).
« Alors que le contexte actuel montre une raréfaction des ressources, une dégradation des milieux de vie et un dérèglement climatique, les métropoles mobilisent des ressources abondantes, d’origines proches ou lointaines, flux physiques de matières et d’énergie qui donnent à voir le métabolisme métropolitain. Une analyse qui s’appuie sur l’exemple de la Métropole européenne de Lille et qui conduit à révéler les interdépendances systémiques des métropoles, traversant les échelles et les périmètres institutionnels, entre voisinages et mondialisation. Elle questionne la capacité des politiques publiques interterritoriales à agir sur ce métabolisme ».
Vincent BEAL, Nicolas CAUCHI-DUVAL, Max ROUSSEAU (dir.), Déclin urbain. La France dans une perspective internationale (Editions du Croquant, 2021).
« Derrière la célébration médiatique du triomphe métropolitain, une autre imagerie se diffuse depuis quelques années: celle de villes, petites ou moyennes, aux commerces fermés, aux maisons en vente et aux rues désertées. Cette scénographie du déclin dévoile de manière spectaculaire le décrochage d’anciennes villes industrielles ou de territoires plus ruraux restés à l’écart des flux de l’économie globale. Issu d’un travail d’enquête et d’analyse minutieux, ce livre dépasse l’instrumentalisation du déclin par des visions manichéennes. Il éclaire la diversité de la marginalisation urbaine », rend compte des réponses qui y sont apportées et insiste sur les dynamiques sociales contrastées qui animent ces territoires. Et si ces villes constituaient des « laboratoires de politiques et pratiques alternatives, plus soucieuses de justice sociale et environnementale » ?
Vincent BEAL, Nicolas CAUCHI-DUVAL, Georges GAY, Christelle MOREL JOURNEL, Valérie SALA PALA, Sociologie de Saint-Etienne (La Découverte, 2020).
L’ouvrage aborde une réalité souvent occultée : celle des villes dont la situation s’éloigne des récits vertueux sur la métropolisation. Saint-Étienne apparaît comme l’une des grandes perdantes des transformations du capitalisme contemporain. Pourtant certains habitants et collectifs se saisissent des ressources de la ville pour renouveler les pratiques sociales.
Mark BEISSINGER, The Revolutionary City. Urbanization and the Global Transformation of Rebellion (Princeton University Press, 2022).
« Comment et pourquoi les villes sont devenues les principaux lieux des bouleversements révolutionnaires dans le monde contemporain ? ».
Vincent BERDOULAY, Olivier SOUBEYRAN, L’aménagement face à la menace climatique. Le défi de l’adaptation (UGA Editions, 2020).
« Comment l’adaptation est-elle invoquée face au caractère imprévisible des menaces qui pèsent sur nos sociétés ? À l’aide de l’exemple du changement climatique, cet ouvrage s’attache à montrer comment l’adaptation est pensée en matière de planification territoriale et environnementale et comment l’utilisation de notions comme la prévention, la résilience, la sécurité ou la préemption font à leur tour peser de graves menaces sur les libertés fondamentales ».
Augustin BERQUE, Mésologie urbaine (édition Terre Urbaine, 2021).
Mésologie : l’étude des milieux. Le géographe et philosophe en fait « une perspective qui traverse aussi bien les sciences humaines que les sciences de la nature. L’auteur nous invite à le suivre dans des réflexions sur le privé, le public, le commun à l’ère de l’Anthropocène dans un urbain généralisé. Sur ce point, l’analyse comparatiste qu’il mène entre Orient et Occident, s’avère lumineuse tant sur le plan des concepts que sur celui du décryptage de situations existentielles qui voient chacun, chacune, tenter d’inscrire son destin dans un lieu qui l’accueille sans aucunement le juger. Là, le lecteur comprend en quoi l’écoumène est bel et bien la possibilité d’habiter la Terre ».
Philippe BIHOUIX, Clémence DE SELVA, Sophie JEANTET, La ville stationnaire. Comment mettre fin à l’étalement urbain? (Actes Sud, 2022).
« Et si les villes n’avaient pas vocation à grandir éternellement ? Plus tôt nous protégerons nos terres agricoles, naturelles et forestières de l’artificialisation, plus grande sera notre résilience face aux risques et aux crises écologiques à venir. Au plus vite, les villes doivent — et peuvent — devenir stationnaires. Il ne s’agit pas de les figer, mais de les transformer et les embellir, d’exploiter l’immense patrimoine déjà bâti. Surtout, c’est notre rapport aux territoires qu’il faut faire évoluer, en favorisant la redistribution des services et des emplois, en œuvrant à une nouvelle attractivité des villes moyennes, des bourgs, des villages et des campagnes. Désormais les métropoles ne doivent plus attirer et grandir, mais essaimer ».
Thierry BRENAC, Hélène REIGNER (dir.) Les faux-semblants de la mobilité durable. Risques sociaux et environnementaux (Éditions de La Sorbonne, 2021).
« Les politiques de mobilité durable, légitimes au regard de la nécessaire transition écologique, ne sont pas dénuées d’angles morts ni de contradictions. Privilégiant l’amélioration du cadre de vie dans certains espaces, ces politiques sont paradoxalement porteuses de risques environnementaux et sociaux. Identifier ces risques, largement occultés, et en comprendre l’origine est une nécessité si l’on veut qu’ils soient pris en compte dans l’action publique. C’est l’objet de cet ouvrage, qui rassemble les contributions de géographes, d’économistes, d’urbanistes, de politistes, de psychologues, d’ingénieurs en transport ».
Nicolas BUCLET, Écologie territoriale et transition socio-écologique. Méthodes et enjeux (ISTE Editions, Smart Innovation, Volume 35, 2022).
Une approche interdisciplinaire fondée sur l’optimisation des flux (eau, énergie, déchets, etc.) qui accorde une place particulière « à l’analyse des interactions entre les acteurs à l’origine de la circulation des flux, ou influant sur elle. L’ouvrage insiste également sur la façon de relier les méthodes développées avec des principes politiques aptes à favoriser la transition socio-écologique ».
Lucius BURCKHARDT, Promenadologie. Se promener pour mieux voir (Flammarion, 2022). Traduction par Catherine Aubard.
« Le sociologue Lucius Burckhardt est l’un des premiers à remarquer, dans les années 1970, que la relation à notre environnement est en pleine mutation. Son intuition alors visionnaire est plus que jamais avérée aujourd’hui, alors que les nouvelles technologies et la crise écologique bousculent notre rapport au dehors. Avec la promenadologie, approche esthétique et sociologique de la promenade, l’auteur entend refonder notre compréhension du paysage et de l’espace urbain, afin d’en saisir la diversité et la beauté ».
Jean-Paul CARRIERE, Francesca DI PIETRO, Abdelillah HAMDOUCH, Amélie ROBERT, José SERRANO (dir.), Faire Nature en ville (L’Harmattan, 2021).
« À travers des réflexions historiques et des études locales, cet ouvrage nous plonge dans la nature des villes françaises, brésiliennes, portugaises. Espaces verts résidentiels, espaces verts publics, traversées urbaines des cours d’eau et espaces agricoles aux marges de la ville, les principales formes de la nature en ville sont présentées ici de façon critique. Une variété de cas d’études à travers lesquels des questions cruciales de l’urbanisme contemporain sont soulevées : la nature est un besoin humain fondamental, mais aussi un marqueur de la ségrégation socio-spatiale dans les villes ; des modèles de parcs et des formes urbaines de la nature en ville qui semblent universels, mais aussi une nature que les habitants s’approprient difficilement ».
Jean-Paul CARRIERE, Francesca DI PIETRO, Abdelillah HAMDOUCH, Amélie ROBERT, José SERRANO (dir.), La transformation urbaine au prisme de la nature (L’Harmattan, 2021).
« La ville transforme la nature, certes, mais la nature transforme-t-elle la ville ? Au-delà du consensus de façade que la nature en ville suscite, les auteurs s’interrogent sur la réalité de l’action publique en la matière. Dans quelle mesure la nature renouvelle-t-elle les politiques urbaines ? Les espaces semi-naturels en ville sont-ils conçus et réalisés pleinement comme une infrastructure urbaine ? Les usages informels de ces espaces par les habitants, usages qui témoignent de la diversité des fonctions des sols urbains, sont-ils simplement considérés par l’action publique ? La réflexion suit 8 études de cas en France, au Brésil et en Tunisie ».
Laurent CASTAIGNEDE, La bougeotte, nouveau mal du siècle? Transports et liberté (écosociété, 2021).
« Autrefois réservée à une élite, cette hypermobilité s’est progressivement répandue tel un virus en conquérant l’ensemble des territoires et classes sociales. Si la prolifération des transports motorisés promet confort, bonheur et liberté pour tous et partout, cette envie parfois pathologique de bouger n’est pas sans conséquence: accidents, pollution, étalement urbain, changements climatiques et risque épidémique… ».
Laurent CASTAIGNEDE, Airvore ou le mythe des transports propres. Chronique d’une pollution annoncée (écosociété, 2022).
« L’omniprésence des transports dans nos sociétés a imposé une telle culture de la mobilité motorisée qu’il est tentant de considérer ces machines comme une nouvelle génération de dinosaures énergivores et polluants. Dans une enquête historique et sociologique inédite et minutieuse, Laurent Castaignède retrace l’épopée de leur ascension et expose leurs impacts environnementaux et sociaux. L’expansion du parc motorisé ne donnant aucun signe d’essoufflement, l’auteur passe au crible les innovations en vogue pour en faire ressortir les limites. Il propose aussi un ensemble de mesures radicales mais pragmatiques qui permettraient de relever le double défi sanitaire et climatique ».
Samuel CHALLEAT, Sauver la nuit. Comment l’obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant, et comment la reconquérir (Premier Parallèle, 2019).
L’auteur « retrace l’histoire de la revendication d’un « droit à l’obscurité » concomitant au développement urbain et décrit la manière dont s’organise, aujourd’hui, un front pionnier bien décidé à sauver la nuit ».
François CHIRON, Audrey MURATET, Myr MURATET, Manuel d’écologie urbaine (Les presses du réel, collection Al Dante, 2019).
Ouvrage de deux écologues et un photographe, ce manuel propose un état de l’art du fonctionnement de la nature en milieu urbain. Il souligne les dimensions sociologiques, urbanistiques et politiques du lien entre le vivant et la ville.
Armelle CHOPLIN, Matière grise de l’urbain: la vie du ciment en Afrique (Métis Presses, 2020).
La géographe nous emmène dans une exploration de la filière ciment en Afrique de l’Ouest, au cœur de multiples enjeux politiques, sociaux et économiques. L’urbanisation très rapide du continent africain se traduit par une vogue des constructions en béton alors même que « des voix s’élèvent pour dénoncer une industrie cimentière aux effets destructeurs sur l’environnement ». L’autrice mène une enquête au plus près de son sujet, de la carrière de calcaire jusqu’au chantier, le long du corridor urbain de 500 km qui relie Accra, Lomé, Cotonou et Lagos, mais aussi au plus près des humains liés à cet « or gris » : « des géants du secteur, des investisseurs, des acteurs politiques mais aussi des maçons et des habitants qui construisent leur propre maison ».
Claudia CIRELLI, Fabrizio MACCAGLIA (dir.), Territoires des déchets. Agir en régime de proximité (Presses universitaires François-Rabelais, 2021).
« Du compostage collectif urbain aux ressourceries de ville, les initiatives pour ancrer le traitement des déchets dans la ville se multiplient en s’appuyant sur l’investissement des usagers. En confrontant les politiques menées en France et dans divers projets européens (Suède, Catalogne, Belgique), ce livre propose d’analyser en profondeur les expériences de la proximité dans le traitement des déchets : expériences des gestionnaires, des usagers, des militants écologistes ».
Philippe CLERGEAU (dir.), Urbanisme et biodiversité. Vers un paysage vivant structurant le projet urbain (Apogée, 2020).
L’idée majeur de cet ouvrage est d’aller plus loin que les services rendus par la nature en ville (notamment via la végétalisation) en plaçant les processus écologiques et la biodiversité au cœur du projet urbain : il s’agit dès lors de faire un écosystème urbain, de donner une place aussi importante au non-bâti qu’au bâti.
Benoit COQUARD, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin (La Découverte,2019).
« À partir d’une enquête immersive de plusieurs années dans la région Grand-Est, Benoît Coquard plonge dans la vie quotidienne de jeunes femmes et hommes ouvriers, employés, chômeurs qui font la part belle à l’amitié et au travail, et qui accordent une importance particulière à l’entretien d’une “ bonne réputation “. À rebours des idées reçues, ce livre montre comment, malgré la lente disparition des services publics, des usines, des associations et des cafés, malgré le chômage qui sévit, des consciences collectives persistent, mais sous des formes fragilisées et conflictuelles ».
Stéphane CORDOBES, Xavier DESJARDINS, Martin VANIER (dir.), Repenser l’aménagement du territoire (Berger Levrault, 2020).
« La pensée aménagiste collective serait-elle en retard sur les transformations sociales, économiques, environnementales et culturelles qu’elle prétend réguler ? ». Une quarantaine de chercheurs, chercheuses et d’acteurs et actrices se sont retrouvés du 7 au 13 septembre 2019 au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle pour questionner la pensée et l’action aménagistes.
Antoine COURMONT, Quand la donnée arrive en ville. Open data et gouvernance urbaine (PUG, 2021).
Fruit d’une enquête ethnographique au sein d’une collectivité française, le politiste analyse comment les pouvoirs publics locaux entendent gouverner les données pour gouverner leur territoire. Selon une approche de sociologie politique des données, il suit la chaîne des données, de leur production à leur mise à disposition puis leur réutilisation, pour analyser les recompositions de la gouvernance urbaine. Il ouvre le débat sur les manières dont les pouvoirs publics peuvent gouverner les données pour conserver la maîtrise du pouvoir sur la ville à l’ère du numérique.
William CRONON, Chicago, métropole de la nature (Zones sensibles, 2019). Traduction par Philippe Blanchard.
Paru en 1991 aux Etats-Unis et enfin traduit en français, ce classique, reconnu, cité et lu dans le monde entier est un ouvrage hors-norme, un livre sur Chicago et les Grandes plaines qui ne parle ni de Chicago ni des Grandes plaines mais de la façon dont la ville et la nature s’assemblent pour donner naissance à une métropole de rang mondial dans un contexte régional.
Federico CUGURULLO, Frankenstein Urbanism. Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City (Routledge, 2021).
« Iconoclaste et prophétique, cet ouvrage est à la fois un examen de l’évolution de l’expérimentation urbaine à travers le prisme du roman de Mary Shelley, et une mise en garde contre un urbanisme dont le produit ressemble au monstre de Frankenstein : une entité fragmentée qui échappe au contrôle et à la compréhension humaine. Il raconte l’histoire d’expériences urbaines visionnaires, en faisant la lumière sur les théories qui ont précédé leur développement et sur les monstres qui ont suivi et qui pourraient être la fin de nos villes. Le récit est triple et se penche d’abord sur l’éco-cité, ensuite sur la ville intelligente et enfin sur la ville autonome, conçue comme un lieu où les technologies intelligentes existantes évoluent vers des intelligences artificielles qui retirent la gestion de la ville des mains des humains ».
Olivier DAIN BELMONT, Permacité. Réinventer la ville d’aujourd’hui (Editions Mardaga, 2021).
Version adulte de l’album jeunesse présenté un peu plus haut. « Comment réenchanter la ville pour que les écosystèmes humains et naturels vivent en symbiose ? Dans un contexte de crise écologique et démographique mondiale, marqué par une emprise toujours plus massive et destructrice de l’espace urbain sur l’environnement, Olivier Dain Belmont nous invite à repenser la ville et à libérer l’habitat pour s’y sentir mieux. Pour y parvenir, il s’appuie sur la permaculture qu’il décline dans le domaine de l’architecture, nous faisant ainsi découvrir la permacité ».
Julien DAMON, Toilettes publiques. Essai sur les commodités urbaines (Presses de Sciences Po, 2023).
« Sujet habituel de plaisanteries et d’agacements, les petits coins voient aussi converger une partie des grands problèmes du monde. Hors des domiciles, les commodités urbaines comprennent l’ensemble des toilettes ouvertes au public. Des efforts s’imposent pour les rendre plus accessibles, dans les villes riches déjà bien loties comme dans les bidonvilles du monde pauvre, qui en sont très mal dotés. Combien de centaines de millions de personnes sont encore contraintes à la défécation à ciel ouvert ? Les toilettes sèches, au nom du souci écologique, remplaceront-elles celles à chasses d’eau ? Les WC de demain seront ils déconnectés des réseaux d’égout et connectés à Internet pour les examens médicaux ? Comment offrir des conditions dignes face aux inégalités de toute nature ? L’analyse de ces défis conduit à dessiner les contours d’un droit aux toilettes, matérialisant une dimension concrète du droit à la ville ».
Laurent DAVEZIES, L’État a toujours soutenu ses territoires (Seuil, 2021).
« Les grands thèmes de protestation, largement relayés par les médias, tournent aujourd’hui autour de l’«explosion» des inégalités et de la «sécession» des grandes métropoles. Il est donc crucial de procéder à un état des lieux au regard de toutes ces revendications. «Abandon des territoires», vraiment ? De quelle «fracture territoriale» parle-t-on ? Car les métropoles, Paris, Lyon, Nantes ou Toulouse, sont de véritables poules aux œufs d’or pour les autres régions. En outre, les territoires dits «périphériques» bénéficient de mécanismes qui viennent compenser les pertes agricoles et industrielles qu’ils ont subies. D’où ce paradoxe : en dépit de la concentration croissante des richesses, les inégalités de revenu entre les territoires se réduisent depuis des décennies ».
Agnès DEBOULET, Sociétés urbaines. Au risque de la métropole (Armand Colin, 2021).
« 75 % de la population mondiale vivra en ville en 2050, soit près de 2 milliards de personnes de plus qu’aujourd’hui : face à cette internationalisation des flux et des migrations, les villes n’ont d’autre choix que de se restructurer, se rénover, et ces changements confrontent les citadins et les décideurs à des défis inédits. Cet ouvrage interroge la façon dont ces recompositions urbaines et sociétales majeures se donnent à voir et sont pensées par les décideurs et les habitants ».
Chantal DECKMYN, Lire la ville. Manuel pour une hospitalité de l’espace public (éditions Dominique Carré/La Découverte, 2020).
Un manifeste pour la ville. Un manuel pratique exposant « le bénéfice que représenterait pour tous, individuellement et collectivement, un espace public civil, favorisant la citoyenneté, l’égalité et la solidarité » (Le Monde, 20/11/2020).
Andrew DEENER, The Problem with Feeding Cities. The Social Transformation of Infrastructure, Abundance, and Inequality in America (The University of Chicago Press, 2020).
Une étude historique et sociologique du système alimentaire états-unien. Le sociologue met en lumière le système imbriqué d’agriculture, de fabrication, d’expédition, de logistique et de vente que représente chaque aliment. Il analyse la transformation du système alimentaire états-unien, passant en un siècle de l’approvisionnement de communautés locales à la nation tout entière, mais passant également de la satisfaction des besoins vitaux au dégagement de bénéfices. Il montre enfin que le développement du marché et des villes, et la construction des systèmes de distribution ont conduit à des infrastructures défaillantes et à l’émergence de « déserts alimentaires ».
Antonio DELFINI, Rafaël SNORIGUZZI, Contre Euralille. Une critique de l’utopie métropolitaine (Les Étaques, 2019).
La critique va bien au-delà du grand projet urbain Euralille (opération commerciale, immobilier tertiaire financiarisé) pour s’étendre à «l’utopie métropolitaine» et ses formes architecturales, ses imaginaires politiques, son délire sécuritaire et sa fermeture aux pratiques jugées non conformes et aux populations indésirables. L’ouvrage propose également un répertoire d’actions pour réinvestir les centres métropolitains et y bâtir des contre-utopies.
Kaduna-Eve DEMAILLY, Jérôme MONNET, Julie SCAPINO, Sophie DERAEVE (dir.), Dictionnaire pluriel de la marche en ville (Éditions L’Œil d’or, 2021).
« Faut-il vraiment faire 10 000 pas par jour ? Pourquoi dire aux enfants de regarder avant de traverser ? Comment gérer la foule lors des grands événements ? La trottinette va-t-elle supplanter les sprints pour attraper le dernier bus ? Les piétons sont-ils des automobilistes comme les autres ? La « rando » en ville a-t-elle de beaux jours devant elle ? La marche est-elle l’avenir de la mobilité urbaine ? Ces questions, parmi bien d’autres, traduisent d’importantes préoccupations liées à la vie urbaine, telles l’insécurité routière, la crise environnementale, les pathologies de la sédentarité, la mixité ou l’exclusion sociale ».
Tom DUBOIS, Christophe GAY, Vincent KAUFMANN, Sylvie LANDRIEVE, Pour en finir avec la vitesse. Plaidoyer pour la vie en proximité (l’aube, 2021).
« Pouvoir se déplacer de plus en plus rapidement grâce à la vitesse du train, de la voiture, de l’avion… a modifié nos modes de vie fondamentalement. Mais si voyager toujours plus loin, vite et à bas coût, au quotidien et pour les vacances, exauce les rêves de liberté et de découverte d’une partie croissante de la population mondiale, il y a un revers à la médaille ? : fatigue, stress, inégalités, fragilité du système, congestion et pollution. La récente révolution numérique n’a permis de diminuer ni les déplacements, ni le rythme de vie de nos contemporains. Est-il (encore) possible de sortir de l’emprise de la vitesse ? Les auteurs donnent sur le sujet un point de vue inédit et proposent de réorganiser le territoire pour permettre de vivre en plus grande proximité et répondre aux enjeux climatiques ».
Olivier DUCHARME, Ville contre automobiles. Rendre l’espace urbain aux piétons (Editions Ecosociété, 2021).
« L’automobile a transformé radicalement nos villes, au point de s’imposer comme l’étalon de mesure de la planification urbaine. Architectes et urbanistes ont embrassé cette vision de la ville qui mène à des espaces pollués, peu sécuritaires, et dont les infrastructures pèsent lourd sur le trésor public. Devant l’urgence climatique, le chercheur veut renverser ce modèle pour redonner au piéton la place qui lui revient. Il livre une charge pour sortir de nos villes ces « requins d’acier », qu’ils soient électriques ou à essence, et remettre la vie de quartier et le transport collectif au centre de l’aménagement urbain ».
Ludovic DUHEM (dir.), CRASH METROPOLIS : Design écosocial et critique de la métropolisation des territoires (T&P Publishing, 2022).
« L’ouvrage rassemble des chercheurs, des designers, des architectes, des urbanistes, des artistes, tous engagés dans les enjeux fondamentaux de la transformation urbaine contemporaine. Ils étudient et critiquent en particulier ceux liés à la métropolisation qui concentre les lieux de pouvoir, d’activités et de vie, créant de fait un déséquilibre avec les territoires non inclus. Le processus de métropolisation minore l’interaction des éléments écologiques et sociaux ».
Guillaume FABUREL, Les métropoles barbares (Le passager clandestin, 2019).
« La métropolisation implique une expansion urbaine incessante et l’accélération des flux et des rythmes de vie. Ce livre nous montre comment ces villes génèrent exclusion économique, ségrégation spatiale et souffrance sociale, tout en alimentant la crise écologique. Mais l’auteur brosse aussi le portrait d’une nouvelle société qui émerge hors des grandes villes, un possible plus réjouissant, décroissant et fertile. Dépassant la simple analyse critique, ce livre donne à voir la multitude et la force des résistances à l’extension sans fin du capitalisme dans nos vies, loin des métropoles barbares ».
Ludovic FAYTRE, Tanguy LE GOFF, Fragiles métropoles. Le temps des épreuves (puf, 2022).
« La plupart des grandes métropoles dans le monde vivent sous la menace permanente d’aléas naturels ou technologiques. D’autres enjeux de vulnérabilité se dessinent : dérèglement climatique, crise d’approvisionnement énergétique, crise économique mondiale… Densité extrême, bétonisation des sols, dépendance énergétique : ces fragilités nous interpellent sur la capacité des métropoles à se développer dans le futur. Croisant les regards d’historiens, d’urbanistes, de politistes ou d’anthropologues, cet ouvrage s’interroge sur ce moment inédit que nous venons de vivre où l’histoire nous a traversés. Il tire ainsi des premiers enseignements pour renforcer la capacité des grandes villes à faire face aux enjeux sociaux, sanitaires, économiques et écologiques ».
Michael FENKER, Isabelle GRUDET, Jodelle ZETLAOUI-LEGER (dir.), La fabrique de la ville en transition (Editions Quae, 2022).
« Cet ouvrage analyse les sphères politiques, professionnelles, citoyennes, scientifiques et médiatiques, qui se sont mobilisées et ont interagi pour négocier le tournant sociétal de transition écologique. Il rend compte des tensions qui se sont manifestées entre une approche de la ville écologique encore marquée par les logiques normatives et productivistes, et une autre fondée sur l’idée de sobriété et de capacité du citoyen-habitant à maîtriser la transformation de son cadre de vie. Dans un contexte économique très influencé par des logiques néolibérales, il questionne la notion même de « fabrique » qui s’est progressivement substituée à celle de production dans les domaines de la transformation urbaine depuis le début de ce troisième millénaire ».
Cédric FERIEL, La ville piétonne. Une autre histoire urbaine du XXe siècle ? (Editions de la Sorbonne, 2022).
« Explorant le sujet des années 1930 aux années 1980, Cédric Feriel démontre que la ville piétonne constitue depuis bientôt cent ans l’un des héritages méconnus de la ville contemporaine. Au même titre que les grands ensembles ou les villes nouvelles, elle est un terrain pour évaluer la manière dont les pouvoirs et les sociétés ont façonné l’urbain. Croisant les échelles d’analyse locale, nationale, transnationale, les sources archivistiques et les écrits théoriques sur la ville, l’ouvrage propose une relecture inédite de la relation des sociétés urbaines à la ville au XXe siècle, loin de la détestation supposée de la ville contemporaine ».
Carole GAYET-VIAUD, La civilité urbaine. Les formes élémentaires de la coexistence démocratique (Economica, 2022).
« Une enquête ethnographique montre que les citadins sont loin d’être indifférents à leur entourage public, qu’il s’agisse de faire l’aumône, se disputer, se livrer à la sociabilité pure ou encore perpétuer mais aussi combattre les discriminations » (La vie des idées, 14/12/2022).
Kian GOH, Form and Flow. The Spatial Politics of Urban Resilience and Climate Justice (MIT Press, 2021).
« Les villes du monde entier élaborent des stratégies pour répondre au changement climatique et s’adapter à son impact. Souvent, les résidents urbains marginalisés résistent à ces plans, proposant des “contreplans” pour protester contre ces actions injustes et excluantes. Kian Goh examine les réponses au changement climatique de 3 villes — New York, Jakarta et Rotterdam — et la mobilisation des groupes communautaires pour lutter contre les injustices et les oublis perçus dans ces plans. En mobilisant l’urbanisme et la politique spatiale socio-écologique, Goh révèle comment les visions contestées de la ville future sont produites et acquièrent du pouvoir ».
Ian GOLDIN, Tom LEE-DEVLIN, Age of the City. Why our Future will be Won or Lost Together (Bloomsbury, 2023).
« Pour rendre nos sociétés plus justes, plus solidaires et plus durables, il faut commencer par nos villes. La mondialisation et l’évolution technologique ont concentré les richesses dans un petit nombre de métropoles en plein essor, laissant de côté de nombreuses villes plus petites et alimentant le ressentiment populiste. Pourtant, même dans des villes apparemment prospères comme Londres ou San Francisco, le fossé entre les nantis et les démunis continue de se creuser et notre repli sur les mondes numériques déchire notre tissu social. Entre-temps, les pandémies et le changement climatique constituent des menaces existentielles pour notre monde de plus en plus urbain. Les auteurs combinent les leçons de l’histoire avec une profonde compréhension des défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui pour montrer pourquoi les villes sont à la croisée des chemins — et tiennent nos destins dans la balance ».
Sylvain GRISOT, Manifeste pour un urbanisme circulaire. Pour des alternatives concrètes à l’étalement de la ville (Dixit, 2020).
Pour sortir de l’impasse actuelle de l’étalement urbain qui menace notamment la souveraineté alimentaire, l’urbaniste consultant propose un « urbanisme circulaire dont les trois grands principes sont : l’intensification des usages (usage des lieux vacants, optimisation fonctionnelle des lieux utilisés, mixité des programmes et des temps d’occupation, etc.), la transformation de l’existant (surélévation, extensions, densification pavillonnaire, serres urbaines, etc.) et le recyclage des espaces (réhabilitation de friches, végétalisation d’espaces urbanisés, etc.) (Cairn, 27/07/2020).
Antoine GUIRONNET, Au marché des métropoles. Enquête sur le pouvoir urbain de la finance (éditions les étaques, 2022).
« En nous plongeant dans les allées et les coulisses du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), Au marché des métropoles donne à voir comment la financiarisation de la ville se joue à travers « l’accréditation » des territoires par les investisseurs. Cette enquête menée entre Cannes, Paris, Londres et Lyon dévoile le rôle de la finance dans la transformation de pans entiers de nos villes. Elle constitue une contribution inédite à la critique des rouages par lesquels le capital étend son pouvoir sur nos vies quotidiennes ».
Jean HAËNTJENS, La Ville Frugale. Un modèle pour préparer l’après-pétrole (Rue de l’Echiquier, 2021).
« Les villes les plus audacieuses ont compris que la contrainte énergétique pouvait être une formidable opportunité de se réinventer en s’appuyant sur une autre vision de la cité de demain : celle d’une ville frugale, conciliant la satisfaction des besoins avec une économie de moyens et de ressources. Illustrant son propos par des exemples pertinents en France et en Europe, Jean Haëntjens explique le principe de ce modèle en l’appliquant de manière concrète aux différents composants de notre système urbain : la mobilité, l’aménagement de l’espace, l’accessibilité des services essentiels, etc. ».
Eric HAMELIN, Olivier RAZEMON, La Tentation du bitume. Où s’arrêtera l’étalement urbain ? (Rue de l’échiquier, 2020).
Réédition en poche de l’ouvrage paru en 2012 qui brosse un portrait vivant et sans concession de la bataille inégale entre la soif de bitume et les rares garde-fous susceptibles de contrer le phénomène : d’un côté l’artificialisation galopante des sols, l’étalement urbain, les centres commerciaux, les entrepôts et les parkings, de l’autre la densification urbaine et vitalisation de la ville existante, une gouvernance adaptée, des alternatives au tout-voiture et tout-parking, bref une amélioration de la qualité de vie sans gaspiller le territoire.
David HAPPE, Au chevet des arbres. Réconcilier la ville et le végétal (Le mot et le reste, 2022).
« Du modeste érable qui ombrage le parking d’une école au vénérable tilleul qui veille sur l‘entrée d’une bâtisse remarquable, les arbres des villes sont constamment confrontés à de multiples pressions qui réduisent leur espérance de vie. Mobilisée par ce constat inquiétant, une communauté de spécialistes intervient pour les préserver, les soigner puis les renouveler: les arbres sont leurs patients. Ce livre met en lumière l’activité de ces praticiens, peu nombreux en France, et propose au lecteur d’aller différemment à la rencontre de ces végétaux urbains »m.
Patrick HENRY, Des tracés aux traces. Pour un urbanisme des sols (Editions Apogée, 2022).
« Les débats sur l’objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN) doivent-ils être compris comme une menace pour l’urbanisation ou au contraire une façon de rebattre les cartes ? Considérer les sols dans l’aménagement du territoire ne nous oriente-t-il vers de nouvelles coopérations entre les territoires et les acteurs concernés ? L’ouvrage ouvre des pistes pour étendre le domaine de l’urbain, définir un urbanisme de l’attention basé sur l’observation et l’interaction avec les sols ».
Anselm JAPPE, Béton. Arme de construction massive du capitalisme (L’échappée, 2020).
Un essai à charge contre le béton, et à travers lui contre l’architecture moderne et l’urbanisme contemporain qui auraient transformé le bâtiment en marchandise. L’enseignant de philosophie retrace l’histoire du béton et met en lumière l’impact néfaste que le matériau a eu sur les architectures et savoir-faire traditionnel·les, l’environnement et la santé.
JARDINS DES VAITES, Une lutte pour le vivant à Besançon (Editions 2031, 2021).
Récit d’une lutte contre la bétonisation de 34 hectares de jardins, zones humides, espaces naturels et maraîchers des Vaîtes, au cœur de Besançon, pour construire un projet d’écoquartier. Ce mouvement résonne avec d’autres résistances aux Grands Projets Inutiles et Imposés en France et dans le monde et dessine les formes d’organisation d’un “habiter autrement” la ville.
Darryl JONES, A Clouded Leopard in the Middle of the Road. New Thinking About Roads, People and Wildlife (Cornell University Press, 2022).
Ecologie routière : un état des lieux de moyens divers et innovants pour réduire les collisions entre animaux et véhicules et minimiser les risques de traversée des routes pour la faune.
Leïla KEBIR, Frédéric WALLET, Les communs à l’épreuve du projet urbain et de l’initiative citoyenne (Editions du PUCA, 2021).
Un ouvrage qui recense plus de 140 initiatives locales autour des biens communs et en analyse une dizaine de manière approfondie pour mieux saisir cette nouvelle approche de création et de gestion des ressources urbaines et territoriales. Accessible en ligne.
Roger KEIL, Fulong WU (dir.), After Suburbia: Urbanization in the Twenty-First Century (University of Toronto Press, 2022).
L’ouvrage s’appuie « sur des recherches menées en Asie, en Afrique, en Australie, en Europe et sur le continent américain pour présenter une étude mondiale complète sur la périphérie urbaine. Les auteurs et autrices rejettent explicitement la dichotomie traditionnelle centre-périphérie et la priorité accordée aux épistémologies qui favorisent le Nord global. L’ouvrage met en avant la notion d’une réalité post-suburbaine dans laquelle la dynamique traditionnelle d’extension urbaine vers l’extérieur du centre est remplacée par un ensemble de développements contradictoires complexes ».
Leslie KERN, Ville féministe. Notes de terrain (les éditions du remue-ménage, 2022). Traduction par Arianne DesRochers.
« Kern s’attarde à la manière dont les relations de genre, de classe, de race et d’âge se déploient dans la ville. Elle nous invite à redéfinir et à nous réapproprier les espaces urbains. Comment rendre nos villes plus féministes ? Partant de son expérience quotidienne de citadine à différentes époques de sa vie (enfant, adolescente, étudiante, travailleuse, militante et mère), elle s’appuie sur les théories d’urbanisme, des travaux de géographes féministes et des références à la culture pop pour montrer comment une ville genrée qui s’embourgeoise exclut les populations marginalisées, mais également pour évoquer les possibles configurations d’une ville plus inclusive ».
Hannah KNOX, Thinking Like a Climate. Governing a City in Times of Environmental Change (Duke University Press, 2020).
Un enquête ethnographique menée en Angleterre, le berceau de la révolution industrielle, auprès de décideurs/euses, de politicien·nes, de militant·es, d’universitaires et de citoyen·nes pour comprendre les défis que le changement climatique pose à la production de connaissances et aux politiques publiques. Le changement climatique bouscule les limites administratives et bureaucratiques et invite à réinventer le social en termes climatiques.
Mickaël LABBE, Aux alentours. Regard écologique sur la ville (Payot, 2021).
« Ouvrons les yeux, portons attention à ce qui se trouve alentour. Notre maison, notre rue, notre quartier. Là où nous avons tissé des liens avec ceux qui nous entourent, avec ce qui nous entoure. Un endroit non seulement dans lequel on vit, mais dont on vit. Par-delà l’opposition entre la ville et la nature, l’urbain reste l’un des lieux indépassables et nécessaires pour une réinvention des manières d’habiter dans l’Anthropocène. Un territoire vivant coproduit par nous et par nos voisins non-humains. Faisons l’expérience de le voir comme « nature ». Arpentons-le, parcourons-le. Apprenons à le réhabiter ».
Mickaël LABBE, Reprendre place. Contre l’architecture du mépris (Payot, 2019).
« Quel est ce malaise que nous ressentons à la vue d’un banc «design» segmenté en places individuelles, de pics au rebord d’une vitrine, de grillages et de caméras tous azimuts ? Ce sont autant de symptômes de suspicion et de mépris de la ville à notre égard, autant de sensations de dépossession. Loin d’être une chose inerte, l’espace urbain formé par les urbanistes et architectes est politique, vivant et signifiant ».
Christine LECONTE, Sylvain GRISOT, Réparons la ville ! Propositions pour nos villes et nos territoires (éditions Apogée, 2022).
« Puisque l’essentiel de la ville de 2050 est déjà là, il est temps d’en assumer l’héritage et d’engager sa transformation. Comment faire ? En réparant la ville pour la rendre adaptable à nos envies et nos besoins. En bâtissant une ville qui donne envie d’y vivre ». En proposant « une vision courageuse de la ville, à la hauteur des enjeux du siècle. Une vision qui tienne compte de ses habitants comme du ménagement de la planète ».
Nicolas LEDOUX, Réinventer la ville (Le Cherche Midi, 2022). Illustrations de Benjamin Adam.
« Le livre développe 4 grandes thématiques : une ville qui donne toute sa place à la nature ; une ville bienveillante, à taille humaine ; une ville qui améliore les mobilités, où l’on se déplace moins et mieux ; et une ville frugale qui favorise une construction responsable et durable. On voit alors se dessiner une cité aux multiples villages, fluide, verte et décarbonée ».
Christian LEFEVRE, Gilles PINSON, Pouvoirs urbains. Ville, politique et globalisation (Armand Colin, 2020).
Un bilan critique de 5 controverses sur l’urbain : l’urbanisation généralisée, les rapports entre milieux urbains et capitalisme, les relations entre les villes et les États, la distribution du pouvoir dans la ville et la démocratie urbaine, et la gouvernance des espaces métropolitains.
Franck LIRZIN, Paris face au changement climatique (l’aube, 2022).
« En 2050, Paris aura le climat de Marseille aujourd’hui. Il y a donc urgence à adapter Paris à ce nouveau climat, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle méditerranéenne et en intégrant toutes les nouvelles approches bioclimatiques. C’est ce à quoi nous exhorte Franck Lirzin, s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques et innovations technologiques afin de montrer les voies de l’adaptation climatique de Paris, et de créer une véritable capitale écologique, une « écotopie » ».
Nicolas MAISETTI, Cesare MATTINA (dir.), Maudire la ville. Socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine (Septentrion, 2021).
Un ouvrage qui analyse et compare les histoires de cités mal-aimées et stigmatisées : New York, Boston, Chicago, Glasgow, Montréal, Naples et Marseille. « Car il y a des villes où ces dénonciations sont plus fréquentes qu’ailleurs, des villes maudites qui finissent par avoir une mauvaise réputation ».
Hervé MARCHAL, Jean-Marc STEBE, Le pavillon, une passion française (PUF, 2023).
« Quoi qu’on en pense, la maison individuelle incarne depuis fort longtemps l’idéal résidentiel pour nombre de Français. Aujourd’hui, on en compte près de 20 millions en France sur un total de 34,5 millions de logements. En dépit des discours dénonçant l’étalement urbain, la défiguration des villages, la dénaturation des paysages, l’artificialisation des sols ou l’omniprésence de l’automobile et des infrastructures qui l’accompagnent, cette passion française pour le pavillon avec jardin et garage est loin d’être remise en cause. Ne sommes-nous pas là en présence d’un tournant anthropologique ? »
Solène MARRY (dir.), Intégrer l’économie circulaire. Vers des bâtiments réversibles, démontables et réutilisables (Editions Parenthèses, 2022).
« Cet ouvrage collectif, coordonné par l’Ademe, présente un « benchmark » des initiatives européennes et met en lumière les grands enjeux de la circularité dans le secteur de la construction, en même temps qu’il pose un cadre de définition et d’indicateurs. Il a pour ambition de capitaliser les expériences pionnières et de les diffuser afin d’encourager ces pratiques d’avenir ».
Shannon MATTERN, A City Is Not a Computer. Other Urban Intelligences (Princeton University Press, 2021).
Les modèles informatiques d’urbanisme promettent de nouvelles fonctionnalités urbaines et de nouveaux services. Pourtant ils réduisent notre compréhension de la ville qui est façonnée par une myriade d’intelligences locales et indigènes ainsi que d’institutions du savoir. Ces ressources sont indispensables pour compléter les modèles algorithmiques qui se répandent.
Aurélie MERCIER, Roelof VERHAGE (dir.), Lyon, métropole en mouvement (PUL, 2023).
« Cet ouvrage vise à comprendre comment la métropole de Lyon s’est constituée, mais aussi comment on y vit et quelles sont ses relations avec les autres territoires ».
Caroline MOLLIE, Des arbres dans la ville. L’urbanisme végétal (Actes Sud, 2020).
Nouvelle édition par l’architecte qui souligne le caractère ambivalent de la relation entre les humains et les arbres. Elle invite à dépasser la simple vision esthétique de l’arbre et de la végétation en général pour développer une véritable ingénierie du paysage.
Christian MOUGIN, Francis DOUAY, Marine CANAVESE, Thierry LEBEAU, Elisabeth REMY (coord.), Les sols urbains sont-ils cultivables ? (éditions Quae, 2020).
Un regard prudent sur la qualité des sols urbains et périurbains de plus en plus plébiscités pour du jardinage collectif, notamment à usage alimentaire : « la localisation des jardins suscite des interrogations en termes de risques sanitaires puisque nombre d’entre eux sont implantés sur des délaissés urbains, des friches industrielles ou le long d’infrastructures routières ou ferroviaires ». Une invitation à « débattre des connaissances, des enjeux et des orientations techniques relatifs aux sols (péri)urbains ».
Lewis MUMFORD, Écologie des villes (PUF, 2023). Traduction par Martin Paquot.
« Ce texte de Lewis Mumford de 1956, inédit en français, retrace l’histoire environnementale des villes et plus généralement de l’urbanisation, depuis leur apparition au Néolithique jusqu’aux mégalopoles du XXe siècle, en passant par les cités grecques, les villes médiévales et industrielles. Cette analyse du fait urbain se veut écologique : en quoi l’urbanisation modifie-t-elle l’environnement, transforme-t-elle les paysages et reconfigure-t-elle les territoires ? Il y est ainsi question des relations villes/campagnes et de la bonne taille des villes ».
Carl H. NIGHTINGALE, Earthopolis. A Biography of Our Urban Planet (Cambridge University Press, 2022).
« Une biographie d’Earthopolis, la seule planète urbaine que nous connaissons. Un tour d’horizon des villes du monde sur 6 continents et 6 millénaires, avec en point d’orgue les 250 dernières années, au cours desquelles nous avons considérablement étendu nos domaines d’action, d’habitat et d’impact sur la planète, nous exposant à de nouvelles conséquences dangereuses et ouvrant des perspectives de nouveaux espoirs. Ce livre expose les profondes inégalités de pouvoir, de richesse, d’accès au savoir, de classe, de race, de sexe, de sexualité, de religion et de nation qui caractérisent la planète urbaine. Il nous invite à nous inspirer des moments les plus justes et démocratiques du passé d’Earthopolis pour sauver son avenir ».
Jean-Marc OFFNER, Anachronismes urbains (SciencesPo Les Presses, 2020).
Une déconstruction des dogmes hérités des Trente Glorieuses (qui continuent de gouverner les villes et les territoires) pour penser la ville de demain, mobile, connectée et soumise aux exigences environnementales.
Flaminia PADDEU, Sous les pavés la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles (Seuil, 2021).
« Dans les friches des quartiers populaires, les jardins partagés des centres-villes et les potagers en lutte, l’agriculture urbaine permet de produire, de résister et d’habiter autrement. Issu d’une enquête au long cours dans le Grand Paris, à New York et à Détroit, ce livre porte sur les efforts collectifs d’associations et d’individus pour reprendre et cultiver la terre dans les métropoles. Au fil des récits recueillis et des parcelles arpentées, il restitue la pluralité des espaces et des pratiques socio-écologiques, et rend compte des alliances et des conflits qui se nouent autour du retour de l’agriculture dans les ruines du capitalisme urbain ».
Thierry PAQUOT, Mesure et démesure des villes (CNRS éditions., 2020).
Le philosophe de l’urbain soulève la question de l’habitabilité à travers les tailles idéales d’une ville. Elles sont liées au rapport équilibré dans les parcours et les accès aux services que peut offrir une ville à ses habitant.es.
Thierry PAQUOT, Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter (éditions Terre Urbaine, 2020).
« Le philosophe de l’urbain nous invite à nous demander ce que signifie habiter. Un questionnement qui sonde à la fois ce que nous sommes, mais aussi notre relation à autrui et notre façon d’être au monde » (Libération, 03/07/2020).
Chris PEARSON, Dogopolis. How Dogs and Humans Made Modern New York, London, and Paris (University of Chicago Press, 2021).
« Dogopolis affirme de manière audacieuse et convaincante que les relations entre l’homme et le chien ont été un facteur crucial dans la formation de la vie urbaine moderne. En se concentrant sur New York, Londres et Paris du début du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, Pearson montre que les réactions humaines aux chiens ont considérablement remodelé ces villes et d’autres villes occidentales contemporaines ».
Philippe RAHM, Histoire naturelle de l’architecture. Comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville (Pavillon de l’Arsenal, 2020).
L’ouvrage invite à reconnaître le rôle essentiel des causes naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire architecturale de la préhistoire à nos jours. « Pourquoi notre nature homéotherme a donné naissance à l’architecture ? Comment le blé a engendré la ville ? Comment les petits pois ont fait s’élever les cathédrales gothiques ? Ce que les dômes doivent à la peur de l’air stagnant ? Comment un brin de menthe invente les parcs urbains ? Pourquoi l’éruption d’un volcan a-t-elle inventé la ville moderne ? Comment le pétrole a-t-il fait pousser des villes dans le désert ? … Comment le Co2 est-il en train de transformer les villes et les bâtiments ? ». Cette relecture de l’histoire de l’architecture à travers les faits physiques, géographiques, climatiques et bactériologiques nous équipe pour mieux comprendre et affronter les défis environnementaux du monde urbanisé (Libération, 24/10/2020).
Olivier RAZEMON, Comment la France a tué ses villes (Rue de l’Echiquier, 2017).
« L’offensive délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-ville et des quartiers anciens, et sacrifie les emplois de proximité. Mais les modes de vie sont fortement liés aux modes de déplacement. Ainsi, au-delà de la dévitalisation urbaine, cet ouvrage observe les conséquences, sur le territoire, de la manière dont on se déplace ».
Tyler REIGELUTH, L’intelligence des villes. Critique d’une transparence sans fin (Editions météores, 2023).
« Face aux multiples défis urbains, la ville est appelée à devenir « intelligente », smart. Son augmentation par des technologies numériques interconnectées et synchronisées promet d’optimiser les flux et de résoudre des problèmes en tous genres. Mais loin de simplement augmenter la ville, ces « solutions » promettent de produire un nouvel espace urbain qui serait parfaitement transparent et accessible en temps-réel, qui ne serait plus qu’une interface sans matière. À qui profite cette transparence et à quoi sert-elle ? En rematérialisant cette « transparence », ce livre propose une critique d’un discours contemporain qui ne semble tenir à rien et s’imposer partout ».
Claire RICHARD, Louise DRULHE, Technopolice : défaire le rêve sécuritaire de la safe city (369 éditions, 2021).
« Ce manuel nous emmène dans la ville de Marseille pour décrypter les dispositifs de surveillance numérique et automatisée qui s’y déploient. Il va à la rencontre du collectif Technopolice, dont les actions invitent à documenter la mise en place d’outils numériques à des fins de contrôle dans les villes françaises. En compagnie d’habitants du quartier de la Plaine, l’initiative œuvre à la réappropriation de l’espace urbain par celles et ceux qui l’habitent et affirme le droit à une ville vivante, humaine et conviviale ».
Alexandre RIGAL, Habitudes en mouvement. Vers une vie sans voiture (MétisPresses, 2020).
Pour aller vers une société post-automobile, le sociologue « part d’un postulat simple. Si l’on peut s’habituer à l’automobile, on peut également s’en déshabituer ». Il propose de privilégier des moments comme la jeunesse ou des déménagements pour procéder à une déshabituation de la voiture et s’entraîner à de nouveaux modes de déplacement (vélo, train, bus) pour créer de nouvelles habituations. La « valeur symbolique et rituelle du permis de conduire » pourrait également être affaiblie par un « permis de mobilité » qui marquerait le passage à l’âge adulte par un large accès aux mobilités actives et douces (la vie des idées, 13/01/2021).
Gillian ROSE (dir.), Seeing the City Digitally. Processing Urban Space and Time (Amsterdam University Press, 2022).
« Ce livre explore ce qu’il advient des manières de voir les espaces urbains à l’époque contemporaine, alors que tant de technologies permettant de visualiser les villes sont numériques. Les villes ont toujours été représentées, dans de nombreux médias et à des fins très diverses. Les technologies visuelles analogiques, comme les caméras de cinéma, étaient considérées comme créant une sorte de trace de la ville réelle. Les technologies visuelles numériques, en revanche, récoltent et traitent des données numériques pour créer des images qui sont constamment rafraîchies, modifiées et diffusées ».
Nathalie ROSEAU, Le futur des métropoles. Temps et infrastructure (MétisPresses, 2022).
« L’étude de 3 métropoles — New York, Paris, Hong Kong — permet d’approfondir les rapports au temps qu’entretiennent les villes et leurs infrastructures, construites pour durer alors même que leurs fonctions sont destinées à évoluer. Elle envisage les infrastructures dans une perspective située et transnationale et identifie, à la manière de l’archéologue, les traces visibles et invisibles de leur sédimentation. Les récits dévoilent les attentes d’une société au regard des temps à venir ».
Frédéric ROSSANO, La part de l’eau. Vivre avec les crues en temps de changement climatique (Editions de la Villette, 2021).
« Ce livre explore l’origine de la gestion des crues et la place déterminante qu’elle a occupée dans la construction de nos territoires. Après des siècles de travaux d’assèchement et d’endiguement, La Part de l’Eau présente les nouvelles stratégies spatiales, moins défensives et plus résilientes, mises en place ces dernières années pour restaurer, valoriser et habiter les paysages inondables, des vallées alpines de Suisse, France et d’Allemagne, aux plaines littorales néerlandaises ».
Max ROUSSEAU, Vincent BEAL, Plus vite que le cœur d’un mortel. Désurbanisation et résistances dans l’Amérique abandonnée (Grevis, 2021).
« Ségréguée, paupérisée et vidée, Cleveland est passée du statut de métropole florissante à celui de cauchemar urbain. Massivement démolis, ses quartiers noirs sont progressivement rendus à la nature. Les conservateurs y extraient les dernières richesses tandis que racisme et austérité avancent masqués derrière des algorithmes. De ce paysage dystopique, une vision alternative émerge pourtant : celle d’un futur agricole et coopératif. Dix ans après le crash déclenché par l’effondrement des subprimes, ce livre offre une plongée dans l’épicentre de la dernière crise globale. En donnant la parole à celles et ceux qui sont confrontés au déclin extrême, il cherche à éclairer l’Amérique urbaine abandonnée ».
Charlotte RUGGERI (dir.), Atlas des villes mondiales (Autrement, 2020).
« Grâce à plus de 90 cartes et documents inédits et originaux, cet atlas interroge l’avenir des villes, mégalopoles ou villes plus petites, en posant la question du renouvellement des modèles urbains ».
Joëlle SALOMON CAVIN, Céline GRANJOU (dir.), Quand l’écologie s’urbanise (UGA Editions, 2021).
« Cet ouvrage collectif interroge les différentes facettes de cette écologie qui s’urbanise, en proposant les perspectives croisées des sciences humaines et sociales, des sciences de la nature, ainsi que des gestionnaires urbains. L’objectif est de répondre à deux questionnements principaux en miroir. D’une part : Qu’est-ce que la ville fait à l’écologie ? En quoi fait-elle évoluer ses concepts, ses pratiques, ses imaginaires ? Et, d’autre part : Qu’est-ce que l’écologie fait à la ville ? En quoi influence-t-elle la gestion et la fabrique urbaine contemporaine ? Pour répondre à ces questions, les contributions abordent des espaces et des échelles — parcs, jardins privés, friches, quartier, système urbain — de même que des objets de connaissance naturalistes — plantes, animaux, insectes, sols — très variés dans les villes de Berlin, Zurich, Genève, Lausanne, Paris, Strasbourg et Marseille ».
Richard SENNETT, Bâtir et habiter : pour une éthique de la ville (Albin Michel, 2019). Traduction par Astrid von Busekist.
Une analyse de la relation entre la ville — ce lieu construit — et la manière dont nous l’habitons. Ce lien plaide pour une éthique de la ville qui concilie justice et mixité et tient en un mot : l’ouverture ; à la fois, celle du bâti et celle des habitants.
Álvaro SEVILLA-BUITRAGO, Against the Commons. A Radical History of Urban Planning (University of Minnesota Press, 2022).
Une histoire alternative de l’urbanisation capitaliste à travers le prisme des biens communs. L’ouvrage souligne la manière dont l’urbanisation façonne le tissu social des lieux et des territoires, en faisant prendre conscience de l’impact des initiatives de planification et de conception sur les communautés ouvrières et les couches populaires. Projetant l’histoire dans le futur, il esquisse une vision alternative pour un urbanisme postcapitaliste, dans lequel la structure des espaces collectifs est définie par les personnes qui les habitent.
Clara SIMAY, Philippe SIMAY, La Ferme du Rail. L’aventure de la première ferme urbaine à Paris (Actes Sud, 2022).
« Comment les habitants, y compris les plus défavorisés, peuvent-ils devenir les acteurs de la transition écologique et sociale ? Comment envisager d’autres façons de travailler et d’habiter plus pérennes ? Comment partager plus équitablement les ressources d’un monde commun ? À ces questions, l’initiative citoyenne de la Ferme du Rail apporte des réponses concrètes. Première ferme urbaine à Paris, elle relocalise la production de fruits et légumes tout en permettant à des personnes en réinsertion de se loger et de travailler dignement. Construite en matériaux renouvelables par des artisans locaux, son architecture se fonde sur des liens retrouvés entre les territoires urbains et agricoles, entre les humains et le reste des vivants ».
Eric VERDEIL, Thomas ANSART, Benoît MARTIN, Patrice MITRANO, Antoine RIO, Atlas des mondes urbains (SciencesPo Les Presses, 2020).
Au-delà des discours sur les nombreux maux de la ville (inégalités, standardisation, disparition des mondes ruraux, artificialisation, îlots de chaleur, perte de la biodiversité, etc.), Eric Verdeil, chercheur en géographie urbaine, et son équipe rappellent que « les villes sont aussi notre bien commun, des lieux de production de richesses, d’innovation, de création culturelle, de solidarité et de résilience ». Les auteurs explorent les mondes urbains à travers de multiples champs hétéroclites : les mégalopoles (qui ne sont plus européennes) comme les petites villes, les sous-sols comme nouvelle frontière, la végétalisation, « le faible «ruissellement» de la prospérité économique des métropoles », l’accroissement des rythmes urbains dans les métropoles, smart cities et low tech cities, le multilinguisme à Toronto, l’insécurité perçue par les femmes» à Delhi etc. (Géographies en mouvement — Libération, 09/11/2020).
Pierre VERMEREN, L’impasse de la métropolisation (Gallimard, 2021).
L’historien livre une charge contre la métropolisation, un « phénomène de concentration de la production de richesses dans de très grandes agglomérations » né aux États-Unis et qui a transformé la France au cours des dernières décennies. L’auteur « retrace les étapes de cette nouvelle organisation du territoire autour de ses principaux pôles urbains » et alerte sur ses « retombées négatives » : « une éviction des classes moyennes et populaires des métropoles, renvoyées dans une « France périphérique » appauvrie » et « les dégâts écologiques causés par le béton-roi, la démultiplication des infrastructures nécessaires à l’approvisionnement et au fonctionnement des métropoles et l’usage massif de l’automobile imposé à leur périphérie ».
Serge WACHTER, Dominique LEFRANÇOIS, Gouverner avec les habitants (Editions Recherches, 2021).
« Cet ouvrage explore les mérites et les limites des nouveaux instruments visant à favoriser la participation citoyenne aux politiques d’aménagement. À travers une enquête anthropologique sont aussi examinés les barrières et les moyens possibles d’une amélioration de la prise en compte de la parole citoyenne dans les quartiers marginalisés. Ces réflexions esquissent des voies pour la mise en place de formes nouvelles de la démocratie locale permettant de gouverner avec les habitants ».
Joëlle ZASK, Se réunir. Du rôle des places dans la cité (Premier Parallèle, 2022).
L’autrice « enquête sur les conditions matérielles qui rendent l’exercice de la démocratie possible. Car « en démocratie, plus on se réunit, plus grandes sont nos libertés, plus les institutions qui nous protègent sont fortes » ».
Joëlle ZASK, Zoocities. Des animaux sauvages dans la ville (Premier Parallèle, 2020).
La philosophe enquête sur les kangourous qui arpentent les rues australiennes, ou les coyotes, celles de New York. Elle « propose une expérience de pensée. À quoi ressemblerait une ville dans laquelle les distances et les espaces rendraient possible la coexistence avec les bêtes sauvages ? Une ville qui ne serait plus pensée contre les animaux, ni d’ailleurs pour eux, mais avec eux ? ».
URBAIN was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Bon Pote
Actu-Environnement
Amis de la Terre
Aspas
Biodiversité-sous-nos-pieds
Bloom
Canopée
Décroissance (la)
Deep Green Resistance
Déroute des routes
Faîte et Racines
Fracas
F.N.E (AURA)
Greenpeace Fr
JNE
La Relève et la Peste
La Terre
Le Lierre
Le Sauvage
Low-Tech Mag.
Motus & Langue pendue
Mountain Wilderness
Negawatt
Observatoire de l'Anthropocène
