18.02.2020 à 01:00
Zettlr : markdown puissance dix
Le logiciel libre a toujours quelque chose de magique. Cédant au plaisir coupable d’une attitude consommatrice, on se met à essayer frénétiquement plusieurs solutions logicielles, rien que « pour voir ». Zettlr fera-t-il partie de ces nombreux éditeurs markdown que je recense dans l’espoir de trouver le Graal du genre ? Attention : on n’essaye pas Zettlr sans en comprendre d’abord les objectifs.
Comparaison et flux de travail
Dès les premières pages de présentation dans la documentation de Zettlr, on voit clairement que pour se servir de ce logiciel, il faut de bonnes raisons.
On peut expliquer ces raisons en comparant Zettlr avec d’autres éditeurs spécialisés dans le markdown. Essayons par exemple de le comparer Ghostwriter (j’en ai parlé dans ce billet), du point de vue utilisateur.
La première différence c’est que là où Ghostwriter propose une interface très facile et rapide à prendre en main… Zettlr n’est pas aussi explicite. Bien sûr, on peut d’emblée commencer à écrire en markdown, enregistrer un fichier, mais ce n’est pas le but unique de Zettlr. Si Ghostwriter se concentre avant tout sur la partie éditeur, Zettlr est à la fois dédié à l’écriture et à la gestion de connaissances. Et pour cause, il a été créé et il est utilisé essentiellement dans le monde universitaire. C’est donc dans un contexte qui concerne les documents longs qu’il faut appréhender Zettlr, là où Ghostwriter servira bien la cause pour écrire un billet de blog, par exemple.
En fait tout se joue dans la manière dont on intègre un éditeur markdown dans un flux de travail. Dans mon cas, l’éditeur que j’utilise ne constitue pas un nœud décisif, ce qui fait que, selon les situations, je peux opter pour un autre éditeur (spécialisé ou non dans le markdown) pour continuer à travailler sur le même document.
J’aime bien avoir cette possibilité d’utiliser plusieurs éditeurs pour un même fichier, indépendamment du système sur lequel je travaille. Ensuite, pour produire le document final, j’exporte directement dans un format donné (si l’éditeur le permet) ou bien j’utilise pandoc qui me permet de transformer le fichier markdown en à peu près tout ce que je veux. Dans ce cas, je « sors » de l’éditeur pour utiliser la ligne de commande, puis une fois le document produit, j’utilise un autre logiciel pour terminer ma production selon le format choisi (LibreOffice pour.odt, un éditeur TeX pour(La).TeX, un éditeur de texte pour le .html, LibreOffice pour .docx, etc.). Pour les questions liées à la gestion de la bibliographie, c’est un peu complexe, puisque je suis contraint d’ouvrir, en plus de mon éditeur, un gestionnaire de bibliographie tel Zotero ou JabRef, repérer les clé bibtex des références, les insérer sous la forme [@dupont1955].
Tout dépend des goûts, mais on voit bien qu’un éditeur markdown trouve vite ses limites lorsqu’on commence à intégrer le markdown dans une démarche de rédaction plus « soutenue » et afin de rédiger des documents longs. Des allers-retour avec d’autres logiciels (notamment pour la gestion de la bibliographie) sont nécessaires.
Bien sûr les éditeurs comme Ghostwriter permettent de faire des exports en différents formats. Ils peuvent même créer du PDF en utilisant LaTeX (c’est d’ailleurs l’option recommandée pour un bon résultat, à condition d’avoir préalablement installé LaTeX). Mais il faut savoir se méfier des solutions qui prétendent tout faire. Ainsi, lorsqu’on commence à manipuler de la bibliographie, les « exports-gadgets » sont plus encombrants qu’autre chose. Cependant, il faut reconnaître que Zettlr a plutôt bien réussi à intégrer ces fonctionnalités d’export.
Pour ce qui me concerne, la solution que j’ai adoptée consiste à utiliser un éditeur de texte nommé Atom qui dispose d’extensions permettant d’écrire en markdown, faire de l’autocomplétion avec du Bibtex, intégrer un convertisseur avec pandoc et utiliser la console pour lancer des commandes (et plein d’autres choses). Cela me permet d’avoir mon flux de travail concentré pour l’essentiel sur un seul logiciel et utiliser les fonctionnalités au besoin, en gardant l’avantage de segmenter l’activité.
Alors, si de tels couteaux suisses existent, me demanderez-vous, pourquoi s’intéresser à Zettlr ? parce que les couteaux suisses demandent un temps d’apprentissage assez long, disposent d’une foule de fonctionnalités au point de s’y perdre et que Zettlr cherche à concentrer l’essentiel (avec quelques bémols toutefois).
De la gestion de connaissance
Avant de parler des fonctionnalités concrètes de Zettlr, il faut questionner l’ambition générale de ce logiciel.
Il a été créé essentiellement pour les chercheurs et les écrivains. C’est d’ailleurs un chercheur en sciences humaines, Hendrik Erz, qui a créé Zettlr afin de pouvoir sortir du carcan « traitement de texte » qui ne correspond pas vraiment aux besoins lorsqu’on écrit ou prend des notes dans une activité de production de connaissances (là où le traitement de texte devrait intervenir à une étape ultérieure de « mise au propre »).
Quels sont ces besoins ? pouvoir écrire en se concentrant sur ce qu’on écrit, tout en disposant d’une aide pour accéder aux ressources cognitives qu’on aura prit soin d’organiser en amont.
Cette organisation passe par la gestion bibliographique (à l’aide de logiciels dédiés tels Zotero) ainsi que par la gestion des notes et autres notices ou fiches que l’on stocke dans un système de pensée qui nous est propre.
Pour ce qui concerne la gestion bibliographique, l’utilisation de logiciels dédiés (et capables de sortir différents formats de bibliographie) est une habitude que bon nombre de chercheurs ont déjà (si ce n’est pas le cas, il y a un problème). Zettlr permet d’intégrer l’utilisation de références bibliographiques au cours du travail d’écriture dans l’éditeur markdown. Il suffit de renseigner le fichier .bib (ou CSL Json, qu’on obtient avec Zotero) puis Zettlr permet son utilisation au cour de la frappe. Cela rappelle par exemple l'extension Zotero qu’on installe dans LibreOffice, mais de manière plus brute et beaucoup plus fluide.
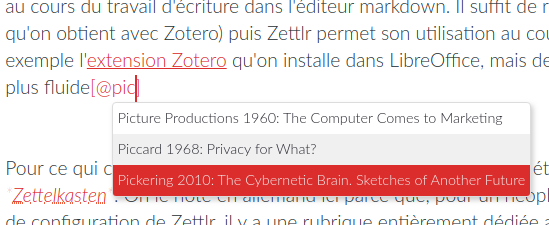
Pour ce qui concerne la mobilisation des connaissances, Zettlr a été conçu pour créer un système de Zettelkästen. On le note en allemand (ici au pluriel) parce que, pour un néophyte qui se rendrait dans les options de configuration de Zettlr, il y a une rubrique entièrement dédiée au « flux de travail Zettelkasten », et très franchement ça peut surprendre (sauf qu’on comprend aussi pourquoi Zettlr se nomme ainsi).
Une Zettelkasten signifie littéralement « boîte » (der Kasten) à notices ou pense-bêtes (der Zettel). Personnellement j’appelle cela une « boîte à fiches ». Dans ce cas, direz-vous, il y a déjà des logiciels spécialisés dans les « notes », y compris en permettant de synchroniser en ligne, avec une interface pour smartphone, etc. Oui, évidemment, et il n’est pas idiot de penser que, dans la mesure où ces logiciels de prise de notes utilisent le plus souvent le markdown, ces notes peuvent aussi être ouvertes avec Zettlr (c’est que je fais). Mais cela va plus loin.
Zettlr permet de créer des fiches tout en créant soi-même un système de rangement. C’est ce qui est expliqué ici. Le logiciel ne cherche pas à formater les notes ou à créer une seule manière de les rédiger ou les stocker : c’est à vous de créer votre système de rangement. On utilise alors pour cela les outils courants de liens externes entre les fiches et les mots-clés qu’on note pour chaque fiche. Un genre wiki, si on veut (même si un logiciel comme Dokuwiki sera bien plus puissant), mais sans quitter Zettlr.
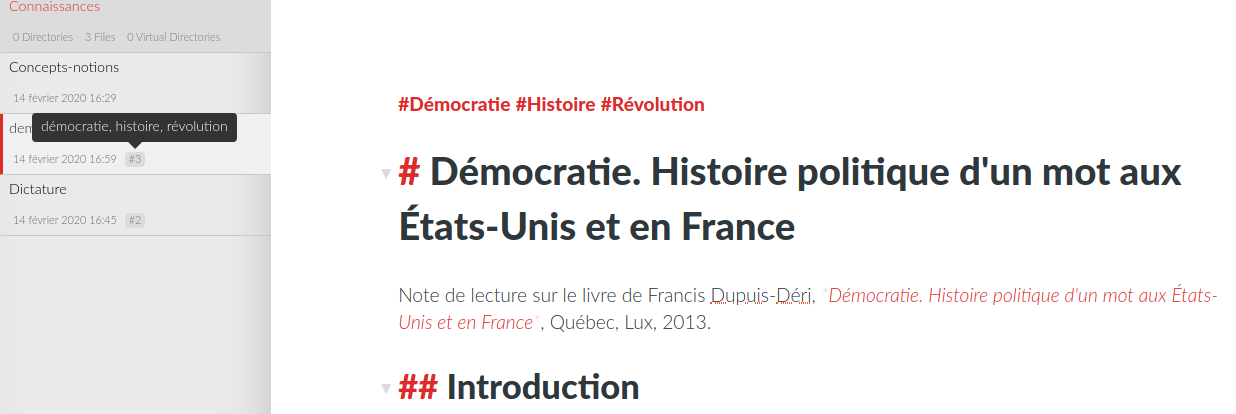
L’intérêt réside selon moi dans la création et le nommage des fiches. Selon le besoin, il est possible de configurer l’identifiant de la fiche (le nom du fichier) et créer des liens entre les fiches en profitant de l’assistant (menu contextuel qui liste les noms de fiche). Ces fonctionnalités sont très simples, on pourra même les qualifier de basiques, mais à l’utilisation quotidienne, elle permettent un réel gain de temps… Et à propos de temps on notera que si Zettlr propose un format d’export en Org (pour Emacs), ce n’est pas pour rien !

Aide à la saisie
Zettlr est d’abord un éditeur markdown et le moins qu’on puisse dire est qu’il accompli ce rôle avec brio. L’aide à la saisie, indissociable de l’interface, est soignée.
Outre un petit menu, en haut, dédié à la mise en forme, on notera :
- la visibilité automatique des titres de section, avec la possibilité de masquer la section ;
- l’aide à la saisie de tableaux ;
- quelques raccourcis et astuces (voir la documentation) tels la combinaison
Ctrl + alt + Fqui permet d’entrer une référence de note de bas de page automatiquement, ou encoreCtrl + alt + pointage curseurqui permet de saisir le même texte à deux endroits en même temps…
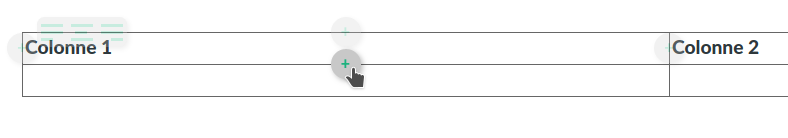
Correction en cours de frappe
L’ajout d’une fonction de correction basée sur des dictionnaires est quelque chose d’assez banal. Zettlr l’intègre pour plusieurs langues et c’est un atout très important. Mais pour un éditeur markdown, la possibilité de configurer soi-même la correction en cours de frappe est, osons le dire, assez exceptionnel. Ainsi, dans Paramètres > AutoCorrect il est possible d’activer l’utilisation des guillemets selon le contexte linguistique, mais aussi toutes sortes de saisies utiles, en particulier pour la typographie. Ainsi, on peut faire en sorte que la frappe d’un double point soit remplacée par une séquence qui associe une espace insécable (AltGr + Esp) et un double point, et toutes autres joyeusetés relatives aux règles typographiques.
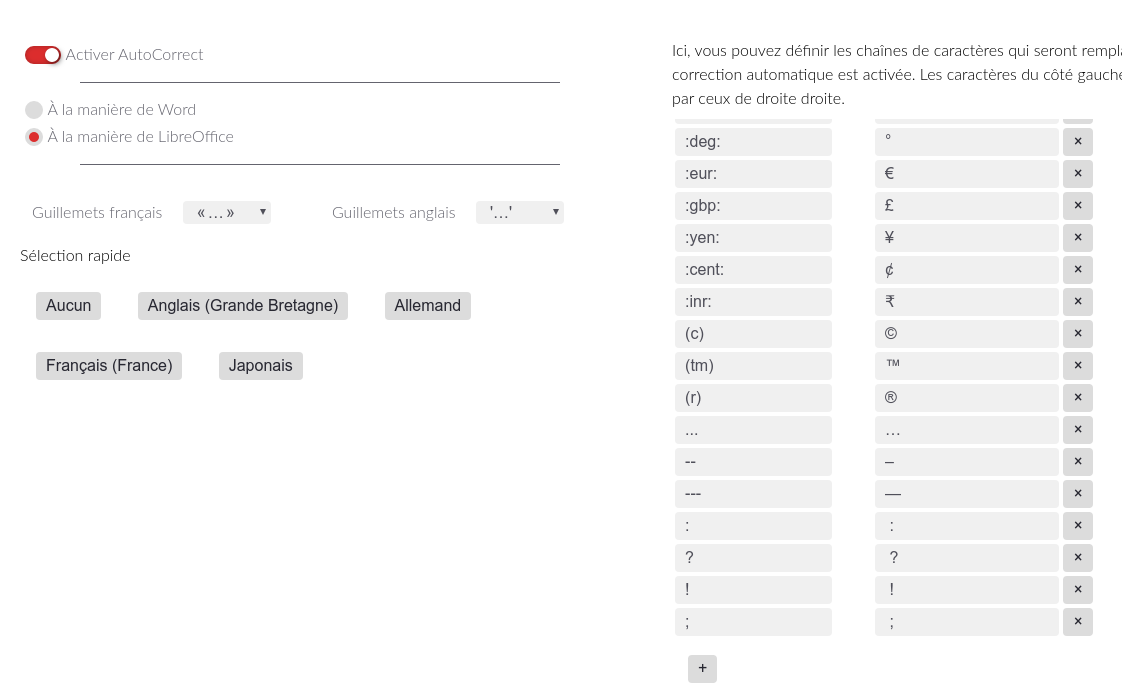
Travailler par projet
Comme le font beaucoup d’éditeurs, en particulier pour la programmation, l’utilisation de Zettlr sera d’autant plus efficace si vous optimisez la gestion des fichiers en créant un dossier par projet. C’est ce dossier que vous ouvrez alors, et c’est dans ce dossier que seront listés les fichiers que vous créez (dans le panneau de gauche). Ainsi, dans les options d’export, je conseillerais plutôt de cocher l’option qui consiste à sauvegarder les fichiers exportés dans le dossier en cours.
La bibliographie
Comme mentionné plus haut, Zettlr fournir un outil d’aide à la saisie de références bibliographiques.
Le principe qui a été retenu par les créateurs est celui-ci : dans les paramètres, vous entrez le chemin du fichier de bibliographie que vous avez créé. Vous pouvez entrer un fichier .bib ou un fichier .json créé par exemple avec Zotero.
À la différence de la gestion bibliographique via une extension Zotero ou JabRef dans le logiciel de traitement de texte tel LibreOffice, il faut entrer le chemin du fichier .bib ou .json dans les paramètres et ce seront ces données qui seront utilisées par Zettlr. Évidemment, si vous complétez votre bibliographie il faut s’assurer que Zettlr pourra bien trouver dans le fichier vos nouvelles références sans pour autant remplacer le fichier à chaque fois et devoir recharger Zettlr. Une fonctionnalité de Zotero vous sera très utile pour cela :
- Dans Zotero, sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez exporter, clic droit puis
Exporter la bibliothèque - Sélectionnez le format Better BibTeX ou Json et cochez la case
Garder à jour - Sauvegardez et entrez le chemin vers ce fichier dans Zettlr
- Désormais, lorsque la bibliothèque Zotero subira des modifications, le fichier d’export sera toujours à jour (et vous retrouverez vos nouvelles références)
À mes yeux, c’est une posture bancale. Certes, le fichier sera toujours à jour mais c’est une fonctionnalité qui dépend d’un autre programme (et tant pis si vous n’aimez pas Zotero). Par ailleurs, cela implique aussi que le fichier de bibliographie soit le même pour tous vos projets, ce qui signifie que si, comme moi, vous avez une biblio séparée pour chaque projet dans Zotero, la seule bibliothèque à exporter, c’est la principale. Cela dit, une fois configurée la bibliographie, Zettlr permet l’autocomplétion des références, ce qui est déjà d’une grande aide.
Ceci est valable aussi pour la configuration du format de bibliographie à la production de sortie, c’est-à-dire à l’export. En effet, pour formater la bibliographie, Zettlr permet de sélectionner le fichier de style CSL (que vous pourrez trouver sur ce dépôt ou via ce configurateur – reportez-vous à la section Bibliographie de ce billet pour comprendre de quoi il s’agit). Là encore, l’idée me semble bancale : si vous rédigez plusieurs documents avec des exigences différentes de format de bibliographie, il faut changer à chaque fois.
Donc idéalement, l’une des prochaines améliorations de Zettlr devrait inclure une solution d’extension Zotero ou JabRef capable de générer le fichier de bibliographie final à la volée et une solution de sélection de fichiers de style CSL. Plus facile à dire qu’à faire…
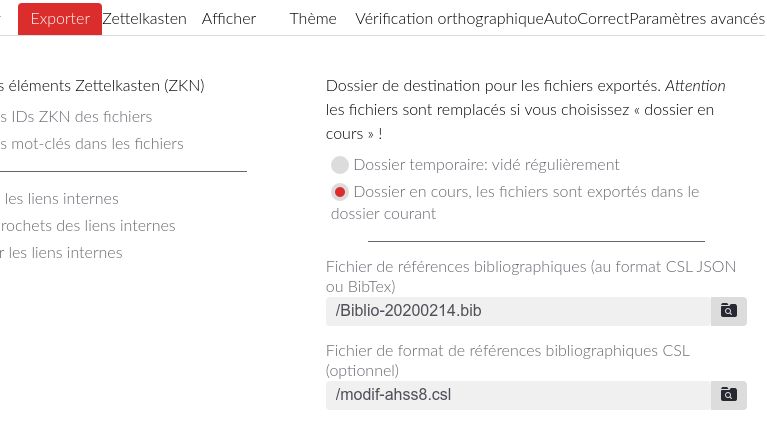
Export et pandoc
Pour utiliser les fonctionnalités d’export de Zettlr, il vous faut le logiciel pandoc installé sur votre système. Vous ne serez pas efficace si vous ne connaissez pas dans les grandes lignes le fonctionnement de ce logiciel… Qui ne connaît pas pandoc aura toutes les peines du monde à comprendre comment Zettlr exporte les fichiers dans un format choisi.
Pandoc est un logiciel de conversion muti-format très puissant et avec des résultats très propres (il ne s’encombre pas de formules polluantes qui rendent inutilisables les fichiers produits). Là où pandoc prend toute sa valeur dans notre cas, c’est qu’il permet de transformer le format markdown en à peu près tout ce que vous voulez. Par ailleurs, il est capable non seulement de convertir, mais aussi de convertir en utilisant des modèles et même d’autres logiciels qui paramètrent la conversion. Je vous invite à lire ce billet à propos de la manipulation de documents markdown et ce billet à propos de pandoc et LaTeX pour vous faire une idée (complétez aussi par celui-ci).
Ces lectures vont vous permettre de mieux comprendre la section des paramètres avancés de Zettlr.
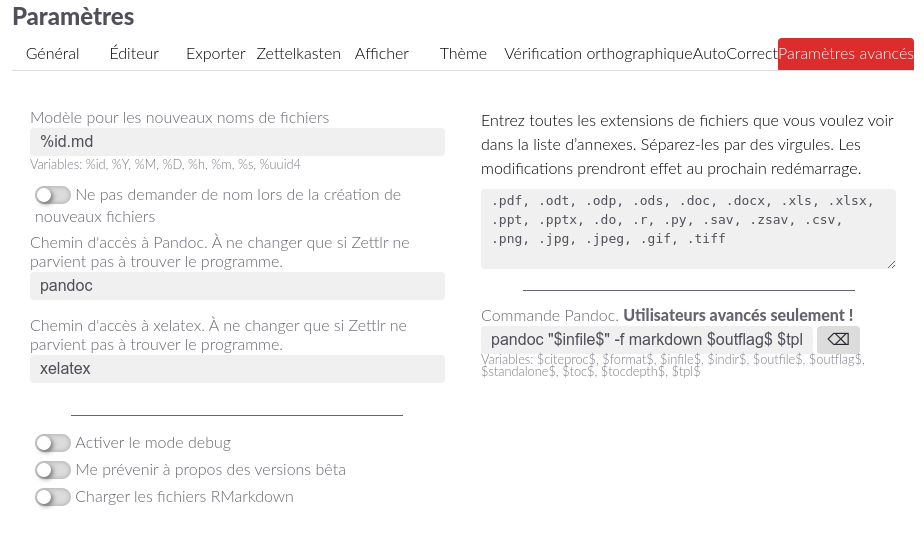 Dans l’illustration, la liste des annexes concerne les fichiers que vous allez voir figurer dans le panneau latéral de droite (en cliquant sur la petit trombone) lorsque vous liez des documents annexes à votre document. Quant aux chemins vers pandoc et XeLaTeX, inutile de vous en soucier, pourvu que ces programmes soient bien installés.
Dans l’illustration, la liste des annexes concerne les fichiers que vous allez voir figurer dans le panneau latéral de droite (en cliquant sur la petit trombone) lorsque vous liez des documents annexes à votre document. Quant aux chemins vers pandoc et XeLaTeX, inutile de vous en soucier, pourvu que ces programmes soient bien installés.
Ce qui nous intéresse dans les paramètres avancés, c’est la commande pandoc réservée aux « utilisateurs avancés seulement ». Parce qu’en réalité, elle détermine comment pandoc doit fonctionner avec Zettlr. Essayons de comprendre.
Pandoc est un logiciel dont l’usage est simple. Ce n’est pas parce qu’il s’utilise en ligne de commande que cela en fait un logiciel compliqué. La preuve : pour utiliser pandoc, vous devez lancer la commande pandoc en précisant le fichier sur lequel vous voulez travailler, le nom du fichier à produire et les options et formats choisis pour la conversion. Ainsi la commande
$pandoc source.md -o sortie.odt
Consiste à produire un fichier .odt nommé « sortie » à partir d’un fichier nommé « source ». Le -o signifie « output » (vers la sortie).
Une variante pourrait être :
$pandoc -f markdown -t odt bonjour.md
… c’est à dire transformer le fichier « bonjour.md » du markdown vers (-f c-à-d. : from markdown vers -t c-à-d. : to) le .odt.
Ça va jusque là ? vous voyez il n’y a rien de compliqué. Continuons un peu.
Pandoc ne fait pas « que » convertir. Il est capable de convertir en utilisant des informations beaucoup plus complexes et qui permettent même d’enrichir le fichier de départ, surtout si ce dernier n’est qu’en markdown. Par exemple :
- avec le programme
citeprocil est capable d’interpréter un format de bibliographie (en CSL) et on aura pris soin de renseigner dans la ligne de commande à la fois l’optionciteprocet le chemin vers le fichier de bibliographie ; - avec
reveal.jsil est capable de sortir, à partir d’un fichier markdown rédigé à cette intention, une très jolie présentation en HTML qu’il reste à afficher dans un navigateur en vue de faire une conférence.
Maintenant imaginez que vous n’avez pas le nom du fichier source ni le nom de sortie et que vouliez permettre à un utilisateur de choisir le format de sortie. Et bien il vous reste à créer une ligne de commande qui, au lieu de donner des instruction rigides, propose des valeurs (avec des $ qui seront utilisées (ou pas). Et vous voilà avec la ligne de commande que propose Zettlr dans les paramètres avancés.
Exporter en PDF
L’export au format PDF à partir de Zettlr suppose que vous ayez LaTeX (et XeLaTeX) installé sur votre système. Si tel est le ca,s il vous reste à vous rendre dans le menu fichier > Paramètres de PDF afin d’y renseigner divers éléments dont un modèle .tex qui pourra être utilisé. Rendez-vous sur la documentation de Pandoc pour apprendre à vous en servir.
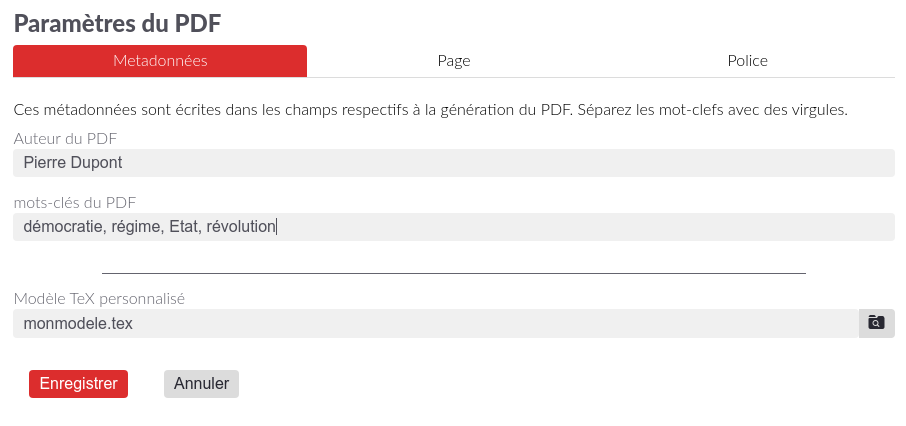
Attention : Si vous avez une version de pandoc antérieure à 2.0 (c’est le cas pour beaucoup d’installations), Zettlr (via pandoc) retournera une erreur du type unrecognized option --pdf-engine=xelatex. L’explication se trouve ici. Il s’agit d’un changement qui a eu lieu pour pandoc 2.0 qui est passé de la commande --latex-engine=xelatex à la commande --pdf-engine=xelatex. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement l’occurrence dans la ligne de commande pandoc que vous trouverez dans Paramètres > Paramètres avancés. Ou bien installez la dernière version de pandoc.
Attention (bis) : Dans les options du PDF, section Police sont indiquées les polices de caractères que pandoc utilisera pour la transformation en PDF via XeLaTeX. Si vous ne les avez pas sur votre système, un message d’erreur sera affiché. Indiquez à cet endroit les polices de caractères que vous souhaitez utiliser.
Les autres formats
Zettlr permet de faire des présentations en markdown puis de les exporter en utilisant reveal.js. Il vous reste donc à rédiger votre présentation et choisir parmi les modèles proposés (couleurs dominantes).
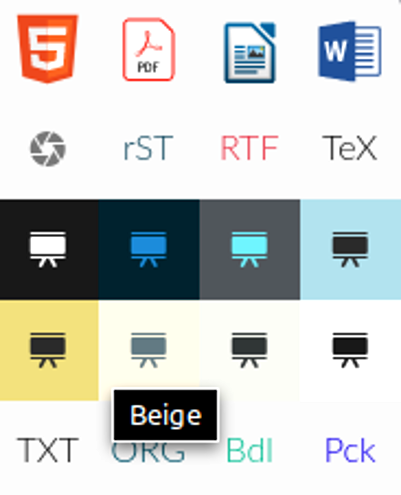
Vous pouvez aussi exporter directement en HTML : pour cela Zettlr dispose d’un modèle et exportera votre document en une page HTML contenant aussi les styles (on dit « standalone » ou option -s avec pandoc).
Quand aux autres formats, le choix reste intéressant :
| Format | Destiné pour |
|---|---|
| HTML | Navigateur |
| .ODT | Traitement de texte type LibreOffice, MSWord, AbiWord, etc. |
| .DOCX | Microsoft |
| rST | ReStructuredText : mise en forme pour de la doc de langage type Python |
| RTF | Rich Text Format : format descriptif pour traitement de texte |
| TeX | Format pour TeX / LaTeX |
| TXT | Format texte (simple) |
| ORG | Pour Emacs Org (pour les utilisateurs d’org-mode, très puissant |
| Bdl / Pck | TextBundle (un conteneur markdown + description + fichiers liés) / Variante |
… il manque selon moi la possibilité d’exporter en .epub, un tâche dont s’acquitte très bien pandoc et qui pourrait avoir son application pour l’écriture de livre, lorsqu’on a plusieurs chapitres dans des fichiers séparés. Peut-être que cette fonctionnalité sera ajoutée ultérieurement.
Conclusion
Zettlr est un excellent logiciel qui tire de nombreux avantages du markdown dans le flux de production de documents longs et dans la gestion de documentation personnelle. Il pêche encore par manque de pédagogie, mais il est sur la bonne voie. Par ailleurs, sur les aspects qui concernent l’exportation, ce que propose Zettlr est une interface graphique de pandoc. Les habitués de al ligne de commande, comme moi, ne seront pas franchement épatés : j’estime qu’il à ce niveau plus important d’apprendre à complètement se servir de pandoc. Et s’il lui faut une interface graphique (et je pense que ce serait plutôt bien), dans ce cas, je préférerais largement un programme uniquement dédié aux fonctions de conversion de pandoc (et pas au markdown).
Des directions devront être envisagées en fonction du public visé pour Zettlr. Par exemple, au vu de son fonctionnement global, il pourrait tout à fait être utilisé en binôme avec Git et par conséquent intégrer des options spécialisées dans le versionning. Une autre possibilité consisterait à utiliser une connexion à un dépôt Nextcloud afin de pouvoir synchroniser facilement l’écriture de documents en markdown. Bien sûr, qu’il s’agisse de Git ou de Nextcloud, il est déjà possible soit de commiter les fichiers à part, soit de travailler dans un dossier distant, mais il s’agit-là de tâches spécialisées avec lesquelles tout le monde n’est pas familier.
05.01.2020 à 01:00
Sentiers et randonnée : le grisbi du Club Vosgien
En octobre 2019, après un bon repas dans un restaurant montagnard, la Direction du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et le Club Vosgien ont signé une charte de protection des sentiers pédestres. Ils entendent ainsi définir l’exclusivité des usages et tentent de légitimer une discrimination entre les piétons et les autres usagers, en particulier les VTT. Si cette charte n’a qu’une valeur juridique potentielle, elle n’en demeure pas moins une démarche qui pourra essaimer dans les autres parcs naturels, et c’est toute une activité sportive (et touristique) qui en subira les conséquences. Il faut se mobiliser.
Vététiste
Loin des clichés et des vidéos impressionnantes de DownHill qu’on trouve sur les zinternetz, le VTT est d’abord et avant tout une activité à la fois sportive et populaire. Cela va de la petite promenade dominicale en famille dans les sous-bois, à la grande randonnée de 60 kilomètres avec 2500 m de dénivelé. Cette forme de randonnée sportive a un autre nom, le Cross Country ou All Mountain… On va appeler cela la Randonnée Sportive en VTT, pour faire court et francophone.
Il s’agit d’une pratique en solo ou en petits groupes. On croisera rarement un peloton de 20 vététistes dans la forêt sauf en cas d’organisation d’un événement dédié. On peut dire aussi que les vététistes sont des amoureux de la nature. Lorsque vous croisez un vététiste sur un sommet, par exemple dans les Vosges, il y a de fortes chances qu’il soit monté depuis le fond de la vallée (pour mieux y redescendre) et il n’a donc pas amené sa voiture sur le parking à 200 m de là. Dans son sac à dos, il préfère embarquer quelques outils et non pas la combinaison chips et papiers gras que d’aucuns n’hésitent pas à laisser traîner : il préfère une petite barre de céréales et quelques fruits secs. C’est aussi un contemplatif, il aime les paysages et reste très sensible aux aspects esthétiques du circuit qu’il accompli.
Bref, il ressemble à quoi notre vététiste ? à un randonneur. Un pur, un vrai, exactement comme les randonneurs chevronnés du Club Vosgien, cette vénérable institution qui regroupe des mordus de la marche et du bivouac. Sauf que lui, il a juste un vélo en plus.
Cette pratique du VTT rassemble l’écrasante majorité des pratiquants. Ils descendent sur les sentiers ou les chemins plus larges sans se prendre pour des champions du monde (parce que se casser la figure en VTT peut coûter cher). Sourire aux lèvres, sensations dans le guidon, quelques menus frissons : le VTT est une activité cool (avec un peu de transpiration quand même, sinon c’est pas drôle). Et pour les mordus comme moi, quelques degrés vers zéro ou un peu de pluie ne nous font peur (même la neige c’est marrant).
Dans les Vosges, on croise les vététistes soit sur les sentiers soit à la terrasse des fermes-auberges. Quoi de plus normal ? Des allemands, des belges, des habitants du coin ou d’un peu plus loin… exactement comme les randonneurs pédestres vous dis-je.
Alors c’est quoi le problème ?
J’ai déjà eu l’occasion de pondre un assez long billet sur cette curieuse mentalité de quelques antennes (alsaciennes) du Club Vosgien qui refusent le partage des usages tout en s’octroyant le droit de décider des libertés (en particulier celle d’aller et venir) pour l’ensemble des usagers, y compris les randonneurs qui ne font pas partie du Club Vosgien (une majorité, donc).
Il faut croire que les mêmes ont su réitérer de manière encore plus officielle et cette fois en entraînant dans leur sillage la plus haute responsabilité du Club Vosgien, sa présidence, et en sachant convaincre le président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
À l’initiative de l’antenne CV de Saint Amarin, une charte a été signée le 11 octobre 2019, avec pour titre : « Charte de protection des sentiers pédestres ». Elle concerne tout le massif et engage réciproquement le Parc le Club Vosgien… Je n’en fais pas l’article, l’antenne de la MBF Vosges a écrit à ce sujet un communiqué plus que pertinent.
Cette charte a été rédigée, discutée et signée en totale exclusion des représentants des autres usagers de la montagne et de ses sentiers, en particulier les vététistes. On remarque parmi les présents à la « cérémonie » de la signature : des représentants d’antennes du Club Vosgien (surtout celui de Saint Amarin), des représentants du Parc, le préfet du Haut Rhin (surprenant !), un représentant du Club Alpin Français, un représentant d’Alsace Nature (association de protection de la nature), quelques élus municipaux, départementaux et régionaux… C’est-à-dire, outre le Club Vosgien, une très faible représentation des usagers de la montagne et du Parc mais une très forte représentation des instances administratives.

Source : page FB du club Vosgien antenne St. Amarin
Cette charte engage réciproquement le Club Vosgien et le Parc sur des sujets tels l’entretien des sentiers et leurs préservation, en vertu de leurs valeurs patrimoniale, esthétique, et économique. Fort bien, dirions-nous, puisque dans ce cas, les devoirs ne concernent que ces instances.
Mais que lit-on au détour d’un article ? que les « sentiers fragiles de montagnes seront réservés en exclusivité à la circulation pédestre ».
On ne parle pas ici des sentiers déjà interdits par arrêté (parfois même aux piétons) et qui concernent de très petites parties classée en zone protégée. Non : on parle des sentiers que visiblement le Club Vosgien défini péremptoirement comme des sentiers « fragiles », c’est-à-dire « inférieurs à 1 mètre de large », « sinueux, situés dans des pentes raides » et « ne permettent pas le croisement avec d’autres usagers que pédestres » (comme si les VTT ne s’arrêtaient jamais pour laisser passer les marcheurs…)
En d’autres termes, dans une charte qui ne fait que stipuler des engagements réciproques entre le Parc et le Club Vosgien, c’est-à-dire entre une association et une autorité administrative, on voit apparaître comme par enchantement une clause qui rend exclusif et discriminatoire l’usage des sentiers. Faute d’avancer des faits réels et tangibles pour justifier cette exclusivité, la clause en question n’a pas la valeur d’un arrêté mais elle est néanmoins légitimée par une autorité administrative. Tel était l’objectif du Club Vosgien, et il a été atteint.
Il faut encore préciser que la valeur patrimoniale de ces sentiers est essentiellement le fruit du travail du Club Vosgien depuis le début du siècle dernier. On ne peut que saluer l’énorme travail fourni mais on ne peut toutefois s’empêcher de remarquer que le CV se place aujourd’hui en juge et partie : la même valeur patrimoniale est-elle communément partagée ? Certains préfèrent peut-être davantage insister sur les aspects environnementaux, sportifs, culturels…
Le seul argument éventuellement vérifiable qui soit avancé par le Club Vosgien consiste à accuser les VTT de favoriser l’érosion des sentiers. Tout comme on pourrait pointer l’élargissement des sentiers par les randonneurs qui marchent de front. J’ai de mon côté la certitude que le VTT n’est certainement pas un facteur significatif d’érosion. Et si tant est qu’une étude sérieuse porterait sur l’érosion par les usagers du Parc il faudrait alors s’attendre à devoir questionner :
- l’intérêt réel pour le Club Vosgien de baliser près de 20.000 Km de sentiers (sans aucune érosion bien entendu),
- les pratiques des exploitants et la gestion forestière en général (une calamité dans le massif vosgien),
- la gestion du couvert végétal et de la faune,
- questionner le schéma de circulation des véhicules à moteur,
- la pratique du ski,
- etc.
Et il faudrait alors aussi questionner les raisons pour lesquelles, par exemple, une association comme la MBF se voit souvent refuser les autorisations de participer à l’entretien des sentiers. Car de ce côté aussi une certaine exclusivité du Club Vosgien est organisée (puisque valider la participation des vététistes reviendrait à valider aussi leur usage).
Bref, qu’on se le dise : certains membres de certaines antennes du Club Vosgien ont une dent contre les vététistes. Et profitant de leurs appuis et de leurs relations, ils s’arrangent pour officialiser les choses.
Conséquences
Il est clair que de telles dispositions dans la charte ont de fait une valeur juridique potentielle. Cela signifie que désormais il sera possible de se référer à cette charte comme un élément justifiant un arrêté futur visant carrément à interdire la pratique du VTT.
Mais cette disposition change aussi la manière de concevoir l’espace commun : sous prétexte d’entretenir les sentiers balisés, et donc d’exercer le monopole des itinéraires de randonnée, le Club Vosgien s’approprie cet espace commun, ses valeurs patrimoniales et esthétiques, et s’arroge le droit de choisir qui peut en jouir et comment.
Comme le dit Ludovic, membre de la MBF :
Le problème dans les documents signés par le PNRBV et la Fédération du Club Vosgien, c’est qu’on inverse totalement la réalité des usages et la loi. Légalement, la règle c’est la libre circulation partout et les limitations par voie d’exception (avec des motifs réels et sérieux). Ici l’exception est partout.
Et quitte à l’interdire, toujours selon cette charte, cela risquerait de concerner énormément d’endroits dans le massif des Vosges :
- « Sentiers fragiles » : concept très vagues et donc pouvant être élargi toujours davantage (montées, descentes…),
- chemins de moins d'1 mètre de large,
- « Sentiers pittoresques à haute valeur esthétique en sommet de crête, chaumes, forêts d’altitudes ».
Bref, autant dire que si on veut passer d’une vallée à l’autre ou atteindre un sommet, cela ne sera plus possible en VTT (sauf éventuellement par la route bitumée et les cols des départementales).
Mais le plus grave dans tout cela, c’est que si de telles dispositions sont prises dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, on peut s’inquiéter légitimement pour ce qu’il en sera dans les autres Parcs Naturels Régionaux ! Car en effet, on sait combien les « expérimentations » ont tendance à devenir très vite des règles universelles.
Et pourtant
La solution pour plus de sérénité dans le massif réside autant dans le partage des usages que dans le partage des responsabilités. Les mains n’ont cessé de se tendre vers le Club Vosgien.
Les vététistes sont toujours prêts à accepter que dans certains cas, sur des zones particulières et rares, des sentiers dédiés peuvent être imaginés, voire même des itinéraires de délestage, comme des contournements, mais laissant aux uns comme aux autres la liberté de circuler. Des propositions peuvent être élaborées, il reste à les faire valoir, y compris pour leurs intérêts touristiques.
Toute forme d’interdiction portant sur un usage global et dont les conditions seraient définies par un seul acteur, aussi engagé soit-il et exerçant un monopole, reviendrait à l’échec. Non seulement parce que le Club Vosgien ne représente pas tous les usagers, mais aussi parce qu’il serait impossible de faire respecter de tels interdits à moins de placer un agent du Parc Régional chaque jour à chaque coin de la forêt. Il ne pourrait en résulter autre chose que des tensions inutiles entre pratiquants. Au contraire, proposer de manière ouverte et démocratique des solutions alternatives serait profitable à deux points de vue :
- éviter les clivages là où le respect des usages et de l’environnement est d’abord un combat à mener en commun,
- améliorer les flux de circulation et enrichir les itinéraires selon les pratiques (randonneurs, VTT, VTT électriques, niveaux de difficulté, etc.).
Pour cela, il faut associer systématiquement tous les usagers aux décisions, ce qui est est une démarche démocratique et égalitaire. Associer les vététistes reviendrait aussi à leur confier les responsabilités qu’ils réclament de leur côté, y compris pour entretenir les sentiers.
Pour éviter que les seules réponses aux difficultés ne soient que l’exclusion et l’ignorance, il est important pour les pratiquants de VTT se rassemblent pour former un front commun de discussion. Seule la MBF et la Fédération Française de Cyclisme (dont le silence est parfois assourdissant) peuvent être des interlocuteurs valables dans un monde où peinent à être reconnus les collectifs informels. Alors, si ce n’est déjà fait, adhérez à la MBF !

21.12.2019 à 01:00
L’utopie déchue
Ce livre est écrit comme un droit d’inventaire. Alors qu’Internet a été à ses débuts perçu comme une technologie qui pourrait servir au développement de pratiques émancipatrices, il semble aujourd’hui être devenu un redoutable instrument des pouvoirs étatiques et économiques.
Pour comprendre pourquoi le projet émancipateur longtemps associé à cette technologie a été tenu en échec, il faut replacer cette séquence dans une histoire longue : celle des conflits qui ont émergé chaque fois que de nouveaux moyens de communication ont été inventés. Depuis la naissance de l’imprimerie, les stratégies étatiques de censure, de surveillance, de propagande se sont sans cesse transformées et sont parvenues à domestiquer ce qui semblait les contester. Menacé par l’apparition d’Internet et ses appropriations subversives, l’État a su restaurer son emprise sous des formes inédites au gré d’alliances avec les seigneurs du capitalisme numérique tandis que les usages militants d’Internet faisaient l’objet d’une violente répression.
Après dix années d’engagement en faveur des libertés sur Internet, Félix Tréguer analyse avec lucidité les fondements antidémocratiques de nos régimes politiques et la formidable capacité de l’État à façonner la technologie dans un but de contrôle social. Au-delà d’Internet, cet ouvrage peut se lire comme une méditation sur l’utopie, les raisons de nos échecs passés et les conditions de l’invention de pratiques subversives. Il interpelle ainsi l’ensemble des acteurs qui luttent pour la transformation sociale.
Tréguer, Félix. L’utopie déchue. Une contre-histoire d’Internet, XVe-XXIe siècle. Fayard, 2019.
Lien vers le site de l’éditeur : https://www.fayard.fr/sciences-humaines/lutopie-dechue-9782213710044
11.12.2019 à 01:00
Monopoly Capital
« Aux États-Unis comme dans tous les autres pays capitalistes, les masses dépossédées n’ont jamais été en mesure de déterminer leurs conditions de vie ou les politiques suivies par les différents gouvernements. Néanmoins, tant que démocratie signifiait le renversement du despotisme monarchique et l’arrivée au pouvoir d’une bourgeoisie relativement nombreuse, le terme mettait l’accent sur un changement majeur de la vie sociale. Mais qu’est-il resté de ce contenu de vérité dans une société où une oligarchie minuscule fondée sur un vaste pouvoir économique et contrôlant pleinement l’appareil politique et culturel prend toutes les décisions politiques importantes ? Il est clair que l’affirmation selon laquelle une telle société est démocratique ne fait que dissimuler la vérité au lieu de la mettre à jour. » (P. A. Baran, P. Sweezy, Monopoly Capital, 1966).
Il y a des citations dont le commentaire ne ferait que retranscrire les évidences auxquelles nous faisons face actuellement (les fonctions de l’État bourgeois). Remplacez ici le pouvoir monarchique par la peur du fascisme, et vous retrouvez la soupe continuellement touillée par une certaine oligarchie française (pour ne citer qu’elle). Lorsqu’il se plonge dans les vieux grimoires, le sorcier en sort toujours des grenouilles.
En 1966, paraît un pavé dans les sciences économiques aux États-Unis : Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order (trad. fr. : Le capitalisme monopoliste - Un essai sur la société industrielle américaine). Il est écrit par deux économistes d’inspiration marxiste, Paul Sweezy (fondateur de la Monthly Review) et Paul A. Baran (professeur d’économie à Standford). Le livre sera pour ce dernier publié à titre posthume.
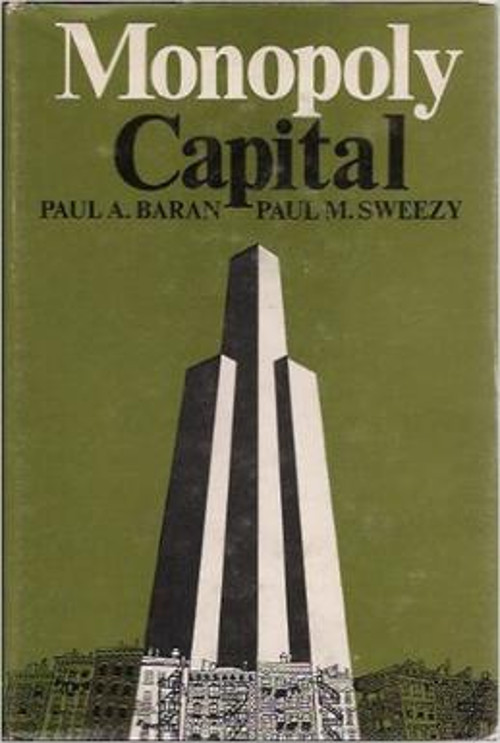
P. A. Baran, P. Sweezy, Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order
En quoi cet ouvrage est-il intéressant aujourd’hui ? Nous évoluons dans un modèle d’économie capitaliste à forte tendance monopoliste et cet ouvrage en développe une description particulièrement pertinente. Néanmoins, depuis les années 1960 beaucoup de choses ont changé et lire cet ouvrage aujourd’hui implique de le resituer dans son contexte : une économie capitaliste-monopoliste naissante. Et c’est là que l’ouvrage prend toute sa dimension puisqu’il explore les mécanismes du modèle que nous subissons depuis des années, en particulier la manière dont les schémas concurrentiels influent sur l’ensemble de l’économie et, par conséquent, la politique.
Qu’il s’agisse d’un capitalisme dirigiste ou de l’émergence de monopoles privés sur certains secteurs économiques (grâce aux « bienfaits » du libéralisme), le rôle de la décision publique dans le cours économique est fondamental à tous points de vue. C’est l’évidence pour la Chine par exemple. Mais en Occident, le libéralisme a tendance parfois à masquer cette évidence au profit d’une croyance populaire en des lois quasi-naturelles d’équilibre de marché et d’auto-régulation. Superstitions.
Pour ce qui concerne l’histoire contemporaine de l’économie américaine et, par extension celle des économies occidentales, l’apparition des monopoles est le résultat de stratégies politiques. Pour les deux auteurs, l’accumulation du capital par des acteurs privés atteint des sommets vertigineux à partir du moment où ces stratégies (notamment en politique extérieure) se déploient selon deux grands principes : l’impérialisme économique et la domination militaire. À leur suite, et surtout après la crise du début des années 1970, d’autres économistes apportèrent encore d’autres éléments : le rôle de la politique dans la régulation du marché intérieur comme arme stratégique protectionniste, la division sectorielle de l’impérialisme (financier, informationnel et culturel), le lobbying, etc.
La traduction littérale du titre originel de l’ouvrage est sans doute plus évocatrice. Il s’agit bien de la création d’un nouvel ordre social et économique. P. A. Baran et P. Sweezy ont su prendre la mesure du nouvel agencement socio-économique de la seconde moitié du xxe siècle, au-delà de la seule question de la consommation de masse. Le refrain n’a guère changé aujourd’hui : en faveur de la dynamique accumulatrice du capitalisme dans une économie monopoliste, la politique doit jouer son rôle de transfert des ressources vers le privé. Aucun échange non-marchand n’a d’avenir dans une telle économie. Sa nature procède par phases successives de centralisations des ressources (matérielles, informationnelles et financières) et d’éclatements de bulles erratiques.
Pour ce qui concerne le nouvel ordre social, les auteurs ont identifié plusieurs dynamiques en cours aux différents niveaux de l’économie quotidienne : les fluctuations de l’immobilier, les banques, les assurances et, surtout, le marketing. Cette dernière activité (avec l’impérialisme et le militarisme) a pour objectif la bonne allocation du surplus économique, c’est-à-dire le rapport excédentaire entre ce qu’une société produit et le coût (théorique) de la production. Avec le marketing, l’absorption du surplus est assurée selon deux moteurs : l’investissement et la consommation.
Il me semblait amusant de recenser quelques citations relevées par P. A. Baran et P. Sweezy et transcrites dans leur ouvrage au chapitre concernant le marketing. Je les reproduis ci-dessous. En effet, dans ce domaine on cite régulièrement l’inventeur du marketing (plus exactement des « relations publiques ») Edward L. Bernays et son ouvrage Propaganda. Mais on oublie bien souvent qu’il a fait école et que les piliers du marketing, la mesure et l’influence des comportements des individus et des masses, sont à la base de la propagande nécessaire à l’assentiment politique des foules. Jusqu’à atteindre des raffinements inégalés avec les GAFAM (pensons à l’affaire Cambridge Analytica, pour ne citer qu’elle). À cet égard, nous avons bel et bien vécu plus de 50 années bercés par une persuasion clandestine (pour reprendre le titre français du best-seller de V. Packard). De cette lancinante berceuse, il est temps de s’extraire (avec pertes et fracas).
Quelques citations
Pourtant, il suffisait de lire… Les citations ci-dessous n’ont rien d’étonnant si on les considère avec nos yeux du début du xxie siècle, mais c’est justement ce qu’elles préfiguraient…
La publicité affecte la demande… en transformant les besoins eux-mêmes. La distinction entre ceci et la modification des moyens de satisfaire des besoins existants est souvent cachée dans la pratique par le chevauchement des deux phénomènes ; analytiquement, elle est parfaitement claire. Une publicité qui ne fait qu’afficher le nom d’une marque de fabrique particulière ne donnera aucune information sur le produit lui-même ; cependant, si ce nom devient ainsi plus familier pour les acheteurs ils auront tendance à le demander de préférence à d’autres marques peu connues et sans publicité. De même, les méthodes de vente qui jouent sur la susceptibilité de l’acheteur, qui se servent de lois psychologiques qu’il ignore et contre lesquelles il ne peut se défendre, qui l’effrayent, le flattent ou le désarment, n’ont rien à voir avec l’information du client : elles tendent à manipuler et non à informer. Elles créent un nouvel ensemble de besoins en remodelant ses motivations.
– Edward H. Chamberlin, The Theory Of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 1931, p. 119.
« Les études menées au cours des douze dernières années montrent de façon évidente que les individus sont influencés par la publicité sans en être conscients. L’individu qui achète est motivé par une annonce publicitaire mais il ignore souvent l’origine de cette motivation. »
– Louis Cheskin, Why People Buy, New York, 1959, p. 61.
Les défenseurs de la publicité affirment qu’elle comprend de nombreux avantages économiques. D’utiles informations sont transmises au public ; des marchés s’ouvrent à la production de masse ; et en guise de sous-produits nous obtenons une presse indépendante, le choix entre de nombreux programmes de radio et de télévision, et des revues épaisses. Et ainsi de suite. D’autre part on prétend que l’excès de publicité tend à en annuler les effets et procure peu d’informations valables au consommateur ; que pour chaque minute de musique symphonique il y a une demi-heure de mélo. Le problème serait plus susceptible d’être discuté s’il n’existait le fait troublant, révélé par le Sondage Gallup, que de nombreuses personnes semblent aimer la publicité. Ils ne croient pas tout ce qu’on leur raconte mais ils ne peuvent s’empêcher de s’en souvenir.
– Paul A . Samuelson, Economics, New York, 1961, p. 138.
Claude Hopkins, qui est l’un des « immortels » de la publicité raconte l’histoire de l’une de ses campagnes publicitaires pour une marque de bière. Au cours d’une visite à la brasserie il écouta poliment l’exposé des qualités du malt et du houblon employés, mais ne s’intéressa qu’à la stérilisation par la vapeur des bouteilles vides. Son client lui fit remarquer que toutes les brasseries procédaient de la sorte. Hopkins lui expliqua patiemment que ce n’était pas ce que les brasseries faisaient qui importait, mais ce qu’elles affirmaient faire par leur publicité. Il fonda sa campagne sur le slogan : « Nos bouteilles sont lavées à la vapeur ! ». George Washington Hill, le grand fabricant de tabac, fonda une campagne publicitaire sur le slogan « Nous grillons notre tabac ! » En fait, tous les tabacs le sont, mais aucun autre fabricant n’avait pensé à l’énorme potentiel publicitaire du slogan. Hopkins, remporta une autre grande victoire publicitaire en proclamant à propos d’une marque de dentifrice : « Enlève la pellicule qui se forme sur vos dents ! » En vérité tous les dentifrices en font autant.
– Rosser Reeves, Reality in Advertising, New York, 1961, p. 55-56.
Quand la forme du produit est reliée à la vente plutôt qu’à la fonction productive, comme cela est le cas de plus en plus souvent, et quand la stratégie de vente est fondée sur de fréquents changements de style, certains résultats sont presque inévitables : tendance à l’emploi de matières de qualité inférieure ; « raccourcis » adoptés pour limiter le temps indispensable à une bonne mise au point des produits ; négligence sur l’indispensable contrôle de qualité. Une telle obsolescence provoquée amène une augmentation de prix pour le consommateur sous la forme d’une réduction de la durée des biens et d’un accroissement des frais de réparation.
– Dexter Master, ancien dirigeant de l’Association des Consommateurs, cité par Vance Packard, The Waste Makers, 1960, p.14.
11.11.2019 à 01:00
Les voies de la préfiguration
Pour de récentes approches des mouvements altermondialistes ou apparentés, il semble que le concept de préfiguration devienne une clé de lecture prometteuse. Doit-on uniquement réfléchir en termes de stratégies politiques, ou justifier les initiatives en cherchant une légitimité dans des expériences fictives, comme celle d’Orwell ? Et si oui, comment obtenir l’adhésion du public ? Il importe de travailler un peu cette idée de la préfiguration et c’est ce que je propose dans cet article.
Titre
Qu’est-ce que préfigurer ? La préfiguration est d’abord un concept travaillé dans les études littéraires, artistiques ou philosophiques. Pour un événement ou des idées, il s’agit de déceler des éléments antérieurs, culturels, issus de l’expérience, ou d’autres idées et concepts qui peuvent être liés d’une manière ou d’une autre au présent qu’on analyse.
L’ordre temporel n’est pas toujours aussi net. En littérature, les commentateurs construisent des généalogies entre les auteurs, certes, mais avec le dialogue qu’ils construisent avec leurs lecteurs (à titre posthume ou pas), les auteurs aussi construisent à rebours leurs généalogies, déterminent les « plagiats par anticipation ». C’est-à-dire qu’il existe entre les pensées et les textes des fictions de généalogies. Le lecteur n’est pas en reste puisqu’à reconnaître chez un auteur des formes littéraires, des pensées ou des concepts déjà présents chez d’autres auteurs précédents, le lecteur change lui-même, de manière rétroactive, la réception du discours, et les textes plus anciens deviennent des préfigurations historiques.
Précurseurs ? les sciences n’en sont pas exemptes : on voit dans l’histoire des sciences à quel point les auteurs sont toujours soucieux de se situer dans des « Écoles de pensées », de citer les expériences et les théories non seulement lorsqu’il s’agit de les remettre en cause ou les questionner, mais aussi établir une filiation qui permet de légitimer leurs propres recherches. En sciences, la recherche de la préfiguration est une recherche de légitimation, y compris lorsque cette recherche n’est pas effectuée par le chercheur mais aussi par le lecteur qui établit des liens, élabore des clés de lecture jamais pensées auparavant. On peut citer par exemple la re-découverte des travaux de G. Mendel au début du vingtième siècle, et les controverses que cela suscita1 au sujet de la construction d’une nouvelle discipline (la génétique), des controverses qui furent justement les produits de lectures différentes et donc de généalogies différentes.
En histoire, il en va de même, notamment parce qu’il s’agit d’en faire l’épistémologie. Les événements ont-ils toujours une histoire causale, linéaire, dans laquelle on peut facilement trouver les éléments qui en préfigurent d’autres, ou au contraire faut-il réfléchir en faisceaux d’évènements, de documents qui permettent de construire un sens dont on peut dire que ces indices préfigurent quelque chose, mais jamais entièrement ?
Dans les fictions politiques et leur réception dans les représentations dominantes à travers les époques, les mécanismes à l’œuvre ne sont pas tant ceux d’une légitimation de l’action (les auteurs ne sont pas des prophètes dont on suivrait les préceptes) qu’une reconnaissance a postériori d’une expérience politique qui devient alors un instrument de compréhension du présent. À travers l’histoire de l’informatisation de la société, dès les années 1950 et 1960, de nombreux textes font référence à la dystopie de G. Orwell et 1984 pour décrire les dangers des grandes bases de données. Et aujourd’hui encore cette clé de compréhension qu’est le monde politique de 1984 est énoncée, le plus souvent sans vraiment en faire la critique, comme si cette unique référence pouvait réellement fonctionner depuis plus de 60 ans.
Comme le dit P. Boucheron2 :
La littérature ne prédit pas plus l’avenir qu’elle n’en prévient les dangers. Et voilà pourquoi la critique littéraire de l’anticipation ne peut être qu’une critique de l’après-coup. Si on pense aujourd’hui que les fictions politiques de Kafka ou d’Orwell préfigurent une politique à venir, c’est parce que nous vivons aujourd’hui une situation politique en tant que nous sommes préparés à les reconaître comme ayant déjà été expérimentées par avance dans les fictions politiques.
L’ennui c’est que nous avons tendance à penser l’action politique en fonction de cette manière de concevoir la préfiguration, c’est-à-dire en s’efforçant de chercher les concepts dans des expériences fictives ou analytiques qui précèdent l’action et de manière à justifier l’action. Dans l’action politique, toute idée ou pratique qui n’appartiendrait pas à une généaologie donnée serait par définition non recevable, indépendamment de son caractère novateur ou non.
Ceci est particulièrement problématique car le caractère novateur des idées ne peut alors se prouver qu’en fonction d’efforts théoriques soutenus, généalogie et démonstration, ce qui ne coïncide que très rarement avec l’urgence politique. Penser qu’un acte, une décision ou une idée préfigurent toujours potentiellement quelque chose, c’est penser que l’action politique obéit toujours à une stratégie éprouvée et prétendre que « gouverner, c’est prévoir ». Mais jusqu’à quel point ?
Par exemple, l’activisme lié aux questions environnementales montre qu’on ne peut pas circonscrire l’action (comme une zone à défendre contre des projets capitalistes nuisibles aux biens communs) à la seule revendication pro-écologique. D’autres aspects tout aussi importants se greffent et que l’on pourrait rattacher aux nombreux concepts qui permettent d’opposer au modèle dominant des modèles sociaux et économiques différents. Pour rester sur le thème environnementaliste, c’est bien le cas de l’activisme dans ce domaine qui, dans les représentations communes chez les décideurs politiques comme dans la population en général, est resté longtemps circonscrit à une somme de revendications plus ou moins justifiées scientifiquement mais toujours à la merci de la décision publique, elle-même sacralisée sur l’autel « démocratique » du vote et de la représentativité.
L’apparition des ZAD et leur sociologie ont montré combien l’activisme ne correspondait plus à ce « revendicalisme », et c’est ce choc culturel qui permet de comprendre pourquoi il ne passe plus par les mécanismes habituels des démocraties libérales mais propose d’autres mécanismes, basés sur des modes de démocratie directe et l’exercice de la justice, mais inacceptables pour les réactionnaires. Ces derniers ont alors beau jeu de traduire ces nouvelles propositions politiques en termes de radicalismes ou d’extrémismes car elles sont en fait la traduction sociale de la crise des démocraties capitalistes.
Est-ce de l’action directe ? L’action directe (qui n’est pas nécessairement violente, loin s’en faut) est le fait d’imposer un rapport de force dans la décision sans passer par l’intermédiaire de la délégation de pouvoir (la représentativité) et même parfois, dans certains cas, sans passer par les institutions judiciaires (ce qui peut parfois aider à justifier des actions illégales, bien qu’étant légitimées du point de vue moral, ou éthique, tels les actes de désobéissance civile).
Pour ce qui me concerne, l’ennui avec l’action directe est qu’elle relève d’une conception anarchiste qui me semble aujourd’hui dépassée. C’est Voltairine de Cleyre qui a théorisé l’action directe en 1912. Dans les commentaires et les reprises qui ont suivis, l’action directe est pensée en mettant sur le même plan la revendication (syndicale, par exemple), le devoir d’un ouvrier dans la défense des intérêts collectifs de sa classe devant le patronat, la négociation directe entre un collectif et des autorités, etc. C’est-à-dire que l’action directe n’a pas pour objet la prise de pouvoir (elle exclu donc la conquête du pouvoir par la violence) mais elle est d’abord un acte d’organisation. Hier, on pensait cette organisation généralement en termes de classes sociales, aujourd’hui d’autres auteurs parlent plutôt de groupes d’affinités (ce qui n’efface pas pour autant les classes). Et comme il s’agit d’abord d’organiser des actions collectives en fonction de projets prééxistant, c’est-à-dire en fonction d’une expérience relevant de l’imaginaire politique, c’est seulement après-coup que l’on peut penser la puissance préfigurative de l’action directe : « ils avaient bien raison », « c’est grâce à ces luttes sociales que nous pouvons aujourd’hui… », etc.
Or que constatons-nous aujourd’hui ? Tout comme n’importe quel historien le constate en étudiant objectivement l’histoire des luttes sociales. Très rares sont les projets théoriques suscitant l’adhésion d’un collectif et suffisamment compris par chacun pour susciter de l’action directe. On le trouve peut-être dans l’action syndicale, mais si on regarde les processus révolutionnaires, on voit bien que la théorie n’a pas nécessairement précédé l’action, elle s’est construite « en faisant », « en marche » (comme dirait l’autre). On peut douter par exemple que les Révolutionnaires à la Bastille avaient bien tous compris (et lu) les textes de l’Assemblée Constituante. Meilleur exemple, la Commune de Paris née d’un mouvement d’opposition et de révolte, mais débouchant sur une expérience de gestion collective. Ainsi, il y a une stratification des actions et des pratiques dans un mouvement d’opposition et de préfiguration qui font qu’une ZAD ne ressemble pas à une autre ZAD, qu’un rond-point de gilets jaunes dans le Sud de la France ne ressemblera pas à un autre rond-point dans le Nord de la France, et ce n’est pas seulement parce que les contextes environnementaux et sociaux ne sont pas les mêmes, mais c’est parce qu’ils n’ont pas de prétention à préfigurer quoique ce soit de manière stratégique, suivant un plan préétabli.
Cela explique aussi pourquoi il y a de grandes transformation dans le fil chronologique des mouvements sociaux. Les revendications à Hong-Kong se sont certes construites au début sur un rejet des politiques pro-Chine, mais elles se sont assez vite cristallisées autour de contestations plus étendues et diverses rendant de plus en plus difficile une réponse politique (autre que la violence policière et l’étouffement). Il en va de même au sujet des autres mouvements à travers le monde aujourd’hui, qui ont tendance à transformer la revendication en une opposition de modèles sociaux et politique.
Certains sociologues qui se sont intéressés aux mouvements tel Occupy (Wall Street), les ZAD ou Nuit Debout ont montré que, en réalité, à la logique de l’action directe répondait aussi une logique de la théorie directe. N. Sturgeon3 montre combien les mouvements d’opposition changent aussi le cadre discursif : en tant qu’action directe ils rendent le dialogue et la négociation très difficiles avec les autorités (et vouent souvent à l’échec le discours politique en place) mais ils retravaillent aussi à l’intérieur même du mouvement les notions d’horizontalité, de diversité, de décision, de mécanisme démocratique, etc. En somme ce que les mouvements alter- proposent, ce sont tout autant des alternatives que de l’altérité.
Si ces mouvements alter préfigurent quelque chose, ce n’est donc pas par la formalisation d’un discours mais par l’organisation elle-même, au moins aussi importante que la revendication. C’est ce qu’un chercheur comme T. Luchies identifie en étudiant les courants anarchistes de l’anti-oppression4 :
Dans une organisation politique anarchiste, un tel activisme cherche à identifier les formes normalisées d’oppression et à éliminer les institutions qui reproduisent la suprématie blanche et masculine, le handicap, l’homophobie et la transphobie, le racisme et le capitalisme. La lutte contre l’oppression est une action continue et, grâce à sa pratique collaborative et cumulative, nous pouvons entrevoir des formes radicalement inclusives et autonomisantes de communauté politique. Son fonctionnement quotidien préfigure des modes alternatifs d’organisation et de résistance ensemble.
Sans forcément mobiliser un collectif à part entière, ces expériences peuvent être éprouvées dans n’importe quelle organisation qui met l’autonomie et la démocratie au premier plan de ses règles de fonctionnement.
Pour prendre un exemple que je connais plutôt bien, l’association Framasoft fonctionne sur ce modèle. Sans avoir formalisé notre mode de fonctionnement dans une charte ou un règlement intérieur particulièrement élaboré, l’idée est justement de laisser assez de latitude pour apprendre en permanence à moduler le système collectif de prise de décision. Dans les objectifs de réalisation, l’idée est bien de prétendre à l’action directe : mettre en oeuvre des projets concrets, des expériences de logiciels libres et de culture libre, et faire autant de démonstrations possibles d’un monde numérique basé sur une éthique du partage et de la solidarité. Ainsi, nous ne revendiquons rien, nous mettons au pied du mur la décision publique et les choix politiques en proposant d’autres expériences sociales en dehors du pouvoir et de la représentativité politique.
Dans cet ordre d’idée, un dernier auteur que nous pouvons citer est la chercheuse M. Maeckelbergh qui montre bien que la préfiguration n’est ni une doctrine, ni une stratégie politique. Elle échappe à une lecture du pouvoir politique parce qu’elle est presque exclivement en acte. Et c’est aussi la raison pour laquelle, du point de vue de la méthodologie sociologique, elle ne peut s’appréhender qu’en immersion. Elle affirme dans son étude sur les mouvements altermondialistes5 :
Ce qui différencie le mouvement altermondialiste des mouvements précédents, c’est que le « monde » alternatif n’est pas prédéterminé ; il est développé par la pratique et il est différent partout.
Est-ce pour autant du relativisme selon lequel tous les mouvements seraient équivalents, quelles que soient leurs orientations morales et politiques ? Heureusement non, car ce qui défini l’action directe dans cette dynamique de préfiguration, c’est aussi l’expérimentation de multiples formes de démocraties directes. Si, de manière générale, elles ont tendance à appeler à un changement de paradigme (celui de la représentativité et de la délégation de pouvoir) elles appellent aussi à un changement de modèle social et économique. Il peut néanmoins subsister des désaccords. Très prochainement, nous verrons sans doute apparaître quelques tensions entre ceux pour qui le capitalisme pourrait retrouver figure humaine (et pourquoi pas humaniste) et ceux pour qui le modèle capitaliste est en soi un mauvais modèle. Mais quelle que soit la prochaine configuration, les enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui présentent assez d’urgence pour ne plus perdre trop de temps à écrire des fadaises : les principes d’expansion et d’exploitation capitalistes des ressources (naturelles et humaines) impliquent dès mainenant une urgence de l’action.
-
On peut se reporter aux travaux de l’historien des sciences Jean Gayon à ce sujet. ↩︎
-
Patrick Boucheron, Qu’est-ce que préfigurer ? Des généalogies à rebours, Cours au Collège de France, 27 mars 2017, Lien. ↩︎
-
Noel A. Sturgeon, « Theorizing movements: direct action and direct theory », in : M. Darnovsky, B. Epstein, R. Flacks (Éds), Cultural Politics and Social Movements, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1995, p. 35– 51 ↩︎
-
Timothy Luchies, « Anti-oppression as pedagogy; prefiguration as praxis », Interface : a journal for and about social movements, 6(1), 2014, p. 99-129. ↩︎
-
Marianne Maeckelbergh « Doing is Believing: Prefiguration as Strategic Practice in the Alterglobalization Movement », Social Movement Studies, 10(1), p. 1-20, 2011. ↩︎
25.10.2019 à 02:00
Perspectives d’avenir
Comment les crises politiques et économiques pourront-elles être surmontées demain par ceux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui ? En se livrant à une analyse critique et prospective, Peter Gelderloos envisage la manière dont les gouvernements pourront à l’avenir proposer des solutions à la crise du capitalisme et de la démocratie. Ces solutions sont-elles souhaitables ? quels en seront les mécanismes politiques ? laisseront-ils des opportunités pour d’autres modèles sociaux et d’autres modes de vie ?
Source : Peter Gelderloos, « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast » sur Crimethinc.
Parutions de cette traduction : sur Crimethinc, sur la Bibliothèque anarchiste
Table des matières
Avant-propos
Paris, Hong Kong, Beyrouth, Détroit, Santiago, Barcelone… les contestations sociales finissent par être traitées dans les médias, même si nous devrions nous attendre à autre chose que des éléments de langage. Depuis la crise de 2008 on peut constater que les grands mouvements de contestation dans les démocraties occidentales trouvent leurs sources dans les inégalités sociales autant que dans le manque de confiance dans les institutions démocratiques elles-mêmes. En fait, brandissant l’épouvantail du fascisme au prétexte que le seul choix des peuples se situe désormais entre la dictature (d’extrême droite) et la démocratie, les régimes démocratiques cherchent par tous les moyens à sauvegarder le modèle économique dominant du capitalisme.
Cela se fait par exemple au détriment de l’urgence environnementale et climatique, pour laquelle les gouvernements, sous la pression des peuples et des sciences, ont été obligés de prendre des engagements, aussitôt relégués au rang de promesses d’ivrognes par les pays les plus capitalistes à commencer par les États-Unis, la France et l’Allemagne.
Cela se fait en faveur du capitalisme de surveillance, par lequel l’accumulation de valeurs se fait désormais sur nos vies privées, tout en permettant aux démocraties d’espionner en masse et de mettre en oeuvre des lois liberticides tout en marchant sur les plate-bandes des partis fascistes (par exemple lorsque C. Castaner, ministre de l’Intérieur, promeut une société de la vigilance).
Cela se fait en faveur des inégalités sociales, comme le Chili qui actuellement tremble dans ses fondations après des années de néolibéralisme frénétique. Mais qu’on se rassure sur ce point, comme le dit le ministre Français J. Y. Le Drian le 22 octobre dernier à l’Assemblée Nationale : le Chili est une démocratie qui a apporté des « réponses » aux revendications malgré « les violences qui ont donné lieu à un bilan humain lourd » (et par conséquent, il n’y a aucune raison de remettre en cause la participation de la France à la COP 25 qui aura lieu en décembre 2019 à Santiago). Les périphrases en disent long : outre le déni, on interprète très bien l’idée selon laquelle ce sont les « violences » du peuple qui sont la causes des morts sous les balles d’une police pourtant connue pour sa violence « légitime ». D’ailleurs, la France n’a pas à rougir de sa politique de maintien de l’ordre, puisque ce sont bien les mêmes méthodes de pourissement politique et de répression qui prévalent dans plusieurs pays.
Et, pour finir la litanie, cela se fait aussi en faveur d’une technocratie qui, petit à petit remplace les mécanismes démocratiques pour maintenir en place la collusion entre capitalisme et représentativité. Ainsi on remplace la voix du peuple par des mini-conseils ou des mini-débats (et le texte ci-dessous est visionnaire sur ce point), ou bien on joue sur un incessant ballet de modifications constitutionnelles afin de consolider un système moribond.
Le théoricien anarchiste Peter Gelderloos a des avis sur ces questions. Bousculant les idées reçues sur la démocratie et les mouvements sociaux qui s’y exercent, il est l’auteur en 2013 d’un ouvrage intitulé The Failure of Nonviolence: From the Arab Spring to Occupy (traduit en Français en 2018 sous le titre Comment la non-violence protège l’État : Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux). L’année dernière le 05/11/2018, il publie un long texte prospectif intitulé « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast ». Ce texte résonne parfaitement aujourd’hui, alors que dans les pays démocratiques la crise du capitalisme entraîne une crise des institutions que pourtant on pensait constitutionnellement indépendantes.
Bien que je ne puisse pas apprécier certains raccourcis historiques hâtifs de la part de Peter Gelderloos, et bien que certains points méthodologiques font la part bien trop belle au déterminisme, j’ai pris la décision de traduire ce texte et le diffuser (avec l’accord de l’auteur). La principale raison est qu’il y a bien peu d’auteurs qui, aujourd’hui, osent se lancer dans une critique prospective sans tomber dans le piège du futurisme ou du catastrophisme. Peter Gelderloos nous propose ici un texte lucide dont certains points se sont déjà vérifiés depuis la première publication du texte.
La difficulté de lecture pourra néanmoins concerner les aspects historiques souvent trop peu connus (mais Wikipédia pourra alors être d’une grande aide) ou un vocabulaire auquel le lecteur européen est peu habitué (on peut citer par exemple la manière d’aborder la notion de suprémacisme blanc). D’autres points seront tout à fait compréhensibles car ils partent du même diagnostic que l’on trouve chez tous les défenseurs des libertés.
Les mouvements du capitalisme, les réponses sociales et les interactions entre l’économie et les types de régimes politiques sont autant de clés pour une lecture historique et actuelle de la société. Lorsqu’on aborde ces thèmes, en particulier pour tâcher de construire l’avenir, il n’y a aucune raison de ne pas proposer de critique de la démocratie au prétexte que le régime est en soi non-critiquable. Mais nos inhibitions sont souvent les fruits de nos certitudes. Et si pour changer on adoptait un point de vue anarchiste ?
- Document original publié le 05/11/2018 sur CrimethInc. sur sous le titre « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast ».
- Publié aussi sur The Anarchist Library à cette adresse. Disponible en V.F. sur La Bibliothèque anarchiste.
Perspectives d’avenir
Entre la crise de la démocratie et la crise du capitalisme : quelques prévisions
Peter Gelderloos / traduction (24/10/2019) par Framatophe.
Ce n’est un secret pour personne : la démocratie et le capitalisme sont tous deux en crise. Pendant plus d’un demi-siècle, les dirigeants et leurs experts se sont bornés à à faire valoir la démocratie comme un régime « préférable au communisme (d’État) ». Dans les années 1990 et la plus grande partie des années 2000, ils n’avaient même pas à se justifier du tout. La démocratie était la seule voie possible, le destin téléologique de l’humanité tout entière.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Sur la scène mondiale, les institutions démocratiques de coopération interétatique sont en désordre, et l’émergence de nouvelles alliances et de nouvelles positions suggère qu’une alternative commence à se coaliser. Au niveau des États-nations proprement dits, la base qui a permis un grand consensus social pendant des décennies a pratiquement disparu. Il y a de plus en plus de mouvements à droite pour reformuler le contrat social – et, à la limite, pour en finir complètement avec la démocratie – alors que la gauche prépare une vague de fond pour renouveler la démocratie et lisser ses contradictions en renouvelant le rêve de l’inclusion universelle et de l’égalité. Ces deux mouvements suggèrent que la démocratie telle qu’elle existe actuellement ne peut pas perdurer.
Entre-temps, la crise financière mondiale de 2008 n’a pas été résolue, elle s’est simplement stabilisée grâce à la privatisation massive des ressources publiques et à la création de nouvelles bulles financières toujours plus grosses pour absorber temporairement le capital en excès. Le capitalisme a désespérément besoin d’un nouveau territoire pour s’étendre. Quelle que soit la stratégie adoptée par les capitalistes, il leur faudra fournir une croissance exponentielle des opportunités d’investissement rentables et une solution au chômage de masse qui pourrait toucher plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale car l’Intelligence Artificielle (IA) et la robotisation la rendent inutile.
Ces deux crises sont intimement liées. Les capitalistes soutiendront les modèles gouvernementaux qui protègent leurs intérêts, alors que seul l’État peut ouvrir de nouveaux territoires à l’accumulation de capital et réprimer la résistance qui se manifeste toujours. En tirant sur les coutures révélées dans cet interstice, nous pouvons commencer à diagnostiquer l’avenir que ceux qui détiennent le pouvoir s’affairent à échafauder afin de tenter d’enterrer les possibilités divergentes et émancipatrices qui se présentent à nous. Si nous ne faisons rien, cette Machine que nous combattons corrigera ses dysfonctionnements. Si nous analysons ces dysfonctionnements et les solutions qui nous sont offertes, nous pouvons agir de façon plus intelligente. La crise nous offre l’occasion d’une révolution qui pourrait abolir l’État et le capitalisme, mais seulement si nous comprenons comment la domination évolue et seulement si nous cherchons à bloquer son avancée, au lieu d’ouvrir la voie à de nouvelles formes de domination comme tant de révolutionnaires l’ont fait dans le passé.
Pour ce faire, nous examinerons l’architecture du système mondial actuel et nous identifierons exactement ce qui ne fonctionne pas dans ce système. Le diagnostic permettra de déterminer ce dont le capitalisme a besoin pour sortir de la crise actuelle et quelles options lui offrent l’horizon le plus prometteur, notamment la possibilité d’une expansion bioéconomique. Parallèlement, nous analyserons la crise de la démocratie, tant au niveau de l’État-nation qu’au niveau de la coopération interétatique et mondiale ; nous comparerons les solutions, qu’elles soient fascistes, démocrates-progressistes, hybrides ou technocratiques, envisagées pour rétablir la paix sociale et satisfaire les besoins des capitalistes. Au cours de cette discussion, nous nous pencherons sur le changement climatique, qui est un élément clé qui conditionne les crises gouvernementales et économiques et qui suggère – ou même exige – une synthèse dans les réponses à ces deux crises. Enfin, nous aborderons ce que tout cela signifie pour nous et nos possibilités d’action.
L’État ethnique
Le 20 juillet 2018, avec la signature de la loi loi « Israël, État-nation du peuple juif », Israël est devenu le premier État ethnique explicite. Les actions du Likoud et la coalition réactionnaire qu’il représente mettent en évidence la crise de la démocratie.
Un État ethnique est une reformulation récente de l’État-nation souverain, cet élément fondamental de l’ordre mondial libéral depuis le traité de Westphalie de 1648 jusqu’à nos jours. Ethnos et nation ont la même signification – la première d’une racine grecque, la seconde d’une racine latine – donc la différence est contextuelle. De 1648 à 1789, l’État-nation a évolué jusqu’à prendre sa forme actuelle en tant que complexe institutionnel qui prétend donner une expression politique à une nation par le biais du mécanisme de représentation, modulé par la vision du monde des Lumières et les valeurs d’égalité juridique et de droits universels.
S’écartant de ce modèle désormais poussiéreux, l’État ethnique est une révision de la pensée du siècle des Lumières, en se fondant sur une interprétation, au xxie siècle, des anciens concepts politiques. Au xviie siècle, aucune des nations occidentales n’existait en tant que telle ; elles se forgeaient encore à partir de myriades d’expressions linguistiques et culturelles et inventaient les institutions sociales capables de peser culturellement assez lourd pour créer une identité commune et inter-classe de peuples disparates. La proto-nation la plus stable de l’époque, les Britanniques, était encore une alliance hiérarchique de plusieurs nations. Les créateurs du système d’État-nation (ou interétatique), ceux que nous appellerions anachroniquement les Hollandais, étaient connus sous le nom de Provinces Unies ou de Pays-Bas, et leur unité reposait davantage sur une opposition commune au pouvoir impérial Espagnol des Habsbourg que sur une identité nationale commune. Ils n’avaient pas de langue ou de religion commune.
À l’origine, la souveraineté westphalienne était un système de ségrégation et de droits des minorités : des frontières solides étaient tracées entre les entités politiques, mettant fin au système féodal disparate dans lequel la plupart des terres étaient inaliénables et étaient réparties entre plusieurs propriétaires et utilisateurs. Comme les puissances féodales avaient des possessions dans plusieurs pays, aucun pays n’était soumis à une hiérarchie politique uniforme. Le système westphalien a cimenté de telles hiérarchies, aboutissant à la reconnaissance d’un souverain suprême dans chaque pays, et à la reconnaissance de la religion des dirigeants comme la religion du territoire. Cependant, les membres des minorités religieuses avaient toujours le droit de pratiquer en privé dans la mesure où ils étaient catholiques, luthériens ou calvinistes (car seules les Provinces Unies pratiquaient une tolérance religieuse assez large pour inclure les anabaptistes et les juifs). Dans sa phase inachevée, ce système a utilisé l’identité religieuse pour exercer la fonction de ségrégation que la nation allait remplir par la suite.
Comme il n’y avait pas encore de science de la nation, les différentes stratégies de construction nationale qui sont apparues au cours des deux siècles suivants ont d’abord été considérées comme également valables : le melting-pot américain, le colonialisme français des Lumières, l’essentialisme scientifique par lequel les grands penseurs universitaires et gouvernementaux du monde occidental ont tenté de figer l’origine ethnique en une réalité biologique.
Au xxie siècle, les mécontents réactionnaires de l’ordre mondial libéral font appel à un essentialisme scientifique dépassé pour contester les évolutions postmodernes et transhumanistes du concept de nation. Ces dispositifs idéologiques plus flexibles associent l’intégration mondiale croissante du capitalisme à une intégration philosophique de l’humanité. Les postmodernes ont mis à nu les mécanismes brutaux de l’édification de la nation pour dépeindre une similitude aliénée qui traverse prétendument les continents, tandis que les transhumanistes adaptent les valeurs libérales à un culte de la bio-machine, dans lequel les différences supposées entre communautés humaines deviennent irrationnelles et une version moderne et progressive de la culture occidentale est proposée comme nouvel universel.
S’opposant à ces innovations psycho-économiques, les promoteurs réactionnaires de l’État ethnique utilisent un pilier fondamental de la modernité contre un autre, utilisant une acception de la nationalité provenant à la fois du XIXe et du xxie siècle, ravivant les éléments suprémacistes blancs toujours présents dans la pensée des Lumières et rejetant ce qui avait été l’élément intégralement interconnecté de l’égalité démocratique.
En d’autres termes, l’État ethnique d’aujourd’hui n’est pas seulement une reformulation de l’État-nation classique : l’État ethnique émerge de l’autre côté de la démocratie, tentant de rompre avec la vieille synthèse des Lumières. Pourtant, en même temps, la nouvelle formulation exige que l’État ethnique remplisse l’ancien objectif supposé de l’État-nation : prendre soin d’un peuple et lui donner une expression politique. Les promoteurs de l’État ethnique estiment que cette tâche est plus importante que ce qui, pendant des siècles, a été considéré comme des fonctions indissociables et concomitantes dans la pensée occidentale : la garantie de l’égalité des droits et la participation démocratique.
Si nous le regardons en face, nous constatons que l’État ethnique est une réponse réactionnaire à une crise de la démocratie et de l’État-nation. Une crise qui est, sinon générale, certainement mondiale. Notant le premier indice qui pourrait nous permettre d’identifier des schémas plus larges, rappelons que c’est la gauche para-institutionnelle du mouvement altermondialiste qui a d’abord sonné la crise de l’État-nation et appelé l’État – comme il le demande encore pathétiquement – à remplir son devoir et à prendre soin de ses populations.
L’État israélien a révélé sa volonté de rompre avec l’égalité démocratique afin de construire une nouvelle synthèse en légiférant des droits non égaux, en refusant explicitement aux Arabes, aux musulmans et aux autres non-juifs le droit à l’autodétermination ou le droit à la terre et au logement, en soulignant même un engagement symbolique à la démocratie selon les termes de la nouvelle loi.
Le système mondial
La période entre la Première et la Seconde Guerre Mondiale a représenté un interrègne au cours duquel le Royaume-Uni s’est battu pour conserver sa domination dans un système mondial en voie d’extinction, tandis que l’Allemagne et les États-Unis s’en sont disputés les rôles d’architectes rénovateurs (l’URSS ayant rapidement abandonné ses piètres tentatives). Comme l’affirme Giovanni Arrighi, le crash de 1929 a signifié la crise finale du système britannique. Depuis la Seconde Guerre, les États-Unis ont conçu et dirigé un système mondial d’accumulation économique et de coopération interétatique. Prétendue championne de la décolonisation, elle-même nation d’anciennes colonies qui ont obtenu leur indépendance, les États-Unis ont gagné la participation de la quasi-totalité de la population mondiale à leur système en créant l’ONU et en donnant à tous les nouveaux États-nations une place à la table des négociations. Par l’intermédiaire des institutions de Bretton Woods – le Fonds monétaire international et, plus tard, le GATT/OMC – les États-Unis ont amélioré le système britannique antérieur et intensifié la participation mondiale au régime capitaliste en créant un ensemble équitable de règles fondées sur l’idéologie du libre-échange. Les règles étaient honnêtes dans la mesure où elles étaient censées être les mêmes pour tous, contrairement à l’ancien système colonial qui reposait explicitement sur la suprématie et la puissance militaire – le genre de pratiques crues qui avaient été nécessaires pour imposer brutalement l’économie capitaliste à la population mondiale. Et les règles étaient attrayantes pour les acteurs dominants parce qu’elles éliminaient les obstacles au jeu du capital accumulant toujours plus de capital, de sorte que ceux qui en avaient le plus profiteraient le plus. Dans ce diabolique arrangement, les États-Unis ont maintenu leur supériorité militaire – le seul élément au sujet duquel personne n’a parlé d’égalisation – par le biais de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
C’était peut-être une structure à toute épreuve, mais le pouvoir est d’abord et avant tout un système de croyances, et le pouvoir de la stupidité est tel que rien au monde n’est infaillible. Il ne faut jamais s’attendre à ce que l’État soit au-dessus des effets de la stupidité ; à plusieurs niveaux, l’État est l’institutionnalisation de la stupidité humaine. La vraie sagesse n’a jamais eu besoin d’un État.
Avec un pouvoir aussi remarquable, la classe dirigeante américaine sentait qu’elle était au-dessus de ses propres règles. Ce sont les États-Unis, et en particulier les réactionnaires de ce pays, qui ont saboté l’ONU, l’OMC et l’OTAN. Sur les trois, paralyser l’ONU était le projet le plus collaboratif, impliquant démocrates et républicains dans une proportion presque égale ; bien que les démocrates aient fait un meilleur travail pour que l’ONU se sente appréciée, mais ils l’ont toutefois empêchée de remplir sa mission au Vietnam, au Salvador, au Nicaragua, en Afrique du Sud et, surtout, en Israël.
Il est de circonstance que la nouvelle synthèse qui pourrait sonner le glas du système mondial américain trouve sa première manifestation en Israël, son allié le plus coûteux et inopportun bénéficiaire. Plus que tout autre État-client sanguinaire, c’est l’utilisation agressive du soutien américain par Israël qui a fait de l’ONU un tigre de papier incapable de faire face aux injustices les plus flagrantes dans le monde. Ce n’était pas non plus un prix à payer pour servir des intérêts géopolitiques machiavéliques au Proche-Orient. L’Arabie saoudite, l’Égypte et d’autres États arabes se sont avérés des alliés plus fiables, avec plus de ressources naturelles, alors qu’Israël est petit, belligérant et déstabilisateur. Il est possible que cette alliance désastreuse soit moins le résultat d’une pensée stratégique que d’une pensée suprémaciste blanche et chrétienne – l’identification de la classe politique américaine à une culture judéo-chrétienne. La tendance suprémaciste blanche israélienne est beaucoup plus développée que la tendance suprémaciste blanche saoudienne. Non pas par la faute des Saoudiens, qui ne se retiennent pas d’abuser et d’exploiter leurs propres classes marginalisées et racialisées, mais parce que, mille ans après les Croisades, les Occidentaux considèrent toujours les Arabes et les musulmans comme une menace.
Certes, avec plus d’aide militaire par habitant que tout autre pays du monde (et les dépenses militaires par kilomètre carré les plus élevées), Israël a été très utile à l’OTAN en tant que laboratoire militaire développant des techniques non seulement pour la guerre entre États mais aussi le type de guerre intérieure qui concerne davantage les États-Unis, le Royaume-Uni, la France : les quartiers sécurisés qui se défendent contre les ghettos racialisés. Mais d’autres pays auraient aussi pu jouer ce rôle sans déstabiliser de point chaud géopolitique.
Les systèmes mondiaux fluctuent toujours et finissent par disparaître. Les tendances de ces changements sont des terrains d’étude intéressants. Jusqu’à présent, les systèmes mondiaux successifs ont montré une alternance entre expansion et intensification. Le cycle d’accumulation des Pays-Bas a représenté une intensification des modes d’exploitation coloniale. Cette exploitation s’était déjà répandue dans tout l’océan Indien et jusqu’en Amérique du Sud grâce au partenariat Portugais et Castillano-génois, mais les Hollandais ont perfectionné la technique de la terre brûlée des nouvelles économies et des nouvelles sociétés.
Le cycle d’accumulation des Britanniques représentait une expansion géographique qui a vu le colonialisme (qui utilisait encore des modèles économiques et politiques largement néerlandais) absorber tous les coins du monde. Et le cycle d’accumulation des États-Unis représentait une intensification des relations capitalistes et interétatiques qui s’étaient développées au cours du cycle précédent, à mesure que les colonies se libéraient politiquement afin de participer davantage au capitalisme occidental et aux structures démocratiques mondiales.
Le rythme de plus en plus rapide de ces changements suggère que nous sommes en passe de connaître un nouveau cycle d’accumulation. Arrighi a émis l’hypothèse que la crise pétrolière de 1973 était le signal de la crise du cycle américain, marquant le passage de l’expansion industrielle à l’expansion financière et donc le gonflement d’une bulle massive, qui devait faire de la récession de 2008 la crise finale. La fin apparente de l’hégémonie américaine, que les historiens de demain pourraient dater jusqu’en 2018, à moins que 2020 n’apporte des changements extrêmes, suggère que nous sommes peut-être déjà dans l’interrègne. En témoignent la déclaration de la Palestine, après le déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem, selon laquelle les États-Unis n’avaient pas leur place dans les futures négociations de paix ; ou les déclarations que l’UE est prête à faire sans la coopération étroite des États-Unis ; ou le rôle croissant de la Chine dans la géopolitique à travers l’initiative Belt and Road ; ou le lancement du partenariat transpacifique (la plus grande zone de libre-échange au monde) sans les États-Unis ; ou encore la course diplomatique que la Corée du Nord a menée autour des États-Unis – par le biais de négociations bilatérales avec la Corée du Sud et la Chine, puis avec les négociations avec les États-Unis dans lesquelles ces derniers n’avaient aucun moyen de pression – détruisant de fait le consensus international et l’embargo les plus efficaces que les États-Unis avaient jamais orchestrés.
Comprise comme l’idéologie qui sous-tend le système mondial dirigé par les États-Unis, la démocratie est en crise parce que l’hégémonie américaine est en crise, et elle est également en crise parce qu’elle ne parvient pas à fournir l’expression politique qui suffira à maintenir les populations mondiales intégrées dans un système économique et interétatique unique, de la Grèce à la Hongrie et à la Birmanie.
La coalition réactionnaire qui a été créée par Nétanyahou – et non par Trump – ne représente pas la seule façon de progresser à partir de la démocratie libérale. Mais le fait qu’un État important, suivi d’un nombre croissant d’autres États, est en train de briser une synthèse ancienne et sacrée – retourner l’État-nation contre l’égalité universelle – est la preuve irréfutable que le système mondial qui nous a gouvernés jusqu’à présent s’effondre.
La droite réactionnaire
En tant qu’étiquettes politiques, gauche et droite se réfèrent à l’origine aux bancs gauches et droits des États Généraux au début de la Révolution Française, avec des tendances politiques différentes qui recoupent les différentes rangées. À proprement parler, les anarchistes n’ont jamais appartenu à la gauche, à moins que l’on ne compte ces moments honteux où une partie du mouvement a rejoint les bolcheviks en Russie ou encore le gouvernement républicain en Espagne. Plutôt que d’être des exemples d’action anarchiste efficace, il s’agissait d’opportunistes et de possibilistes médiocres, incapables de tempérer les tendances autoritaires de leurs alliés d’autrefois, ni même de sauver leurs propres peaux.
Néanmoins, les anarchistes ont toujours participé à des mouvements révolutionnaires et ont toujours été des ennemis farouches des mouvements réactionnaires, et en tant que tels, nous avons souvent éprouvé un grand sentiment de proximité avec la base – et non avec les dirigeants – des organisations de l’aile gauche. Les tout premiers anarchistes à prendre ce nom furent les enragés de la Révolution Française qui étaient trop téméraires pour rejoindre les Jacobins et les Girondins dans leur politique de pouvoir, leurs alliances sordides, leurs bureaucraties étouffantes et les massacres des paysans au nom de la bourgeoisie.
Dans ce cadre historique, la droite est certainement la branche la plus répugnante du gouvernement, mais pas nécessairement la plus dangereuse pour les gens qui se trouvent en bas de l’échelle. Dans le cas de la Révolution Française, oui, les paysans mouraient de faim sous la monarchie, mais ils ont été massacrés par les Jacobins, et finalement dépouillés des biens communs pour toujours par les différentes libéraux progressistes.
De toutes les tendances du pouvoir, la droite réactionnaire a été la moins perspicace pour sentir la direction du vent. Tout changement graduel dans l’organisation du capitalisme mondial et du système interétatique a emprunté beaucoup plus à la gauche qu’à la droite, mais cela ne signifie pas que la droite soit sans importance. Elle n’est pas tournée vers l’avenir, on peut même la décrire comme cette part de la classe dirigeante qui n’a jamais de bonnes idées, mais les conflits que la droite a poussés à maintes reprises au-delà du point d’ébullition sociale façonnent généralement, bien que négativement, le régime à venir. L’avenir a rarement appartenu aux Napoléons et aux Hitler, mais ils ont laissé leurs empreintes sanglantes, décimant les classes les moins élevées et les luttes sociales de leur temps. Et lorsque la gauche a été plus efficace dans l’élaboration de nouveaux régimes de domination et d’exploitation, c’est en cooptant les réflexes de survie des classes populaires et en étouffant les éléments les plus radicaux dans des alliances progressistes qui semblaient alors nécessaires pour assurer la survie face aux attaques de la droite.
Si l’avenir est une Machine à orienter des résultats inconnus dans l’intérêt de ceux qui dominent une société, cette interaction entre la droite et la gauche a longtemps été l’un de ses principaux moteurs.
Une analyse historique montre à l’évidence que les changements dans les modèles de gouvernement et d’exploitation ne surviennent pas dans un seul pays, mais toujours en réponse à une dynamique qui a été mondiale pendant des siècles.
Il en va de même pour une nouvelle mouture de la droite réactionnaire qui, au centre du système mondial à l’agonie – l’Occident anachronique – a trouvé un terrain commun pour faire émerger le programme de l’État ethnique. Ceux qui suivent les tendances du néo-fascisme ont tracé la portée internationale de cette idée, mais ils ont rarement mentionné le rôle de premier ordre occupé par la droite israélienne, une omission qui n’est plus justifiée depuis la nouvelle loi du 20 juillet. L’angle mort concernant Israël était idéologiquement inscrit, étant donné le poids que la gauche allemande – influencée par l’idéologie anti-allemande pro-israélienne – a eu dans l’articulation de l’anti-fascisme contemporain. Mais nous en reparlerons plus tard.
Le Likoud de Netanyahou est à la tête d’une nouvelle coalition qui comprend la Hongrie sous Orban au gouvernement depuis 2010, la Pologne fermement à droite depuis 2015, et la nouvelle coalition d’extrême droite à la tête de l’Autriche depuis fin 2017.
Cette alliance politique conclut l’un des débats les plus stériles du xxe siècle, celui sur le sionisme, dans lequel ses nombreux critiques juifs (Arendt, Chomsky, Finkelstein, etc.) ont été délégitimisés par cette caricature artificielle du « Juif qui se hait ». Maintenant que les défenseurs du sionisme ne cherchent plus à justifier leur projet raciste en termes démocratiques, il devient également clair que c’est la droite israélienne, et non la gauche juive, qui a une tolérance politiquement opportune pour l’antisémitisme. Orban n’a pas seulement fait des commentaires antisémites au sujet de George Soros : lui et sa base commémorent régulièrement les collaborateurs nazis qui gouvernaient autrefois la Hongrie. Le gouvernement polonais de droite a récemment rendu obligatoire le déni de l’Holocauste, criminalisant toute mention du fait que la Pologne était complice de l’Holocauste. Et le partenaire minoritaire de la coalition du chancelier autrichien Kurz est le néo-fasciste Parti de la Liberté, qui a édulcoré sa rhétorique antisémite sans changer fondamentalement d’opinion.
Il est stratégique à court terme pour Israël de tenter de déstabiliser l’Union européenne et la soi-disant communauté internationale dans son ensemble, car de nombreux membres des deux alliances considèrent Israël comme un paria pour ses violations flagrantes des accords internationaux. En brisant ce consensus, Israël ouvre davantage d’opportunités pour construire des alliances bilatérales et réintégrer la géopolitique mondiale. Sur un autre plan, cependant, cette stratégie va certainement à l’encontre de ses intérêts les plus fondamentaux. En chassant l’ensemble de la gauche israélienne dans ce qui est devenu une diaspora majeure, la droite prive l’État israélien de la possibilité d’un rajeunissement démocratique dans l’avenir, lorsque les choses iront mal, comme cela arrivera inévitablement. En ne montrant aucun respect pour la vie des Palestiniens, il devient de plus en plus illusoire qu’ils puissent compter sur la pitié de leurs voisins dès lors que l’aide militaire américaine – non seulement à Israël mais aussi à l’Arabie saoudite et à l’Égypte – ne leur offre plus de bouclier efficace.
Une classe dirigeante israélienne lucide aurait fait des concessions, en faisant semblant de respecter l’ordre international et en adaptant son inhérente suprématie blanche, tout comme la classe dirigeante américaine l’avait fait dans les années 1960 et 1970 pour restaurer sa légitimité ternie en redéfinissant elle-même son suprémacisme. Comme nous l’avons déjà dit, la droite réactionnaire omet souvent de privilégier la compréhension claire de ses propres intérêts à long terme sur les idéologies troubles avec lesquelles elle justifie les inégalités et les instabilités qu’elle impose.
Les nazis se sont en fait suicidés en pensant qu’ils pouvaient restaurer l’Allemagne en tant que puissance coloniale par une expansion militaire, non seulement contre la Grande-Bretagne et ses alliés mais aussi contre l’URSS. Et c’est à pas de géant que la droite xénophobe d’aujourd’hui a affaibli économiquement les États-Unis et l’Europe. L’économie de pointe exige un recrutement intellectuel mondial et, par conséquent, des régimes d’immigration relativement ouverts, ce qui explique pourquoi les entreprises de la Silicon Valley ont été bruyamment pro-immigrés et anti-Trump. La décision de Merkel d’accueillir des réfugiés syriens a été juste précédée par l’annonce de la plus grande association d’employeurs allemands pour qui l’économie nationale faisait face à une pénurie de millions de travailleurs qualifiés. Mme Merkel n’a jamais pris la moindre mesure pour sauver les classes défavorisées syriennes des camps de réfugiés en Turquie où elles pourrissaient ; tout son programme consistait à réglementer l’entrée des Syriens de la classe moyenne, ayant fait des études supérieures, et qui pouvaient se permettre de faire un voyage de plusieurs milliers d’euros vers l’Europe.
L’extrême droite n’a absolument aucune réponse à ce casse-tête qui menace actuellement le grand avantage que l’Europe et l’Amérique du Nord ont dans le secteur de la haute technologie sur la Chine, puissance économique mondiale prochainement dominante. Par des guerres commerciales nationalistes et des manœuvres populistes comme le Brexit, ils nuisent en fait à leur économie nationale. En semant la discorde dans ce qui avait été de solides centres de consensus néolibéraux – l’ALENA et l’UE – ils érodent la confiance à laquelle les investisseurs rattachent systématiquement la croissance économique.
Les réactionnaires sont les produits de leur temps. Ils répondent à un consensus démocratique qui se déchire - tantôt en l’anticipant, tantôt en l’accélérant – et proposent de nouvelles synthèses. En tant que réactionnaires, ils sont prêts à se donner beaucoup de mal pour choquer le système afin de restaurer les valeurs élitistes qu’ils défendent ; souvent, les chocs qu’ils fournissent galvanisent un système mondial défaillant pour promouvoir un nouveau plan organisationnel afin de sortir de la période de chaos systémique, où la plupart des acteurs ne reconnaissent toujours pas que l’ancien régime est dépassé. Le problème est que le nouveau plan d’organisation est rarement calqué sur la synthèse qu’ils proposent.
En d’autres termes, la montée du modèle de l’État ethnique jouera sans aucun doute un rôle dans la déstabilisation du consensus néolibéral et menacera les configurations existantes du pouvoir, mais la probabilité qu’il représente le nouveau modèle organisationnel de l’avenir est faible.
Perspectives d’avenir
L’avenir est aussi une machine discursive qui construit le récit qui fait surgir la cohérence d’un chaos d’événements conflictuels, en recadrant tout, en soulignant certaines choses et en écartant les autres. En tant que stratégie politique, cette machine mobilise d’immenses énergies de la part des gouvernements pour produire les résultats souhaités, mais l’horizon fluide de ce qui est techno-socialement possible constitue une limitation majeure. Au moment où l’on découvre le nouveau récit, un développement peut-être politiquement identifié comme une percée stratégique. À ce moment-là, tout s’accélère au point de devenir une initiative partagée, unissant experts gouvernementaux et capitalistes dans une course en avant. Mais avant ce moment, dans la phase inachevée, les entreprises de technologie et les agences de recherche définissent les frontières obscures comme des parois opaques et pâteuses, à travers lesquelles on sent les possibilités inexploitées qui se déclarent comme « rentables ». Le leitmotiv de cette phase est l’admirable intuition du capital-risqueur. L’investissement dans un avenir incertain qui n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle scientifique doit être réalisé à l’aveuglette, comme les paris d’un joueur, plutôt que systématiquement évalué, comme dans les calculs du propriétaire du casino.
Dans cette situation, des idées très différentes du profit sont soumises à la même méthode, stupéfiante. Le casino brûle et poser les jetons pour un autre tour de poker pourrait être plus rentable que d’éteindre le feu. La classe capitaliste présente exactement le même genre de comportement au crépuscule du cycle actuel d’accumulation.
Pratiquement tous les capitalistes américains, outre les entreprises sidérurgiques, sont touchés par la guerre tarifaire, mais ils ont empoché des centaines de millions en réductions fiscales et ils salivent devant les possibilités offertes par l’abrogation des règlements environnementaux. Les capitalistes de la Silicon Valley ont reconnu que les politiques anti-immigration de Trump étaient une mauvaise stratégie commerciale, mais leurs protestations se sont amenuisées. Après tout, les gouvernements ne se contentent pas de restreindre ou de permettre l’accès aux marchés, comme le veut la philosophie libérale. Ils créent aussi des marchés. Microsoft, Google, Amazon et Accenture ont plongé leurs doigts dans des contrats lucratifs avec l’ICE et le Pentagone, offrant un régime frontalier rentable. L’État est nécessaire pour apprivoiser le terrain social de l’expansion économique, mais les États disposent aussi de tant de ressources qu’ils peuvent amener les capitalistes à investir dans des domaines qui contredisent leurs intérêts à long et moyen terme.
Les capitalistes ne connaissent pas l’avenir. Il peut être utile de sonder leurs prédictions, mais au mieux cela nous fait entrer dans la tête d’un expert en profits, alors qu’ils sont aveuglés par leur idéologie à tel point qu’ils ne voient pas la nature contradictoire du capitalisme.
Dans l’ensemble, ce que l’on peut voir dans leur comportement est une augmentation de l’instabilité systémique.
Les États-Unis hébergent toujours le plus grand ou le deuxième plus grand marché du monde, selon la façon dont on l’évalue ; cependant, l’investisseur américain typique conserve maintenant 40% voire 50% de son portefeuille en actions étrangères, soit entre deux et quatre fois plus que dans les années 1980. Rien qu’en 2017, le montant total des fonds américains investis à l’étranger a augmenté de 7,6% (427 milliards de dollars), principalement vers l’Europe, dont 63 milliards de dollars d’investissements dans des sociétés suisses (plus 168 milliards, non comptabilisés comme investissements, déposés sur des comptes bancaires suisses), et encore plus en Irlande. Les investissements directs étrangers aux États-Unis ont chuté de 36% en 2017.
Les ultra-riches investissent également dans des bunkers post-apocalyptiques de luxe, achetant pour des centaines de millions de dollars des installations militaires rénovées ou des silos à missiles en Europe et en Amérique du Nord, équipés pour la survie pendant un an ou plus avec des systèmes autonomes d’aération, de distribution d’eau, de réseau électrique, ainsi que des piscines, des bowlings, des salles de projection. Les ventes de bunkers haut de gamme par l’une des plus grandes entreprises du domaine ont augmenté de 700% entre 2015 et 2016, et ils ont continué à augmenter après les élections présidentielles.
Pour ajouter aux mauvaises nouvelles, les experts en Intelligence Artificielle (IA), y compris bon nombre de ceux qui bénéficient des développements dans ce domaine, préviennent que d’ici dix à vingt ans, l’IA pourrait causer un chômage massif car les robots et les programmes informatiques remplaceront les emplois de fabrication, d’administration, de gestion, de vente au détail et de livraison. Sur les 50 plus grandes catégories d’emplois aux États-Unis, seuls 27 ne sont pas significativement menacées de remplacement par l’IA. Sur les 15 premières, seulement 3 ne sont pas menacées : les infirmiers, les serveurs et les aides-soignants. Les vendeurs dans le commerce de détail, qui occupent la première place avec 4 602 500 employés en 2016, devraient diminuer considérablement à mesure que les ventes en ligne continueront de croître. Dans les magasins physiques qui persisteront en raison des préférences pour l’achat de certains produits en main propre, le personnel de vente au détail subsistera même s’il ne sera plus technologiquement nécessaire, car son but premier est de donner une touche humaine pour encourager les ventes, contrairement aux caissières (le numéro deux avec trois millions et demi) qui continueront à être remplacées par des machines.
En fait, la plupart des catégories d’emplois qui ne seront pas remplacées par des machines ne sont pas protégées par des limites technologiques mais par des limites culturelles. Notre société devrait subir un énorme changement de valeurs pour permettre aux avocats (num. 44) ou aux enseignants du primaire (num. 22) d’être remplacés par des robots. Prenons l’exemple des serveurs, la catégorie d’emploi qui connaît la croissance la plus rapide. À aucun moment de l’histoire, ce travail n’a été technologiquement nécessaire. Mais le fait d’avoir une personne dont le travail est d’attendre, d’être de garde pour transporter votre nourriture de la cuisine à votre table, crée une expérience que ceux qui en ont les moyens ont toujours été prêt à payer pour en bénéficier.
Bien que les pires effets de l’IA et de la robotisation n’aient pas encore été ressentis (en dehors des activités manufacturières, des télécommunications et des services postaux), le sous-emploi est déjà élevé et de plus en plus de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Les taux de chômage réels aux États-Unis sont réputés historiquement bas, mais c’est en grande partie parce qu’un nombre croissant de personnes sans emploi ne sont plus dénombrées parmi la population active.
La dette américaine liée aux cartes de crédit a atteint mille milliards de dollars et les taux d’intérêt ne font qu’augmenter, beaucoup plus rapidement que les salaires, en fait. Cela s’explique surtout par le fait que le principal cadeau fiscal de Trump a forcé la Fed (NdT. Réserve Fédérale) à augmenter les taux pour prévenir l’inflation galopante. La proportion de paiement du service de la dette par rapport au revenu disponible par ménage est récemment revenue aux niveaux élevés que l’on observait juste avant la Grande Récession de 2008 ; en termes simples, les gens doivent dépenser une plus grande part de leur argent pour rembourser leurs dettes. Entre-temps, les effets de stimulation économique engendrés par les réductions d’impôt de Trump devraient prendre fin d’ici 2020. Le ministre saoudien de l’Énergie a également averti que d’ici 2020, la demande croissante de pétrole excédera l’offre en cours de diminution, à moins d’un afflux important d’investissements en vue d’exploiter de nouvelles ressources. Et les prix du pétrole ont déjà augmenté, ce qui tend à augmenter les prix de tous les autres biens de consommation.
Au sujet du pétrole, les industriels ont majoritairement décidés qu’une taxe sur les émissions de carbone était acceptable. Même certains républicains ont proposé une telle taxe. Les entreprises devraient payer 24$ la tonne pour le droit d’émettre du CO2 ; cette somme d’argent serait versée aux ménages les plus pauvres et servirait à améliorer les infrastructures de transports. Le piège de cette proposition, c’est que le gouvernement affaiblirait la réglementation sur les émissions, de sorte que les entreprises pourraient faire tout ce qu’elles veulent avec l’atmosphère tant qu’elles en paient le prix, et elles seraient à l’abri des responsabilités civiles comme celles qui ont été vues à la baisse pour l’industrie du tabac et même pour Monsanto. Tout cela indique que les entreprises du secteur de l’énergie veulent des incitations pour développer des énergies alternatives, qu’elles s’attendent à ce que les prix du pétrole continuent d’augmenter et qu’elles craignent qu’un retour de bâton ne les oblige à payer des dommages.
La dette des entreprises a atteint de nouveaux sommets. La valeur de l’encours des obligations d’entreprises est passée de 16% du PIB américain en 2007 à 25% en 2017. Il y a encore plus d’emprunts d’entreprises sur les marchés émergents et des prêts plus risqués. Tant que les taux d’intérêt seront bas, la plupart des entreprises pourront se permettre de poursuivre cette pratique, mais si les taux d’intérêt augmentent, comme ils sont censés le faire afin de contenir l’inflation, cela pourrait provoquer une cascade de défauts de paiement – le dégonflement de la bulle – surtout si cela coïncide avec le ralentissement économique mondial qui devrait commencer entre 2020 et 2022. Les taux d’intérêt augmentent au fur et à mesure que les affaires baissent : les entreprises ne peuvent pas payer toutes leurs dettes, ou contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciennes.
Il ne s’agit pas seulement d’un problème américain. Bien que la croissance économique indienne et surtout chinoise ait été astronomique, la Chine ralentit et commence à montrer des signes avant-coureurs d’un krach boursier, quant à l’Inde, elle se heurte à des problèmes monétaires qui pourraient bientôt mettre un terme à sa croissance.
Par nature, le capitalisme crée des bulles et s’engage de manière répétitive sur la voie de l’effondrement financier. Cependant, ces effondrements peuvent être très difficiles à prévoir. Élaboré par le théoricien des systèmes mondiaux Giovanni Arrighi, l’un des meilleurs modèles rétrospectifs à ce jour et offrant une vision à long terme de ces cycles d’accumulation, est pourtant déjà en retard dans ses prévisions. Du passé, Arrighi a dressé la frise d’une accélération exponentielle de la fréquence des crises : à mesure que le capitalisme croît exponentiellement, le capital s’accumule et s’effondre de plus en plus rapidement. Cependant, pour que son modèle conserve sa précision géométrique, la Grande Récession de 2008 aurait dû être la crise terminale du cycle d’accumulation américain. Même si, selon certaines mesures, cette récession vient d’être évitée et n’a pas été complètement dépassée, la reprise apparente rompt encore le schéma historique des transitions d’un cycle à l’autre.
Cela s’explique en partie par l’intelligence et la complexité institutionnelle de plus en plus grandes du capitalisme, à savoir le rôle toujours plus important de la planification étatique dans l’économie et les interventions économiques de l’État toujours plus fortes et constantes. Cela réfute les néomarxistes qui annoncent en toute occasion l’obsolescence de l’État, quel que soit le nombre de fois où ils se trompent.
Le New Deal de Roosevelt, un investissement majeur de l’argent du gouvernement dans les travaux publics afin de créer des emplois, a permis aux États-Unis de sortir de la Grande Dépression avant leurs contemporains européens, tout en se positionnant comme le sauveur économique de l’Europe et de l’Asie ravagées par la guerre, et donc comme l’architecte du prochain cycle d’accumulation. Les dépenses publiques massives assimilées à un stimulant économique continu ont caractérisé le système américain, lié à la Réserve fédérale et à un réseau mondial de banques centrales et d’institutions monétaires qui maintiennent l’inflation dans des limites acceptables et renflouent les banques privées ou les petits gouvernements qui font faillite.
Paradoxalement, tout ce régime de stabilité économique est basé sur la dette. Pour empêcher le capitalisme de s’écrouler, les États-Unis et beaucoup d’autres États dépensent systématiquement beaucoup plus d’argent qu’ils n’en ont réellement. Le déficit américain – le montant qu’ils dépensent chaque année au-delà des gains réels – est maintenant supérieur à mille milliards de dollars, et la dette totale est maintenant de 21 mille milliards de dollars, soit plus que le PIB (la production totale de l’économie américaine). Le gouvernement paiera des centaines de milliards de dollars en intérêts à ses créanciers cette année.
Cependant, le système n’est pas aussi instable qu’il n’y paraît. D’un point de vue capitaliste, il est assez bien organisé (bien que, contrairement à l’idéologie du libre marché, il dépende entièrement de l’État). Environ un tiers de la dette est due à d’autres organismes gouvernementaux, principalement la Sécurité Sociale. Cette pratique d’un gouvernement qui emprunte à lui-même stabilise une énorme portion de la dette en la soustrayant aux créanciers privés qui pourraient encaisser des obligations ou cesser de faire des prêts. Cela donne également à ces capitalistes une assurance : si les États-Unis manquent à leurs obligations, ils peuvent en premier lieu choisir de ne pas rembourser la dette due à leurs propres citoyens ordinaires, de sorte que ceux qui en souffrent sont les vieux retraités et non les investisseurs. C’est comme ce qui est arrivé récemment à Porto Rico.
Environ un quart de la dette est détenu par des fonds communs de placement, des banques, des compagnies d’assurance et d’autres investisseurs privés, et plus du tiers est détenu par des gouvernements étrangers, principalement la Chine et le Japon. Les investisseurs privés et les investisseurs d’État étrangers achètent la dette du gouvernement américain parce qu’on considère qu’il s’agit d’un pari sûr. Quiconque a beaucoup d’argent en main veut probablement en investir une partie importante dans un placement sans risque qui rapportera continuellement des intérêts modestes mais sans danger. Mais cela en dit très peu sur les mathématiques de ce pari. Personne ne peut expliquer comment les États-Unis pourraient un jour rembourser leur dette sans dévaluer massivement leur monnaie et détruire ainsi l’économie mondiale. Et plus la dette augmente, plus les intérêts augmentent, jusqu’au moment où le paiement des intérêts dus dépassent la capacité de paiement du budget américain.
Au fond, la notation favorable de la dette américaine signifie seulement que, dans le système économique mondial actuel, les investisseurs ne peuvent pas imaginer que les États-Unis ne soient pas en mesure de payer les intérêts de leurs dettes. Mais la seule façon d’éviter un défaut de paiement est que les investisseurs et les gouvernements étrangers continuent à jamais de prêter aux États-Unis des sommes d’argent toujours plus élevées. La Chine et le Japon (les deux plus grands prêteurs) ont tous deux ralenti leurs achats de dette américaine, tandis que la Russie en a récemment abandonné sa part relativement faible.
Les crises capitalistes sont souvent liées aux guerres, alors même que les États-nations luttent pour le contrôle du système mondial. La guerre est également utile au capitalisme parce qu’elle détruit une énorme quantité de valeurs excédentaires, effaçant l’ardoise pour de nouveaux investissements. C’est fondamentalement un moyen de sauver le capitalisme de lui-même. En permanence, le système économique génère une quantité de capital en croissance exponentielle, jusqu’à ce qu’il ait plus de capitaux qu’il ne peut en investir. Cette abondance – et ce n’est pas une abondance humaine, mais une abondance purement mathématique, car les gens meurent encore de faim, même en ces temps bienheureux – menace de détruire la valeur cumulative de tout capital. Ainsi, une partie est détruite par la guerre, ceux qui misent du côté des perdants sont écartés du terrain, et les autres continuent le jeu.
Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n’y a pas eu de guerre directe entre les grandes puissances, surtout à cause des armes nucléaires qui ont introduit le principe de certitude de la destruction mutuelle. Les progrès technologiques de la guerre ont dépassé son utilité en tant qu’outil politique, sauf à l’échelle des petites guerres par procuration.
Pourtant, dans une économie basée sur l’endettement, il est possible de détruire une énorme quantité d’excédent de valeur sans guerre. L’effacement de la dette américaine nuirait aux gouvernements japonais et chinois et donc à leurs économies, ruinerait de nombreuses banques et fonds communs de placement, et laisserait la majeure partie de la classe ouvrière américaine sans couverture de santé ou sans prestations de retraite.
Dans ce cas, sauf révolution, une économie robuste, capable d’un haut degré de production industrielle et de capitaux liquides pour les investissements et les prêts nécessaires, ramasserait les morceaux et amorcerait un nouveau cycle d’accumulation. L’Union européenne ou la Chine pourraient se trouver dans une telle situation. La première, parce que sa politique de dépenses anti-déficit lui offre une certaine protection et pourrait la distinguer comme modèle d’économie responsable en cas d’effondrement catastrophique du modèle américain ; quant à la seconde, c’est en raison de sa plus grande aptitude gouvernementale à ajuster toute son économie de manière technocratique et à l’aide de ses énormes capacités industrielles.
Après cet effondrement, selon l’ampleur du chaos politique et leur capacité à projeter les forces militaires, les nouveaux dirigeants mondiaux répareraient et reconstruiraient les éléments institutionnels du système actuel qu’ils jugeraient les plus utiles à leurs plans stratégiques, tels que l’OMC ou l’ONU, ou – si les conflits débouchaient sur une rupture avec la structure traditionnelle – ils devraient acquérir une influence politique suffisante pour amener assez de joueurs à la table et créer un nouveau complexe mondial d’institutions.
Mais il y a un problème. Pour que le capitalisme continue, le nouveau cycle d’accumulation qui suivra le prochain effondrement devra être exponentiellement plus grand que celui qui l’a précédé. Cela semble être l’une des caractéristiques les moins variables du modèle historique en vigueur. Intrinsèquement, le montant du capital à investir est en constante augmentation. Ceci explique la variation historique entre les périodes d’expansion géographique, lorsque de nouveaux territoires sont mis en contact avec le capitalisme par le biais d’une relation de principe qui se caractérise au mieux par l’accumulation primitive grâce à une forme de contrôle colonial, et les périodes d’intensification, lorsque les habitants des zones colonisées dans la période précédente sont davantage intégrés et reproduits comme des sujets capitalistes, non seulement en s’adonnant au travail forcé pour produire des matières premières pour les marchés lointains et acheter une petite portion de l’excès de production venant de la métropole, mais aussi en vivant, en respirant et en mangeant le capitalisme, devenant à part entière capitalistes et travailleurs salariés.
Le « siècle américain » a vu l’intensification des relations capitalistes sur l’ensemble du territoire qui était placé sous le contrôle du capital pendant le cycle britannique, ce qui représente pour ainsi dire le monde entier. Il n’y a pas d’autre géographie terrestre pour qu’un nouveaux cycle d’accumulation puisse s’étendre. Certes, l’économie indienne continue de croître et les capitalistes d’État chinois passent par l’Afrique, l’Océanie et les Caraïbes, et engagent des prêts sur un mode prédateur pour acquérir des infrastructures dont la Banque mondiale a été promotrice dans les années 1970 et 1980, tandis que Google et quelques autres entreprises font des incursions tièdes en Afrique pour y encourager une économie fonctionnelle high-tech. Mais ces populations dites sous-développées sont plus petites, et non plus grandes, que les populations d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe, d’Asie et d’Australie, où le développement capitaliste atteint un point de saturation. Pour simplifier grosso modo, le prochain terrain pour l’expansion capitaliste devrait être plus grand pour s’adapter à un autre cycle.
C’est cette problématique qui a conduit à la prédiction dans « Un pari sur l’avenir » et « Exploitation extraterrestre » que le prochain territoire d’expansion capitaliste était hors planète, sur la lune, la ceinture d’astéroïdes, et un jour, Mars. Beaucoup des capitalistes parmi les plus avisés d’aujourd’hui s’engagent dans des investissements et des projets ambitieux pour rendre cela possible. Mais ici sur Terre nous pouvons remercier notre bonne étoile qu’au cours des deux dernières années ils n’aient pas fait de progrès assez rapides pour sauver le capitalisme de son effondrement imminent.
Les fusées réutilisables et le système de récupération des drones de SpaceX constituent l’une des composantes les plus importantes d’un hypothétique cycle extraterrestre d’accumulation – un accès peu coûteux à l’espace – mais aucune des pièces suivantes n’a encore été mise en place. Il s’agirait d’un service de transport de passagers de luxe vers l’espace orbital et, à terme, vers la lune, ce qui ne serait jamais en soi une industrie importante, mais qui contribuerait à injecter des flux de trésorerie à un stade décisif du développement des capacités à plus longue distance, ainsi qu’à vanter l’attractivité de l’espace aux méga-riches afin d’obtenir du financement supplémentaire. La deuxième pièce, plus importante, est l’exploitation des astéroïdes et de la lune. Le Japon et la NASA sont actuellement en train d’installer des sondes robotiques sur des astéroïdes pour effectuer les analyse chimique qui faciliteront la prospection future, entre autres choses, mais ces sondes ne sont pas prévues avant 2020 et 2023, et il reste d’autres étapes à franchir avant de pouvoir commencer l’exploitation commerciale. Sans ces éléments, les fusées moins coûteuses ne contribuent qu’à la rentabilité d’une activité économique résolument géocentrique, c’est-à-dire le lancement de satellites toujours plus nombreux.
Il y a cependant une autre voie possible pour l’expansion capitaliste. Comme le disait Richard Feynman en 1959, « il y a plein de place en bas ».
Expansion bioéconomique
Les sept milliards d’êtres humains sur la planète sont un petit troupeau si l’ensemble du vivant pouvait être assimilé au capitalisme. Il n’y a aucune raison pour qu’une nouvelle expansion productive du capitalisme soit géographique, puisque le capitalisme fonctionne selon les flux, les relations, et non selon les lieux, ou les kilomètres carrés.
Une expansion bioéconomique impliquerait l’invasion du capitalisme dans les processus par lesquels la vie elle-même est produite et reproduite. Les antécédents de cette activité sont importants : ils représentent les premières incursions, mais ils n’ont pas encore été développés au point de déclencher un nouveau cycle d’accumulation. Dans la production de la vie organique, ils concernent les domaines du génie génétique et de la reproduction de la vie humaine, ainsi que les technologies de réseaux sociaux. Les premiers ont permis à certaines entreprises de faire beaucoup d’argent, mais ils n’ont pas été extrêmement efficaces et sont encore loin d’avoir réussi à modifier notre relation avec la production alimentaire, les maladies et les autres domaines d’intervention. Les autres ont sidéré les masses et produit des techniques de contrôle social qui s’améliorent de jour en jour, mais elles se mesurent encore en dollars publicitaires qu’elles génèrent pour la vente de marchandises réelles, donc un secteur quaternaire plutôt qu’une économie à part entière.
Une expansion bioéconomique impliquerait de rentabiliser les processus planétaires qui, une fois intégrés à une logique capitaliste, pourraient être analysés comme « reproductifs » ; rentabiliser les processus biologiques qui sont exploités en permanence par accumulation primitive mais ne se sont pas encore soumis à une architecture capitaliste ; rentabiliser les processus chimiques organiques qui conditionnent le déroulement continu de la vie ; et rentabiliser les processus sociaux qui, sous l’appellation « temps libre », n’ont été jusqu’ici que mal exploités par la consommation.
Au cours des deux prochaines décennies, ces secteurs pourraient voir leurs expansions prendre les formes suivantes :
- Le déploiement de réflecteurs orbitaux ou d’autres dispositifs visant à diminuer puis ajuster la quantité de rayonnement solaire qui atteint la planète. Conjuguée à une multiplication des technologies de captage du carbone, cette évolution pourrait permettre un contrôle mécanique du climat axés sur des modèles d’affaires, non pas comme une biosphère dans laquelle s’inscrit l’économie, mais un nouveau champ économique à considérer.
- L’utilisation du clonage pour prévenir l’extinction d’espèces économiquement utiles. Avec un inventaire total de la biodiversité régulée par l’IA qui peut déployer des drones et des nanorobots comprenant une codification génétique et capables d’identifier et de détruire des espèces cibles, cela pourrait théoriquement permettre un contrôle rationnel total de tous les écosystèmes, avec des paramètres et des objectifs fixés par des consortium d’entreprises et de gouvernements possédant la technologie et contrôlant les procédures.
- L’assemblage de nanomatériaux fabriqués sur commande et l’utilisation d’animaux-usines génétiquement modifiés pour produire des composés organiques complexes. Cela supprimerait le concept de « ressources naturelles » en transformant les matières premières en un produit industriel affranchi des limites naturelles.
- Le développement de la nanomédecine et de la thérapie génique pour soustraire davantage la vie humaine aux aléas de la mort et des maladies qui ont un impact négatif sur la productivité humaine. La mort est particulièrement problématique car elle permet aux gens d’échapper définitivement à la domination.
- Le passage d’une monoculture de plein champ à un modèle de contrôle total décentralisé de l’agriculture basé sur la production en serre et la technique hydroponique. Dans ce modèle la production alimentaire se fait dans un environnement totalement contrôlé en fonction de la lumière, de la chaleur, de l’atmosphère, de l’eau et des nutriments, en rupture avec l’agriculture de la Révolution Verte qui tentait de produire des aliments en modifiant l’environnement naturel par voie industrielle. L’agriculture décentralisée serait plus économe en énergie, réduirait la dépendance au transport sur de longues distances et à la machinerie lourde, et permettrait temporairement une augmentation de l’emploi et des investissements à mesure que les terres agricoles – 40% de la surface de la planète – seraient redessinées et potentiellement réintégrées à l’espace urbain.
La capitalisation des processus sociaux peut progresser grâce à l’expansion des activités économiques dans les domaines de la santé, des loisirs, des activités sexo-affectives, des activités récréatives et du divertissement, ainsi qu’à la surveillance algorithmique et la combinaison de ces secteurs économiques. Cela impliquerait la conquête totale du « temps libre » et l’abolition de cette victoire partielle remportée à travers des siècles de luttes ouvrières.
Il fut un temps où les capitalistes ne pouvaient qu’apprécier la valeur productive de leurs vassaux, considérés comme des esclaves ou des machines, selon que l’on soit progressiste ou non. La résistance de ces classes exploitées n’a pas réussi à abolir cette relation, mais elle a réussi à gagner une certaine marge de manœuvre. L’obtention de salaires plus élevés était avant tout la conquête du « temps libre ». Les travailleurs ne voulaient pas d’un salaire plus élevé pour les mêmes journées de 12 ou 14 heures ; ils ont laissé cela aux classes professionnelles, comme les avocats et les médecins, dont l’estime de soi découle entièrement de leur valeur sur le marché. Ils voulaient pouvoir répondre plus facilement à leurs besoins afin de conserver une partie de leur vie pour leur propre plaisir. L’opposition entre la vie et le travail est on ne peut plus claire.
Le capitalisme ne peut tolérer aucune autonomie, aucun espace libéré, mais il ne peut pas non plus vaincre la résistance des exploités. Pendant un siècle, son approche stratégique avec le temps libre a consisté à produire des activités commerciales alternatives pour capitaliser sur les choix faits par les gens en dehors du travail. Le temps libre était encore libre, mais comme les capitalistes et les décideurs gouvernementaux ont appauvri l’imagination et le paysage social au point que les peuples furent plus enclins à choisir des activités de consommation plutôt que des formes non marchandes de jeu et de détente, ces peuples devinrent dépendants des relations capitalistes, générant de la demande artificielle, et assurant de nouveaux secteurs productifs.
Les espaces verts et les terrains publics ont été asphaltés. La politique partisane et la répression d’État ont conduit à l’effritement des centres ouvriers. Les trottoirs et les places ont été envahis par les terrasses de restaurants. Le canapé devant la radio ou la télévision a remplacé le perron ou les chaises qu’on plaçait à même la rue. Les espaces de vie communs de couture et de lavage ont été remplacés par des machines. Les sports ont été professionnalisés et rendus commerciaux. Les bars ont remplacé la consommation dans les bois ou dans les parcs. Les promenades en montagne ont cédé la place à des sports spécialisés qui dépendent de l’acquisition d’équipements coûteux. Des monstruosités en plastique et, plus tard, des monstruosités électroniques ont éclipsé les jouets en bois simples, imaginatifs et physiquement a attrayants que les oncles sculptaient pour leurs neveux et nièces, ou les simples bâtons que les enfants prenaient sur le sol et transformaient en mille choses différentes selon leurs besoins et selon leur imagination.
Les incursions capitalistes dans le temps libre nécessitaient une publicité qui devint un capteur d’attention de plus en plus agressif et omniprésent, un détournement des possibilités non marchandes sur le terrain du temps libre, avec des rendements à la baisse à mesure que les cibles publicitaires deviennent hostiles, cyniques, sophistiquées, saturées ou égocentrées. La diminution de l’efficacité de la publicité révèle que le temps libre offrait encore aux gens un choix, et bien que les capitalistes aient remporté une victoire écrasante contre la nature, l’imagination et la sociabilité im-médiates (unmediated : ici mon dictionnaire automatique affiche une ligne rouge ondulée pour me dire que « sans médiation » n’est pas un mot) – et l’économie de consommation a été extrêmement rentable et ne cesse de le devenir – nonobstant l’efficacité de la publicité, les puissants préfèrent que nous ne puissions plus avoir aucun choix significatif du tout.
Qu’il en soit ainsi : dans la nouvelle économie, il n’y a plus de distinction entre le temps de travail et le temps libre, ni même entre le temps du producteur et le temps du consommateur ; au contraire, tout le temps vécu est absorbé dans une logique capitaliste unifiée qui conduit à une avance qualitative dans la production des subjectivités. Depuis l’arrivée du téléphone cellulaire, les travailleurs sont toujours sur appel, mais les technologies sociales qui ont été inaugurées plus récemment ou qui attendent leur avènement proche font en sorte que l’ensemble de notre temps vécu fait l’objet de surveillance, de commercialisation et d’exploitation. Alors qu’auparavant l’information sur les consommateurs était vendue à des annonceurs qui pouvaient faire de l’argent en convainquant les gens d’acheter des produits matériels, toute la chaîne économique dépendant en fin de compte de la vente d’un produit manufacturé, nous avons opéré un saut qualitatif où les données sont devenues une ressource à valeur intrinsèque (think bitcoin), et afin de ne pas perdre notre condition d’êtres sociaux, nous devons adosser nos comportements sociaux aux dispositifs numériques qui extraient notre activité pour produire des données.
Avant, vous pouviez encore être un être humain sociable si vous jouiez au football dans le parc, si vous invitiez les gens à un barbecue ou alliez camper dans les bois plutôt que d’acheter des billets pour le match, vous rencontrer dans un bar ou sauter à l’élastique. Aujourd’hui, vous êtes un paria social et inemployable si vous n’avez pas de smartphone, pas de Facebook ou d’Instagram, pas de GPS, et si vous n’utilisez pas cette application stupide qui vous permet d’inviter des gens à des événements.
Il n’est plus possible de passer du temps libre dans les bois, en tant qu’activité non marchande, à partir du moment où vos déplacements y sont suivis par GPS, ce qui permet aux acteurs concernées d’attribuer une valeur aux parcs naturels ou de faire des plans pour occuper cet espace commercial.
Nixon nous a fait renoncer à l’étalon-or pour permettre à l’expansion financière de se poursuivre sans entrave. Pour retrouver la stabilité, le capitalisme peut bien ancrer la valeur économique dans les données – sous une forme ou une autre de bit economy.
L’économie « sociale » (NdT. : ne pas confondre avec l’économie sociale/solidaire) devra se développer considérablement si elle veut permettre un nouveau cycle d’accumulation capitaliste, et bien que permettre l’accès à Internet et aux smartphones à une majorité de la population mondiale soit certainement une condition préalable nécessaire, cela ne sera pas suffisant en soi pour constituer une expansion industrielle. Rappelez-vous que l’expansion économique américaine de l’après-guerre reposait en grande partie sur l’acquisition d’une voiture et d’une maison de banlieue pour tous les gens de la classe moyenne. Par rapport aux maisons et aux voitures, les téléphones sont des équipements trop bon marché pour constituer l’épine dorsale d’une expansion industrielle, étant donné que chaque cycle doit être exponentiellement plus grand que l’expansion industrielle et financière du cycle qui l’a précédé.
La marge de croissance de l’économie « sociale » devra assimiler davantage la surveillance de l’activité vitale des personnes et l’exploitation de leur potentiel productif, afin que la surveillance ne se limite pas à repérer les comportements criminels ou à cibler des produits à promouvoir, mais englobe systématiquement les activités dans une logique économique, invitant ainsi les gens à s’exprimer ou à consacrer leur créativité à la décoration des espaces virtuels et sociaux, permettant à chacun de devenir un influenceur. Elle inclurait également la valorisation du crowdsourcing comme un modèle productif dominant, profitant de la connectivité générale pour traiter la population comme un réservoir de main-d’œuvre disponible en permanence, prête à se consacrer à résoudre tel ou tel problème, souvent sans rémunération en retour. Il y aurait également une croissance exponentielle de l’économie du soin, des loisirs, du sexo-affectif, du jeu, de la gastronomie, des voyages, de la médecine, du design et du divertissement, fusionnant dans une économie de la qualité de vie capable de générer les centaines de millions de profils d’emploi qui remplaceront ceux que l’IA et la robotisation rendront obsolètes dans les secteurs de la fabrication, des télécommunications, du commerce de détail, du design et de l’architecture, du nettoyage et de l’hygiène, puis des transports et de la distribution, du secrétariat et de la comptabilité, de la supervision dans les domaines du bâtiment et de la sécurité, de la surveillance et de la gestion.
Le secteur économique de la qualité de vie compenserait la misère et l’aliénation de la vie capitaliste par une sociabilité totalement organisée. Tout le monde suivrait une sorte de thérapie, et la classe moyenne-supérieure aurait des thérapeutes émotionnels et physiques, des entraîneurs personnels et des conseillers en diététique ; ils mangeraient beaucoup plus souvent à l’extérieur que chez eux, et leur vie tournerait en grande partie autour des activités de loisirs. Les précaires travailleraient non seulement dans la restauration et la vente, mais aussi dans une industrie du sexe en expansion qui se distingue des autres formes d’emploi selon des frontières de plus en plus floues, ou encore comme instructeurs de yoga, guides de sports extrêmes et de tourisme d’aventure, ou comme assistants ou personnages de décor pour des jeux commerciaux de type LARPing, paintball ou autres. Les concepteurs et programmeurs constitueraient un segment important et hautement rémunéré de la classe ouvrière, juste en dessous des cadres et des capitalistes, et suivraient à leur tour les professionnels comme les avocats, les médecins, les technocrates et les professeurs d’université, les flics, les infirmières et autres thérapeutes avec un large éventail de responsabilités et de salaires. Viennent ensuite les « créateurs » précaires mais bien payés, puis les autres professions en col bleu comme les menuisiers et réparateurs qui travaillent dans des situations trop variables pour être traitées en IA, puis encore les enseignants (NdT. : non-universitaires), et enfin, le gros des précaires dans cette économie de la qualité de vie.
Qu’en est-il de Mars ?
Incidemment, les secteurs technologiques – opérant au niveau planétaire, biologique, chimique et social – qui auraient besoin de progresser pour ouvrir le territoire à une autre expansion industrielle sont les mêmes secteurs qui auraient besoin de progresser pour permettre une expansion extraterrestre ultérieure du capitalisme et une véritable colonisation de l’espace extra-atmosphérique. Contrairement aux principales techniques de production et d’accumulation qui caractérisent le cycle qui se termine, une caractéristique majeure de ces technologies est leur décentralisation. De même, pour prendre un exemple, la colonisation de Mars nécessiterait une technologie décentralisée et à petite échelle. On ne peut pas faire voler des grands complexes industriels ; la mission ne serait réalisable qu’avec des nanorobots, des imprimantes 3D et des machines auto-reproductives. Les nanomatériaux fabriqués sur mesure seraient cruciaux pour des constructions capables de résister à des environnements extrêmes, et le clonage combiné à l’agriculture en serre dans des environnements totalement confinés et contrôlés serait nécessaire pour amorcer la production alimentaire et la production biosphérique. Qui plus est, une terraformation efficace serait impensable si l’État n’avait pas déjà l’expérience d’un contrôle climatique efficace ici sur Terre.
Quant aux technologies sociales, elles pourraient bien être la cheville ouvrière. La technologie décentralisée, telle qu’elle serait nécessaire dans une colonisation extraterrestre, peut contribuer à la décentralisation politique. Toute entreprise capitaliste, toute association scientifique et toute agence gouvernementale qui collaborent un jour à la colonisation de Mars ou d’un autre corps céleste aborderont sans aucun doute, avec mille autres questions techniques, la question de savoir comment garder le contrôle des colonies. Il n’est pas facile d’exercer un effet de levier militaire et bureaucratique sur une population qui se trouve à un ou plusieurs mois de voyage. Il y a cinq cents ans, les colonisateurs européens y sont parvenus grâce aux technologies sociales du christianisme et de la blancheur de peau, mais non sans quelques grandes mutineries et défections.
Encore une fois, il est plus logique d’analyser la situation sous l’angle du contrôle social que sous celui de l’accumulation du capital. Le capitalisme a longtemps favorisé des techniques de production industrielle beaucoup plus inefficaces et centralisées parce que l’État n’avait pas les techniques pour maintenir le contrôle sur une production dispersée. Plutôt que de rester un simple comité d’organisation du Capital, l’État remplace et englobe le Capital, car le territoire effectivement discipliné par l’État est le seul territoire où le capitalisme peut fonctionner. Ainsi, le contrôle général rendu possible par les nouvelles technologies sociales (cet Internet des objets dans lequel nous sommes les objets de prédilection) est une composante vitale de la colonisation extraterrestre.
La nécessité du changement climatique
Les récents remous de l’économie Turque qui ont failli faire chavirer l’UE, montrent clairement que la croissance économique actuelle ne cesse de dépendre d’une accumulation financière non soutenable. Les banques européennes n’ayant nulle part en Europe pour investir tous leurs bénéfices, elles financèrent alors une énorme vague de construction en Turquie, tandis que les entreprises turques se développaient en empruntant des dollars, profitant du faible taux d’intérêt. À court terme, de l’argent gratuit. Mais à mesure que le taux d’intérêt américain grimpait, la valeur de la livre turque s’effondrait, et comme l’économie locale n’avait jamais sollicité ce boom de la construction, elle n’a pas eu les moyens de rembourser la totalité des prêts. Les actions de toutes les grandes banques européennes ont alors chuté. Ça aurait pu être le début d’un gros krash. Mais le Qatar est intervenu avec un prêt de 15 milliards de dollars pour la Turquie, montrant une fois de plus l’importance de la politique : l’une des premières initiatives diplomatiques de Trump dans la région avait été de s’associer à l’Arabie saoudite et de se rallier pleinement à l’éviction du Royaume du Qatar. Puis Trump s’est brouillé avec la Turquie et a essayé de couler son économie. Le Qatar est alors intervenu pour la sauver, du moins pour l’instant. Mme Merkel, elle aussi récemment dupée par les États-Unis, a tenté de normaliser les relations avec la Turquie alors qu’elle avait même été l’une de ses principales détractrice.
Il y a des bulles de l’immobilier similaires au Brésil, en Chine, à Singapour. La prochaine crise pourrait commencer n’importe où, mais elle se propagera sans doute partout.
Si une expansion bioéconomique est le moyen le plus viable pour le capitalisme d’éviter ses contradictions et de poursuivre son déchaînement frénétique, quelles sont les stratégies politiques qui permettraient à cette expansion d’avoir lieu ? Certains des changements technologiques décrits ci-dessus sont déjà en cours, mais de nombreux éléments clés exigent un changement si radical qu’une planification stratégique à l’échelle mondiale serait nécessaire. Ce n’est pas de bon augure pour le capitalisme, puisque les institutions mondiales de coopération interétatique sont en désordre, en grande partie à cause des acteurs d’extrême droite de Netanyahou à Poutine et à Trump.
En fin de compte, la guerre contre le terrorisme n’a pas réussi à rallier les grandes puissances pour créer une nouvelle ère de coopération mondiale. Parce qu’elle a trop emprunté au jeu à somme nulle de l’orientalisme de la Guerre Froide, elle n’a conduit qu’à l’érosion des structures politiques mondiales qui maintenaient l’hégémonie américaine.
Actuellement, la seule tribune valable pour lancer un nouveau projet de coopération interétatique capable de déployer et de gérer les changements qu’exigerait une expansion bioéconomique du capitalisme se trouve dans la réponse au changement climatique. Le changement climatique fournit un tableau narratif de l’ensemble des intérêts mondiaux. Tout pouvoir politique qui agit au nom de la lutte contre le changement climatique peut agir au nom de l’humanité tout entière : cela permet d’établir un projet hégémonique, de la même manière que le récit de la démocratie et des droits humains a alimenté projet hégémonique après les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale. Les structures politiques de coordination interétatique et d’intervention mondiale seraient justifiées en tant que mesures holistiques nécessaires pour sauver l’ensemble de la biosphère, et elles pourraient aussi avoir un caractère technocratique légitime, étant donné que les médias ont réussi à présenter le changement climatique comme une question scientifique et non économique ou spirituelle.
La principale faiblesse du système américain était que l’ONU, en tant que garante des droits de l’homme et de l’État, ne pouvait guère faire plus que protester alors que le FMI et l’OMC, sanctionnés pour mener des interventions technocratiques afin de sauvegarder l’ordre économique, présentaient clairement un caractère mercenaire, dressant le capitalisme contre les droits humains alors que, dans un régime libéral, ils devaient faire la synthèse des deux. Dans un régime où prévaut l’obligation de donner des réponses au changement climatique, des interventions technocratiques vigoureuses et la sauvegarde des intérêts communs trouveraient leur parfaite synthèse. Tant que le changement climatique sera traité comme une question purement scientifique, toute réponse devra être compatible avec les relations sociales préexistantes, les sources de financement et les mécanismes réglementaires par lesquels elle doit être menée. En d’autres termes, une approche technocratique du changement climatique ne menacerait pas le capitalisme.
Mais les capitalistes eux-mêmes sont incapables de construire la plateforme pour réaliser le type de changement systémique dont ils ont besoin. Les investissements dans les énergies renouvelables ont chuté de 7% en 2017. La volatilité du marché ne produira jamais les ressources nécessaires à un changement de phase des technologies énergétiques. Le capitalisme libéral nous laisserait en proie à l’effervescence – ou plutôt à l’ébullition – dans une économie basée sur les énergies fossiles. Un passage rapide à une économie du changement climatique ne sera pas possible sans que, dans leur majorité, les grands gouvernements introduisent d’énormes réorientations politiques et imposent juridiquement des investissements dans les énergies alternatives et des mesures de protection environnementale, puisant pour cela dans une part significative de leurs budgets, au même titre que les dépenses de santé ou militaires.
Le capitalisme fait face à un grand besoin de changement stratégique, un engagement gouvernemental capable de réorienter les ressources sociales de manière concertée et massive. C’est là que la question des différents modèles de gouvernement devient extrêmement importante, car certains types de gouvernement sont mieux placés que d’autres pour effectuer un tel basculement, et certaines tendances politiques sont bien placées pour s’emparer des problématiques du changement climatique, alors que d’autres en sont incapables.
Le fascisme, historiquement
Jusqu’à présent, en parlant de Nétanyahou ou de Trump, j’ai parlé de réactionnaires ou d’extrême droite. Il y a ceux qui favorisent l’hyperbole émotive à la clarté historique, et classent l’ensemble de ce mouvement réactionnaire dans la case « fascisme ». Si je conteste cette terminologie, ce n’est pas parce que j’aime les querelles sémantiques, mais parce que parfois, les mots comptent. Dans ce cas, la précision théorique est particulièrement importante, car il existe une divergence de longue date entre les modes dictatoriaux et démocratiques du pouvoir de l’État.
Dans le mode dictatorial, une partie de la classe dirigeante utilise des moyens militaires pour imposer ses orientations stratégiques au reste de la classe dirigeante et à la société en général. Ils le font en s’appuyant sur un appareil militaire fort ou en mobilisant une partie des classes inférieures contre un supposé ennemi intérieur – en général, ils font les deux. Ils peuvent suivre cette voie parce qu’ils estiment que les structures de pouvoir sur lesquelles ils s’appuient sont menacées d’une manière que le reste de la classe dirigeante n’apprécie pas, ou à cause d’un conflit culturel qui les conduit à voir les autres membres de la classe dirigeante comme des ennemis plutôt que comme des pairs, ou parce qu’ils n’ont pas le contrôle nécessaire sur les classes inférieures pour générer un consensus social.
Dans le mode démocratique, la classe dirigeante débat des orientations stratégiques et tente de gagner la participation volontaire à sa stratégie, et donc une sorte de consensus, de la part du plus large éventail possible de la société. Bien qu’ils puissent s’engager dans d’âpres combats contre leurs rivaux, ils ne leur refusent pas le droit d’exister et ne tentent pas non plus de détruire les mécanismes qui permettent le débat et la décision participative. À différents moments de l’histoire, les classes dirigeantes ont reconnu les avantages du mode démocratique. Ce mode leur permet de récupérer les mouvements révolutionnaires et de coopter les valeurs populaires pour qu’elles puissent se protéger de leurs propres classes subalternes, et même les enrôler pour aider à gérer les processus d’exploitation. Le mode démocratique leur permet de procéder à des réajustements intelligents et périodiques des stratégies décisionnelles, ce qui rend l’appareil d’État toujours plus fort et plus scientifique. Et il crée un jeu à somme positive qui donne la priorité à l’enrichissement mutuel de tous les membres de la société propriétaires de biens plutôt qu’à des luttes intestines à somme négative.
Historiquement, les États alternent entre le mode dictatorial et le mode démocratique, selon les circonstances ; cependant, ils ne sont capables d’opérer ce changement en un clin d’œil que s’ils ont construit auparavant un énorme complexe psychosocial qui entraîne les gens à s’identifier à leur dictateur ou à leur démocratie. Habituellement, plus un État est fort, plus l’échafaudage idéologique qui accompagne et justifie le mode dictatorial ou le mode démocratique est fort ; et donc, plus le mode est stable, plus la crise sera grande pour basculer d’un mode à l’autre.
Il est important de bien distinguer ces deux modes en raison de la différence entre les expériences de gouvernance de l’un à l’autre.
Le fascisme est un mouvement politique particulier qui s’est développé dans les années 1920 en Italie, inspirant des mouvements politiques similaires qui ont pris le pouvoir dans une douzaine d’autres pays, chacun étant une variante du modèle original. Ce modèle n’a jamais eu le temps de s’homogénéiser parce que le fascisme a été vaincu par les États démocratiques et socialistes, ceux-là mêmes qui ont ensuite mis en place le nouveau système mondial.
Dans le passé, certains anarchistes comme Voline, ont utilisé une définition plus étendue du fascisme afin de critiquer l’Union Soviétique. Ils l’ont fait parce que le fascisme était le mal dominant de l’époque et parce qu’il était politiquement opportun d’utiliser l’étiquette dans un sens plus large. Néanmoins, ils n’ont pas eu à s’entacher de pure malhonnêteté intellectuelle pour étendre la portée de ce terme, comme l’ont fait ceux Parti Communiste en qualifiant les socialistes allemands de « social-fascistes » pour justifier leur propre collaboration avec le Parti Nazi au début des années 1930. En fait, il y avait des relations organiques entre les autoritarismes de gauche et de droite à l’époque. Les fascistes italiens dirigés par Mussolini sortaient en grande partie du Parti Socialiste et améliorèrent la tactique socialiste consistant à mobiliser un mouvement de masse obéissant pour conquérir le pouvoir, et l’État policier Nazi s’inspira directement de son homologue soviétique, sans parler de l’affinité qui s’est manifestée dans le Pacte de non-agression entre l’Allemagne Nazie et les Soviétiques, ou encore de la complicité avérée entre le KPD et les Nazis dans l’attentat contre la démocratie allemande.
La définition élargie utilisée par Voline et quelques-uns de ses contemporains jouissait encore d’une certaine précision parce qu’elle faisait la distinction entre les modes de pouvoir dictatoriaux et démocratiques. Voline n’était pas un amoureux de la démocratie, mais il savait qu’il était important d’établir une distinction fondamentale entre ces différents modes. Ainsi, les justifications avancées pour qualifier l’URSS de « fasciste » étaient la suppression de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et des élections – en un mot, sa constitution en tant que dictature.
Les détracteurs socialistes d’aujourd’hui, pour qui Trump et May représentent le « fascisme », ne font pas cette distinction. Dans l’ensemble, ils refusent aussi de définir le fascisme. Au lieu de cela, ils affirment parfois que, puisque certains historiens ont été encore plus stricts dans leur définition – en se demandant si les nazis ou les phalangistes peuvent aussi être qualifiés de fascistes – ils trouvent légitime d’aller à l’extrême opposé et d’être laxistes dans leur définition au point de ne faire aucune distinction entre les modes fascistes et démocratiques de domination blanche. En outre, ils lancent des prédictions dramatiques selon lesquelles le fascisme pourrait revenir dans des circonstances historiques complètement différentes parce qu’il y avait des gens dans les années 1930 qui ne croyaient pas que cela pouvait arriver (ces deux non-arguments sont tirés de « Yes, Trump Does Represent Fascism »). Ou encore, ils proposent les termes d’une définition qui pourrait s’appliquer à pratiquement n’importe quel État, citant des caractéristiques telles que « le populisme sélectif, le nationalisme, le racisme, le traditionalisme, la propagation de la Novlang et le mépris pour le débat argumenté » – sans jamais penser que ce sont des « caractéristiques communes à toutes les formes de politiques d’extrême droite (et en fait, la Novlang est une caractéristique du stalinisme) » comme je le disais précédemment dans une critique.
Ou bien ils fabriquent un simulacre de partialité ou d’argumentation de bon sens, comme McKenzie Wark : « Il est étrange que les catégories politiques libérales, conservatrices, etc. soient utilisées de manière trans-historiques, alors qu’on n’est pas censé utiliser la catégorie du fascisme en dehors d’un contexte historique spécifique… Nous devrions peut-être la concevoir non comme l’exception mais comme la norme. Ce qu’il faut expliquer, ce n’est pas le fascisme, mais son absence. »
Cette énigme rhétorique est facile à résoudre. Le libéralisme est un élément fondamental de la modernité. Nous vivons toujours dans le système économique et politique créé par le libéralisme, donc la terminologie du libéralisme est toujours d’actualité, toujours historique. Appliquer les termes « libéral » et « conservateur » à l’époque médiévale ou au début de la Chine des Han, c’est cela qui serait « trans-historique ».
Au contraire, le fascisme a perdu. Il n’a jamais créé de système mondial, et les circonstances dans lesquelles il s’est créé ne sont plus d’actualité. Il y a eu des douzaines de variantes à la politique autoritaire et à l’idéologie suprémaciste blanche, la plupart incohérentes ou s’opposant mutuellement. Pour justifier l’utilisation du « fascisme » comme catégorie fourre-tout, il faudrait que quelqu’un livre un argument positif pour expliquer pourquoi cela nous donne des outils théoriques que nous n’aurions pas autrement. Pour autant que je sache, cet argument n’a pas encore été avancé. Il semble que la raison pour laquelle les gens parlent du fascisme comme d’un danger imminent est que cela inspire la crainte et les fait paraître importants. On n’a pas la même réaction en parlant d’une « démocratie de plus en plus brutale », même si les gouvernements démocratiques sont responsables d’une grande partie des génocides les plus sanglants de l’histoire mondiale (y compris l’anéantissement et l’extermination de centaines de nations autochtones par les politiques coloniales des États démocratiques comme les États-Unis, l’Australie, le Canada, le Chili et l’Argentine ; les massacres perpétrés par des puissances démocratiques comme le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France en Inde, au Congo, en Indonésie, en Algérie, au Vietnam et dans d’autres colonies ; et les génocides perpétrés par des démocraties post-coloniales comme la Colombie et la Birmanie). La plupart des gens ne le savent pas, parce qu’on accorde tellement d’importance aux méfaits des régimes dictatoriaux… Les crimes des démocraties sont occultés. Les anarchistes devraient être mieux informés, mais un nombre important d’entre eux ont choisi l’opportunisme politique plutôt que l’honnêteté intellectuelle et la tâche difficile de partager les vérités que personne d’autre ne veut évoquer.
Il est important de critiquer cette négligence théorique parce que notre analyse de l’histoire est d’une importance vitale. L’amnésie historique est l’un des plus grands obstacles récurrents aux mouvements révolutionnaires.
Tirée d’un article précédent, voici une définition opérationnelle du fascisme :
Le fascisme n’est pas n’importe quelle position d’extrême droite. C’est un phénomène complexe qui mobilise un mouvement populaire sous la hiérarchie d’un parti politique et cultive des systèmes parallèles d’allégeance dans la police et l’armée afin de conquérir le pouvoir, que ce soit par des moyens démocratiques ou des moyens militaires ; il abolit ensuite les procédures électorales pour garantir la perpétuation d’un parti unique ; il crée aussi un nouveau contrat social avec la classe ouvrière nationale, d’une part en créant un meilleur niveau de vie que ce qui pourrait être atteint sous un capitalisme libéral, d’autre part en protégeant les capitalistes par une nouvelle paix sociale ; et enfin il élimine les ennemis intérieurs qui étaient responsables, selon lui, de la déstabilisation du régime précédent.
L’abolition d’un système électoral libre est essentielle. Avec des élections libres, pas de dictature ; sans dictature, pas de fascisme. Le fascisme multipartite avec une presse capitaliste libre est une contradiction dénuée de sens qui prive le langage de toute précision ou pertinence au profit de l’amplification démagogique, un peu comme le style préféré des populistes de tous bords, de Trump aux fascistes d’aujourd’hui.
La présence d’une force paramilitaire organisée hiérarchiquement est également essentielle pour détruire les freins et les contrepoids du système démocratique et soutenir la création autocratique d’une nouvelle juridiction pendant la période de transition. Dans le fascisme historique, ces chemises noires ou stormtroopers sont indispensables dès les premières années, et sont finalement affaiblis ou même supprimés après que les nouvelles lois fascistes aient été suffisamment institutionnalisées.
Ami du Radical met en garde contre les « organisations de chemises noires dans tous les États », mais c’est une exagération. L’Alt-Right aux États-Unis est une organisation criminelle ; les priver d’une tribune et les expulser de la rue a été la meilleure chose à faire. Mais ces groupes hétéroclites de guerriers d’Internet et de trolls de bas-étage sont des broutilles à côté des chemises noires historiques ou du KKK pendant la Reconstruction. Ils n’ont pas de leadership unifié, pas de structure militaire étoffée1, pas de discipline et un nombre relativement faible de membres. Les para-militaires susmentionnés étaient engagés dans une guerre civile ouverte. Le nombre de morts se chiffrait en milliers et en dizaines de milliers. Il est important de le reconnaître, car c’est une chose, pour les anarchistes, de pouvoir vaincre un groupe dispersé et marginalisé comme l’Alt-Right. Ce serait vraiment autre chose que de se mesurer à une véritable organisation de chemises noires.
Les différents modèles d’organisation sont aussi extrêmement importants. S’il y avait une véritable organisation paramilitaire organisée hiérarchiquement à la suite d’un parti politique avec un programme fasciste (antidémocratique), cela en dirait long sur la faiblesse du gouvernement et sur les inquiétudes de la classe capitaliste prête à autoriser une telle violation de ses propres normes. Ces conditions n’existent tout simplement pas à l’heure actuelle, et quiconque ne le comprend pas se bat contre des moulins à vent. En second lieu, la structure organisationnelle actuelle de l’extrême droite aux États-Unis est tout à fait conforme au mode diffus de violence paramilitaire qui existe sous les gouvernements démocratiques. Confondre l’un avec l’autre équivaut à laisser passer le suprémacisme blanc et démocratique, ce qui constitue une erreur stratégique majeure.
Il y a eu un parti néo-fasciste ces dernières années, avec un programme fasciste visant à s’emparer du pouvoir et à créer une force paramilitaire avec des allégeance anti-démocratiques dans la police et l’armée. Aube Dorée, en Grèce. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Ils ont certainement été affaiblis par des actions directes anarchistes, mais c’est le gouvernement démocratique de la Grèce qui les a fait taire, du jour au lendemain, après qu’ils aient outrepassé leur mission en tuant des artistes et en attaquant des journalistes plutôt que de se contenter de tuer des migrants et blesser des anarchistes.
Avant et après les poursuites visant leurs dirigeants, Aube Dorée a utilisé une rhétorique similaire à celle de l’AfD en Allemagne et d’autres partis d’extrême droite. Les principales différences étaient leur structure paramilitaire, leur adhésion permanente à l’esthétique nazie, même après avoir été sous les projecteurs des médias, et leur tendance à promouvoir une stratégie putschiste unie autour d’un personnage faisant office de Führer. Les partis d’extrême droite utilisent les feux des médias pour rendre le nationalisme et la xénophobie acceptables. L’AfD, par exemple, a salué la manière dont les chrétiens-démocrates ont adopté des éléments concernant l’immigration dans leur programme. Aube Dorée, en revanche, affiche ses intentions dictatoriales. Aux États-Unis, c’est une chose que seuls les secteurs les plus extrêmes de l’extrême droite feront, alors que tout groupe qui veut courtiser le Parti Républicain ou les riches donateurs minimise l’esthétique nazie et se concentre sur l’adoption de programmes politiques assimilables dans le cadre du système démocratique. Quant aux forces paramilitaires, dans une démocratie, elles devraient être gérées par des agences de renseignement, plutôt que de travailler directement pour un parti politique. Bien que cette distinction s’estompe parfois dans certains cas sous l’administration Trump, avec des implications à la fois effrayantes et dangereuses, nous ne pouvons encore rien affirmer à propos d’un mouvement fasciste unifié, avec des paramilitaires, et qui serait sous le contrôle direct d’un grand parti politique.
Depuis le triomphe des puissances capitalistes démocratiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fascisme a été apprivoisé et mis en laisse comme un monstre de compagnie, enfermé dans la boîte à outils démocratique. Les fascistes dans l’hémisphère Nord sont utilisés pour faire passer un discours acceptable à droite, pour attaquer et intimider les marginalisés sociaux, pour fabriquer des tensions ou des crises politiques, mais on ne détache jamais la laisse. Les fascistes qui font comme si cette laisse n’existait pas finissent au tribunal, comme les dirigeants d’Aube Dorée ou encore comme ces membres survivants d’une cellule néonazie allemande qui avaient des contacts étroits avec les services de renseignement allemands mais qui ont fini par tuer un policier après ce que j’imagine être considéré par leurs supérieurs comme une traque réussie pour tuer des migrants.
Dans les pays du Sud, l’équation est un peu différente, principalement parce que le système démocratique mondial a toujours permis les dictatures dans les sociétés post-coloniales. C’était en fait la norme tout au long de la guerre froide, au cours de laquelle un gouvernement démocratique était une marque de privilège et de progrès plutôt qu’une garantie universelle. La dictature est particulièrement compatible avec les économies fondées principalement sur l’extraction de ressources comme l’exploitation minière, pétrolière, agricole et forestière. Quand le capitalisme prend la forme d’un simple pillage, il n’y a pas vraiment besoin de cultiver les valeurs de la citoyenneté. La démocratisation, par contre, a tendance à accompagner des investissements plus importants et plus complexes ainsi que des cycles locaux d’accumulation – quoique si la démocratie ne parvient pas à établir la paix sociale, la dictature puisse réapparaître rapidement. Pourtant, depuis la Seconde Guerre Mondiale, la plupart des dictatures ne se sont pas positionnées comme des adversaires à l’ordre démocratique mondial, mais plutôt comme des alliés. Suivant les signaux des États-Unis, elles se sont engagées dans la croisade contre le communisme sans se positionner comme les héritières du fascisme. C’est d’ailleurs exactement le même espace de compromis idéologique que la démocratie libérale occupait dans les années 1930 et 1940.
Against the Fascist Creep d’Alexander Reid Ross est l’une des plus ambitieuses tentatives de cartographie du fascisme sur le plan historique et théorique. Le livre retrace l’évolution des philosophies et des penseurs qui ont fini par former des mouvements fascistes en Italie et ailleurs. La recherche est vaste et intéressante, mais le cadrage souffre d’une erreur qui rend l’œuvre presque inutile d’un point de vue théorique : il prend le fascisme au sérieux en tant que mouvement philosophique. Ni Mussolini, ni Hitler, ni Franco, ni Codreanu, ni aucun des autres dirigeants fascistes n’étaient des penseurs cohérents. Ils étaient des populistes efficaces, ce qui signifie qu’ils mélangeaient et correspondaient à n’importe quel modèle de revendications, de philosophies et de visions du monde qui pouvait motiver leur base. C’est pourquoi les fascistes étaient à la fois chrétiens, païens et athées, bohémiens et esthétiques, capitalistes et socialistes, scientifiques et mystiques, rationalistes et illogiques. Cet aspect pseudo-intellectuel a été une caractéristique essentielle de l’extrême droite tout au long du XXe siècle et jusqu’à nos jours. C’est une raison de plus pour laquelle il n’est pas judicieux de s’engager avec eux dans un débat raisonné, car ils sont prêts à dire n’importe quoi pour provoquer le genre de réaction qu’ils veulent provoquer.
Il serait stupide de faire remonter le fascisme à Nietzsche et Sorel à moins d’avoir des idées derrière la tête. Sur le plan structurel et organisationnel, le fascisme a emprunté énormément à la gauche, en particulier au syndicalisme et au parti socialiste et communiste. Pourtant, ceux qui tentent de faire une généalogie philosophique du fascisme tentent toujours de le relier aux éléments les plus marginalisés des mouvements anticapitalistes ; les nihilistes, les naturalistes et les individualistes sont les souffre-douleur habituels. Ce n’est pas spécialement utile pour comprendre le fascisme ; c’est plutôt un mécanisme par lequel les gauchistes nettoient la maison et marginalisent davantage leurs critiques les plus radicaux.
Une analyse historique utile du fascisme emprunterait bien plutôt une approche économique et poserait la question suivante : à partir de quel moment les capitalistes commencent-ils à soutenir les mouvements fascistes ? Le moment où l’establishment industriel et militaire allemand décida de soutenir les nazis fut sans aucun doute un tournant pour ce petit groupe d’abrutis violents qui évolua en un immense parti capable de prendre le pouvoir. Le soutien militaire et capitaliste a également joué un rôle décisif dans le changement de l’idéologie nazie et dans l’affaiblissement de nombreuses croyances ésotériques et contestataires sur lesquelles Ross a passé tant de temps à faire des recherches.
Sans le soutien économique des capitalistes, il n’y a pas de fascisme. Les anarchistes devraient passer moins de temps sur les forums d’Alt-Right et prêter plus d’attention à ce que les capitalistes les plus influents disent sur la façon de répondre à la crise en cours. Il s’agit d’une question de priorités et non d’une critique de cette dernière activité. L’Alt-Right n’avait pratiquement aucun soutien capitaliste en dehors de la famille Mercer, des capitalistes moyens pour ainsi dire, et quand la scission s’est faite entre Trump et Bannon, ils ont clairement choisi Trump (faisant apparaître de réelles divergences entre le suprémacisme blanc démocratique et le suprémacisme blanc fasciste, comme je le disais précédemment, et comme l’auteur de Yes ! le conteste en qualifiant Trump et Bannon de « bons camarades » huit mois avant leur discorde). À l’échelle mondiale, il n’y a pratiquement aucun capitaliste qui envisage le fascisme pour résoudre ses problèmes. Et nous le saurions si c’était le cas. Dans les années 1930, Ford, Dupont et d’autres capitalistes de premier plan exprimèrent ouvertement leur admiration pour Mussolini et les groupes qui manifestaient pour faire écho aux chemises noires. Certains d’entre eux ont également pris contact avec l’armée pour discuter d’un éventuel coup d’État.
Tout indique aujourd’hui que les capitalistes apprécient Trump pour l’allégement fiscal à court terme qu’il leur a accordé, mais craignent ses guerres commerciales et désapprouvent la plupart de ses stratégies à moyen terme (ou ce qui passe pour être des stratégies dans le camp Trump), et poussent un soupir de soulagement quand il prend ses distances avec l’extrême droite. Les capitalistes joueront avec Trump tant qu’il aura ses petites mains sur les manettes. Ils se fichent de Bannon. En Europe, les investisseurs ont tremblé à chaque victoire de l’extrême droite, du Brexit à la nomination de Salvini en Italie.
Plus le capitaliste est fort, plus son engagement en faveur d’une conception politique ou une autre est faible. Les capitalistes sont réputés à la hauteur de leurs profits sous des gouvernements complètement différents. Ils feront des profits à court terme sous un gouvernement qui se suicide sur le plan politique, et des profits à long terme sous un gouvernement qui adopte une stratégie plus intelligente. Ce qu’ils ne feront pas, c’est saboter un système mondial qui leur assure la stabilité, encourager des stratégies suicidaires dans les pays dont ils sont tributaires ou entreprendre des croisades politiques qui sacrifient le profit, augmentent l’instabilité et entravent la finance et le commerce.
Curieusement, dans les années 1930, les paramètres économiques étaient souvent très similaires entre New Deal démocratique et New Deal fasciste, tous deux axés sur des programmes gouvernementaux ambitieux pour stimuler l’emploi. Cela montre comment, indépendamment de la politique politicienne, les capitalistes ont tendance à faire face simultanément aux mêmes besoins à l’échelle mondiale, et qu’ils peuvent réaliser le même grand programme économique avec une variété de modèles politiques. Les démocrates triomphants ont convaincu les capitalistes de la scène internationale d’investir dans les déficits budgétaires américains, alors que les fascistes ont désespérément essayé de faire la guerre à tous pour voler les ressources dont ils auraient eu besoin pour financer des dépenses aussi élevées. C’était clairement un jeu à somme négative, et il a mal fonctionné pour ceux qui ont parié trop lourd sur les grandes fortunes de l’Allemagne. Les capitalistes allemands, cependant, ont été exclus des marchés coloniaux par le succès des Anglais et des Français dans la Première Guerre mondiale, ils n’avaient donc pas le choix.
Combien de ceux qui crient aujourd’hui au « fascisme » se sont demandé si la situation actuelle est comparable ? La réponse est simple : ce n’est pas le cas. De même, il n’y a pas besoin d’une guerre économique entre les grandes puissances comme dans les années 1930. La destruction mutuelle que nous assurerait une guerre nucléaire supprime les avantages économiques que procure la guerre conventionnelle, la poursuite de la politique de la Guerre Froide signifie que les dépenses militaires sont perpétuellement au niveau de conflit imminent, et les multiples guerres héritées de la Guerre contre le Terrorisme donnent toute la stimulation nécessaire à une production militaire.
Suprématie blanche démocratique
Les gens doivent se sortir de la tête que la démocratie est une bonne chose. La vraie démocratie n’exclut pas l’esclavage. La vraie démocratie, c’est le capitalisme. La vraie démocratie, c’est le patriarcat et le militarisme. La démocratie a toujours comporté ces éléments. Il n’y a pas d’histoire sérieuse de la démocratie qui pourrait nous servir un exemple du contraire.
Nous avons vu, de façon dramatique, à quel point les fascistes de la rue peuvent être dangereux. Mais l’histoire des États-Unis est jalonnée de rappels sur la façon dont les suprémacistes blancs peuvent soutenir la démocratie et non le fascisme, de manière beaucoup plus systématique, lorsqu’il s’agit de se tirer d’affaire en cas de meurtre. Semblable à certains égards au mouvement du Tea Party, le KKK est né entre autre pour protéger la démocratie américaine – suprémaciste blanche depuis ses origines – des changements qui étaient indésirables aux yeux des riches blancs. Ils se sont mobilisés pour empêcher les Noirs de voter, pour empêcher les Noirs de communautariser les terres saisies aux propriétaires de plantations (et en cela ils ont été aidés par l’armée de l’Union), et pour attaquer les politiciens blancs qui tentaient de changer les relations de classe qui ont toujours prévalu dans le Sud. Ils ont essayé d’influencer les élections par divers moyens (y compris le terrorisme dans le cas du Klan et par le biais des médias dans le cas du Tea Party), mais ils ont aussi légitimé le système électoral, au lieu de chercher à en prendre le contrôle et l’éliminer.
Si on remonte aux premiers États, toutes les formes de gouvernement reposent sur une combinaison de mécanismes inclusifs et exclusifs. La démocratie prêche les droits universels et donc l’inclusion, mais elle permet aussi à l’État de déterminer qui est citoyen et donc qui obtient tous les droits. Elle prescrit certains modes d’être humain et pratique le génocide et la colonisation contre ceux qui adoptent d’autres modes. Les gouvernements démocratiques n’ont jamais concédé les droits de l’homme aux sociétés qui n’acceptent pas la propriété ou le travail obligatoire (salaire ou esclave). Les conservateurs ont tendance à être plus exclusifs et les progressistes sont connus pour être plus inclusifs, mais tous ont été responsables des guerres exterminatrices contre les formes de vie qui ne défendent pas les valeurs des Lumières patriarcales et suprémacistes des Blancs qui déterminent ce que signifie être humain.
C’est pourquoi le concept diffus de suprématie blanche dans l’histoire américaine, si différent du modèle centralisé du fascisme, est si crucial. Roxanne Dunbar-Ortiz évoque une idée similaire lorsqu’elle décrit la « manière de faire la guerre » de l’Amérique, une guerre totale et d’extermination menée par des milices volontaires de rangers colons. Il ne s’agit pas de brutalité raciste dirigée par un parti extrémiste ; il s’agit plutôt d’une aspiration commune que partagent tous les Blancs. En tant que telle, elle transcende les partis et s’épanouit dans un système démocratique.
La crise de la blancheur dans laquelle Trump a puisé provient d’une crainte profondément enracinée selon laquelle le rôle paramilitaire historique des Blancs deviendrait obsolète. Il s’agit d’une insécurité viscérale qui a fait disparaître le rôle de protagoniste que les Blancs jouaient depuis longtemps. Dans l’histoire des États-Unis, ce rôle a toujours été de soutenir la démocratie américaine, en attaquant violemment les ennemis de la nation mais aussi en définissant ce que cela signifie d’être humain et de se voir attribuer des droits. Cette forme de suprématie blanche existe même à l’intérieur de la gauche du Parti démocrate, comme un prétendu droit à déclarer si une résistance est légitime ou non en devenant des protagonistes dans les luttes des autres peuples, soit comme les dispensateurs des libertés (et des relations capitalistes de propriété) pendant la Guerre Civile et la Reconstruction, soit comme les « alliés blancs » du mouvement pour les droits civils jusqu’à aujourd’hui.
L’idéologie blanche a été développée précisément pour les contextes coloniaux où le capitalisme exigeait une activité économique décentralisée et était limité dans sa capacité à centraliser le contrôle politique : en d’autres termes, l’État colonisateur. Non seulement une suprématie blanche décentralisée et démocratique est plus efficace dans un État colonisateur, mais une itération dictatoriale ou fasciste de la suprématie blanche dans de telles circonstances est très dangereuse pour le pouvoir étatique. Le fascisme implique la suppression des éléments privilégiés de la société qui ne suivent pas la ligne du parti. Dans un État colonisateur, cela obligerait les membres progressistes de la caste des colons (les Blancs) à conclure des alliances d’autodéfense avec des éléments moins bien classés de la main-d’œuvre coloniale ou néocoloniale (personnes de couleur), menaçant ainsi la dynamique même du pouvoir qui donne vie à l’État. Voyez comment, dans les pays occupés par les nazis, des cadres progressistes et des familles riches ont conclu des alliances avec des Juifs et des anticapitalistes de la classe ouvrière pour combattre le régime, modérant temporairement leur antisémitisme et leur sentiment de classe. En fait, le mouvement partisan était si ample et si puissant qu’il était capable de vaincre les nazis militairement dans plusieurs régions et de contrecarrer continuellement leurs plans dans une grande partie du reste de l’Europe.
Au départ, les États colons ont tendance à exercer une suprématie blanche décentralisée parce qu’il s’agit de faire en sorte que tous ceux qui sont catégorisés blancs puissent reproduire cette suprématie de leur propre chef. Au fur et à mesure de leur maturité, les États colons préfèrent une organisation démocratique afin de permettre aux progressistes et aux conservateurs d’exercer la suprématie blanche à leur guise. Ce n’est probablement pas un hasard si ce qui fut peut-être la plus grande itération du fascisme dans un État colonisateur, le péronisme en Argentine, a toléré des variantes de partis de droite et de gauche et n’a pas autant insisté sur la pureté raciale que les autres mouvements fascistes, permettant ainsi la reproduction diffuse de la suprématie blanche Argentine, non soumise à la centralisation du nouveau régime.
Il est clair qu’une grande partie de l’extrême droite américaine est néo-fasciste à tous points de vue. Ils veulent transformer les États-Unis en un État ethnique blanc et en dictature. De plus, les factions traditionnellement démocratiques d’extrême droite n’ont pas hésité à travailler en coalition avec ces néo-fascistes. Cela montre l’incohérence idéologique caractéristique de l’extrême droite, cela montre aussi une exaspération à l’égard du parti républicain et des institutions démocratiques qui avaient l’habitude de maintenir un ordre suprémaciste blanc plus visible et, dans certains cas du moins, cela montre la volonté des centristes de se servir des éléments d’extrême droite dans la rue, bien qu’ils comprennent que ces derniers ont peu de chances de gagner et prévoient de les abandonner quand l’alliance ne sera plus aussi commode.
Il est possible que l’extrême-droite américaine, historiquement démocratique, puisse devenir en majorité fasciste à long terme, même si cela l’éloignerait davantage des institutions qu’elle cherche à influencer. Cependant, il y a l’opinion que les capitalistes changeront soudainement leur politique quand se produira la crise économique. Ami du Radical affirme que le fascisme est historiquement une réponse à la crise économique. C’est une erreur2.
Les échantillons et premières expressions du fascisme structuré en Italie et en Allemagne ont été des réponses aux crises politiques qui ont précédé les grandes crises économiques : le Biennio Rosso et les occupations d’usines en Italie, les différentes communes ou républiques ouvrières écrasées par les Freikorps en Allemagne. (Bien sûr, un taux de chômage élevé est apparu à la fin de la Première Guerre mondiale, mais c’est la situation explicitement révolutionnaire qui a motivé les chemises noires et les Freikorps à agir). Les mouvements fascistes étaient déjà bien développés, et déjà sous contrôle en Italie, lorsque l’effondrement économique de 1929 s’est produit. L’Angleterre, la France et les États-Unis ont souffert de la même crise économique mais n’ont pas basculé dans le fascisme ; en fait, deux d’entre eux en sont sortis parce que la nature des crises politiques auxquelles ils étaient confrontés et les stratégies locales à long terme de contrôle politique étaient différentes. Dans les pays aux perspectives géopolitiques réduites, les capitalistes ont commencé à soutenir les mouvements fascistes en réponse à une crise politique, alors que les mesures économiques qu’ils soutenaient étaient globalement similaires à celles des États démocratiques.
De nos jours, les nouvelles itérations de ce que certains appellent négligemment le fascisme ont également précédé de manière significative la crise économique de 2008.
Le creuset de la droite réactionnaire aux États-Unis remonte à la déclaration des « Guerres Culturelles » dans les années 1970. Il s’agissait avant tout d’un appel à investir dans une renaissance idéologique de droite. Après les changements progressifs des Droits Civils et de la Grande Société, la droite était structurellement puissante mais culturellement moribonde, représentée par des bandes d’arriérés aussi embarrassantes que la John Birch Society et le KKK. Plutôt que d’indiquer une orientation stratégique – ils n’en avaient pas, et le Nixon sans perspective ou le Kissinger machiavélique et sans scrupules illustrent leur faillite – ils ont identifié une faiblesse stratégique et se sont mis à bâtir leurs propres médias, réseaux culturels, groupes de réflexion et autres structures qui les aideraient à formuler une idéologie pour bâtir un nouveau consensus politique. De toute évidence, ils avaient même le soutien d’un bon nombre de léninistes devenus néoconservateurs, rebutés par la politique identitaire de la Nouvelle Gauche, et qui avaient compris les techniques pour atteindre la classe ouvrière blanche (au Royaume-Uni, il existe une tendance similaire d’anciens Trot’s tournés vers l’extrême droite, avec des discours po-business). Leur principal effort ne visait pas à accroître la puissance géopolitique américaine ou à améliorer la conduite du capitalisme, mais plutôt à se faire les champions de la malhonnêteté intellectuelle, des préjugés et des discours alarmistes. Leur priorité était de sauver certaines valeurs élitistes qu’ils associaient à l’histoire et au pouvoir américains, plutôt que de faire une distinction lucide et stratégique entre intérêts et valeurs – une erreur courante à droite. Mais les tropes qu’ils formulaient s’exportaient rapidement et devenaient une idéologie de plus en plus internationale.
Les Guerres Culturelles ont réussi pendant un certain temps à conduire le débat vers la droite, mais les mouvements antimondialisation, féministes et antiracistes ont finalement réussi à abattre toutes les vaches sacrées de la droite, même si, à gauche, on a réussi à institutionnaliser ces mouvements et limiter leur pouvoir subversif. En fin de compte, les Guerres Culturelles ont laissé aux États-Unis et dans certains pays d’Europe et d’Amérique latine des minorités enracinées et réfractaires, presque incapables d’établir un dialogue politique et des stratégies de gouvernance intelligente. Elles contribuent à la crise de la démocratie, mais n’indiquent pas de voie de sortie.
Certains soutiennent que les néo-fascistes n’ont pas besoin de renverser le gouvernement s’ils peuvent créer un système à parti unique au sein d’un gouvernement démocratique. L’Israël de Netanyahou, la Turquie d’Erdogan et la Hongrie d’Orban offrent ici des scénarios potentiels, bien que décrire un gouvernement juif comme architecte d’une nouvelle forme de fascisme soit une manœuvre risquée pour les gens qui ne sont pas absolument sûrs du choix de leurs mots. Il est difficile de trouver d’autres exemples de gouvernements démocratiques de droite qui se soient maintenus au pouvoir pendant seulement huit ou neuf ans – ce qui n’est pas une si longue période pour un parti capable de rester au pouvoir dans un système multipartite – et même avec cette faible liste, il est difficile de savoir si l’idée de système démocratique à parti unique ne relève pas simplement d’une exagération. Le fait que certains prétendent qu’un système de parti unique est déjà arrivé aux États-Unis en raison de la majorité temporaire des républicains, montre comment ils ont transformé la panique et l’impatience en valeurs analytiques.
Cela montre également la tolérance à l’égard d’un système de valeurs fondamentalement démocratique. En mettant en garde contre les dangers de tomber dans un système à parti unique, ils identifient implicitement la victoire du second parti, les démocrates, comme un moyen d’éloigner la menace, une victoire de l’antifascisme. Cela jette les bases d’un renouveau démocratique.
Mais prenons la menace au pied de la lettre : l’avantage d’un tel modèle est que l’extrême droite n’a pas à renverser le gouvernement ni à provoquer une déstabilisation. En d’autres termes, centraliser toutes les institutions et fabriquer une majorité pérenne est probablement plus facile aujourd’hui que lancer une sorte de coup d’État. L’inconvénient est qu’un système à parti unique perd presque tous les avantages d’un gouvernement démocratique, comme la récupération de la dissidence, la correction stratégique des trajectoires et l’institutionnalisation du changement et du renouveau politiques. Netanyahou, Erdogan et Orban ont tous fabriqué des majorités relativement stables, qu’ils ont renforcées par des lois récentes en référence à l’« État-nation », c’est-à-dire un référendum constitutionnel et des restrictions imposées aux ONG. Mais aucun de ces États ne fournit de modèle facilement exportable vers de plus grands pays, et ils ne s’avèrent pas non plus être des modèles économiquement performants. Les politiques de Netanyahou ont conduit à l’exode massif des Juifs progressistes, créant le genre de carcan culturel qui n’est généralement pas associé aux idées de croissance économique et d’innovation. La construction de sa majorité se fait au détriment de l’avenir d’Israël, un calcul qui n’était possible que dans un État enclavé et qui considère la géopolitique essentiellement en termes militaires. La situation est similaire en Turquie, où la guerre civile est un aspect déterminant de la politique intérieure ; c’est d’une main de fer qu’Erdogan a construit une majorité, ce qui a joué un rôle significatif dans la destruction de l’économie turque, éloignant le pays de multiples partenaires commerciaux possibles, dont l’UE. Quant à la Hongrie, où Orban a construit sa majorité sur le dos d’une population rurale notoirement xénophobe, la droite bien établie n’a qu’une portée limitée à l’échelle européenne, en tout cas comme exemple des difficultés liées à l’intégration culturelle, ou peut-être pour justifier un autoritarisme technocratique, mais non comme un modèle à suivre. Du point de vue des dirigeants de l’UE et des capitalistes européens, la Hongrie est un État perdant et gênant qui n’est en mesure de donner des conseils à personne.
Quant aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n’y a pas de solide majorité de droite, et il est peu probable que les politiques de Trump et May marquent un changement radical dans la direction politique et économique de ces deux pays. Mais si les annonciateurs d’une menace fasciste sont convaincus que nous sommes sur la voie d’un système à parti unique, appelons ça un pari. Il est fort probable qu’ils s’apercevront de leur erreur dès 2020, mais pour que leurs sinistres avertissements soient fondés, il faudrait que ce nouveau style de politique reste à la barre pendant au moins trois mandats, avec une centralisation efficace entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire ainsi qu’un contrôle plus serré des médias par la droite politique. Les alarmistes auront raison si Trump peut transmettre le pouvoir à un successeur en 2024, ou s’il s’avère capable d’abolir la limite constitutionnelle du nombre de mandats et d’en gagner un troisième. Cela ne se produira probablement pas : le virage actuel vers la droite sera suivi d’un virage vers la gauche, dans le pendule éternel et sidérant de la démocratie.
Renouveau démocratique
En termes de longévité parmi les pays fascistes, l’Espagne franquiste l’a emporté largement. De 1936 à 1976, le régime a survécu à ses coreligionnaires les plus belliqueux, principalement parce qu’il pouvait s’incliner devant un système mondial démocratique – en fait, Franco a reçu une aide secrète de la Grande-Bretagne dès les premiers moments du coup d’État. L’histoire de la transition espagnole vers la démocratie est de la plus haute importance pour les anarchistes, non seulement parce qu’elle s’est déroulée au milieu de l’un des plus grands mouvements de grève sauvage de l’histoire mondiale, mais parce que ce sont les fascistes eux-mêmes qui ont initié la Transition, comprenant que sous un gouvernement capitaliste démocratique, ils pouvaient tirer plus de profit et créer une structure gouvernementale plus stable et plus puissante. Plus que les victoires américaines et soviétiques de la Seconde Guerre Mondiale, cet épisode illustre la subordination définitive du fascisme à la démocratie. Lorsque les fascistes eux-mêmes réalisent qu’ils peuvent mieux atteindre leurs objectifs sous les auspices de leur ancien ennemi juré, la démocratie, le fascisme en tant que modèle de gouvernement cesse d’être pertinent3.
La Transition est aussi une étude de cas sur la façon dont la peur ou l’opposition unanime à l’apparente exception du fascisme a été systématiquement utilisée par la classe dirigeante pour renforcer le capitalisme. En Espagne, le renouveau démocratique des années 1970 et 1980 a réussi à institutionnaliser ou à réprimer des mouvements anticapitalistes très puissants. En abandonnant leurs insignes de Phalangistes et en rejoignant les libéraux ainsi que les socialistes et les communistes sous la bannière démocrate, les fascistes d’Espagne ont réussi à créer les conditions d’une croissance plus régulière du capitalisme.
Des facteurs similaires sont à l’œuvre dans les dénouements des dictatures militaires du Brésil, de l’Argentine, du Chili, de la Bolivie et, plus récemment, de la Birmanie4.
Un renouveau démocratique antifasciste n’est qu’une variante du modèle (contre-)révolutionnaire que les mouvements démocratiques ont utilisé depuis le début de la modernité :
- faire appel aux classes populaires contre un ennemi commun (en premier lieu, l’aristocratie et l’Église) ;
- s’appuyer sur des principes équivoques et néanmoins partagés comme les droits et l’égalité qui semblent être meilleurs que les valeurs de l’ancien système ;
- laisser de côté les valeurs des classes sociales inférieures comme la défense des biens communs et l’auto-organisation non représentative, au motif qu’elles sont anti-modernes ou qu’elles « aliéneraient » la bourgeoisie qui, en fait, dirige toute la coalition ;
- utiliser les classes populaires comme de la chair à canon et leurs éléments les plus radicaux comme des croque-mitaine pour effrayer les plus modérés parmi les détenteurs du pouvoir afin de les poursuivre à la table des négociations ;
- à la table des négociations, inclure des représentants des structures institutionnelles formelles – celles qui sont capables de produire des représentants et une adhésion disciplinée et obéissante – tout en excluant les radicaux et les masses.
Tout au long des révolutions libérales des xviiie et xixe siècles, tout au long des luttes anticoloniales du xxe siècle, ce même modèle a été utilisé à maintes reprises pour désamorcer les mouvements radicaux qui menaçaient de détruire l’ordre capitaliste et interétatique, pour institutionnaliser une partie des insurgés et réprimer les autres, permettre aux capitalistes et aux dirigeants intellectuels de prendre le contrôle du gouvernement et de créer un État plus robuste, contrôlant mieux ses populations et capable de façonner les conditions d’accumulation capitaliste. Nous avons été vaincus par ce même modèle tellement de fois que nous devrions nous le faire tatouer sur le front pour y penser à chaque fois que nous nous regardons dans le miroir.
Les indices ne manquent pas pour montrer que la plupart des élites américaines, en particulier les secteurs les plus cultivés, se préparent à un renouveau démocratique majeur, en utilisant la peur de l’autoritarisme trumpien comme tactique de mobilisation.
Avant Trump, la démocratie américaine était déjà confrontée à une crise, tout comme de nombreuses autres démocraties libérales à travers le monde. Aux États-Unis, la crise a frappé les fondement mêmes du pays en tant qu’État colonisateur. D’énormes foules rejetaient énergiquement le droit de la police d’assassiner des personnes racialisées et le droit des compagnies d’extraction minières liées au gouvernement d’exploiter ou de contaminer des terres autochtones. Les expériences des Noirs et des peuples autochtones ont été au premier plan dans ces deux luttes, mais en même temps, les discours raciaux n’ont pas été utilisés efficacement pour diviser les gens et empêcher la solidarité interraciale, bien que les progressistes liés aux ONG, aux églises et au Parti démocratique aient certainement essayé.
Avec l’élection de Trump et la montée temporaire de l’extrême droite, le récit a radicalement changé. La police n’est plus sous les feux de la rampe et, bien qu’elle n’ait pas fait du bon travail en se contentant de faire jouer à ses agents le rôle de médiateurs neutres pour empêcher les escarmouches entre Nazis et Antifa, les critiques auxquelles elle doit maintenant faire face soulignent que c’est ce rôle qui doit être joué désormais, alors que lors des événements de Ferguson, on avait surtout exigé des policiers d’aller mourir.
Le nouveau récit dépeint un gouvernement corrompu, de droite, avec des liens peu recommandables avec des groupes d’extrême droite – un gouvernement qui harcèle la presse, s’associe à l’ennemi juré qu’est la Russie, se montre conciliant envers les dictateurs et attaque le libre échange.
Ce discours est idéal pour le Parti Démocrate. La solution la plus évidente est de favoriser un contrôle juridique plus rigoureux du financement des campagnes électorales et du lobbying, de faire honneur aux médias, de promouvoir l’indépendance de la justice, de protéger l’OTAN, l’ALENA, l’Union européenne et « nos » autres alliances, de cautionner une censure toujours plus sévère sur Twitter, Facebook et les plateformes similaires, et de se livrer à nouveau à une guerre froide contre la Russie. Ce n’est pas un hasard si, malgré une courte mais enthousiasmante vague subversive d’occupations aéroportuaires au tout début du mandat de Trump, les principaux protagonistes de la résistance anti-Trump ont été les juges, le FBI, la CIA, des dirigeants comme Trudeau, Merkel et Macron, des politiciens « honorables » comme McCain, les stars hollywoodiennes, les grands médias tels CNN et le New York Times.
Le nouveau conflit social réunit une large gauche pour combattre une droite dangereuse sans pour autant remettre en cause les aspects fondamentaux de l’État. Au contraire, le nouveau terrain est façonné de manière à canaliser nos efforts vers le renouveau de l’État.
Cela ne veut pas dire que la seule posture critique consiste rester sur la touche. Bien au contraire. La destruction récente de la statue de Silent Sam à Chapel Hill est l’un des nombreux exemples où des personnes ont agi avec courage et intelligence dans des circonstances difficiles pour faire reculer simultanément la droite suprémaciste blanche et subvertir la tendance pacificatrice de la gauche institutionnelle. Le contrepoint est que le spectre de Trump et de l’extrême droite rendent encore plus facile les relations de solidarité entre les gens et la dissémination de pratiques d’autodéfense et d’action directe, et cela dans beaucoup plus de situations par rapport aux rebellions anti-police qui se sont multipliées avant Trump.
Le problème est que ces nouvelles alliances sont beaucoup plus susceptibles d’être accaparées ou neutralisées par les politiciens identitaires, la gauche autoritaire et les militants des partis.
Cela ne rend pas les choses plus faciles quand de nombreux anarchistes et antifascistes adoptent pour l’essentiel la politique du Front Populaire et font le travail discursif des démocrates. Dans le même ordre d’idées, nous avons Ami du Radical qui met en garde contre un « système judiciaire corrompu », d’autres encore qui prônent les « droits de l’homme » ou même les antifascistes de Portland qui exigent que la police reçoive une meilleure formation.
Chaque fois que nous participons à des débats essentiellement gauchistes, de tels discours abondent. Cela fait partie du paysage, et dans la mesure où ces discours sont en dehors de notre contrôle, la seule question pour nous est de savoir comment y répondre efficacement, en soulignant leurs défauts sans être autoritaire ou insensible. Mais lorsque nous reproduisons ces discours pour nous intégrer, ou parce que nous avons tellement peur de la droite que nous commençons à soutenir les projets de la gauche, nous creusons nos propres tombes. Il est vital d’articuler des positions spécifiquement anarchistes en ce qui concerne les conflits sociaux plutôt que de se ruer vers les positions du plus petit dénominateur commun, précisément parce que ces positions sont formulées pour favoriser les intérêts du contrôle social – et sur le long terme, ces positions ne contestent pas la suprématie blanche.
Au centre gauche abondent les propos alarmistes quant à l’approche de la tyrannie et du fascisme. Comment comprendre qu’une grande partie du contenu d’un site anarchiste puisse être redondante par rapport aux éditoriaux de CNN et du New York Times ? Par exemple, Jeffrey Sachs écrit pour CNN sur la façon dont nous prenons le chemin de la tyrannie, ou encore les récents best sellers tels On Tyranny, de Timothy Snyder, The Plot to Destroy Democracy de Malcolm Nance, et Fascism: A Warning, de Madeleine Albright. Des entreprises de premier plan y participent également, comme Microsoft avec son nouveau Programme de Défense de la Démocratie.
On perçoit communément les démocrates comme des nullards politiques, et ils n’ont pas cette réputation pour rien. Pourtant, ils ont beaucoup plus d’influence dans la rue que nous ne voudrions l’admettre, surtout vis-à-vis des anarchistes. En 2008, le Parti démocrate a prouvé qu’il était capable de gérer un vaste mouvement populaire de rue qui a temporairement réduit au silence les initiatives plus critiques et qui a canalisé un grand déploiement d’efforts militants dans une campagne électorale. Les Marches des Femmes ont montré qu’elles n’ont pas oublié comment transformer les angoisses populaires en bases électorales. La Marche pour Nos Vies les a vus créer un mouvement dans un délai beaucoup plus court, mobilisant des centaines de milliers d’élèves du secondaire qui seront en âge de voter en 2020.
Les démocrates, dans leur grand cynisme, ont utilisé le mouvement contre la séparation des enfants pour montrer qu’ils pouvaient coopter un mouvement ayant des implications potentiellement radicales et l’utiliser pour protéger le régime frontalier auquel il s’était d’abord opposé. Les manifestations contre l’éclatement des familles immigrées et l’emprisonnement des enfants de parents sans papiers ont été organisées en partie par des ONG qui reçoivent des fonds publics pour administrer les centres de détention des immigrants. Le résultat a été que l’enfermement des familles a été présenté comme une victoire, la haine des frontières a été remplacée par la haine de l’ICE et de Trump (souvenons-nous que l’ICE peut être remplacé par d’autres agences), et tout le monde a oublié que les enfants migrants étaient également enfermés sous Obama. En fait, les tribunaux ont dû forcer l’administration Obama à cesser d’enfermer indéfiniment des familles de demandeurs d’asile – ensemble – dans des « conditions généralement déplorables » afin de dissuader d’autres demandeurs d’asile, c’est-à-dire une sorte de terrorisme léger visant à empêcher l’accès à ce qui, selon l’ordre démocratique, est censé être un droit humain fondamental. Et alors que l’administration Obama ne séparait qu’« occasionnellement » les enfants de leurs parents à la frontière, chacune des plus de 2,5 millions de personnes déportées par Obama laissait derrière elle des enfants ou d’autres êtres chers.
Les frontières séparent les familles. C’est ce qu’elles font. Et ceux qui sont en faveur des frontières, c’est-à-dire ceux qui soutiennent les États, les élections et tout ce qui va avec, peuvent soit déshumaniser les migrants, soit se réjouir des façons « humaines » de les emprisonner et de séparer leurs familles.
À l’approche des élections de novembre 2018, on nous dira que nous sommes des monstres si nous ne votons pas en faveur de frontières plus humaines, pour des assassinats policiers plus humains, pour des guerres plus humaines, pour les habituelles alliances politiques et pour les accords commerciaux néolibéraux d’usage. Ce processus s’intensifiera graduellement jusqu’à la campagne électorale de 2020, qui débute le 7 novembre prochain. Le Parti démocrate dépensera des millions de dollars pour prendre le contrôle ou réduire au silence les grandes coalitions de gauche formées au cours des deux dernières années d’organisation antifasciste et pro-immigrés. Ceux qui font valoir des positions critiques seront traités de criminels, de racistes, ou de n’importe quoi d’autre. Partageant nos terrains d’action, les militants d’ONG ont appris notre langue et ils savent comment nous neutraliser presque aussi bien que le FBI a neutralisé les Panthers dans les années 1960 et 1970.
Pendant ce temps, des dizaines de millions d’Americains, jeunes et moins jeunes, fonderont leurs espoirs sur une renaissance progressive. Les jeunes femmes migrantes rêveront d’étudier pour devenir avocates et juges dans les « tribunaux du conquérant », pour reprendre une phrase de ce juge en chef historique, John Marshall. Les étudiants radicaux se qualifieront de socialistes et iront jusqu’à préconiser l’élargissement des programmes gouvernementaux de soins de santé et la gratuité des frais de scolarité à l’université. Ils vont tous, sans le dire, conspirer pour que l’Amérique redevienne grande (great again).
Pour que ce renouvellement soit possible, le Parti démocrate devra négocier une sorte de consensus viable entre sa branche centriste et sa branche progressiste. Les progressistes qui ont remporté les primaires devront montrer qu’ils peuvent gagner des sièges en novembre 2018 ; comptons néanmoins une amélioration sérieuse de la machine populaire qui n’a pas obtenu la nomination de Bernie Sanders en 2016, et le candidat 2020 sera le représentant de la mouvance centriste. En 2016, les primaires démocrates ont surtout servi de référendum pour savoir qui était le mieux connecté à la machine du parti, et non savoir qui avait les meilleures chances de battre les républicains. Si les démocrates sont tout aussi stupides et ne privilégient pas les critères qui leur donneront des chances de gagner, ils risquent de perdre coup sur coup deux élections pourtant acquises d’avance. S’ils se réveillent, ils nommeront quelqu’un de charismatique capable de faire un signe de tête dans le sens des programmes progressistes qui motiveront une base activiste. C’est particulièrement crucial si l’on considère deux facteurs : le déclin toujours plus vif de la participation électorale des plus jeunes et, pour ceux des moins vieux qui votent néanmoins, une forte inclination à gauche. En favorisant des candidats centristes sans perspective qui découragent les électeurs progressistes, les démocrates se suicident politiquement, utilisant une arithmétique pro-centre qui ne s’applique plus à la réalité sociale actuelle.
Si l’économie commence à s’écrouler avant novembre 2020, les Démocrates recevront une aide supplémentaire, peut-être même qu’elle les rendra hermétiques à la stupidité aussi bien que Trump s’est lui même judicieusement rendu hermétique aux controverses. Ils devront travailler dur pour ne pas gagner en 2020, et s’ils le font, ils s’engageront immédiatement dans un volte-face musclé de la politique américaine. La fin des tarifs douaniers, des relations plus étroites avec l’UE, un retour tardif à l’accord de Paris, une riposte contre l’influence russe au Moyen-Orient, un dégel en Iran, une politique moins agressive concernant les limites imposées à la Chine, une tentative hypocrite pour diffuser une propagande démocratique cohérente et stimulante. Sur le front intérieur, si la majorité du Congrès le permet, ils chercheront à réformer le système de santé – soit en consolidant le Obamacare, soit en mettant en œuvre quelque chose qui a du sens – et à légaliser en masse les migrants, tout en renforçant davantage les mécanismes frontaliers et les expulsions.
Par-dessus tout, ils vendront le rêve d’un patriotisme inclusif, une vision que les médias grand public essaient déjà de véhiculer. Cela nous rappelle le gouvernement SYRIZA en Grèce, le plus progressiste de toute l’Europe, qui, en plus d’avoir mis en place les mesures d’austérité les plus sévères, s’est également distingué en étant encore plus militariste que ses prédécesseurs conservateurs.
Avec le temps, les circonscriptions démocrates continueront probablement à se réorienter en faveur de la faction progressiste qui pourrait présenter un candidat d’ici 2028. Bien sûr, si l’effondrement économique est aussi grave qu’il pourrait bien l’être, toutes leurs politiques porteront sur ce sujet, se limiteront à cela et à la tourmente géopolitique qui ira avec.
Pendant ce temps, l’infra-majorité fantôme de Trump va continuer à s’affaiblir. Les tranches d’âge qu’il a conquises commencent à 65 ans, de sorte qu’un nombre croissant mourront chaque année, et à moins que les progressistes ne commencent soudainement à perdre les Guerres Culturelles, ces groupes d’électeurs ne se renouvelleront pas vite. Pendant un certain temps, toutefois, ils diviseront fatalement les circonscriptions républicaines, forçant ce parti à trouver un équilibre en devant concilier deux factions polarisées, dont aucune ne sera franchement motivée à soutenir l’autre aux élections (surtout maintenant que l’objectif de la majorité à la Cour suprême ne joue plus).
Si d’une manière ou d’une autre les républicains gagnent en 2020, soit ils reviennent en arrière (par exemple, en remplaçant un Trump destitué par un Pence), soit ils vont se raffermir autour de leur destruction de l’hégémonie politique américaine et sa domination économique. Le programme de Trump, tel qu’il est, n’est pas « revanchard » comme l’ont prétendu par hyperbole certains antifascistes ; plutôt que d’essayer de retrouver le rôle dominant de l’Amérique dans le monde, il le détruit en fait. Dans un avenir alternatif où les États-Unis sont économiquement déprimés, géopolitiquement has-been, et où les républicains trumpistes continuent de gagner, on pourrait imaginer les possibilités pour davantage de mouvements fascistes, mais que feraient tous les capitalistes américains extrêmement puissants durant toutes ces années intermédiaires en voyant leurs fortunes s’évaporer ? Ils feraient tout ce qu’ils pourraient pour l’empêcher, comme ils ont déjà commencé à le faire, ainsi qu’en témoignent nombre d’entreprises américaines parmi les plus importantes qui s’élèvent régulièrement contre les politiques de Trump. Encore une fois, cela contredit l’affirmation antifasciste simpliste selon laquelle la récession économique est synonyme d’une montée du fascisme. C’est beaucoup plus compliqué que cela : parfois, les crises économiques poussent les capitalistes à soutenir davantage la démocratie, pas moins, comme ce fut le cas en Espagne dans les années 1970 et comme c’est le cas aujourd’hui.
Dès lors, face à la résurgence de la droite et à la possibilité encore plus grande de voir une gauche triomphante, la question pour les anarchistes est la suivante : quelles sont les positions qui vont au cœur du problème, peu importe qui est au pouvoir, tout en se concentrant aussi sur les détails concrets qui expliquent comment le pouvoir étouffe les peuples ?
Il n’est pas si difficile de trouver un moyen de s’opposer au pouvoir de l’État et à la violence raciste, de manière à ce que nous soyons prêts, aptes et sur pieds, peu importe qui gagne en novembre, et de nombreux anarchistes font exactement cela. En tant qu’anarchistes, nous lutterons toujours contre les frontières, contre le racisme, contre la police, contre la misogynie et la transphobie, et nous serons donc toujours en première ligne contre toute résurgence de la droite. Mais les frontières, la police, la pérennisation des institutions coloniales, la régulation du genre et de la famille ne sont-elles pas aussi des éléments fondamentaux du projet progressiste ?
La principale hypocrisie des progressistes réside souvent dans leur soutien tacite à la répression, cette chaîne ininterrompue qui relie le fasciste le plus vicieux à la gauche la plus humaniste. C’est pourquoi, au cœur de toute coalition avec la gauche, il est logique que les anarchistes mettent l’accent sur la grève des détenus (NdT. : août-sept. 2018) et amènent la question de la solidarité avec les prisonniers militants des luttes anti-pipeline et les ceux des soulèvements anti-police. S’ils veulent protéger l’environnement, appuieront-ils Marius Mason et Joseph Dibee ? S’ils pensent que la construction d’un plus grand nombre d’oléoducs et de gazoducs à ce stade avancé du réchauffement de la planète est inadmissible, se joindront-ils aux mouvement des Water Protectors ? S’ils détestent le racisme policier, vont-ils soutenir ceux qui sont encore emprisonnés après les soulèvements à Ferguson, Baltimore, Oakland et ailleurs, principalement des Noirs qui se battent en première ligne contre la violence policière ?
Une telle approche permettra de séparer les agents du Parti Démocrate d’un côté et de l’autre les militants sincères des mouvements en faveur de l’environnement, de la solidarité avec les migrants et du mouvement « Black Lives Matter ». Elle remettra également en question l’illusion que de nouveaux politiciens résoudront ces problèmes et généralisera le soutien aux tactiques d’action directe et d’autodéfense collective.
Socialisme démocratique ou technocratique
Rien n’est éternel, et même si les stratégies démocratiques de gouvernance et d’exploitation sont peut-être le plus grand danger actuel, cela ne signifie pas qu’il en sera de même demain. La démocratie en tant que pratique gouvernementale incapable de réaliser ses idéaux est en crise aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, et la démocratie en tant que structure de coopération interétatique et d’accumulation de capital fait également face à une crise au niveau mondial.
En raison de sa crise interne, la démocratie ne parvient pas à capter les aspirations de ses sujets. Les types d’égalité qu’elle garantit sont pour la plupart insignifiants ou pernicieux, et les avantages diminuent à mesure que l’on descend dans l’échelle sociale. Le régime démocratique n’a pas réussi à créer des sociétés justes et n’a pas réussi à combler l’écart qui se creuse entre les nantis et les démunis. Il a fini par devenir un autre système aristocratique, pas meilleur que ceux qu’il a remplacés.
Cela signifie que la démocratie est en train de perdre sa capacité novatrice de récupération des résistances. Mais jusqu’en 2008 environ, les membres de l’élite néolibérale se souciaient à peine de la résistance. Ils pensaient qu’ils avaient si bien vaincu et enterré les potentiels révolutionnaires qu’ils n’avaient plus besoin de faire semblant, plus besoin de jeter des cacahuètes à la foule. Au fur et à mesure que les années 1990 et 2000 avançaient, ils sont devenus de moins en moins discrets dans leur croisade pour concentrer la richesse dans un nombre de mains toujours plus faible, tout en détruisant l’environnement et en marginalisant une partie toujours plus importante de la population. Maintenant qu’ils ont révélé leur vrai visage, il faudra un certain temps pour que les gens oublient avant de pouvoir à nouveau succomber à leurs sirènes, et ce manque de confiance dans les institutions publiques arrive à un mauvais moment pour les pays autrefois hégémoniques de l’OTAN et leurs alliés.
Cela souligne à quel point les radicaux font preuve d’un court-termisme frustrant lorsqu’ils cherchent à restaurer la valeur séduisante de la démocratie en parlant de ce à quoi devrait ressembler la « vraie démocratie » : c’est comme l’histoire de cet ingénieur pendant la Révolution française dont la vie est épargnée au dernier moment alors que la guillotine se bloque, jusqu’à ce qu’il lève les yeux et dise « je pense voir votre problème ».
Si la crise mondiale de l’ordre démocratique atteint son point culminant avant que le potentiel de séduction de la démocratie ne soit renouvelé, il leur sera d’autant plus difficile d’empêcher les mouvements révolutionnaires de devenir de véritables menaces. Cette deuxième crise s’articule autour de l’effondrement en cours des mécanismes politiques interétatiques qui sont de moins en moins en mesure de tempérer les conflits, et de l’effondrement économique imminent qui menace de fermer le banquet autour duquel la plupart des États du monde s’agglutinent, cherchant à coopérer en faisant valoir les possibilités de croissance économique dont ils sont tous dotés.
Les problèmes multiples et toujours plus nombreux du système mondial conçu par les États-Unis ont en effet conduit de nombreux experts économiques et de gouvernement à envisager de modifier le système démocratique actuel. Différentes propositions pour résoudre la crise interne de la démocratie comprennent le passage à une démocratie plus délibérative ou participative, le passage à la démocratie numérique ou électronique, comme moyen de recouvrer la participation civique des masses ; ou de relier à nouveau les aspects socio-économiques à l’égalité politique et de contrôler le pouvoir cumulatif de l’élite. Ce courant a décidément peu d’influence sur les institutions et les décideurs politiques. Autrefois défendues par les idéalistes de la science politique, qui étaient très lus mais peu connectés, ces idées ont depuis migré vers la rue, et sont aujourd’hui principalement évoquées par des acteurs du secteur des technologies qui pensent que leurs nouveaux gadgets peuvent révolutionner le gouvernement – en présumant sans réserve que les mauvais résultats des gouvernements ont été les conséquences des limitations technologiques – et par des partis progressistes en Europe et en Amérique latine, qui exercent surtout leur influence au niveau municipal.
La plupart des chercheurs et des groupes de réflexion politiquement connectés adoptent l’approche inverse : la participation civique de masse est un objectif irréaliste ou indésirable, et beaucoup accablent même la plèbe du déclin de la démocratie. Une contre-proposition consiste à doubler la démocratie représentative et à résoudre la crise par la consultation de « mini-publics » qui remplacent la participation civique de masse. Cette dernière, en tant que contrôle institutionnel du pouvoir de l’élite, ne serait plus un objectif réaliste selon les promoteurs. D’autres parlent de la nécessité d’un plus grand professionnalisme et d’une amélioration structurelle des intermédiaires (partis politiques et groupes d’intérêts), une sorte d’hybride entre la démocratie et des politiciens professionnels de la représentation. Mais comme la première crise porte autant sur la perception que sur les résultats, il est peu probable que les chercheurs collet monté qui se méfient profondément du public sachent comment la résoudre, quelle que soit la qualité de leurs données.
Cependant, il n’y a aucune raison pour que ces deux courants ne puissent être combinés : des référendums plus populaires et des sondages numériques à l’échelle municipale ; une plus grande professionnalisation, des évaluations technocratiques et une amélioration structurelle des partis politiques à l’échelle nationale. Les premières dispositions amélioreraient la confiance du public et le sentiment d’autonomisation, les secondes réduiraient l’incompétence et empêcheraient des changements populistes désastreux et soudains dans les choix politiques. Le plus grand obstacle à de tels changements stratégiques est la culture politique, l’inertie institutionnelle d’un système complexe déjà en place depuis plusieurs décennies. Considérez l’impossibilité pratique d’aller au-delà d’un système bipartite aux États-Unis et considérez que dans la plupart des pays, toute modification de la structure des partis politiques et autres intermédiaires, au-delà d’une simple réforme du financement des campagnes électorales (déjà mise en œuvre dans de nombreuses démocraties), exigerait des réformes constitutionnelles bien difficiles à réaliser.
Quant à la deuxième crise, il semble y avoir beaucoup moins de débats. Les journaux économiques occidentaux font état d’un consensus presque complet sur la nécessité de rejeter le nationalisme économique et de rétablir « l’ordre commercial multilatéral régi par des règles que les États-Unis eux-mêmes ont créé ». Les seules voix en faveur du nationalisme économique sont celles de certains écologistes peu influents sur le plan politique ; celles des restes de l’antimondialisme péroniste de gauche en Amérique latine, longtemps éclipsés par des courants néolibéraux endogènes suivant les signaux de Lula et compagnie ; et celles de certains politiciens réactionnaires de l’hémisphère Nord qui ne comprennent rien à l’économie et sont arrivés au pouvoir uniquement parce qu’ils étaient les premiers en ligne pour appliquer des récentes innovations en analyse de données que les politiciens plus centristes, certains de leur succès, n’avaient pas encore exploitées5. L’élite des entreprises voit unilatéralement le nationalisme économique comme un risque – une mauvaise chose – et organise actuellement un débat sur la façon dont « les compagnies multinationales doivent surmonter les sentiments protectionnistes des consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux et réinventer leurs modèles de responsabilité sociale des entreprises ».
Il n’y a qu’une seule exception importante à ce consensus, et en réalité la seule véritable alternative à l’ordre démocratique actuel : la technocratie, qui est parfois assimilée à un nationalisme économique sans rapport avec celui proposé par des gens comme Bannon.
L’État chinois est le principal modèle et promoteur d’un tel système, bien que des discussions franches aient également eu lieu à ce sujet en Occident. L’Union Européenne constitue un hybride entre un modèle technocratique et un modèle démocratique, bien qu’elle ne puisse préconiser une telle hybridation, car reconnaître un fossé entre démocratie et technocratie serait en contradiction avec l’identité fondamentale de l’UE.
Un système technocratique laisse les décisions politiques à des experts désignés qui graviront les échelons, soi-disant en fonction des performances ; les nominations sont effectuées par l’institution elle-même, comme dans une université, et non par consultation avec le public. La plupart des dirigeants du Parti Communiste chinois, par exemple, sont des ingénieurs et autres scientifiques. Cependant, il serait naïf d’ignorer qu’ils sont d’abord et avant tout des politiciens. Ils doivent simplement répondre à la dynamique interne du pouvoir au lieu de consacrer leur efficacité pour le grand public.
Aux États-Unis, la très importante Réserve Fédérale fonctionne de manière technocratique, bien qu’elle soit subordonnée au leadership démocratique. Les éléments technocratiques de l’Union européenne, tels que la Banque Centrale Européenne, jouissent d’un pouvoir décisionnel beaucoup plus important et sont souvent capables de dicter des conditions aux gouvernements démocratiques des États membres. Cependant, l’UE a pris soin de profiter de la vieille distinction libérale entre politique et économie : en reléguant la technocratie à une sphère prétendument économique, l’UE maintient son engagement obligatoire envers la démocratie.
L’une des principales faiblesses de la démocratie occidentale qu’un système technocratique peut renforcer est la tendance à des changements politiques soudains et irrationnels qui correspondent à une tentative populiste de prendre le pouvoir. Quelqu’un comme Trump peut présenter une demande fondée sur des renseignements erronés qui, malgré tout, correspondent aux expériences vécues par une partie de l’électorat – par exemple, l’ALENA a fait du tort à un grand nombre de personnes, mais les raisons à cela et les effets de la solution de rechange proposée sont très différents de ceux que Trump a avancés. Au gouvernement, la condition sine qua non pour mettre en œuvre son programme est de prendre le contrôle des instruments du pouvoir. Dans un système démocratique, pour obtenir le contrôle de ces instruments, il faut réussir à attirer la majorité de l’électorat par le biais des filtres élitistes des médias corporatistes et du financement des campagnes électorales. Pendant longtemps, les partis y sont parvenus en faisant la distinction entre discours populaires et discours professionnels. En d’autres termes, ils ont régulièrement menti aux masses sur ce qu’ils allaient réellement faire, contribuant année après année à la crise de la démocratie. Les populistes comme Trump ont signalé qu’ils rompraient avec ce modèle en brisant toutes les autres règles de la politique respectable. Le problème (du point de vue de l’État) est qu’une telle stratégie est efficace pour gagner un vote mais pas pour défendre les intérêts des institutions gouvernementales.
Les systèmes technocratiques résolvent ce problème en supprimant la boucle de rétroaction non pertinente de l’électorat, en basant l’accès au pouvoir directement sur la performance des stratégies qui vont amplifier le pouvoir. Ce faisant, les technocrates se protègent aussi théoriquement du risque de mauvais dirigeants. Des dirigeants stupides et charismatiques sont la marque de la démocratie, mais le danger qu’ils représentent pour le système est neutralisé par des conseillers intelligents et peu charismatiques qui les tiennent en laisse. George W. Bush et Ronald Reagan étaient des exemples parfaits et fonctionnels de ce modèle. En rompant la laisse, Trump a démontré qu’il ne s’agit pas d’une composante structurelle importante du gouvernement démocratique, et donc d’un point faible potentiel.
Un autre avantage des systèmes technocratiques est leur capacité à centraliser les intérêts. Dans tout système démocratique, il existe de nombreux intérêts divergents qui rendent le consensus difficile, ce qui peut mener à une politique partisane, polarisée et retranchée. Pendant l’âge d’or de la démocratie, il y avait un consensus parmi les élites sur les stratégies fondamentales de la gouvernance. Aujourd’hui, nous constatons de plus en plus une divergence des intérêts de l’élite et l’incompatibilité des différentes stratégies de gouvernance. Un système technocratique utilise le pouvoir massif de l’État non pas pour créer un terreau sur lequel les capitalistes peuvent prospérer, mais pour ordonner stratégiquement les opérations du capital dans une trajectoire convergente. Ces dernières années, l’État chinois a arrêté, emprisonné et fait disparaître des milliardaires qu’il accuse de corruption, ce qui signifie qu’il agit en dehors du contrôle du Parti sur le marché, s’engageant dans une planification économique alternative ou autonome.
Sur le plan géopolitique, le modèle technocratique chinois a un certain avantage. Pays après pays et entreprises après entreprises se sont pliés aux exigences de Pékin et ont cessé de reconnaître Taiwan comme un pays indépendant. Non seulement la Chine est une grande économie, mais elle a une plus grande capacité de tirer parti de l’accès à cette économie à des fins politiques, en combinant une plus grande centralisation avec une approche stratégique rationalisée qui exclut la séparation de la politique et de l’économie.
Cependant, il y a beaucoup de mythes autour de la gouvernance technocratique. On ne peut pas avoir un gouvernement purement « scientifique » parce que « intérêts objectifs » est une contradiction dans les termes. L’empirisme pur ne peut pas reconnaître quelque chose d’aussi subjectif que les intérêts ; c’est pourquoi les organes scientifiques doivent fabriquer des idéologies discrètes déguisées en présentations neutres des faits, puisqu’il n’y a aucune activité humaine, et certainement aucune recherche et développement bien coordonnée, sans intérêts. Pourtant, les gouvernements ne sont rien sans les intérêts. Ils représentent, à leur niveau le plus rudimentaire, la concentration d’une grande quantité de ressources, de pouvoir et de potentiel de violence dans le but de satisfaire les intérêts d’un groupe spécifique de personnes. La relation devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que les gouvernements deviennent plus complexes, avec différents types de personnes qui développent des intérêts différents à l’égard du gouvernement, avec des institutions qui produisent des subjectivités et, par conséquent, façonnent la conception qu’ont les gens de leurs intérêts ; mais le caractère central des intérêts demeure, tout comme le fait que le pouvoir hiérarchique empêche le discernement en dehors d’une réalité très étroite, et une si grande insensibilité combinée à une telle puissance est une recette implacable qui engendre une stupidité sans précédent.
On peut citer à titre d’exemple le barrage des Trois Gorges, peut-être le plus grand exploit de construction du xxe siècle, et certainement un symbole de la capacité du Parti Communiste Chinois à mener à bien une planification stratégique qui sacrifie les intérêts locaux au profit d’un présumé plus grand bien. Mais le barrage a causé tellement de problèmes démographiques, environnementaux et géologiques qu’ils pourraient l’emporter sur les avantages de la production d’énergie. La principale motivation pour la construction du barrage était probablement l’orgueil – l’État se prélassant dans son pouvoir technocratique – plus qu’une juste estimation des avantages du barrage.
Les politiques de pouvoir peuvent également jouer un rôle dans la crise du crédit en Chine. Les petites entreprises ont du mal à obtenir des prêts du système bancaire chinois, qui a traditionnellement favorisé les entreprises publiques, les grandes entreprises ou les entreprises affiliées politiquement. Ces petites entreprises se sont donc tournées vers de nouvelles plateformes de prêts entre pairs, dont beaucoup ont été démantelées ou fermées par le gouvernement, entraînant une perte considérable en épargne. Le problème prend des dimensions supplémentaires si l’on considère l’importance des nouvelles entreprises dans l’économie américaine au cours des deux dernières décennies : pensez à Apple, Google, Amazon, Facebook. On peut soutenir que seules ces entreprises permettent aux États-Unis de conserver leur première place dans l’économie mondiale. Et si des start-up technologiques comme Didi et Alibaba ont joué un rôle important dans la croissance économique chinoise et ont également réussi à gravir les échelons pour recevoir un soutien vital de l’État, elles n’ont pas encore démontré les capacités d’innovation de pointe qu’un leader mondial devrait avoir. Elles ne peuvent peut-être être perçues que comme des copies d’entreprises occidentales bien implantées, n’ayant pu recevoir de financement qu’après que les occidentaux aient démontré l’importance de ces firmes. Si cela est vrai, cela n’augure rien de bon pour la capacité du capitalisme d’État chinois à créer un climat qui favorisera une innovation plus avant-gardiste que les États capitalistes occidentaux.
L’Union européenne a aussi des problèmes avec la technocratie. Outre les rébellions temporaires provoquées par l’autoritarisme de la Banque Centrale, la menace existentielle numéro un de l’UE à l’heure actuelle peut être attribuée au Règlement de Dublin, un accord européen précoce, peu examiné au moment de sa signature, qui prévoit que les migrants peuvent être renvoyés vers le premier pays européen où ils sont entrés. Ordinairement, en plus d’intimider leurs homologues les plus pauvres, les plus important États membres de l’UE (Allemagne, Royaume-Uni, France, Benelux) protègent leurs industries stratégiques tout en dictant quelles industries les plus pauvres doivent se développer ou abandonner. Et si les pays méditerranéens ont pu tolérer d’être transformés en colonies à dette et en enfers touristiques, ils n’ont pas été aussi tolérants à l’égard de la politique d’immigration, ce qui donne aussi à leurs dirigeants un bouc émissaire pour les deux premiers problèmes. La politique d’immigration de l’UE est un dumping évident pour la Grèce, l’Italie et l’Espagne et, dans une moindre mesure, pour la Pologne et les autres États frontaliers. Ce sont ces pays qui peuvent le moins se permettre d’alourdir le fardeau de leurs services sociaux, l’Allemagne s’accaparant les migrants les plus instruits et renvoyant les plus pauvres vers les États frontaliers. Cette politique a été la cause principale de toutes les menaces de droite qui pèsent sur l’intégrité de l’UE. Bien qu’elle soit le produit de planificateurs technocrates, elle reflète la même arrogance qui accompagne toute politique de pouvoir.
Il y a aussi la question de la résistance. Le gouvernement chinois fait le pari qu’il a le pouvoir technologique et militaire de neutraliser tous les mouvements de résistance, de façon permanente. S’il se trompe, il risque l’effondrement politique total et la révolution. Les gouvernements démocratiques jouissent d’une plus grande souplesse, car ils peuvent détourner les mouvements dissidents vers des réformes qui rajeunissent le système, plutôt que de les contraindre au silence ou à exploser. Les institutions démocratiques européennes ont prouvé que ce mécanisme de soupape de pression fonctionne toujours, les partis progressistes empêchant la croissance des mouvements révolutionnaires en Grèce, en Espagne et en France. Ensuite, il y a le problème de la continuité. En concentrant tant de pouvoir en la personne de Xi Jinping, l’État chinois s’attaque au problème séculaire de la succession : comment transmettre le pouvoir à un dirigeant qui a les bonnes compétences ?
Le modèle technocratique n’est donc pas franchement supérieur. Même si c’était le cas, les puissances occidentales auraient du mal à l’accepter sous une forme qui ne soit pas hybride. Cela nous ramène à la suprématie blanche et à sa centralité dans le paradigme occidental. La démocratie joue un rôle fondamental dans la mythologie de la suprématie blanche et dans les prétentions implicites des progressistes blancs à être supérieurs aux autres. S’appuyant sur les racines mythiques de la démocratie dans la Grèce antique, les Blancs peuvent se considérer comme les fondateurs de la civilisation et donc les meilleurs tuteurs pour les autres sociétés dans le monde. Les paranoïas orientalistes sont basées sur l’idée que les civilisations orientales sont associées à l’autocratie et le despotisme. Sans cette opposition, l’estime de soi occidentale s’effondre.
En fait, l’État chinois se réclame de la démocratie, de la justice, de l’égalité et du bien commun, de manière tout aussi valable que les États occidentaux. Mais ces prétentions sont validées dans un paradigme différent de celui que les élites occidentales utilisent pour justifier leurs propres défaillances. La démocratie chinoise s’inspire à parts à peu près égales du léninisme et d’une approche confucianiste de l’art politique. Dans ce modèle, le Parti consulte les groupes politiques minoritaires et les groupes d’intérêt avant de rédiger une déclaration consensuelle jugée dans l’intérêt général. Cette conception ne se traduit pas bien dans un paradigme libéral occidental. Les classes dirigeantes occidentales ne peuvent être convaincues par un tel modèle ; elles se sentent menacées par la perspective de la domination chinoise, même si elles croient en leur propre hypocrisie.
La concurrence entre l’OTAN et la Chine revêt de plus en plus ces nuances culturelles. Mais à mesure que les conflits géopolitiques entre les États-Unis, la Russie et la Chine continuent d’éroder les institutions interétatiques existantes, les querelles actuelles pourraient représenter un revirement plus radical vers une confrontation entre différents modèles de gouvernance à l’échelle mondiale.
La tendance que nous avons évoquée plus haut, par laquelle de nombreux pays ont changé leurs relations diplomatiques de Taiwan à la Chine, a une signification qui va au-delà du sort de l’île autrefois connue sous le nom de Formose. Bon nombre des pays qui se sont conformés aux exigences de Pékin sont de petits pays des Caraïbes et d’Amérique centrale historiquement inféodés aux États-Unis. Le fait qu’ils s’éloignent de Taïwan symbolise également un certain refroidissement de leurs relations avec les États-Unis eux-mêmes. Dans le système émergent, ils ont des alternatives, et ces alternatives érodent la domination américaine, non seulement en Amérique centrale, mais aussi dans un certain nombre de points chauds géopolitiques. Comme l’a dit M. Erdogan en réponse aux tentatives classiques des États-Unis de renforcer leur politique étrangère, « avant qu’il ne soit trop tard, Washington doit abandonner l’idée fausse que nos relations peuvent être asymétriques et accepter le fait que la Turquie a des alternatives. »
L’Arabie saoudite a fait preuve de la même sensibilité vis-à-vis de la situation géopolitique en expulsant l’ambassadeur du Canada et en suspendant les accords commerciaux après une énième critique à propos des Droits de l’Homme, vu que les réprimandes hypocrites typiques des pays occidentaux ont toujours laissé place au déroulement habituel des affaires. L’assassinat du journaliste dissident Khashoggi par la Couronne saoudienne et la réaction des gouvernements occidentaux montrent également que les règles sont en cours de réécriture. Certains acteurs tentent de modifier leurs prérogatives, tandis que d’autres reculent. Le rôle que joue l’État turc, qui tire astucieusement parti de la controverse à son profit, illustre à quel point tout est à sa portée dans cette situation : chaque alliance et chaque pays peut améliorer sa position, ou la perdre.
Les critiques véhémentes de la Chine à l’égard du racisme suédois, après l’humiliation relativement mineure d’un petit groupe de touristes chinois, sont également significatives. La critique est valable, mais son contenu n’est pas pertinent dans la mesure où l’État chinois aurait pu critiquer de la même manière des attaques beaucoup plus graves contre les voyageurs et les migrants chinois à travers l’Occident depuis plus de cent ans. Ce qui a changé, c’est qu’un État de l’hémisphère Sud remet en question la supériorité morale de l’Occident, frappant au cœur même d’une Scandinavie auto-satisfaite, et cet État associe la critique à une menace économique : la Chine a doublé sa réprimande d’un avertissement à ses citoyens contre le tourisme en Suède, et des campagnes ont également été menées pour boycotter des produits suédois.
Si l’État chinois devenait l’architecte d’un nouveau cycle mondial d’accumulation, il aurait besoin d’un système de relations interétatiques compatible avec le modèle technocratique de régulation de son capitalisme d’État. Tout porte à croire qu’il chercherait la stabilité mondiale en plaçant explicitement les droits de l’État au-dessus de tout autre type de droits. Cela signifierait que si la Turquie voulait raser tout le Bakur, si l’Arabie saoudite voulait complètement réduire en esclavage ses employés de maison, si la Chine voulait emprisonner un million d’Ouïghours dans des camps de concentration, ce serait leur prérogative et l’affaire de personne d’autre. Il s’agirait d’une stratégie efficace pour créer plus de bonne volonté et une coopération économique sans entrave entre les États avec, au fondement du droit, la puissance militaire. Cela ne nous choquerait pas non plus qu’une telle conception émane du Parti Communiste, qui a depuis longtemps adopté l’idée jacobine que la fin justifie les moyens.
La CIA est intervenue dans le discours public pour avertir le monde que la Chine veut remplacer les États-Unis en tant que superpuissance mondiale. Afin de faire passer cela pour une mauvaise chose, ils doivent suggérer que le monde est mieux en tant que protectorat américain qu’en tant que protectorat chinois. Selon un agent : « moi aussi, je suis optimiste que dans la bataille pour les normes, les règles et les standards de comportement, l’ordre national libéral est plus fort que les standards répressifs promulgués par les Chinois. Je suis sûr que les autres ne voudront pas souscrire à ça. »
En toute transparence, les États-Unis doivent convaincre le monde que le modèle démocratique peut fournir un meilleur système interétatique. Mais malgré plus d’un siècle de propagande occidentale, le produit se vend difficilement. Les populistes comme Trump affichent délibérément les faiblesses du système démocratique et sapent les alliances occidentales à leur moment le plus critique depuis 1940 – et même à leur apogée, la démocratie a donné des résultats décevants. Les États-Unis sont réputés pour leur racisme systémique et leur injustice. Avec tous les Brixton et Tottenham, le Royaume-Uni montre qu’il est dans la même voie, et la vague croissante de mouvements d’extrême droite à travers l’Europe montre que les démocraties libérales, de la Suède à l’Italie, n’ont jamais été moins racistes que les États-Unis, comme elles aimaient à le croire. Au moment où des personnes de couleur ont gagné en visibilité dans ces sociétés, des citoyens supposés éclairés se sont jetés dans les bras de partis xénophobes et d’extrême droite. Même l’extrême gauche allemande a commencé à adopter des positions ouvertement anti-immigrés.
Dans les pays du Sud, où les puissances occidentales prêchent depuis longtemps la démocratie comme la panacée alors même qu’elles continuent à soutenir les dictatures militaires, les résultats ont été décevants. Dans toute l’Amérique du Sud, la gouvernance démocratique n’a fait que cristalliser la polarisation sociale causée par le capitalisme et le néocolonialisme, et a tout ramené au niveau d’instabilité qui amené les dictatures militaires au devant de la scène6. En Birmanie, un pays qui a longtemps été une grande cause des démocrates et des pacifistes, la conseillère d’État lauréate du prix Nobel n’a pas été au pouvoir plus d’un an avant que son gouvernement ne commence à commettre le génocide contre les Rohingyas et à persécuter les journalistes dissidents. Mais quelle démocratie n’a jamais commis un petit génocide, n’est-ce pas ?
Ailleurs, la supériorité morale que les médias et les institutions gouvernementales occidentaux ont tenté de propager contre la prétendue menace chinoise a été tout aussi creuse. En réponse à la concurrence économique croissante en Afrique, longtemps réservée à l’arrière-cour de l’Europe, les articles de presse se sont enchaînés. Il déploraient la pratique chinoise des prêts prédateurs, et la manière de refourguer aux pays pauvres d’Afrique, et du Sud en général, des infrastructures inutiles tout en s’appropriant tous leurs services publics, leurs ressources et leurs futurs intérêts lorsque ces pays ne peuvent rembourser leurs dettes.
Le New York Times décrit la sujétion à la dette chinoise de la Malaisie et salue le gouvernement local pour avoir supposément tenu tête à cette pratique. Ils vont jusqu’à parler d’une « nouvelle version du colonialisme ». Ce n’est pas faux : il n’y a eu qu’un siècle sur les vingt derniers (1839-1949) où la Chine n’était pas une puissance coloniale ou impériale avec sa propre forme de supériorité ethnique. Le colonialisme a eu de nombreux visages en plus du modèle racial particulier qui a évolué dans le commerce triangulaire de l’Atlantique. Une pratique anticoloniale véritablement mondiale ne peut se limiter à une compréhension eurocentrique de la race ou à une opposition simpliste qui place tous les blancs d’un côté et tous les gens de couleur de façon homogène de l’autre.
Ce qui est en fait inexact dans le New York Times, c’est que cette « nouvelle version du colonialisme » a été développée par les États-Unis dans les décennies suivant la Seconde Guerre Mondiale. Quiconque connaît les critiques du mouvement antimondialisation et altermondialiste sait que ce sont les institutions de Bretton Woods créées aux États-Unis qui ont été les pionnières de la pratique de la servitude pour dette et de l’appropriation des infrastructures publiques. Les médias institutionnels espèrent apparemment que tout le monde a déjà oublié ces critiques.
Si cette préoccupation bien tardive et moralisatrice est ce que les promoteurs de la démocratie occidentale peuvent susciter de mieux, le combat est déjà perdu. Il faudrait une refonte majeure pour sauver les institutions actuelles de coopération interétatique et créer la possibilité d’un nouveau Siècle Américain, ou du moins Américano-Européen. Cela signifierait faire de l’ONU une organisation qu’il faudrait prendre au sérieux, une organisation qui pourrait isoler les pays qui ne respectent pas le cadre juridique commun. Pour y parvenir, les États-Unis devraient cesser d’être les principaux saboteurs de l’ONU et faire des actions sans ambiguïté, comme mettre fin à l’aide militaire à Israël.
Les responsables gouvernementaux ne prendront des mesures aussi radicales que s’ils en viennent à croire que le respect impartial des droits de l’hom me est essentiel pour faire des affaires et pour renforcer la coopération internationale. Et au xxie siècle, un respect significatif des droits de l’homme devrait tenir compte des considérations écologiques, ne serait-ce que d’un point de vue anthropocentrique. Cela signifie rien de moins qu’une intervention massive de l’État dans les processus économiques pour réduire la poursuite des intérêts à court terme et assurer la gestion humanitaire du climat et de tous les autres systèmes géobiologiques. Et comme une telle intervention serait inséparable des enjeux technologique, et donc de l’IA, les responsables gouvernementaux devraient atténuer la contradiction de la démocratie entre égalité politique et inégalités économiques en introduisant du socialisme sous la forme du salaire de base universel. Tout cela au cours des dix ou vingt prochaines années.
En d’autres termes, les gouvernements occidentaux devraient subir un changement radical de paradigme afin de pouvoir continuer à façonner le système mondial. Le défi est probablement trop grand pour eux. Les quelques progressistes visionnaires, capables d’anticiper, sont enchaînés par la logique même de la démocratie au poids mort du centre. Cela n’arrange pas les choses que la Chine ai damé le pion à l’Europe en tant que leader mondial incontesté dans la production de cellules solaires et autres énergies renouvelables. (75% des panneaux solaires dans le monde sont fabriqués soit en Chine, soit par des entreprises chinoises dans des néo-colonies industrielles d’Asie du Sud-Est et grâce à une campagne gouvernementale agressive qui pousse les banques publiques à investir). Pendant ce temps, les États-Unis se dirigent vers d’autres excès pétroliers, ouvrant des gisements inexploités dans le bassin Permien au Texas, jugés encore plus grands que les champs pétroliers d’Arabie Saoudite.
En d’autres termes, nous pouvons presque écrire l’éloge funèbre du système mondial conçu par les États-Unis. Mais la suite n’est pas claire. La Chine elle-même se dirige vers un désastre économique. Son marché boursier tremble et le pays est lourdement endetté, en particulier ses grandes entreprises. La Chine a évité la récession de 2008 grâce à une vaste campagne de relance artificielle. Aujourd’hui, les dirigeants du Parti insistent pour que l’on mette un frein à l’octroi de prêts risqués, mais cela conduit à une pénurie de crédit qui ralentit la croissance économique. Prenons l’exemple de l’Australie, réputée pour ne pas pas avoir connu de récession technique depuis 27 ans : c’est aussi en partie à cause des dépenses publiques importantes. Mais les ménages s’endettent de plus en plus et donc dépensent de moins en moins, ce qui entraîne un ralentissement des dépenses intérieures, et le principal partenaire commercial de l’Australie est la Chine, où l’affaiblissement du yuan va également nuire à la capacité des consommateurs chinois à acheter des produits importés comme ceux qui proviennent d’Australie. Avec les ralentissements économiques en Turquie et au Brésil, où les bulles de surinvestissement sont également prêtes à éclater, la Chine est le dernier acteur de poids. S’il tombe, le krach économique sera probablement mondial, et vraisemblablement bien pire qu’en 2008. Toutes les contradictions du capitalisme sont en train de converger.
Pour soutenir l’économie, la Chine suit une voie similaire à celle des États-Unis : réduire les impôts, investir davantage dans les infrastructures et modifier les règles afin que les prêteurs privés puissent consentir des prêts dont le montant est largement supérieur à celui des dépôts.
La possibilité que la Chine devienne l’architecte d’un nouveau système mondial ne repose pas sur la croissance économique ou la puissance militaire. Elle n’a pas besoin de gagner une guerre contre les États-Unis, tant qu’elle dispose d’une autonomie militaire dans son coin ; par le passé, tous les pays qui voulaient accéder à ce type de rôle ont gagné des guerres défensives contre le leader mondial en titre, et la Chine l’a déjà fait pendant la guerre de Corée. En fait, elle devrait plutôt se faire le centre de l’organisation du capitalisme mondial.
La question cruciale pourrait être : quel pays se tire le mieux de la crise économique et ouvre de nouvelles directions et de nouvelles stratégies pour l’expansion du capitalisme ? et quelles seront ces stratégies ?
Et les anarchistes ?
L’une des rares choses dont on puisse être sûr, c’est que nous n’avons aujourd’hui aucun témoin vivant d’un tel niveau d’incertitude à l’échelle mondiale. Un système défaillant peut continuer à durer encore deux ou même trois décennies, tout en faisant des ravages. Une renaissance progressive pourrait sauver ce système par le socialisme démocratique, l’éco-ingénierie et le transhumanisme. Une coalition de certains pays pourrait inaugurer un ordre plus technocratique fait de plus grands États, sur la base d’institutions et de contrats sociaux qui restent à définir.
Bien entendu, aucune de ces possibilités n’intègre de perspectives de liberté, de bien-être et de soin de la planète. Tous supposent la survie de l’État. Je n’ai pas parlé d’anarchistes dans les considérations précédentes parce que nous perdons notre capacité à nous manifester en tant que force sociale dans des circonstances aussi changeantes. Nous n’avons pas réussi à résister au confort technologique, à surmonter les diverses dépendances que le capitalisme nous impose, à abandonner les habitudes puritaines qui passent pour de la politique, à répandre les imaginaires révolutionnaires, à communautariser la vie quotidienne. Notre aptitude à l’émeute a suffit à changer le discours social et à ouvrir quelques nouvelles perspectives aux mouvements sociaux au cours des deux dernières décennies. Si le système ne se répare pas rapidement, cependant, nos compétences combatives peuvent devenir insuffisantes et invisibles à côté des conflits beaucoup plus importants qui vont surgir. La compétence qui peut être la plus importante, et qui semble manquer le plus, est la capacité de faire de la survie une préoccupation communautaire. Malheureusement, la plupart des gens semblent tomber de l’autre côté de l’individualisme dans les formes les plus extrêmes d’aliénation.
Tout cela peut changer, bien sûr. En attendant, il est plus judicieux de parler de ce que pourrait être notre vie au cours de ces prochaines années de troubles. Nous avons encore la capacité de diffuser de nouvelles idées au niveau social, de faire fonction de conscience de la société. Le capitalisme n’a plus guère de légitimité ; il faut enfoncer les derniers clous de son cercueil avant qu’il ne développe un nouveau discours pour justifier son expansion acharnée.
Pour ce faire, nous devons développer un sens aigu des voies encore ouvertes à ceux qui voudraient préserver et renouveler le capitalisme, puis les saper avant qu’elles ne puissent être solidifiées et devenir la structure du prochain discours mondialiste. De simples critiques de la pauvreté, des inégalités et de l’écocide ne suffisent pas. Éloignées d’une perspective anarchiste, chacune de ces lignes de protestation ne fera que faciliter une stratégie de sortie des contradictions actuelles vers l’avenir capitaliste.
Une fois que le néolibéralisme aura pris fin et qu’une quantité importante de la valeur mondiale aura été détruite par des défauts de paiement en cascade ou par la guerre, des choses comme le salaire de base universel deviendront probablement des stratégies intéressantes de réintégration. Il pourrait réintégrer les pauvres et les marginalisés, constituer une nouvelle réserve de prêts garantis par l’État et offrir une solution au chômage de masse exacerbé par l’IA. De plus, les variantes du revenu universel sont compatibles aussi bien avec une politique progressiste et régénératrice qu’avec une politique de droite xénophobe qui attacherait de tels avantages à la citoyenneté. Le salaire de base universel, au lieu de l’aide sociale, peut être justifié à la fois par la rhétorique de la justice sociale et par la rhétorique de la réduction de la bureaucratie gouvernementale. Cet esprit augmente les possibilités d’une nouvelle politique de consensus. Les promoteurs du revenu universel – et ils sont de plus en plus nombreux – peuvent utiliser les critiques anticapitalistes de la pauvreté et de l’inégalité pour inciter les gouvernements à investir dans les formes de financement et d’ingénierie sociale qui atténueront les problèmes causés par les entreprises et maintiendront une base de consommateurs viable qui continueront à acheter leurs produits.
Les inégalités, quant à elles, peuvent plus facilement trouver leur remède avec la promesse d’une plus grande participation : le renouveau démocratique mentionné plus haut. Dans la mesure où les critiques des inégalités sont relatives au genre, à la race et à d’autres formes d’oppression liés aux conflits sociaux, le féminisme et l’antiracisme, dans leurs aspects égalitaires, ont déjà triomphé. Le féminisme a modifié les conceptions dominantes du genre, renforçant les stéréotypes binaires mais en dotant les gens des moyens de comprendre le genre comme un autre choix du consommateur pour s’exprimer librement. Ces concepts sont en voie d’intégrer entièrement toutes les identités au sein du modèle patriarcal et suprémaciste blanc. En rejetant nominalement les formes paramilitaire du pouvoir qui maintenaient historiquement les hiérarchies sociales (ex. les viols, les lynchages), on peut enfin partager les comportements et privilèges auparavant réservés aux hommes blancs hétérosexuels. Dans la pratique, l’égalité signifie que chacun peut agir comme un homme blanc normalisé, jusqu’à ce que cette norme soit déclassée et que ses fonctions paramilitaires soient réabsorbées par des institutions comme la police, le corps médical, les agences publicitaires, etc.
Une telle pratique de l’égalité neutralise la menace que les mouvements féministes et anticoloniaux font peser sur le capitalisme et l’État. La seule façon d’en sortir est de relier les corps non normatifs à des pratiques intrinsèquement subversives, plutôt qu’à des étiquettes identitaires récupérables (essentialisme). Nous ne critiquons pas l’État parce qu’il n’y a pas assez de femmes à sa tête, mais parce qu’il a toujours été patriarcal ; non pas parce que ses dirigeants sont racistes, mais parce que l’État lui-même est une contrainte coloniale, et le colonialisme sera vivant sous une forme ou une autre tant que l’État ne sera pas supprimé. Un tel point de vue exige de mettre davantage l’accent sur les continuités historiques de l’oppression plutôt que sur des indicateurs symboliques de l’oppression au moment présent.
En ce qui concerne les critiques de l’écocide, le capitalisme a sérieusement besoin prendre soin de l’environnement. À l’évidence, nous devons davantage nous pencher sur ce que cela implique, afin de le contester, plutôt que d’en rester aux discours réactionnaires qui, de toute façon, ne seront jamais d’accord avec l’idée de la protection de l’environnement. Les préoccupations capitalistes envers l’environnement impliqueront nécessairement la gestion et l’ingénierie de la nature. La préoccupation anticapitaliste pour l’environnement n’a de sens que si elle est éco-centrée et anticolonialiste.
Ce qui est fait à la planète est une atrocité. Les responsables doivent être dépossédés de tout pouvoir social et tenus de répondre des centaines de millions de morts et d’extinctions qu’ils ont causées ; par-dessus tout, on ne peut pas leur faire confiance pour résoudre le problème dont ils tirent les fruits. La racine du mal n’est pas l’énergie fossile, mais l’idée archaïque que la planète – en fait, l’univers entier – existe pour la consommation humaine. Si nous ne parvenons pas à changer de paradigme et à mettre au premier plan l’idée que notre but est de prendre soin de la terre et que nous devons être une composante respectueuse de la communauté du vivant, il n’y a aucun espoir de sauver la nature, de libérer l’humanité ou de mettre fin au capitalisme.
La technologie se trouve au carrefour de toutes les voies de sortie de la crise écologique causée par le capitalisme. La technologie n’est pas une liste d’inventions. Il s’agit plutôt de la reproduction de la société humaine à travers une lentille technique : le comment de la reproduction sociale. Tout ce qui concerne la façon dont les humains sont en relation avec le reste de la planète et la manière dont nous structurons nos relations internes est modulé par notre technologie. Plutôt que de nous embarquer dans un débat rabâché et inutile (du genre : la technologie, est-ce bien ou mal ?) nous devons nous concentrer sur la façon dont la technologie telle qu’elle existe dans la société mondiale fonctionne comme un « tout ou rien ». Le seul débat sur la technologie que nous ne pouvons pas perdre, et qui n’est pas pris en compte dans la conception dominante, concerne la nature autoritaire de la technologie telle qu’elle existe actuellement. Elle est présentée comme un choix du consommateur, mais chaque nouvelle avancée devient obligatoire en quelques années. Nous sommes forcés de l’adopter ou d’en être totalement exclus. Chaque nouveau progrès réécrit les relations sociales, nous privant progressivement du contrôle de notre vie et donnant le contrôle aux gouvernements qui nous surveillent et aux entreprises qui nous exploitent. Cette perte de contrôle est directement liée à la destruction de l’environnement.
On nous vend de plus en plus un récit transhumaniste dans lequel la nature et le corps seraient des contraintes à surmonter. C’est la même vieille idéologie des Lumières pour laquelle les anarchistes sont tombés amoureux à maintes reprises, et elle repose sur une haine du monde naturel et une croyance implicite dans la suprématie humaine (occidentale) et le libre arbitre. Elle est aussi de plus en plus utilisée pour rendre l’avenir capitaliste séduisant et attrayant, à une époque où l’une des principales menaces pour le capitalisme est que beaucoup de gens ne voient pas les choses s’améliorer. Si les anarchistes ne peuvent pas récupérer notre imagination, si nous ne pouvons pas parler de la possibilité d’une existence épanouie, non seulement dans des moments fugaces de contestation mais aussi dans le genre de société que nous pourrions créer, dans nos relations mutuelles humaines et avec la planète, alors je ne crois pas que nous puissions changer quoique ce soit pour l’avenir.
Le système entre dans une période de chaos. Les piliers sociaux, longtemps considérés comme stables, se mettent à trembler. Ceux qui possèdent et gouvernent ce monde cherchent des moyens de s’accrocher au pouvoir ou d’utiliser la crise pour obtenir un avantage sur leurs adversaires. Les structures qu’ils ont construites de longue date sont sur le point d’entrer en collision, ils ne s’entendent pas sur les remèdes, mais ils seront fichus s’ils nous laissent sortir de cette voie suicidaire. Ils peuvent nous offrir des emplois, de la nourriture et des voyages sur la lune ; ils peuvent nous terroriser et nous soumettre.
C’est un moment angoissant et les enjeux sont élevés. Ceux qui sont au pouvoir n’ont pas le contrôle. Ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite, leurs intérêts divergent et ils ne sont pas d’accord sur un plan cohérent. Néanmoins, ils utiliseront tout ce qu’ils ont sous la main pour s’accrocher au pouvoir. Pendant ce temps, leurs échecs sont visibles par tous, et l’incertitude est dans l’air. C’est un moment qui exige qualitativement plus de notre part : des pratiques communautaires de solidarité qui peuvent s’étendre des groupes d’affinité aux quartiers et à la société dans son ensemble ; des représentations de ce que nous pourrions faire si nous étions maîtres de nos propres vies, avec des plans pour y arriver ; et des pratiques d’autodéfense et de sabotage qui nous permettent de rester sur nos pieds et qui empêchent ceux qui tiennent les rênes du pouvoir de s’en tirer en tuant encore et encore.
C’est un défi de taille. En fait, on ne devrait même plus être sur scène. Le capitalisme a envahi tous les recoins de notre vie, nous retournant contre nous-mêmes. Le pouvoir de l’État s’est accru de façon exponentielle et ils nous ont vaincus tant de fois auparavant. Cependant, leur système est de nouveau défaillant. À gauche et à droite, ils chercheront des solutions. Ils essaieront de nous recruter ou de nous faire taire, de nous unir ou de nous diviser, mais quoi qu’il arrive, ils veulent s’assurer que la suite ne dépend pas de nous.
Tel est l’avenir, une machine qui produit une nouvelle version de la même vieille domination afin d’enterrer, avant leur apparition, toutes les solutions au déclin du système. Nous pouvons détruire cet avenir et récupérer nos vies, en entamant le long travail qui consiste à transformer le terrain vague actuel en jardin – ou bien nous pouvons succomber.
-
Au cas où quelqu’un serait enclin à citer la structure pseudo-militaire de certains groupes de milices, il devrait d’abord la comparer à l’importante chaîne de commandement qui reliait les mouvements fascistes historiques aux vrais militaires ou à un parti politique fasciste. ↩︎
-
C’est en outre un argument embarrassant pour quelqu’un qui prétend que le fascisme est en train de renaître, étant donné que deux des principaux modèles d’État autoritaire et antidémocratique actuels – Israël et la Turquie – ont fait le changement en période de croissance économique. Hum… même Trump a été élu dans un contexte de croissance économique, mais il semble qu’au moins quelques antifascistes soient tombés dans le piège de la fable médiatique implicitement suprémaciste blanche, selon laquelle la victoire de Trump a été rendue possible par la hausse de la pauvreté des « blancs de la classe ouvrière ». ↩︎
-
La légende raconte qu’Eisenhower demanda à Franco quelle structure il avait mise en place pour s’assurer que l’Espagne ne retombe pas dans le chaos, ce à quoi Franco répondit : « la classe moyenne ». ↩︎
-
Bien que cela soit hors de propos ici, nous devons applaudir la Birmanie comme un autre triomphe de la non-violence. Je me demande si Gene Sharp va rendre visite aux Rohingya… ↩︎
-
Les analyses de données utilisées par les entreprises liées au méga-donateur réactionnaire Robert Mercer ont joué un rôle déterminant dans la victoire de Trump et celle du référendum du Brexit, toutes deux rejetées par les médias traditionnels, les campagnes d’opinion et les mesures prédictives. ↩︎
-
C’est un point douloureux que les libéraux essaient désespérément d’oublier : d’un point de vue étatique, la plupart des dictatures étaient en fait nécessaires. ↩︎
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Blogs Mediapart
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD