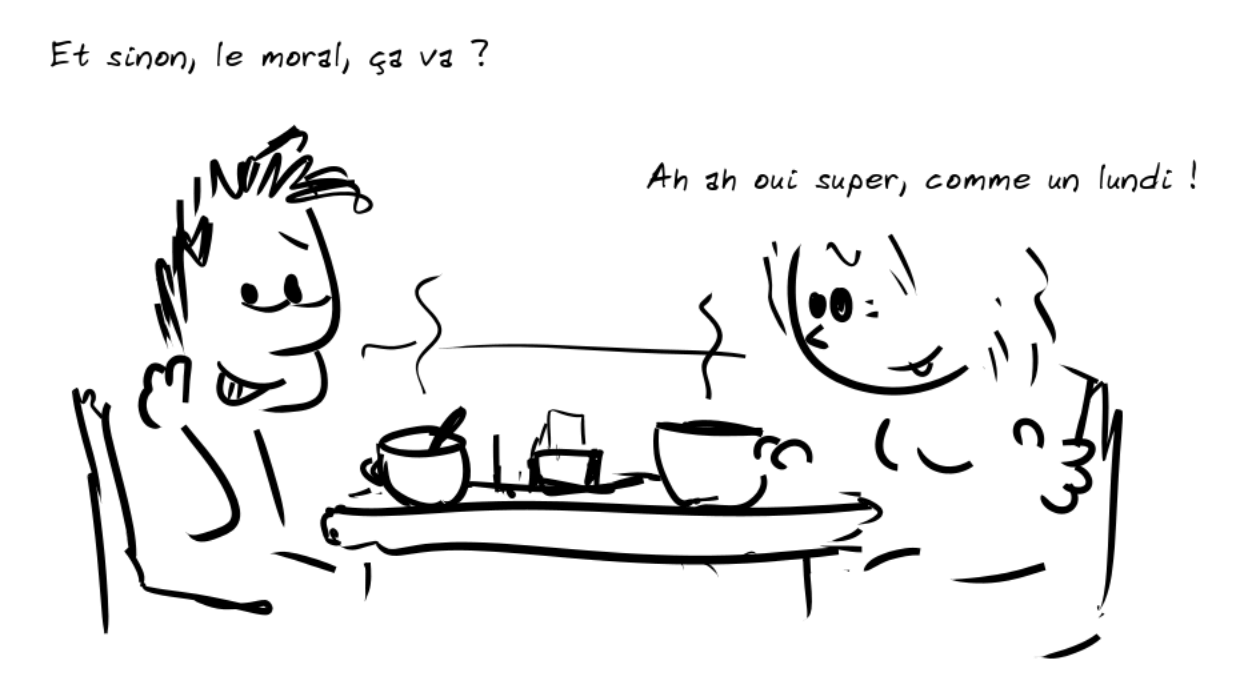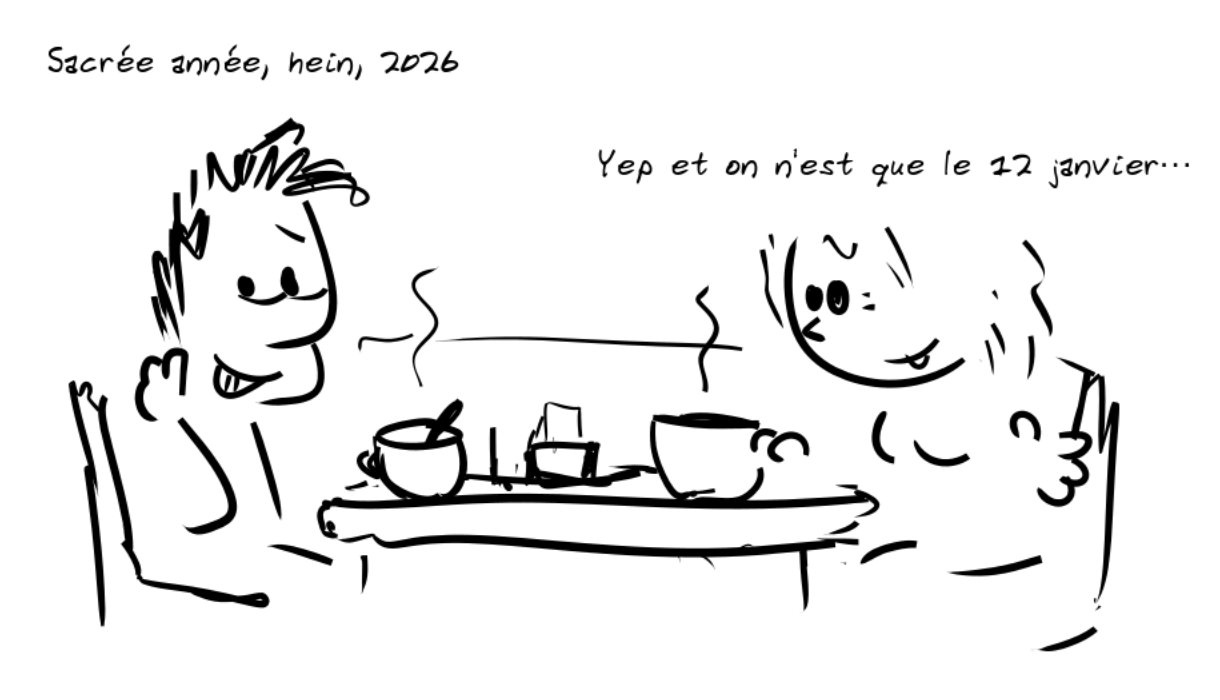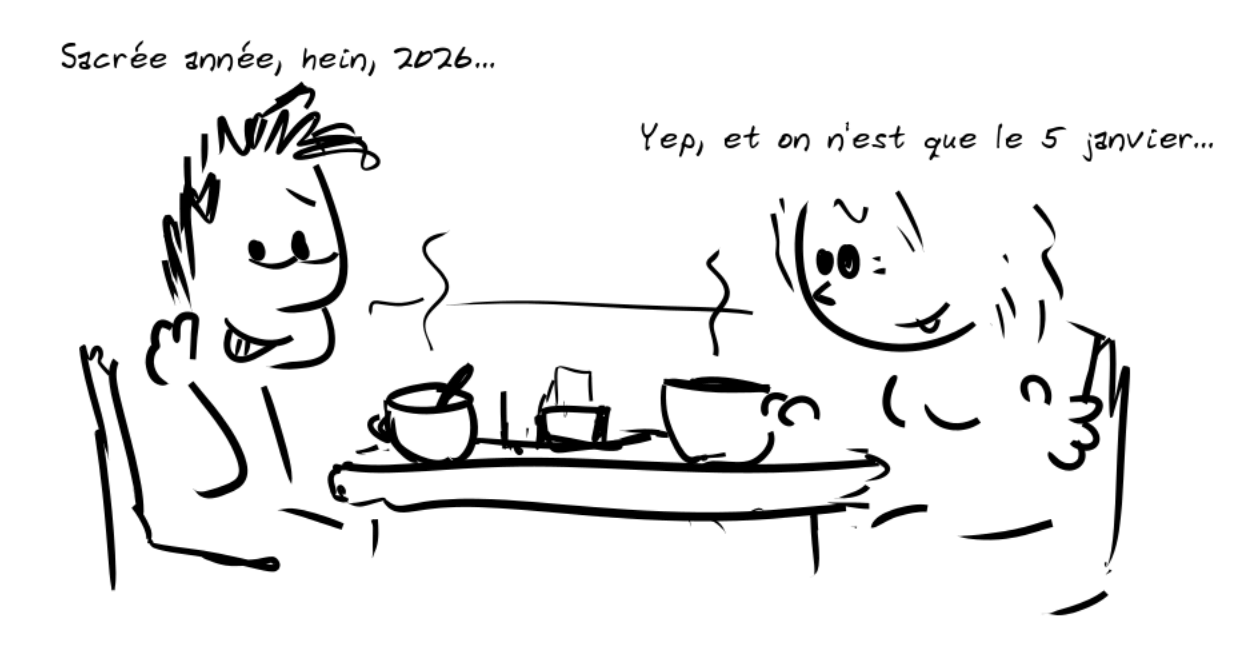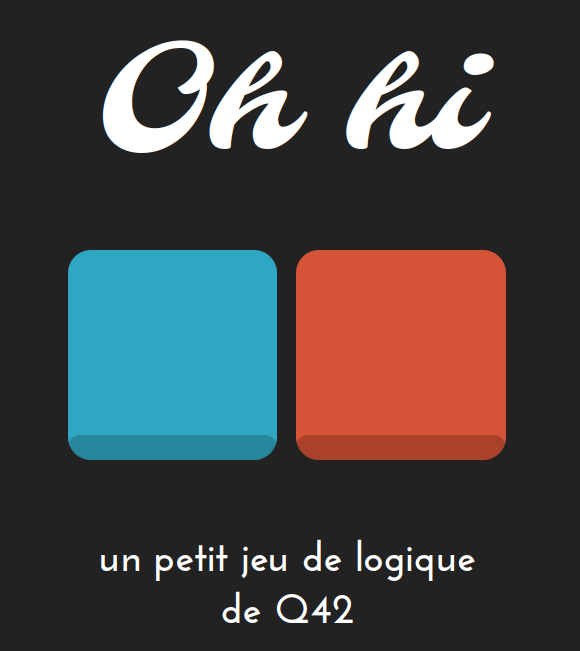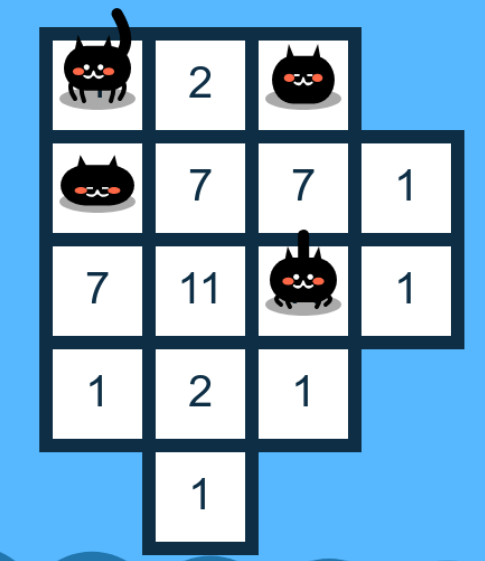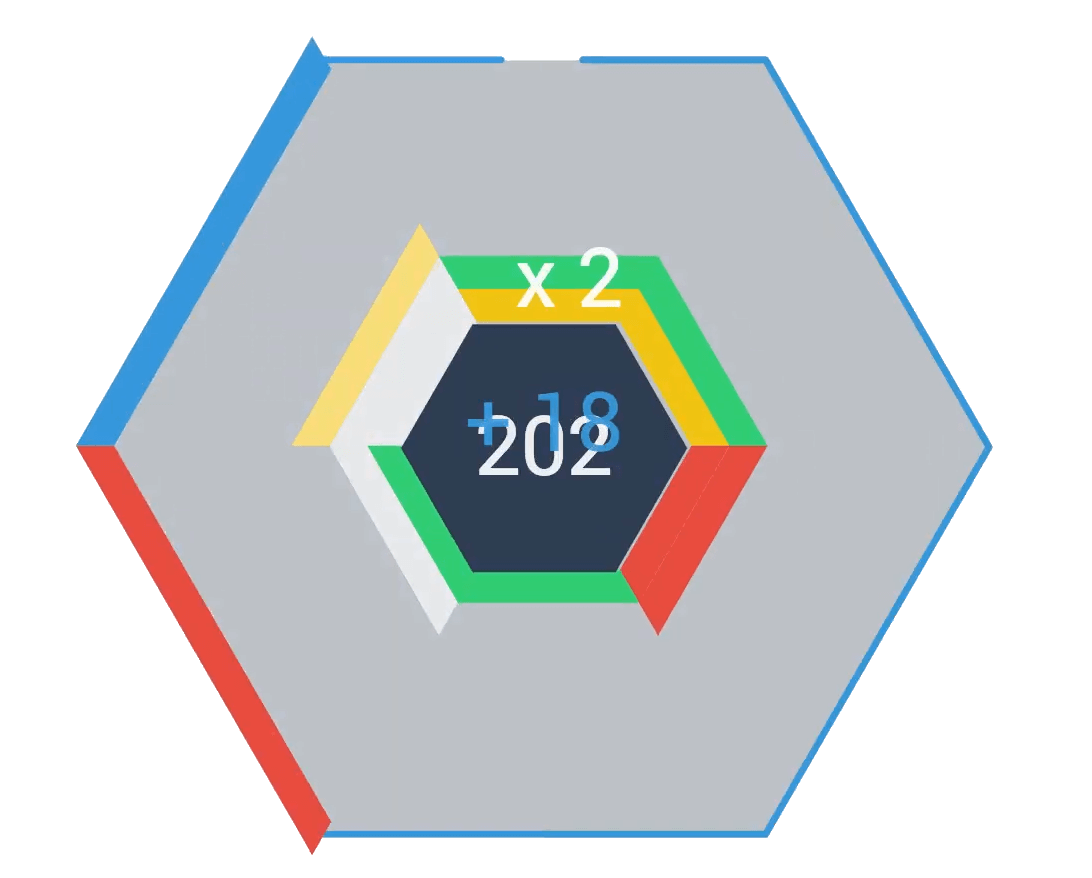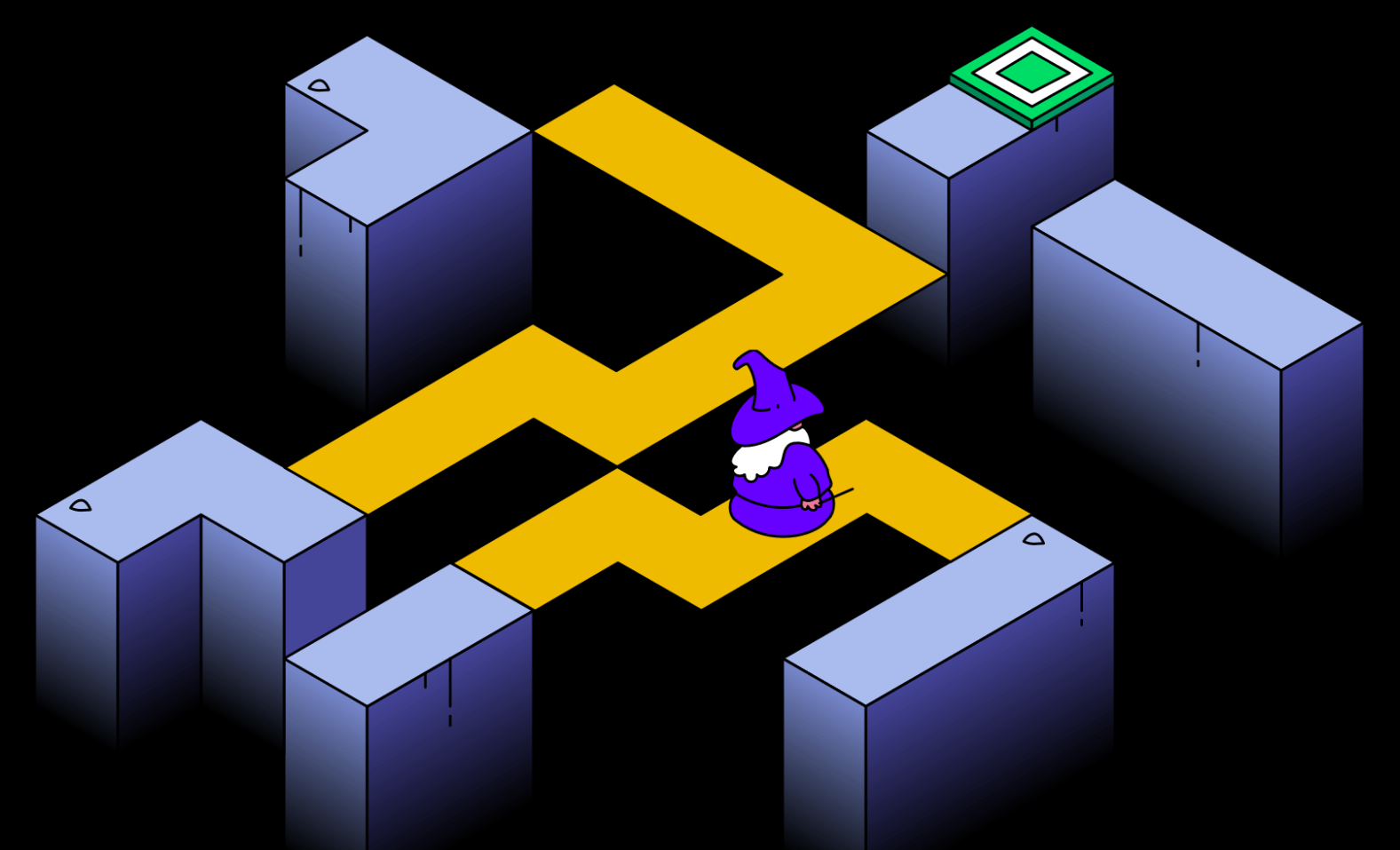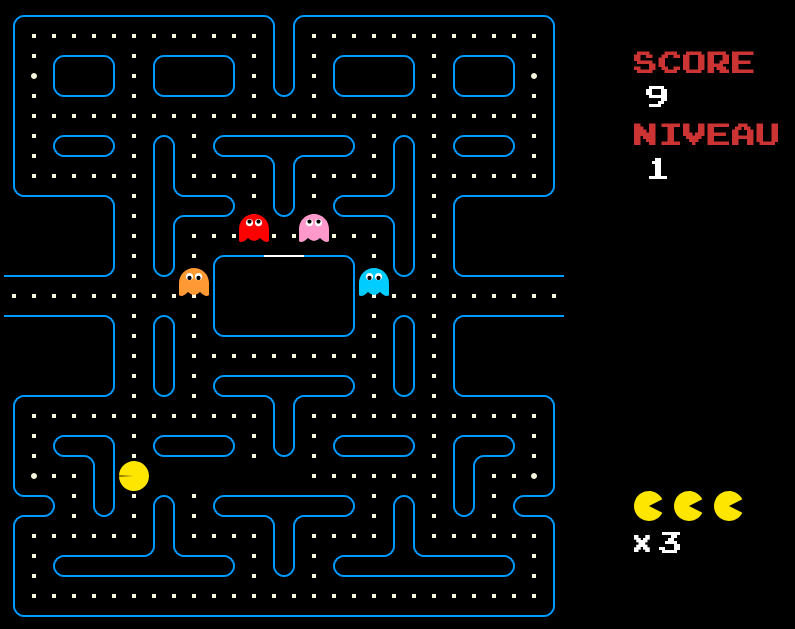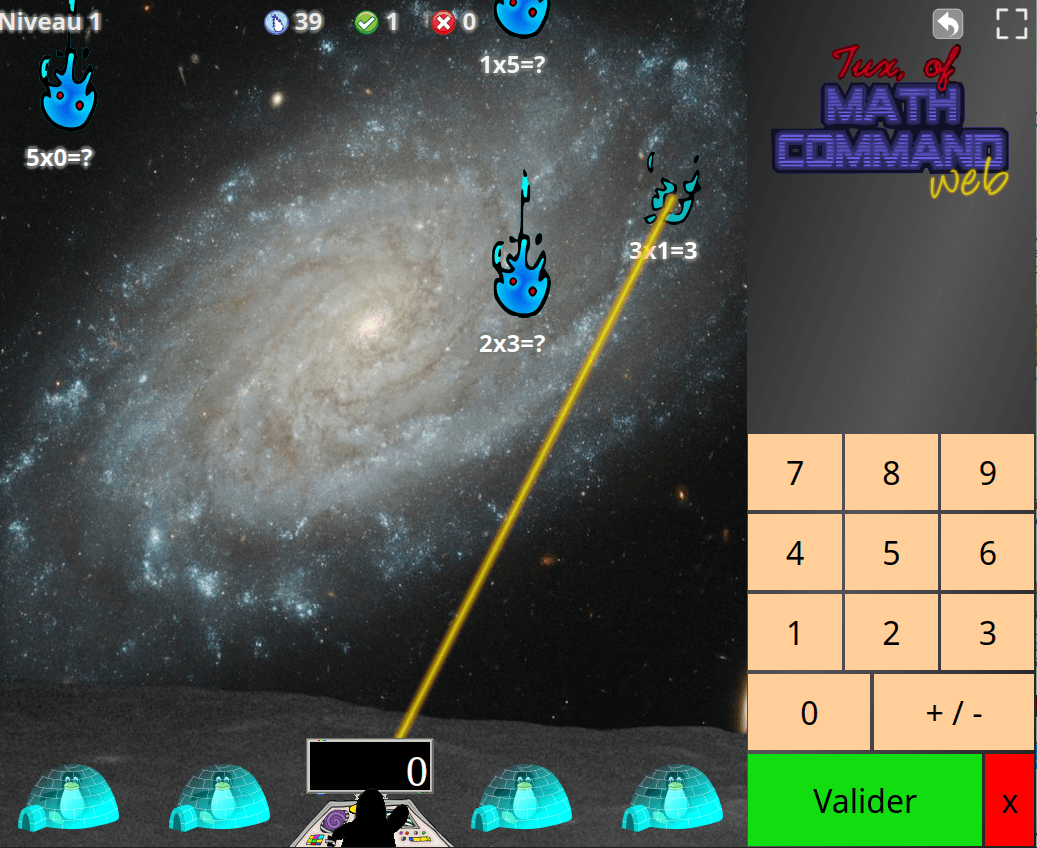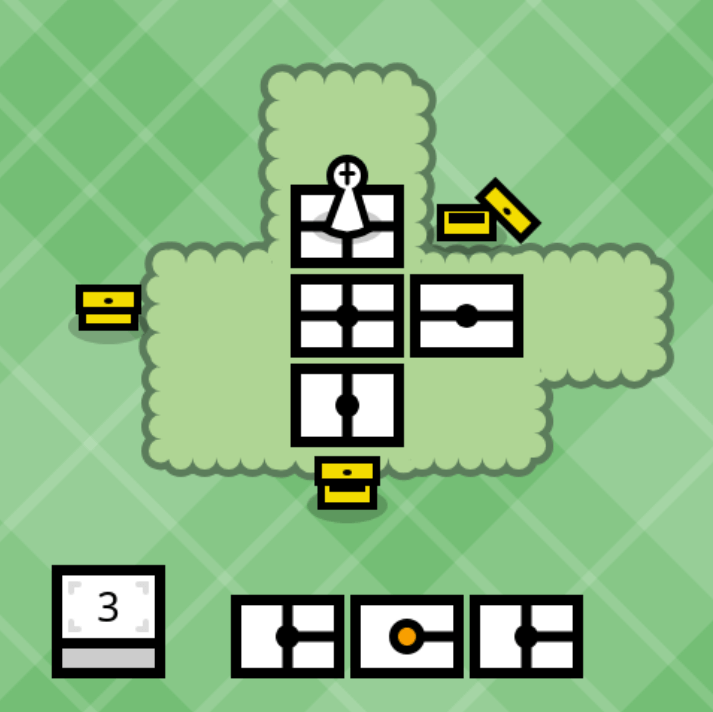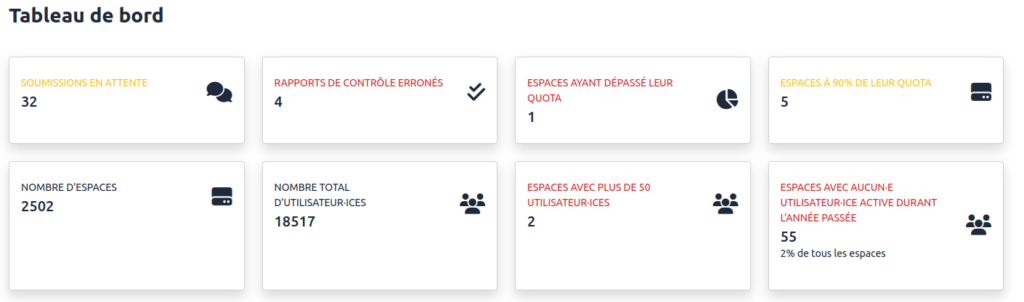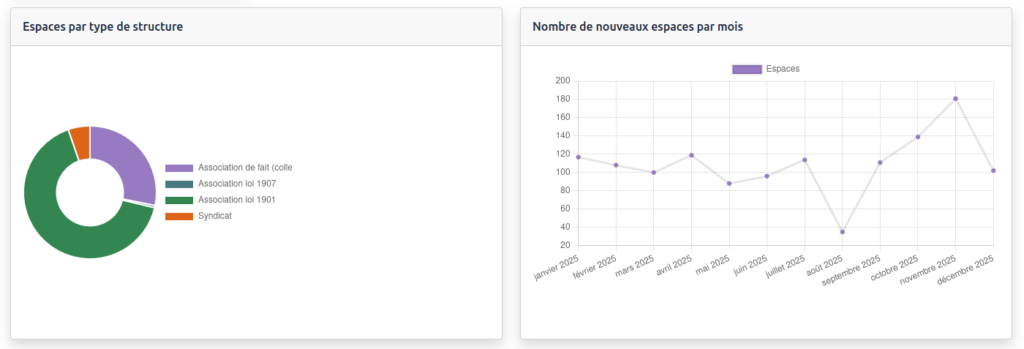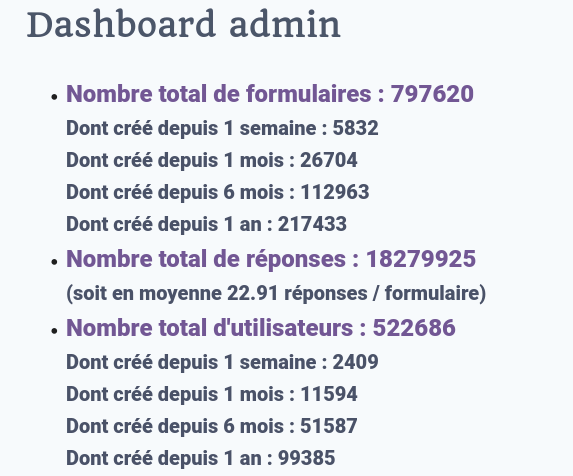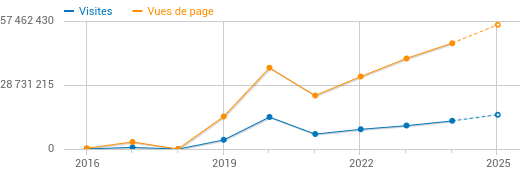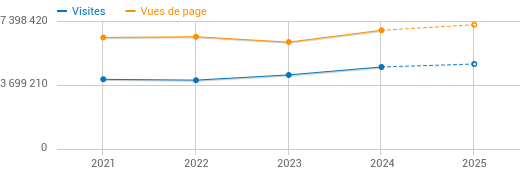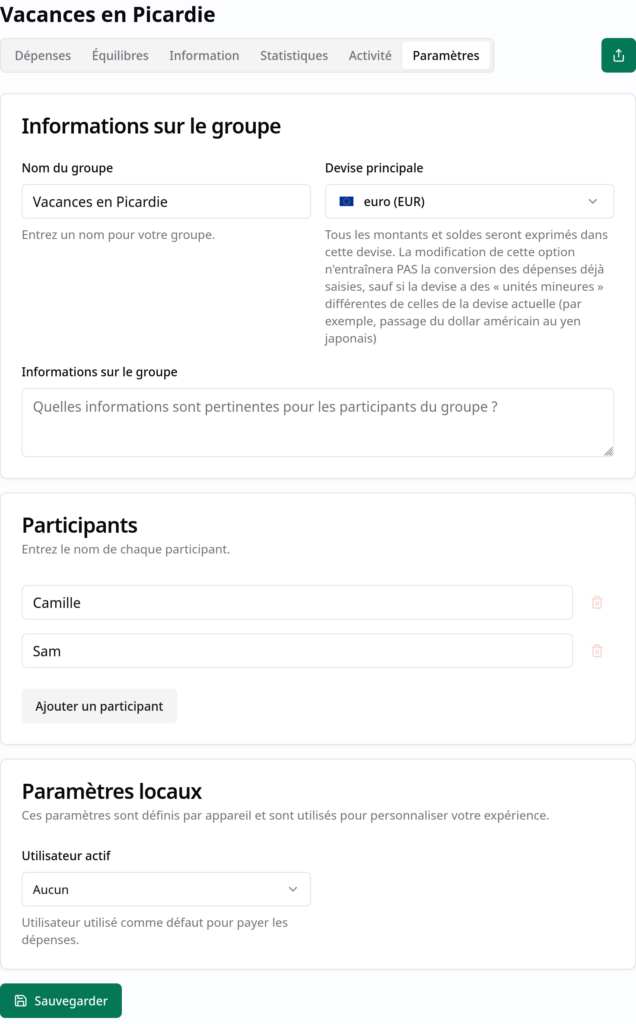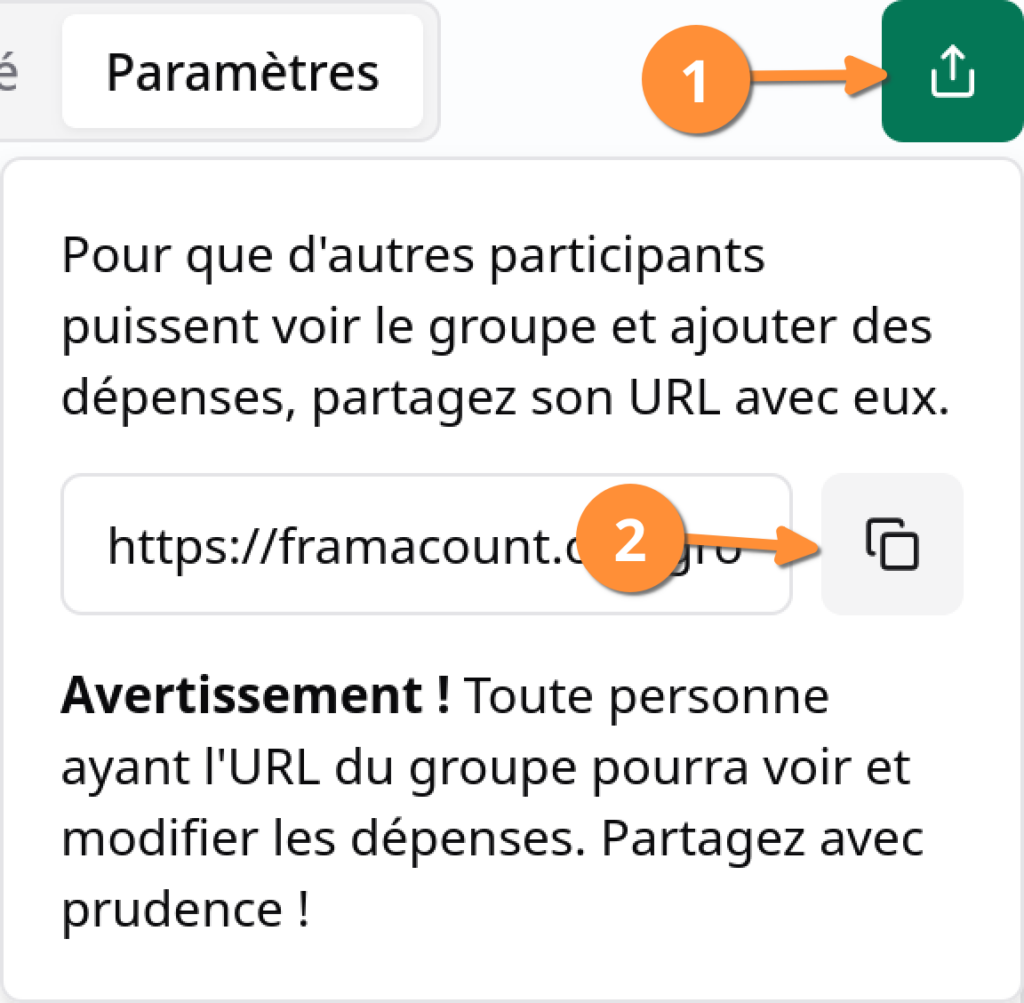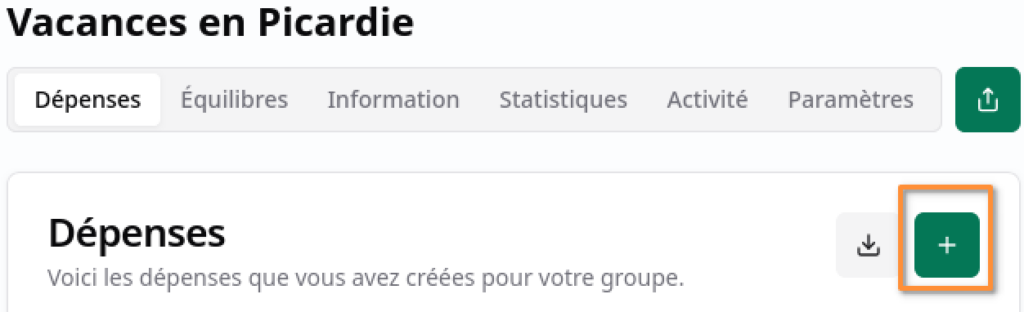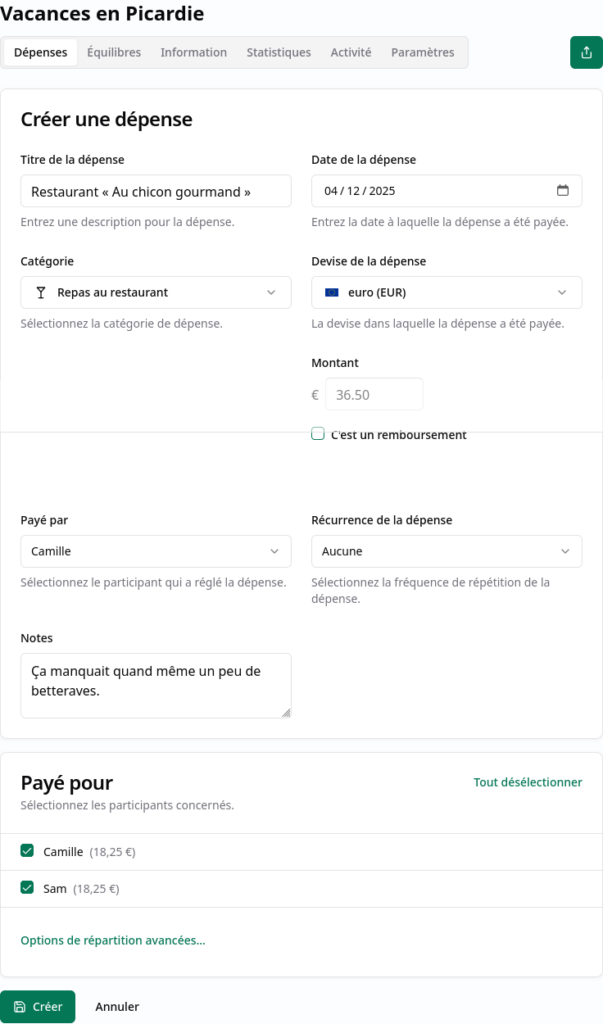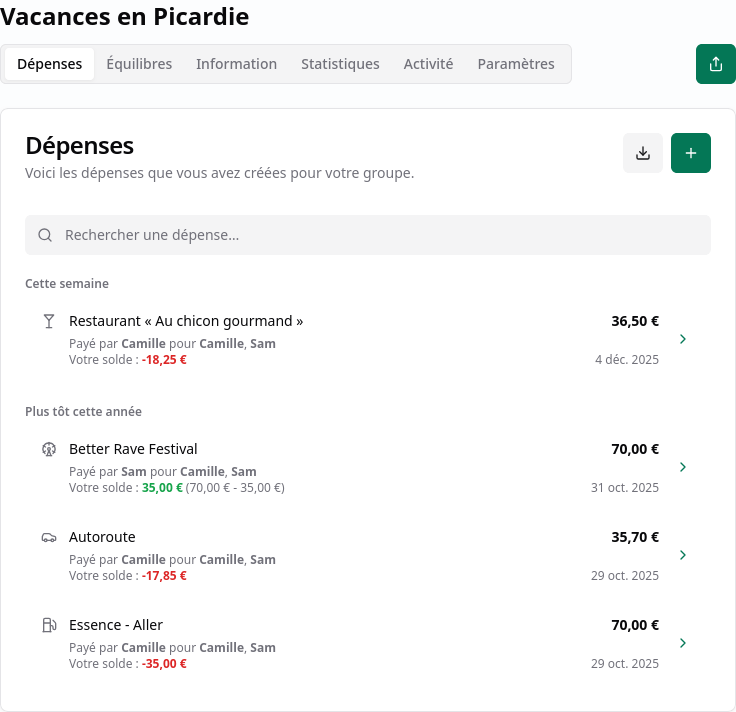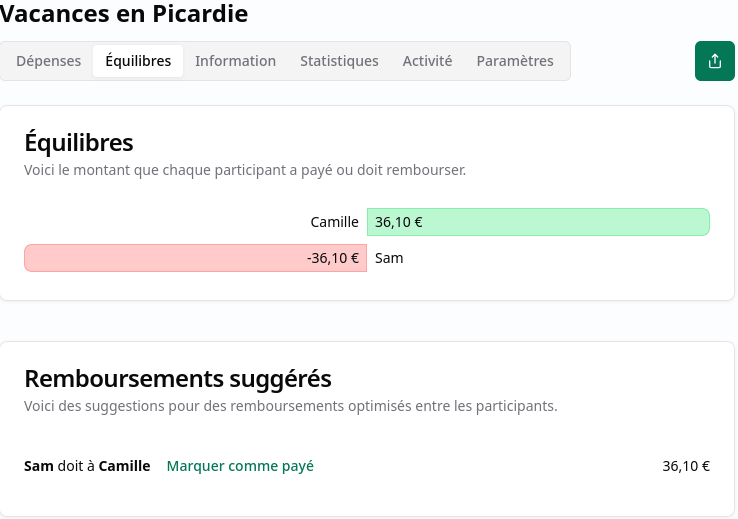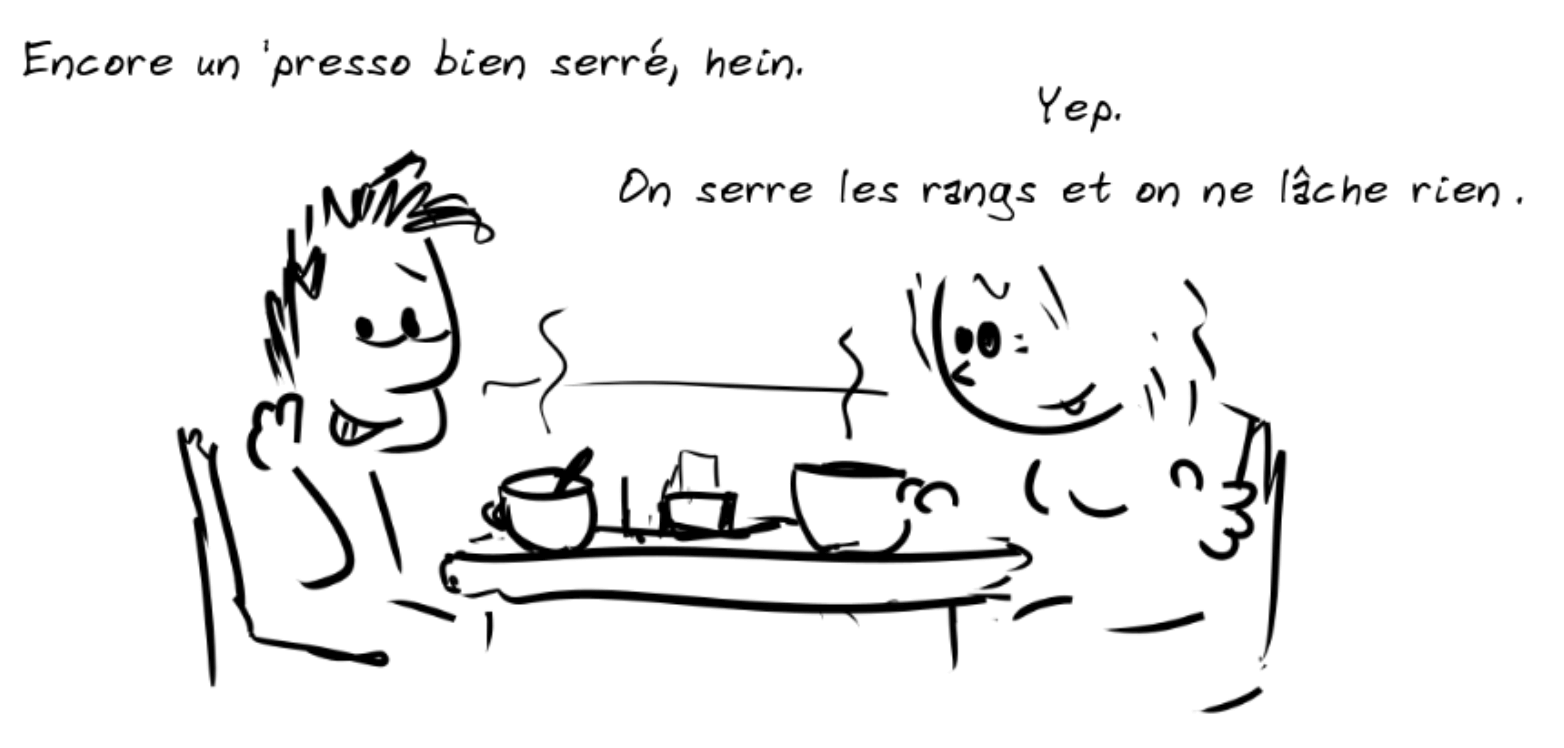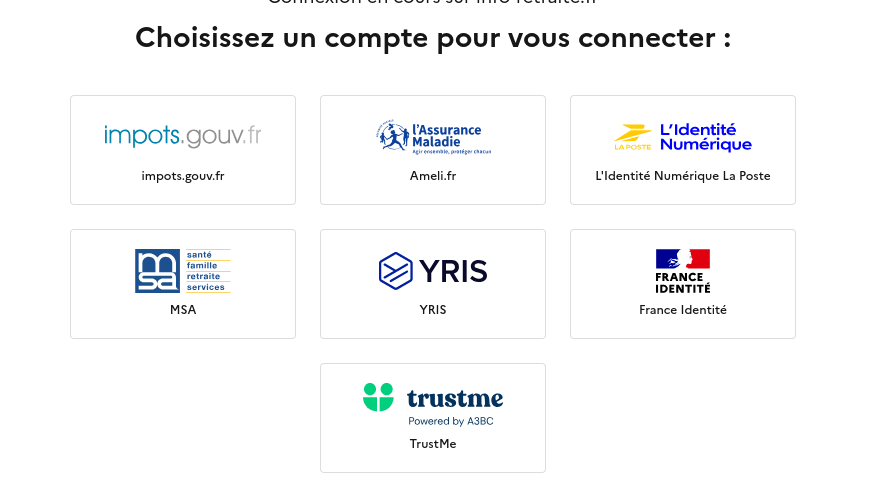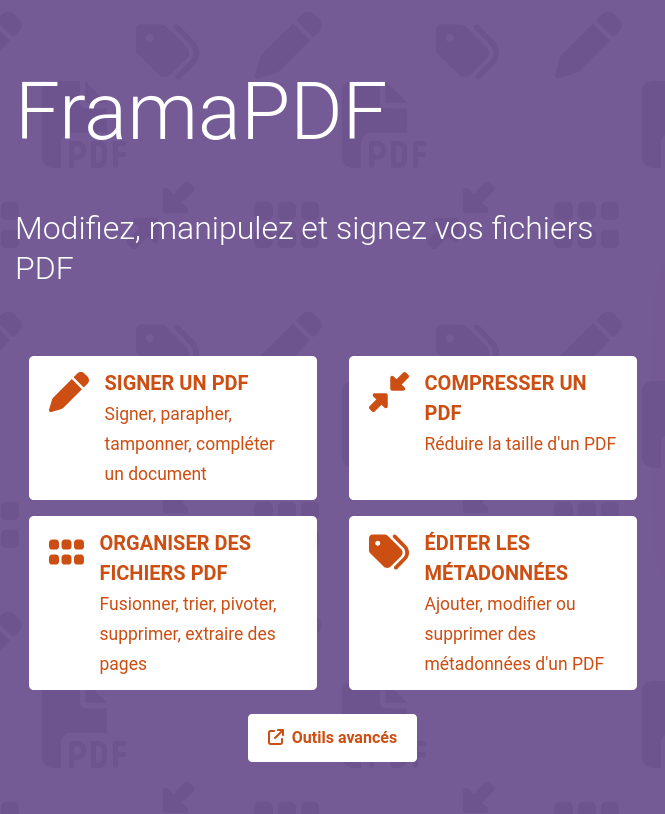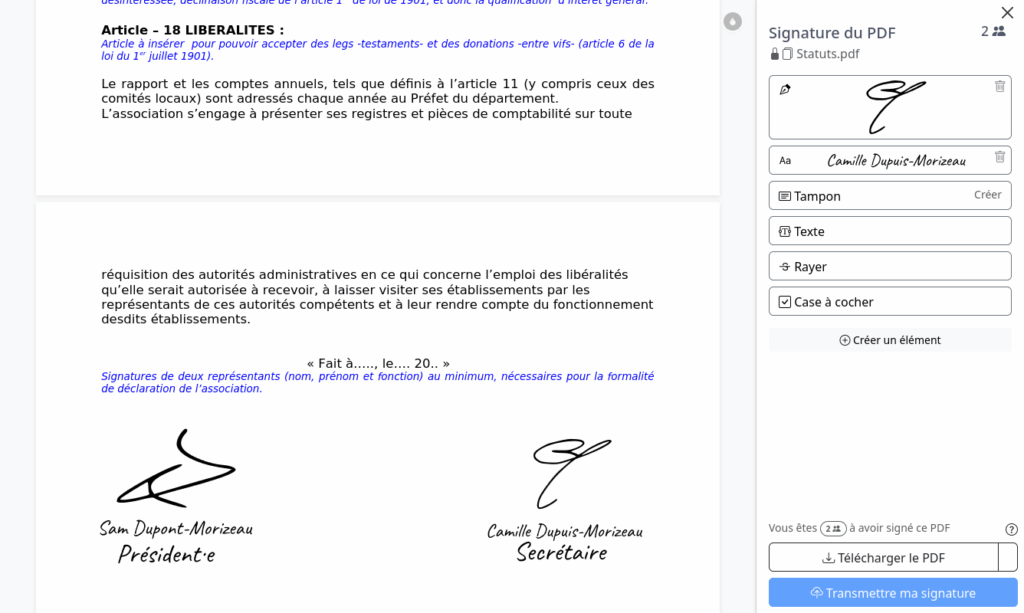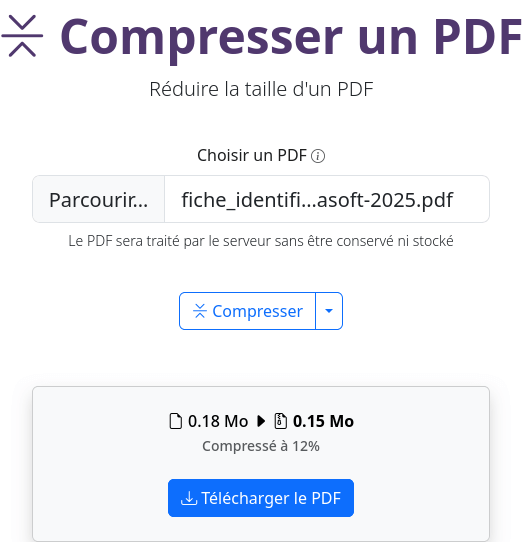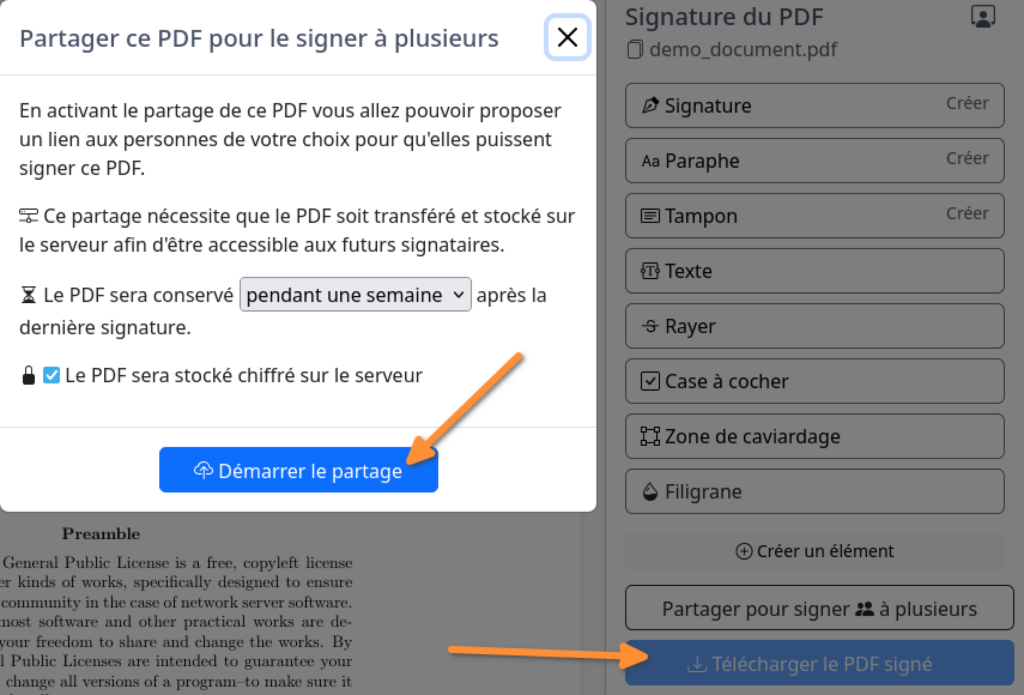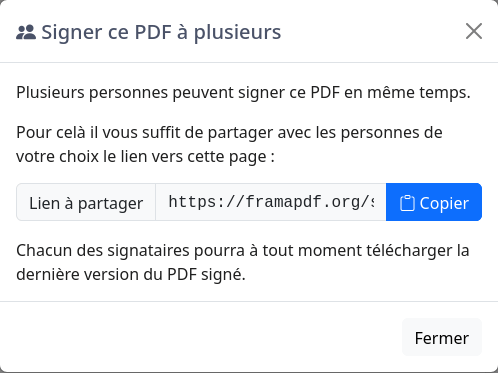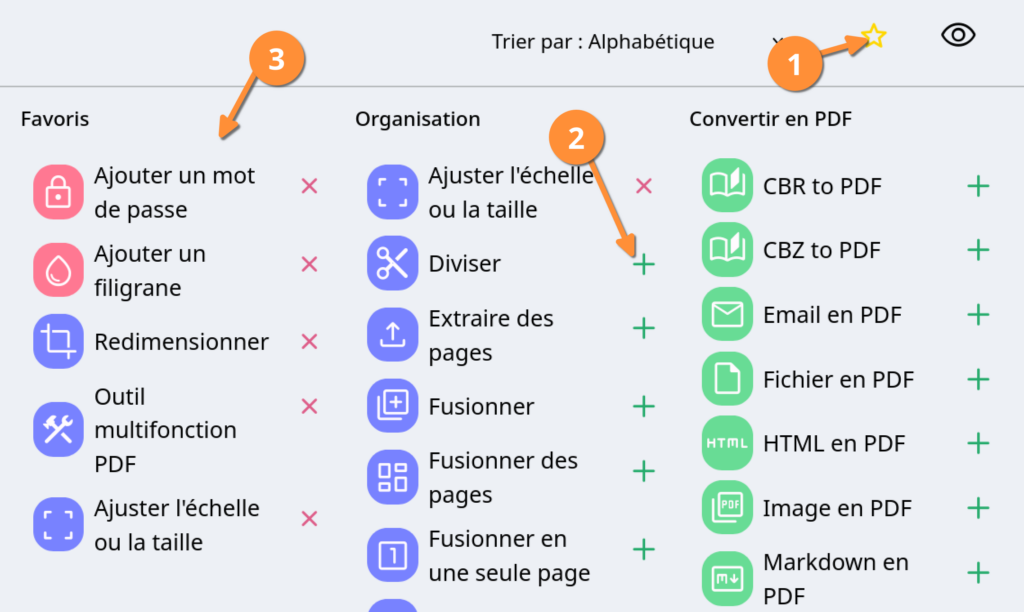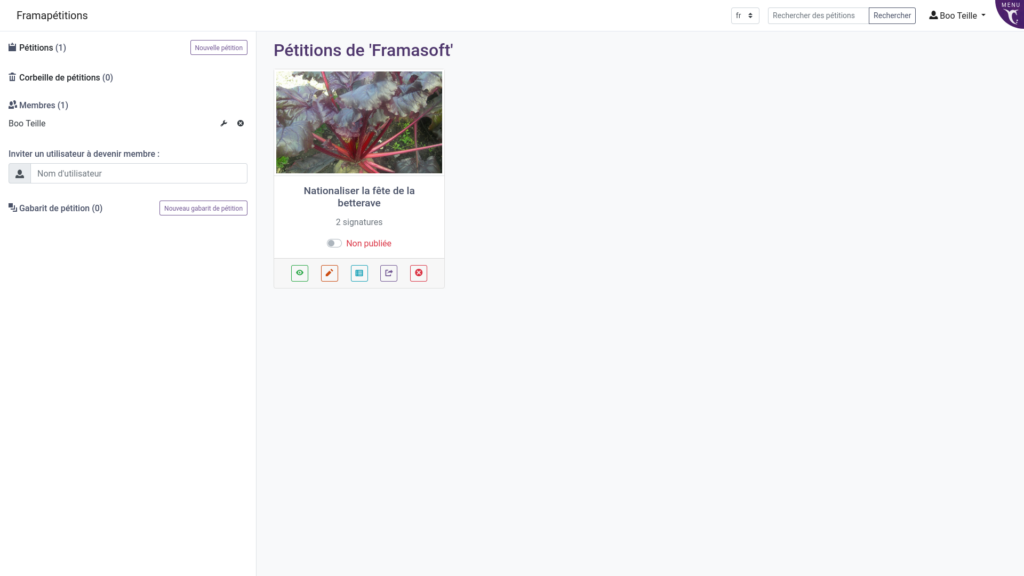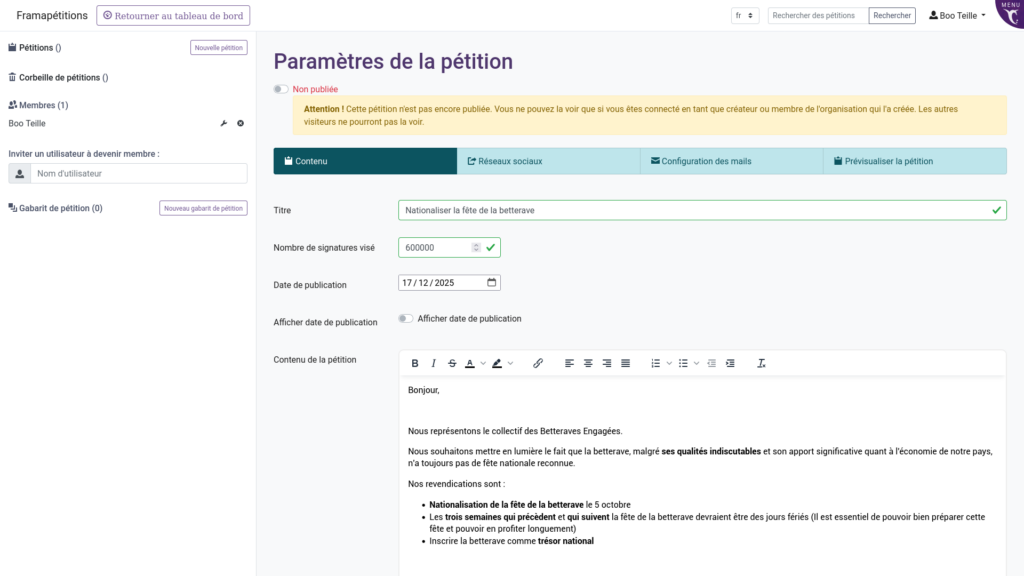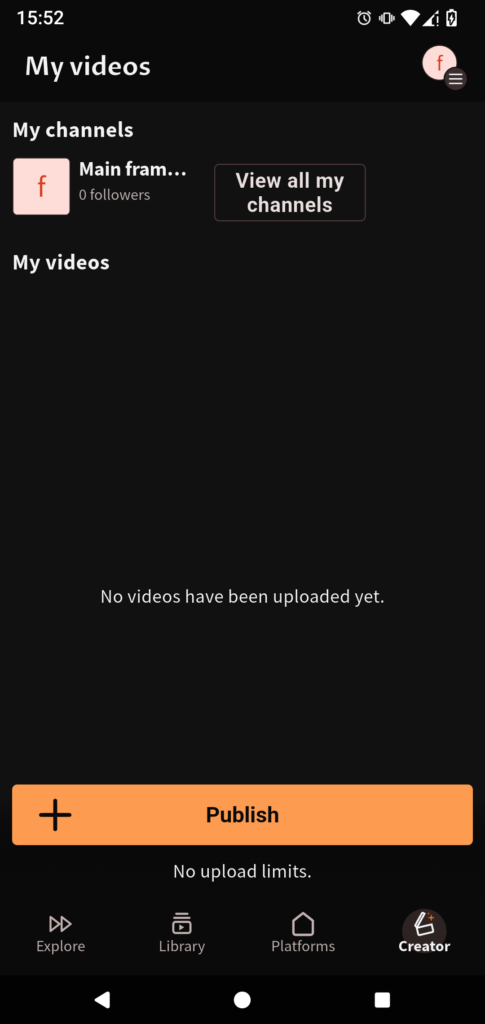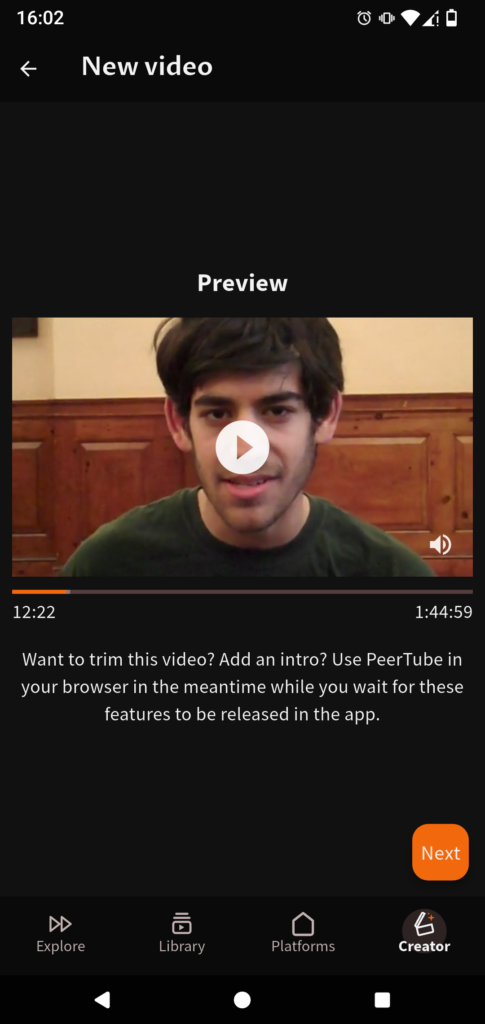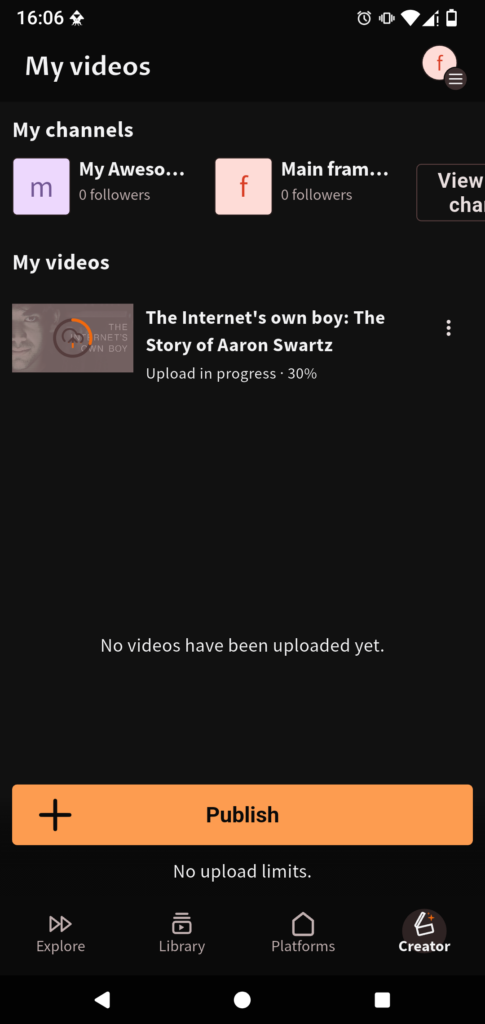04.02.2026 à 08:00
Retravaillez vos PDFs sans crainte
Eve Demaziere
Texte intégral (1501 mots)
Vous avez besoin de retravailler vos PDFs pour compléter un formulaire en ligne ? Voici pourquoi il ne faut pas utiliser de convertisseurs de PDF en ligne qui ne soient pas libres, même gratuits.
Un peu de vocabulaire, pour bien se comprendre :
- « en ligne » = sur internet, sur le réseau, sur le web, connecté
- « le cloud » = les lieux de stockage sur le réseau, là où se trouvent les éléments de votre Drive, les documents partagés, les données des bases de données…
- « en local » = sur votre ordinateur, hors connexion, injoignable depuis l’extérieur.
Les PDFs demandés sont très personnels
Nous devons de plus en plus souvent fournir des documents justificatifs au format PDF, sur les sites des administrations dématérialisées, que ce soit pour nous, pour aider une personne qui ne sait pas faire ou un étranger perdu dans la dématérialisation de la préfecture. Nous scannons des documents papier sur un copieur pour obtenir les documents PDFs puis nous les téléchargeons sur le formulaire de l’administration. Qu’il s’agisse de justificatifs d’identité, de nationalité, de domicile, de travail, diplômes, avis d’imposition, carte de séjour, convocation de la préfecture, permis de conduire ou attestation Vitale, il s’agit de documents personnels qui construisent notre identité. Nous devons donc veiller à ne pas les laisser dans un endroit non sûr.
Scanner les documents au format PDF puis finaliser les PDFs
Un premier conseil : nommez correctement, au fur et à mesure, chaque scan fourni par votre copieur. Par exemple, pour les différents scans des pages de votre passeport, nommez dans l’ordre : passeport1, passeport2, passeport3, et rangez-les dans son sous-dossier /passeport/. Quand vous devrez les réunir en un seul PDF, vous les trouverez dans l’ordre, sans avoir à les regarder pour vérifier.
Le copieur génère les PDFs, mais il nous faut souvent un outil pour les retravailler : réunir certaines pages en un seul document, mettre les pages dans l’ordre et à l’endroit, supprimer les pages inutiles, alléger le PDF final…
Pour cela, on peut utiliser un outil convertisseur en ligne, gratuit : voici pourquoi c’est une mauvaise idée et quel outil utiliser, à la place.
Le cloud, un endroit sûr pour les données personnelles ?
Votre convertisseur en ligne, comme iLovePDF (mais il y en a des dizaines d’autres), travaille vos documents sur le « cloud » (le réseau) : vous envoyez vos PDFs originaux sur le site de iLovePDF, il fait ce que vous lui demandez et vous livre le PDF final.
A noter que vous n’avez pas besoin de créer de compte personnel, tout est en libre accès, ce qui fait son succès. Mais l’avenir des documents est très incertain. Même s’il ne vous le dit pas, il y a de fortes chances qu’il conserve les PDFs envoyés et générés dans sa propre base de données.
Or, vous savez que les données en ligne, même les plus protégées, peuvent être piratées et récupérées par des personnes malveillantes (voir un article sur les cyberattaques en France, novembre 2025 ou le site « C’est qui qui a fuité aujourd’hui ?« ). Vous avez sûrement déjà reçu un mail vous expliquant le piratage de vos données sur l’un de vos comptes : moi, le dernier était la base de données de mon médecin…
Ces attaques valent pour les convertisseurs en ligne : « Attention, des fuites de données touchent ces deux outils PDF en ligne » (article de 2024).
Vos documents risquent donc d’être récupérés et utilisés par des escrocs. La proposition de certains convertisseurs de protéger le fichier en le chiffrant n’est pas sérieuse : il existe autant d’outils « déverrouilleurs de PDF » que d’outils qui les « verrouillent ».
Quels usages pour des escrocs ?
Il existe un important marché de documents de données personnelles, vendues au plus offrant sur des forums illégaux (voir l’article sur le vol des données de la Fédération de tir). Parmi les documents que vous avez retravaillés sur votre convertisseur en ligne, beaucoup peuvent servir à créer une nouvelle identité ou à usurper la vôtre.
En modifiant les documents avec un outil de retouche d’image (comme Photoshop ou Gimp), les pirates peuvent falsifier de vrais documents pour les attribuer à d’autres personnes, par exemple fournir une fausse convocation de la préfecture à un étranger, comportant son nom, son numéro d’étranger (la convocation se monnaye 300 euros). Ou usurper votre identité (voir l’article L’usurpation d’identité). Ou vous rendre visite à l’improviste, puisqu’ils ont votre adresse…
La solution : convertir les PDFs avec un outil sûr
La solution est d’utiliser un outil que vous installez sur votre ordinateur et qui travaille en local ou dont les serveurs sont sécurisés, c’est le cas des logiciels libres. Vos documents restent au chaud et ne s’en vont que dans le bon site web, celui de l’Etat qui vous l’a demandé pour votre démarche. Accessoirement, conserver une copie PDF de vos papiers est une bonne idée, en cas de perte ou de vol : prenez donc soin d’archiver régulièrement les données de votre ordinateur sur un disque dur externe (que de recommandations…).
Les étapes :
- Vous scannez vos documents sur le copieur, en les réunissant dans une clé USB
- Vous veillez à donner un nom clair à chaque document scanné et à les ranger dans un dossier spécifique
- Par la clé USB, vous les récupérez sur votre ordinateur.
- Vous utilisez un outil sûr pour retravailler les documents qui le nécessitent : regrouper les pages, les mettre à l’endroit et dans l’ordre, réduire le poids du PDF total, et vous continuez à donner un nom clair au PDF résultant
- Et vous ne mettez le document en ligne qu’au moment de compléter le formulaire.
Les outils libres, ou en local
- FramaPDF = https://framapdf.org/abc/fr/. FramaPDF fonctionne à partir de votre navigateur, pas d’outil à installer. Si votre modification demande un traitement en ligne (la compression, par exemple), FramaPDF la réalisera sans conserver ni stocker le document. Documentation pour les manipulations simples = https://framablog.org/2025/12/18/framapdf-modifiez-manipulez-signez-vos-pdf-simplement/ ; site pour les manipulations avancées = https://stirling.framapdf.org/?lang=fr_FR
- Suivez ce lien si vous cherchez d’autres outils libres (en) dont certains peuvent être utilisés localement, sans nécessiter de connexion internet une fois installés.
La cerise sur le gâteau : un filigrane sur vos PDFs
Une fois votre PDF finalisé, vous pouvez utiliser le service FiligraneFacile, un service gratuit créé et mis à disposition par l’État, pour sécuriser avec un filigrane numérique les documents à envoyer. Voyez :
- les explications : https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/protection-contre-les-risques/protection-des-donnees/filigranefacile-un-service
- la version beta : https://filigrane.beta.gouv.fr/
Bons PDFs et bonne bagarre avec la dématérialisation !
03.02.2026 à 08:42
Sortir de la matrice : Le combat pour un numérique libre et humain
Magali Garnero
Texte intégral (3189 mots)
Il est impossible de vivre dans une société orchestrée par les GAFAM !
Les multinationales comme Alphabet (Google), Amazon, Méta (Facebook), Apple et Microsoft sont des entreprises qui s’imposent de plus en plus par leurs pouvoirs économique, politique et technologique.
- Elles font partie des plus grandes capitalisations boursières. Leurs chiffres d’affaires comme leurs bénéfices se comptent en milliards. En milliards, arrivez-vous à concevoir ce genre de fortune ? Tout cet argent, c’est indécent !
- Et elles n’hésitent d’ailleurs pas à l’utiliser pour faire du lobbying que ce soit à Bruxelles, en France et ailleurs, pour lutter contre les tentatives de régulations européennes, comme le DMA, le DSA ou le RGPD. Sans parler de ce qu’il se passe aux États-Unis, où c’est pire. Les droits humains sont beaucoup moins protégés et respectés là-bas.
- Leurs intérêts passent forcément avant le bien commun, avant l’intérêt général des personnes qui peuplent cette terre, avant même la protection de notre environnement, avant la planète.
- Et bien sûr, elles imposent leurs technologies numériques, leurs standards, rendant difficile l’utilisation d’alternatives.
Cela a de très nombreuses conséquences sur le commun des mortel·les comme vous et moi, quasiment invisibles, mais très bien décrites dans de nombreux articles : surveillance massive grâce à l’extraction de données des utilisateurices sans leur consentement « éclairé », dépendance et enfermement dans des services soi-disant gratuits, obsolescence logicielle programmée, perte de contrôle du matériel informatique, monopole par l’achat systématique d’autres entreprises pour éliminer la concurrence, menace pour les libertés par la censure, la captation et la monétisation de l’attention, perte de la souveraineté numérique (influence et dépendance institutionnelles).
Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux vivre dans cette société où je me sens continuellement épiée, manipulée, en colère, esseulée, paranoïaque, désespérée et, pour finir, résignée. Je ne suis pas Winston Smith, le héros de 1984 de Georges Orwell et pourtant notre société ressemble chaque jour de plus en plus à celle d’Océania…
Heureusement, il est encore possible, pour nous, de partager nos doutes, nos pensées, nos tentatives et nos solutions pour s’en sortir avec d’autres personnes.
Une communauté à la rescousse
Depuis plus de trente ans, une irréductible communauté de libristes se bat pour proposer des logiciels libres et respectueux des utilisateurices. Cette communauté suit 4 libertés. Ces libertés ne sont pas de simples recommandations, mais des critères obligatoires qui forment le socle éthique et pratique du mouvement du logiciel libre
-
- la liberté 0 (en informatique, tout commence par 0, faut pas s’étonner) : la liberté d’utiliser les logiciels, qui qu’on soit, où qu’on soit, quel que soit le matériel utilisé. Aucune restriction ;
- la liberté 1 : la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses besoins. Bon ok, tout le monde n’a pas forcément cette compétence technique d’accéder au code source. Mais beaucoup l’ont, et peuvent donc aller y jeter un œil et améliorer le dit logiciel. Ensemble on est plus fort ;
- la liberté 2 : la liberté de redistribuer des copies de ce logiciel (ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre ces copies) ;
- la liberté 3 : la liberté d’améliorer le logiciel et de distribuer ces améliorations à d’autres, pour en faire profiter toute la communauté.
Quand j’ai rencontré les libristes, les logiciels libres (dits aussi open source dans le monde entrepreneurial) s’opposaient aux logiciels « propriétaires », maintenant ces derniers sont nommés « privateurs » pour bien montrer qu’ils privent les utilisateurices des libertés qui leur sont offertes par les logiciels libres.
Les valeurs qui en découlent : Transparence, Accessibilité, Coût, Coopération, Indépendance, Sécurité, Innovation et Protection de la vie privée.
J’utilise plusieurs logiciels libres que vous connaissez sans doute déjà :
-
- Firefox qui remplace les navigateurs web comme Chrome, Edge ou Safari.
- Signal ou Matrix/Element pour discuter instantanément. Adieu WhatsApp et Messenger.
- Nextcloud qui offre le partage de fichiers, documents, le calendrier, le traitement de texte collaboratif. Bye bye Google Workplace et AWS.
- LibreOffice la suite bureautique avec tableur, texte, pdf, diaporama. Non à Excel, Word et compagnie !
- Évolution ou Thunderbird, pour gérer ses mails. Ciao Apple mail et Outlook.
- VideoLAN, pour voir et écouter des films et de la musique.
- Inkscape et Gimp, pour dessiner ou retoucher des photos.
Et ce ne sont pas les seuls.
Alors certains détracteurs me diront qu’il sont moins bien, moins beaux, moins connus, moins fonctionnels… Rappelons juste une chose, la communauté libriste s’appuie sur les contributions d’informaticien·nes qui le font sur leur temps libres (bénévolat), il y a également de plus en plus d’entreprises qui paient des salarié·es pour l’amélioration et le maintien de ces logiciels et services libres, sans oublier des fondations à but non lucratif ou encore des universitaires. Merci à toustes. Mais on est très loin, très très très loin des milliards cités plus haut. Bref on fait ce qu’on peut et c’est déjà fabuleux pour moi tout ce qui est produit chaque jour.
Un boycott inconfortable mais indispensable
L’émancipation passe par la reprise de contrôle sur nos outils et nos données et il n’est pas aisé de changer ses habitudes, de sortir de son confort d’utilisation.
Pourquoi arrêter d’utiliser des logiciels et services en ligne qui fonctionnent bien et que l’on maitrise depuis des années ?
Si vous vous posez encore cette question, je vous laisse aller relire la première partie de mon texte.
Si au contraire, vous êtes entré·es dans une démarche d’actions individuelles et que vous voulez réduire votre dépendance au quotidien alors j’ai de bonnes nouvelles.
Il existe une multitude de logiciels libres qui remplacent tous les logiciels privateurs utilisés, voire imposés ces dernières années par les GAFAM et autres entreprises privatrices. Et il y a même un annuaire, Framalibre proposé par Framasoft. Vous pourrez découvrir de nombreux logiciels libres, suivant vos besoins, vos envies ou votre curiosité ! Et derrière chaque logiciel libre, il y a une communauté qui maintient, qui améliore, qui promeut. Et, en France, l’April, dont je suis la présidente, les défend au niveau institutionnel et politique.
Voilà de quoi remplacer tous vos logiciels privateurs installés par un voire plusieurs logiciels libres ! Votre ordinateur se sentira libéré et vous remercie !
Mais il n’y a pas que les logiciels que l’on peut changer. Il y a aussi les mauvaises habitudes en ligne. Tous ces services soi-disant gratuits qui vous espionnent, accèdent à vos données et vous envoient des informations ciblées pour vous manipuler. Rappel : Les GAFAM ne sont pas neutres, ils façonnent nos sociétés, nos lois, nos comportements.
Allez, je continue de vous offrir des informations en cadeau, alors que Noël est déjà passé depuis quelques semaines. C’est toujours grâce à la communauté libriste et à ses nombreuses initiatives pour se libérer.
Vous aimez les images de chats ? Et bien les chatons vont sauver internet ! Si si, absolument ! Initiative lancée d’abord par Framasoft, qui voulait se dégoogliser, le Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres, et Solidaires – ça fait CHATONS en acronyme :-D a vu le jour en février 2016 (bon anniversaire des 10 ans ! !), soit il y a plus de huit ans, et est composé de nombreuses organisations (associations, particuliers et entreprises – il y a deux « portées » par an qui en fait augmenter le nombre total). Toutes proposent des services en ligne que vous pouvez utiliser sans rien avoir à installer sur votre ordinateur, juste en lançant votre navigateur web. Est-ce que l’on peut avoir confiance dans ces chatons ? Alors il faut savoir que pour devenir chatons, il faut s’engager à respecter la charte des chatons. Et si votre chatons ne vous plaît plus, comme tout est transparent, ouvert, neutre et solidaire, il est possible d’en adopter un autre. Aucun emprisonnement, ni surveillance, ni manipulation. Ce n’est pas non plus un monde de bisounours, alors n’hésitez pas à soutenir les organisations qui vous offrent ces services, litières, croquettes et sous-sous sont toujours les bienvenus !
Autre initiative fort sympathique : DéMAILnagement. Vous avez capté le jeu de mots ? Comme son nom l’indique, cette initiative vous permet de quitter Gmail, mais aussi d’autres fournisseurs qui ont accès à toutes les données qui circulent dans vos mails (et ne se privent pas pour y accéder) et de découvrir le mail libre ! Ok, ça veut dire avoir une nouvelle adresse mail et cela fait toujours peur, cela peut également prendre du temps à mettre en place, prévenir tous vos contacts, vos banques, employeurs, administrations et autres… mais après, on est un peu plus en sécurité. La transition se fait en douceur, les données sont protégées, et c’est vous qui choisissez ce que vous voulez suivant vos besoins, vos valeurs, vos envies, vos moyens.
Est-ce que vous connaissez PeerTube ? Comme son nom l’indique, c’est une plateforme de vidéos décentralisée qui commence à faire de l’ombre à YouTube. Développée par Framasoft, encore elle, elle donne accès à de nombreuses vidéos et permet de monter sa propre instance pour héberger les siennes et les partager avec d’autres. Et OpenstreetMap ? pour sortir de GoogleMap, Mappy ou autre service de cartographie ? Et Wikipedia ? Cette encyclopédie en ligne qui met en exergue les 4 libertés du logiciel libre ? FFDN, qui regroupe de nombreux fournisseurs d’accès à Internet. Vous n’avez qu’à choisir un près de chez vous. On a parlé des GAFAM, mais il y a aussi d’autres entreprises dont il faut se méfier… genre au hasard X et toutes les possession d’Elon Musc, dernier cadeau de l’article : le Fediverse. C’est un ensemble de plusieurs réseaux sociaux où diverses applications sont compatibles et permettent de discuter ensemble.
Et si on parlait du matériel ? Et de son coût écologique ? Mieux vaut choisir des appareils respectueux, ou du reconditionné. Le ré-emploi c’est la vie qui continue
Tout cela est un bon début mais c’est fragile, comme tous les biens communs. Financièrement déjà. C’est pourquoi les associations qui proposent ces logiciels et services sont souvent en recherche de soutien financier et de contributions, techniques ou pas. C’est valable également pour les entreprises qui codent, développent et maintiennent des logiciels libres. Il faut les favoriser, leur donner la priorité. Mais en plus ils sont régulièrement menacés par différentes lois.
Collectivement : on est plus puissant qu’on ne le croit !
Si les politiques avaient pour but l’intérêt du plus grand nombre et le respect de la vie privée cela se saurait. En tout cas depuis plusieurs année, les questions se posent, soient sur leurs compétences soit sur leur absence de compréhension des conséquences de certains projets de lois.
Il est possible d’agir collectivement et de plein de manières différentes. À vous de choisir comment et combien de temps vous êtes prêt à consacrer. Ensemble, on est plus puissant qu’on ne le croit !
- adhérer à des associations militantes, des syndicats ou des partis politiques. Faîtes entendre votre voix, vos idéaux, mais également vos peurs et coups de gueules ! (c’est plus utile dehors que dedans, ça diminue aussi le nombre de cheveux blancs)
- rejoindredes dynamiques locales : l’Agenda du Libre recense de nombreuses organisations et présentent les évènements autour du numérique organisés partout en France et aussi un peu en Belgique et en Suisse. Allez à leur rencontre ! Iels sont sympa.
- informer le grand public par des campagnes, des ateliers, des conférences ou des stands. Participer aux émissions Libre à vous ! sur Cause commune. C’est une occasion extraordinaire de partager nos idées, nos valeurs, d’échanger sur les dernières nouveautés, d’alerter sur les derniers méfaits des GAFAM et de se sensibiliser sur les sujets du moment.
- s’organiser à plusieurs, mettre en place différents partenariats entre associations et entreprises (je ne vous ai pas encore parlé du CNLL, il n’y a pas que des personnes et des associations dans la communauté libriste, il y a aussi de nombreuses entreprises !).
– profiter de chaque occasion pour lancer des campagnes de sensibilisation. Comme l’opération Adieu Windows, bonjour le Libre ! qui a débuté en octobre 2025, à la date choisie par Microsoft pour arrêter son support gratuit à Windows 10 alors qu’une loi européenne l’obligeait à le maintenir une année supplémentaire. L’opération a pour but de visibiliser au maximum les actions des GULL (Groupe d’Utilisateurices de Logiciels Libres), qui régulièrement organisent des rencontres accessibles à toustes pour libérer les ordinateurs et téléphones des personnes qui le souhaitent des produits des GAFAM. On appelle cela des install’s parties.
– mobiliser l’opinion publique par la mise en place de pétitions ou de plaidoyers destinés aux politiques, sur des sujets importants comme l’éducation au numérique, l’interopérabilité ou la souveraineté technologique. Cela n’est pas toujours évident d’atteindre des chiffres suffisants pour influencer les lois, mais c’est toujours une occasion de voir nos sujets abordés dans la presse. Si vous aimez ce genre de mobilisations, allez sur les sites de la quadrature du net ou d’HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)
– convaincre les candidat·es aux élections de s’engager pour le Libre et les libertés numériques. Par exemple en leur faisant signer un pacte, comme le Pacte du Logiciel Libre. Une occasion de passer à l’action, une chance pour ces personnes de s’engager à donner la priorité aux logiciels libres, à faire respecter la vie privée et aussi à sortir des griffes des GAFAM.
– essayer de faire évoluer la législation, prendre contact avec les député·es, les sénateurices, les membres du gouvernement. Constamment. C’est chronophages et rarement épanouissant mais c’est indispensable. C’est aussi très intimidant. Mais ces personnes sont sensées nous représenter, et comme leurs votes ne correspondent pas toujours à l’intérêt général, il faut leur rappeler qu’on existe ! !
Les actions collectives et les mobilisations créent un rapport de force, tandis que les politiques publiques permettent d’ancrer durablement le logiciel libre dans la société. Les deux sont indispensables pour une transition numérique éthique et durable.
Et parfois, ok trop rarement, il y a de bonnes surprises qui en ressortent comme la loi pour une République numérique, comme l’utilisation des logiciels libres au sein du ministère de l’éducation, l’utilisation par la gendarmerie d’une distribution libre améliorée et adaptée à ses besoins.
Au niveau européen le RGDP (Règlement Général pour la Protection des Données) ou le DMA (Digital Market Act) et le DSA (Digital Service Act). En Europe, on est quand même mieux protégé·es qu’aux États-Unis.
Et pour conclure ?
Chaque geste compte, comme ce conte où un feu de forêt se déclenche, tous les animaux fuient, sauf un petit colibri qui essaie de l’éteindre, goutte d’eau par goutte d’eau. Quand les autres animaux s’en rendent compte, ils décident d’en faire de même et d’essayer de mettre fin à l’incendie ensemble.
Et bien, nous aussi, notre monde brule et il est temps de se rassembler pour changer le système, sortir de nos prisons un peu trop confortables et s’émanciper numériquement.
02.02.2026 à 07:42
Khrys’presso du lundi 2 février 2026
Khrys
Texte intégral (9507 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- La purge militaire chinoise offre à Taïwan un répit qui pourrait être de courte durée (slate.fr)
Depuis Taipei, l’éviction du général Zhang Youxia et la brusque réorganisation de la commission militaire centrale en Chine ont été suivies de près. À court terme, cela pourrait servir les intérêts taïwanais, mais annonce surtout une armée de plus en plus au service de Xi Jinping, bien déterminé à ce que Taïwan soit contrôlée par la Chine.
- China hacked Downing Street phones for years (telegraph.co.uk)
Spying operation targeted senior government members, including aides to Boris Johnson and Rishi Sunak
- ‘Mother of all deals’ : EU and India sign free trade agreement (theguardian.com)
Tariffs cut to zero for many industrial products, including iron and steel, plastics, chemicals and pharmaceuticals
- Fédération de Russie. Un atome non pacifique (reseau-bastille.org)
- Interpol : Comment Moscou traque ses opposants grâce à l’organisation policière (disclose.ngo)
La Russie use de tous les outils offerts par Interpol pour traquer opposants, journalistes et militants en exil […] Alors que des contrôles renforcés ont été mis en place après l’invasion de l’Ukraine, en 2022, les abus n’ont jamais cessé. Plutôt que de sévir, Interpol a récemment allégé les mesures de surveillance imposées à Moscou.
Voir aussi Révélations sur le détournement d’Interpol par les pays les plus répressifs au monde (disclose.ngo)
Persécutions, traques secrètes, arrestations arbitraires… Révélations sur un système qui permet à des régimes autoritaires comme la Russie, la Turquie ou le Tadjikistan d’utiliser Interpol pour persécuter leurs opposants politiques.
Et Au Tadjikistan, Interpol ferme les yeux sur les persécutions de la dictature (disclose.ngo)
Avec près de 3 500 notices rouges en circulation, le Tadjikistan fait partie des trois pays qui sollicitent le plus Interpol au monde. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, ce recours à l’organisation policière permet à la dictature tadjike de pourchasser des opposant·es politiques et des citoyens musulmans sans lien avec des organisations armées.
Et encore Interpol : Des journalistes et militants politiques turcs fichés comme « terroristes » (disclose.ngo)
Depuis une décennie, la Turquie s’appuie sur l’organisation de police criminelle pour mener une traque acharnée contre des opposant·es politiques et des journalistes en exil
- Syrie. À Raqqa, la fin du rêve kurde (orientxxi.info)
Raqqa, 18 janvier. Les soldats de l’armée syrienne se prennent en photo dans la ville, des tirs de célébration claquent, le drapeau syrien flotte. Après sept années sous administration des Forces démocratiques syriennes (FDS), la ville repasse sous le contrôle de Damas, à la faveur d’un accord. Tandis que certains fêtent la « libération », s’éloignent le projet du « Rojava » et l’autonomie kurde.
Voir aussi Syrie : un risque de génocide des kurdes ? Des militantes nous expliquent (humanite.fr)
- Quels sont les moyens militaires que l’armée américaine a déployés à proximité de l’Iran ? (legrandcontinent.eu)
- L’Iran riposte à l’Union européenne et met en garde les États-Unis contre des frappes (huffingtonpost.fr)
En rétorsion à la mesure prise jeudi par l’UE, Téhéran fait des armées européennes des groupes terroristes.

- En Iran, danser devant la mort pour briser le silence (blogs.mediapart.fr)
Quand l’enterrement se change en noce, et le deuil en tactique de résistance… En janvier 2026, les cimetières iraniens sont devenus le théâtre d’une insurrection symbolique. Face à un pouvoir qui administre jusqu’aux cadavres, horaires, silences, signatures, enterrements sous surveillance, des familles endeuillées transforment les funérailles en « mariage ».
- Mozambique : 112 décès, 99 blessés, 3 disparus et 645 000 personnes victimes des inondations (la1ere.franceinfo.fr)
- « Il fait moins de 0°C chez moi » : sans chauffage ni électricité, la survie quotidienne des habitant·es de Kiev (slate.fr)
plus de 90 tentes chauffées ont été installées dans la ville par le Service national des situations d’urgence. Surnommés « points d’invincibilité », ces abris accueillent, 24 heures sur 24, les habitant·es privés d’électricité.
- « Paresseux et complaisants » : des retraités suédois racontent comment la suppression de l’impôt sur la fortune a transformé leur pays (theconversation.com)
- Une première : les Pays-Bas condamnés à mieux protéger une île caribéenne du changement climatique (reporterre.net) – voir aussi « Un précédent d’importance mondiale » pour la justice climatique : les Pays-Bas condamnés pour discrimination envers l’île de Bonaire (humanite.fr)
Un tribunal néerlandais a sommé, mercredi 28 janvier, les Pays-Bas de mieux protéger du changement climatique l’île antillaise de Bonaire et de fixer à l’ensemble de l’économie nationale des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Zimbabwe, Madagascar, Honduras… Ces crises humanitaires oubliées et aggravées par le changement climatique (reporterre.net)
- Milan mayor calls ICE “a militia that kills” and says agents not welcome as part of U.S. Olympic security (cbsnews.com)
- L’exception espagnole qui dérange (politis.fr)
L’Espagne est la preuve qu’une coalition de gauche, lorsqu’elle assume ses désaccords mais partage un cap, peut produire des politiques à la hauteur des attentes populaires.
- UK police to use AI facial recognition tech linked to Israel’s war on Gaza (aljazeera.com)
The United Kingdom’s controversial rollout of facial recognition technology will rely on software that appears to have already been deployed in Gaza, where it is used by the Israeli army to track, trace, and abduct thousands of Palestinian civilians passing through checkpoints.
- Sanctions contre les partenaires de Cuba : Trump accentue l’offensive impérialiste contre l’île (revolutionpermanente.fr)
- ICE knocks on ad tech’s data door to see what it knows about you (theregister.com)
It’s not enough to have its agents in streets and schools ; ICE now wants to see what data online ads already collect about you. The US Immigration and Customs Enforcement last week issued a Request for Information (RFI) asking data and ad tech brokers how they could help in its mission.
- Capgemini participe à traquer les migrant·es pour l’ICE, des millions de dollars à la clé (next.ink) – voir aussi Avant même de signer son nouveau contrat, Capgemini traquait déjà des migrant·es pour l’ICE (multinationales.org)

- États-Unis : après Capgemini, les groupes français Thalès et Parrot sont accusés de fournir des services à ICE (humanite.fr)
- En lien avec Minneapolis, ce que l’on sait de l’arrestation de l’ancienne star de CNN Don Lemon (huffingtonpost.fr)
Ce mois-ci, il avait couvert une action contre la police de l’immigration dans une église à Saint Paul, dans le Minnesota.
- « Leur but, c’est de vous casser » : détenu par l’ICE pendant un mois, ce Français raconte (huffingtonpost.fr)
J’avais fait les choses dans les règles. Je pensais être protégé.
- Minneapolis : un juge ordonne la libération de l’enfant de 5 ans dont l’arrestation a fait le tour du monde (huffingtonpost.fr)
Liam Conejo Ramos et son père avaient été arrêtés par l’ICE le 20 janvier à Minneapolis.
- Los Angeles contre l’ICE (laviedesidees.fr)
À Los Angeles, la résistance des habitant·es et des pouvoirs publics à la politique anti-migrant·es manifeste l’ampleur du militantisme populaire. On voit s’engager là une lutte majeure pour la souveraineté territoriale.
- Alex Pretti : Analysing Footage of Minneapolis CBP Shooting (bellingcat.com)
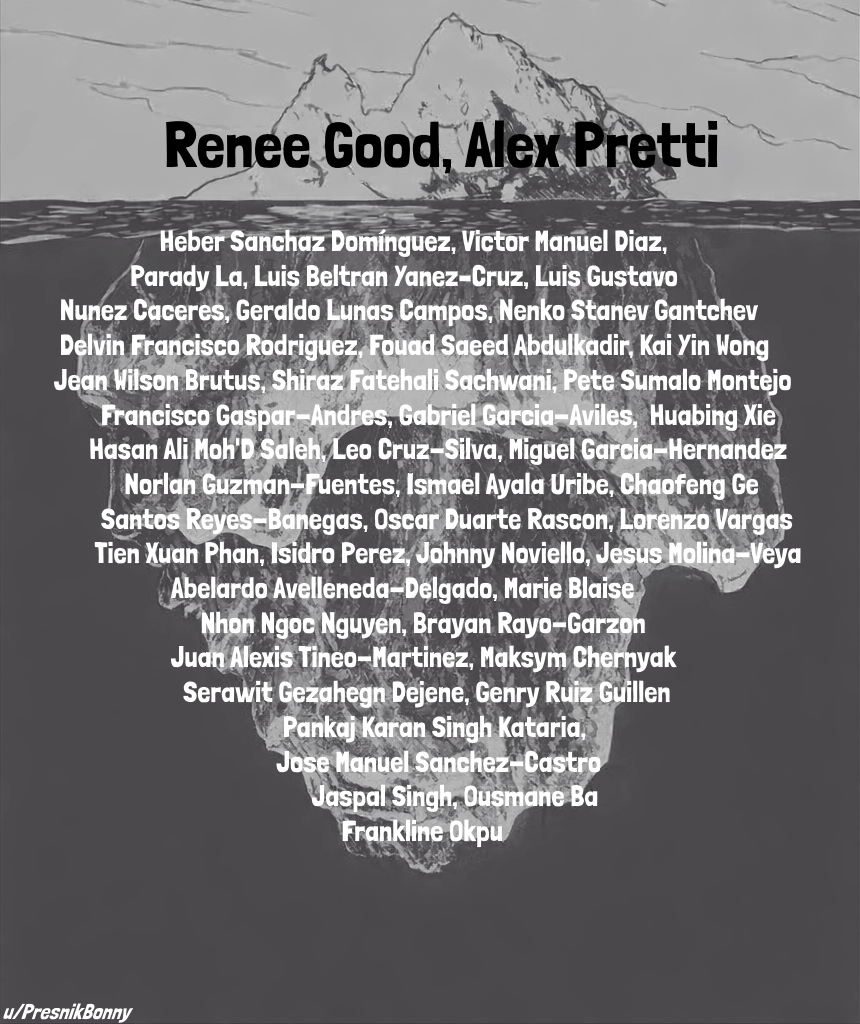
- Meurtre d’Alex Pretti : la Border Patrol, cette autre police de l’immigration américaine à l’origine du drame (huffingtonpost.fr)
Censée s’occuper des frontières, la Border Patrol accompagne désormais l’ICE dans la vaste campagne d’expulsions lancée par l’administration Trump.
- Après les violences de Minneapolis, les Républicains se prennent les pieds dans le tapis sur le 2e amendement (huffingtonpost.fr)
Pour certains Républicains, le fait qu’Alex Pretti ait pu porter une arme justifierait qu’il ait été abattu par la police.
- Minnesota : un juge fédéral interdit la détention de réfugié·es en situation légale (lemonde.fr)
L’ordonnance du juge John Tunheim exige que tout·e réfugié·e détenu·e dans le cadre du programme, lancé en janvier par les autorités, visant à réexaminer le statut légal d’environ 5 600 réfugié·es de cet État démocrate n’ayant pas encore reçu leur « carte verte », soit « immédiatement remis·e en liberté ».
- Minnesota Proved MAGA Wrong (theatlantic.com)
Maybe they had assumed that they would find only a caricature of “the resistance” […] what they discovered in the frozen North was something different : a real resistance, broad and organized and overwhelmingly nonviolent, the kind of movement that emerges only under sustained attacks by an oppressive state. Tens of thousands of volunteers—at the very least—are risking their safety to defend their neighbors and their freedom.
- The dildo distribution delegation (closertotheedge.net)
I stood there, half-blind, lungs on fire, thinking : We just got tear-gassed over a dildo.Not a brick. Not a Molotov. Not a weapon. A rubber dick. That is how fragile federal masculinity is in 2026. […] We proved that you can bring a trillion-dollar security apparatus to its knees with one well-aimed rubber cock. As I stood there coughing, eyes streaming, lungs on fire, watching cops lose their goddamn minds over a dildo, I realized something sacred and stupid and true : You can’t baton your way out of satire. You can’t gas a punchline. And you absolutely cannot maintain authority while tear-gassing people over a rubber dick.
- ‘Rage knitting’ against the machine : the hobbyists putting anti-ICE messages into crafts (theguardian.com)
They didn’t want to return to the “pussy hats” that symbolized women’s resistance to Donald Trump in 2016, so Paul, their employee, did some research and came back with a proposal : a red knit hat inspired by the topplue or nisselue (woolen caps), worn by Norwegians during the second world war to signify their resistance to the Nazi occupation.
- Bruce Springsteen Revives the Protest Song, Condemns ICE Violence in “Streets of Minneapolis” (openculture.com)
- More ‘No Kings’ protests planned for March 28 as outrage spreads over Minneapolis deaths (winnipegfreepress.com)
- À Minneapolis, Donald Trump cède à la pression avec l’annonce du retrait progressif d’agents fédéraux (huffingtonpost.fr)
Après des semaines de manifestations et deux morts lors d’interventions fédérales, la Maison-Blanche semble infléchir sa stratégie sous la pression des autorités locales et judiciaires.
- Comment Minneapolis a fait reculer l’ICE (revolutionpermanente.fr)
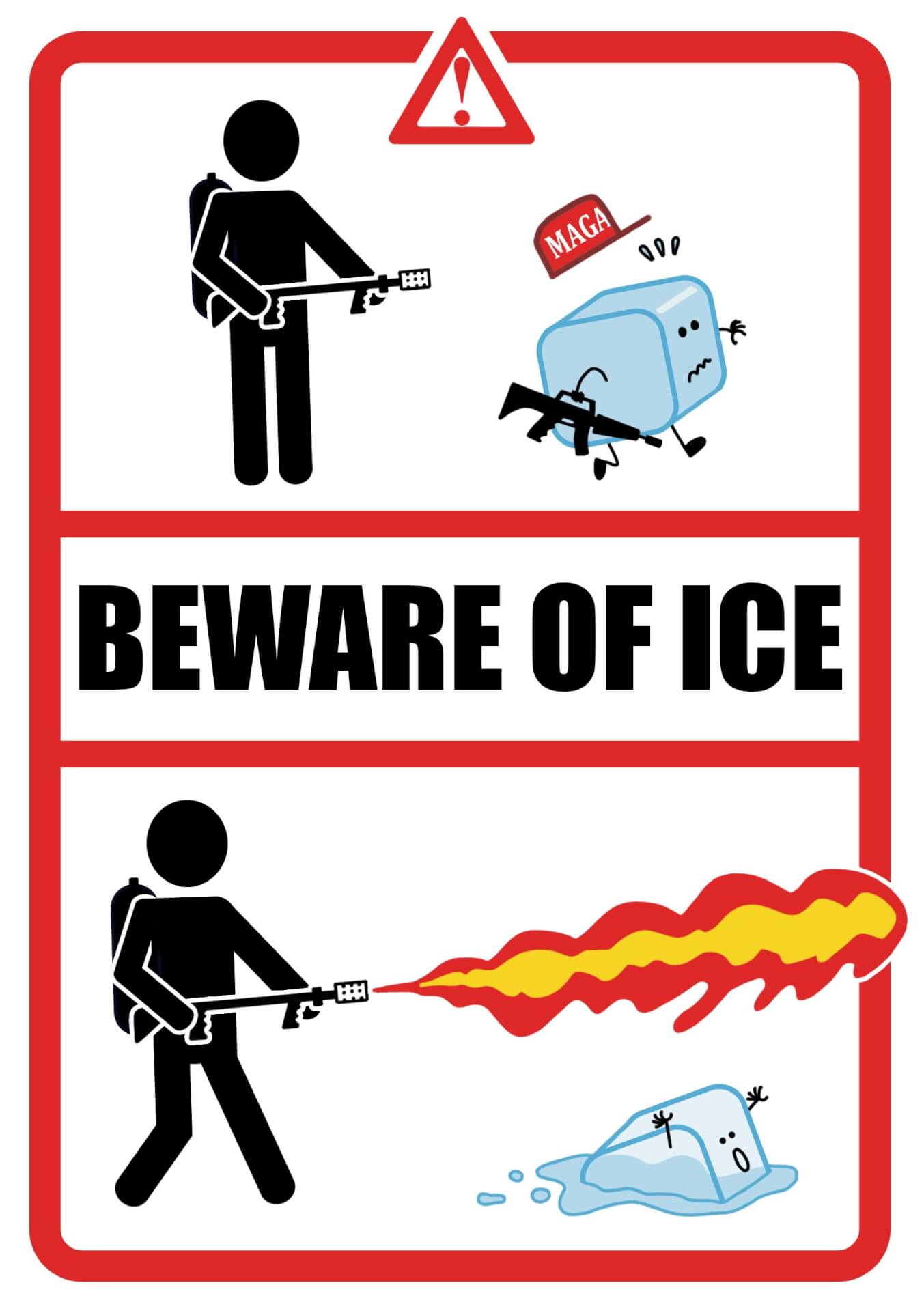
- Luigi Mangione ne risque plus la peine de mort (huffingtonpost.fr)
Le souhait de Pam Bondi concernant la peine de mort de Luigi Mangione n’a pas été écouté par la juge fédérale Margaret M. Garnett. Cette dernière a rejeté les deux chefs d’accusation pour lesquels le parquet avait requis la peine de mort, à savoir le meurtre et l’utilisation d’un pistolet équipé d’un silencieux.
- Quand Donald Trump se prend pour Napoléon Ier avec son projet d’arc de triomphe (slate.fr)
À Washington, le président des États-Unis veut ériger l’« Independence Arch », un arc de triomphe à sa gloire, fortement inspiré de celui de Paris.
- TrumpRx delayed as senators question if it’s a giant scam with Big Pharma (arstechnica.com)
The website is delayed as senators seek answers from health department watchdog.
- Dozens of CDC vaccination databases have been frozen under RFK Jr. (arstechnica.com)
Anti-vaccine Kennedy may be “enacting a self-fulfilling prophecy,” expert says.
- Trump policies at odds with emerging understanding of COVID’s long-term harm (cbsnews.com)
- Custom machine kept man alive without lungs for 48 hours (arstechnica.com)
The artificial lung system was built by the team of Ankit Bharat, a surgeon and researcher at Northwestern. It successfully kept a critically ill patient alive long enough to enable a double lung transplant, temporarily replacing his entire pulmonary system with a synthetic surrogate. The system creates a blueprint for saving people previously considered beyond hope by transplant teams.
- Former astronaut on lunar spacesuits : “I don’t think they’re great right now” (arstechnica.com)
Crew members traveling to the lunar surface on NASA’s Artemis missions should be gearing up for a grind. They will wear heavier spacesuits than those worn by the Apollo astronaut
- Earth’s Lower Orbit Could Rapidly Collapse, Scientists Warn (futurism.com)
With satellites and space junk increasingly cluttering our planet’s low Earth orbit, a team of scientists warn that this entire region could suddenly collapse into a destructive maelstrom of swirling debris, posing a threat to any spacecraft that dares to venture up there, and hurling dangerous missiles of space junk down onto our planet below.
- New fear unlocked : runaway black holes (theconversation.com)
Astronomers have seen clear signs of runaway supermassive black holes tearing through other galaxies, and have uncovered evidence that smaller, undetectable runaways are probably out there too.
Spécial IA
- There are now more than 1 million “.ai” websites, contributing an estimated $70 million to Anguilla’s government revenue last year (sherwood.news)
- Starlink utilise les données personnelles de ses abonné·es à leur insu et par défaut pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. (01net.com)
- Massive AI Chat App Leaked Millions of Users Private Conversations (apple.slashdot.org)
Chat & Ask AI, one of the most popular AI apps on the Google Play and Apple App stores that claims more than 50 million users, left hundreds of millions of those users’ private messages with the app’s chatbot exposed
- Web portal leaves kids’ chats with AI toy open to anyone with Gmail account (arstechnica.com)
Just about anyone with a Gmail account could access Bondu chat transcripts.
- Google begins rolling out Chrome’s “Auto Browse” AI agent today (arstechnica.com)
- Mozilla is building an AI ‘rebel alliance’ to take on industry heavyweights OpenAI, Anthropic (cnbc.com)
In practice, Mozilla is focused on deploying its roughly $1.4 billion worth of reserves to support “mission driven” tech businesses and nonprofits, including its own
Voir aussi Mozilla veut accroître ses investissements dans l’IA open source de confiance (zdnet.fr)
Mozilla Ventures a investi dans 55 entreprises, dont des start-up de l’IA, et d’autres opérations sont prévues cette année.
- DuckDuckGo Asked Its Users How They Feel About AI Search. 90 % Hate It (pcmag.com)
- ChatGPT cite Grokipedia comme une source pertinente (next.ink)
- EDRi calls for swift action as EU probes X’s Grok over AI-generated harm (edri.org)
The European Commission has opened a DSA investigation into Grok, X’s AI chatbot. EDRi welcomes this decision and is calling for a swift resolution to this matter, to ensure that X complies fully with its DSA obligations and protects its users.
- New OpenAI tool renews fears that “AI slop” will overwhelm scientific research (arstechnica.com)
On Tuesday, OpenAI released a free AI-powered workspace for scientists. It’s called Prism, and it has drawn immediate skepticism from researchers who fear the tool will accelerate the already overwhelming flood of low-quality papers into scientific journals. The launch coincides with growing alarm among publishers about what many are calling “AI slop” in academic publishing.
- Drowning in AI slop, cURL ends bug bounties (thenewstack.io) – voir aussi “Préserver notre santé mentale” : cURL suspend son bug bounty, face aux mauvaises contributions par IA (zdnet.fr)
- Vibe Coding Kills Open Source (arxiv.org)
- AI agents now have their own Reddit-style social network, and it’s getting weird fast (arstechnica.com)
Moltbook lets 32,000 AI bots trade jokes, tips, and complaints about humans.
- Yann LeCun claque la porte de Meta et balance : « Les LLM sont une impasse, la Chine va gagner » (goodtech.info)
Après avoir quitté Meta en novembre 2024 où il était chief AI scientist depuis 12 ans, le pionnier des réseaux de neurones affirme sans détour que les investissements massifs de la Silicon Valley dans les grands modèles de langage (LLM) représentent une « impasse » qui ne mènera jamais à une IA de niveau humain, encore moins superintelligente.
- La bulle de l’IA et l’économie étatsunienne (contretemps.eu)
Selon l’économiste Michael Roberts, la bulle de l’IA masque l’état désastreux de l’économie américaine… en attendant l’inévitable crise qui découlera de son éclatement.
Spécial Palestine et Israël
- UNRWA staff cuts deepen in Gaza as Israel restricts critical aid access (aljazeera.com)
- Al Jazeera Denounces YouTube’s Submission to the Ban of its Broadcast in Israel and Calls for Adherence to International Conventions (network.aljazeera.net)
Al Jazeera Media Network strongly denounces YouTube’s submission to the Israeli authorities’ decision to ban the broadcast of its channels on the platform and the blocking of its websites in Israel. The Network emphasises that this measure represents a flagrant violation of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees the right to seek, receive, and impart information freely.
- Palestine : la solidarité syndicale n’est pas un délit ! (snes.edu)
Le SNES-FSU apporte tout son soutien à la délégation de l’Internationale de l’Éducation, stoppée par l’armée israélienne alors qu’elle rendait visite à des camarades et collègues palestinien·nes.
- En France, le gel des avoirs est une arme islamophobe contre le combat palestinien (politis.fr)
Spécial femmes dans le monde
- Pourquoi y a-t-il autant de « ladyboys » en Thaïlande ? (slate.fr)
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, sous l’influence occidentale, que la monarchie thaïlandaise impose une différenciation nette des sexes, à travers les vêtements ou encore les normes sociales. Et, par la même occasion, la notion même de transgenre apparaît dans la société : auparavant, les personnes n’allaient pas « au-delà » (du préfixe latin trans-) d’une norme binaire… puisqu’elle n’existait pas vraiment.
- Kristen Stewart préfère être réalisatrice car « les actrices sont traitées comme de la merde » (huffingtonpost.fr)
La star de « Twilight » dénonce la différence de traitement entre les actrices et les réalisatrices, mais aussi le fait que la vision masculine prime dans le milieu.
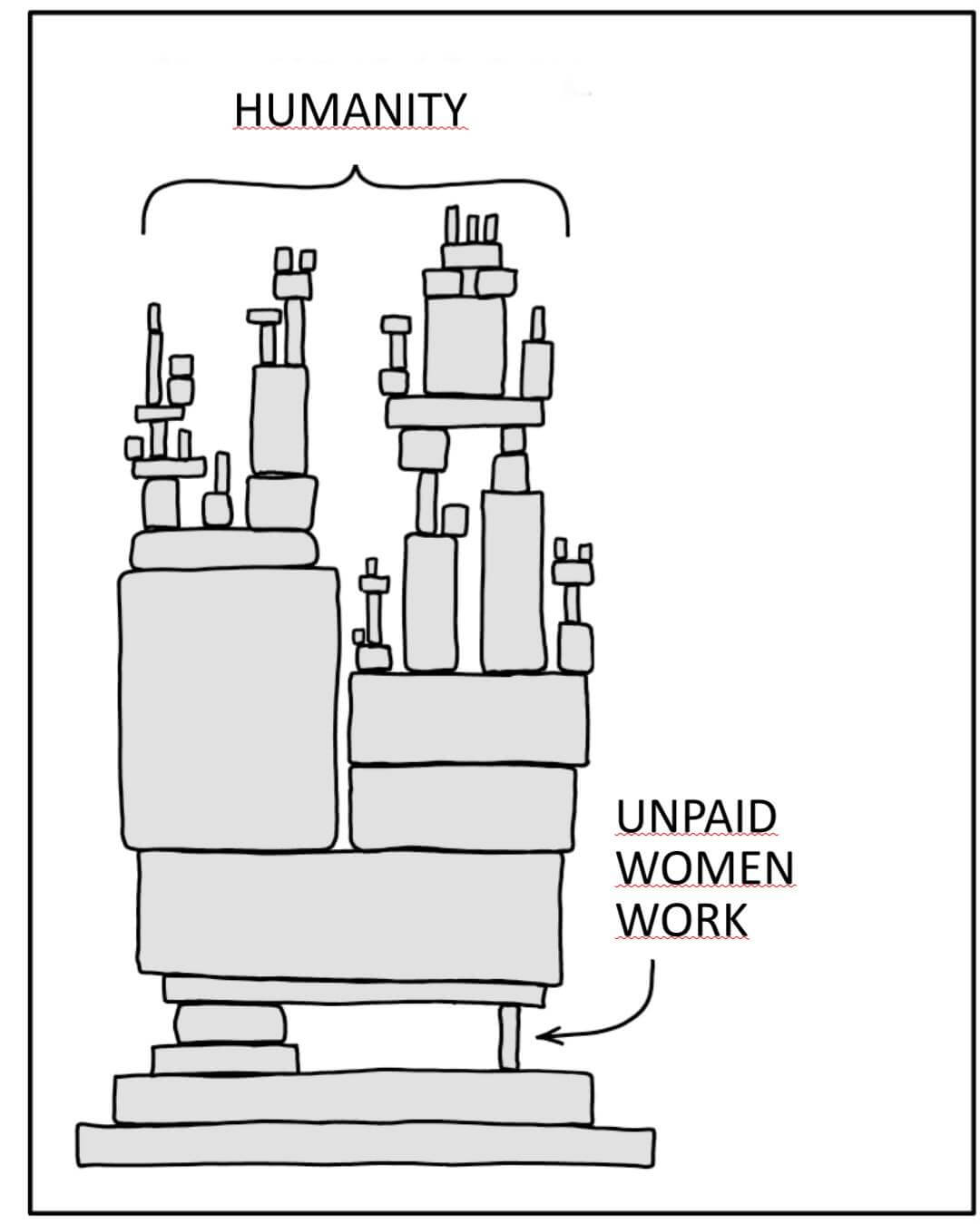
- Daniel Bravo suspendu pour des propos sexistes lors de PFC-OM, beIN Sports présente ses excuses (huffingtonpost.fr)
Le consultant de beIN Sports a fait une remarque déplacée à propos de Gaëtane Thiney.
- Musk’s Estranged Daughter Shares Haunting Holiday Memory Following Revelations He Planned Epstein Island Visit (ibtimes.co.uk)
Elon Musk’s estranged daughter has broken her silence following the release of explosive emails showing her father coordinated travel plans with convicted sex offender Jeffrey Epstein, sharing a haunting childhood memory that has intensified scrutiny over the tech mogul’s past connections.
- Les lunettes connectées de Meta sont détournées par les harceleurs et ce sont les femmes qui trinquent (slate.fr)
RIP
- Venus Khoury Ghata, the Lebanese poet who wrote in French, but from right to left (today.lorientlejour.com)
One of the most celebrated icons of Lebanese-origin in Francophone literature, Venus Khoury Ghata left quietly, her heart weary from too much love and suffering, burning with a sometimes otherworldly radiance.
À (ré)écouter : Vénus Khoury-Ghata, poète des fantômes (radiofrance.fr)
Spécial France
- JO d’hiver 2030 : un juge ordonne un débat démocratique sur leur organisation (reporterre.net)
- Usurpation de numéro, spam : l’Arcep ouvre une enquête contre l’ensemble des opérateurs (next.ink)
- Quelle est la véritable situation financière des universités françaises ? (theconversation.com)
- Le Sénat rejette la loi sur l’aide à mourir, le texte renvoyé à l’Assemblée nationale (la1ere.franceinfo.fr)
- Procès FN-RN en appel : Marine Le Pen coule et embarque les coaccusés avec elle (politis.fr)
Devant la cour d’appel, la présidente des députés RN tente de faire tomber l’élément central du jugement, celui qui la place à la tête d’un détournement organisé. Pour y parvenir et sauver 2027, elle concède des « ambiguïtés » et laisse l’addition politique à ses proches.
- Notre-Dame de Bétharram va fermer ses portes. (huffingtonpost.fr)
Au cœur de l’un des plus gros scandales de pédocriminalité de l’histoire de l’école en France, l’établissement béarnais s’apprête à mettre un terme à son activité.
- 35 étudiant·es d’AgroParisTech exclu·es 15 jours après une mobilisation contre l’agro-industrie (reporterre.net)
- Dans les Hauts-de-France, 83 000 personnes boivent une eau contaminée à un fongicide (reporterre.net) – voir aussi PFAS : 83 000 habitants affectés par la pollution de l’eau à un fongicide, dénonce une ONG (humanite.fr)
L’ONG Générations Futures alerte, mercredi 28 janvier, sur la contamination à grande échelle de l’eau du robinet dans 46 communes. En cause : le fluopyram, un produit chimique utilisé pour la culture de fruits, légumes, céréales et des pommes de terre.
- Des traces du pétrole de l’« Erika », échoué en 1999, retrouvées sur des oiseaux dans le Finistère (humanite.fr)
Le Cedre a annoncé ce jeudi 29 janvier, avoir détecté du fioul similaire à celui du pétrolier « Erika », échoué en 1999, sur des oiseaux présents au large de la Bretagne. Leurs plumes sont en cours d’analyse.
- « On nous abandonne » : à La Rochelle, un cluster de cancers à côté des usines (reporterre.net)
- Les victimes des essais nucléaires mieux indemnisées : « Nous sommes de la chair à canon, ils doivent passer à la caisse » (reporterre.net)
Spécial femmes en France
- La promesse de remboursement des protections périodiques toujours pas tenue par le gouvernement (huffingtonpost.fr)
Adopté fin 2023, le remboursement des coupes et culottes menstruelles attend toujours un décret que la ministre Aurore Bergé avait promis pour fin 2025.
- Devoir conjugal : « Pour que les mentalités changent, il faut des propositions de loi comme celle-ci » (huffingtonpost.fr)
C’est une avancée attendue de longue date par les associations féministes. Mercredi 28 janvier, les député·es ont voté à l’unanimité pour entériner dans le droit l’absence de tout devoir conjugal au sein du mariage.
- Près du tiers des collégiennes et un quart des lycéennes ont été victimes d’une forme de cyberviolence au cours de l’année scolaire, selon l’éducation nationale. (huffingtonpost.fr)
- Journaliste cyberharcelée après la CAN : « rien ne justifie les insultes sexistes » dénonce la ministre des Sports (huffingtonpost.fr)
La journaliste de beIN Sports Vanessa Le Moigne a annoncé sa décision de ne plus couvrir le football à la suite d’une vague de cyberharcèlement après la finale de la CAN.
- « Je suis allée voir un ami, j’ai découvert un agresseur » témoigne Sandrine Josso au procès Guerriau (huffingtonpost.fr)
Au tribunal de Paris, l’ex-sénateur et la députée livrent deux récits opposés d’une soirée devenue affaire nationale.
- Affaire Joël Guerriau : “C’est inadmissible”, Sandrine Josso dénonce le manque de soutien et de coopération du président du Sénat Gérard Larcher (ladepeche.fr) – voir aussi “Votre silence m’interroge”. Après la condamnation de Joël Guerriau, la députée Sandrine Josso, interpelle Gérard Larcher, président du Sénat. (france3-regions.franceinfo.fr)
lors du procès de mon agresseur, ce dernier a dévoilé à la barre de nombreuses pratiques illégales ou contraires à l’éthique, notamment le fait que la drogue mise dans mon verre lui avait été remis par un de ses collègues sénateur mais également qu’il avait eu des relations sexuelles avec deux de ses anciennes collaboratrices.
Spécial médias et pouvoir
- Jean-Marc Morandini maintenu sur CNews, la fronde gagne « Le JDD » et symbolise la crise dans l’empire Bolloré (huffingtonpost.fr)
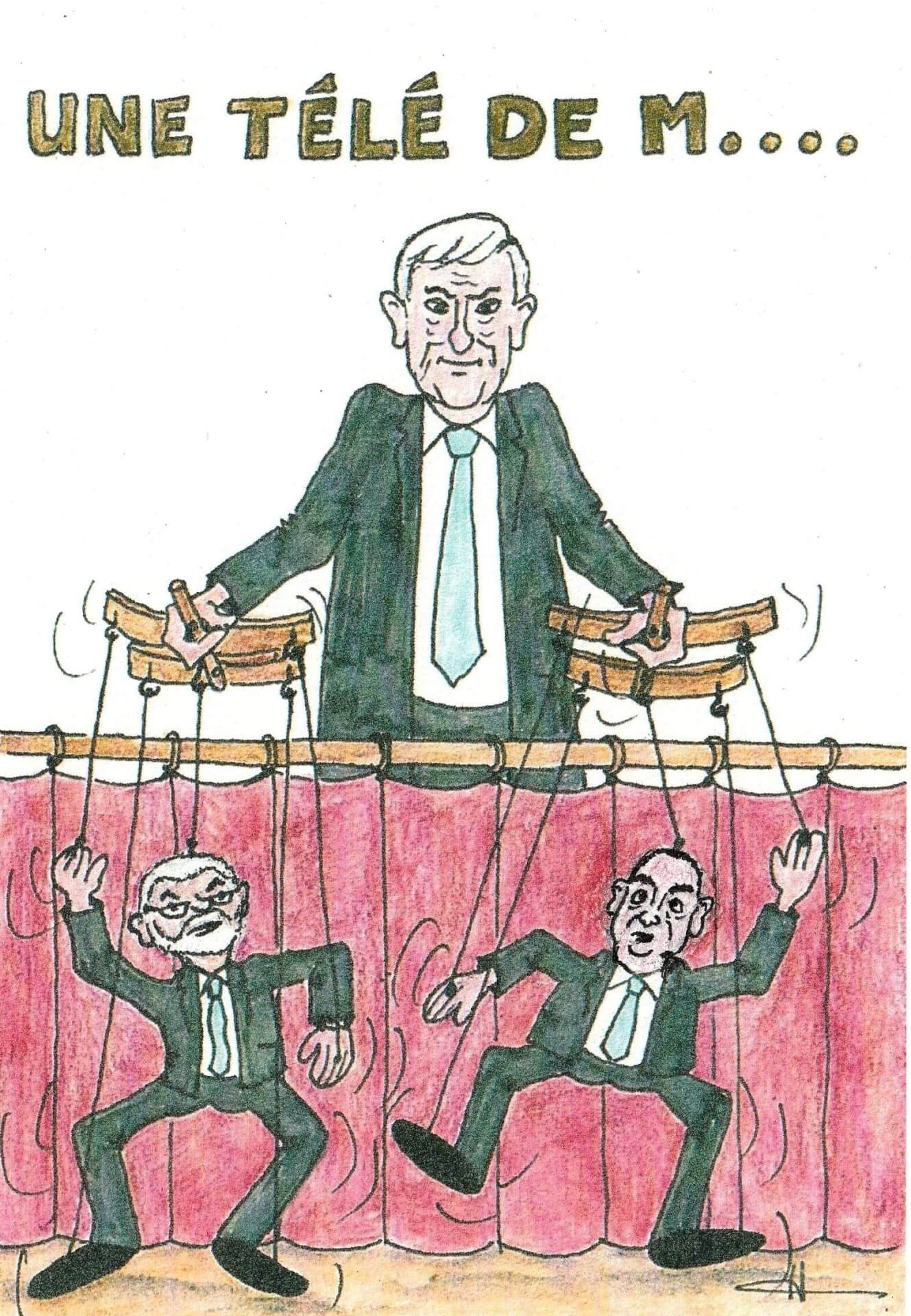
- Sur Franceinfo : Sophie Binet, le patronat et l’extrême droite (politis.fr)
le patronat a oublié la leçon de la Seconde Guerre mondiale et le fait qu’il n’y a pas seulement leurs intérêts économiques, il y a aussi des questions morales
- « 90 % du marché du livre sont aux mains de dix groupes » (politis.fr)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Budget : que reste-t-il de la taxation des riches dans la copie finale ? (ouest-france.fr)

- Sébastien Lecornu met le remaniement dans l’atmosphère, mais pour quoi faire ? (huffingtonpost.fr)
À quinze mois à peine de la prochaine élection présidentielle, le Premier ministre s’apprête à procéder à un remaniement. Surtout technique, il sera aussi politique.
- Nicolas Sarkozy veut (encore) tenter d’échapper au bracelet électronique malgré sa condamnation (huffingtonpost.fr)
Définitivement condamné dans l’affaire Bygmalion à l’automne dernier, l’ancien président de la République va essayer d’échapper à l’exécution de sa peine.
- Peter Thiel, le fondateur de Palantir attendu à l’Académie des sciences morales pour faire son (fa) show (humanite.fr)
Dépendant de l’Institut de France, cette vieillerie conservatrice qui a récemment intronisé le milliardaire français Bernard Arnault, reçoit ce lundi 26 janvier Peter Thiel.
Vous savez, le mec qui disait en 2010 déjà que la technologie est le moyen de changer le monde sans avoir à obtenir sans cesse le consentement du peuple (tube.fdn.fr)
Pour celleux qui ont envie de se faire mal : Peter Thiel à l’Académie : notes intégrales et commentaires critiques (legrandcontinent.eu) - L’Assemblée nationale adopte l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans (liberation.fr) – voir aussi Interdiction des réseaux sociaux : surveiller plus que protéger (blogs.mediapart.fr)
Discutée et votée en procédure d’urgence, dans un climat de populisme éducatif, l’interdiction brutale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en dit probablement davantage sur ses inspirateurs que sur le public visé.
Et Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la fausse bonne idée autoritaire (frustrationmagazine.fr)
Car quelle est la méthode envisagée ? La “reconnaissance faciale” ou “le téléchargement de documents d’identité”. Il est aussi question de lancer une application de vérification d’âge reliée à la carte d’identité et intégrée à France Identité. Autrement dit : la fin totale de l’anonymat.

Et encore Vérification de l’âge sur les réseaux sociaux : un texte mort-né (projetarcadie.com)l’État serait prêt à « dégainer son application de vérification d’âge, adossée à la carte d’identité électronique, et à la proposer gratuitement aux plateformes ». Cependant […] elle ne permet pas le double anonymat pour préserver la vie privée des utilisateurs, comme l’impose la loi SREN. Car, l’application ou l’outil sera directement adossé à France Identité, gérée par le ministère de l’Intérieur. L’idée est que ce ne seront pas les réseaux sociaux qui auront accès aux identités des utilisateurs, mais l’État lui-même, qui agirait comme tiers de confiance. Sauf que le droit communautaire impose que le tiers de confiance soit un « passeur » et non un « stockeur », notamment pour limiter les risques en cas de piratage. Les incidents de sécurité informatique se multiplient. Il n’y a pas un acteur qui soit épargné par des fuites de données, sauf celles qui ne stockent aucune donnée. […] À ce stade, on pourrait presque parler de mise en open-data des données personnelles.
- Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : “Ce n’est qu’un début, les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste”, assure Anne Le Hénanff, ministre de l’IA et du Numérique (franceinfo.fr)
- La « loi Duplomb » est de retour : le sénateur va déposer un nouveau texte pour réautoriser l’acétamipride dans certaines cultures (vert.eco)
- « La simplification est un mot magique pour détruire les protections environnementales » (reporterre.net)
- « Avec le “cancer backlash”, les intérêts économiques prévalent toujours sur le reste » (reporterre.net)
- Le syndicat des lunetiers du Jura affirme que les montures des lunettes de soleil d’Emmanuel Macron ne sont pas “Made in France” (franceinfo.fr)
Ces personnes se servent d’une notoriété ancestrale de la fabrication de lunettes dans le Jura et en réalité vont faire certainement fabriquer au mieux en Italie, au pire en Asie
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Censure et surveillance : surchauffe au Parlement (laquadrature.net)
- Cette pinata « anti-flics » dans une école d’art de Mulhouse suscite l’indignation de Laurent Nuñez (huffingtonpost.fr) – voir aussi Une voiture de police en carton détruite dans une école d’arts à Mulhouse : le ministre de l’Intérieur dénonce des faits « inadmissibles » (leparisien.fr) et Police et Piñata (mollette.vivaldi.net)
Le Ministre veut des coupables de lèse-police par usage de pinata, tandis que de nombreux élus défilent aujourd’hui même avec les policiers en manif contre le laxisme de la justice. Cette même semaine, d’autres élus ont imaginé de promouvoir une proposition de loi de présomption de légitime défense au profit de la police. C’est beau tous ces élus qui participent collectivement à une nouvelle idéologie à la mode : dégommer l’état de droit et la séparation des pouvoirs.
- Mort d’El Hacen Diarra en garde à vue : l’avocat de la famille dépose une nouvelle plainte et dénonce une “destruction de preuves” (franceinfo.fr)

- La Défenseure des droits dénonce l’usage des lacrymogènes et LBD sur les exilé·es de Calais (reporterre.net)
- « Il faut de grandes rafles d’OQTF » : Arno Klarsfeld veut copier l’ICE et ses méthodes fascistes (revolutionpermanente.fr) – voir aussi Le Conseil d’État engage une procédure disciplinaire contre Arno Klarsfeld après ses propos sur CNews (franceinfo.fr)
L’ancien avocat avait évoqué le lancement de grandes rafles en France, afin d’arrêter des étrangers en situation irrégulière.
- Pas touche aux APL… Sauf pour les étudiant·es étranger·es non européen·nes (basta.media)
Un article du budget entend supprimer les aides au logement pour les étudiant·es étranger·es non citoyen·nes d’un pays de l’Union européenne s’iels ne sont pas boursier·es. La mesure risque de précariser davantage encore des dizaines de milliers de jeunes.
- Discrimination raciale dans l’immobilier : près d’une agence sur deux épinglée par SOS Racisme (lemonde.fr)
Spécial résistances
- Que peuvent faire les syndicats contre la diffusion des idées racistes au sein du salariat ? (basta.media)
- Le Planning familial : l’un des derniers remparts à l’extrême droite en ruralité ? (contretemps.eu)
Association historique luttant pour les droits des femmes et des minorité·es et sur les thématiques liées à la sexualité, le Planning est depuis plusieurs années la cible de l’extrême droite et d’une partie du gouvernement. Pourtant, à l’heure où l’extrême droite pourrait bien accéder au pouvoir […] le rôle politique d’associations comme le Planning Familial est significatif.
- Tribune collective « Immigration : nous constatons les conséquences funestes de la loi Darmanin et de la circulaire Retailleau sur la vie des personnes étrangères » (ripostes.org)
- TRIBUNE « Appel à défendre le Rojava en Syrie » (fondationdaniellemitterrand.org)
- « Ce qu’on a découvert est sidérant » : contre les géants de la chimie, elles défendent 200 citoyen·nes intoxiqué·es aux PFAS (reporterre.net)
- OFF February, le défi collectif de 28 jours pour « se libérer de l’emprise des réseaux sociaux » (huffingtonpost.fr)
Lancé dans quatre pays, dont la France, ce défi invite à supprimer les applications de réseaux sociaux pendant 28 jours, pour en finir avec l’hyperconnexion.
Spécial outils de résistance
- Guide du journaliste pour détecter les contenus générés par l’IA (gijn.org)
- Data Protection Day : 5 misconceptions about data protection, debunked (noyb.eu)
- Masculinismes : neuf idées reçues qui empêchent de qualifier la menace (entreleslignesentrelesmots.wordpress.com)
Spécial GAFAM et cie
- “Instagram is a drug” : Internal messages may doom Meta at social media addiction trial (arstechnica.com)
Anxiety, depression, eating disorders, and death. These can be the consequences for vulnerable kids who get addicted to social media, according to more than 1,000 personal injury lawsuits that seek to punish Meta and other platforms for allegedly prioritizing profits while downplaying child safety risks for years.
- WhatsApp intègre les publicités et vous fait désormais payer pour les supprimer (generation-nt.com)
- Lawsuit Alleges That WhatsApp Has No End-to-End Encryption (pcmag.com) – voir aussi Meta peut accéder à toutes les conversations WhatsApp : un procès accuse l’entreprise d’avoir escroqué des milliards d’utilisateurices grâce à un accès backdoor aux communications privées chiffrées (developpez.com)
- Meta blocks links to ICE List across Facebook, Instagram, and Threads (arstechnica.com)
Mark Zuckerberg’s social media platforms are assisting the Trump administration.
- Apple’s Second-Biggest Acquisition Ever Is a Startup That Interprets Silent Speech (apple.slashdot.org)
Apple has acquired Q.AI, a secretive Israeli startup whose technology can analyze facial skin micro-movements to interpret “silent speech”
- Oui, Microsoft donne les clés BitLocker aux forces de l’ordre. Non, ce n’est pas nouveau (next.ink)
- Microsoft ordered to stop tracking school children (noyb.eu)
The Austrian data protection authority (DSB) has decided that the company illegally installed cookies on the devices of a pupil without consent. According to Microsoft’s own documentation, these cookies analyse user behaviour, collect browser data and are used for advertising. Microsoft now has four weeks to comply and cease the use of tracking cookies.
- Systemd daddy quits Microsoft to prove Linux can be trusted (theregister.com)
- TikTok users say they can’t upload anti-ICE videos. The company blames tech issues (edition.cnn.com) – voir aussi TikTok is investigating why some users can’t write ‘Epstein’ in messages (npr.org) – voir aussi TikTok users “absolutely justified” for fearing MAGA makeover, experts say (arstechnica.com)
TikTok wants users to believe that errors blocking uploads of anti-ICE videos or direct messages mentioning Jeffrey Epstein are due to technical errors—not the platform seemingly shifting to censor content critical of Donald Trump after he hand-picked the US owners who took over the app last week.
- Americans are baffled to discover TikTok is more censored under US ownership than it ever was under China (hespectaclemag.substack.com)
- Altman, Cook et d’autres condamnent les actions de l’ICE alors que leurs sociétés y participent (next.ink)
Les autres lectures de la semaine
- Est-il possible de rapprocher Trump de l’ordre nazi ? Les réponses de Chapoutot (legrandcontinent.eu)
- Technofascisme : quand la Silicon Valley fusionne avec l’autoritarisme trumpiste (synthmedia.fr)
- How to get Doom running on a pair of earbuds (arstechnica.com)
No display ? No problem for the UART-to-web-server “Doombuds” project.
- Infrastructure ou Intrusion ? L’expansion controversée des centres de données en Europe (synthmedia.fr)
- Infrastructures done differently (apc.org)
- Faut-il rendre le vote obligatoire en France ? (usbeketrica.com)
Atteinte à la liberté individuelle fondamentale pour les un·es, remède à l’abstention pour les autres, le vote obligatoire est loin de faire consensus en France, où il est ponctuellement débattu.
- Le microbiote de l’écorce des arbres a un rôle essentiel pour le climat (lareleveetlapeste.fr)
Les chercheureuses montrent que ce microbiote module notamment les flux de gaz en fonction de la disponibilité en oxygène.
- How the Incas Performed Skull Surgery More Successfully Than U.S. Civil War Doctors (openculture.com)
- Les engagé·es de La Réunion, grands oubliés de l’histoire coloniale (afriquexxi.info)
- Le tout premier auteur de l’histoire était une autrice : Enheduanna (theconversation.com)
Longtemps éclipsée par les figures canoniques de la tradition occidentale, Enheduanna est pourtant la première autrice connue de l’histoire. Il y a plus de 4 000 ans, en Mésopotamie, cette grande prêtresse a signé ses textes, mêlant poésie, pouvoir et spiritualité, et laissé une œuvre fondatrice.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Télé
- Scandale
- Interdire
- Choquant
- Liberty
- ICE
- Beware
- Cap Gemini
- Iceberg
- Retourne
- No human
- Dark web
- Women
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Avec les inculpé·es du 8 décembre (1/2) : Quand l’antiterro’ toque à la porte (audioblog.arteradio.com)
- Avec les inculpé·es du 8 décembre (2/2) : Qui terrorise qui ? Le petit théâtre de la justice d’exception (audioblog.arteradio.com)
- Témoignage du Juge Guillou de la Cour Pénale Internationale – Soirée ISC-PIF 20Janvier 2026 (tube.fdn.fr)
- Face à l’extrême droite, la résistance s’organise (blast-info.fr)
- L’ICE ou l’arsenal technologique en action (radiofrance.fr)
Du ciblage publicitaire à la reconnaissance faciale en passant par les Meta Ray-Ban, les agents de l’ICE déploient en toute impunité un arsenal technologique. Quid de la riposte ?
- Désordre mondial : et si Donald Trump n’était pas le problème ? (humanite.fr)
Trump, le pétrole, Venezuela, droits de douane : et si le problème n’était pas Donald Trump lui-même mais un changement profond du capitalisme mondial ? Sommes-nous en train d’assister à la fin du néolibéralisme ?
- Quand les femmes vieillissent (radiofrance.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- Tesla : 2024 was bad, 2025 was worse as profit falls 46 percent (arstechnica.com)
More than half its profit came from emissions credits as sales fell 8.6 percent.
Voir aussi
- Tesla’s Wile E. Coyote Moment Is Here (prospect.org)
But how long can Elon Musk keep running on air ? Potentially quite a long time.
- Why Linux is safe from viruses (programmerhumor.io)
- Concevoir un site web durable et accessible (gaite-lyrique.net)
- Accessibility For Everyone (accessibilityforeveryone.site)
- Les animaux aussi savent se servir d’outils ! (reporterre.net)
Des vaches sont capables de se gratter avec un balai, des pieuvres se fabriquent des armures en noix de coco… Focus sur ces animaux habiles.
- La première cartographie du réseau souterrain mondial des champignons a été révélée (lareleveetlapeste.fr)
La Société pour la protection des réseaux souterrains (SPUN) a dévoilé une carte unique au monde : celle du monde fongique. Aussi communément appelé le réseau mycorhizien, il est bien qu’invisible, extrêmement vaste et absolument essentiel pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales. Les scientifiques à l’origine du projet veulent mieux protéger ce réseau, qui sert à la fois de puits de carbone et réserve de nutriments. La longueur totale du mycélium dans les 10 premiers cm du sol est d’environ la moitié de la largeur de notre galaxie.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
26.01.2026 à 07:42
Khrys’presso du lundi 26 janvier 2026
Khrys
Texte intégral (8878 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Le traité sur la haute mer entre officiellement en vigueur : des aires marines protégées à la COP1 sur l’océan, voici ce qui va changer (vert.eco)
- Nous entrons dans « l’ère de la faillite de l’eau », alerte un rapport de l’ONU (reporterre.net)
- Half the world’s 100 largest cities are in high water stress areas, analysis finds (theguardian.com)
Beijing, Delhi, Los Angeles and Rio de Janeiro among worst affected, with demand close to exceeding supply
- CPJ Reports Near-Record Global Journalist Imprisonments in 2025 (occrp.org)
- Japon : le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde arrêté très rapidement (rtbf.be)
- Le mystère de la face cachée de la Lune relancé par l’analyse de roches rapportées par une mission chinoise (slate.fr)
- China’s population falls again as birthrate drops 17 % to record low (theguardian.com)
The fall comes despite years of policies from Beijing intended to boost the flagging birthrate. This year, the government allocated 90bn yuan (£9.65bn) for its first nationwide childcare subsidy programme, for children aged under three. There are also plans to expand national healthcare insurance to cover all childbirth related expenses, including IVF treatment.
- Thousands of workers flee Cambodia scam centres, officials say (theguardian.com)
Thousands of people, including suspected victims of human trafficking, are estimated to have been released or escaped from scam compounds across Cambodia over recent days, after growing international pressure to crackdown on the multibillion-dollar industry.
- Déforestation : l’Indonésie révoque les permis de 28 entreprises, en réponse aux inondations meurtrières (reporterre.net)
- Ni mollahs ni Shah : le double combat des Iranien·nes contre l’autoritarisme et l’impérialisme (frustrationmagazine.fr)
- Iran’s internet blackout may become permanent, with access for elites only (restofworld.org)
The regime is testing a two-tier internet where access becomes a vetted privilege. Its economic cost could be staggering.
- Quelques heures d’accès internet révèlent l’escalade dramatique de la répression en Iran (france24.com)
- Soulèvement et répression en Iran : que peut (et doit) faire la communauté internationale ? (portail.basta.media)
Depuis fin décembre, les Iraniens et Iraniennes sont descendus dans la rue. Le régime a réprimé les manifestations dans le sang. Les médias indépendants internationaux analysent la situation et les pistes d’action possibles.
- Rojava : le crépuscule d’une expérience d’autonomie et d’écologie (reporterre.net)
Un rêve brisé ? L’espoir des Kurdes de Syrie de vivre dans une région semi-autonome ou fédérale semble s’être brisé face au rouleau compresseur de l’armée syrienne. Comme un domino sanglant, les territoires sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), à majorité kurde, sont tombés les uns après les autres dans les mains du gouvernement d’Ahmed el-Cheraa.
- Dans l’État de Bayelsa, la pollution en héritage (afriquexxi.info)
Au cœur du delta du Niger, dans l’État de Bayelsa, les marées noires façonnent le quotidien des communautés riveraines. Sabotages, infrastructures vieillissantes et retrait des compagnies pétrolières nourrissent un désastre environnemental durable et largement impuni.
- Big Tech is racing to own Africa’s internet (restofworld.org)
Amazon has joined Starlink, Google, and Meta in the scramble to control how Africa goes online.
- MAYDAY from the airwaves : Belarus begins a death penalty purge of radio amateurs (steanlab.medium.com)
Behind the absurdity of charging Baofeng users with ’High Treason‘ lies a terrifying intellectual genocide and an urgent call for international solidarity
- In Belgium, locals offer refugees a place to stay (voxeurop.eu)
In Brussels, grassroots solidarity is putting roofs over the heads of refugees and helping them with paperwork. The results are encouraging, but such initiatives cannot solve the structural problems faced by refugees and asylum seekers.
- Forum de Davos : le nombre de trajets en jet privé empire d’année en année (reporterre.net)
Une avalanche de jets privés au Forum économique mondial. Chaque année, banquiers, patrons de multinationales, milliardaires, puissants responsables politiques et intellectuels influents se réunissent par centaines à Davos, ville des Alpes suisses, soi-disant pour « améliorer l’état du monde ». Problème : bon nombre d’entre eux n’hésitent pas à exploser leur empreinte carbone pour s’y rendre.
- Spyware Document Pool (edri.org)
Spyware is one of the most serious threats to fundamental rights, democracy and civic space across Europe. This document pool brings together EDRi’s analysis, advocacy, research, and curated third-party resources as part of our push for a full EU-wide ban on spyware.
- En Angleterre, une plage recouverte de… frites surgelées et d’oignons (huffingtonpost.fr)
Cette marée alimentaire d’un nouveau genre est due à l’échouage de plusieurs conteneurs maritimes quelques jours plus tôt.
- Ireland wants to give its cops spyware, ability to crack encrypted messages (theregister.com)
- Groenland : la dette américaine, arme de dissuasion massive pour l’Europe ? (france24.com)
Un fonds de pension danois vient de montrer la voie. L’AkademikerPension a annoncé, mardi 20 janvier, son intention de se délester de 100 millions de dollars d’obligations du Trésor américain.
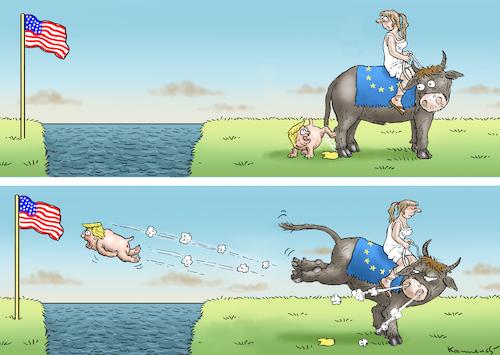
- À quoi ressemble Sirius, l’unité d’élite danoise chargée de protéger le Groenland ? (slate.fr)
- Donald Trump estime qu’il n’est “plus tenu de penser uniquement à la paix”, car il n’a pas reçu le prix Nobel (franceinfo.fr)
Un journaliste américain a révélé le message adressé par le président des Etats-Unis au Premier ministre norvégien, pour évoquer le sort du Groenland, dans lequel il se montre passablement vexé.
Voir aussi Dans un message au Premier ministre norvégien, Trump explique se sentir légitime d’annexer le Groenland car il n’a pas obtenu le prix Nobel de la paix (legrandcontinent.eu)
- A melting Greenland is easier to exploit — but also more perilous (grist.org)
Climate change is opening up previously inaccessible land and sea, boosting global interest in Greenland.
- Sur près de 60 pays invités, seulement 19 ont rejoint le « Conseil de la paix » de Trump (legrandcontinent.eu)
La France, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni et la Slovénie ont refusé d’accepter l’invitation de Trump.
Voir aussi Le « Conseil de la paix » de Trump ne pèse que 24 % du PIB mondial — soit trois fois moins que le G20 (legrandcontinent.eu)
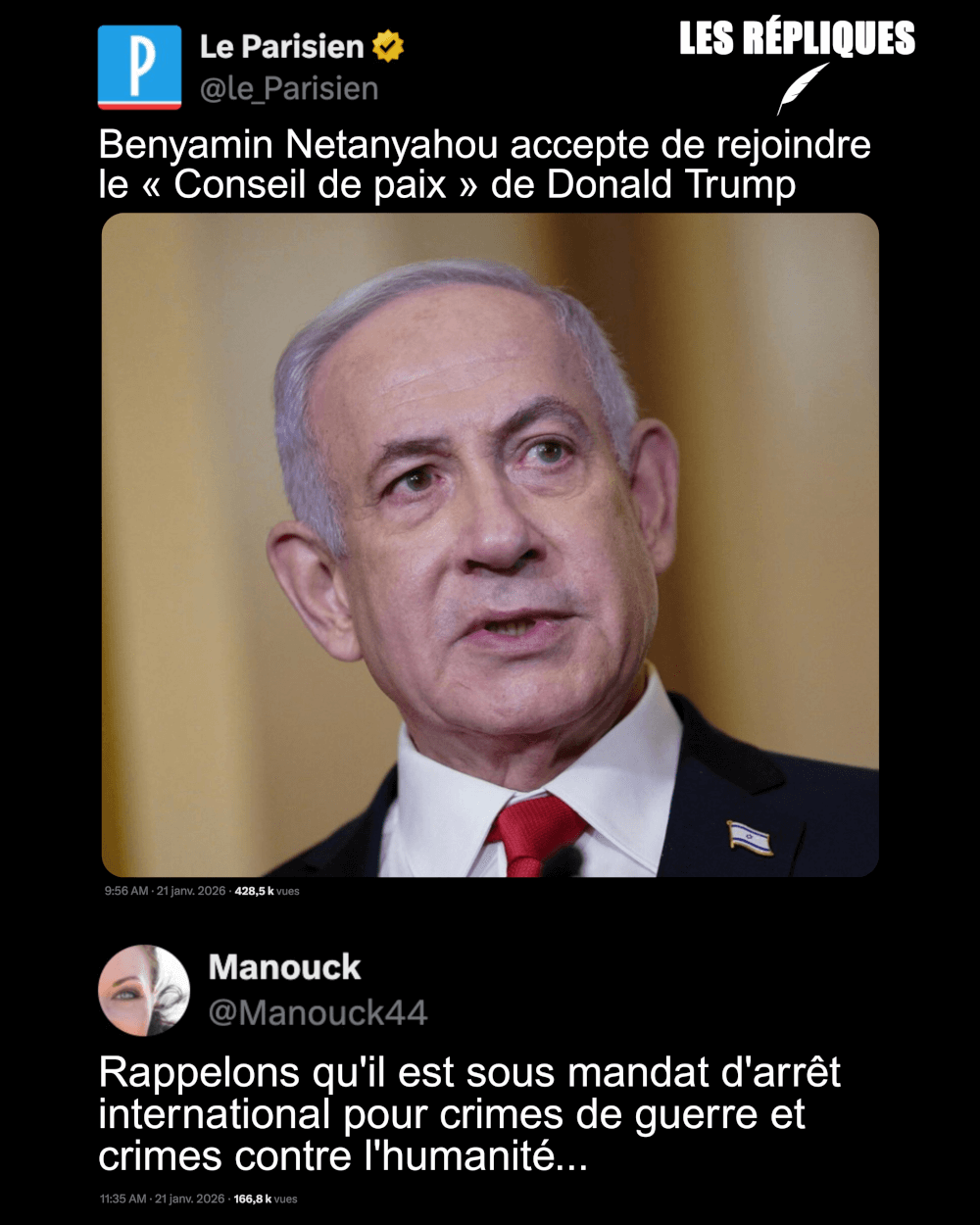
- « Je vais mettre 200 % de droits de douane sur ses vins et champagnes » : Trump menace Macron après le refus de la France de participer à son « Conseil de paix » (humanite.fr)
- « Deal » entre Donald Trump et l’Otan : après le Venezuela, les États-Unis bientôt aux commandes des ressources du Groenland ? (humanite.fr)
Un accord-cadre, négocié par le secrétaire général de l’Otan, donnerait à Washington la souveraineté sur ses bases militaires, ainsi que l’accès à des ressources minérales critiques du Groenland.
- Un homme entraîne des corneilles à attaquer les casquettes MAGA (slate.fr)
- L’ICE va-t-elle provoquer une grève générale dans le Minnesota ? (contretemps.eu)
- Contre l’ICE et malgré le froid glacial, Minneapolis redouble d’ingéniosité et de solidarité (huffingtonpost.fr)
Déterminés à ne pas se laisser faire par la police de l’immigration aux ordres de Donald Trump, les habitants de Minneapolis ont développé des réseaux de résistance.
- Après Renee Good, un homme tué à Minneapolis par des agents fédéraux (huffingtonpost.fr)
La ville du Minnesota est secouée depuis plusieurs jours par des manifestations contre l’ICE, la police de l’immigration.

- Minneapolis Responds to the Murder of Alex Pretti (crimethinc.com)
- Comment un champion du CAC40 aide l’ICE de Trump à traquer les migrant·es (multinationales.org)
ICE, la milice anti-migrant·es de Trump, est à nouveau au centre de l’actualité depuis l’assassinat de Renee Good à Minneapolis. De nombreuses entreprises profitent à plein de l’expansion du budget et des activités de cette agence, dont un groupe du CAC 40 : Capgemini.
- Judge orders stop to FBI search of devices seized from Washington Post reporter (arstechnica.com)
It may be only a temporary reprieve for the Post and reporter Hannah Natanson, however. […] Natanson herself isn’t the subject of investigation, but the FBI executed a search warrant at her home and seized her work and personal devices last week as part of an investigation into alleged leaks by a Pentagon contractor.
- FBI’s Washington Post Investigation Shows How Your Printer Can Snitch on You (theintercept.com)
Workplace printers don’t just track file names — in some cases, they can recall the exact contents of any file they print.
- Smart TV : captures d’écran, revente de données, une “surveillance” devant les tribunaux (clubic.com)
Depuis plusieurs années, la collecte de données par les téléviseurs connectés est surtout documentée dans des rapports d’experts et des enquêtes spécialisées. Un sujet connu des initiés, mais largement invisible pour le grand public. Cette fois, le débat change de dimension : la justice américaine s’en empare.
- Millions of people imperiled through sign-in links sent by SMS (arstechnica.com)
Even well-known services with millions of users are exposing sensitive data. A paper published last week has found more than 700 endpoints delivering such texts on behalf of more than 175 services that put user security and privacy at risk.
- Spotify won court order against Anna’s Archive, taking down .org domain (arstechnica.com)
Lawsuit was filed under seal ; Anna’s Archive wasn’t notified until after takedown.
- L’« enshittification » en cinq étapes des publications scientifiques (theconversation.com)
Devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars, l’édition académique adopte des mécanismes proches de ceux des géants du numérique. Revues commerciales, frais de publication et indicateurs de performance redessinent en profondeur le paysage de la recherche.
- Airlines cancel more than 13,000 weekend flights as massive winter storm sweeps across the U.S. (cnbc.com)
- Flesh-eating flies are eating their way through Mexico, CDC warns (arstechnica.com)
The alert provides guidance on what to do if any such festering wounds are encountered—namely, remove each and every maggot to prevent the patient from dying, and, under no circumstance allow any of the parasites to survive and escape.
- On pourrait renforcer les astronautes avec de l’ADN de tardigrade… mais c’est pas encore franchement au point (slate.fr)
Spécial IA
- Intel struggles to meet AI data center demand, shares drop 13 % (reuters.com)
Intel executives said the company was caught off guard by surging demand for server central processors that accompany AI chips. Despite running its factories at capacity, Intel cannot keep up with demand for the chips, leaving profitable data center sales on the table while the new PC chip squeezes its margins.
- NVIDIA Contacted Anna’s Archive to Secure Access to Millions of Pirated Books (torrentfreak.com)
Anna’s Archive then warned Nvidia that its library was illegally acquired and maintained. Because the site previously wasted time on other AI companies, the pirate library asked NVIDIA executives if they had internal permission to move forward.This permission was allegedly granted within a week, after which Anna’s Archive provided the chip giant with access to its pirated books.
- Wikipedia volunteers spent years cataloging AI tells. Now there’s a plugin to avoid them. (arstechnica.com)
On Saturday, tech entrepreneur Siqi Chen released an open source plugin for Anthropic’s Claude Code AI assistant that instructs the AI model to stop writing like an AI model. Called “Humanizer,” the simple prompt plugin feeds Claude a list of 24 language and formatting patterns that Wikipedia editors have listed as chatbot giveaways.
- Your Brain on ChatGPT : Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task (arxiv.org)
Self-reported ownership of essays was the lowest in the LLM group and the highest in the Brain-only group. LLM users also struggled to accurately quote their own work. While LLMs offer immediate convenience, our findings highlight potential cognitive costs. Over four months, LLM users consistently underperformed at neural, linguistic, and behavioral levels.
- Latest ChatGPT model uses Elon Musk’s Grokipedia as source, tests reveal (theguardian.com)
Guardian found OpenAI’s platform cited Grokipedia on topics including Iran and Holocaust deniers
- Asking Grok to delete fake nudes may force victims to sue in Musk’s chosen court (arstechnica.com)
The latest estimates show that perhaps millions were harmed in the days immediately after Elon Musk promoted Grok’s undressing feature on his own X feed by posting a pic of himself in a bikini. Over just 11 days after Musk’s post, Grok sexualized more than 3 million images, of which 23,000 were of children
- Korea sets AI safety rules, first in world (koreaherald.com)
South Korea will begin enforcing its Artificial Intelligence Act on Thursday, becoming the first country to formally establish safety requirements for high-performance — or so-called frontier, AI systems — a move that sets the country apart in the global regulatory landscape.
- À Davos, la Chine est le grand épouvantail des leaders de l’IA générative (next.ink)
- Anthropic Updates Claude’s ‘Constitution,’ Just in Case Chatbot Has a Consciousness (gizmodo.com)
- Computers can’t surprise (aeon.co)
As AI’s endless clichés continue to encroach on human art, the true uniqueness of our creativity is becoming ever clearer
- Why We Need Tech Lawyers to Shine Again (technollama.co.uk)
In courtrooms across the globe, a quiet crisis is brewing. As the number of artificial intelligence copyright litigations increases, judges are being asked to decide the fate of technologies that often operate in dimensions the human mind struggles to visualise accurately. From the High Court in London to the Munich Regional Court, the central question is no longer just “Who owns this ?” but “How does this actually work ?”
- AI boom could falter without wider adoption, Microsoft chief Satya Nadella warns (irishtimes.com)
Big tech boss tells delegates at Davos that broader global use is essential if technology is to deliver lasting growth
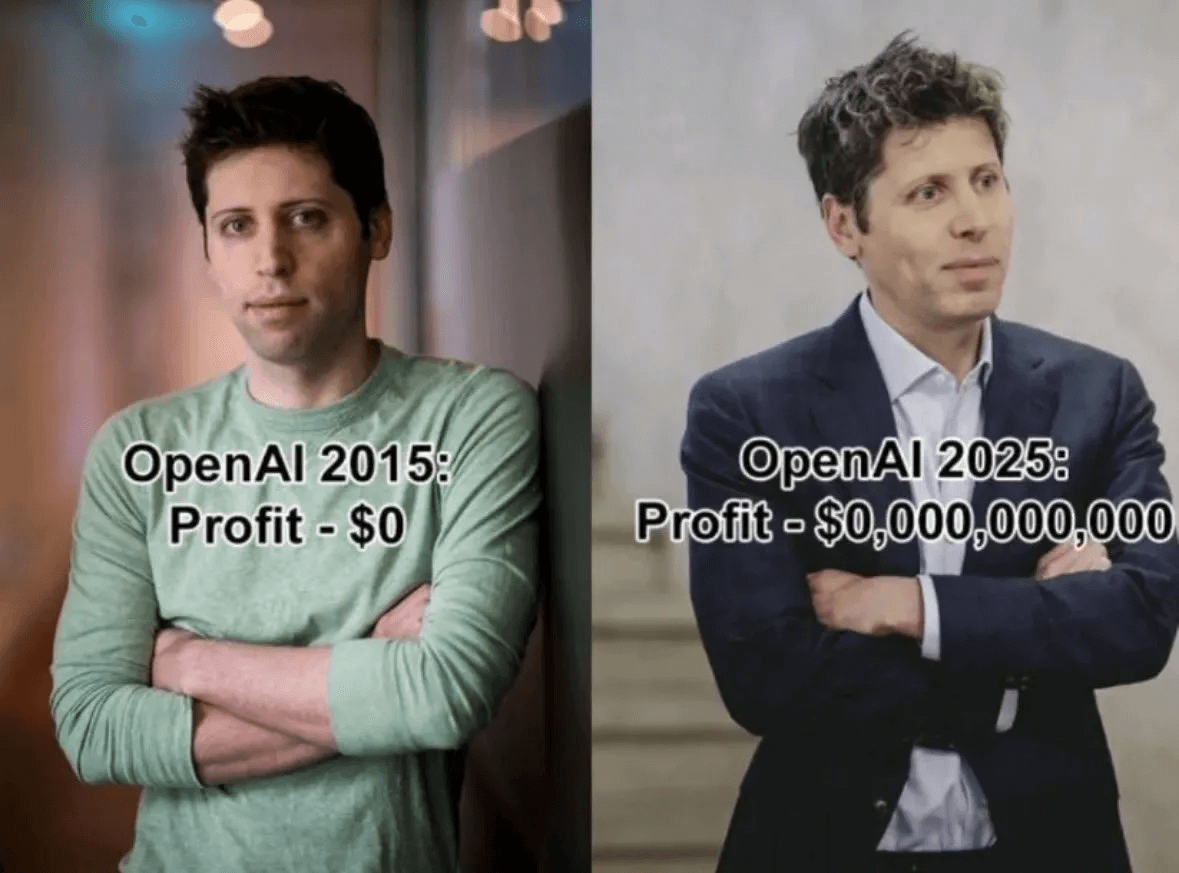
- The Microsoft-OpenAI Files : Internal documents reveal the realities of AI’s defining alliance (geekwire.com)
- Comment les entreprises de la tech nous forcent à utiliser l’IA (limitesnumeriques.fr)
- ‘AI’ is a dick move, redux (baldurbjarnason.com)
Debating people who look past “chatbot psychosis”, the dismantling of the education system, the gendered abuse, the generated CSAM images, the overt attacks on the media industries, or the ultra-right’s glee about “AI”, by showing them a well-constructed academic study is never going to work. […] Somebody who is capable of looking past “ICE is using LLMs as accountability sinks for waving extremists through their recruitment processes”, generated abuse, or how chatbot-mediated alienation seems to be pushing vulnerable people into psychosis-like symptoms, won’t be persuaded by a meaningful study.
- The Computational Web and the Old AI Switcharoo (fromjason.xyz)
Artificial intelligence, manifested in Chatbots and agents, isn’t the product. The product is the trillion-dollar data center kingdoms required to power those bots. ChatGPT might be OpenAI’s Ford F150, but datacenters are Microsoft’s gasoline. Without Microsoft’s infrastructure, ChatGPT is a $500 billion paperweight. I don’t know when Sam Altman realized AI is just a means to sell retail compute to the masses. Probably just before the ink dried on the pair’s partnership agreement.
- La destruction créancière du capital fictif. Bulle de l’intelligence artificielle et mystère de la rentabilité (contretemps.eu)
Spécial Palestine et Israël
- Malgré le cessez-le-feu, la justice reconnaît que les Palestinien·nes de Gaza sont toujours persécuté·es par Israël (politis.fr)
Le 19 décembre, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu dans une décision importante que, malgré le « cessez-le-feu », les Palestiniens de Gaza étaient toujours en danger en raison de leur nationalité. Il y a un mois, Mariam, jeune femme palestinienne, a obtenu le statut de réfugié. Elle témoigne.
- UN accuses Israel of ‘unprecedented attack’ as diggers start demolishing UNRWA site (news.sky.com)
The UN Palestinian refugee agency’s former chief of staff says the move is “another message to the world that Israel is the only country that can demolish international law and get away with it”.
- À Gaza, trois journalistes dont un collaborateur de l’AFP tués par une frappe israélienne (huffingtonpost.fr)
L’attaque a eu lieu dans le centre de l’enclave palestinienne, l’armée israélienne assure avoir ciblé les opérateurs « suspects » d’un drone « affilié au Hamas ».
- Utopie génocidaire : Trump annonce la deuxième phase de son plan colonial pour Gaza (revolutionpermanente.fr)
Après la création d’un comité technocratique palestinien chargé de gérer les affaires courantes à Gaza, Trump a présenté le conseil d’administration colonial, composé des figures de l’internationale réactionnaire, qui règnera sur les ruines de Gaza.
Spécial femmes dans le monde
- Les violences faites aux femmes augmentent elles avec le réchauffement climatique ? (bonpote.com)
- « Ni mollahs, ni shah » : les Iraniennes en exil veulent la démocratie (basta.media)
Alors qu’un nouveau mouvement de contestation embrase l’Iran depuis fin décembre, la répression du régime a fait des milliers de morts. En France, des Iraniennes en exil espèrent voir émerger de cette révolte un pays libre, « sans mollahs, ni shah ».
- Migrantes Subsahariennes enceintes : survivre dans l’ombre en Tunisie (nawaat.org)
En Tunisie, des femmes migrantes accouchent dans des conditions précaires, exposant leurs nouveau-nés aux maladies et à la malnutrition. Accusées de contribuer à un prétendu « changement démographique » du pays, elles se heurtent aux obstacles administratifs, au racisme et à la pauvreté.
- Julio Iglesias voit la plainte pour agressions sexuelles le visant classée sans suite (huffingtonpost.fr)
La justice espagnole a classé ce vendredi 23 janvier la plainte pour agressions sexuelles contre le chanteur Julio Iglesias, une superstar mondiale des années 1970 et 1980, le parquet s’estimant incompétent pour juger de faits qui se seraient déroulés aux Bahamas et en République dominicaine.
- Affaire Epstein : les Clinton refusent de témoigner devant le Congrès et déclenchent une escalade politique (huffingtonpost.fr)
Une commission du Congrès américain a voté pour engager une procédure contre Bill et Hillary Clinton, leur refus de comparaître étant jugé comme un acte de défiance.
- Aux États-Unis, ce militant américain d’extrême droite doit son salut à une femme trans (huffingtonpost.fr)
RIP
- Dr. Gladys West, Mathematician Whose Work Made GPS Possible, Dies at 95 (thezebra.org)
- Agnès Bertrand, activiste majeure de l’altermondialisme, s’est éteinte (reporterre.net)
Spécial France
- La France est le pays qui a reçu le plus d’investissements étrangers pour la construction de centres de données en 2025 (legrandcontinent.eu)
Ce montant est deux fois supérieur à celui enregistré aux États-Unis et trois fois supérieur à celui de la Corée du Sud.
- Le géant de l’informatique Capgemini envisage de supprimer 2 400 postes en France (liberation.fr)
Le groupe hexagonal, qui invoque un ralentissement de ses clients dans l’industrie et le développement de nouvelles activités, assure que tout se fera sur la base du volontariat, par des réorientations internes ou une rupture conventionnelle collective.
- Le groupe parlementaire de la France insoumise propose de sortir de l’OTAN (lafranceinsoumise.fr)
Le groupe parlementaire de la France insoumise dépose ce lundi 19 janvier une proposition de résolution invitant le Gouvernement à organiser le retrait de la France de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), en commençant par son commandement intégré.
- Au Sénat, une commission d’enquête visant Pierre-Édouard Stérin s’organise (basta.media)
Validée par la commission des lois du Sénat le 14 janvier, une commission d’enquête initiée par les socialistes vise l’écosystème du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Sa composition vient d’être dévoilée.
- Patrick Balkany renvoyé en procès pour détournement de fonds publics (franceinfo.fr)
L’audience aura pour but de fixer la date du jugement au fond de cette affaire concernant des faits qui s’étaient déroulés lorsque l’homme politique était maire de Levallois-Perret.
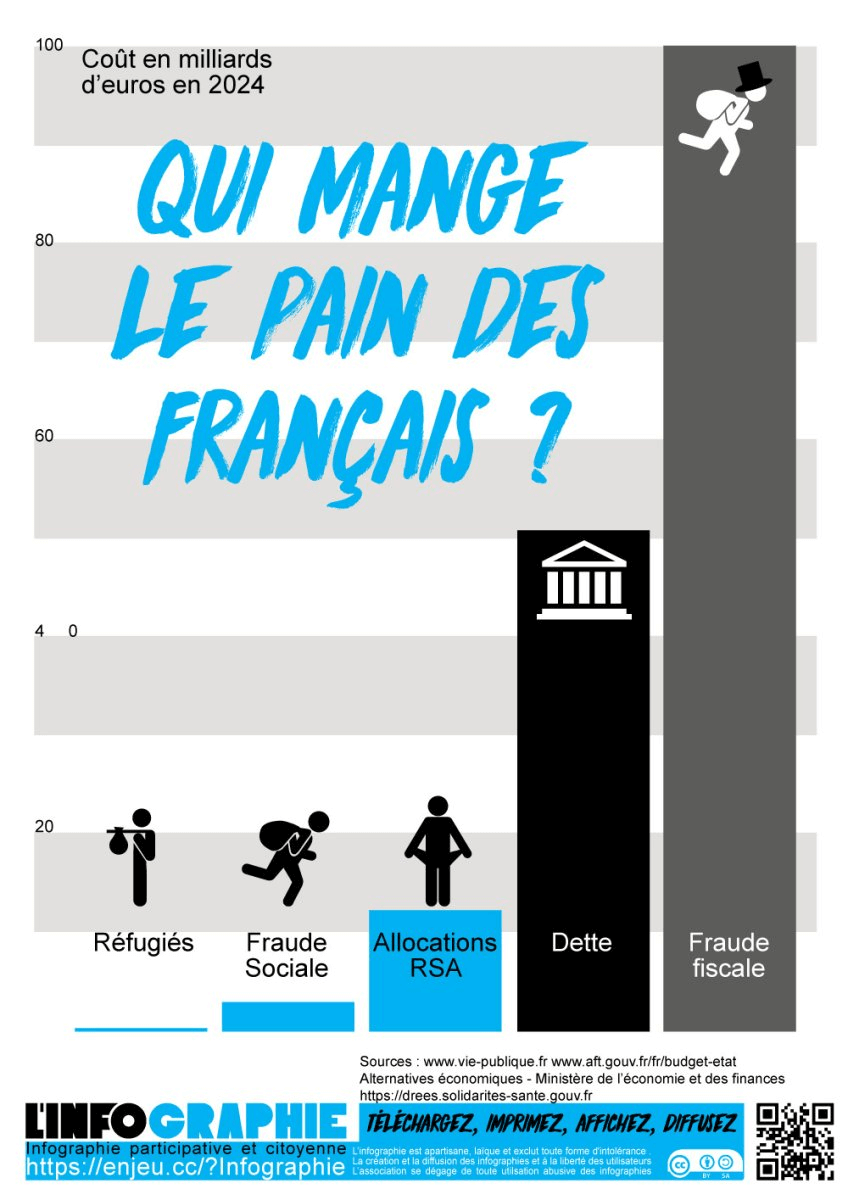
- Fin de vie : le Sénat a vidé la proposition de loi en supprimant un article clé dès le deuxième jour des débats (huffingtonpost.fr)
Les sénateurs ont fait sauter un article sur les conditions requises pour accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie, confirmant les réticences de la chambre haute face au texte.
- Un morceau de la tapisserie de Bayeux volé par les nazis revient en France (humanite.fr)
Symbole de « pureté aryenne » pour les nazis, le peuple normand les a passionnés… Au point de voler un précieux morceau de leur patrimoine. Le fragment retrouvé par hasard en 2023 a été rendu à Bayeux le 14 janvier dernier.
- La SNCF choque la Haute-commissaire à l’enfance avec ce nouveau service interdit aux moins de 12 ans (huffingtonpost.fr)
La nouvelle classe « Optimum » entend offrir un « espace calme » et sans enfants aux voyageurs, Sarah El Haïry juge que le signal adressé aux familles est « brutal ».
- Forêts des Landes : un petit ver entraîne l’abattage de milliers de pins (reporterre.net)
- Biodiversité : test de fermeture hivernale de la pêche, comment vont les dauphins du golfe de Gascogne ?(humanite.fr)
Le Conseil d’État avait ordonné 30 jours de fermeture du golfe de Gascogne à certains types de pêche en hiver, de 2024 à 2026, pour protéger les petits cétacés des captures accidentelles dans les filets. Des mesures sont expérimentées pour les réduire sans interrompre la pêche, mais les données sont encore insuffisantes.
Spécial femmes en France
- Mais que sont devenues les femmes ministres sous Sarkozy et Hollande ? (20minutes.fr)
- À la SNCF, des violences sexistes et sexuelles tolérées, des victimes mises à l’écart (basta.media)
La SNCF affiche une politique de « tolérance zéro » face au harcèlement sexuel et aux agressions. Plusieurs femmes témoignent pourtant d’un renversement de la culpabilité à leur défaveur. Leurs récits mettent en lumière des défaillances à répétition.
Voir aussi La SNCF face aux violences sexuelles : une direction « de l’éthique » à la gestion opaque (basta.media)
C’est un rouage clé dans le traitement, par la SNCF, des affaires de violences sexistes et sexuelles : la direction de l’éthique. Le service mène des enquêtes internes. Mais son fonctionnement est mis en cause pour ses manquements.
- Les femmes sont moins adeptes du vélo que les hommes, et cela cache un vrai problème (huffingtonpost.fr)
41 % d’entre elles déclarent avoir déjà été confrontées à des comportements agressifs et/ou sexistes […] 39 % ont dû essuyer des mises en danger routières comme des frôlements, des refus de priorité ou des dépassements dangereux, 24 % du harcèlement sexiste (sifflements, « drague » insistante, poursuites, blocages…) et 9 % des violences physiques ou sexuelles (attouchements, agression…).
- Violences sexistes et sexuelles : quand le patriarcat ronge les milieux militants (lisbethmedia.com)
Manipulation des faits, retournement de culpabilité, discrédit de la parole des victimes, captation du pouvoir symbolique : autant de stratégies de domination bien connues, qui structurent les rapports de force à l’échelle des États, des entreprises, des associations ou encore des relations inter-personnelles, y compris à gauche.
- Culture du viol, masculinisme… C’est quoi le « sexisme hostile », auquel adhèrent 10 millions de Français (humanite.fr)
Le dernier rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes dresse un état des lieux préoccupant du sexisme en France. Entre paternalisme, violences banalisées, haine en ligne et montée du masculinisme, l’étude révèle une idéologie toujours plus structurée.
Spécial médias et pouvoir
- Venezuela : quand l’éditocratie légitime l’impérialisme (acrimed.org)
Défendre le droit international ou appuyer l’impérialisme étatsunien ? Les éditorialistes ont tranché.
- Praud et Morandini : sur CNews, une semaine absolument normale (politis.fr)
Des propos racistes le mardi par l’un, une condamnation définitive envers l’autre le mercredi, un maintien dudit condamné à l’antenne le jeudi : rien à signaler sur la chaîne d’info d’extrême droite de Vincent Bolloré.
- Procès des droites contre les indés : un hiver bien rempli (portail.basta.media)
Les mois de décembre 2025 et janvier 2026 ont été chargés en procédures judiciaires pour les médias indépendants. Tandis qu’une rédaction du pays d’Arles est confrontée à un « procès-bâillon » intenté par l’extrême droite, trois autres médias locaux ont récemment célébré une victoire. Leur point commun : des plaignants identifiés comme de droite ou d’extrême droite.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Les 53 milliardaires français·es ont doublé leur fortune depuis l’arrivée de Macron au pouvoir (lareleveetlapeste.fr)
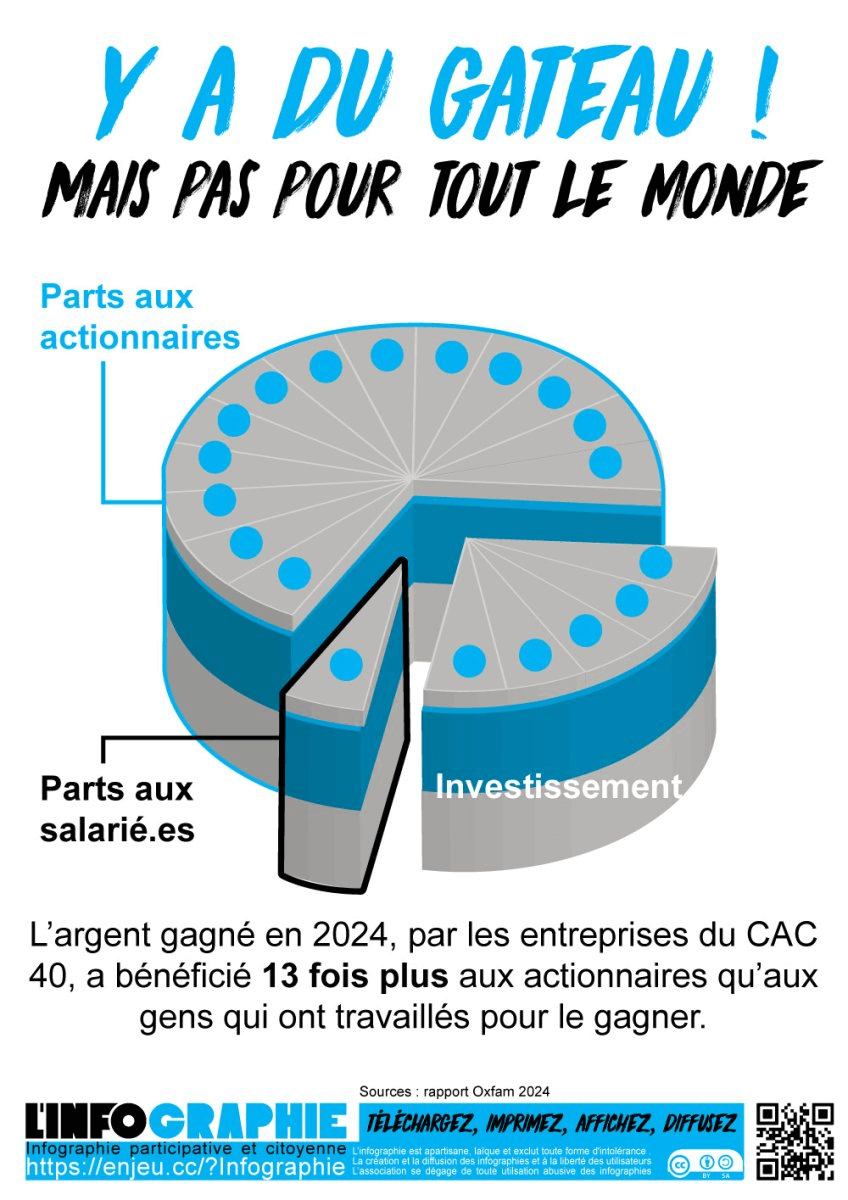
- Sébastien Lecornu va finalement recourir au 49.3 pour faire adopter le budget de l’État pour 2026 (huffingtonpost.fr)
- Budget : les deux motions de censure rejetées, Lecornu déclenche un deuxième 49.3 sur la partie « dépenses » du PLF (humanite.fr)
Celle de l’extrême droite était vouée à l’échec, la gauche ne comptant pas y mêler ses voix, elle n’a obtenu que 142 suffrages. Quant à celle déposée par Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain, Stéphane Peu et 108 de leurs collègues, moins de 20 voix lui ont fait défaut pour atteindre la majorité de 288 votes nécessaire pour faire tomber le gouvernement.
- « Le gouvernement a décidé de tout démanteler » : le monde du vélo sonné par les coupes budgétaires (reporterre.net)
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Recensement 2026 : une nouvelle question fait polémique sur le questionnaire (capital.fr)
La période du recensement annuel a débuté en France depuis le 15 janvier. Pour connaître le nombre d’habitants dans l’Hexagone, les personnes devant être recensées doivent répondre à un questionnaire d’une trentaine de questions. Parmi elles, l’une fait polémique et concerne le lieu de naissance des parents.
- Whatsapp, Signal et Telegram ouverts à la police française ? Le chiffrement des messageries encore menacé (01net.com)
C’est un Graal derrière lequel courent bon nombre d’hommes et de femmes politiques : permettre aux forces de l’ordre et au renseignement d’accéder aux conversations des messageries chiffrées comme WhatsApp et Signal, jusqu’ici inaccessibles. Et si Gérald Darmanin, aujourd’hui ministre de la Justice, a déjà demandé, ces dernières années, des voies pour passer outre le chiffrement des plateformes, c’est désormais le cas de Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Le Monde révèle ainsi, ce jeudi 22 janvier, la publication d’un décret au Journal officiel, mercredi 21 janvier. Au premier abord, son objectif est anodin – il s’agit de « charger un député d’une mission temporaire ». Mais la mission en question a, en fait, trait aux « politiques publiques de sécurité à l’ère numérique ».
- Groupuscules, partis, institutions : les droites en guerre contre les librairies indépendantes (blast-info.fr)
- Au sujet des agressions fascistes de jeudi dernier au Centre Culturel Libertaire de Lille (ripostes.org)
Le centre culturel libertaire (CCL) a été la cible d’une attaque menée par un groupuscule d’extrême droite peu avant le début d’un concert. En quelques minutes, huit individus ont frappé plusieurs personnes, brisé tout sur leur passage et filmé leur méfait.
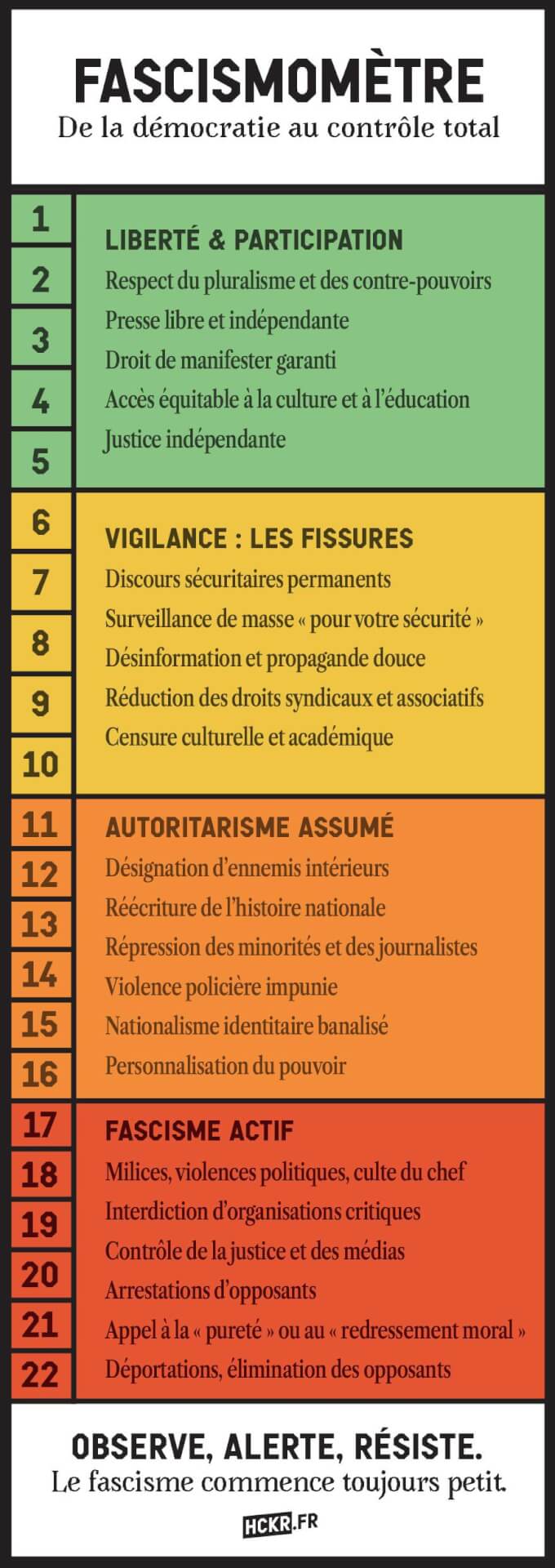
- Une présomption de légitime défense des policiers serait synonyme d’impunité (politis.fr)
Une tribune s’inquiète d’une proposition de loi instituant une présomption d’usage légitime de l’arme par les policiers, ce qui serait un changement majeur dans l’appréhension des critères qui protègent le citoyen du risque létal.
- À Mayotte, de graves violences policières passées sous silence (blast-info.fr)
En juillet dernier, deux incidents graves ont impliqué la Police aux frontières à Mayotte : un homme blessé par balle dans le dos et une embarcation clandestine retournée dans le lagon après un choc avec un patrouilleur. Dans les deux cas, la version officielle tranche avec celle des victimes. Et si des enquêtes préliminaires ont été ouvertes, tout laisse à penser que ces affaires seront enterrées.
- Scandale : le gouvernement veut compter les prisons comme logements sociaux (confederationnationaledulogement.fr)
- Cafards, surpopulation, enfants enfermés : les révélations de la contrôleuse générale des prisons (lemediatv.fr)
Spécial résistances
- « On reconnaît les méthodes des harceleurs » : des cheminotes aident les victimes de la SNCF (basta.media)
Dégoûtées par le traitement des affaires de harcèlement sexuel ou moral au sein de la SNCF, deux cheminotes ont créé, en 2022, l’association Stop harcèlement ferroviaire. Elles recueillent la parole de leurs collègues et les aident face à l’entreprise.
- Un rassemblement pour qu’Ary Abittan ne joue pas son spectacle « en toute impunité » (blogs.mediapart.fr)
Les militantes des Tricoteuses hystériques, collectif féministe originaire de Montpellier, seront présentes jeudi 22 janvier, à partir de 19 heures, pour protester contre la venue de l’acteur, accusé de viol en 2021. Alors que le spectacle demeure maintenu, elles appellent au rassemblement.
- “Votre cloud, notre fournaise” : résister à la dématérialisation depuis Marseille (terrestres.org)
- Algorithme discriminatoire de notation de la CNAF : 10 nouvelles organisations se joignent à l’affaire devant le Conseil d’État (laquadrature.net)
- « Le prosulfocarbe n’a plus sa place sur le marché français » : très volatil, l’herbicide toxique a été relevé au-delà de la limite réglementaire dans les jardins du Loir-et-Cher (humanite.fr)
Un rapport de Générations Futures démontre une pollution généralisée des jardins du Loir-et-Cher au prosulfocarbe, un herbicide extrêmement volatil et toxique. L’ONG et les agriculteurs bio du territoire exige son retrait du marché.
Spécial outils de résistance
- Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches (oxfamfrance.org)
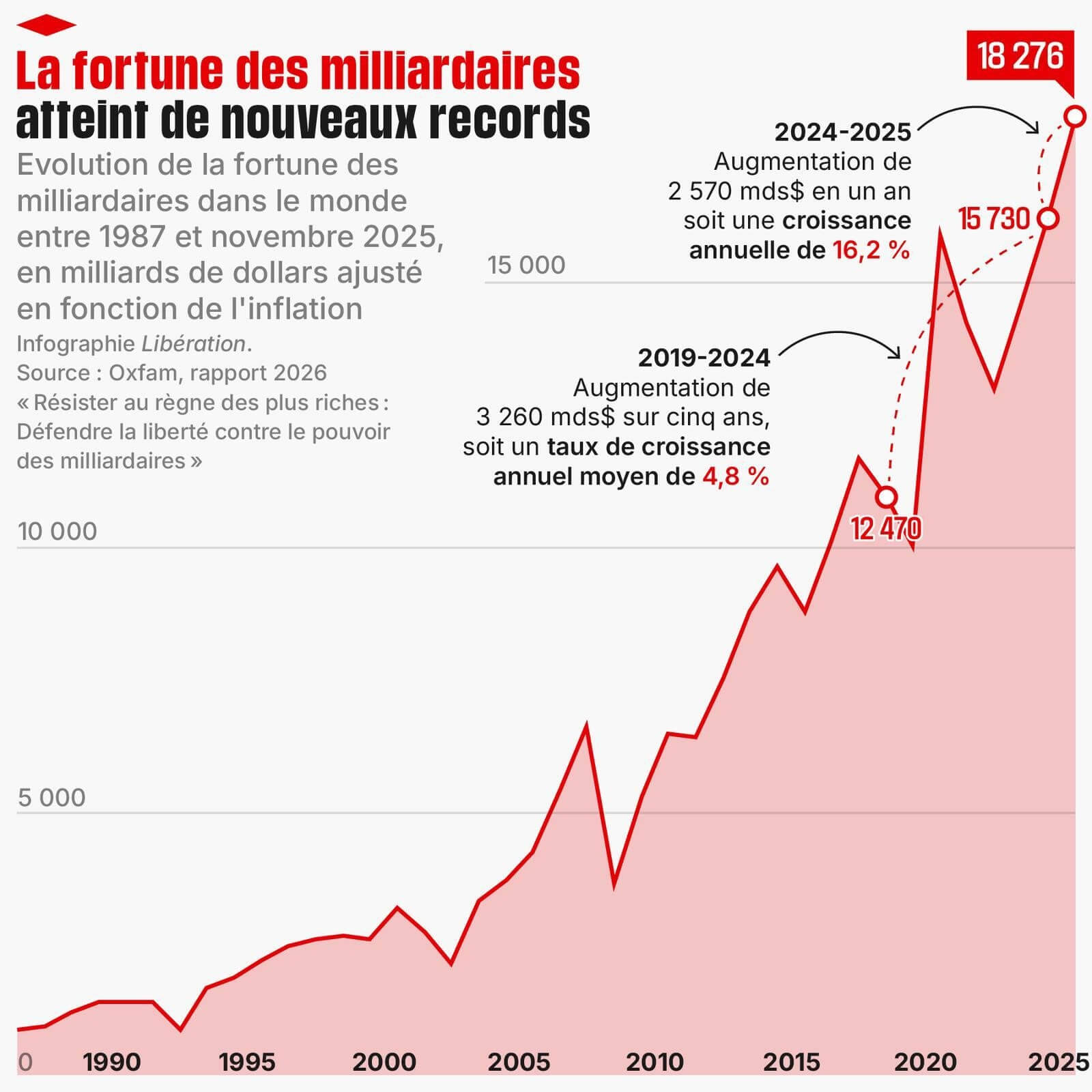
- From Rapid Response to Revolutionary Social Change (crimethinc.com)
- Ne manquez pas cette occasion de dire à Mozilla ce que vous voulez (formulaire fortement biaisé en faveur de l’IA mais détournable) (mozillafoundation.tfaforms.net)
- FantomApp : l’application de la CNIL pour aider les 10-15 ans à se protéger sur les réseaux sociaux (cnil.fr)
Tout au long de son développement, des collégiens ont été associés au projet, cette démarche collaborative a permis de concevoir une application réellement pensée par et pour les jeunes. FantomApp s’appuie sur leurs pratiques et valorise leurs propres compétences numériques, afin de les aider à développer les bons réflexes
Spécial GAFAM et cie
- Google vient de lever le voile : installer des applications hors Play Store va devenir un parcours du combattant (clubic.com)
- Google adds your Gmail and Photos to AI Mode to enable “Personal Intelligence” (arstechnica.com)
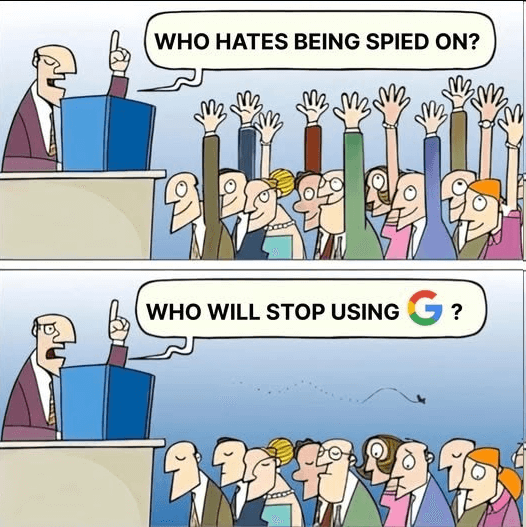
- Google AI Overviews cite YouTube more than any medical site for health queries, study suggests (theguardian.com)
- Meta wants to block data about social media use, mental health in child safety trial (arstechnica.com)
Company is pulling out all the stops to protect itself in advance of New Mexico trial.
- Apple Reportedly Replacing Siri Interface With Actual Chatbot Experience For iOS 27 (apple.slashdot.org)
- Microsoft confirms it will give the FBI your Windows PC data encryption key if asked — you can thank Windows 11’s forced online accounts for that (windowscentral.com)
- TikTok évite son interdiction aux États-Unis grâce à la création d’une coentreprise (france24.com)
Les activités de Tiktok aux États-Unis seront désormais gérées par une coentreprise détenue par une majorité d’investisseurs américains, dont plusieurs riches soutiens du président Donald Trump. Le réseau social chinois évite ainsi d’être interdit sur le sol américain.
- TikTok Is Now Collecting Even More Data About Its Users. Here Are the 3 Biggest Changes (wired.com)
- French response : quand la diplomatie française colle à l’ambiance de X (next.ink)
La diplomatie française a intensifié son utilisation du compte French response pour ne pas laisser passer les attaques étrangères sur le réseau social d’Elon Musk. Ce compte réagit aussi aux attaques politiques du milliardaire états-unien comme du CEO de Telegram Pavel Durov.
Les autres lectures de la semaine
- Algérie, Angola, Mozambique… Un cheminement décolonial commun (afriquexxi.info)
L’année 2025 a marqué le cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Angola et du Mozambique vis-à-vis du Portugal. L’histoire de leurs guerres respectives de libération nationale reste peu connue du grand public, tout comme le rôle important qu’y a joué l’Algérie.
- Du technocapitalisme aux Venture Capitals : la grande transformation des industries de défense (theconversation.com)
- Chasse aux migrants, DOGE, techno-fascisme… Retour sur un an de trumpisme perfusé aux multinationales (multinationales.org)
Il y a tout juste un an, Donald Trump faisait son grand retour à la Maison Blanche. Ce retour aux affaires a galvanisé les forces les plus réactionnaires, et entraîné une reconfiguration profonde de la donne géopolitique et des relations entre l’économique et le politique, l’argent et le pouvoir.
- The Trump administration has a Nazi problem : (theguardian.com)
- Fascisation et stratégie. Entretien avec Ugo Palheta (contretemps.eu)
La France vit-elle un processus de fascisation ? C’est la thèse proposée par Ugo Palheta, qui explique dans son dernier livre – Comment le fascisme gagne la France (éditions La Découverte) – en quoi le règne d’Emmanuel Macron, et plus généralement le capitalisme néolibéral, prépare les conditions d’avènement d’un fascisme du 21e siècle.
- L’engagement des antifas en France (laviedesidees.fr)
- Who gets to inherit the stars ? A space ethicist on what we’re not talking about (techcrunch.com)
- L’affaire Nicolas Guillou, ou quand Washington bascule votre vie en mode 404 (ladn.eu)
La « mort numérique » du juge Guillou a fait voler en éclats le mythe de la souveraineté européenne : nous sommes à la merci technologique des États-Unis. Le constat de dépendance acté – maintenant, on fait quoi ?
- Idées reçues à propos de l’accessibilité numérique (ideance.net)
- Interdire les réseaux aux moins de 15 ans, la fausse bonne idée (humanite.fr)
- What Happens When Mortals Try to Drink Winston Churchill’s Daily Intake of Alcohol (openculture.com)
- Discover the World’s First Earthquake Detector, Invented in China 2,000 Years Ago (openculture.com)
- Macaque facial gestures are more than just a reflex, study finds (arstechnica.com)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Record
- Évolution
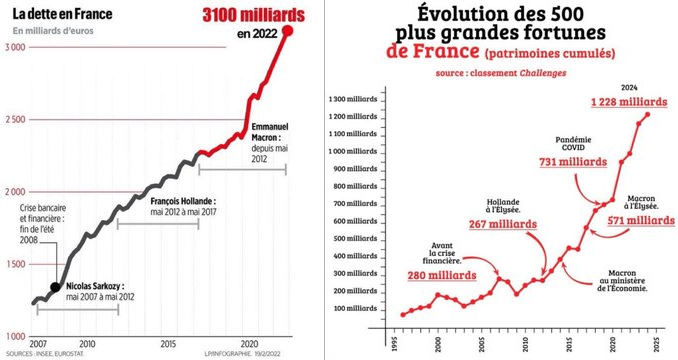
- Gâteau
- Pain
- Répartition
- Liberty
- Healthcare
- Comparaison
- Communist
- Tax
- OpenAI
- NoKings
- Trump
- Rappel
- Fascismomètre
- Chier
- Médias français : qui possède quoi ? (acrimed.org)
- Plongée dans le déni climatique hexagonal, illustré par une cartographie interactive (portail.basta.media)
- Social Network User Data Storage : Fediverse (arewedecentralizedyet.online)
- Café ou thé
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Budget 2026 : le PS se félicite du 49.3, LFI et le RN préparent la riposte (radiofrance.fr)
- Logement social : notre enquête sur le vrai visage de Rachida Dati (humanite.fr)
- Affronter le néofascisme avec Herbert Marcuse (spectremedia.org)
- Brainwashed : le sexisme au cinéma (arte.tv – disponible jusqu’au 03/04/2026)
Les trucs chouettes de la semaine
- Bitchat is a decentralized peer-to-peer messaging application that operates over bluetooth mesh networks. no internet required, no servers, no phone numbers (bitchat.free)
traditional messaging apps depend on centralized infrastructure that can be monitored, censored, or disabled. bitchat creates ad-hoc communication networks using only the devices present in physical proximity. each device acts as both client and server, automatically discovering peers and relaying messages across multiple hops to extend the network’s reach.
- Bientôt peut-être un nom de domaine en .meow, par et pour la communauté queer ! (dotmeow.org)
- Fedipourgaza (fedipourgaza.org)
Ce n’est pas une organisation, mais un fil tendu entre des inconnu·es qui refusent de détourner les yeux. Une poignée d’humaines et d’humains qui croient qu’il est encore possible de réparer quelque chose du monde, pixel après pixel.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
19.01.2026 à 07:42
Khrys’presso du lundi 19 janvier 2026
Khrys
Texte intégral (10562 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- D’incroyables chutes de neige ont enseveli des maisons entières au Kamtchatka (huffingtonpost.fr)
- Des chercheurs japonais développent un « voyant moteur » pour l’humain, qui clignote quand quelque chose cloche (slate.fr) – voir aussi Glow with the flow : Implanted “living skin” lights up to signal health change (iis.u-tokyo.ac.jp)
- China Builds Wild Gravity Machine (futurism.com)
The futuristic-looking machine, called CHIEF1900, was constructed at China’s Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF) at Zheijang University in Eastern China, and allows researchers to study how extreme forces affect various materials, plants, cells, or other structures
- Coal power generation falls in China and India for first time since 1970s (theguardian.com)
The simultaneous fall in coal-powered electricity in the world’s biggest coal-consuming countries had not happened since 1973, according to analysts at the Centre for Research on Energy and Clean Air, and was driven by a record roll-out of clean energy projects.
- En Inde, un État de 25 millions d’habitant·es passe en 100 % bio (reporterre.net)
- L’Inde veut accéder au code source des smartphones, et c’est un sérieux problème pour Apple (01net.com)
- Au Kirghizstan, un black-out énergétique se profile à cause du réchauffement climatique (reporterre.net)
- Uganda shuts down internet two days before election (restofworld.org)
As President Yoweri Museveni contests for the seventh term, regulators cite misinformation risks for internet shutdown. Rights groups say it undermines free and fair voting.
- 2025 deadliest year for Ukrainian civilians since first year of Russia’s full-scale war, UN says (kyivindependent.com)
- « Nous sommes dans une zone grise, personne ne peut nous aider » : être queer en Ukraine occupée (basta.media)
Dans les territoires d’Ukraine occupés par la Russie, la politique homophobe devient une arme de répression contre la population locale. Témoignages de personnes originaires du Donbass et qui ont dû fuir.
- Rights groups hail acquittal after seven years of aid workers prosecuted during Greece refugee crisis (theguardian.com)
Lesbos court clears aid workers of people smuggling, a move Human Rights Watch called a vindication of their lifesaving activities at sea
- Article by article, how Big Tech shaped the EU’s roll-back of digital rights (corporateeurope.org)
- Law professor sues Germany for ‘illegal’ border controls (euobserver.com)
Border controls aren’t supposed to exist between EU member states – that’s the promise of the 1985 Schengen treaty. Yet today, travelers routinely face checks when crossing borders within the union.
- White supremacist dating site profiles linked to Tory and Reform councillors (observer.co.uk)
“When elected officials show up in these spaces, it stops being private and becomes a public issue,” Root told The Observer. “The goal wasn’t humiliation. It was accountability.”
- Face aux menaces de Trump à l’encontre du Groenland, la France, l’Allemagne, la Suède et la Norvège ont annoncé l’envoi de personnel militaire sur l’île (legrandcontinent.eu)
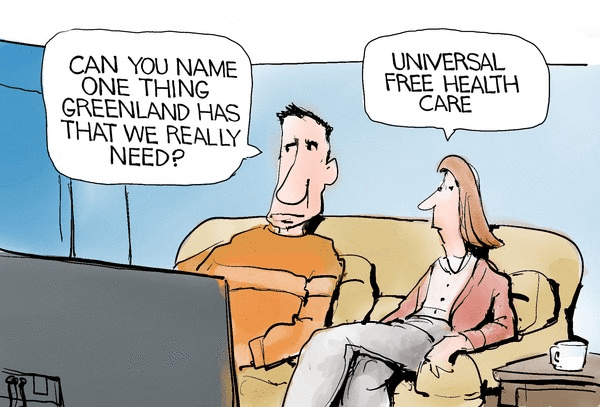
- Les huit pays (dont la France) que Donald Trump va sanctionner « jusqu’à l’achat du Groenland » (huffingtonpost.fr)
Le président américain contre-attaque face aux pays européens qui tentent de lui mettre des bâtons dans les roues sur sa volonté d’acquérir le Groenland.
- Macron urges EU to deploy trade ‘bazooka’ against US as Trump ramps up tensions (politico.eu)
- Archaeologists find a supersized medieval shipwreck in Denmark (arstechnica.com)
The sunken ship reveals that the medieval European economy was growing fast.
- US cargo tech company publicly exposed its shipping systems and customer data to the web (techcrunch.com)
For the past year, security researchers have been urging the global shipping industry to shore up their cyber defenses after a spate of cargo thefts were linked to hackers. The researchers say they have seen elaborate hacks targeting logistics companies to hijack and redirect large amounts of their customers’ products into the hands of criminals, in what has become an alarming collusion between hackers and real-life organized crime gangs.
- Judge orders Anna’s Archive to delete scraped data ; no one thinks it will comply (arstechnica.com)
- Donald Trump adresse un doigt d’honneur à une personne, la Maison Blanche défend une réponse « adéquate » (lemonde.fr)
- NASA reports record heat but omits reference to climate change (france24.com)
- Aux États-Unis, la multiplication de data centers suscite une opposition locale croissante (next.ink)
- EPA makes it harder for states, tribes to block pipelines (arstechnica.com)
The Trump administration on Tuesday proposed a new rule aimed at speeding up and streamlining the permitting process for large energy and infrastructure projects, including oil and gas pipelines and facilities tied to artificial intelligence.The rule, which does not require action by Congress, includes a suite of procedural changes to section 401 of the Clean Water Act
- A Mining Town Scattered Residents, and Asbestos, to the Wind (thetyee.ca)
Cassiar exposed residents to asbestos for 40 years. But little has been done to follow their health outcomes.
- Donald Trump et Stephen Miller ont créé une sorte de force de police secrète, qui en plus, n’a rien de secrète (huffingtonpost.fr)
Donald Trump utilise les agents de l’ICE pour terroriser les villes où il est impopulaire.
- Hannah Natanson, la journaliste du « Washington Post » qui couvre les réformes de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI (humanite.fr)
il est rare qu’un ou une journaliste soit directement ciblé, et de manière aussi agressive. Quand on ajoute qu’Hannah Natanson, au Washington Post, est chargée de couvrir la refonte du gouvernement fédéral par Donald Trump, cette perquisition pourrait apparaître comme une remise en cause de l’indépendance du quatrième pouvoir.

- We Found More Than 40 Cases of Immigration Agents Using Banned Chokeholds and Other Moves That Can Cut Off Breathing (propublica.org)
- You’ve Heard About Who ICE Is Recruiting. The Truth Is Far Worse. I’m the Proof. (slate.com)
- Roughly 100 members of Congress have said they will not approve further funding of ICE without reforms. (huffpost.com)
- Minneapolis attaque en justice l’administration Trump et les méthodes de l’ICE (huffingtonpost.fr)
La mort d’une mère de famille, Renee Good, abattue au volant de sa voiture par un agent de la police de l’immigration, a déclenché une vague de manifestations dans le pays.
Voir aussi « Cassez-vous de notre ville ! » : Jacob Frey, le maire de Minneapolis porte plainte contre l’administration Trump après le meurtre de Renee Nicole Good par l’ICE (humanite.fr)
- Report : ICE Using Palantir Tool That Feeds On Medicaid Data (eff.org)
“Palantir is working on a tool for Immigration and Customs Enforcement (ICE) that populates a map with potential deportation targets, brings up a dossier on each person, and provides a “confidence score” on the person’s current address,” 404 Media reports today. “ICE is using it to find locations where lots of people it might detain could be based.”
- Personal Details of Thousands of Border Patrol and ICE Goons Allegedly Leaked in Huge Data Breach (thedailybeast.com)
It is a sign that people aren’t happy within the U.S. government, clearly. The shooting [of Good] was the last straw for many people.
Voir aussi Whistleblower drops ‘largest ever’ ICE leak to unmask agents : ‘The last straw’ (rawstory.com)
- Minneapolis Labor, Community Leaders Join Call for Jan. 23 General Strike to Demand ICE Out (commondreams.org)
“We are asking every single person, every family member, every teacher, every bus driver, every childcare worker, to come together, to be in community, to stand with one another.”
- « Du jamais-vu » : au Mexique, les agriculteurices bloquent routes et postes frontières, depuis 2 mois contre une réforme de l’eau et des accords de libre-échange favorables aux grands exploitants. Iels menacent de bloquer la Coupe du monde de foot en juin. (reporterre.net)
- Venezuela : Le changement de régime parfait. De l’autoritarisme au néocolonialisme ? (contretemps.eu)
« Le plus facile n’est pas d’entrer, mais de sortir », se vantaient-ils. Mais les Américains sont entrés, sont sortis et ont emmené Maduro sans la moindre résistance.[…] Le succès tactique n’est pas seulement celui des forces spéciales américaines. La seule explication à une telle précision semble être une trahison parfaitement exécutée.
- Maria Corina Machado a réalisé (un peu) du rêve de Donald Trump avec ce « geste magnifique » (huffingtonpost.fr)
La prix Nobel de la paix 2025 a offert sa médaille au président des États-Unis. Pour autant, le Centre Nobel a rappelé que le titre de lauréat ne se transmet pas.
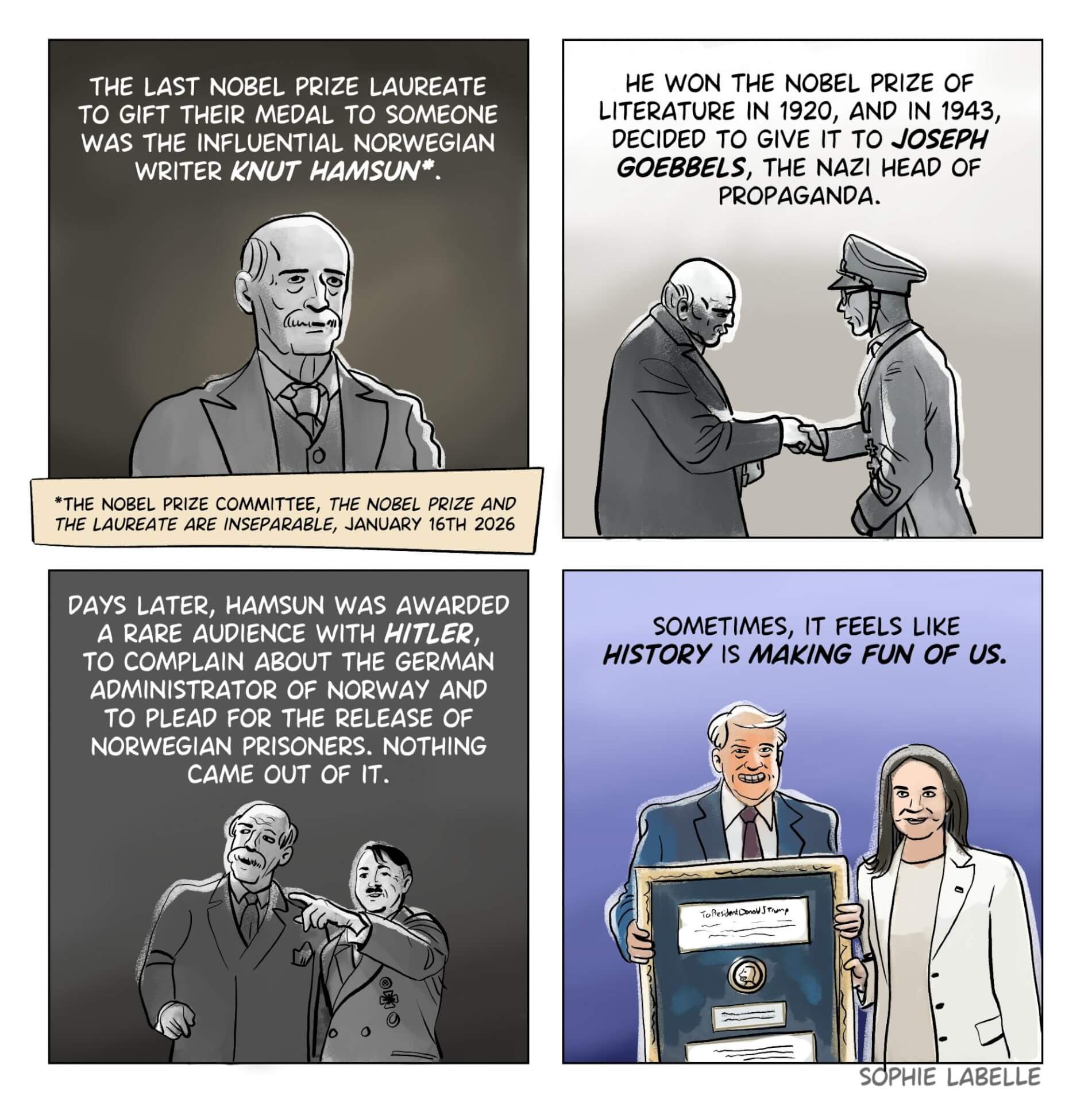
Spécial IA
- Silicon, not oil : Why the U.S. needs the Gulf for AI (restofworld.org)
Qatar and the UAE are set to sign the Pax Silica initiative that would add Gulf wealth to Washington’s AI supply chain push.
- AI’s green-energy goal is devastating Taiwan’s coastal villages (restofworld.org)
Aggressive expansion of wind energy to power the semiconductor industry is upending the livelihoods of farmers and fishers.
- Why India’s plan to make AI companies pay for training data should go global (restofworld.org)
- Deny, deny, admit : UK police used Copilot AI “hallucination” when banning football fans (arstechnica.com)
After repeatedly denying for weeks that his force used AI tools, the chief constable of the West Midlands police has finally admitted that a hugely controversial decision to ban Maccabi Tel Aviv football fans from the UK did involve hallucinated information from Microsoft Copilot.
- ‘Dangerous and alarming’ : Google removes some of its AI summaries after users’ health put at risk (theguardian.com)
Guardian investigation finds AI Overviews provided inaccurate and false information when queried over blood tests
- Grok was finally updated to stop undressing women and children, X Safety says (arstechnica.com)
“We have implemented technological measures to prevent the Grok account from allowing the editing of images of real people in revealing clothing such as bikinis,” X Safety said. “This restriction applies to all users, including paid subscribers.”
- How AI and Wikipedia have sent vulnerable languages into a doom spiral (technologyreview.com)
Machine translators have made it easier than ever to create error-plagued Wikipedia articles in obscure languages. What happens when AI models get trained on junk pages ?
- Wikipedia signs AI training deals with Microsoft, Meta, and Amazon (arstechnica.com)
On Thursday, the Wikimedia Foundation announced licensing deals with Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, and Mistral AI, expanding its effort to charge major tech companies for using Wikipedia content to train the AI models that power AI assistants like Microsoft Copilot and OpenAI’s ChatGPT.
- How AI Destroys Institutions (papers.ssrn.com)
AI systems are built to function in ways that degrade and are likely to destroy our crucial civic institutions. The affordances of AI systems have the effect of eroding expertise, short-circuiting decision-making, and isolating people from each other. These systems are anathema to the kind of evolution, transparency, cooperation, and accountability that give vital institutions their purpose and sustainability. In short, current AI systems are a death sentence for civic institutions, and we should treat them as such.

- Intelligence artificielle à France Travail : des risques pour les agent·es (basta.media)
L’usage de l’IA progresse à France Travail. Un rapport de la Cour des comptes s’y intéresse pour la première fois, soulevant plusieurs risques : l’impact sur le travail des salarié·es ainsi que sur la protection des données des usager·es.
- 1200 suppressions de postes : le CHU de Montpellier utilise l’IA pour accélérer la casse sociale (revolutionpermanente.fr)
- Bientôt reviewés par des IA ? (themeta.news)
Alors que le recours à l’IA générative explose dans la recherche, la question de son utilisation pour le peer review se pose et les éditeurs n’ont pas tous la même réponse.
- Ads Are Coming To ChatGPT in the Coming Weeks (slashdot.org)
- Even Linus Torvalds is vibe coding now (zdnet.com)
- Musk and Hegseth vow to “make Star Trek real” but miss the show’s lessons (arstechnica.com)
Unchecked military AI dominance is precisely the problem that the “Arsenal” episode warns of—a lesson either unknown to Musk and Hegseth or one that they chose to ignore.
- Keeping Bandcamp Human (blog.bandcamp.com)
Our guidelines for generative AI in music and audio are as follows : Music and audio that is generated wholly or in substantial part by AI is not permitted on Bandcamp. Any use of AI tools to impersonate other artists or styles is strictly prohibited in accordance with our existing policies prohibiting impersonation and intellectual property infringement.
- Why We Don’t Use AI (yarnspinner.dev)
TL;DR : AI companies make tools for hurting people and we don’t want to support that.
Spécial Iran
- Iran : ce que l’on sait de l’ampleur des manifestations, de la répression du régime et d’une possible intervention des États-Unis (legrandcontinent.eu)
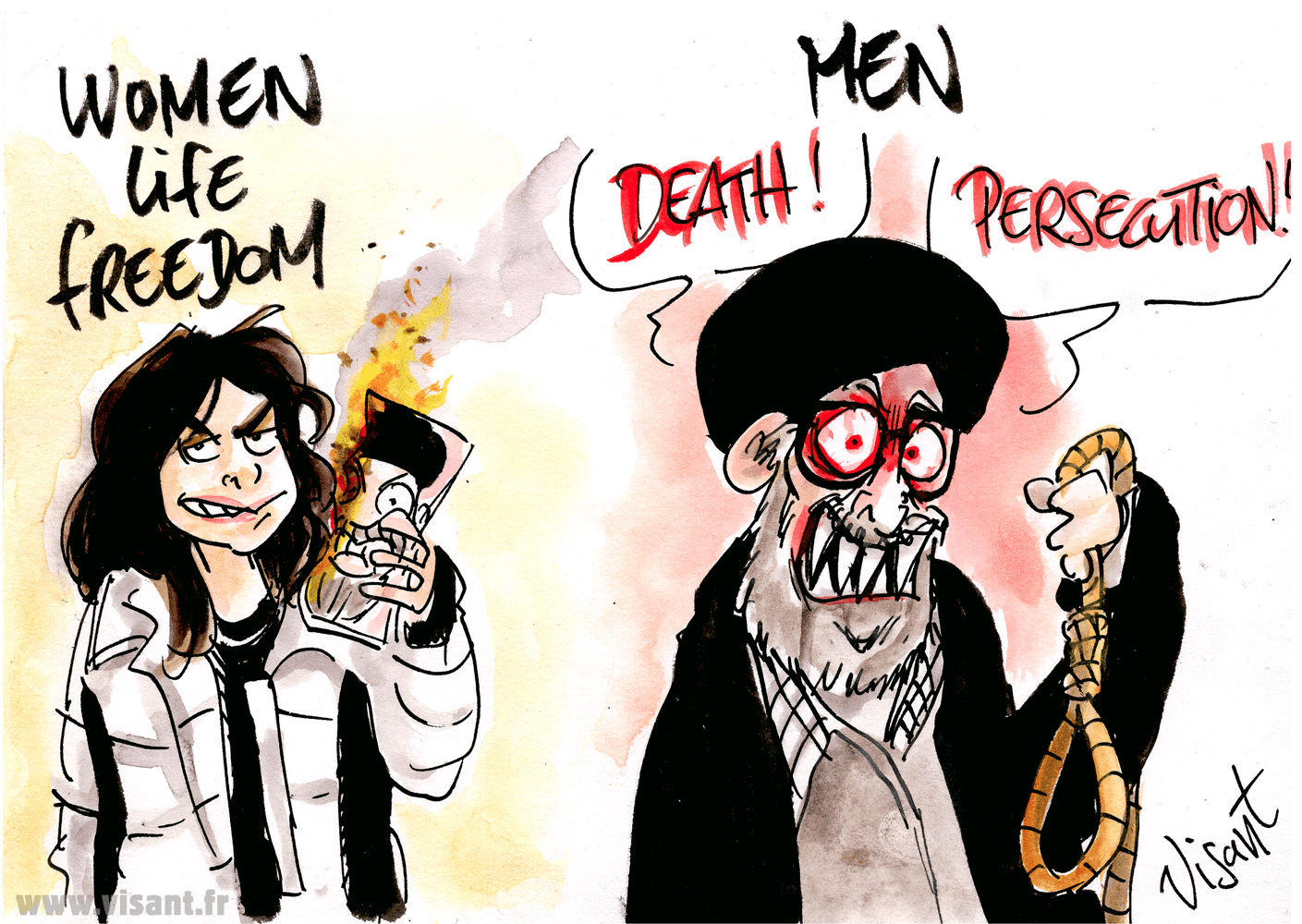
- Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation (theconversation.com)
Près de la moitié des Iranien·nes ne sont pas des Perses. Si les habitant·es des régions périphériques — Kurdistan, Baloutchistan, Azerbaïdjan… — soutiennent le mouvement de contestation, iels redoutent également un éventuel retour de la monarchie Pahlavi, qui ne leur a pas laissé que de bons souvenirs…
- Hundreds of gunshot eye injuries found in one Iranian hospital amid brutal crackdown on protests (theguardian.com)
Doctors in Tehran tell of overwhelmed medical staff as violent crackdown intensifies
- En Iran, les familles de manifestant·es tué·es forcées de payer pour récupérer les corps (slate.fr)
Selon des témoignages recueillis par la BBC, les autorités iraniennes exigent des sommes colossales aux proches de manifestants tués pour restituer les dépouilles, transformant les morgues en instruments de répression.
- En larmes à l’ONU, la journaliste et militante irano-américaine Masih Alinejad tente d’égrener le nom des morts de la répression (huffingtonpost.fr)
- Iran crippled Starlink and why the rest of the world should worry (restofworld.org)
The service became synonymous with censorship-proof connectivity. Iran has just proved that assumption wrong.
- Iran’s internet shutdown is now one of its longest ever, as protests continue (techcrunch.com)
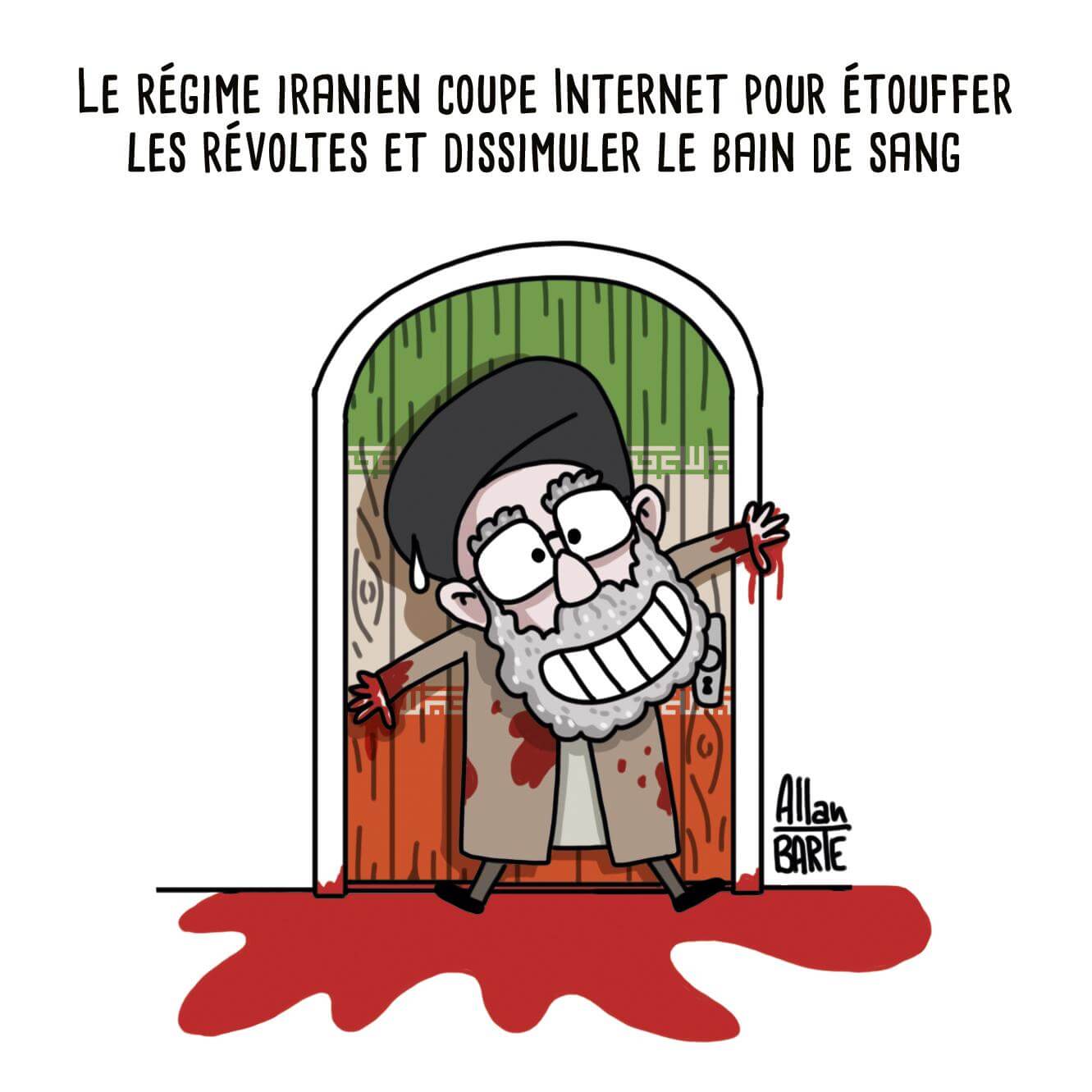
- Iran : Khamenei promet de « briser le dos des séditieux », des milliers de manifestant·es à Paris en solidarité avec le peuple iranien (humanite.fr)
Ce samedi, des milliers de manifestant·es se sont rassemblé·es dans plusieurs villes de France – Paris, Nantes, Rennes…- pour dire leur solidarité avec le peuple iranien. Une mobilisation à l’appel d’ONG, parmi lesquelles Amnesty International et la Ligue des droits de l’homme, de syndicats, et de partis de gauche.
Spécial Palestine et Israël
- Génocide à Gaza : plus de 100 enfants tués par l’armée israélienne depuis le « cessez-le-feu », alerte l’Unicef (humanite.fr)
Un responsable du ministère de la Santé de Gaza, qui tient les registres des victimes, a fait état d’un chiffre plus élevé, soit 165 enfants tués depuis le cessez-le-feu, sur un total de 442 décès. « De plus, sept enfants sont morts d’hypothermie depuis le début de l’année »
Spécial femmes dans le monde
- Voici ce que les dernières recherches révèlent sur le traitement hormonal de la ménopause et la santé cognitive (theconversation.com)
- Est-il toujours important d’évoquer l’avortement ? (theconversation.com)
Depuis plus de 50 ans, le cinéma et la littérature racontent les combats pour l’IVG, donnent voix aux femmes et dénoncent les attaques. En transmettant une mémoire collective, en brisant les tabous et en exposant les stratégies des mouvements ultraconservateurs, ces œuvres rappellent que l’IVG n’est pas seulement un droit juridique, mais un combat politique et culturel toujours d’actualité.
- Désarmement démographique : et si c’était un signe de vitalité du féminisme ? (lesnouvellesnews.fr)
La chute de la natalité affole les responsables politiques… Qui ne voient pas la fin du mythe imposant la maternité comme destin et bonheur unique des femmes. La propagation de la parole féministe, grâce à Internet, provoque une grève silencieuse des ventres.
- Une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées (theconversation.com)
Les modèles numériques actuellement utilisés pour évaluer les blessures de la moelle épinière ne sont pas adaptés aux caractéristiques des personnes âgées ou des femmes.
- L’ACLU lance la campagne « More Than a Game » avec Elliot Page, Megan Rapinoe et Naomi Watts pour soutenir les jeunes transgenres. (huffingtonpost.fr)
La campagne arrive au moment où des lois restrictives en Idaho et Virginie-Occidentale envers les femmes transgenres sont contestées à la Cour suprême.
- Trump ends rape protections for trans inmates in ICE facilities and U.S. prisons (lgbtqnation.com)
- A GOP Lawmaker Who Targeted Trans People Over “Child Safety” Is Now Convicted of Child Porn Crimes (freedomforallamericans.org)
A former South Carolina Republican lawmaker who built part of his political profile around “protecting children” has been sentenced to 17.5 years in federal prison after admitting he distributed child sexual abuse material online.
- Mother of one of Elon Musk’s offspring sues xAI over sexualized deepfakes (arstechnica.com)
Claims Grok chatbot created “countless” sexual images of her without her consent.
- Les réseaux sociaux nuisent davantage aux filles selon cette étude qui a duré 5 ans (huffingtonpost.fr)
- Julio Iglesias accusé de violences sexuelles répétées dans ses résidences aux Caraïbes (huffingtonpost.fr)
Deux médias espagnols, elDiario.es et Univision Noticias, ont réalisé une enquête qui a duré trois ans sur les traitements infligés par Julio Iglesias à des employées de maison.
- Un an après le procès des viols de Mazan, une enquête choc au Québec (huffingtonpost.fr)
Un journaliste a publié une fausse annonce sur un site pour proposer à des hommes de coucher avec sa femme pendant qu’elle dormait.[…]les réponses ont commencé à arriver, atteignant la centaine en 48 heures. En tout, 105 hommes ont manifesté leur intérêt. Seuls trois d’entre eux se sont posé la question du consentement de la femme, un seul soulignant que dans le cas contraire, c’était un viol.
- Misogyny, Murder and Renee Nicole Good (disabledginger.com)
It’s been a week since we watched an ICE agent shoot and kill Renee Nicole Good and then mutter “fcking btch” at her. It’s time we talk about the misogyny that’s baked into ICE enforcement
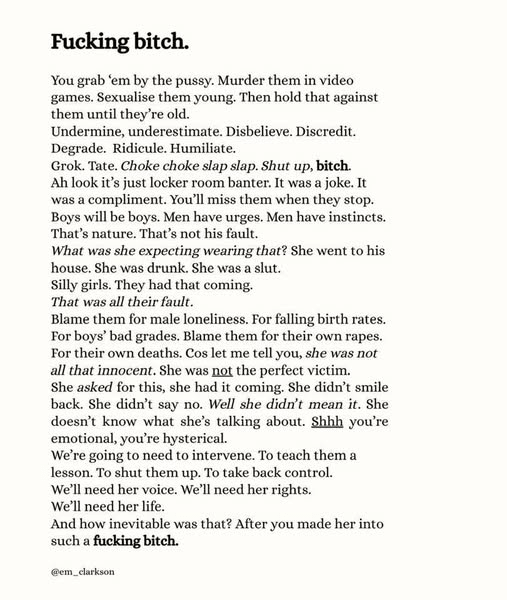
RIP
- Claudette Colvin, who refused to move seats on a bus at start of civil rights movement, dies at 86 (apnews.com)
Colvin, at age 15, was arrested nine months before Rosa Parks gained international fame for also refusing to give up her seat on a segregated bus.
Spécial France
- L’Assemblée nationale adopte une résolution contre la désinformation climatique (reporterre.net)
Le 12 janvier, l’Assemblée nationale a adopté une résolution « visant à garantir l’intégrité de l’information sur le changement climatique face à la désinformation climatique et aux ingérences étrangères ». Ce texte s’adresse à la fois au pouvoir exécutif français et à celui de l’Union européenne (UE).
- Ces motions de censure examinées à l’Assemblée dépassent largement la question du Mercosur (huffingtonpost.fr)
La France insoumise d’un côté, et le Rassemblement national de l’autre, ont décidé de déposer des motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement.
- Budget 2026 : Lecornu annonce le repas à 1 euro pour tous les étudiants « à compter du mois de mai » (lesechos.fr)
Le Premier ministre annonce vouloir « donner une priorité à la jeunesse ». Il fait des concessions fortes aux socialistes, sur l’enseignement supérieur et la recherche comme sur les postes destinés aux élèves en situation de handicap.
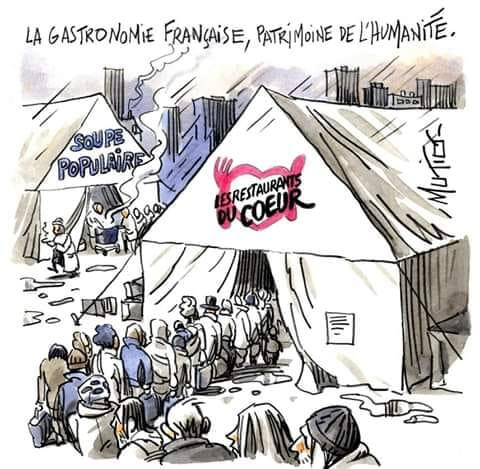
- Dès le 31 janvier, c’est le début de la fin du cuivre pour 26 000 communes (20 millions de locaux) (next.ink)
2026 devait être l’année de changement de braquet pour la fermeture du cuivre pour laisser place à la fibre optique. 2026 formera finalement une charnière avec 2027. Si 26 000 communes (20 millions de locaux) ne pourront plus souscrire au xDSL dès la fin du mois, ce sera finalement le 31 janvier 2027 pour les 8 000 communes (23 millions de locaux) restantes.
- Fin de la 3G chez Free Mobile : près de 15 000 sites en moins dans les 900 MHz (next.ink)
- Violation de données : sanction de 42 millions d’euros à l’encontre des sociétés FREE MOBILE et FREE (cnil.fr)
Le 13 janvier 2026, la CNIL a rendu deux décisions de à l’encontre des sociétés FREE MOBILE et FREE, prononçant respectivement des amendes de 27 et 15 millions d’euros, compte tenu du caractère inadapté des mesures prises pour assurer la sécurité des données de leurs abonné·es.
- Marseille : la ruée vers l’or numérique écrase l’opposition locale (synthmedia.fr)
- Quels sont ces sacs à dos high tech qui diffusent de la publicité en Dordogne ? (dordognelibre.fr)
Touchlive, c’est le nom d’un projet porté par Khaoula Pichardie. L’idée : transformer des sacs à dos en supports de publicité en les dotant d’un écran, pour promouvoir les commerces de la ville.
- Shiva : la face sombre de l’entreprise qui promet un ménage « premium » (basta.media)
Normalement, Shiva devrait n’être qu’un intermédiaire entre des aides ménagères et des particuliers. Des témoignages montrent que l’entreprise se comporterait plutôt comme un employeur, sans en accepter les responsabilités face aux abus.
- Après le désastre des Ehpad, le groupe Orpea rebondit en psychiatrie (blast-info.fr)
- Les changements climatiques menacent l’avenir des Jeux olympiques d’hiver (ledevoir.com)
- Salon International de l’Agriculture : les bovins seront absents en raison de la dermatose nodulaire contagieuse (huffingtonpost.fr)
- FNSEA et pesticides : « La science, c’est quand ça les arrange » (basta.media)
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, appelle à s’appuyer sur la science pour justifier l’abattage total face à la dermatose nodulaire contagieuse. Mais il refuse d’entendre les scientifiques sur les dangers des pesticides.
- Plus il y a de pesticides, moins il y a d’oiseaux, confirme une étude (reporterre.net)
Spécial femmes en France
- Filles et garçons ont des bulletins scolaires bien différents, et c’est à cause des stéréotypes (huffingtonpost.fr)
Les relevés de notes de 600 000 élèves de terminale analysés par deux chercheuses montrent une terminologie différente selon leur genre.
- L’alerte de la haute-commissaire à l’Enfance sur le jeu Roblox, un « repaire de pédocriminels » (huffingtonpost.fr)
Selon Sarah El Haïry, la messagerie du jeu le plus utilisé par les enfants de huit à neuf ans est devenu un lieu de prédilection des pédocriminels.
- « Je suis masculiniste » : ce que révèle une revendication devenue possible (blogs.mediapart.fr)
Lors d’un tractage aux municipales lyonnaises, un soutien politique s’est publiquement revendiqué « masculiniste » face à une femme candidate. Cette auto-désignation, rendue possible par la circulation médiatique récente du terme, marque un seuil : le masculinisme n’est plus seulement analysé ou dénoncé, il devient un outil électoral mobilisable sans coût politique immédiat.
- L’Etat condamné pour avoir caché des messages féministes affichés par une librairie (lesnouvellesnews.fr)
Le tribunal administratif de Nice a confirmé la condamnation de l’Etat à dédommager la librairie Les Parleuses qui avait été bâchée par la police pour cacher des messages féministes lors d’un passage de Gérald Darmanin
- Angoulême : le girlcott, et après ? (revueladeferlante.fr)
Fait rare dans son histoire, le Festival de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu cette année. En décembre 2025, une large mobilisation, dont les militant⋅es queers et féministes ont été les initiatrices, a obtenu son annulation. Elles entendent faire durer le mouvement et célébrer le neuvième art de manière plus inclusive.
- Hip Opsession. Une plainte pour violence sexiste et sexuelle déposée contre l’un des membres de l’équipe organisatrice (france3-regions.franceinfo.fr)
- Un an après l’assassinat de Lison, ses proches mobilisé·es contre les violences faites aux femmes (rue89bordeaux.com)
Un femmage à Lison Méral, Girondine tuée par son ex compagnon en décembre 2024, s’est tenu jeudi 8 janvier à l’Athénée Municipal à Bordeaux.« Porter son histoire, c’est refuser de faire des féminicides un tabou, nous en parlerons encore et encore. »
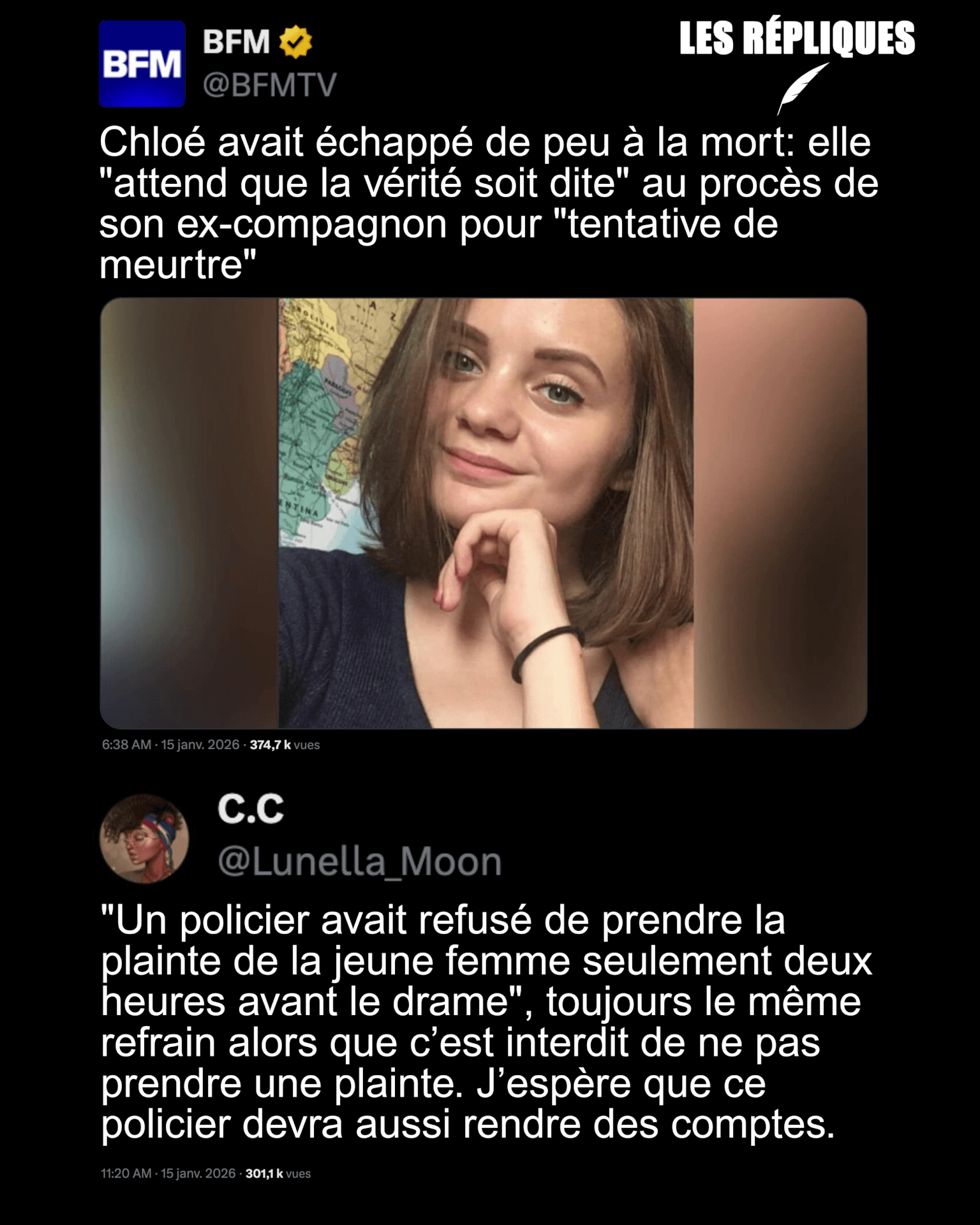
- Cette nouvelle façon d’enquêter sur Dominique Pelicot peut changer beaucoup de choses (huffingtonpost.fr)
Le pôle cold cases de Nanterre enquête désormais sur d’autres victimes potentielles du principal condamné des viols de Mazan.
- Viols de Mazan : ce document judiciaire ignoré qui aurait pu éviter le calvaire de Gisèle Pelicot (huffingtonpost.fr)
Un rapport de l’Inspection générale de la Justice pointe un « impensé organisationnel » en 2010 qui a eu de graves conséquences.
- « Monte, ou je te bute » : le policier arrêté pour le viol d’une adolescente en Charente et qui a avoué 5 autres tentatives est mis en examen et placé en détention provisoire (humanite.fr)
un policier âgé de 45 ans et exerçant au commissariat d’Angoulême a avoué le viol d’une adolescente de 17 ans début 2025, ainsi que cinq tentatives d’enlèvement de femmes, a annoncé jeudi 15 janvier le parquet. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi 16 janvier.
- Viols conjugaux, prostitution forcée, zoophilie, passages à tabac… Le calvaire de Laëtitia R., torturée par son ex-compagnon (humanite.fr)
Un homme de 52 ans, Guillaume B. va être jugé cette année par les assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, pour des faits de viols aggravés, proxénétisme et actes de torture et de barbarie à l’encontre de sa compagne.
« Et il faut savoir que c’est précisément en me meurtrissant, en m’avilissant, qu’il se procurait tout son plaisir » - Le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti restera impuni malgré les aveux de l’auteur (huffingtonpost.fr)
Yves Chatain avait avoué en 2022 avoir étranglé la jeune femme, portée disparue à l’âge de 25 ans en mai 1986 en Isère.La Cour de cassation a entériné ce vendredi 16 janvier la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, en dépit d’aveux d’un homme recueillis 36 ans après sa disparition.
Spécial médias et pouvoir
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (acrimed.org)
- « Flatter les banlieues musulmanes » : dans la presse, la cristallisation d’une « évidence » (acrimed.org)
- Laïcité : comment les grands médias sabotent le débat public (acrimed.org)
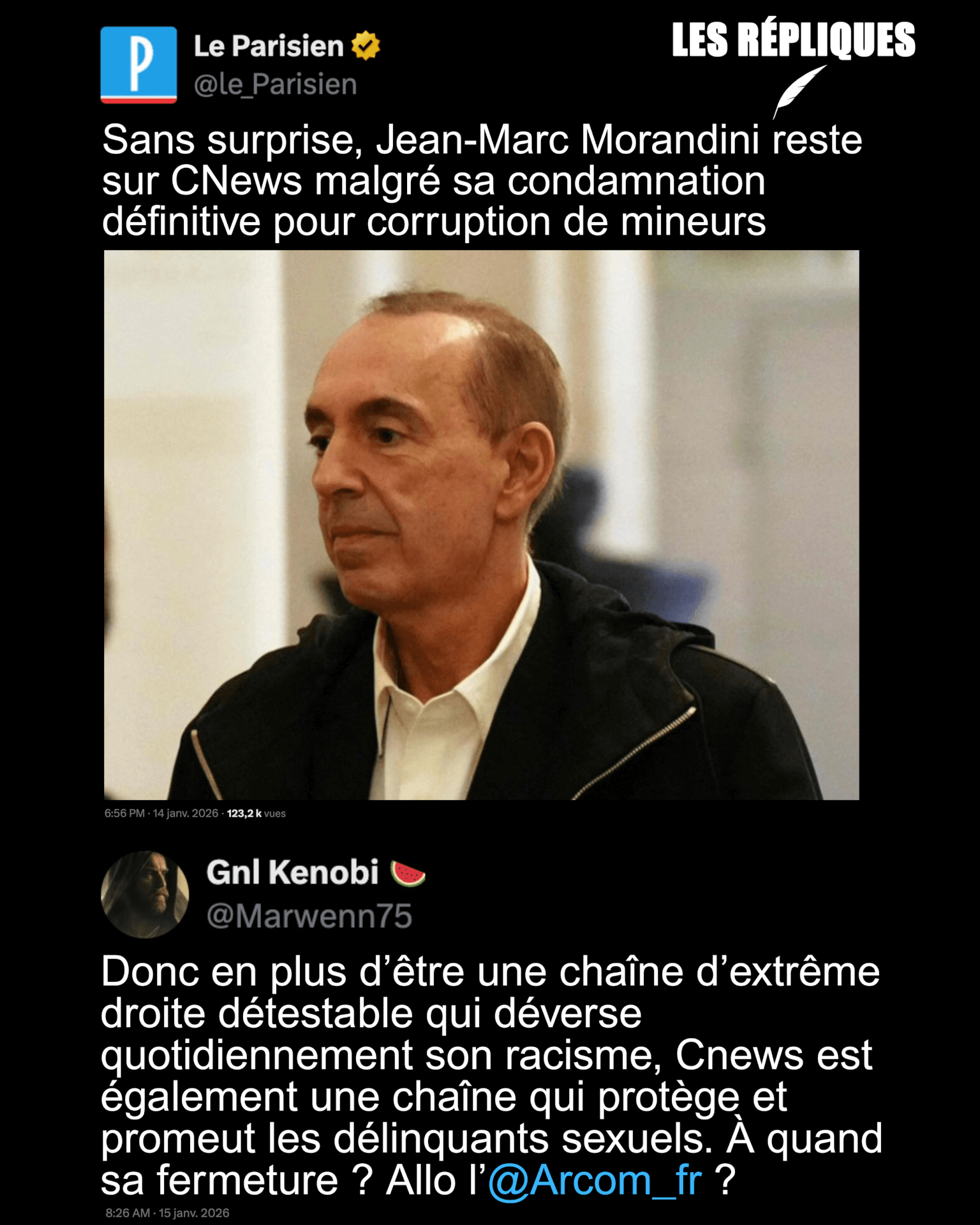
- Matthieu Pigasse, le patron de Radio Nova, provoque CNews pour fêter les bonnes audiences (huffingtonpost.fr)
Face aux médias d’extrême droite, l’homme d’affaires entend bien mener « la bataille culturelle pour la diversité et l’ouverture ».
- Le Grand Continent, ou la géopolitique mondaine des petits Machiavel de notre temps (première partie) (letempsdessalauds.substack.com)
Le Grand Continent et son « mage » Giuliano da Empoli veulent raconter le chaos du monde. Mais leur proximité avec les puissants nourrit une géopolitique lettrée et sans vertèbre.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Vers un 49 alinéa 3 de Lecornu et une dissolution ? (projetarcadie.com)
Cette semaine, c’est une ambiance de fin de règne qui prédomine à l’Assemblée nationale. Alors que les agriculteurs, principalement membres de la FNSEA ont installé leur campement devant le Palais Bourbon, avec braseros, tracteurs, baraques à frites et bières, les députés essaient de donner le change.
- Budget : Olivier Faure annonce que le PS ne censurera pas le gouvernement, à deux conditions (huffingtonpost.fr) – voir aussi L’appel de Sandrine Rousseau aux socialistes qu’elle ne « comprend plus » sur le budget (huffingtonpost.fr)
La députée écologiste estime que le PS « n’obtient pas de progrès sociaux, mais une non-dégradation. »
- Budget 2026 : C’est quoi cet amendement technique qui aurait fait perdre 2 milliards d’euros ? (20minutes.fr)
Un amendement discret et avantageux pour les contribuables qui quittent la France devrait coûter 2 milliards d’euros de plus qu’anticipé et complique les calculs du gouvernement pour réduire le déficit

- Taxe GAFAM : comment la France a cédé aux pressions américaines (franceinfo.fr)
- Patrick Balkany pourra purger ses 18 mois de prison restants chez lui (huffingtonpost.fr)
L’ancien maire a notamment été condamné en 2023 à quatre ans de prison pour avoir dissimulé avec son épouse, Isabelle Balkany, quelque 13 millions d’euros d’avoirs au fisc.
- Bernard Arnault installé à l’Académie des sciences morales et politiques (franceinfo.fr)
Le PDG du numéro un mondial du luxe LVMH succède à Denis Kessler, ancien président du réassureur Scor, mort en juin 2023.
- Le gouvernement prépare « un recul historique » dans la prévention des risques industriels (basta.media)
Face à la colère agricole, le gouvernement veut sortir les élevages industriels du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). « Il sous-estime les dangers des ammonitrates » alerte le spécialiste Paul Poulain.
- Annonces du gouvernement sur l’eau : « C’est une forme de trumpisme à la française » (reporterre.net)
« C’est dramatique. » Pour Arnaud Clugerie, d’Eaux et Rivières de Bretagne, les récentes annonces agricoles du gouvernement s’assoient sur des décisions prises démocratiquement et remettent en cause la science.
- Déchets radioactifs : un député pronucléaire d’extrême droite chargé du dossier Cigéo (reporterre.net)
Le député RN de la Meuse, Maxime Amblard, a été nommé rapporteur sur l’évaluation de la demande d’autorisation de création du centre de stockage des déchets radioactifs Cigéo, situé à Bure (Meuse). Il a été nommé par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et ce, malgré ses liens étroits avec la filière nucléaire française.
- Exposés au chlordécone, indemnisés au compte-gouttes : la longue attente des ouvrier·es agricoles antillais·es (reporterre.net) – voir aussi Chlordécone, ce scandale qui n’en finit pas (reporterre.net)
- Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le neveu de Bolloré joue avec le Caillou (basta.media)
À la veille de négociations cruciales à l’Élysée prévues le 16 janvier 2026, dans une enquête exclusive, Le Canard enchaîné révèle l’implication de Clément Leroux, neveu de l’industriel Vincent Bolloré, dans la structuration des mouvements loyalistes radicaux de Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- La librairie Violette and Co perquisitionnée à Paris : « Une dérive autoritaire inédite » (basta.media)
Victime de nombreuses attaques pour avoir mis en vitrine, à l’été 2025, un livre réalisé en solidarité avec la Palestine, intitulé « From the River to the Sea », la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée.
Voir aussi Librairie Violette and Co : l’État et l’extrême droite ensemble contre les librairies soutiens à la Palestine (politis.fr)
Le 7 janvier, la librairie parisienne a été perquisitionnée par la police, dans le cadre d’une enquête autour de la publication du livre de coloriage pour enfants sur la Palestine.
Et Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique” (actualitte.com)
Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L’enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».
- « Créer un public d’abonnés fanatiques » : Une agence anti-woke au service de l’extrême droite (stup.media)
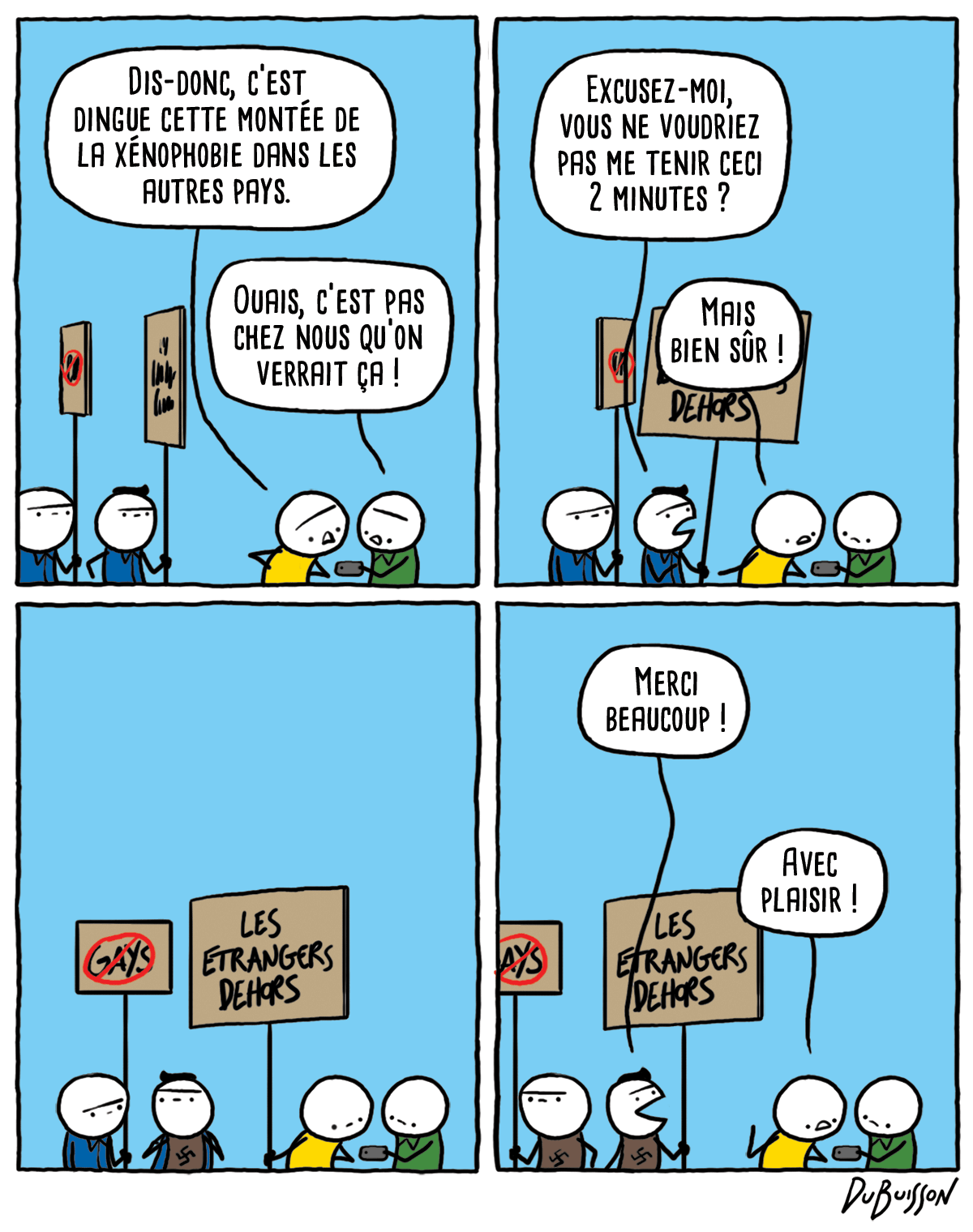
- Plusieurs élu·es de gauche ont annoncé leur intention de saisir la justice ainsi que l’Arcom après la sortie raciste de Pascal Praud sur CNews. (huffingtonpost.fr)
« Il y a les policiers qui font leur travail, et les gens en face sont blancs. C’est important de le dire, parce que ce n’est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s’interposer avec des gens, de qui ils partagent parfois les convictions, ou même les origines. »
- Un policier condamné à sept ans de prison ferme pour un tir mortel sur Aboubacar Fofana lors d’un contrôle à Nantes en 2018 (franceinfo.fr)
Le policier avait soutenu tout au long du procès avoir tiré accidentellement sur le jeune homme de 22 ans.
- Une plainte déposée après la mort d’un homme dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris (franceinfo.fr)
Interpellé mercredi pour possession de cannabis, El Hacen Diarra a perdu connaissance dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris. Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à l’IGPN. La famille parle de “violences ayant entraîné la mort”.
Voir aussi Paris : la famille d’El Hacen Diarra, décédé pendant une garde à vue, porte plainte (huffingtonpost.fr)
El Hacen Diarra, un Mauritanien de 35 ans, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi pendant sa garde à vue dans un commissariat du 20e arrondissement.
Spécial résistances
- On ne bâillonne pas la lumière (rogueesr.fr)
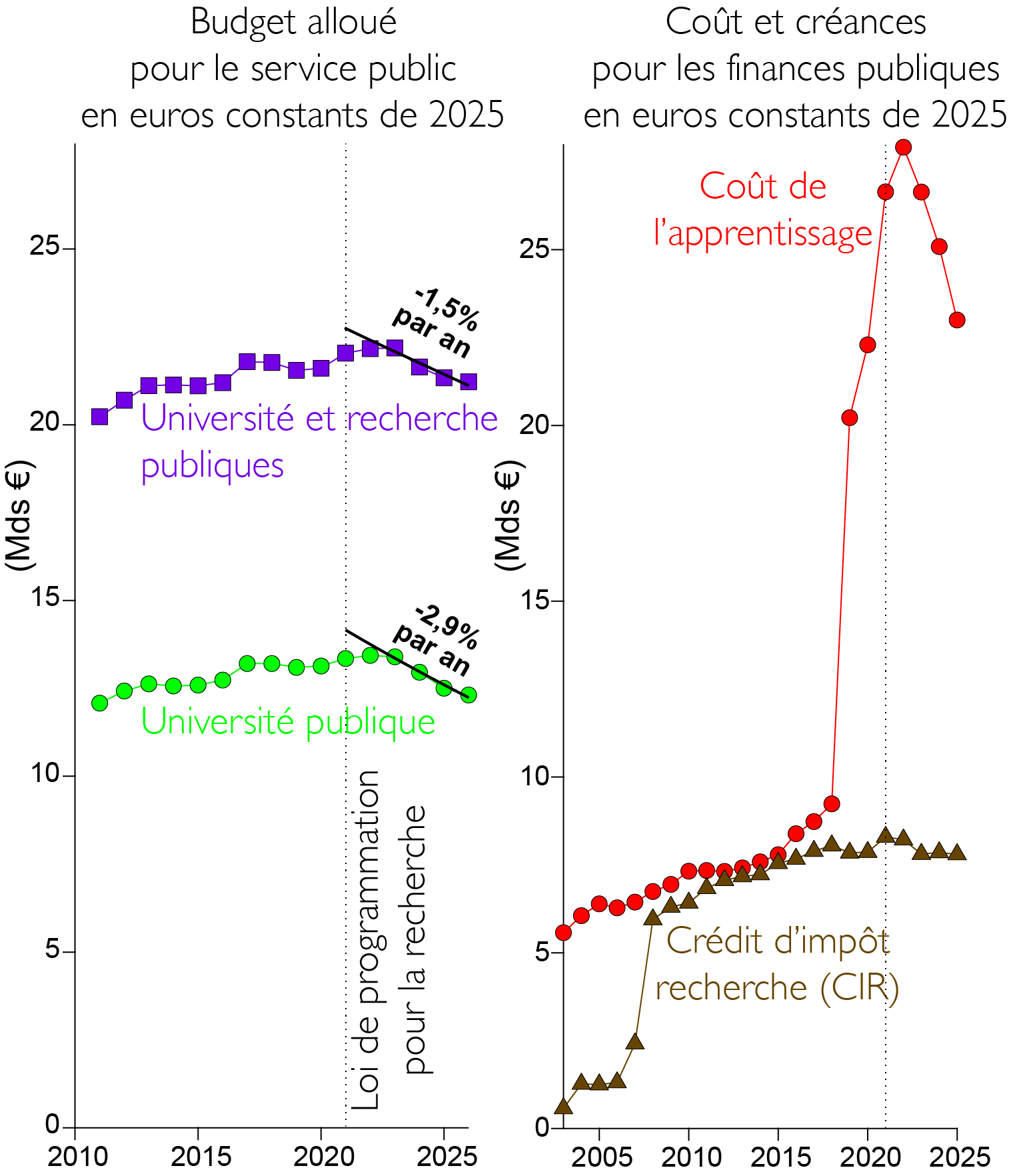
- Colère agricole : tapis rouge pour la FNSEA, mépris pour la Confédération paysanne (reporterre.net)
- Une action de la Confédération paysanne au ministère de l’Agriculture écourtée manu militari (huffingtonpost.fr)
Le syndicat agricole s’est invité mercredi 14 janvier au ministère pour dénoncer la « cogestion » de l’agriculture par l’État et la FNSEA.
- 52 paysan·nes de la Confédération paysanne en garde à vue : rassemblement de soutien (basta.media)
Suite à une action au ministère de l’Agriculture le 14 janvier en fin de journée, 52 militant·es de la Confédération paysanne dont le représentant de Guyane sont actuellement en garde à vue. Le syndicat agricole appelle à un rassemblement de soutien.
- « C’était un guet-apens » : des manifestants grièvement blessés à Sainte-Soline annoncent « redeposer » plainte (lavoixdunord.fr)
- En réponse à « la proposition humiliante de la direction sur les salaires », la rédaction a massivement voté la grève aux Échos, propriété de Bernard Arnault (humanite.fr)
Une grève de la rédaction du quotidien économique Les Échos, a été votée par 89 % des 190 votant·es (sur 206 inscrit·es), jeudi 15 janvier, selon un communiqué des élus de la rédaction soutenu par tous les syndicats.
Spécial outils de résistance
- Lancement de l’Observatoire de l’extrême droite – Franche-Comté » (OBEX-FC) et de son site (ripostes.org)
Le projet Obex-FC porté par un collectif bisontin se fixe pour objectif via son site internet de mettre à disposition une plateforme numérique, à destination du grand public, recensant, classifiant et décrivant, au niveau local, les synergies nationalistes, identitaires, néonazies, intégristes ou complotistes.
- Si vous êtes utilisateurice de DuckDuckGo, faites leur savoir que vous ne voulez pas d’Intelligence Artificielle, cela prend juste le temps d’un clic. (voteyesornoai.com)
Et pensez à utilisez l’extension de Next pour repérer les sites générés par IA, c’est d’utilité publique !
Spécial GAFAM et cie
- Hundreds of Millions of Audio Devices Need a Patch to Prevent Wireless Hacking and Tracking (wired.com)
Flaws in how 17 models of headphones and speakers use Google’s one-tap Fast Pair Bluetooth protocol have left devices open to eavesdroppers and stalkers.
- Leaked Windows 11 Feature Shows Copilot Moving Into File Explorer (techrepublic.com)
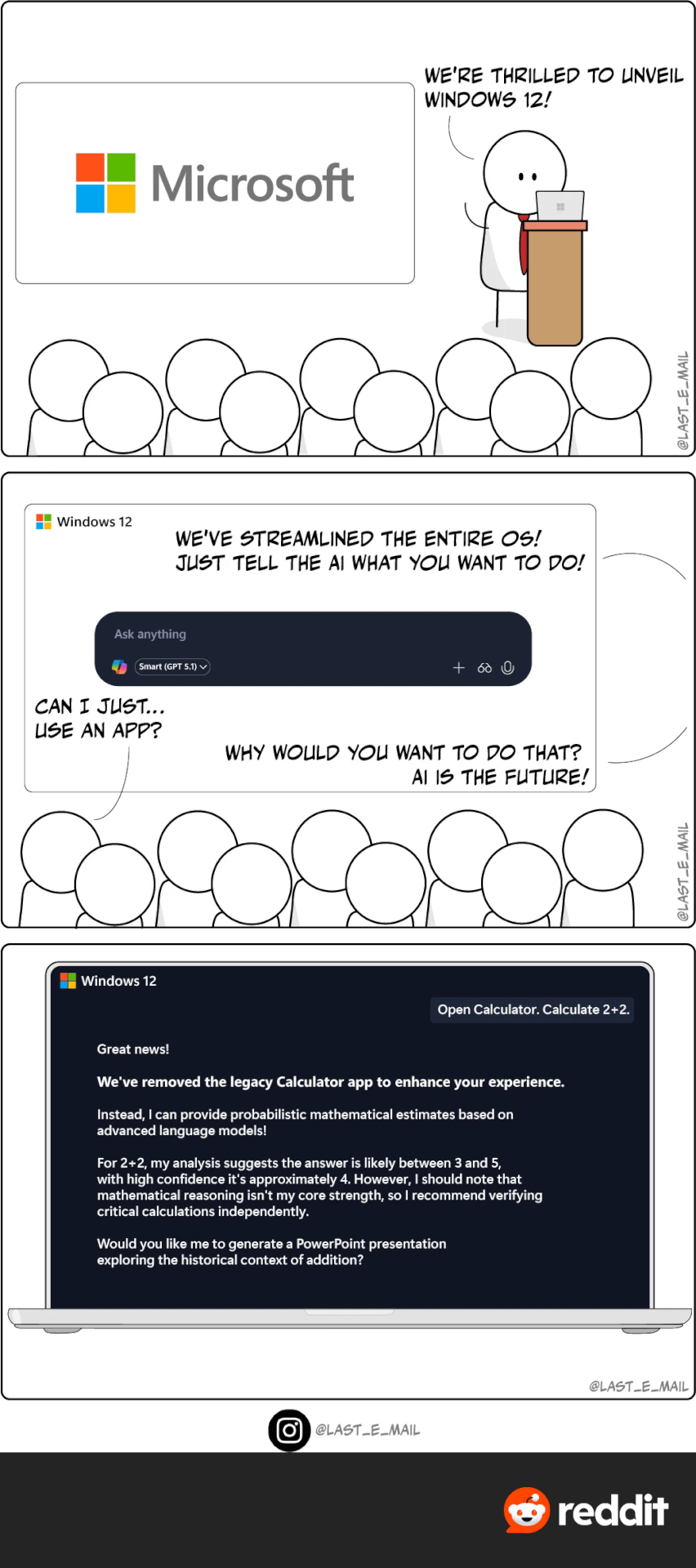
- Disney deleted a Thread because people kept putting anti-fascist quotes from its movies in the replies (theverge.com)
”Share a Disney quote that sums up how you’re feeling right now !”That’s what Disney posted on Threads the other day, and people immediately replied with lines from Star Wars, The Hunchback of Notre Dame, and even Mary Poppins. The throughline between all the quotes : they were pretty pointedly anti-fascist and clearly aimed at the current administration. Apparently, Disney either couldn’t handle the anti-fascist messaging of its own movies or was too afraid of pissing off the powers that be, because it quickly deleted the post.
Les autres lectures de la semaine
- Le trumpisme, anatomie d’un fascisme moderne (politis.fr)
La personnalité dite imprévisible de Trump est un piège. Il a derrière lui des idéologues d’une redoutable efficacité. Dont le très inquiétant vice-président J.D. Vance.
- Ressources pétrolières et interventions militaires : la carte du « capitalisme extractiviste » des États-Unis (humanite.fr)
Le pétrole est l’éléphant au milieu de la pièce. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, concentrées notamment dans le bassin de l’Orénoque, ce qui fait du pays un enjeu stratégique majeur sur l’échiquier mondial.
- Freedom Cities : au Vénézuela et au Groenland, l’enjeu d’un néocolonialisme tech (synthmedia.fr)
- L’avenir du Groenland, symbole du capitalisme du désastre (reporterre.net)
- Groenland : eldorado minier ou mirage stratégique ? (synthmedia.fr)
- Comment la création d’une base américaine secrète au Groenland a bouleversé la vie des Inuits (ouest-france.fr)
En juin 1951, l’explorateur Jean Malaurie voit surgir de la toundra une immense base militaire américaine, bâtie dans le secret le plus total. Ce choc marque pour lui le début d’un basculement irréversible pour les sociétés inuites. Aujourd’hui, alors que le Groenland redevient un enjeu stratégique mondial, l’histoire semble se répéter. Rester avec les Inuits polaires, c’est refuser de parler de territoires en oubliant ceux qui les habitent.
- Comment la première Bible à comporter une carte a contribué à diffuser l’idée de pays aux frontières établies (theconversation.com)
- The shape of time (aeon.co)
In the 19th century, the linear idea of time became dominant – with profound implications for how we experience the world
- Fin du projet « DNS et vie privée » à l’IETF (afnic.fr)
- Internet voting is insecure and should not be used in public elections (blog.citp.princeton.edu)
- Attaques DDoS hyper-volumétriques : la menace change d’échelle (incyber.org)
- Numérique : en quête de sens (curseurs.be)
- Large language mistake (theverge.com)
Cutting-edge research shows language is not the same as intelligence. The entire AI bubble is built on ignoring it. […] We use language to think, but that does not make language the same as thought. Understanding this distinction is the key to separating scientific fact from the speculative science fiction of AI-exuberant CEOs.
- On The Money – PSF Accepts Sponsorship From Anthropic (pythonbynight.com)
The amount echoes exactly the previously rejected grant amount from the US government.
- La gauche face à l’IA : utopie post-capitaliste ou cyber-écosocialisme ? (socialter.fr)
- Fascintern Media (berjon.com)
In an unusual turn, we are dealing with a power-aligned dominant media ecosystem that is pushing to overthrow the existing political system […] When you read Fascintern media, you are reading editorialised fascism. You aren’t protesting. You have no power. You are just subjecting yourself to an information space that is editorially structured to promote fascism. No one is impervious to the influence of their information environment — not even you, smart as I know you are. And you’re making them money. When you write for Fascintern media, you are choosing to publish with them. When you post on X you are basically pitching a story to Der Stürmer. You are not speaking to anyone that they don’t want you speaking to. You’re not being courageous ; you’re collaborating. You’re associating your name with that outlet. And you’re making them money.
- La violence sociale des discussions ordinaires (frustrationmagazine.fr)
D’abord, le manipulateur déplace l’origine du conflit du fonds vers la forme. Il insiste sur la manière par laquelle son adversaire s’est manifesté, en lui indiquant qu’il n’a pas dit les choses avec tact, que le moment et le lieu étaient inappropriés, que ses termes étaient exagérés ou que son ton était agressif. Quand bien même il y aurait une part de vérité, là n’est pas le sujet car l’objectif recherché de la démonstration est de focaliser sur le verbe et de renverser la charge de la faute.
- Les Néandertaliens ont-ils mystérieusement oublié comment faire du feu ? (slate.fr)
Alors qu’ils en avaient le plus besoin, les hommes de Néandertal en France ont cessé de faire du feu. Un paradoxe archéologique qui intrigue de plus en plus les scientifiques.
- Les chiens apprennent des nouveaux mots simplement en nous écoutant parler (slate.fr)
Une étude montre que certains chiens peuvent associer des mots à des objets simplement en entendant des conversations humaines, une capacité longtemps considérée comme propre aux très jeunes enfants.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Budget
- Gastronomie
- Impôts
- Dopage
- Xénophobie
- Morandini
- Plainte
- Fucking Bitch
- Men
- Étouffer
- Actualité Iran – 14 janvier 2026 (blogs.mediapart.fr)
- Need
- Petition
- Water
- Trump
- Nobel
- History
- Fraud

- Protests
- AI
- Stackoverflow
- Future
Les vidéos/podcasts de la semaine
- L’épuisement militant, une question stratégique (spectremedia.org)
- Pour Yann Barthès, l’humour échappe à la censure en France… Vraiment ? (humanite.fr)
- Après le désastre des Ehpad, le groupe Orpea rebondit en psychiatrie (video.blast-info.fr)
- ICE does not move like the gestapo, they move like slave patrols (tube.fdn.fr)
- Hajime Miura vainqueur du championnat de Yo-Yo à Prague (tube.fdn.fr)
Les trucs chouettes de la semaine
- Réouverture du cinéma La Clef, à Paris : pourquoi c’est une salle unique en son genre (telerama.fr)
Le cinéma associatif du 5ᵉ arrondissement de Paris a rouvert ses portes ce mercredi 14 janvier. Tarification libre, structure associative, implication des spectateurs… Les raisons qui font de ce lieu un espace culturel pas comme les autres.
- Wikipédia a 25 ans : indispensable, gratuite et sans pub, l’encyclopédie fait plus que résister à l’IA (clubic.com)
- Logiciel libre et souveraineté : la Commission européenne lance un appel à contributions (zdnet.fr)
La Commission propose jusqu’au 3 février aux développeurs, entreprises et communautés open source, administrations et chercheurs de contribuer à la future stratégie européenne d’écosystème numérique ouvert. En identifiant les obstacles à l’adoption de l’open source et en suggérant des mesures concrètes.
- Zorin OS explose les compteurs : 2 millions de téléchargements en 3 mois (generation-nt.com)
La distribution Zorin OS confirme son succès fulgurant avec 2 millions de téléchargements pour sa version 18 en moins de trois mois. Un chiffre impressionnant, alimenté à 75 % par des utilisateurs venant de Windows, qui cherchent une alternative crédible face à la fin du support de Windows 10. Un signal fort pour l’écosystème du logiciel libre.
- En complément au Khrys’presso et sous un format complètement différent, une Revue FéminisTech (blog.feministech.eu.org) à laquelle on peut s’abonner via Newsletter 🎉
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
12.01.2026 à 07:42
Khrys’presso du lundi 12 janvier 2026
Khrys
Texte intégral (9789 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Les 1 % les plus riches ont déjà épuisé leur budget carbone 2026 (reporterre.net)
- The oceans just keep getting hotter (arstechnica.com)
What people often don’t grasp is that it’s taken 100 years to get the oceans that warm at depth […] Even if we stopped using fossil fuels today, it’s going to take hundreds of years for that to circulate through the ocean. We’re going to pay this cost for a very, very long time, because we’ve already put the heat in the ocean.

- Les orques sont de plus en plus cruel·les et violent·es et ça intrigue les chercheureuses (slate.fr)
Ces derniers mois, les attaques d’épaulards se sont multipliées : enlèvements de bébés globicéphales, offensives contre les requins pour extraire leur foie ou collisions répétées contre des bateaux en vue de les faire couler…Derrière ces comportements belliqueux et violents, les scientifiques lisent un signe d’intelligence.
- Solar to the fore as grid sails through heatwave and record demand (abc.net.au)
On Wednesday, as the temperature soared into the 40s across large parts of southern Australia, the country’s biggest electricity market stayed eerily quiet.
- Câbles sous-marins à Taïwan : la stratégie chinoise du blackout (legrandcontinent.eu)
La bataille de Taïwan a déjà commencé — sous la mer. Alors que la Chine prépare l’invasion de l’île, le sabotage des câbles sous-marins reliant Taïwan au monde pourrait la paralyser.
- Que signifie la chute de Maduro pour la stratégie chinoise en Amérique latine ? (legrandcontinent.eu)
- People are leaving cities to escape toxic air (india.mongabay.com)
There is a growing trend of productive people leaving polluted metros for smaller cities, leaving behind growth prospects and their roots for cleaner air.
- Iran : pour contrer la mobilisation, le régime coupe Internet (humanite.fr)
Le mouvement de contestation, qui a débuté fin décembre en Iran, est marqué par d’imposantes manifestations à Téhéran et d’autres villes du pays. Depuis le 7 janvier, Internet a été coupé par les autorités, qui multiplient les déclarations martiales contre les protestataires, faisant craindre une intense répression à l’abri des regards.
Voir aussi IRAN. Internet coupé, manifestant·es massacré·es (kurdistan-au-feminin.fr)
L’accès à Internet reste totalement coupé dans le Rojhelat et en Iran, isolant largement la population du reste du monde. Selon des sources locales, seules quelques zones frontalières permettent à un nombre limité de personnes d’accéder à Internet grâce à des cartes SIM étrangères et aux réseaux de télécommunications des pays voisins. Cet accès demeure extrêmement instable, risqué et insuffisant pour répondre aux besoins de communication de base.
Et « Des corps empilés » : en Iran, ces témoignages font craindre une répression ultraviolente (huffingtonpost.fr)
L’organisation Human Rights Activists News Agency a […] fait état de la mort de 116 personnes, dont 37 membres des forces de sécurité ou autres responsables. « Un massacre est en cours en Iran », a averti cette organisation basée aux États-Unis.
- Les États-Unis ont mené des frappes « à grande échelle » contre l’État islamique en Syrie (huffingtonpost.fr)
Pour Washington, il s’agit d’une nouvelle réponse militaire à une attaque jihadiste à Palmyre mi-décembre, qui avait coûté la vie à deux militaires américains.
- Les Massaïs sacrifié·es aux parcs touristiques (afriquexxi.info)
Dans le nord de la Tanzanie, safaris, princes arabes et industrie du tourisme ont pris la place des Massaïs, exproprié·es de leurs terres au nom d’un modèle néocolonial et de la recherche du profit à tout prix.
- UK and France ‘ready to deploy troops’ to Ukraine after ceasefire (theguardian.com)
- Criminalisation de l’asile en Grèce : suites (blogs.mediapart.fr)
- JO d’hiver en Italie : « La montagne a été éventrée » (reporterre.net)
Les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2026 en Italie étaient promus comme les plus écolos de l’histoire. Mais à un mois de leur lancement, plusieurs chantiers sont lourdement critiqués par des associations et des habitant·es.
- Après l’incendie de Crans-Montana, la télé suisse révèle une vidéo qui pointe un danger connu dans le bar (huffingtonpost.fr)
Sur des images épinglées par la RTS tournées il y a six ans, un employé met en garde des clients qui approchent des feux de Bengale du plafond couvert de mousse isolante.
- Brussels plots open source push to pry Europe off Big Tech (theregister.com)
The European Commission has launched a fresh consultation into open source, setting out its ambitions for Europe’s developer communities to go beyond propping up US tech giants’ platforms.
- En 2026, l’UE permettra aux États-Unis d’accéder aux données biométriques de millions d’Européen·nes (euractiv.fr)
Malgré les relations de plus en plus tendues entre l’UE et les États-Unis, la perspective de communiquer des données sensibles et personnelles concernant des millions d’Européen·nes semble faire l’unanimité au sein du bloc.
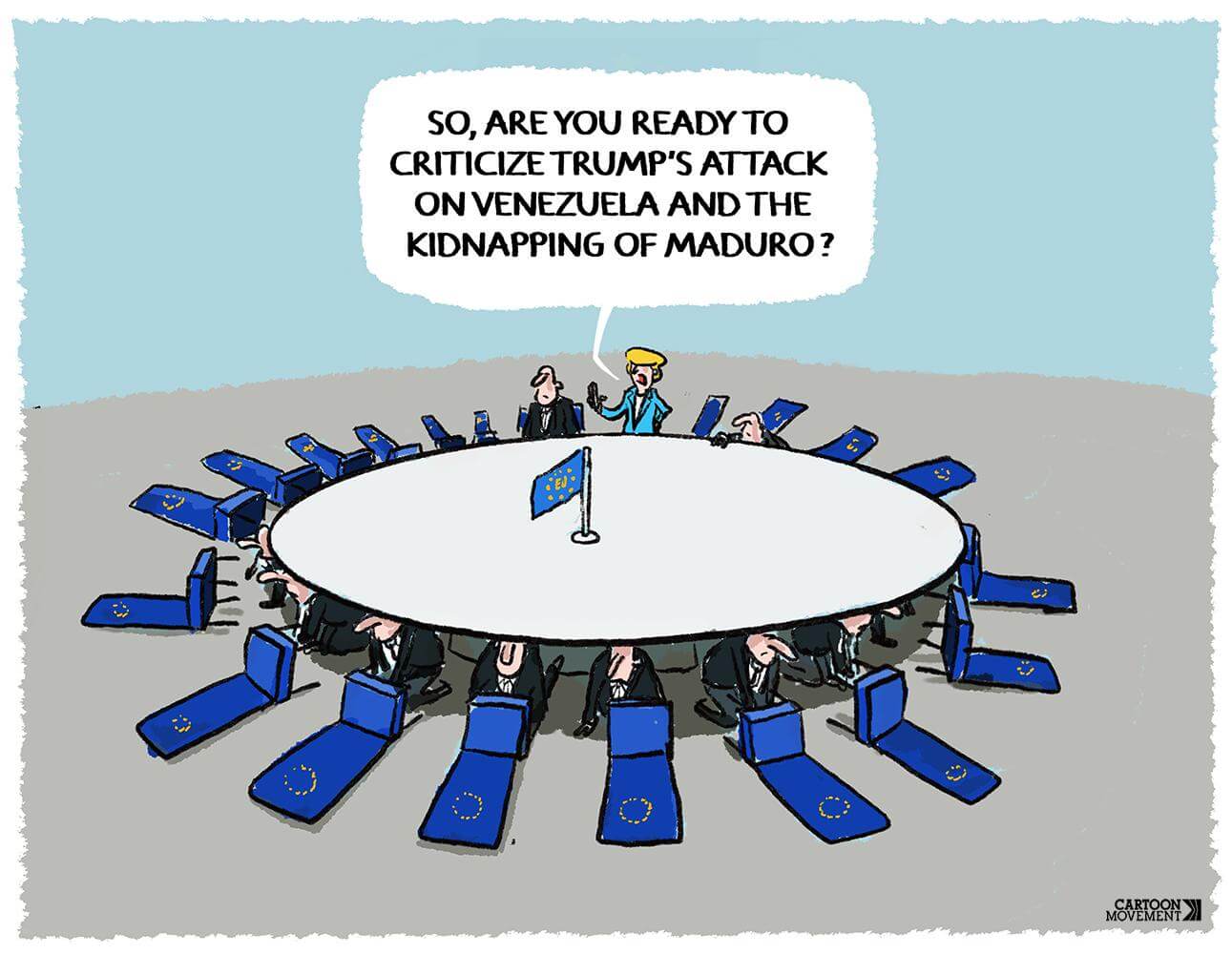
- Anna’s Archive Loses .Org Domain After Surprise Suspension (torrentfreak.com)
Popular shadow library Anna’s Archive has lost control over its main domain name. Annas-archive.org was suspended and put on serverHold status, which is an action that’s typically taken by the domain name registry. The site’s operator doesn’t believe that the actions are related to its recently announced Spotify backup and stresses that the site remains accessible through alternative domains.
Voir aussi Anna’s Archive loses .org domain, says suspension likely unrelated to Spotify piracy (arstechnica.com)
- Les États-Unis quittent 66 organisations internationales (courrierinternational.com)
Pour The Guardian, cette décision du président américain pose des questions d’ordre juridique puisque, “le traité de la CCNUCC ayant été ratifié par le Sénat, il n’est pas certain que Trump puisse le dénoncer unilatéralement. Ni qu’un futur président puisse réintégrer la convention-cadre sans un nouveau vote du Sénat.”
Voir aussi Trump retire les États-Unis de 66 organisations internationales, dont le Giec et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (humanite.fr)
- Make Colonialism Great Again : la Maison-Blanche fait de la recolonisation sa doctrine globale (legrandcontinent.eu)
- Donald Trump et son clan suggèrent que les États-Unis envisagent d’annexer le Groenland « prochainement » (legrandcontinent.eu)
- Donald Trump et le Groenland : Face aux pressions, Björk exhorte les habitants à déclarer leur indépendance (huffingtonpost.fr)
Pour l’artiste islandaise, l’idée que ses « compatriotes groenlandais puissent passer d’un colonisateur cruel à un autre est trop brutale ».
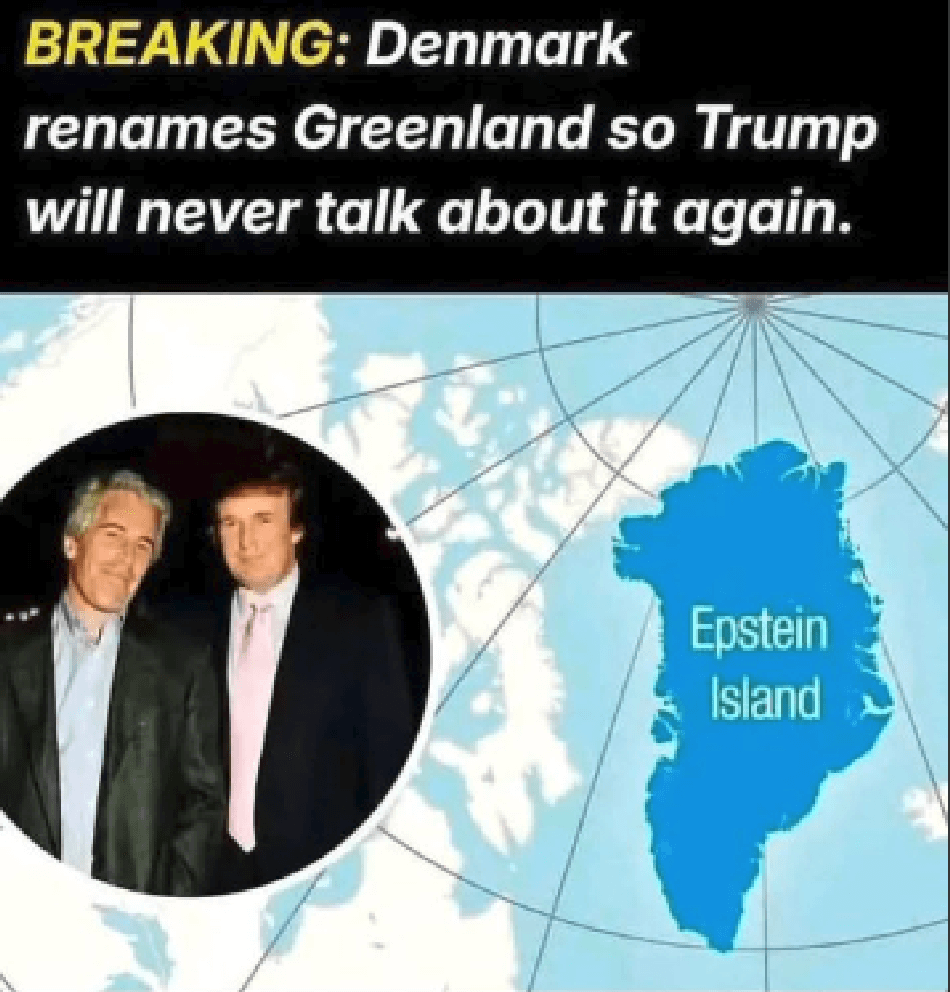
- Au Sénat, cinq élus républicains s’opposent à la prise de contrôle du Groenland par Trump (legrandcontinent.eu)
- U.S. Approves $45M Hellfire Missile Sale to Denmark Despite Active Threats to Seize Greenland (en.defence-ua.com)
- Trump éructe contre les frondeurs Républicains qui lui infligent un camouflet sur le Venezuela (huffingtonpost.fr)
Cinq sénateurs républicains ont rejoint les démocrates pour faire avancer une résolution limitant les pouvoirs militaires de Trump après son action controversée au Venezuela.
- La légalité de l’opération au Venezuela et la capture de Maduro questionnées aux États-Unis (huffingtonpost.fr)
Tandis que les démocrates dénoncent un « acte de guerre », des experts pointent que l’opération a violé la Charte des Nations Unies.« Ils ont pénétré au Venezuela, bombardé des sites aussi bien civils que militaires. Et c’est une violation de la loi de faire ce qu’ils ont fait sans obtenir l’autorisation du Congrès »
- Attaque contre le Venezuela : Delcy Rodriguez, présidente par interim, prête à dialoguer avec Trump (revolutionpermanente.fr)
- Trump ne va pas apprécier la réponse de l’Institut Nobel à Machado, qui n’excluait pas de lui donner son prix (huffingtonpost.fr)
L’Institut Nobel norvégien a opposé un non catégorique à la lauréate du prix Nobel de paix 2025, Maria Corina Machado, après qu’elle a suggéré qu’elle pourrait « partager » voire « remettre » sa prestigieuse distinction au président américain.
- US congressmen ask judge to appoint official to force release of all Epstein files (theguardian.com)
- « QAnon Shaman », le plus célèbre manifestant de l’insurrection du Capitole, acte sa rupture avec Trump (huffingtonpost.fr)
Jake Chansley, condamné pour sa participation à l’attaque du 6 janvier 2021, en veut à Donald Trump pour sa gestion du dossier Epstein.« Le mec refuse de publier la liste de clients d’Epstein, ça a été suffisant pour moi et pour plein d’autres gens de se dire : “Ok, c’est n’importe quoi”. »
- Big Tech’s fast-expanding plans for data centers are running into stiff community opposition (apnews.com)
Communities across the United States are reading about — and learning from — each other’s battles against data center proposals that are fast multiplying in number and size to meet steep demand as developers branch out in search of faster connections to power sources.
- Every data centre is a U.S. military base (policyalternatives.ca)
Understanding how the United States uses its tech companies to serve empire
- Trump administration freezes $10 billion in child, family aid to 5 states over fraud concerns (cnbc.com)
All five states targeted by the freeze — California, Colorado, Illinois, Minnesota and New York — are led by Democrats.
- Measles continues raging in South Carolina ; 99 new cases since Tuesday (arstechnica.com)
Previous measles transmission studies have shown that one measles case can result in up to 20 new infections among unvaccinated contacts.
- L’ISS évacuée à cause d’un astronaute malade, une première (huffingtonpost.fr)
Aucun détail n’a été donné sur la nature de ce problème, mais il a été précisé que l’astronaute, dont on ignore l’identité, se trouve dans un état stable.
- SpaceX gets FCC permission to launch another 7,500 Starlink satellites (arstechnica.com)
- ESA considers righting the wrongs of Ariane 6 by turning it into a Franken-rocket (arstechnica.com)
ArianeGroup proposes replacing the Ariane 6 rocket’s solid-fueled side boosters with new liquid-fueled boosters. The boosters would be developed by MaiaSpace, a French subsidiary of ArianeGroup working on its own partially reusable small satellite launcher. MaiaSpace and ArianeGroup would convert the Maia rocket’s methane-fueled booster for use on the Ariane 6.
- Nature-inspired computers are shockingly good at math (phys.org)
Spécial IA
- Depuis plus d’un an, l’armée ukrainienne teste en condition réelle des drones alimentés par l’IA (legrandcontinent.eu)
un projet confidentiel piloté par l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt
- Ford is getting ready to put AI assistants in its cars (arstechnica.com)
- Les PC avec IA n’intéressent personne et c’est Dell qui le dit (kulturegeek.fr)
Malgré l’omniprésence du marketing autour de l’intelligence artificielle, Dell révèle que les fonctions IA ne constituent pas le déclencheur d’achat pour le grand public qui veut un nouveau PC.
- La FDA réduit sa surveillance des dispositifs de santé portables ou s’appuyant sur l’IA (next.ink)
Le directeur de la FDA, Marty Makary, a annoncé au CES assouplir la régulation sur les appareils de santé numériques, notamment concernant les logiciels d’aide à la décision clinique (dont ceux utilisant l’IA générative) et les produits portables pour surveiller les problèmes de santé, tant que ceux-ci ne s’affichent pas comme des dispositifs médicaux.
- AI starts autonomously writing prescription refills in Utah (arstechnica.com)
- OpenAI lance ChatGPT Santé et encourage les utilisateurs à connecter leurs dossiers médicaux (intelligence-artificielle.developpez.com) – voir aussi OpenAI launches ChatGPT Health, encouraging users to connect their medical records (theverge.com)
- Un adolescent meurt par overdose après avoir suivi des conseils de ChatGPT : pourquoi l’usage de l’IA grand public peut poser un problème de santé publique majeur (intelligence-artificielle.developpez.com)
- Un discours généré avec ChatGPT provoque l’annulation d’un mariage aux Pays-Bas (huffingtonpost.fr)
Selon la justice, « le mariage entre l’homme et la femme n’a pas été officialisé », en raison d’une réplique manquante lors de la cérémonie.
- ’Get the f**k off there’ : MPs, Senators call on government to abandon X/Twitter following wave of ‘Grok porn’ (hilltimes.com) – voir aussi The Abuse Factory (thegist.ie)
X, the child abuse imagery app, revealed our state has no red lines.
Et Elon Musk’s X must be banned (disconnect.blog)
Let’s be honest with ourselves : if a broadcaster or newspaper had started publishing thousands of non-consensual, sexually explicit images of women or — even worse — of children, politicians and regulators would be out for blood. It would be a front-page, ongoing scandal and the organization responsible would be quickly brought to heel because it would be so outrageous.
- India gives Musk 72 hours as X floods with obscene images generated using Grok (restofworld.org)
France and Malaysia have also launched probes into the viral Grok bikini trend.
- Adobe accusé de pillage d’ebooks : le gardien du droit d’auteur devient suspect (actualitte.com)
Adobe occupe depuis des décennies une place centrale dans l’écosystème logiciel : Photoshop, Illustrator ou InDesign sont devenus des standards professionnels, voire des extensions naturelles. Mais depuis quelques mois, ce statut d’allié des auteurs et des éditeurs se fissure. En cause : des poursuites judiciaires intentées aux États-Unis, accusant le groupe d’avoir entraîné ses modèles d’intelligence artificielle sur des livres protégés par le droit d’auteur, sans autorisation ni compensation.
- Journalistic Malpractice : No LLM Ever ‘Admits’ To Anything, And Reporting Otherwise Is A Lie (techdirt.com)
- Google : Don’t make “bite-sized” content for LLMs if you care about search rank (arstechnica.com)
The idea is that if you split information into smaller paragraphs and sections, it is more likely to be ingested and cited by generative AI bots like Gemini. So you end up with short paragraphs, sometimes with just one or two sentences, and lots of subheds formatted like questions one might ask a chatbot.
- Microsoft CEO Begs Users to Stop Calling It “Slop” (futurism.com)
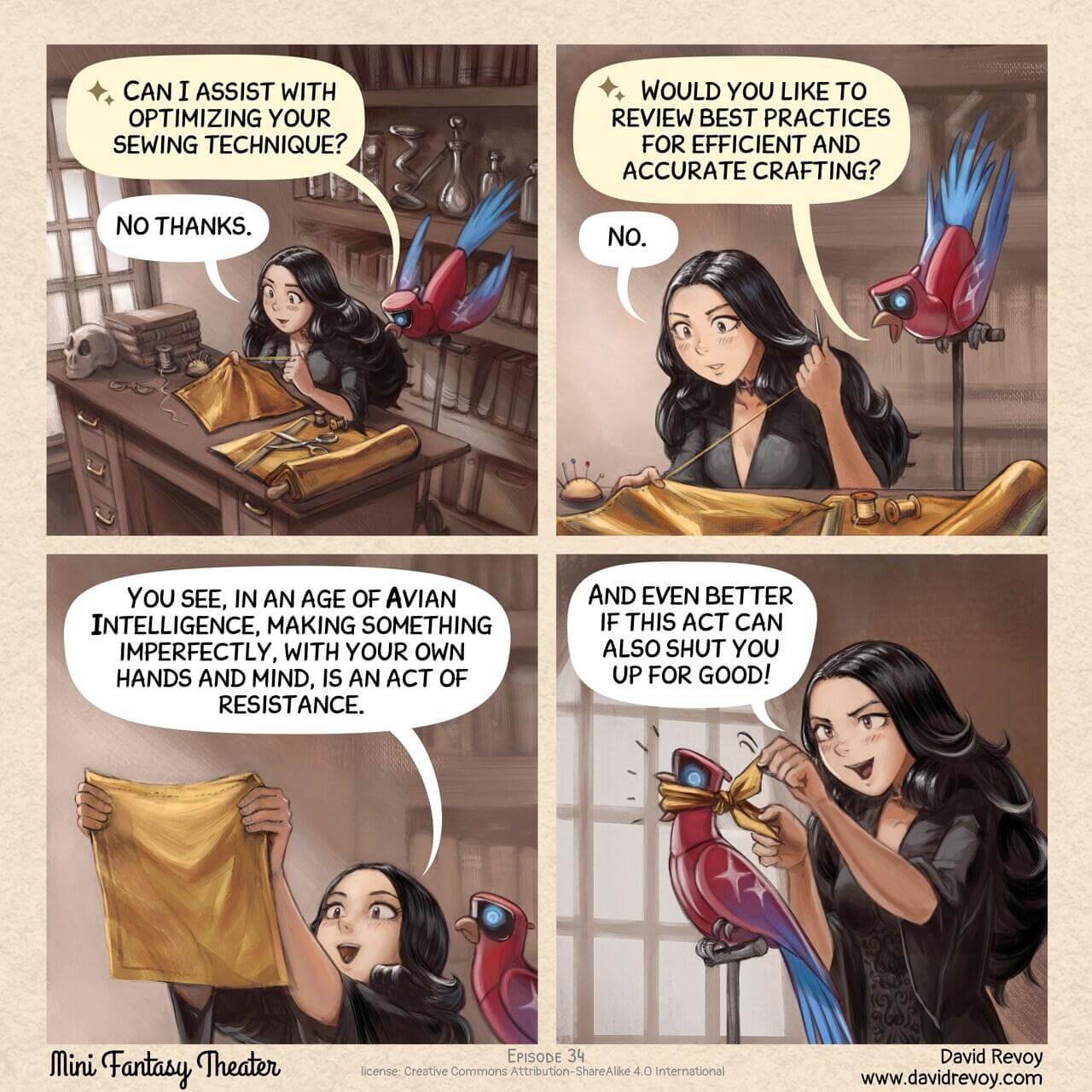
- Linus Torvalds : Stop making an issue out of AI slop in kernel docs – you’re not changing anybody’s mind (theregister.com)
- AI Fails at Most Remote Work, Researchers Find (slashdot.org)
The AI systems failed on nearly half of the Remote Labor Index projects by producing poor-quality work, and they left more than a third incomplete. Nearly 1 in 5 had basic technical problems such as producing corrupt files
- AI will compromise your cybersecurity posture (rys.io)
Les Facepalm de la semaine
- Furious AI Users Say Their Prompts Are Being Plagiarized (futurism.com)
- S’agrandir le pénis pour gagner ? La folle méthode de triche qui frappe le saut à ski (ladepeche.fr)
Spécial Renée Nicole Good
- À Minneapolis, fureur après la mort d’une Américaine tuée par la police de l’immigration (huffingtonpost.fr)
L’administration Trump accuse la femme d’avoir voulu de se servir de sa voiture comme une arme en fonçant sur la police, mais les vidéos de la scène racontent autre chose.
- “Des tirs en plein visage” : un agent de l’ICE, la police de l’immigration américaine, abat une femme dans sa voiture à Minneapolis, la version des autorités qualifiée de “connerie” par le maire (lindependant.fr)
“Nous exigeons le départ immédiat de l’ICE”, a réagi le maire de la ville, alors que le ministère de la sécurité intérieure parle de légitime défense et évoque un “acte de terrorisme intérieur”.

- Abolish ICE Before They Kill Again, Impeach Trump & Noem Before They Incite More Murder (techdirt.com)
Renee Nicole Good was a 37-year-old award-winning poet, a mother of a six-year-old, and a wife who had recently moved to Minneapolis. That all ended yesterday when a masked ICE agent murdered her in broad daylight, shooting her multiple times at close range in the head.
- AOC says ICE has become an “anti-civilian, paramilitary” org after an agent murdered a queer woman (lgbtqnation.com)
- L’ICE de Donald Trump a abattu une citoyenne américaine, elle tente maintenant de salir sa mémoire (slate.fr)

- Trump Isn’t Just Defending ICE for Killing a Woman. He’s Taking It a Chilling Step Further. (slate.com)
The president is blaming his political rivals—and possibly opening the door to more repression.
- Renée Nicole Good – assassinée par l’ICE à Minneapolis le 7 janvier 2026 était une poétesse ayant reçu des prix pour sa poésie. On peut lire l’un de ses poèmes par ici : On Learning to Dissect Fetal Pigs (poets.org).
Voir aussi Renée Nicole Good abattue par l’ICE : son poème prémonitoire (lundi.am) - Après la mort de Renée Nicole Good, des foules immenses réunies aux États-Unis contre l’ICE (huffingtonpost.fr)
Plus personne n’empêche désormais l’administration Trump de tuer des citoyens, de voler et d’enlever des êtres humains. Il est temps que ça s’arrête.
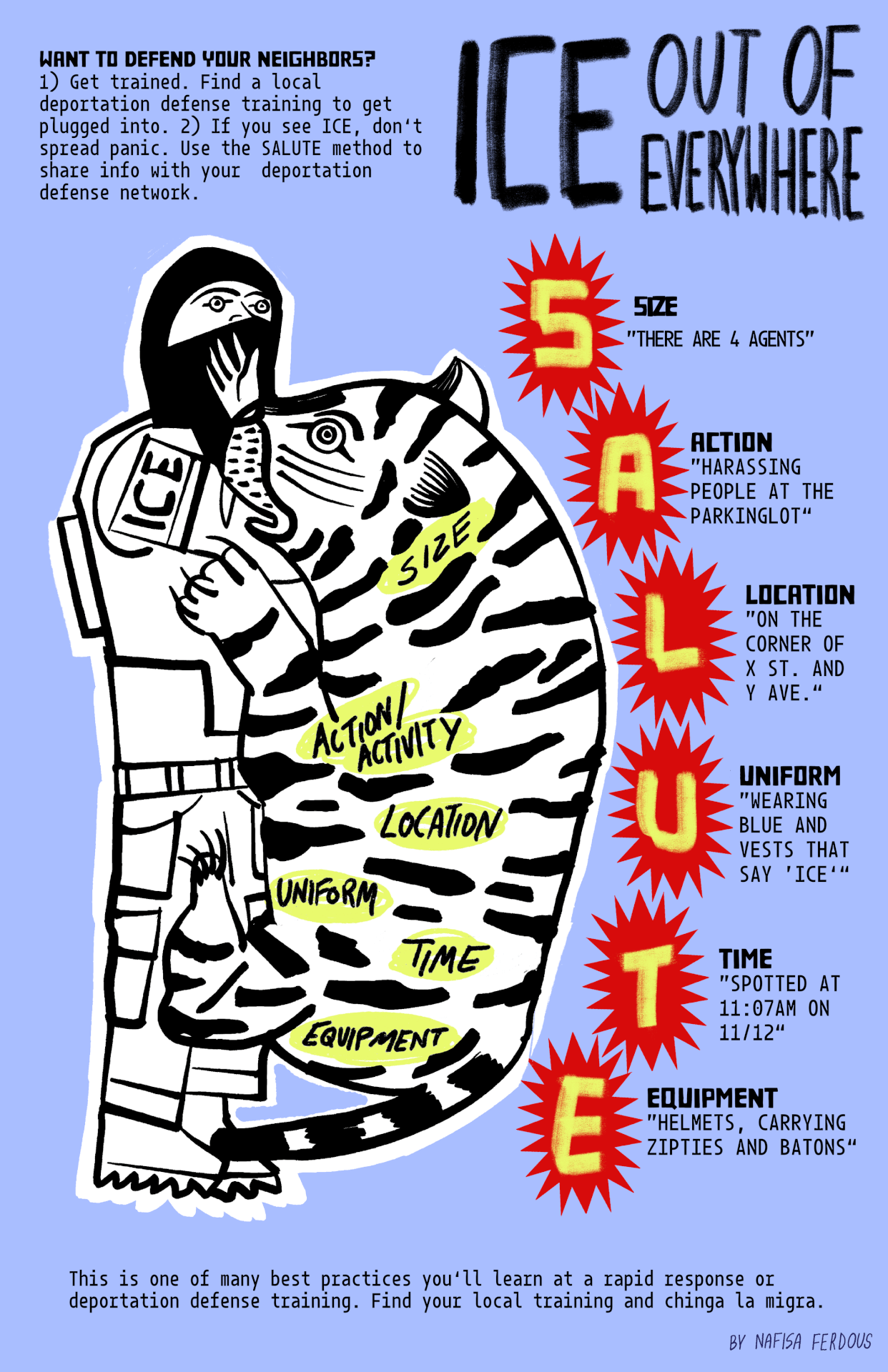
Spécial femmes dans le monde
- Emprisonnée par son pays depuis 4 ans, la journaliste tunisienne Chadha Haj Mbarek privée de soins vitaux (humanite.fr)
Mercredi 7 janvier, les proches de la journaliste arrêtée en 2021 ont lancé un appel pour exiger sa libération immédiate et sa prise en charge médicale d’urgence : un diagnostic a révélé qu’elle souffre de deux cancers.
- Un #MeToo politique déferle en Espagne, pays pionnier de la lutte contre les violences sexuelles (politis.fr)
Une vague de dénonciations de harcèlement sexuel visant des politiques continue de déferler en Espagne, pays pourtant cité comme exemple dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Signe qu’il reste encore du travail à faire ?
- Perpétuité pour Sammy Djedou, peine infinie des femmes yézidies (axellemag.be)
En novembre dernier, la Belgique a condamné le Belge Sammy Djedou pour sa participation au génocide yézidi et pour avoir commis des crimes contre l’humanité envers trois femmes yézidies. Notre pays est ainsi devenu le quatrième membre de l’Union européenne à reconnaître judiciairement le génocide yézidi. Un homme absent, peut-être mort, qu’on juge, des silences qui racontent l’horreur
- Conservative pastor says feminism is a “form of transgenderism” in hateful rant (lgbtqnation.co)
Whether a woman gets a career or transitions, they’re “rejecting their femininity” and “destroying America.”
- Hacktivist deletes white supremacist websites live onstage during hacker conference (techcrunch.com) – voir aussi ‘“Tinder for Nazis” hit by 100GB data leak, thousands of users exposed’ (cybernews.com) et Woman Hacks “Tinder for Nazis,” Tricks the Racist Users Into Falling in Love With AI Chatbots (futurism.com)
Show interest in traditional family roles and heritage, using an approachable tone with a mix of warmth and conviction.
- Indigenous women lead a firefighting brigade in Brazil’s Cerrado (news.mongabay.com)
- New vaginal speculum design might motivate women to go for health checkups (tudelft.nl – article de janvier 2025) – voir aussi Revolutionizing women’s health : New speculum designed to eliminate pain and anxiety (personalcareinsights.com – article de juillet 2025)
- Not Just A ‘Woman’s Hobby’ – Why More Men Are Picking Up Sewing, And Why You Should Too (studyfinds.org)
Spécial Palestine et Israël
- Cisjordanie : Netanyahou attaque l’université de Bir Zeit (humanite.fr)
Le 6 janvier, les forces d’occupation israéliennes ont mené un raid, blessant 41 étudiant·es.
- Génocide à Gaza : le statut de réfugié accordé aux Palestinien·nes de l’enclave étendu à celleux de Cisjordanie (humanite.fr)
La Cour nationale du droit d’asile a non seulement confirmé le statut de réfugié pour les Palestinien·nes de Gaza, mais l’a également étendu à celleux de Cisjordanie, alors que le génocide perpétré par Israël continue, malgré le cessez-le-feu.
- Israel has detained Dr. Hussam Abu Safiya without charges for a year. Why has the New York Times refused to cover his case ? (mondoweiss.net)
One year ago, an iconic photo from Gaza went viral of Dr. Hussam Abu Safiya walking through rubble in Gaza to be detained by Israeli forces. Today, Safiya is still being held without charges, but you wouldn’t know it from reading the New York Times.

Spécial France
- Le budget 2026 de retour à l’Assemblée, Eric Coquerel a trouvé une astuce pour reparler taxation des plus aisés (huffingtonpost.fr)
Le président de la « ComFi » entend se baser sur une jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui permet de « mettre sur la table des mesures nouvelles à partir du moment où ce sont des mesures nouvelles fiscales brutes : c’est-à-dire qui ne font qu’augmenter les recettes et ne transforment pas les impôts »
- Affaire des assistants parlementaires du FN : le président du tribunal de Paris met en garde contre une éventuelle « ingérence » américaine avant le procès en appel (lemonde.fr) – voir aussi Trump contre « l’Humanité » (humanite.fr)
Voilà une nouvelle leçon de démocratie à la Trump : quand on vous accuse d’ingérence, criez à la désinformation. C’est ce que fait la ministre adjointe des Affaires étrangères américaine, Sarah B. Rogers, qui attaque l’Humanité sur X. Elle affirme que l’information selon laquelle l’administration Trump pourrait sanctionner les juges de Marine Le Pen serait une « fake news ». A partir du 13 janvier et jusqu’à la mi-février, la cheffe de file de l’extrême droite, Marine Le Pen, et onze autres prévenus vont être jugés par la cour d’appel de Paris, soupçonnés d’avoir détourné l’argent du Parlement européen au seul profit du parti.
- Marine Le Pen, le procès d’une vie (mediapart.fr) Dossier en accès libre.
- Fin de l’ADSL : Orange reporte la fermeture commerciale, la fibre n’est pas complètement déployée (01net.com)
- Une fuite de données de santé liée à Doctolib ? Heureusement, non, mais de nombreuses infos de Français·es publiées sur le dark web (clubic.com)
Une fuite de données liée, à tort, à Doctolib vient d’être publiée sur un forum cybercriminel. Plus de 150 000 informations personnelles de patients de deux établissements français circulent désormais en ligne.
- Des infirmières de cancérologie reconnues malades d’avoir soigné (basta.media)
Une ex-soignante de cancérologie de Rennes vient d’obtenir la reconnaissance de son cancer comme maladie professionnelle. Elle avait été exposée à des substances toxiques dans son travail. Cela faisait six ans qu’elle se battait.
- Handicap et accessibilité : 4 grands sites de vente en ligne hors la loi (60millions-mag.com)
Auchan, Carrefour, E.Leclerc et Picard Surgelés ont été épinglés pour accessibilité numérique insuffisante.
- Neige et verglas : Record de bouchons en Île-de-France, avec plus de 1 000 kilomètres d’embouteillages (huffingtonpost.fr)
Alors que la région parisienne est placée en vigilance orange, d’importantes chutes de neige ont provoqué plus de 1 000 kilomètres de bouchons.
- Des salles de classe transformées en chambres : l’école, refuge pour les enfants à la rue (basta.media)
Des dizaines d’enfants sans-abri trouvent refuge chaque nuit avec leur famille dans des écoles de Lyon, grâce à l’engagement d’enseignants et de parents d’élèves.
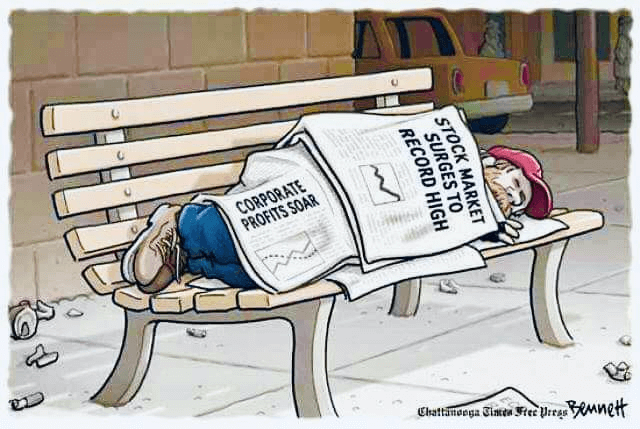
- Le dou détruit des familles en silence, à Saint-Pierre comme ailleurs (parallelesud.com)
Depuis 2023, le dou mène la vie dure à plusieurs familles réunionnaises. Cette drogue de synthèse très addictive, a d’abord été localisée dans le sud de l’île et, en peu de temps, a déjà causé de nombreux dégâts
- Nucléaire : une start-up en redressement judiciaire malgré de fortes subventions publiques (reporterre.net)
- Tempête Goretti : la centrale nucléaire de Flamanville à l’arrêt (reporterre.net)
RIP
- Généalogies féministes et fractures politiques : à la mémoire d’Eleni Varikas (blogs.mediapart.fr)
Le vendredi 9 janvier 2026, Eleni Varikas s’est éteinte à Paris. Son travail s’est concentré sur la théorie féministe, le colonialisme, les origines du racisme et les problématiques de l’exclusion. À travers une lecture exigeante de l’universalisme moderne, Eleni Varikas n’a cessé d’en interroger les angles morts, les exclusions constitutives et les hiérarchies qu’il prétend pourtant abolir.
Spécial femmes en France
- CNews : Le sexisme décomplexé de Ciotti envers Panot (humanite.fr)
Éric Ciotti s’est vautré dans le sexisme crasse envers Mathilde Panot. Une séquence qui a au moins le mérite de rappeler que l’extrême droite et ses alliés ne sont JAMAIS du côté de la lutte pour les droits des femmes.
- Écriture inclusive : l’Académie française « proteste solennellement » après cette décision de justice (huffingtonpost.fr)
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’une association qui cherchait à faire retirer deux plaques commémoratives dans un couloir de l’Hôtel de ville de Paris.
- La transparence salariale sera un choc culturel majeur pour les entreprises françaises (slate.fr)
les économistes tchèques Klára Kantová et Michaela Hasíková montrent –à travers une méta-analyse combinant 268 estimations issues de douze études menées dans plusieurs pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)– que les lois de transparence salariale entraînent en moyenne une réduction modeste mais significative des différences de salaire entre les hommes et les femmes, de l’ordre de 1,2 % en faveur des femmes. Cet effet provient généralement d’une légère hausse des salaires féminins, mais aussi d’une compression salariale, c’est-à-dire d’un ralentissement de la progression salariale masculine.
- Cyberharcèlement de Brigitte Macron : dix personnes condamnées jusqu’à six mois de prison ferme (huffingtonpost.fr)
Dans cette affaire, dix personnes étaient accusées d’avoir publié sur les réseaux sociaux des insultes et fake news sur le genre et l’âge de l’épouse d’Emmanuel Macron.
Voir aussi Face aux complotistes, la défense transphobe de Brigitte Macron (politis.fr)
En allant jusqu’aux États-Unis pour un nouveau procès où elle annonce qu’elle produira des preuves « scientifiques », elle crée un précédent dangereux pour toutes les femmes […] il n’existe scientifiquement pas de « vérité biologique » qu’elle puisse rendre publique et qui annulerait irrévocablement la multiplicité des possibles situations des personnes trans et intersexes.
- Brest : une femme retrouvée morte à son domicile, son compagnon placé en garde à vue (leparisien.fr)
Chaque jour en France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an selon les données 2024 de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées en novembre.
Spécial médias et pouvoir
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le “zéro mort” de franceinfo (arretsurimages.net)

- StreetPress épingle Off Investigation, qui assume puis se contredit (portail.basta.media)
Après une enquête de StreetPress révélant la collaboration d’Off Investigation avec quatre journalistes liés à des médias complotistes, antisémites ou d’extrême droite, le patron du média assume et dénonce une « chasse aux sorcières »… avant d’être désavoué par sa rédaction.
- En Bretagne, des journalistes empêchés d’enquêter : « On ressent une méfiance croissante vis-à-vis de la presse indépendante » (environnementsantepolitique.fr)
En décembre, le site indépendant « Splann ! » s’est vu refuser l’accès à un événement organisé par le conseil départemental du Finistère. Ses journalistes dénoncent une entrave à l’exercice de leur métier et un climat de défiance qui s’aggrave.
- À Perpignan, ville RN, le directeur de la police municipale attaque le média L’Empaillé (basta.media)
Le média du Sud-Ouest « L’Empaillé » comparaît devant le tribunal correctionnel de Perpignan ce 8 janvier après une plainte du directeur de la police municipale de la ville RN pour « injure publique ». Pour le journal, c’est une procédure-bâillon.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Emmanuel Macron n’imagine pas les États-Unis “violer la souveraineté danoise” au Groenland (franceinfo.fr)

- La DGSI reconduit Palantir : chronique d’une dépendance assumée en pleine tension transatlantique (synthmedia.fr)
- Le ministère de la Culture relaie une « hallucination » générée par IA (next.ink)
le ministère de la Culture vient lui-même de publier un communiqué de presse largement inspiré d’un billet de blog généré par IA, tout en y relayant une erreur « hallucinée » par l’IA.
- « On s’est fait rouler dessus par le privé » : des associations craignent une privatisation de l’Evars (basta.media)
Alors qu’un programme d’éducation à la sexualité est pour la première fois imposé à tous les établissements scolaires depuis la rentrée 2025, des associations, syndicats et enseignants s’inquiètent de l’arrivée d’acteurs privés sur le marché.
- Le débat à l’Assemblée sur la pétition contre la loi Duplomb reporté : « Une baffe dans la tête de plus de deux millions de Françaises » (vert.eco)
- Ces mesures de la loi Duplomb passées inaperçues (mais qui avancent en coulisses) (basta.media)
Cinq mois après sa promulgation, la loi Duplomb commence à être appliquée. Avec des effets très concrets sur le recours aux pesticides ou l’agrandissement des plus grandes exploitations d’élevage. Voici ce à quoi vous n’avez pas échappé.
- Dermatose nodulaire contagieuse : plus qu’une infection, un malaise (blogs.mediapart.fr)
Sous couvert de nécessité sanitaire, l’abattage massif des bovins face à la dermatose nodulaire contagieuse cristallise controverses techniques, fractures économiques et conflits politiques. Loin d’une simple crise cantonnée au monde vétérinaire, la DNC et sa gestion révèlent un modèle d’élevage fragilisé dans un contexte de défiance croissante envers les institutions politiques et scientifiques.
- Decathlon, Shein, Kiabi : les invendus servent à encaisser des millions d’euros d’argent public (reporterre.net)
La loi antigaspillage permet à la fast-fashion d’économiser 60 % d’impôts sur chaque vêtement donné à des associations comme Emmaüs, révèle Disclose avec Reporterre, à partir de documents confidentiels.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Campus IA : quand la concertation démocratique devient un théâtre d’acceptabilité sociale (synthmedia.fr)
- Publicité, surveillance, expropriation : une loi spéciale JO 2030 dérégule à tout va (reporterre.net)
Les députés doivent se prononcer le 6 janvier sur la loi pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2030. Ce texte vise à créer une longue liste de dérogations et passe-droits sociaux et environnementaux.
- Six élus RN dont trois députés membres d’un groupe Facebook raciste et islamophobe (humanite.fr)
“Qui aurait pu prédire ?” : six élus RN dont trois députés sont membres d’un groupe Facebook raciste et islamophobe, révèle le site Les Jours. Et ce n’est pas la première fois…
- Ardèche – Annonay : exclue depuis 2 mois du lycée car son bonnet de chimio est assimilé à un signe religieux (le-reveil-vivarais.fr)
- Attaque au couteau dans le métro parisien : quand la nationalité devient l’information (politis.fr)
L’attaque du 26 décembre a fait la une de l’actualité… et l’objet de nombreuses récupérations politiques racistes, remettant le débat sur les OQTF au cœur de la machine médiatique.
- L’homme qui avait écrasé un œuf sur Jordan Bardella condamné à de la prison avec sursis (huffingtonpost.fr)
Le prévenu, un agriculteur à la retraite de 74 ans, avait écrasé un œuf sur la tête du président du RN lors d’une séance de dédicace à Moissac en novembre.
Spécial résistances
- C’est TOUJOURS PAS notre guerre ! (cqfd-journal.org)
Que l’État et les réacs fassent feu de tout bois pour faire renaître en nous l’esprit de sacrifice et l’amour de la patrie, on l’avait vu venir. Mais que la gôche arpente à nouveau les sentiers guerriers, ça nous hérisse le crin. Réaction à chaud contre le retour du nationalisme belliqueux.
- De Paris au Kurdistan, une même exigence : vérité, justice et paix (humanite.fr)
Chaque 9 janvier, la mémoire rassemble. Treize ans après les assassinats de militantes kurdes à Paris, la mobilisation, samedi, a affirmé l’exigence de justice et dénoncé les bombardements visant les Kurdes en Syrie.
- « Virage autoritaire sur le système de santé » : pourquoi les médecins font grève (ou pas) (basta.media)
Les médecins ont lancé une grève de dix jours en début de semaine, pour protester contre un contrôle accru des arrêts maladie et des menaces de sanctions. Mais toutes les organisations professionnelles ne sont pas en accord avec ce mouvement.

- “Je préférerais plus de soutien politique et de financements” : pourquoi le président de France Nature Environnement refuse la Légion d’honneur (france3-regions.franceinfo.fr)
- Des tracteurs d’agriculteurices ont atteint la tour Eiffel et l’Arc de Triomphe à Paris malgré l’interdiction (huffingtonpost.fr)
- Incidents à répétition et dépassements des normes, le four numéro 2 de l’incinérateur d’ordures ménagères d’Ivry-Paris XIII doit fermer (collectif3r.org)
La publication le 6 janvier 2026 d’un article dans Le Monde révèle de nouveaux accidents et dépassements de polluants émis par l’ancien incinérateur d’Ivry-Paris-XIII et par le nouvel incinérateur de l’Interval.
Spécial outils de résistance
- Data centers : une carte exclusive des sites en projet (reporterre.net)
- Générateur de logo antifa (antifa.s3lph.me)

Spécial GAFAM et cie
- Google verrouille Android : la fin des ROMs customs est programmée (generation-nt.com)
- Google Is Adding an ‘AI Inbox’ to Gmail That Summarizes Emails (wired.com)
- Amazon’s AI assistant comes to the web with Alexa.com (techcrunch.com)
- Meta signs deals with three nuclear companies for 6-plus GW of power (techcrunch.com)
- Countries are outlawing online gambling ads. Meta is selling them anyway (restofworld.org)
A Rest of World analysis found Meta is disregarding local laws and the company’s own guidelines in at least 13 countries.
- An Instagram data breach reportedly exposed the personal info of 17.5 million users (engadget.com)
As spotted by Malwarebytes, the alleged leak includes usernames, email addresses, phone numbers and more.
- Comment le fameux « écran bleu de la mort » de Windows est devenu l’arme des hackers pour pirater des hôtels (numerama.com)
- Microsoft is slowly turning Edge into another Copilot app (windowscentral.com)
- Copilot could soon live inside Windows 11’s File Explorer, as Microsoft tests Chat with Copilot in Explorer, not just in a separate app (windowslatest.com)
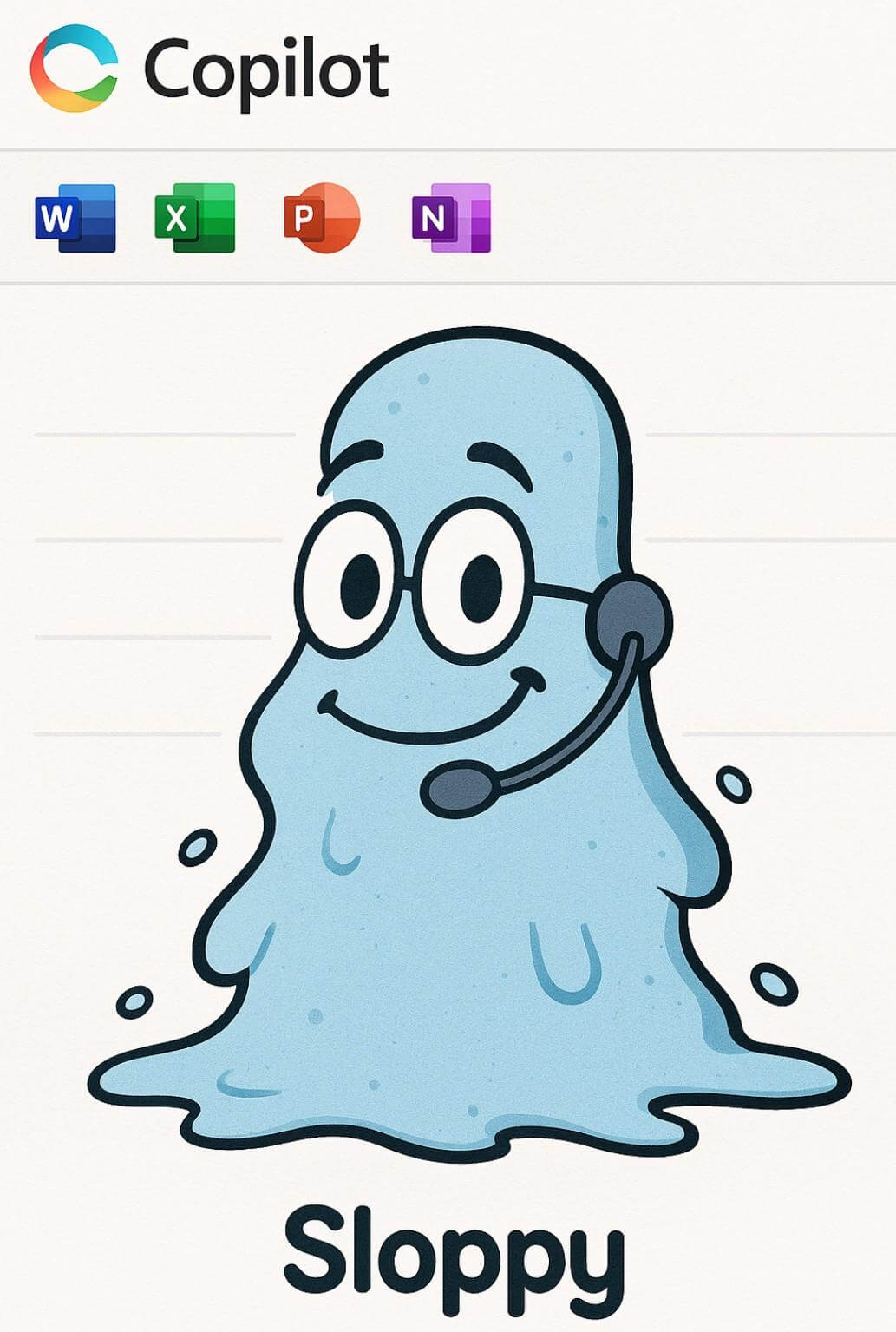
- Elon Musk says X’s new algorithm will be made open source next week (engadget.com)
That includes ‘all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users,’ he wrote.
- Tim Cook and Sundar Pichai are cowards (theverge.com)
X’s deepfake porn feature clearly violates app store guidelines. Why won’t Apple and Google pull it ?
Les autres lectures de la semaine
- Vers une fracture numérique : quand la géopolitique redessine l’open source en 2026 (goodtech.info)
- Trump may be the beginning of the end for ‘enshittification’ – this is our chance to make tech good again (theguardian.com)
- Poutine, Trump et un continent dans la tenaille : 10 points sur la défense européenne en 2026 (legrandcontinent.eu)
- Cinq scénarios pour le Venezuela post-Maduro (theconversation.com)
- Trump-Venezuela : le poids du droit, le choc de la légitimité (blogs.mediapart.fr)
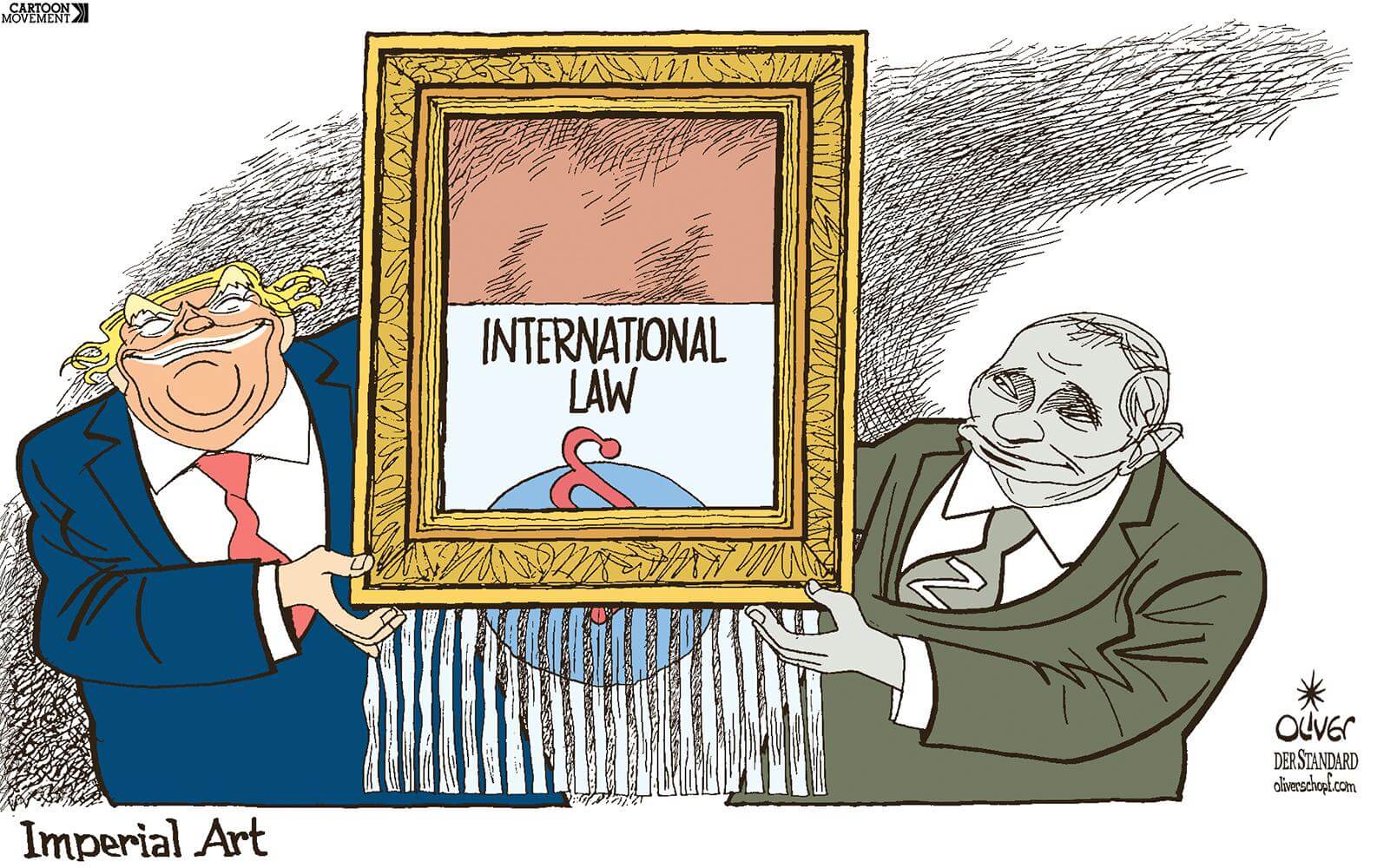
- Du Groenland à la Chine, la géopolitique de Donald Trump est structurée par une obsession : les terres rares (legrandcontinent.eu)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (contretemps.eu)
- Des technofascistes aux néolibéraux confus. Analyse internationale de la nouvelle vague réactionnaire (revuepolitique.be)
Alors que la montée des droites radicales bouleverse les équilibres démocratiques aux États-Unis et en Europe, les concepts habituels – « populisme », « post-vérité », voire « libéralisme » – semblent de moins en moins adaptés à décrire les forces à l’œuvre. Dans cet entretien, le philosophe Jean-Yves Pranchère démonte les étiquettes paresseuses, analyse la nouvelle grammaire autoritaire d’une galaxie moins unie qu’on pourrait le croire.
- C’est quoi « l’écosocialisme » ? (frustrationmagazine.fr)
- Communistes, socialistes, anarchistes… Comment nous définir ? (frustrationmagazine.fr)
- What FOI Data Shows About Trans Women in Single Sex Spaces (translucent.org.uk)
TransLucent’s Freedom of Information investigations across 382 public bodies, covering a period of over three years, found only four complaints about trans women using single-sex spaces, conclusively demonstrating that this widely publicised concern as part of the culture war against trans people is not supported by documented evidence from service providers.
- Échelles, cordes et serruriers : voici le récit insolite de la nuit où Napoléon a fait kidnapper… le pape (ouest-france.fr)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Stock market
- Médecins
- France
- Words
- Either
- Torch
- Salute
- Kaboum
- Maduro
- Trump
- Vocabulaire
- Ready
- Law
- Breaking
- Resistance
- Sloppy
- Antifa
- Wise
- Langues
- The Greek Mythology Family Tree : A Visual Guide Shows How Zeus, Athena, and the Ancient Gods Are Related (openculture.com)
- Lundi
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Watch 50 David Bowie Music Videos Spanning Five Decades of Reinvention : “Space Oddity,” “Life on Mars ?” “ ‘Heroes’,” “Let’s Dance” & More (openculture.com)
- Et même Bowie – Les Goguettes (en trio mais à quatre) (indymotion.fr)
- Alma Dufour met la pâtée à un mec du RN à propos du Venezuela (tube.fdn.fr)
- Le cordon sanitaire médiatique (radiofrance.fr)
Depuis 1988, nos voisins belges francophones ont mis en place une méthodologie médiatique restrictive pour les partis d’extrême droite. Stéphanie Thomas nous explique comment son pays défend un débat sans propos racistes ou discriminatoires.
- Choisir son nouveau fournisseur de messagerie | TUTO N°1 (tube.picasoft.net)
Les trucs chouettes de la semaine
- How the Free Software Foundation Kept a Videoconferencing Software Free (news.slashdot.org)
- Four More Tech Bloggers Are Switching to Linux (slashdot.org)
Is there a trend ? This week four different articles appeared on various tech-news sites with an author bragging about switching to Linux.
- Bose open-sources its SoundTouch home theater smart speakers ahead of end-of-life (arstechnica.com)
If companies insist on bricking gadgets, this is a better way to do it
- Pour retrouver un web douillet (clicetcetera.fr)
- Atlas sonore des langues régionales de France (atlas.lisn.upsaclay.fr)
- Dictionary of the Oldest Written Language–It Took 90 Years to Complete, and It’s Now Free Online (openculture.com)
It took 90 years to complete. But, in 2011, scholars at the University of Chicago finally published a 21-volume dictionary of Akkadian, the language used in ancient Mesopotamia. Unspoken for 2,000 years, Akkadian was preserved on clay tablets and in stone inscriptions until scholars deciphered it during the last two centuries.
- Biodiversité : en 2025, un nombre de poulpes « exceptionnel » (humanite.fr)
Les observations du céphalopode, réalisées par des plongeurs dans le cadre d’un programme scientifique participatif, ont révélé 1 500 % d’augmentation du poulpe commun par rapport au précédent pic de 2023.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
07.01.2026 à 10:00
Les Accords du Lion d’Or, un tiers-lieu à dimension culturelle en cours de dégafamisation
Framasoft
Texte intégral (3914 mots)
Parce qu’il nous semble toujours aussi important de promouvoir les démarches de transition vers les outils numériques éthiques opérées par les organisations, voici un nouvel opus pour notre série de témoignages de Dégooglisation. Un grand merci à Étienne d’avoir pris le temps de nous raconter comment le tiers-lieu Les Accords du Lion d’Or dans lequel il est investi, a changé de vie numérique..
Bonjour, peux-tu te présenter brièvement pour le Framablog ?
Bonjour, je suis Étienne régisseur et technicien du spectacle en transition, passionné d’informatique depuis fort longtemps, je quitte le milieu du spectacle pour me consacrer désormais à ma première passion. J’ai rencontré l’association Les Accords du Lion d’Or en 2016, un tiers-lieu à vocation culturelle fraîchement installé dans mon village natal, juste à côté de la ville dans laquelle je suis revenu m’installer après ma formation et quelques années de travail à Bruxelles.
C’est un projet aux multiples facettes, spectacles vivant, lieu de mémoire du village, projet de forêt nourricière, recherche sur le numérique, en lien avec les habitant⋅e⋅s… J’avais été invité à coanimer une rencontre avec des écoliers au sujet des photos et vieilles cartes postales du village, comment faire un travail de mémoire. C’est un projet qui ressemblait beaucoup à ce que j’avais moi-même vécu à l’école de Simandre en 2003 : numériser et classer dans une base de données sommaire, une partie de ces photos. C’est ainsi que j’ai rencontré l’association.
Située dans un lieu emblématique au cœur du village et de part la volonté d’être à la rencontre des habitants, de nombreuses histoires et matières, cartes postales, images, menus, récits et autres sont arrivées au Lion d’Or ; le besoin d’enregistrer et préserver les souvenirs s’est accentué.
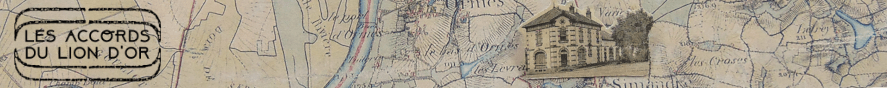
Entête du site Les Accords du Lion d’Or
Nous avons alors choisi de démarrer une base de données avec comme objet les images. Fort de mes convictions elle serait sur GNU/Linux, ce choix était entre mes mains et la confiance de l’équipe était là.
À ce jour, nous sommes un collectif multiforme, un conseil collégial d’administration, 1 salariée à 80 % chargée de missions, 1 salariée à 70 % animatrice nature, 1 salarié à 25 % agent en charge du développement des usages numériques en 2023 : c’est moi, une artiste plasticienne et trois artistes du spectacle pleinement impliqués dans la vie de l’association.
Au fil des projets il s’est avéré que plusieurs personnes au sein de l’équipe étaient sensibles aux questions de souveraineté numérique. Rapidement, nous nous sommes rendu compte des compétences que j’avais accumulées au fil des années et de l’intérêt pour l’association d’en faire un sujet commun.
Quel a été le déclencheur de votre dégafamisation ?
En fait on a pas vraiment eu un déclic, ça s’est fait au fur et à mesure en fonction des besoins des salariés de l’association. Pas à pas nous avons fait des choix de plus en plus importants toujours dans une démarche de recherche et d’expérimentation qui sont des valeurs importantes au Lion d’Or. Par exemple, le site de l’association est éco-conçu : sobriété et inclusion. Ce premier acte avait été posé avant même mon arrivée.
Ma rencontre avec l’association a probablement été un des déclencheurs tout de même, car j’arrivais avec une démarche engagée personnellement depuis longtemps : explorer l’auto-hébergement. J’ai apporté mon expérience du numérique dans plusieurs projets, lors de la création d’un escape-game en assistant l’équipe, dont le duo artistique « Scénocosme », la création de la base de données d’images, la création de documents pour les expositions en coopération avec les habitants… Et de fil en aiguille on a tissé ce lien de confiance avec un numérique différent.

Bannière du couple d’artistes Scénocosme
Comme nous sommes une petite équipe de salariés (en lien avec un conseil d’administration qui a confiance lui aussi !), la question de la dégafamisation nous concernait directement. Être peu nombreux a été clairement un atout pour la rapidité, la simplicité dans toutes les étapes de cette transition, on en reparlera souvent.
Tout le monde était éveillé d’une manière ou d’une autre sur le sujet, certains ayant déjà fait des choix pour leur vie numérique personnelle (il faut dire que dans les livres qui sont posés ici et là dans le tiers-lieu il y a Yggdrasil, Pablo Servigne, Cyril Dion, Socialter ;-)). Quand j’ai proposé de passer une première étape décisive, passer de GDrive à Nextcloud sur un petit NAS, le choix a été rapidement fait. Les quelques craintes soulevées ont été discutées directement and voilà ! Elles concernaient principalement le maintien des données, ne pas perdre le travail en cours. Nous n’avons rien perdu et ça a même été l’occasion de donner une nouvelle arborescence au dossier de travail qui avait déjà 3 ans de données.
Nous avons par la suite organisé une rencontre avec les membres du CA pour leur présenter les outils et les fonctionnements qui ont été reçus avec des avis mitigés mais confiants sur le moment car l’intérêt pour eux n’était pas direct.
Comment avez-vous organisé votre dégafamisation ?
Pour nous, ça s’est vraiment fait au fur et à mesure, à petit pas. L’association est toujours en recherche, en expérimentation sur tous les sujets qui la concerne, donc à chaque fois que nous nous posions la question nous pouvions faire un choix dans cette direction.
J’avais connaissance du réseau des C.H.A.T.O.N.S. et nous avons contacté Hadoly pour avoir un avis, c’est grâce à eux que nous utilisons Yunohost qui est un élément technique important de cette expérience.

Le logo d’HADOLY, un CHATON lyonnais qui vient de fêter ses 10 ans.
On peut résumer les grandes étapes qu’on détaillera plus bas :
- 2018 – réalisation du site internet en éco-conception
- 2019 – démarrage de la base de données d’images : GNU/Linux et DigiKam
- 2019 – N.A.S. pour les sauvegardes et première bascule pour le partage de fichiers et les agendas
- 2022 – installation d’un serveur dédié pour rapatrier plus de services.
- 2023 – changement de système d’exploitation pour 2 salariées de MacOS vers GNU/Linux
- 2024 – changement d’outil de comptabilité
Est-ce que vous avez rencontré des résistances que vous n’aviez pas anticipées, qui vous ont pris par surprise ? Au contraire, y a-t-il eu des changements dont vous aviez peur et qui se sont passés comme sur des roulettes ?
Ça a franchement roulé. Je crois que pour tous dans l’équipe la transition a été fluide même si elle a demandé des temps d’adaptation et lorsqu’il y avait à faire un ajustement, on a pu réagir tout de suite. Par exemple la migration des agendas, nous étions tous dans la même pièce et je guidais chacun·e dans la marche à suivre.
Une nouvelle fois, être en petit nombre a été un atout. Un autre point non négligeable est d’avoir quelqu’un « dédié » à la question, régulièrement présent pour répondre aux questions ou difficultés techniques. C’est presque de la formation continue. Les choses se sont faites au fur et à mesure et ça a permis à chacun et chacune de s’approprier chaque outil petit à petit. Un gros passage a quand même été le changement de système d’exploitation pour la chargée de mission, Véro, lors de notre première install’party, après 30 années avec MacOS, passer à Kubuntu a demandé beaucoup d’énergie et d’adaptabilité. Elle a fait preuve de beaucoup de souplesse et détermination pour changer d’un seul coup tout un environnement de travail (contact, e-mail, suite bureautique, classification…).

Kubuntu
On pourrait parler des problématiques techniques mais ça a quand même bien fonctionné de ce côté là, c’est aussi grâce à l’arrivée de la fibre optique dans le village qui nous a permis de franchir l’étape de l’auto-hébergement.
Parlons maintenant outils ! Quels outils ou services avez-vous remplacé, et par quoi, sur quels critères ?
Voici un tableau récapitulatif que je vais vous détailler ci-dessous :
| Phase | Service | Outil d’avant | Remplacé par |
| NAS 2019 | Agenda partagé | Google Agenda | Nextcloud calendar |
| Partage de fichiers | Google Drive | Nextcloud files | |
| Serveur auto-hébergé 2022 | E-mails | Gmail | Yunohost |
| Sondages | Doodle | Nextcloud poll | |
| Formulaires | Google forms | Nextcloud forms | |
| 2024 | Suivi des adhésions | Excel | Paheko |
| Comptabilité | Numbers | Paheko |
Les critères étaient simples :
- nous ne voulions pas donner d’argent à une entreprise comme Alphabet (maison mère de Google) ;
- nous avions besoin que ce soit ouvert, interopérable et que ça puisse durer dans le temps ;
- nous voulions de la collaboration.
C’est quand le compte Google à commencer à afficher « votre espace de stockage est faible » que les choses ont réellement commencé à bouger. On avait deux choix, payer pour agrandir le cloud ou trouver une autre solution. On venait tout juste d’acheter un NAS pour pouvoir sauvegarder notre base de donnée d’images, du stockage on en avait ! Ça a donc répondu à notre premier besoin, la ressource on l’avait, pas besoin de payer.
J’avais commencé à tester pour moi des systèmes avec Owncloud, avant même le fork qui a donné naissance à Nextcloud, et je trouvais ça « fou » ces outils, vraiment puissants. Nextcloud était apparu en 2016 avec des valeurs clairement posées, une communauté hyper active. J’ai donc proposé de l’installer sur notre NAS. Tout le monde est toujours partant pour les expériences ici. Ça répondait clairement à notre deuxième critère qu’on retrouve dans tous les logiciels libres, on pouvait y importer nos données existantes et on savait qu’on pourrait les récupérer à tout moment, pour les mettre ailleurs si notre expérience à domicile ne marchait pas.
Le choix de Nextcloud a été fait pour la simplicité de mise en œuvre. Une fois installé, nombres d’applications sont disponibles en un clic. On avait besoin du partage de fichier, l’agenda était là en même temps.
La suite découle un peu de ça, on avait Nextcloud, il était facile de rapatrier nos sondages et formulaires.
Rapatrier nos e-mails n’a pas été un choix facile, mais la volonté de le faire était vraiment très présente. Techniquement, j’avais mis le nez dans le système des e-mails mais c’est vraiment complexe et fragile. Quand Hadoly nous a parlé de Yunohost j’ai fait quelques mois de test et puis j’ai proposé à l’association une nouvelle expérience : depuis nous avons nos e-mails sur notre serveur.
Suite au passage en conseil collégial en 2023 et de changements qui en ont découlé, j’ai fait le constat suivant : Denis enregistrait les adhérents dans Paheko, Marie-Line faisait les dépôts en banque puis notait son travail dans un tableur, Gilles pointait les relevés de banque au fluo, Bénédicte triait les factures dans un classeur, Véro suivait un peu tout ça à la fois avec ses propres tableurs, Pierre faisait le suivi de trésorerie sur un autre tableur ; tout ceci coûtait beaucoup d’énergie à chacun et chacune et la mise en commun était laborieuse. J’avais mis à l’essai Paheko dans une association plus petite et je me suis vite rendu compte que ce pourrait être l’outil idéal pour que chacun puisse continuer à faire ce qu’il fait, en réduisant la lourde charge de la mise en commun. C’est donc le critère de la collaboration qui nous a permis cette dernière bascule.

Logo de Paheko, logiciel libre de gestion d’association.
Est-ce qu’il reste des outils auxquels vous n’avez pas encore pu trouver une alternative libre et pourquoi ?
Oui il en reste deux qui sont liés : les e-mails de notre lettre d’information (newsletter) et un moyen de communiquer sur nos évènements (Facebook).
La raison principale du non changement est le temps nécessaire à la transition et à l’apprentissage d’un nouvel outil. Nous avons regardé pour une alternative sur notre serveur (listmonk) mais il y a un gros travail à faire pour migrer depuis MailChimp et appréhender ce nouveau programme. Nous venons de toucher la limite des 2000 inscriptions d’un compte gratuit chez ce fournisseur, donc nous nous pencherons sur la question en 2025, une fois que nous aurons mené à bien la transition comptable vers Paheko.
Nous avons fait le choix fort de quitter Facebook, après avoir constaté que nous ne faisions que fournir de la matière première à cette entreprise afin qu’elle puisse placer ses annonces, les fils d’actu ne ressemblent plus à rien de nos jours, l’information n’arrive même plus jusqu’au destinataire. Nous avons regardé du côté de Mastodon mais ce n’est pas vraiment d’un réseau social virtuel dont nous avons besoin mais d’un espace ou pouvoir partager nos évènements et convier les publics. On pose tout de même nos évènements autour du numérique sur l’Agenda Du Libre.
Questionner notre communication nous pose grandement la question de l’attention disponible de manière générale.
Il y a aussi des considérations techniques plus ou moins abstraites. Dans l’univers des e-mails la chasse est vraiment faite aux indépendants par les entreprises qui monopolisent le domaine, les e-mails peuvent ne pas arriver à destination sans raison valable, une exclusion arbitraire peut tomber à tout moment et empêcher tous les e-mails d’arriver à destination. Je crois que les e-mails ne sont plus utilisés à bon escient de nos jours, cela en fait un système sur-sollicités, sous pression. Malheureusement c’est encore un canal précieux pour la communication.
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps on ne trouvait aucun C.H.A.T.O.N.S. dans la catégorie des campagnes d’e-mailing et ceux qui le proposent maintenant, n’assurent pas livraison des e-mails, seulement leur création.
Quels étaient vos moyens humains et financiers pour effectuer cette transition vers un numérique éthique ?
Alors concernant le matériel nous avions obtenu une subvention de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l’achat du NAS et du PC qui accueillerait la base de données d’images.
Nous avons aussi été soutenus par la CAF, une de nos partenaires pour le faible investissement qu’a représenté l’achat du serveur d’occasion de la phase 2.
Pour le travail humain la première phase de mise en route s’est faite bénévolement, la place pour l’expérimentation est grande ici au Lion d’Or, cela correspond aussi à la période COVID ou j’avais pas mal de temps disponible. Pour la deuxième phase nous avons obtenu un financement du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) pour mon poste à 1/4 de temps (35h/mois) pour le « développement des usages du numérique » qui comprenait un temps dédié à la mise en place de ces nouveaux outils entre-autres.

Étienne lors d’un accompagnement individualisé. (source : site Les Accords du Lion d’Or)
Est-ce que votre dégafamisation a un impact direct sur votre public ou utilisez-vous des services libres uniquement en interne ? Si le public est en contact avec des solutions libres, comment y réagit-il ? Est-il informé du fait que ça soit libre ?
Comme je le disais plus haut, c’est vraiment ce qui a fait notre force pour cette transition, le fait que je sois présent sur plusieurs projets ici a permis un accompagnement régulier des salariés et des autres utilisateurices.
Je mène aussi un atelier mensuel que nous avons appelé Causeries, ou nous traversons de nombreux sujets autour du numérique et où j’ai régulièrement l’occasion de présenter nos outils et détailler leur fonctionnement.

La causerie informalion (Source : site Les Accords du lion d’Or)
Quels conseils donneriez-vous à des structures comparables à la vôtre qui voudraient se dégafamiser aussi ?
Cette dégafamisation a principalement un impact interne à l’association. Nous avons un peu communiqué sur le sujet mais notre public est peu confronté à ce changement, quelques dossiers partagés, quelques sondages, surtout à l’adresse des adhérents. Les retours sont neutres.
C’est quelque-chose que l’on pourrait voir changer, nous n’avons eu absolument aucuns soucis jusqu’à présent et nous débattons de la possibilité d’ouvrir des accès à d’autres structures proches ou aux adhérents. Faire comprendre la nature expérimentale du projet et ramener sur le devant le fait que les services proposés sont à échelle modeste et donc faillibles, est une question à ne pas prendre à la légère mais correspond intégralement aux valeurs de l’association, « parfaitement imparfait » disons-nous souvent ici. Ramener cette faillibilité c’est remettre en question nos usages, la dépendance que nous avons à nos outils et trouver des solutions de repli, retrouver une échelle de temps plus souple sont des valeurs que nous portons pour l’avenir.
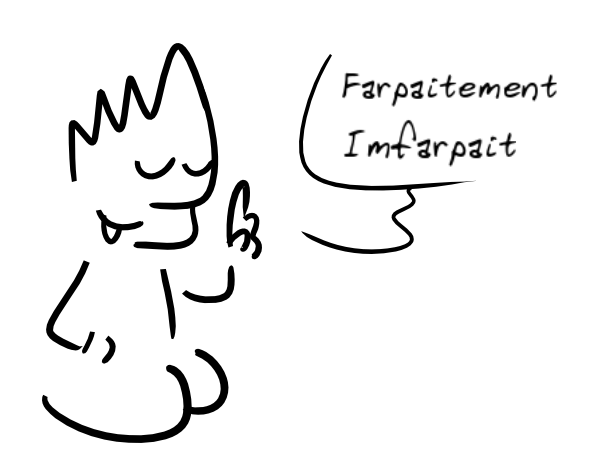
Un mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
En ce tournant vers le monde du libre et en acceptant les remises en questions liées, on gagne en liberté, de moyens, de mouvements et en humanité.
Et n’hésitez pas à venir faire un tour au Lion d’Or pour en discuter !
05.01.2026 à 07:42
Khrys’presso du lundi 5 janvier 2026
Khrys
Texte intégral (7413 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- The Earth Is Nearing an Environmental Tipping Point (wired.com)
Today’s global coral bleaching events are the worst kind of climate warning.

- Les milliardaires, un petit monde toujours plus riche et inégalitaire (alternatives-economiques.fr)
La fortune globale des milliardaires a encore fortement augmenté en 2024, mais elle se concentre au sein des pays les plus riches, et chez une vingtaine d’individus possédant plus de 50 milliards de dollars chacun.
- 2025 : The Year in Review (crimethinc.com)
- From Street Protests to Policy Shifts : India’s Environmental Year in Review (indiaspend.com)
From protests against air pollution in the national capital region to protests to save the trees in Nashik’s Tapovan, and from policies to curb greenhouse gas emissions to policies that further forest diversion, this year saw it all
- Que se passe-t-il en Iran, secoué par une « révolte » depuis quatre jours (huffingtonpost.fr)
Des manifestations spontanées contre l’hyperinflation et le marasme économique ont débuté dimanche avant de gagner en ampleur.
- Donald Trump et l’Iran s’échangent des menaces sur fond de manifestations dans le pays (huffingtonpost.fr)
En réaction aux mobilisations contre la vie chère en Iran, qui ont déjà fait six morts, Donald Trump s’est dit prêt à intervenir militairement pour secourir la population.

- La Bulgarie s’apprête à adopter l’euro alors que la moitié de ses habitant·es y est opposée (huffingtonpost.fr)
À minuit, le petit État des Balkans de 6,4 millions d’habitants dira adieu à 2025 mais aussi à sa monnaie, le lev, en circulation depuis la fin du XIXe siècle.
- Berlin bascule dans une logique d’État de guerre (lvsl.fr)
Explosion des budgets militaires au détriment de tous les services publics, retour du service militaire, discours catastrophistes sur l’imminence d’une attaque russe, propagande dans les écoles… Depuis 2022, l’Allemagne, comme presque tous les autres pays européens, s’est engagée dans un énorme effort d’armement, qui renforce le risque d’un conflit de grande ampleur.
- Polémique aux Pays-Bas après le retrait de panneaux en mémoire de soldats afro-américains dans un cimetière militaire (rtbf.be)
Des panneaux rappelant le rôle des soldats afro-américains dans les rangs de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale ont été retirés du mémorial d’un cimetière américain aux Pays-Bas. Des documents obtenus par plusieurs médias prouvent que cette disparition faisait suite à la politique anti-inclusion mise en place par l’administration Trump.
- Les cyberattaques contre les organisations belges explosent (lesoir.be)
- L’Europe « a perdu l’accès à internet » : le terrible aveu d’un responsable belge (lanouvelletribune.info)
- Incendie à Crans-Montana : comment fonctionne le soutien de l’UE et pourquoi la Suisse y a accès (huffingtonpost.fr)
La Suisse ne compte qu’une vingtaine de lits pour soigner les grands brûlés. Elle a donc fait appel à l’UE pour une prise en charge efficace et coordonnée des nombreux blessés.
- Condamnation de Marine Le Pen : des magistrats français dans le viseur de l’administration Trump (lexpress.fr)
D’après “Der Spiegel”, l’administration Trump aurait envisagé des sanctions contre les juges ayant condamné la figure du Rassemblement national en mars dernier. Des mesures de ce type sont aussi évoquées contre des fonctionnaires allemands.
- Trump attaque des Européen·nes luttant contre la désinformation climatique (reporterre.net)
- NJ’s answer to flooding : it has bought out and demolished 1,200 properties (arstechnica.com)
Sea level rose about 1.5 feet along the New Jersey coast in the last 100 years—more than twice the global rate—and a new study by the New Jersey Climate Change Resource Center at Rutgers University predicts a likely increase of between 2.2 and 3.8 feet by 2100, if the current level of global carbon emissions continues.
- Zohran Mamdani investi à New York par Bernie Sanders, première image forte des États-Unis en 2026 (huffingtonpost.fr)
« Je gouvernerai comme un socialiste démocrate », a promis Zohran Mamdani. Après une première prestation de serment devant la procureure démocrate et ennemie de Trump Letitia James, c’est face au champion de la gauche américaine Bernie Sanders que le nouveau maire de New York a lancé son mandat ce jeudi 1er janvier.
- Big Tech basically took Trump’s unpredictable trade war lying down (arstechnica.com)
From Apple gifting a gold statue to the US taking a stake in Intel.
- Judge To Texas : You Can’t Age-Gate The Entire Internet Without Evidence (techdirt.com)
- Trump Spent 2025 Making Trans Lives Unlivable. It’s Time for Democrats to Defend Them. (theintercept.com)
Elected Democrats haven’t done nearly enough to oppose attacks on gender-affirming care. They risk being on the wrong side of history.
- Curtis Yarvin : le plan pour faire de l’Amérique un État-parti fasciste (legrandcontinent.eu)
Le théoricien des Lumières sombres écouté par J. D. Vance, appelle pour la première fois explicitement Trump à faire sa mue fasciste.
- Victoire de Kast au Chili : la « voie démocratique » vers le pinochetisme (contretemps.eu)
Avec la victoire présidentielle de José Antonio Kast au Chili, le pinochetisme revient au pouvoir par la voie électorale, articulant restauration néolibérale, autoritarisme moral et anticommunisme comme réponse à la crise chilienne.
- Researchers make “neuromorphic” artificial skin for robots (arstechnica.com)
Spécial IA
- OpenAI veut absolument nous faire croire que GPT-5 a le niveau d’un chercheur (next.ink)
- ChatGPT accusé d’avoir encouragé le meurtre perpétré par un utilisateur puis son suicide (next.ink)
- xAI silent after Grok sexualized images of kids ; dril mocks Grok’s “apology” (arstechnica.com)
For days, xAI has remained silent after its chatbot Grok admitted to generating sexualized AI images of minors, which could be categorized as violative child sexual abuse materials (CSAM) in the US.According to Grok’s “apology”—which was generated by a user’s request, not posted by xAI—the chatbot’s outputs may have been illegal
- WordPress wants to force AI onto 43 % of all websites in the world (pivot-to-ai.com)
- YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (kulturegeek.fr)
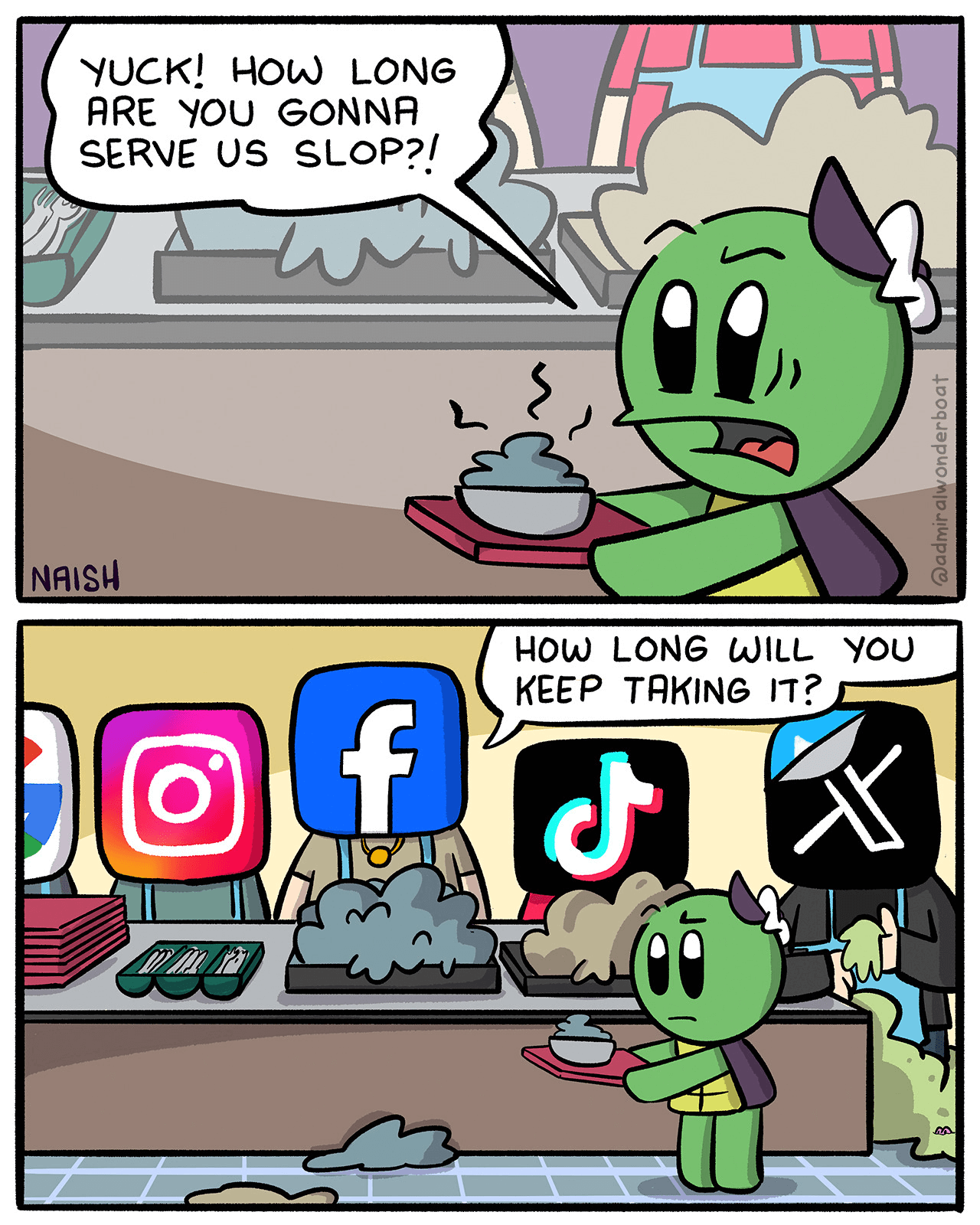
- L’IA a encore enrichi les milliardaires de la tech, et en fait émerger 50 nouveaux (next.ink)
- La Chine veut empêcher les chatbots d’IA de manipuler leurs utilisateurices (next.ink)
La Cyberspace Administration of China (CAC) vient de publier un appel à commentaires au sujet de « mesures provisoires pour l’administration des services interactifs anthropomorphes d’intelligence artificielle » […] Ces règles « constitueraient la première tentative mondiale de réglementation de l’IA dotée de caractéristiques humaines ou anthropomorphiques »
- From prophet to product : How AI came back down to earth in 2025 (arstechnica.com)
In a year where lofty promises collided with inconvenient research, would-be oracles became software tools.
- Exclusive : Groq investor sounds alarm on data centers (axios.com)
Venture capitalist Alex Davis is “deeply concerned” that too many data centers are being built without guaranteed tenants, according to a letter being sent this morning to his investors.
- ‘If this is a joke, the punchline is on humanity’ : Replacement AI blurs line between parody and tech reality (kron4.com)
Anyone driving across the Bay Bridge into San Francisco in the past year has likely noticed the surge of AI-themed billboards lining the highway. […] One reads : “AI does your daughter’s homework. Reads her bedtime stories. Romances her. Deepfakes her. Don’t worry. It’s totally legal.” Visitors to the Replacement AI website are greeted with a banner declaring, “Humans are no longer necessary.”
- An artificial intelligence that writes police reports had some explaining to do earlier this month after it claimed a Heber City officer had shape-shifted into a frog. (fox13now.com)
“The body cam software and the AI report writing software picked up on the movie that was playing in the background, which happened to be ’The Princess and the Frog” […] “That’s when we learned the importance of correcting these AI-generated reports.”
- “April Fools in December” : Hundreds of people waited at the Brooklyn Bridge for fireworks that never came, all because of AI slop (dailydot.com) In the days leading up to New Year’s Eve, AI-generated posts flooded social media, showing fireworks over the Brooklyn Bridge. These posts claimed the fireworks would be part of the city’s New Year’s Eve festivities.
- The Problem With Letting AI Do the Grunt Work (theatlantic.com)
Artificial intelligence is destroying the career ladder for aspiring artists.
- ‘It won’t be so much a ghost town as a zombie apocalypse’ : How AI might forever change how we use the internet (livescience.com)
- « Allez vous faire foutre » : un agent IA envoie un spam et déclenche une polémique (next.ink)
Le 25 décembre 2025, Rob Pike, co-créateur du langage Go et de l’encodage UTF-8, a reçu un e-mail non sollicité généré par une IA. Le message, signé « Claude Opus 4.5 », le remerciait pour ses contributions à l’informatique. Sa réaction a été explosive, cristallisant plusieurs critiques récurrentes autour de l’IA générative. […] « Allez vous faire foutre. Vous pillez la planète, vous dépensez des milliards en équipements toxiques et non recyclables, vous détruisez la société, et vous trouvez le temps de faire en sorte que vos machines immondes me remercient de militer pour des logiciels plus simples. Allez tous vous faire foutre. Je ne me souviens pas avoir été aussi en colère depuis longtemps »
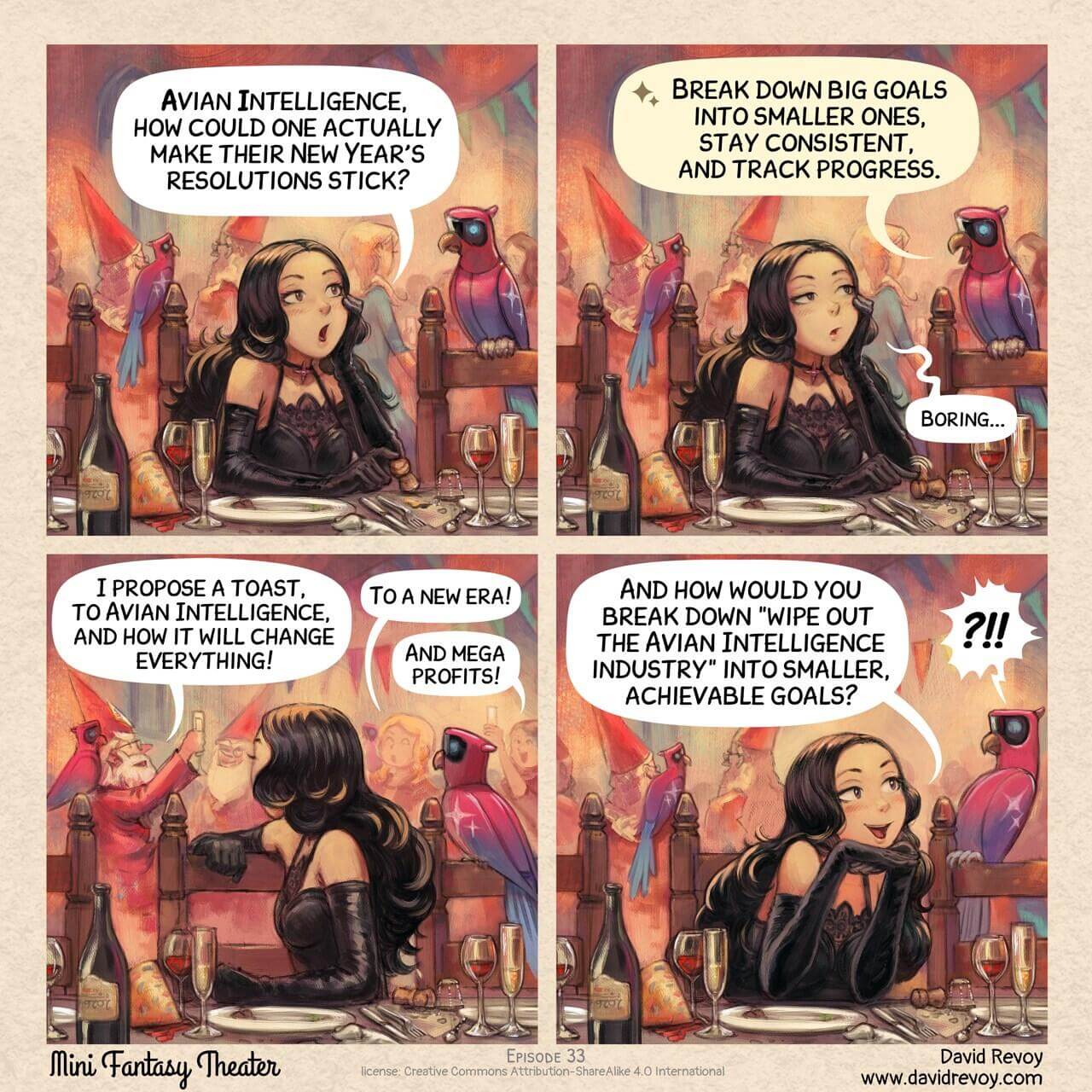
Spécial Venezuela
- Trump confirme que les États-Unis ont bombardé une cible au Venezuela (legrandcontinent.eu)
Selon Donald Trump, les États-Unis auraient détruit au Venezuela une zone de mise à quai pour des navires prétendument impliqués dans du trafic de drogue.
- Venezuela : fortes explosions et survols d’avions entendus à Caracas (france24.com)
Des explosions ainsi que des survols d’avions ont été entendus dans la nuit de vendredi à samedi à Caracas, capitale du Venezuela. Des déflagrations qui surviennent alors que le président américain, Donald Trump, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et a directement menacé le président Nicolas Maduro.
- Nicolás Maduro incarcéré à New York, Delcy Rodriguez chargée d’assurer l’intérim au Venezuela (huffingtonpost.fr)
Des images de l’AFP ont montré le dirigeant vénézuélien sortant d’un avion sous escorte dans un aéroport du nord de New York, puis son arrivée à Manhattan par hélicoptère.
- Les États-Unis interviennent au Venezuela et capturent Nicolas Maduro et son épouse (fr.euronews.com)
“Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés dans le district sud de New York. Nicolas Maduro a été accusé de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis” écrit la procureure générale des États-Unis.
- Après la capture de Maduro Trump annonce la prise du contrôle du Venezuela par les États-Unis : texte intégral de la conférence Mar-a-Lago (legrandcontinent.eu)
- Someone made a huge profit predicting Maduro’s capture. Here’s what happened (axios.com)
- Après Maduro, les États-Unis menacent ouvertement Cuba et le président colombien (huffingtonpost.fr)
Donald Trump a notamment déclaré que son homologue colombien, Gustavo Petro, devrait « faire gaffe à ses fesses » désormais.
- Venezuela : La réaction de Macron à la capture de Maduro saluée par Trump, étrillée en France (huffingtonpost.fr) – voir aussi Venezuela : Emmanuel Macron salue la fin de la « dictature Maduro » et appelle à une « transition démocratique » (leparisien.fr)
De son côté, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, lors d’un rassemblement de soutien au peuple vénézuélien à Paris, a dénoncé le « pur impérialisme » américain et attaqué le silence d’Emmanuel Macron.”La prise de position de Macron n’est pas la voix de la France. Il nous fait honte. Il abandonne le droit international.”
Et La réaction de Macron continue de susciter de vives critiques (lorientlejour.com)
- Les pays ayant condamné l’opération militaire américaine au Venezuela représentent un quart de la population et du PIB mondial (legrandcontinent.eu)
- Zelensky n’a pas pu réfréner ce sarcasme après la capture de Maduro par les États-Unis (huffingtonpost.fr)
« S’il est possible de régler le problème des dictateurs de cette manière, aussi facilement, alors les États-Unis d’Amérique savent ce qu’il leur reste à faire », a-t-il affirmé, un sourire en coin.
- Pourquoi une intervention des États-Unis au Venezuela ? (humanite.fr)
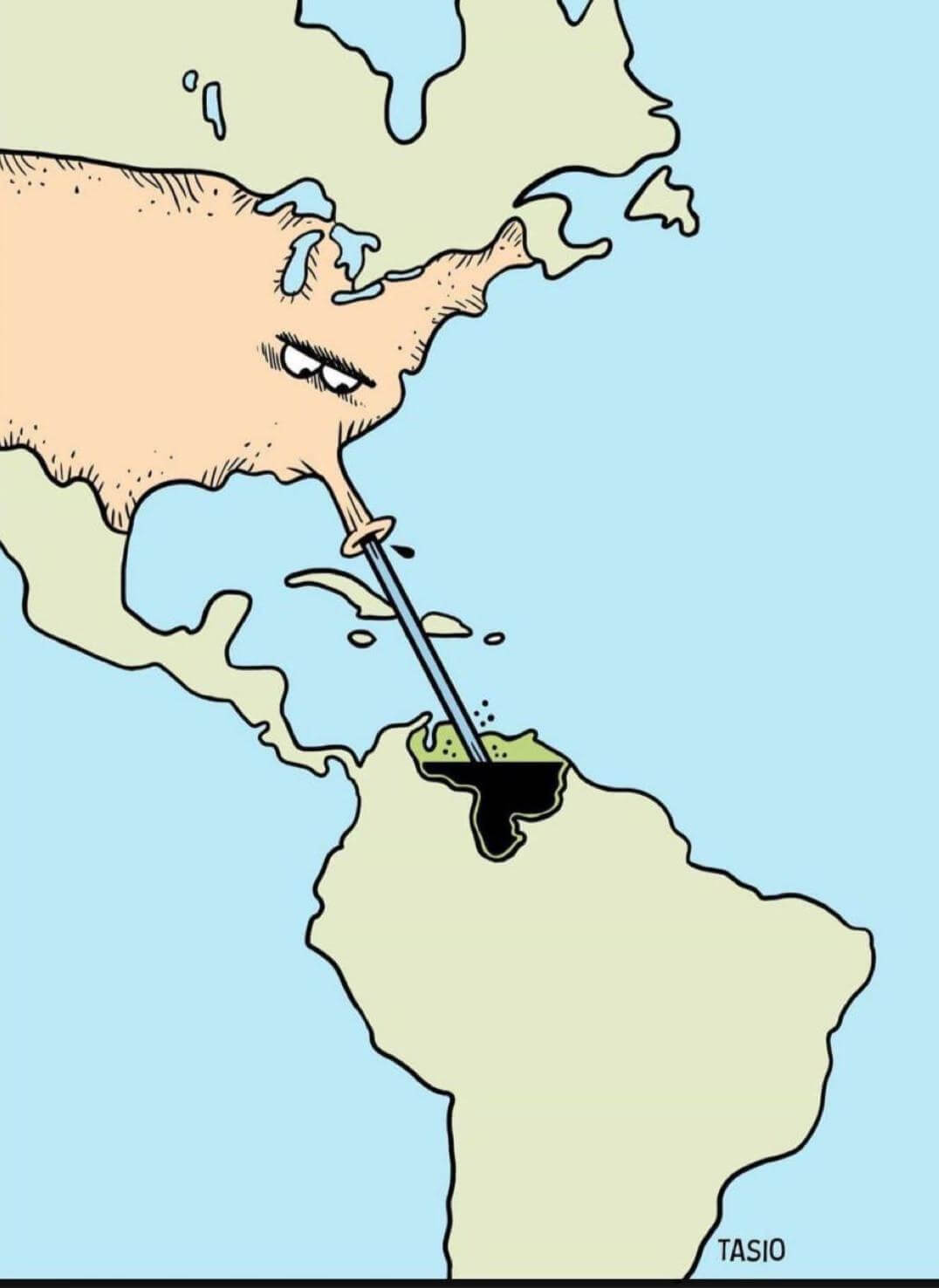
- Attaque du Venezuela : contrer la propagande “démocratique” (frustrationmagazine.fr)
Spécial Palestine et Israël
- Reconnaissance du Somaliland par Israël : comment interpréter cette décision inédite ? (slate.fr)
Depuis le 26 décembre, Israël reconnaît officiellement l’indépendance du Somaliland, territoire de la Corne de l’Afrique qui a fait sécession de la Somalie et république autoproclamée depuis 1991.
- Netanyahu décerne le prix de la paix israélien à Trump (huffingtonpost.fr)
En annonçant remettre à Donald Trump ce prix de la paix, la plus haute distinction civile israélienne, Benjamin Netanyahu rompt avec une tradition vieille de plusieurs décennies consistant à le décerner à un citoyen israélien.

- Gaza : Israël va interdire l’accès à 37 ONG, dont MSF et Handicap International, si elles ne donnent pas une « liste de leurs employés palestiniens » (lemonde.fr)
- Entre politique et poétique. – À propos d’un colloque international sur Gaza au Collège de France (blogs.mediapart.fr)
Spécial femmes dans le monde
- Des féministes chinoises réinventent la langue pour s’attaquer au patriarcat (ici.radio-canada.ca)
En Chine, des féministes remodèlent le mandarin écrit en modifiant d’anciens caractères et en inventant de nouveaux termes afin de contester le système patriarcal qui a longtemps dévalorisé les femmes.
- Ces skateuses Éthiopiennes défient le patriarcat et les traditions (lareleveetlapeste.fr)
Dans les rues d’Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, retentissent les roulettes des skateboards d’un groupe de femmes qui défient les normes sociales et réinventent leur liberté. Dans une société conservatrice, où les sports et l’espace public sont principalement réservés aux hommes, ce mouvement féminin fait parler de lui.
- Soudanaise en exil, elle dénonce les crimes contre les femmes de son pays et l’indifférence du monde (basta.media)
Victimes d’une « guerre internationale pour les ressources », les femmes du Soudan font face aux violences quotidiennes. Alaa Busati, avocate et militante soudanaise en exil, recueille témoignages et preuves pour porter leurs voix devant la justice.
- En RDC, l’arrêt des subventions américaines pénalise les femmes victimes de viols, privées de soins d’urgence (slate.fr)
La suppression de l’aide humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) a stoppé la distribution de soins indispensables pour prévenir les grossesses et les infections sexuellement transmissibles après une agression sexuelle.
- Men embodying women in VR report strong emotional reactions to verbal harassment (phys.org)
The group that experienced verbal harassment reported levels of fear similar to those of participants who did not undergo the catcalling scenario. According to the researchers, this may indicate that simply experiencing the initial situation—a young woman alone, at night, in a subway station—is enough to generate a sense of fear, even among men.
- Woman felt ‘dehumanised’ after Musk’s Grok AI used to digitally remove her clothes (bbc.co.uk)
Samantha Smith shared a post on X about her image being altered, which was met with comments from those who had experienced the same – before others asked Grok to generate more of her.”Women are not consenting to this”
Voir aussi Grok déshabille les femmes sans leur consentement sur X, un acte puni par la loi (huffingtonpost.fr)
« Cette année commence bien en matière de culture du viol… L’IA n’est juste qu’un outil de plus pour les agresseurs… donnant peut être à certains l’illusion facile de ne pas en être. Ne la leur laissez pas. Affichez ces porcs. Continuez à faire ce que vous voulez de vos corps », s’est insurgée la députée LFI Sarah Legrain
Et Sexisme : militantes et responsables politiques alertent sur l’usage de l’IA Grok pour déshabiller virtuellement des femmes sans leur consentement (humanite.fr)
- Everything We Know About Rape Is Wrong (theatlantic.com)
Girls Play Dead is a transformative analysis of what sexual assault does to women.
RIP
- In memoriam Mohammed Harbi (1933-2026) (blogs.mediapart.fr)
Le politiste Nedjib Sidi Moussa retrace la trajectoire militante et savante de Mohammed Harbi, mort le 1er janvier 2026 à Paris. Engagé très tôt pour l’indépendance, promoteur de l’autogestion après 1962, emprisonné sous Boumédiène et exilé en France, historien critique du mouvement national, il fut « un intellectuel postcolonial total et un socialiste internationaliste impénitent ».
- Science-fiction : Pierre Bordage nous a quitté (actusf.com)
- Mort de Cecilia Giménez, autrice de cette restauration d’un tableau du Christ tristement inoubliable (huffingtonpost.fr)
Entre consternation des protecteurs du patrimoine et hilarité des internautes, le travail de Cecilia Giménez n’avait clairement pas fait l’unanimité.
Spécial France
- La DGSI exhibe les erreurs de 3 entreprises françaises piégées par des outils d’intelligence artificielle (clubic.com)
Les dérives de l’intelligence artificielle en entreprise inquiètent la DGSI, la Direction générale de la Sécurité intérieure, qui alerte sur les risques d’ingérence, liés aux documents confidentiels exposés ou encore aux deepfakes.

- Sophia Chikirou sera jugée pour escroquerie juste après les municipales (huffingtonpost.fr)
L’avocat de la candidate LFI dénonce une volonté de la « salir » avant les élections municipales à Paris.
- En France, l’écart entre l’espérance de vie des plus riches et celle des plus pauvres se creuse (europe-solidaire.org)
Pour 40 % de la population française, l’écart d’espérance de vie avec les 5 % les plus riches s’est creusé au cours des douze dernières années. C’est le produit de politiques publiques qui refusent de prendre en compte le lien entre inégalités de revenus et inégalités d’espérance de vie.
- “Je ne pouvais pas donner d’argent car je n’avais pas de monnaie” : dans dix villes de France, on peut désormais faire des virements aux sans-abri (franceinfo.fr)
- Le réseau de bus TADAO est désormais gratuit pour les habitant·es du bassin minier du Pas-de-Calais (francebleu.fr)
- Liquidation de Brandt : en cas de panne, le SAV va-t-il fonctionner ? (60millions-mag.com)
Si votre cuisine est équipée d’électroménager Brandt, de Dietrich, Sauter ou Vedette ou si vous envisagez un achat prochainement, gare à la panne.
- A69 : la justice valide la poursuite du chantier (reporterre.net)
Le tribunal administratif d’appel de Toulouse a scellé l’avenir de l’autoroute A69, le 30 décembre, en autorisant la poursuite du chantier. Les militant·es ont annoncé engager un pourvoi en cassation.
Voir aussi L’A69 ressuscitée par la justice : explication d’un rétropédalage « lapidaire » (reporterre.net)
- Un tireur sportif agressé chez lui à Villeurbanne, neuf armes et 1 300 cartouches dérobées (franceinfo.fr)
Ces faits surviennent après le piratage des données personnelles de centaines de milliers d’adhérents de la Fédération française de tir, et qui ont été utilisées notamment “pour commettre des vols par effraction”.
Spécial femmes en France
- Briser le silence avec un micro (cqfd-journal.org)
Vingt ans après avoir subi un inceste de la part de son beau-père, Léna Rivière cherche « la voix des autres », ses proches et les autres victimes du même agresseur. Le processus aboutit au magnifique documentaire radiophonique « Queen of Bongo », réflexion sur la justice, le pardon et, en creux, le pouvoir du micro.
- Le suspect de l’agression au couteau de trois femmes dans le métro parisien avait en fait la nationalité française, Nuñez admet un « dysfonctionnement » (huffingtonpost.fr)
Dans un communiqué vendredi soir, le ministère de l’Intérieur avait indiqué que le suspect était « de nationalité malienne » et « en situation irrégulière sur le territoire national ».
Spécial médias et pouvoir
- Bernard Arnault et LVMH rachètent « Challenges », « Sciences et Avenir » et « La Recherche » (huffingtonpost.fr)
L’homme d’affaires Claude Perdriel, qui en était l’actionnaire majoritaire jusqu’alors, avait convenu de cette cession, pour un euro symbolique.
- CNews mise en demeure par l’Arcom pour deux séquences incitant « à la discrimination » (huffingtonpost.fr)
Si l’Arcom dit ne pas avoir relevé de problème de pluralisme sur CNews après de récentes enquêtes sur le sujet, elle épingle à nouveau la chaîne pour son traitement de l’immigration et l’islam.
- Le loup mal aimé d’Intermarché, fact-checking (bloomassociation.org)
- Notre Dry January : essayez un mois sans les médias des milliardaires (reporterre.net)
La liste des médias indépendants offre un large éventail de choix pour s’informer via un travail professionnel de qualité. Le portail des médias indépendants constitue, par exemple, une bonne ressource où piocher.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Emmanuel Macron raillé après ses vœux aux Français pour 2026, du RN à LFI (huffingtonpost.fr)
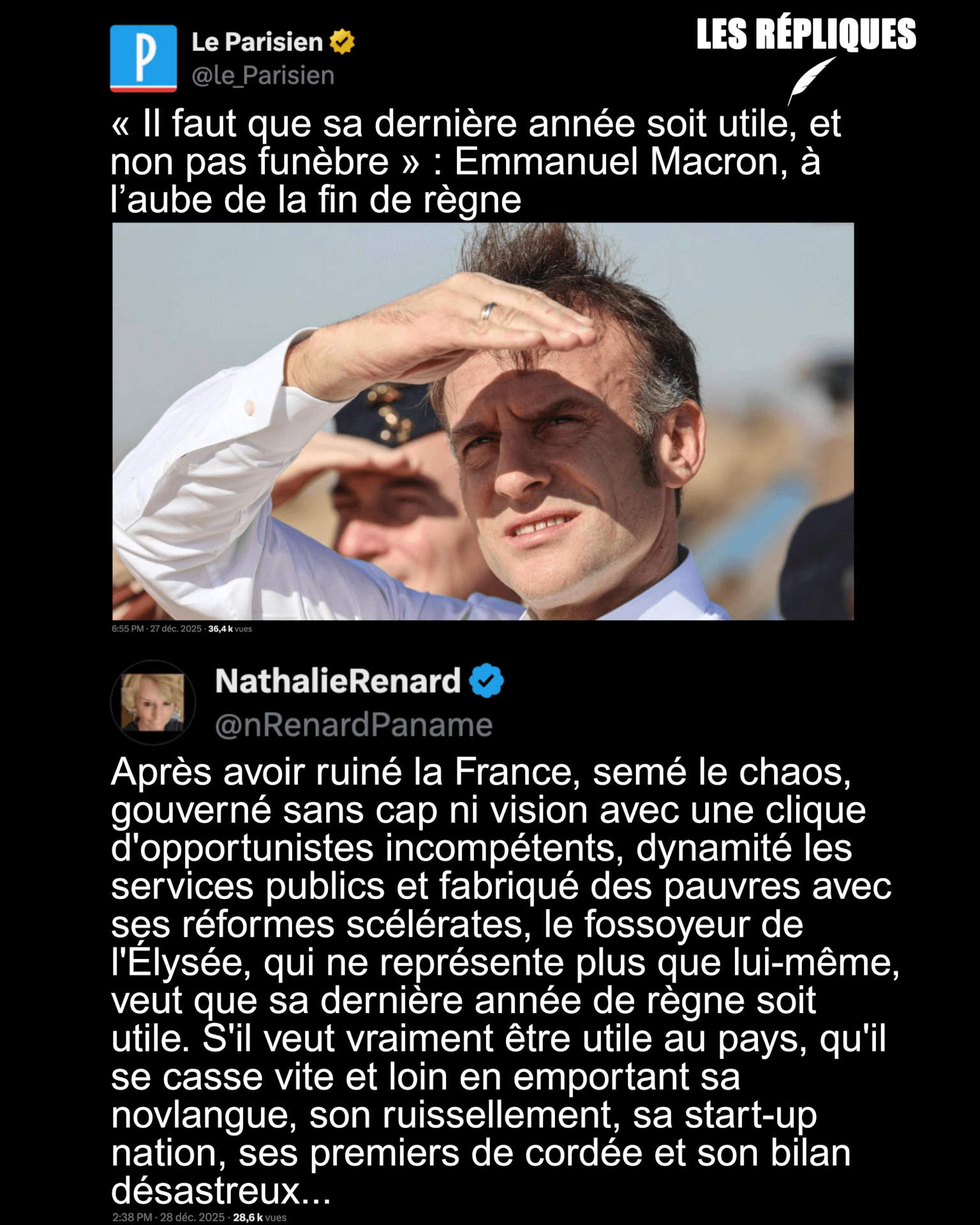
- La France commande deux avions de surveillance GlobalEye au fabricant suédois Saab pour 1,1 milliard d’euros (lemonde.fr)
- Une liaison TGV Lyon Bordeaux en 2027 : la nouvelle aberration signée SNCF (aurail.eu)
- Arrêts maladie : « Le discours de culpabilisation ambiant pousse les salarié·es à ne pas écouter les alertes de leur corps » (humanite.fr)
- Prévue pour 2026, l’interdiction des gobelets jetables composés de plastique reportée à 2030 (humanite.fr)
Selon un arrêté publié mardi 30 décembre, le gouvernement a décidé de remettre à 2030 l’interdiction des gobelets jetables en partie composés de plastique. Les autorités justifient ce report par un manque d’alternative dans l’immédiat. Un nouveau bilan d’étape sera réalisé en 2028.
- Pesticides, océans… 5 mensonges du gouvernement sur l’écologie en 2025 (reporterre.net)
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Ces patrons qui murmurent aux oreilles du Rassemblement national (humanite.fr)
Depuis trois ans, les rendez-vous entre chefs d’entreprise et représentants du Rassemblement national, jadis tabous, se multiplient. Des rencontres qui en disent autant sur le renoncement des milieux d’affaires que sur l’évolution du programme économique de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
- Violences de la Coordination Rurale contre les associations : ça continue et c’est insupportable (fne.asso.fr)
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2025, les locaux de FNE Nouvelle Aquitaine, Poitou Charente Nature et Vienne Nature ont été vandalisés par la Coordination Rurale. Ces actes interviennent une semaine après la dégradation des locaux de Nature Environnement 17 et de la LPO par les représentants du même syndicat. Et quelques semaines à peine après l’appel à « faire la peau » aux écologistes lancé par le nouveau président de la Coordination Rurale.
- Nuñez explique sa décision de ne pas saisir l’IGPN après les images d’un agriculteur mis en joue par la police (huffingtonpost.fr)
À Auch, dans le Gers, des policiers avaient sorti leur arme pour stopper une manifestation d’agriculteurs le 27 décembre.
- Extrême droite, racisme, antiféminisme : Brigitte Bardot, un héritage malaisant pour la cause animale (reporterre.net) – voir aussi Kaoutar Harchi : « La compassion de Brigitte Bardot pour les animaux n’annule pas son racisme » (bonpote.com)
- Brigitte Bardot, icône de l’extrême droite : Éric Ciotti demande un hommage national à Emmanuel Macron (humanite.fr)
- Le leader breton de La Digue, un groupuscule d’extrême droite, retrouvé mort en Belgique (letelegramme.fr)
Spécial résistances
- En Allemagne, des hackers lancent une campagne pour réduire l’emprise technologique américaine (euractiv.fr)
Des collectifs allemands de défense des droits numériques, épaulés par des entreprises technologiques européennes, organiseront ce dimanche 4 janvier et durant l’année 2026 des « journées de l’indépendance numérique », destinées à encourager les utilisateurices à réduire leur dépendance aux plateformes technologiques américaines.
- A69 : une décision inique qu’il faut contester (confederationpaysanne.fr)
- Quartiers populaires : l’histoire invisibilisée de 50 ans de luttes sociales (socialter.fr)
- Ces révoltes paysannes qui ont marqué l’histoire de France (basta.media)
Spécial outils de résistance
- Too dirty to be trained (too-dirty-to-be-trained.net) (too-dirty-to-be-trained.net) – voir en particulier How to make data dirty (too-dirty-to-be-trained.net) et le talk associé : A media-almost-archaeology on data that is too dirty for “AI” (events.ccc.de)
- The science of how (and when) we decide to speak out—or self-censor (arstechnica.com)
The study’s main takeaway : “Be bold. It is the thing that slows down authoritarian creep.”
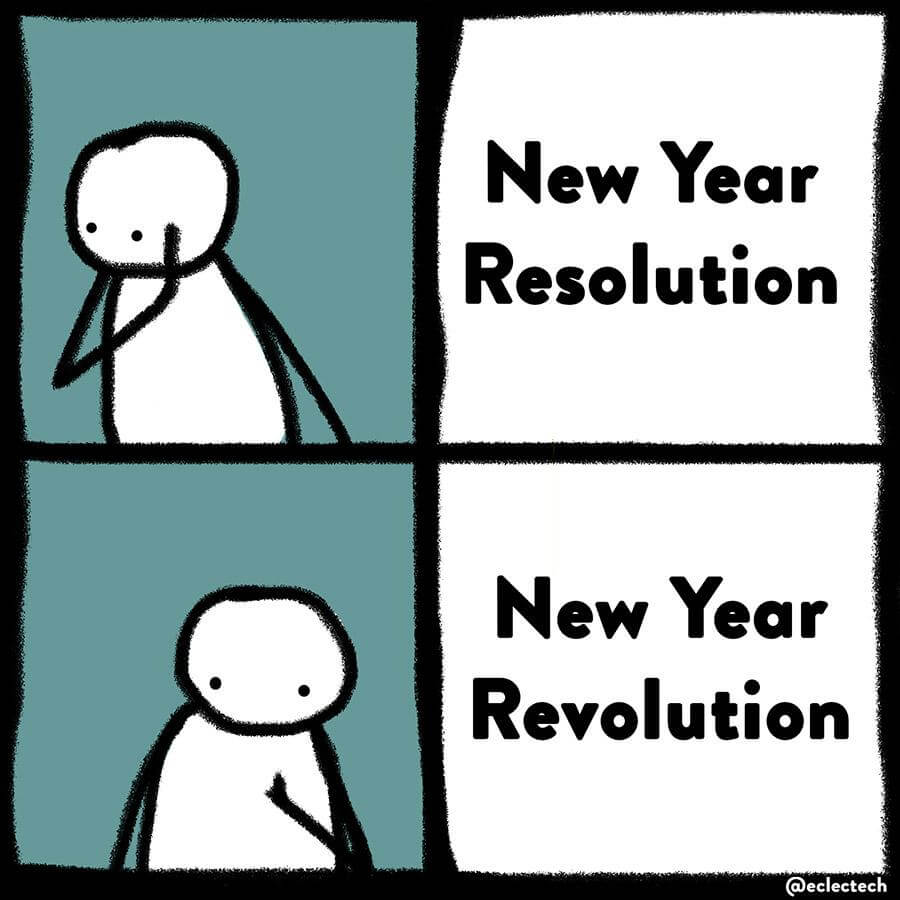
Spécial GAFAM et cie
- Amazon et l’agro-industrie accusés d’empoisonner l’eau potable de populations précaires (synthmedia.fr)
Aux États-Unis, dans le comté de Morrow en Oregon, où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, l’implantation de datacenters Amazon depuis 2011 aurait amplifié une importante contamination aux nitrates. Une crise sanitaire qui rappelle d’autres cas en Amérique où les plus vulnérables paient le prix de décisions économiques prises par des acteurs industriels davantage motivés par l’argent que par le bien-être des populations.
Les autres lectures de la semaine
- La folle histoire du « pirate » derrière le premier .gouv.fr, la radio libre et Canal+ (next.ink)
Historien des médias, pionnier des bases de données, de l’« information automatisée », de l’accès aux images satellitaires puis du web, Antoine Lefébure a aussi créé la première radio « libre » française, et préfiguré ce qui allait devenir Canal+. Il se définit lui-même comme un « pirate », et vient de publier une histoire du « secret d’État », à laquelle il a consacré ces cinq dernières années.
- The Enshittifinancial Crisis (wheresyoured.at)
- Lebensraum : de Hitler à Trump, sources et généalogie d’un concept (legrandcontinent.eu)

- Briser la subalternité : Fanon avec Gramsci (contretemps.eu) – voir aussi le Dossier : retrouver Fanon (contretemps.eu)
- Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne (theconversation.com)
Harbin se situe dans le nord-est de la Chine. Les températures hivernales y descendent régulièrement jusqu’à −30 °C et, en janvier, même les journées les plus douces dépassent rarement −10 °C. Avec environ 6 millions d’habitants aujourd’hui, Harbin est de loin la plus grande ville du monde à connaître un froid aussi constant.
- « Metropolis » imaginait 2026 il y a 100 ans et le monument de la SF résonne étrangement aujourd’hui (huffingtonpost.fr)
Le roman de Thea von Harbou adapté par Fritz Lang imaginait la société de 2026. Une fiction qui trouve un écho encore clair un siècle plus tard.
- Metaphorical Gender in English : Feminine Boats, Masculine Tools and Neuter Animals (antidote.info)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Cyberattaque
- Fossoyeur
- Bingo
- Lauréat
- Oil
- USA
- Coups
- The year in charts (restofworld.org)
Visualizing the ups, downs, and standout stats from 2025’s biggest tech stories.
- Merry Crisis
- Sérénité
- How Long
- Goal
- Deseo
- New Year
Les vidéos/podcasts de la semaine
- 1995-2025 : les médias contre les mouvements sociaux (acrimed.org)
- Les guignols de l’info, en 2001 (tube.fdn.fr)
- 51 Ways to Spell the Image Giraffe : The Hidden Politics of Token Languages in Generative AI (media.ccc.de)
- AI Agent, AI Spy (media.ccc.de)
- The Post-American Internet (pluralistic.net)
- All Sorted by Machines of Loving Grace ? “AI”, Cybernetics, and Fascism and how to Intervene (media.ccc.de)
- Persist, resist, stitch (media.ccc.de)
- Die Känguru-Rebellion : Digital Independence Day (media.ccc.de)
- Mon corps électrique (rts.ch)
Nom de code : UP2-001. Je suis le premier volontaire d’une étude clinique révolutionnaire : un implant dans mon cerveau, un autre dans ma moelle épinière, pour tenter de redonner vie à mon bras gauche.
Les trucs chouettes de la semaine
- En France, X (ex-Twitter) est complètement à la ramasse (clubic.com)
Pour la première fois depuis 2017, le réseau social d’Elon Musk n’apparaît plus dans les 50 marques les plus consultées en France selon Médiamétrie. X affiche désormais une audience comparable à celle de Reddit, signe d’un décrochage durable.
- La première carte nationale des transports (cartes.app)
Nous publions le premier plan interactif des transports en commun français. Zoomez où vous voulez pour afficher les lignes de bus, de tram, de métro et bientôt de train du réseau local.
- Europe : dix itinéraires en train à couper le souffle à découvrir en hiver (nationalgeographic.fr)
- En Écosse, une langue traditionnelle au secours des forêts (reporterre.net)
Deux luttes se rencontrent en Écosse : la promotion des langues indigènes, et la protection de l’environnement. Retrouver de vieux toponymes en gaélique permet de tracer la mémoire d’une faune et flore disparues.
- Stingless bees from the Amazon granted legal rights in world first (theguardian.com)
Planet’s oldest bee species and primary pollinators were under threat from deforestation and competition from ‘killer bees’
- The ASCII Side of the Moon (aleyan.com)
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
29.12.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 29 décembre 2025
Khrys
Texte intégral (8577 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Montées des eaux, inondations… Des pêcheurs indonésiens intentent un litige contre le cimentier Holcim (humanite.fr)
Le Tribunal cantonal de Zoug a accepté d’examiner un litige intenté par quatre habitants de l’île indonésienne de Pari contre le géant suisse du ciment, Holcim. Les plaignants réclament notamment une indemnisation pour les dommages causés sur l’île du fait de la montée des eaux et des inondations, ainsi qu’une baisse de ses émissions de Co2.
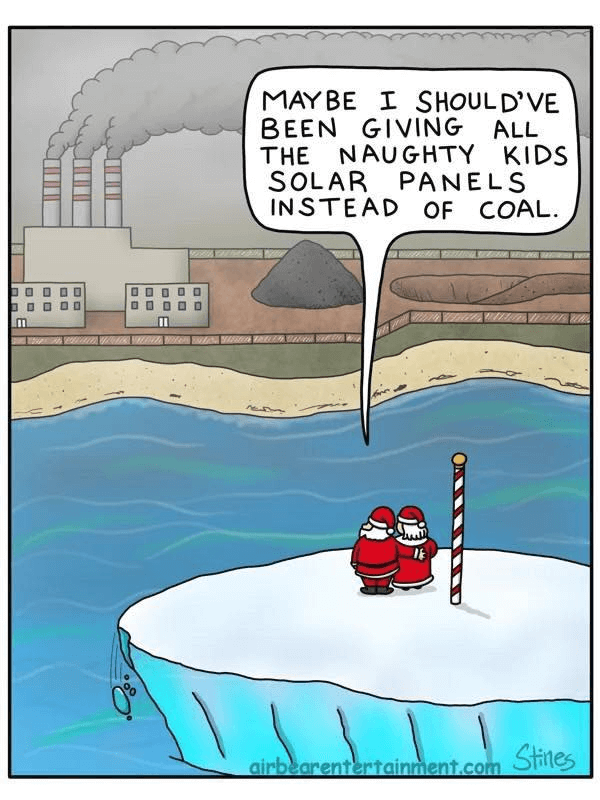
- Russia plans a nuclear power plant on the moon within a decade (reuters.com)
- En Iran, la résistance portée par les générations Z et Y (basta.media)
La répression du régime contre la population s’accentue en Iran, alerte Hamid Enayat, proche de l’opposition iranienne à l’étranger. Malgré tout, l’espoir d’un avenir meilleur subsiste grâce à la résistance populaire, notamment portée par la jeunesse.
- Entire oblasts in Ukraine ‘almost completely without power’ after mass Russian missile, drone attack (kyivindependent.com)
- Le Danemark sur le qui-vive (lesoirdalgerie.com)
Le Danemark a annoncé lundi 22 décembre la convocation prochaine de l’ambassadeur des États-Unis à Copenhague après que le président Donald Trump eut annoncé ce dimanche la nomination d’un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois qu’il a menacé d’annexer.
- Au Danemark, la poste ne distribue plus le courrier ! Un cas d’école pour l’Europe ? (france24.com)
- Belgique : Fascisme : Assignation à résidence, couvre-feu, interdictions … pour le Nouvel An (stuut.info)
En cette fin d’année, Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur, a préventivement autorisé une série de mesures répressives « exceptionnelles » en prévision de la soirée de la nouvelle année : assignation à résidence de mineur·es, couvre-feu, centre de crise, interdiction de feux d’artifices, interdiction des trottinettes…
- Greta Thunberg arrested at protest supporting Palestine Action hunger strikers (independent.co.uk)
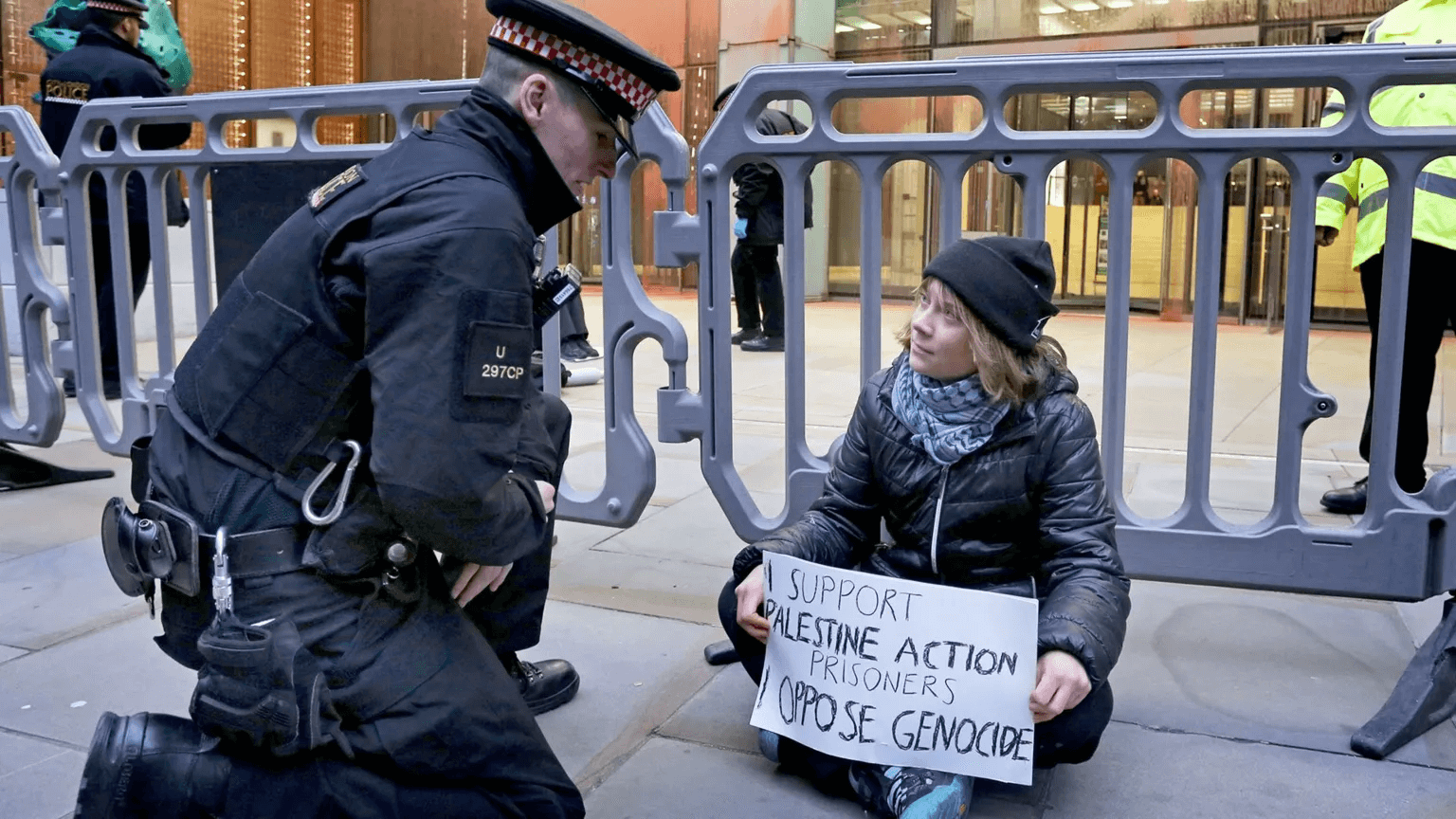
- Le Royaume-Uni sort le (gros) chéquier pour assurer la tapisserie de Bayeux d’éventuels dommages (huffingtonpost.fr)
Fragile et ancienne, la célèbre broderie va disposer d’une assurance de choix pour pallier toute dégradation durant son transport, son stockage et son exposition à Londres.
- Les forêts couvrent près de 40 % de la surface de l’Union, contre 34 % au début du siècle (legrandcontinent.eu)
La surface forestière européenne n’a cessé de croître au cours des dernières décennies.Depuis le milieu des années 1990, le continent européen concentre ainsi une plus grande part de la superficie forestière mondiale que l’Amérique du Sud : 25,1 % contre 20,5 %.
- Cloud, données et souveraineté : les institutions publiques européennes abandonnent discrètement les fournisseurs de services américains (cloud-computing.developpez.com)
Des fournisseurs comme Nextcloud et OVHCloud font état d’un pic de demandes de renseignements de la part de leurs clients. Les responsables desdites structures attribuent ce phénomène non seulement à l’effet Trump, mais aussi aux actions de l’administration américaine dans son ensemble.
Voir aussi Europe gets serious about cutting digital umbilical cord with Uncle Sam’s big tech (theregister.com)
Public bodies migrate in the bloc as hyperscalers claim sovereignty
- Washington sanctionne cinq Européen·nes engagé·es pour une régulation de la tech, dont Thierry Breton (france24.com)
Les États-Unis ont décidé, mardi, d’interdire de séjour cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech, dont le Français Thierry Breton. Leurs agissements s’apparentent à de la “censure” au détriment des intérêts américains, a justifié le département d’État. Thierry Breton a dénoncé un “vent de maccarthysme”.
Voir aussi Régulation de la tech : l’Europe s’alarme après les sanctions de l’administration Trump (france24.com)
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a défendu sur X la “liberté d’expression”, après que l’administration Trump eut banni l’ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre autres personnalités européennes engagées pour la régulation de la tech. Emmanuel Macron a, lui, exprimé son soutien à Thierry Breton.
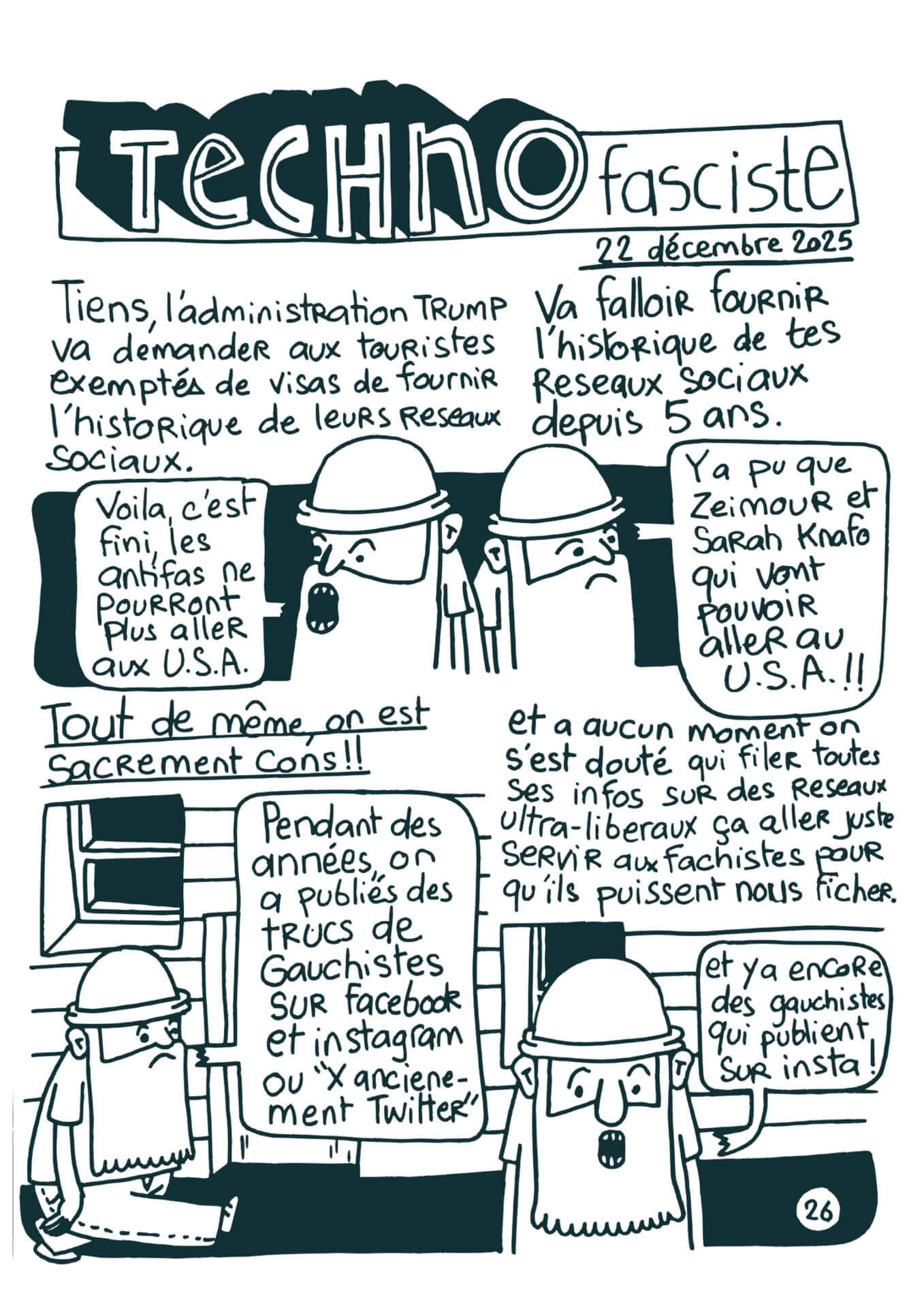
- Aux États-Unis, un des Européens interdits de visa contre-attaque en justice pour éviter l’expulsion (huffingtonpost.fr)
Le Britannique Imran Ahmed a déposé plainte contre l’administration de Donald Trump après les sanctions qu’il s’est vu imposer par Washington. […] Imran Ahmed vit aux États-Unis depuis 2021 et dispose d’une « carte verte » de résident permanent, comme l’indique sa plainte. Son épouse et leur fille sont Américaines
Voir aussi Plateformes numériques : privé de visa comme Thierry Breton, le britannique Imran Ahmed engage une bataille judiciaire contre l’administration Trump (humanite.fr)
- Donald Trump a annoncé des frappes américaines « meurtrières » contre l’État islamique au Nigeria et a menacé de mener de nouvelles attaques. (huffingtonpost.fr) – voir aussi Derrière les frappes américaines au Nigeria, la fixette de Donald Trump sur les chrétiens du pays (huffingtonpost.fr) et Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria (theconversation.com)
Selon Donald Trump, les frappes qui, le jour de Noël, ont visé des groupes djihadistes au Nigeria visaient à protéger les chrétiens de ce pays, qui seraient victimes d’un « génocide ». Qu’en est-il réellement, et quelles pourraient être les conséquences de ces bombardements ?
- Décision « politique » : un reportage de CBS sur Donald Trump censuré à la dernière minute (huffingtonpost.fr)
L’émission « 60 Minutes » avait prévu de diffuser un reportage sur l’expulsion de migrants au Salvador. Mais sans la moindre explication, ce reportage n’a pas été diffusé.
- Offensive transphobe : Trump demande au FBI de classer les organisations LGBTI comme terroristes (revolutionpermanente.fr)
Début décembre, le département de justice étasunien a demandé au FBI d’assembler une liste des organisations promouvant l’ « idéologie radicale du genre », les catégorisant dorénavant, aux côtés des groupes antiracistes et anticapitalistes, comme des groupes terroristes.
- Trump subit un rare revers de la Cour Suprême qui bloque de déploiement de la Garde nationale à Chicago (huffingtonpost.fr)
Le « Posse Comitatus Act », une loi de 1878, interdit d’utiliser des militaires pour mener des opérations de maintien de l’ordre. La Cour suprême, pourtant à majorité conservatrice, a maintenu un blocage qui avait été décidé avant elle par la justice fédérale.
- « Le roi Donnie VIII a perdu » : quand la chaîne britannique Channel 4 offre au présentateur Jimmy Kimmel une tribune contre la tyrannie trumpiste (humanite.fr)
« Jimmy Kimmel Live ! », avait été privé d’antenne aux États-Unis par ABC, pour finalement être réintégré sous la pression d’une campagne de soutien massive. Malgré la censure, Jimmy Kimmel achève l’année en beauté en étant sélectionné pour prononcer le traditionnel discours de Noël sur la chaîne britannique Channel 4.
- Jim Jarmusch, célèbre réalisateur américain, demande la nationalité française (huffingtonpost.fr)
De passage sur France Inter pour la promo de son nouveau film en partie tourné à Paris « Father Mother Sister Brother », le cinéaste de 72 ans a dit vouloir « s’évader des États-Unis ».
- En Californie, une « rivière atmosphérique » laisse des quartiers inondés et des maisons ensevelies (huffingtonpost.fr)
- What changed for deep-sea mining in 2025 ? Everything (grist.org)
Trump reshaped the industry this year, even as it faced opposition from the United Nations, scientists and Indigenous peoples.
- Les Caraïbes ont perdu la moitié de leurs coraux durs en 50 ans (reporterre.net) – voir aussi Réchauffement, acidification des mers, maladies… Près de la moitié des coraux des Caraïbes ont disparu depuis 1980 (humanite.fr)
La couverture en coraux durs dans les Caraïbes a diminué de 48 % entre 1980 et 2024, alerte un rapport du Global Coral Reef Monitoring Network diffusé mardi 23 décembre par la préfecture de Guadeloupe. En cause, le réchauffement et l’acidification des mers dus aux émissions de gaz à effet de serre.
- Au Brésil, Lula souhaite baisser le temps de travail hebdomadaire à 36 heures sans réduction de salaires (humanite.fr)
Dans son allocution de Noël, le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a annoncé qu’il réformera le temps de travail s’il est réélu en 2026.
Spécial IA
- L’explosion de la bulle de l’IA accentuerait la domination technologique mondiale de la Chine (geo.fr)
Alors que des milliers de milliards de dollars sont investis par les géants de la tech et le secteur financier dans l’IA générative, les signaux d’alarme se multiplient. Si la bulle éclate, la Chine en sortirait gagnante.
- As AI Companies Borrow Billions, Debt Investors Grow Wary (news.slashdot.org)
- Nuclear developer proposes using Navy reactors for data centres (financialpost.com)
- Salesforce regrets firing 4000 experienced staff and replacing them with AI (maarthandam.com)
According to executives familiar with the transition, automated systems struggled with nuanced issues, escalations, and long-tail customer problems. The result was declining service quality, higher complaint volumes, and internal firefighting to stabilize operations that had once been handled by experienced staff.
- Microsoft denies rewriting Windows 11 using AI after an employee’s “one engineer, one month, one million code” post on LinkedIn causes outrage (windowslatest.com)
Microsoft told […] that the company does not plan to rewrite Windows 11 using AI in Rust […] the clarification is not coming out of nowhere, as a top-level Microsoft engineer made bold claims of using AI to replace C and C++ with Rust. […] “My goal is to eliminate every line of C and C++ from Microsoft by 2030. Our strategy is to combine AI and Algorithms to rewrite Microsoft’s largest codebases. Our North Star is “1 engineer, 1 month, 1 million lines of code,” Galen Hunt, who is a top-level Distinguished Engineer at Microsoft, wrote in a now-edited LinkedIn post.
- ‘Confused’ Waymos Stopped in Intersections During San Francisco Power Outage (tech.slashdot.org) – voir aussi Waymo resumes service in San Francisco after robotaxis stall during blackout (techcrunch.com)
Waymo said that although its self-driving systems are designed to treat non-functioning traffic lights as four-way stops, the scale of Saturday’s blackout caused some robotaxis to remain stationary for longer than normal as they tried to assess the intersections.
- AI image generators have just 12 generic templates (pivot-to-ai.com)
There’s a new paper : “Autonomous language-image generation loops converge to generic visual motifs” — diffusion models have just 12 standard templates.[…] We know generative AI is just lossy compression of its training. It’s designed to put out the most mid result, and it’s got its favourite bits of the latent space.
- Pourquoi les applications vous forcent à utiliser l’intelligence artificielle, “on fait semblant de vous donner ces fonctionnalités gratuitement” (france3-regions.franceinfo.fr)
En 2024, des chercheuses en design de l’université de Strasbourg ont étudié 53 applications et logiciels informatiques. Objectif : identifier les changements de design qui poussent les consommateurs à utiliser l’intelligence artificielle. Elles déplorent des stratégies particulièrement agressives.
- Votre navigateur vous espionne, mais à quel point ? Vous allez être choqué·e (non) (goodtech.info)
une étude de décembre 2025, rapportée par Neowin et menée par Digitain le confirme : la plupart des navigateurs que nous utilisons quotidiennement sont de véritables passoires pour nos données personnelles. Si Google Chrome est souvent pointé du doigt, […] il existe désormais bien pire que le géant de Mountain View sur le marché et c’est Atlas, le navigateur d’OpenAI
- Samsung is putting Google Gemini AI into your refrigerator, whether you need it or not (nerds.xyz)
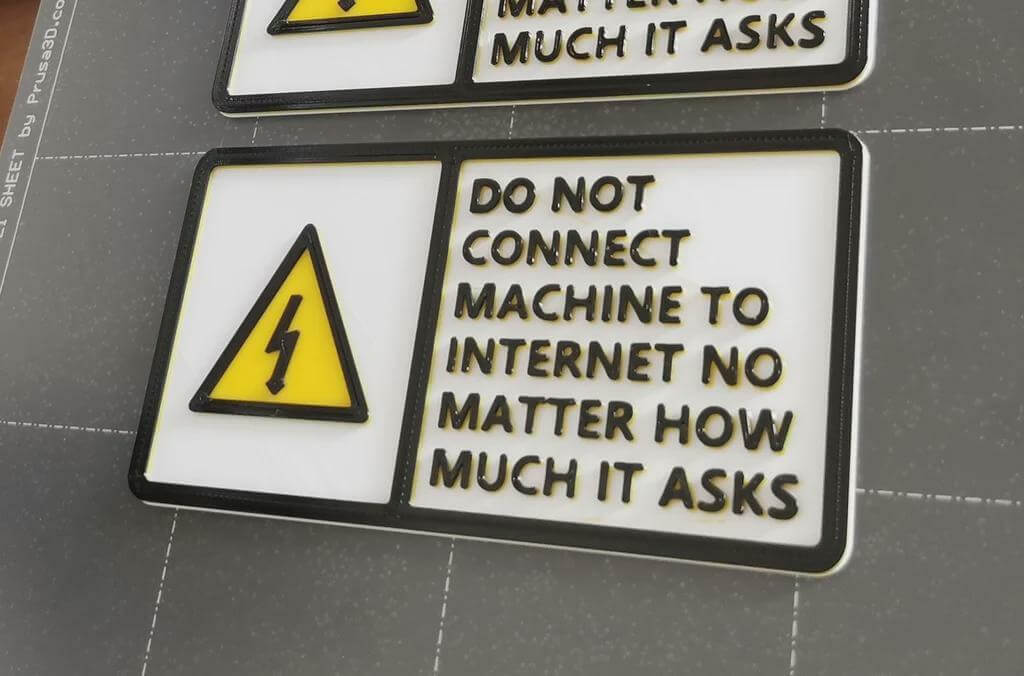
- Texas is suing all of the big TV makers for spying on what you watch (theverge.com)
TVs made by Sony, Samsung, LG, Hisense, and TCL are part of a ‘mass surveillance system,’ Attorney General Ken Paxton alleges.
Voir aussi 172 800 captures d’écran quotidiennes : l’accusation explosive contre les smart TV Samsung, LG, ou Sony (lesnumeriques.com)
Cinq géants de l’électronique grand public — Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL — sont poursuivis par l’État du Texas pour avoir capturé en secret ce qui s’affiche sur les écrans de millions de foyers américains. La fréquence alléguée des captures : deux fois par seconde.
- Flock Exposed Its AI-Powered Cameras to the Internet. We Tracked Ourselves. (404media.co – rticle de novembre 2025)
Unlike many of Flock’s cameras, which are designed to capture license plates as people drive by, Flock’s Condor cameras are pan-tilt-zoom (PTZ) cameras designed to record and track people, not vehicles. Condor cameras can be set to automatically zoom in on people’s faces as they walk through a parking lot, down a public street, or play on a playground, or they can be controlled manually
- What’s the Difference Between AI Glasses and an iPhone ? A Helpful Guide for Meta PR (404media.co)
Meta thinks its camera glasses, which are often used for harassment, are no different than any other camera.
- Les articles générés par des humains sont désormais minoritaires sur Internet en comparaison de ceux produits par l’IA (developpez.com)
Les articles générés par l’intelligence artificielle dépassent ceux écrits par des humains depuis fin 2024, d’après un rapport de Graphite. Plus de la moitié du trafic web est généré par des systèmes automatisés dont la majorité est mise en place par des acteurs malveillants
- Les utilisateurices « sont fatigué·es » : la bouillie générée par IA est-elle sur le point de tuer son premier réseau social ? (numerama.com)
Le contenu généré par IA serait en train de tuer Pinterest. C’est en tout cas ce qu’affirment de nombreux utilisateurices du réseau social, dont certain·es ont témoigné dans un article publié le 24 décembre 2025 sur le site américain Wired. En cause : la prolifération de contenus bas de gamme générés par IA, qui envahissent un réseau historiquement pensé comme un espace d’inspiration et de curation visuelle soignée.
- « Allez tous vous faire foutre ! » Rob Pike explose contre la GenAI : quand l’un des créateurs de Go, Plan 9, UTF-8 accuse l’IA de piller, polluer et détruire le sens même du progrès technologique (developpez.com)
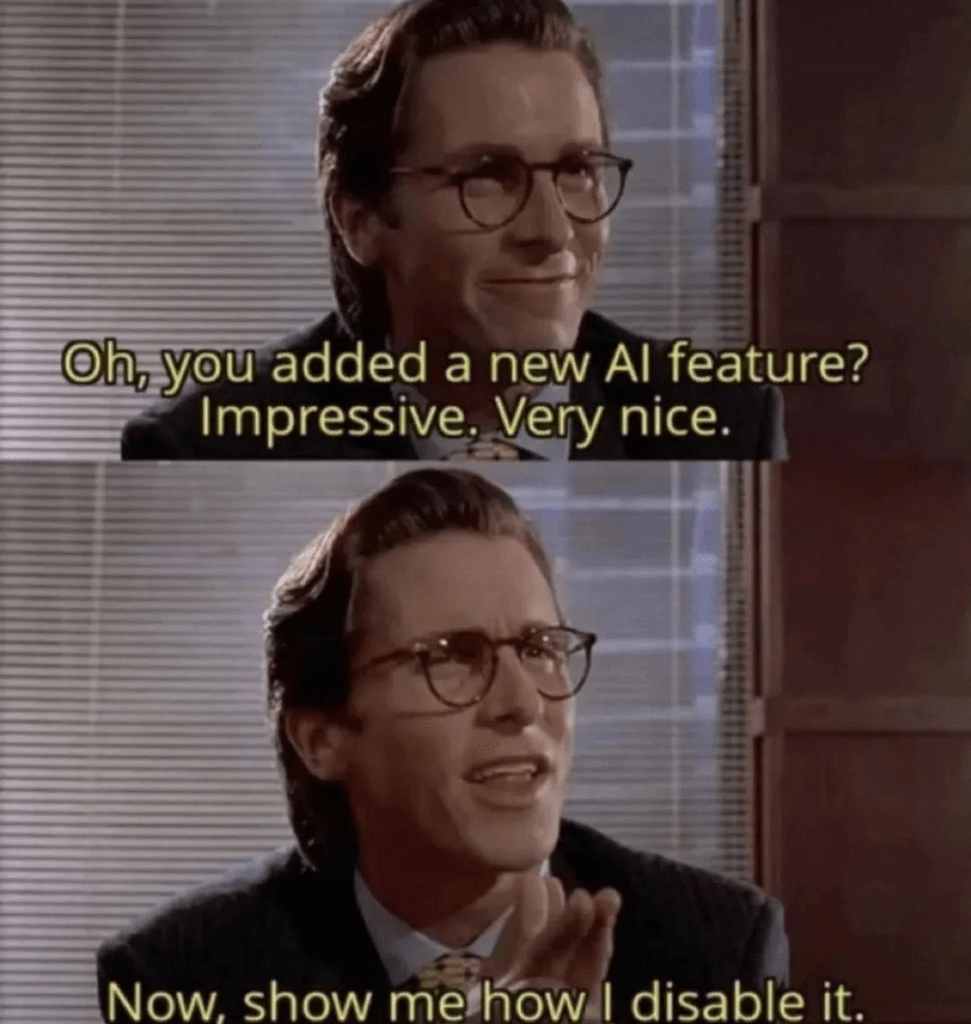
- Le mythe de la bonne IA (danslesalgorithmes.net)
Dans une perspective décoloniale, il n’y a pas de bonne IA
- L’IA en 2025 : quatre tendances (legrandcontinent.eu) – voir aussi L’IA et l’Europe avec Kidron, Benanti, Bradford, Bouverot, le Pas de Sécheval, Crawford et López Águeda (legrandcontinent.eu)
- Why A.I. Didn’t Transform Our Lives in 2025 (newyorker.com)
As 2025 winds down, the era of general-purpose A.I. agents has failed to emerge.
- The AI Revolution Needs Plumbers After All (indiadispatch.com)
How Indian IT learned to stop worrying and sell the AI shovel
- L’intelligence artificielle générale n’aura pas lieu (arretsurimages.net)
Spécial Palestine et Israël
- Israeli police arrest Palestinian man dressed as Santa Claus at Christmas party (theguardian.com)
Officers closed Christmas event in Haifa, confiscating equipment and also arresting a DJ and a street vendor
- Prisoners for Palestine : Qesser Zuhrah (prisonersforpalestine.or)
They won’t imprison us all, they know if they fill the prisons with activists, we will overpower them from within. So flood the damn streets in your millions. Shut down these factories in your thousands ! They can never arrest the resistance in our smiles. We will use the shards of our broken hearts to spear the system of injustice.
- Gaza : The Reckoning (brunomacaes.substack.com)
The debate on whether Israel’s actions in Gaza constitute a genocide is now closed, and has been closed for a while. The international Court of Justice, all the major historians of genocide, the United Nations, all the major human rights organisations, the mainstream Hollywood star Jennifer Lawrence and even a former Israeli Prime Minister all call the Gaza “war” a genocide.
- À la galerie Martel, Art Spiegelman et Joe Sacco vendent leurs originaux pour les enfants de Gaza (humanite.fr)
Jusqu’au 10 janvier, à la galerie Martel à Paris, l’auteur de Maus et le maître de la BD reportage ont choisi de vendre les planches et croquis originaux d’un récit réalisé à quatre mains, autour du conflit israélo-palestinien, au bénéfice de l’Unicef.
Spécial femmes dans le monde
- En Ukraine, la guerre qui s’éternise propulse les femmes en première ligne (slate.fr)
Face à la pénurie de combattants et de volontaires masculins, les Ukrainiennes occupent désormais des rôles-clés, du pilotage de drones de combat à l’évacuation de civils sous le feu de l’envahisseur russe.
- Affaire Epstein : la riposte du camp Trump aux nouveaux documents montre son extrême embarras (huffingtonpost.fr)
- DOJ appears to bungle Epstein Files redactions (theverge.com)
simply copying and pasting many of the redactions into a new document reveals what’s beneath the black boxes.
Le LOL de la semaine
- Epstein Files Redactions Failed After Funding Cuts Forced DOJ to Use Basic Adobe Tools (ibtimes.co.uk)
RIP
- World War Two codebreaker dies aged 99 (bbc.co.uk)
Ruth Bourne, a Jewish veteran, was […] chosen to work at decoding intercepted messages and was based at two outstations of Bletchley Park […]The Bombe machine was an electromechanical device built by Alan Turing to crack Germany’s Enigma code, quickly finding daily settings to decode enemy messages – a breakthrough that changed the course of the war and saved millions of lives.
- Le groupe The Cure pleure son guitariste et claviériste Perry Bamonte (rts.ch)
Le guitariste et claviériste du groupe The Cure, Perry Bamonte, est décédé à l’âge de 65 ans, a annoncé vendredi le légendaire groupe britannique de new wave.
Spécial France
- Budget 2026 : les conséquences de l’échec de la commission mixte paritaire et du choix de l’option de la loi spéciale (theconversation.com)
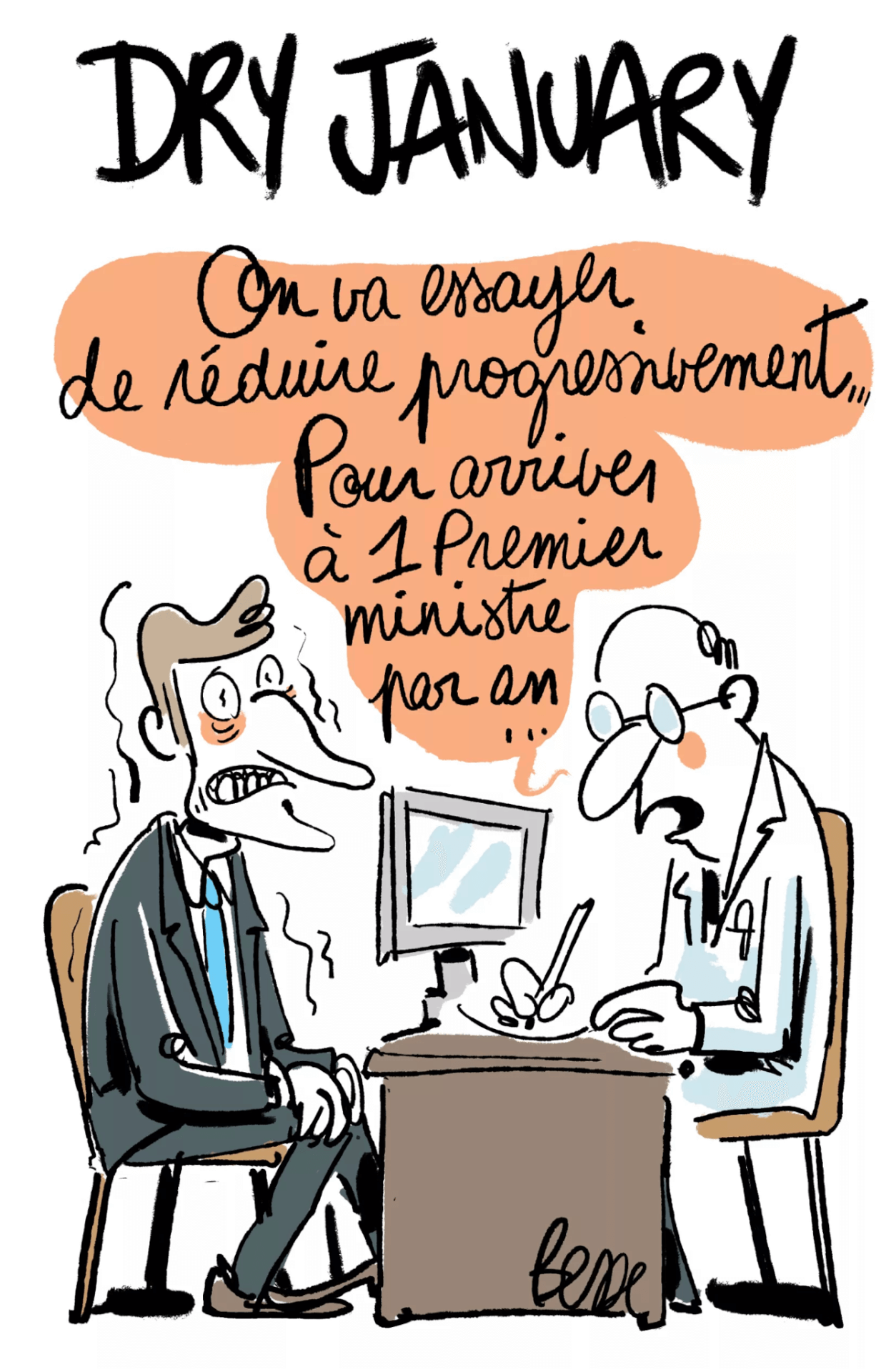
- Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français·es ont fuité (kulturegeek.fr)
Le hack couvre les données de clients Chronopost allant de février à avril 2025. Si vous avez reçu un colis en relais Pickup durant cette période, il est probable que vos données aient été piratées
- Mondial Relay touché par une cyberattaque qui a volé les données de ses client·es (franceinfo.fr)
Selon l’entreprise ce sont les données personnelles des client·es qui sont “susceptibles” d’avoir été volées, notamment “le nom, le prénom, les adresses email et postale ou le numéro de téléphone”.
- La Banque Postale et La Poste de nouveau en panne ce lundi matin, mais que se passe-t-il encore ? (clubic.com)
Moins de quarante-huit heures après un premier gros incident, La Banque Postale et La Poste sont, ce lundi matin, de nouveau frappées par une sévère panne, qui empêche l’accès à de multiples services.
Voir aussi Le groupe NoName de pirates prorusses revendique l’attaque contre La Poste (next.ink)
- Une gardienne de la paix arrêtée pour avoir vendu des fichiers policiers sur Snapchat (next.ink)
- Il pénètre dans un bois privé pour trouver une proie : poursuivi par le propriétaire, le chasseur panique et tire, la victime n’a pas survécu. (ladepeche.fr)
- Une explosion dans une usine chimique près de Lyon fait au moins 4 blessés (huffingtonpost.fr)
L’explosion est survenue dans une usine classée Seveso seuil haut, ce qui signifie qu’elle manipule des substances chimiques présentant un risque majeur pour la santé et l’environnement.
Voir aussi Explosion d’une usine près de Lyon : les maires alertent sur le désengagement de l’État (reporterre.net)
- PFAS : les pompier·es confronté·es à des risques invisibles depuis des décennies (reporterre.net)
Les pompier·es utilisent encore des mousses anti-incendie aux PFAS et des tenues imprégnées de ces polluants éternels. Une exposition chronique qui est pourtant documentée depuis plus de dix ans.
- Décorations de Noël : la fausse neige bientôt interdite ? (reporterre.net)
La magie de Noël mérite-t-elle que l’on libère des nuages de microplastiques dans notre environnement immédiat ? C’est le risque que fait courir une décoration de Noël répandue : la neige artificielle vendue en sachets sous forme de poudre, de paillettes ou de flocons.
- Le « Noël le plus froid depuis 15 ans » est à une température normale pour la saison (reporterre.net)
- Hébergements d’urgence, maraudes… face à la chute des températures, le plan « grand froid » est activé dans plusieurs départements (humanite.fr)
Les préfectures s’organisent face à la chute soudaine des températures. Ainsi, une vingtaine de départements ont déclenché le plan « grand froid ». Des mesures qui interviennent alors qu’une personne sans-abri est décédée du froid, à Reims, le jour de Noël.
- “Un jeune sans-abri retrouvé mort le soir de Noël, le deuxième décès dans la rue en moins d’une semaine à Nantes” (ouest-france.fr)
Le corps inerte de ce jeune homme de 30 ans, sans domicile fixe, a été découvert à deux pas du CHU de Nantes dans la soirée du 25 décembre. Quatre jours avant Noël, c’est un quadragénaire qui est mort sous ses couvertures.
- Montpellier sous l’eau à quelques jours de Noël (reporterre.net)
- Les algues puantes, ce fléau qui engloutit un bout de Guadeloupe (reporterre.net)
C’est que la commune de Capesterre-de-Marie-Galante est celle qui souffre le plus en Guadeloupe des échouements de sargasses, devenus réguliers. Selon les années, l’île aux belles eaux reçoit entre 30 000 et 50 000 tonnes de sargasses sur ses plages depuis 2011
Spécial femmes en France
- Enquête : Traitement hormonal de la ménopause, information ou promotion ? (portail.basta.media)
- Rachida Dati a réussi par « promotion canapé » : Carlos Martens Bilongo présente ses excuses après sa sortie sexiste (huffingtonpost.fr)
Le député LFI a présenté « publiquement » ses excuses à Rachida Dati après avoir dit qu’elle avait progressé en politique « en couchant avec des hommes ».
- Cette caricature de Rokhaya Diallo par « Charlie Hebdo » indigne la gauche qui apporte son soutien à l’essayiste (huffingtonpost.fr)
L’essayiste et militante antiraciste a dénoncé un dessin « dans le droit fil de l’imagerie coloniale », accusant le journal satirique de la « réduire à un corps exotisé ».
- Contre le racisme, en défense de notre collaboratrice Rokhaya Diallo (blogs.mediapart.fr)
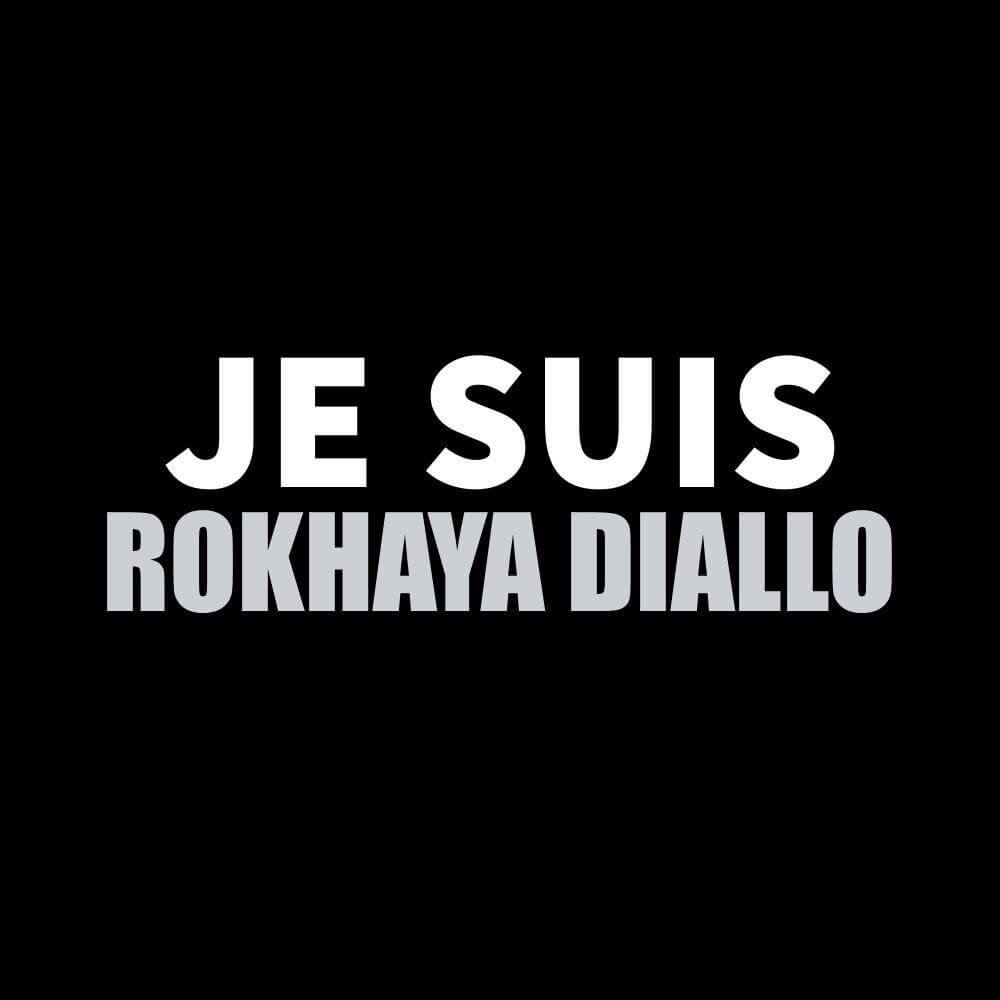
- Mise en examen de Gérard Miller : Motion du Conseil d’administration de l’Université Paris 8 (cgt.fercsup.net)
Le Conseil d’administration de l’Université Paris 8, réuni le 19 décembre 2025, exprime sa résolution à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Un de ses anciens enseignants-chercheurs, Gérard Miller, a été mis en examen le 2 octobre 2025 pour quatre viols, dont trois sur mineures, et deux agressions sexuelles, qui auraient été perpétrés entre 2000 et 2020. Il a en outre été placé sous le statut de témoin assisté pour un fait présumé de viol sur mineur de plus de 15 ans. Il s’agit de faits qui font l’objet d’une procédure en cours. Vingt-sept femmes l’auraient à ce jour accusé.
- Dans le métro à Paris, trois femmes blessées après des agressions au couteau (huffingtonpost.fr)
En fuite, l’agresseur présumé a finalement été interpellé à son domicile. Les agressions sur trois femmes ont eu lieu aux stations Arts et Métiers, République et Opéra.
Spécial médias et pouvoir
- « La quête du vote musulman » : anatomie d’un récit médiatique islamophobe (acrimed.org)
- Attaque terroriste en Australie : de CNews à Franceinfo, blâmer la gauche, surtout ! (politis.fr)
Il y avait des angles politiques et sociaux spécifiques à l’Australie à couvrir dans les médias, suite à l’attentat antisémite de Bondi Beach, à Sydney. Trop compliqué pour nombre d’éditorialistes et journalistes, préférant viser la gauche française.
- Affaire Legrand-Cohen : le parquet de Paris ouvre une enquête pour « atteinte à l’intimité de la vie privée par captation » (humanite.fr)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Piratage du ministère de l’Intérieur : l’État était pourtant prévenu (blast-info.fr)
- Le Wi-Fi d’Elon Musk va équiper les avions d’Air France (reporterre.net)
Objectif de la compagnie aérienne : permettre à ses passagers d’accéder à un réseau internet “ultraperformant” “gratuitement”··· après une inscription à un programme de fidélité.
- Ces députés rédigent secrètement leurs amendements avec la FNSEA (reporterre.net)
Reporterre a épluché les amendements déposés depuis 2024 : 783 ont été fournis clés en main par la FNSEA, le syndicat agricole productiviste. La plupart ont été proposés sans modification, et dans l’opacité.
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- « À quel groupe ethnique vous identifiez-vous ? » : la Société générale propose un questionnaire « illégal et discriminant » à ses candidat·es, l’employé à l’origine de la découverte limogé (humanite.fr)
Pour des postes à l’international, la Société générale propose à ses candidat·es de remplir un questionnaire sur leur genre, leur couleur de peau, leur sexualité et leur appartenance à un parti politique
- « Zone anti antifa » : au Mans, le local d’une association LGBTQI + attaqué par l’extrême droite (humanite.fr)
L’association sarthoise Homogène a annoncé, sur ses réseaux sociaux, avoir été la cible d’actes de dégradation et de vandalisme de la part de militants d’extrême droite. La LDH dénonce une volonté d’intimider les acteurs de la solidarité.
- Diffamation à l’encontre de La Cimade : Marine Le Pen définitivement condamnée (lacimade.org)
- Paysan tué par un gendarme : les scellés ne seront pas détruits (reporterre.net)
Plus de huit ans après la mort de Jérôme Laronze, un éleveur de Saône-et-Loire tué par un gendarme en 2017, la justice s’est opposée le 19 décembre à la destruction des scellés. Celle-ci avait été ordonnée par la juge d’instruction lors de l’audience du 13 novembre, à Dijon.
Pas RIP
- Brigitte Bardot et la politique, à droite toute (telerama.fr)
L’actrice est morte à l’âge de 91 ans. Celle qui créa la Fondation Brigitte Bardot en 1986 et lutta pour la défense des animaux, ne cachait pas sa proximité avec l’extrême droite et fut même condamnée pour incitation à la haine raciale.
Spécial résistances
- “Cessez de vous moquer” : après une série noire de piratages, une lettre ouverte exige une refonte totale de la CNIL (lesnumeriques.com)
- Pour une ligne de train, de meilleurs salaires ou des CDI : ces mobilisations victorieuses en 2025 (basta.media)
Contre la fermeture d’une ligne de train, pour des augmentations ou contre un milliardaire d’extrême droite… Les mobilisations victorieuses passent trop souvent sous les radars. Elles sont pourtant riches d’enseignements. Quatre exemples en 2025.
- Pour continuer à lancer l’alerte et renforcer la solidarité en 2026 (blogs.mediapart.fr)
Nous pouvons toutes et tous trouver des formes de mobilisations pour nous opposer au glissement qui est entrain de s’opérer en France, lancer l’alerte à notre niveau, et choisir de remettre la solidarité au cœur de notre société.
Spécial outils de résistance
- Indextrême (indextreme.fr)
Indextrême est un outil qui a pour objectif de comprendre, dans le contexte français, les symboles utilisés et détournés par l’extrême droite. En connaissant leur histoire, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes sémiotiques de ces symboles et leur impact dans notre société.
- Fachorama en version “Do it Yourself” (lahorde.info)
Vous vouliez offrir (ou vous offrir) Fachorama et vous êtes dépité·e car il est provisoirement épuisé suite à la polémique… Si vous êtes patient·e et un peu habile de vos mains, pourquoi ne pas fabriquer votre exemplaire ? C’est ce qu’on vous propose avec ce kit “do it yourself” à télécharger, imprimer et coller soi-même.
- Chronoluttes (chronoluttes.com)
Saurez-vous placer la grève des corsetières de Limoges, l’occupation d’Alcatraz aux Etats-Unis ou encore la marche pour l’égalité sur une frise du temps ? Pour se réapproprier un passé souvent oublié, partons ensemble à la (re)découverte des grands évènements et des organisations qui ont fait notre histoire collective.
- Accessibility Myths Debunked (a11ymyths.com)
Spécial GAFAM et cie
- Amazon faces ‘leader’s dilemma’ — fight AI shopping bots or join them (cnbc.com)
- Victoire inattendue pour Amazon en justice : la CNIL en partie désavouée par le Conseil d’État (clubic.com)
Le Conseil d’État a divisé par deux l’amende de 32 millions d’euros infligée à Amazon France Logistique. Juste avant Noël, le juge administratif a désavoué partiellement la CNIL sur la surveillance des employés en entrepôt.
- Italy tells Meta to suspend its policy that bans rival AI chatbots from WhatsApp (techcrunch.com)
“Meta’s conduct appears to constitute an abuse, since it may limit production, market access, or technical developments in the AI Chatbot services market, to the detriment of consumers,” the Italian Competition Authority wrote.“while the investigation is ongoing, Meta’s conduct may cause serious and irreparable harm to competition in the affected market, undermining contestability.”
- Mesh Networks Are About to Escape Apple, Amazon, and Google Silos (spectrum.ieee.org)
- Spotify disables accounts after open-source group scrapes 86 million songs from platform (therecord.media)
- “Appuyez sur le bouton et taisez-vous” : la fin des aspirateurs-robots Neato provoque une fronde des utilisateurices (lesnumeriques.com)
Le rapport de la semaine
- Carbon Inequality Kills (oxfamamerica.org)
Why curbing the excessive emissions of an elite few can create a sustainable planet for all
Les autres lectures de la semaine
- Dismantling Defenses : Trump 2.0 Cyber Year In Review (krebsonsecurity.com)
- Global Memory Shortage Crisis : Market Analysis and the Potential Impact on the Smartphone and PC Markets in 2026 (idc.com)
In late 2025, the global semiconductor ecosystem is experiencing an unprecedented memory chip shortage with knock-on effects for the device manufacturers and end users that could persist well into 2027. DRAM prices have surged significantly as demand from AI data centers continues to outstrip supply, creating a supply/demand imbalance.
- Memory is running out, and so are excuses for software bloat (theregister.com)
Maybe the answer to soaring RAM prices is to use less of it
- La directive NIS2, c’est quoi exactement ? Guide complet (newlink.fr)
- La femme que Marx n’a jamais voulu rencontrer : Flora Tristán, l’autodidacte qui aurait pu changer l’histoire du socialisme (theconversation.com)
Autodidacte et militante infatigable, Flora Tristán a observé la réalité sociale avec un regard de scientifique pour proposer un modèle alternatif de société et de travail.
- Le tournant féministe de la primatologie (terrestres.org)
En 1989, Donna Haraway articulait sciences, féminisme, racisme et impérialisme dans un livre devenu culte, enfin traduit en français. Extrait.
- Pourquoi Hannah Arendt ? (legrandcontinent.eu)
- Il faut corriger la carte du monde : voici pourquoi (humanite.fr)
- Tout ce que l’on peut faire avec un planisphère carré (humanite.fr)
- Une gauche dans le déni de son racisme (cheremarianne.wordpress.com)
Le fait qu’une femme seule sur scène soit moquée par un groupe d’homme est de surcroit sexiste. Ce mélange de racisme et de sexisme pour dénigrer et humilier une femme noire est un exemple de misogynoire […] c’est toujours la même réaction : « on n’est pas racistes, parce qu’on est de gauche. On est antiracistes, et donc on ne peut pas être accusé de quelconques biais racistes. » […] C’est une pensée magique qui traverse toute les gauches, et qui permet de systématiquement faire taire toute critique ou remise en question des biais et mécanismes de domination qui gangrène les gauches, d’empêcher d’avancer dans la lutte antiraciste et qui blessent les personnes racisées qui subissent le racisme et se trouvent abandonnées par celles et ceux qui devraient être des allié·es. […] Charlie Hebdo ne s’est donc pas excusé mais a réitéré son accusation contre Rokhaya Diallo d’être une « fossoyeuse de la laïcité » […] pour eux le problème n’est pas la caricature ou l’article, mais la dénonciation par la victime, Rokhaya Diallo, de leur caricature sexiste et raciste. Ce serait elle qui serait raciste et pas eux. C’est un mécanisme courant d’inversion accusatoire qui permet d’asseoir la domination masculine et la domination blanche.[…] Alors que l’extrême-droite est aux portes du pouvoir, il est temps que les gauches se ressaisissent, déconstruisent leurs biais et imaginaires racistes et coloniaux, et construisent un projet émancipateur et inclusif porteur d’espoir et de justice.
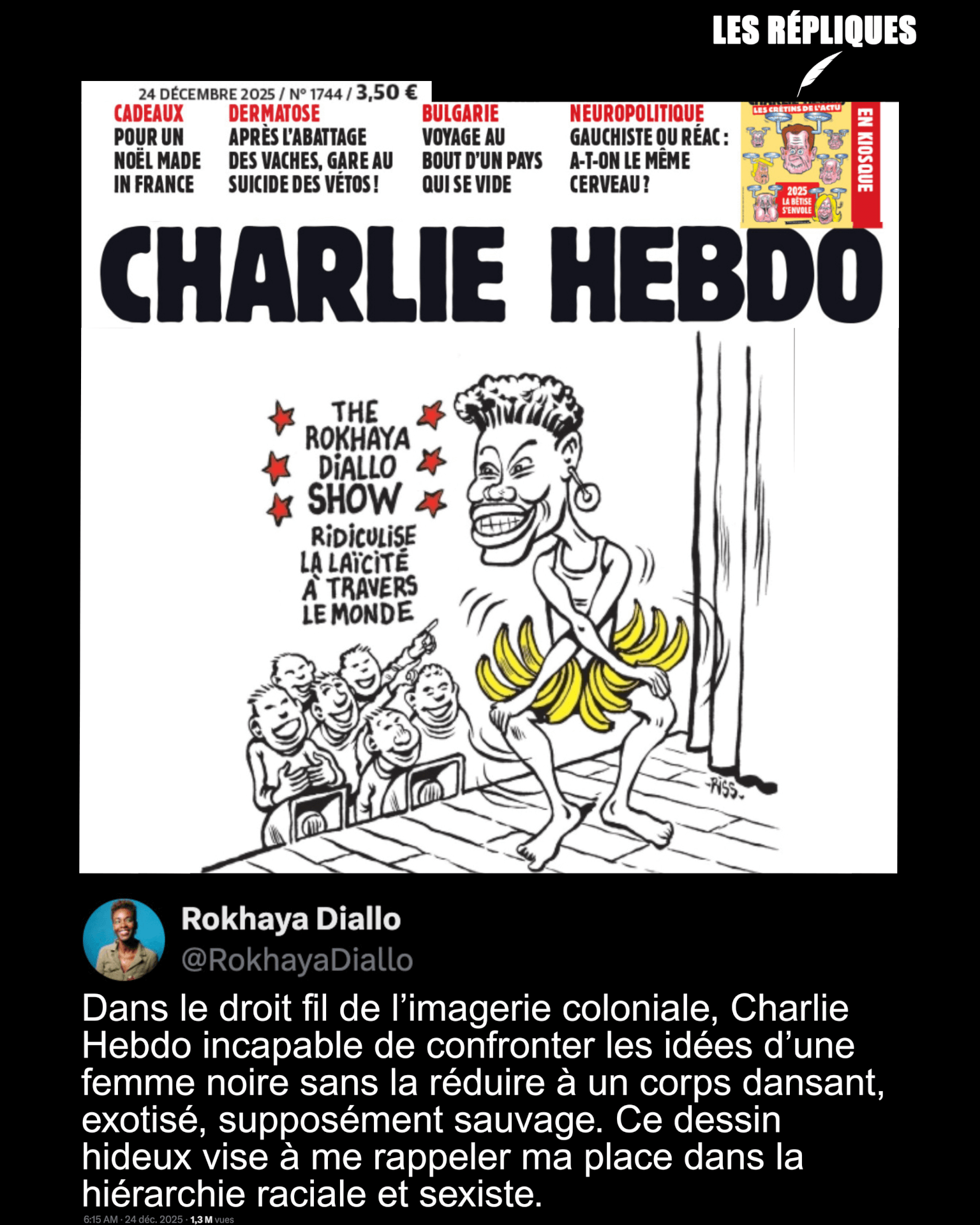
- Oradour coloniaux français : en finir avec la mythologie impériale-républicaine (contretemps.eu)
La France a commis d’innombrables crimes contre l’humanité lors de la conquête coloniale de l’Algérie, puis pour s’y maintenir durant 132 ans. Il est plus qu’urgent de démolir la mythologie impériale-républicaine dans laquelle communie une large partie des champs politique et médiatique.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Dry January
- Insta
- Do not
- Feature
- Merry AIsmas
- All I want
- Maybe
- Pics
- Girl
- Thunberg
- Je suis
- Pas Charlie
- Maths
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Les filles du DC-10 (radiofrance.fr)
Trente-six ans après l’attentat, début 2025, Maryvone et Yohanna sont parmi les parties civiles dans le procès qui juge Nicolas Sarkozy pour le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. “C’est comme si les gens du Bataclan se rendaient compte dix ans après que des politiques avaient été parler avec Salah Abdeslam”
- BBC : AI app apologises over false crime alerts across US (bbc.com)
A company behind an AI-powered app called CrimeRadar has apologised for the distress caused by false crime alerts issued to local US communities after a BBC Verify investigation. CrimeRadar uses artificial intelligence to monitor openly available police radio communications, automatically generating a transcript and then producing crime alerts for users across the US.
- Fascisation sécuritaire, impérialisme et guerre contre les peuples (partie 2) (spectremedia.org)
Les trucs chouettes de la semaine
- PFAS, chacals, océans… Cinq raisons de se réjouir de 2025 (reporterre.net)
Quelques bonnes nouvelles ont percé en 2025 à travers l’avalanche d’informations catastrophiques pour le climat et l’ensemble du vivant.
- Prix libre et légumes bio : ce tiers-lieu nourrit les étudiant·es précaires (reporterre.net)
À Clermont-Ferrand, les bénévoles du tiers-lieu Lieutopie préparent chaque semaine des repas végétariens à prix libre. Un lieu refuge contre la précarité des étudiant·es, qui vit lui-même dans un délicat équilibre financier.
- Une première en France : cette usine transforme notre urine en engrais (reporterre.net)
À Valence, une association vient d’ouvrir une des premières unités de fabrication d’urinofertilisants. Objectif : transformer le pipi d’une centaine de personnes en engrais pour les champs.
- « En acquérant des parcelles de forêts, nous reprenons la main sur leur devenir » (lezephyrmag.com)
- De nouveaux jeux dans Framagames (framablog.org)
- Framacount : partagez l’addition sans partager vos données (framablog.org)
- Framatoolbox, votre boite à outils numérique ! (framablog.org)
- Free and federated platform for membership, ticketing, cash register, and more ! (tibillet.org)
- Free Software Foundation receives historic private donations (fsf.org)
The Free Software Foundation (FSF) today announced it received two major contributions totaling around $900,000 USD.These extraordinary donations, both made to the FSF in the cryptocurrency Monero, are among some of the largest private gifts ever made to the organization. The donors wish to remain anonymous.
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
29.12.2025 à 07:30
Grâce à votre solidarité, Framasoft construira un internet du partage pour une année de plus !
Framasoft
Texte intégral (2927 mots)
L’année se terminera d’ici quelques jours et avec elle, notre campagne de don.
Cette année encore, vous avez été nombreux et nombreuses à vous mobiliser pour faire de cette campagne un succès… et c’est réussi !
Alors merci à vous, pour vos dons, bien sûr, essentiels à notre stabilité, mais aussi pour tous vos messages d’encouragement !
Ils nous font chaud au cœur ! 🥰
Nous avons à ce jour récolté plus de 271 000 € sur les 250 000 € espérés. Cet engouement nous encourage à essayer d’atteindre la barre symbolique des 300 000 € d’ici la fin de l’année, ce qui nous offrirait presque un mois de salaire supplémentaire… On croise les doigts ! 🤞
Renforcez l’internet du partage en contribuant à la robustesse de Framasoft
Grâce à vos dons (défiscalisables à 66 %), l’association Framasoft agit depuis plus de 20 ans pour faire avancer le Web éthique et convivial. Retrouvez un focus sur certaines de nos actions en 2025 sur le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (nov. – déc. 2025)
Un regard sur 2026
Grâce à votre solidarité, nous pouvons aborder la nouvelle année sereinement, sans (trop) nous soucier de notre capacité à financer nos actions.
En 2026, nous pourrons donc continuer à dorloter nos 23 services en ligne !

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Cela prend du temps, de l’énergie, de fournir autant de services à près de 2 millions de personnes, et votre soutien nous permet de pouvoir le faire sans céder à des logiques marchandes, cherchant à tout prix rentabilité et performance.
Le monde qui nous fait envie, celui que nous cherchons à construire, est basé sur la solidarité et la robustesse.
C’est pourquoi nous proposons nos services réellement gratuitement, sans contrepartie, sans avoir à sacrifier votre intimité numérique.
C’est pourquoi, aussi, nous avons lancé un projet comme Framaspace.
Framaspace a pour objectif de renforcer la robustesse de milliers de collectifs, œuvrant pour la justice sociale et environnementale.
En fournissant des espaces de collaboration hors des géants du numérique et de leur idéologie, nous espérons faciliter (ne serait-ce qu’un peu) la réussite des actions de ces collectifs !

Framaspace – Illustration de David Revoy
Pourtant, notre mission ne s’arrête pas là.
Framasoft est une association d’éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Notre rôle est d’aider à comprendre le monde numérique et ses rouages.
C’est pour cela que nous avons créé FramamIA, afin d’aider à mieux appréhender l’intelligence artificielle et ses enjeux.
C’est pour cela, aussi, que nous intervenons régulièrement dans les conventions, pour tenir un stand ou donner des conférences. Nous répondons aux interviews quand nous en avons le temps et l’énergie.
En 2026, nous continuerons donc toutes ces actions.
Et plus encore, car grâce à vous et votre soutien, nous avons la latitude d’expérimenter !
« Est-ce que nous pouvons répondre à un nouveau besoin numérique ? »
« Comment est-ce que nous pouvons mieux vous accompagner face à l’essor de l’intelligence artificielle ? »
« Quels leviers peut-on mettre en place pour permettre à celles et ceux qui cherchent à construire un monde juste et équitable d’y parvenir ? »
Nous avons des pistes sur la façon d’y parvenir, et nous chercherons à les mettre en œuvre si cela nous est possible… et grâce à vous, nous aurons les ressources financières pour le faire, alors merci ! ❤️
Parmi les membres de Framasoft, on donne à…
Car oui, c’est un des leviers que nos membres utilisent déjà pour aider celles et ceux qui cherchent à changer le monde.
Alors c’est tard, mais voici une liste des entités à qui nos membres font des dons. Celle-ci n’est pas forcément exhaustive, et nous avons sans doute oublié des gens (pardon, vraiment !).
Mais nous préférons proposer une liste imparfaite plutôt que de ne pas vous donner des idées, si vous cherchez à qui donner d’ici la fin de l’année (ou en 2026, hein : ça marche aussi !).
Parmi nos membres (personnellement et donc hyper subjectivement), on donne donc, entre autres, à…
Libertés, Communs et numérique
- l’April, association pour la défense et la promotion du logiciel libre ;
- Open Food Facts, pour un commun indépendant qui décrypte ce qu’il y a dans nos assiettes ;
- Open Street Map France, pour un commun qui fait l’Histoire en dessinant la géographie ;
- La Contre-Voie, association qui héberge des services web et sensibilise au numérique éthique ;
- YesWiki, association au service du logiciel libre pour créer des sites communautaires et collaboratifs ;
- Wikimédia France, l’association des contributions aux projets autour de la Wikipédia Francophone ;
- InterHop, pour le développement de communs numériques de la santé ;
- Exodus Privacy, association qui évalue et popularise le niveau de vie privée des applications android ;
- Internet Archive, pour la préservation et l’archivage de l’internet ;
- GCompris, logiciel libre éducatif pour les enfants de 2 à 10 ans ;
- Thunderbird, le client mail libre qu’on ne présente plus ;
- La Digitale pour concevoir et développer des outils numériques libres pour les enseignantes et les enseignants ;
- Flus, logiciel libre pour trier et partager sa veille digitale sans captation de l’attention ;
- Codeberg, organisation sans but lucratif allemande pour le partage de code et le soutien des communs ;
- Fondation GNOME, l’organisation à but non-lucratif qui supporte le projet GNOME ;
Résistances, empouvoirement et justices
- La Quadrature du Net, pour défendre nos libertés mises à mal par le numérique ;
- Échap, association de lutte contre les cyberviolences sexistes ;
- Le Mouton Numérique, collectif de réflexion technocritique ;
- Résistance à l’Agression Publicitaire, pour libérer nos cerveaux des pollutions commerciales ;
- Le Collectif des Associations Citoyennes, qui défend les libertés du tissus associatif français ;
- Maison des Lanceurs d’Alerte, association de protection et défense de lanceuses et lanceurs d’alertes ;
- Attac, association luttant pour la justice fiscale, sociale et écologique ;
- Halte à l’Obsolescence Programmée, pour favoriser un monde plus durable et réparable ;
- Planning Familial, association à but non-lucratif défendant le droit à l’éducation à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, et luttant contre les violences et les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle ;
- SOS Méditérannée, association civile européenne de sauvetage en mer ;
- Anticor, association qui lutte contre la corruption et milite pour l’éthique en politique ;
- L’armée du salut, qui accueille et aide des personnes de toute origine ou condition, sans distinction ;
- Emmaüs, qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;
- Action contre la faim, qui vise à éliminer la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition ;
- Les Restaurants du Cœur, qui lutte contre la pauvreté ;
- Amnesty Internationale, ONG qui promeut la défense des droits humains et le respect de la Déclaration universelle des droits des humains et humaines ;
- La Société Protectrice des Animaux (SPA), qui œuvre à la protection des droits des animaux ;
- La Croix-Rouge, association qui aide les personnes en difficulté en France et à l’étranger ;
- GreenPeace, qui vise à protéger l’environnement et promouvoir la paix ;
- France Nature Environnement, fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement ;
- Ligue pour la Protection des Oiseaux, association de protection de la nature ;
- Action Justice Climat, luttant pour un monde juste et soutenable ;
Journalistes, artistes : cultiver les libertés
- Au Poste !, Média indépendant qui défend les libertés publiques (et utilise et promeut des outils Libres) ;
- Blast Info, autre média indépendant et citoyen, qui lui aussi co-diffuse ses contenus sur PeerTube ;
- Next, web média indépendant sur les évolutions du numérique ;
- Reflets.info, média indépendant d’investigation en ligne ;
- Reporterre, média indépendant axé sur l’écologie ;
- Basta !, média indépendant d’investigation ;
- StreetPress, média indépendant d’investigation autour de la culture urbaine ;
- Coop Médias, coopérative citoyenne des médias indépendants ;
- Médiacités, média indépendant d’investigation consacré aux principales métropoles françaises ;
- David Revoy, artiste du web-comic libre Pepper & Carrot (et des belles illustration pour Framasoft <3) ;
- Gee, alias Ptilouk, auteur du blog BD Grise-Bouille, de jeux vidéos, le tout sous licences libres !
- Hacking Social, autrices et vidéastes popularisant la psychologie sociale, et l’auto défense contre les autoritarismes ;
- Khaganat, association pour la création d’un univers libre afin d’y créer des histoires, œuvres, jeux vidéos ;
- Lent Ciné, association de production et diffusion d’œuvres audiovisuelles libres ;
- Les designers éthiques, qui œuvrent pour aider à produire un numérique émancipateur durable et désirable ;
- Libre à toi, association de la radio Cause Commune (radio promouvant les Communs) ;
- Dogmazic, plateforme de partage de musique sous licence libre ;
Heureuse année 2026
Merci encore pour votre soutien durant cette campagne, mais aussi tout au long de l’année !
Savoir que nos actions vous sont utiles est une réelle source de motivation et d’inspiration au quotidien.
Toute l’équipe de Framasoft vous souhaite une très belle fin d’année et vous donne rendez-vous, en 2026, pour continuer à changer le monde, un octet à la fois… !

Merci – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
25.12.2025 à 08:57
Libre comme un Lama !
Framasoft
Texte intégral (1450 mots)
Vous avez déjà lu des articles concernant l’April qui est la principale association francophone de promotion et de défense du logiciel libre. En voici un petit nouveau, car comme beaucoup d’associations cette année, l’April a lancé sa campagne du Lama déchaîné pour informer des actions réalisées en 2025 et, surtout, demander de l’aide financière. Il nous semble important de relayer cet appel.
L’April fonctionne (depuis 29 ans !) grâce aux cotisations de ses adhérentes, dont le nombre a un impact d’une part du côté des finances de l’association, mais aussi témoigne du soutien aux valeurs défendues par celle-ci. Si les enjeux du logiciel libre vous intéressent, nous ne pouvons que vous encourager à être (comme Framasoft) membre de l’April.
Cet article est co-écrit par Magali Garnero, alias Bookynette, membre de Framasoft, qui est aussi présidente de l’April. Parce qu’elle a tellement d’énergie à canaliser qu’une seule asso ne suffisait pas ! (et on ne vous dit pas qui dynamise les commerçants autour de sa librairie du 11e arrondissement de Paris)
___
Comme l’année dernière, l’April a ressorti sa mascotte de la résistance, sa gazette hebdomadaire du Lama déchaîné afin de cracher sur les GAFAM d’informer le grand public de manière humoristique à propos des actions réalisées en 2025.

Bannière de campagne de l’April
Le lama, c’est le nouveau pingouin : l’April nous pond une campagne à poils et au poil, pleine d’infos et de bonne humeur.
Ayant commencé le 14 octobre 2025 (en même temps que la fin du support gratuit de Windows 10 de Microsoft, coïncidence, je ne crois pas), cette campagne, qui s’achève le 31 décembre à minuit (environ), offre onze numéros à parcourir. Chaque numéro aborde une thématique différente, ainsi le premier disait Adieu à Windows, le troisième Non à Google, un autre Le Libre est (déjà) leader
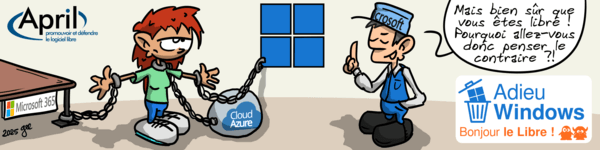
Bannière Adieu Windows de l’April
Notre préféré commençait par Moi, si j’étais maire de ma commune…
Moi, si j’étais maire
Je m’engagerais à :
- donner la priorité aux logiciels libres, dans un premier temps, pour garantir l’indépendance technologique, avec obligation au fur et à mesure des années à venir
- mettre fin aux contrats passés avec des entreprises ne proposant que des logiciels et services privateurs : il faut impérativement réformer les futurs appels d’offres publics pour éliminer toute pulsion en faveur des solutions propriétaires, en tenant compte de l’intérêt général et d’une concurrence loyale
- faire en sorte que tout code, tout logiciel financé par la commune, soit publié sous licence libre, donc,
- réutilisable par toustes
- interopérable, auditable, transparent
- accessible à toustes, notamment aux personnes en situation de handicap
- faire en sorte que les algorithmes utilisés par l’administration locale – impôts, allocations, justice, police, éducation – soient rendus publics pour éviter les biais, les discriminations et les abus de pouvoir
- favoriser le plus possible le réemploi, la réparation, la durabilité des matériels informatiques. Ainsi, la commune s’interdit l’achat de matériel incompatible avec des systèmes d’exploitation libres afin de limiter le gaspillage et l’obsolescence logicielle
- encourager l’enseignement des principes du numérique libre dans les écoles, c’est-à-dire l’étude des logiciels et services libres. De leur création à leur maintenance et amélioration. Les élèves doivent devenir des consomm’acteurs de leur numérique.
- m’assurer que, dans la formation continue des enseignant·es dont le rôle est de former les générations actuelles et futures, les principes du numérique libre avec les logiciels libres soient bien présents afin de pérenniser la culture du Libre
- m’assurer que, dans la formation continue des agents publics, les principes du numérique libre avec utilisation des logiciels libres soient bien présents afin de permettre leur montée en compétences et la pérenniser
- créer un fonds public dédié au financement de projets logiciels libres d’intérêt général avec mise en place d’une forge publique à laquelle chaque commune participerait en publiant ses propres travaux
- défendre la neutralité du Net
- promouvoir l’utilisation de solutions numériques décentralisées et locales
- libérer toutes les données publiques – base de données, cartographies et autres – pour une mise en commun et une réutilisation aisée
- lutter sans relâche contre la fracture numérique par le soutien aux initiatives d’éducation populaire au numérique libre : ateliers, formations, événements, associations, GULL
- financer de nouveaux lieux dédiés – tiers-lieux, fablabs, hackerspaces – pour démocratiser l’accès à la culture et aux outils libres.
Dans chaque numéro, vous pouvez lire quinze rubriques différentes. Quinze manières de vous convaincre d’adhérer à l’association ou de faire un don à l’April, parmi lesquelles :
- des éditos qui sortent souvent les griffes ou qui remercient,
- des dessins humoristiques de Gee, vous ne serez pas dépaysé·es
- des présentations d’autres assos adhérentes ou de projets que l’April veut promouvoir (dont Peertube de Framasoft)
- le portrait de bénévoles de l’association
- des anecdotes, des chiffres, des distributions libres, des logiciels libres pour Android
- des GULL qui ont participé à l’opération Adieu Windows, bonjour le Libre
- et, bien sûr, les inévitables mots croisés que tout le monde réclame.
Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, faites comme Framasoft et plusieurs de ses membres, adhérez à l’April pour promouvoir et défendre le Libre.
Ou faites un don sur En Vente Libre
24.12.2025 à 09:30
De nouveaux jeux dans Framagames
Framasoft
Texte intégral (1685 mots)
Nous avions envie de vous faire une petite surprise en cette fin d’année 2025. Nous ne l’avons pas annoncé dans notre article d’annonce de la campagne de don annuelle. Voici 9 nouveaux jeux pour Framagames, 10 ans après le lancement de ce service.
Le principe
Dans notre idée de proposer également des solutions frugales, nous avons volontairement sélectionné des jeux sous licence libre qui fonctionnent en ligne de manière autonome sans serveur. De simples fichiers HTML, un peu de JavaScript et la magie opère.
Vous partez dans une zone blanche sans aucune connexion ? Aucun souci, il vous suffit de télécharger les fichiers concernés sur votre appareil et vous pourrez toujours profiter de ces jeux. Évidemment, nous ne jouons pas dans la même cour que Clair Obscur : Expedition 33, mais nul doute que vous vous perdrez quelques minutes voire heures avec ces nouveautés.
Les nouveautés
0h h1
Un petit jeu de logique assez addictif.
Catculus
Vous avez du mal avec le calcul mental ? Imaginez ce que c’est quand des chats viennent recouvrir vos nombres !
Hextris
Jouer à Tétris est trop facile pour vous ? Parfait, nous vous proposons de vous tester sur un hexagone.
Merlin vs Alfonso
Vous incarnez Merlin, le magicien, qui est invité au château d’Alfonso. En tant que magicien, vous avez la capacité de manipuler des objets à l’aide de la télékinésie. Tout ce qui est doré ou de couleur jaune peut être déplacé en cliquant sur l’objet. Ainsi vous aiderez Merlin à se déplacer dans le château.
Pac-Man
On ne présente plus le petit bonhomme rond comme un ballon et jaune comme un citron.
Tower Building
Qui construira la plus haute tour ?
Tux of Math Command web
Le portage en HTML du célèbre jeu de calcul mental a été réalisé dans le cadre du projet Afrikalan, qui visait à rendre accessibles les logiciels libres éducatifs en Afrique de l’Ouest.
Wash the cat
Serez-vous capable d’activer les bonnes vannes (Non, Gee, nous ne parlons pas de toi) pour nettoyer ce chat particulièrement dégoûtant.
Casual Crusade
Choisissez les bonnes tuiles pour couvrir tout le territoire et piller les richesses présentes.
Petit focus sur js13kGames
Il s’agit d’une compétition annuelle de création de jeux dont le poids total ne peut pas excéder 13 Ko. Chaque année un nouveau thème ajoute une complexité à ce défi de sobriété. L’année dernière, le chat noir était à l’honneur. Catculus, arrivé en 6e position et Wash the cat, 18e, ont été conçus pour ce concours. N’hésitez pas à vous perdre dans les archives des années précédentes pour retrouver qui parmi nos nouveaux jeux est issu de ce site.
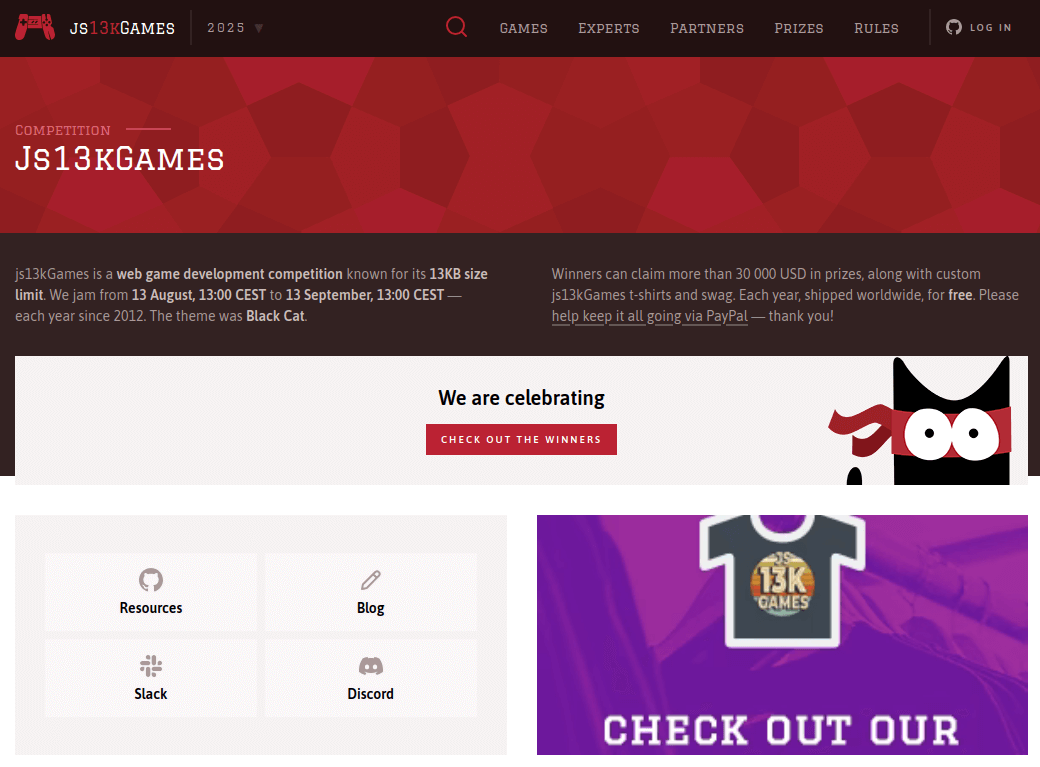
Framagames n’est clairement pas le projet le plus emblématique de Framasoft, mais si Framagames est toujours là 10 ans après son lancement, c’est aussi grâce à votre soutien financier. Merci ! 🥰
À l’heure où nous publions cet article, nous entamons la dernière semaine de notre campagne de don. Il reste donc sept jours pour récolter environ 20 000 € et nous permettre, ainsi, de continuer nos actions pour une année de plus.
Si vous le souhaitez et le pouvez, considérez nous faire un don (défiscalisable à 66 % pour les contribuables français·es).
23.12.2025 à 08:28
Framasoft en chiffres, édition 2025
Framasoft
Texte intégral (8800 mots)
Quel est l’impact concret des actions de notre association ? C’est la question à laquelle nous aimons répondre en fin d’année (cf. chiffres 2016, 2018, 2022, 2023, 2024) : prendre le temps de chiffrer nos actions est essentiel pour réaliser le service que l’on peut rendre aux autres. En route pour les Framastats 2025 !
Grâce à vos dons (défiscalisables à 66 %), l’association Framasoft agit depuis plus de 20 ans pour faire avancer le web éthique et convivial. Retrouvez un focus sur certaines de nos actions en 2024 sur le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (nov. – déc. 2025)
Les statistiques de visites sont issues partiellement de notre service autohébergé Matomo. Ce service, pour différentes raisons, a tendance à sous-estimer la valeur réelle des visites.
Les autres statistiques sont issues des métriques fournies par les logiciels eux-mêmes, ou manuellement obtenues par requêtes SQL sur nos bases de données.
Enfin, ces statistiques ont été récoltées entre le 8 et le 18 décembre, ce qui minimise là encore leurs valeurs réelles, puisqu’il manque entre 23 et 13 jours de comptabilisation (soit environ 5 % des jours de l’année)
Dépliez pour accéder au sommaire
Du côté de nos services en ligne…
Plus de 2 millions de personnes naviguent sur nos sites internet chaque mois : c’est autant que le nombre d’habitant⋅es de Paris intra-muros ! C’est assez fou (et très motivant) d’imaginer que ce que nous faisons est utile à tant de monde.

Dégooglisons Internet – Image CC BY-SA David Revoy
Et service par service, ça donne quoi ?
🗓️ Framadate
💪 Certainement la plus grosse base Framadate au monde, avec près de 1,5 million de sondages en 2025
Framadate permet de créer des mini-sondages, notamment pour trouver le bon créneau de rendez-vous. Nous venons justement d’en annoncer la refonte. Et en chiffres, Framadate c’est :
- 1 436 680 sondages hébergés au total en 2025. Dont :
- 1 338 000 sondages et sur framadate.org (le Framadate « ancienne version », toujours actif).
- 92 680 visites sur beta.framadate.org (le « nouveau Framadate », accessible par défaut depuis mi-novembre)
- 38 475 675 visites en 2025, soit 1 million de plus qu’en 2024
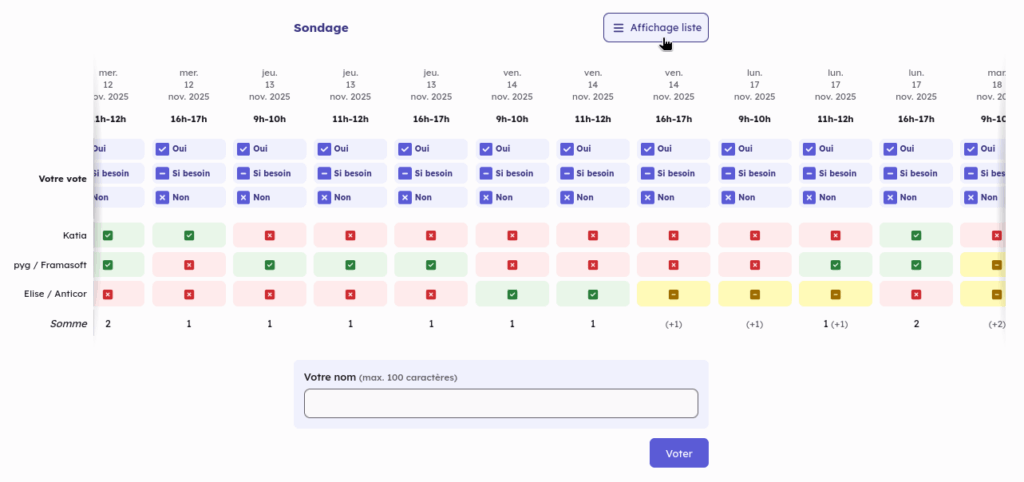
L’affichage classique des résultats, en ligne, est toujours disponible (et par défaut sur écrans larges)
☁️ Framaspace
💪 À notre connaissance la plus large ferme d’instances Nextcloud maintenue par une ONG au monde !
Framaspace est un environnement de travail collaboratif (espace « cloud ») pour les petites associations et collectifs.
En chiffres, c’est :
- 2 502 associations et petits collectifs qui ne s’organisent pas chez Google
- 864 nouveaux espaces ouverts en 2025 (soit 864 instances Nextcloud déployées cette année !)
- 17 serveurs (dédiés et machines virtuelles) pour 640 To d’espace disque provisionné
- 18 456 utilisateurs actifs
- Plus de 7 000 000 de fichiers hébergés (dont 805 000 dans les corbeilles, tout de même 😅)

Framaspace – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
📝 Framaforms
💪 220 000 nouveaux formulaires par an, un demi-million de comptes, 15 millions de visites par an… Framaforms est un « poids lourd » des formulaires
Framaforms permet de créer simplement des questionnaires en ligne. Framaforms en chiffres c’est :
- 15 223 084 de visites par an (soit 1 268 590 visites par mois, en moyenne, et une croissance de 68 % par rapport à 2024 !)
- 797 620 formulaires actuellement hébergés (200 000 de plus que l’an passé)
- 217 433 formulaires créés cette année (23 000 de plus qu’en 2024)
- 522 686 utilisateur⋅ices (+ 100 000 par rapport à 2024)
📨 Framalistes et Framagroupes
💪 Avec près de 70 000 listes actives en 2025, Framalistes et Framagroupes sont certainement les plus gros serveurs de listes de discussions (hors géants du Web) qui existent. Nous décomptons par exemple 2 000 listes publiques sur Universalistes ou 16 316 sur RiseUp.
Framalistes et Framagroupes permettent de créer des listes de discussion par email. Le serveur de Framalistes étant arrivé au maximum de ses capacités, nous avons ouvert Framagroupes en juin 2023, pour continuer à proposer ce service que nous trouvons indispensable. En chiffres, Framalistes et Framagroupes, c’est :
- 1,4 million d’utilisateurs et utilisatrices, soit 100 000 de plus qu’en 2024
- 69 770 listes actives en 2025 (sensiblement le même nombre qu’en 2024, mais ce chiffre ne prend pas en compte que près de 4 000 listes ont été fermées)
- Environ 440 000 mails envoyés en moyenne par jour ouvré (et oui, quand même !)
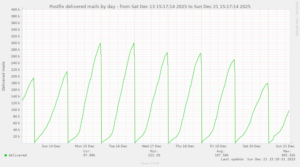
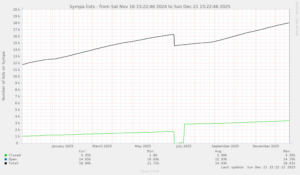
🗒️ Framapad
💪 Avec plus d’un million de pad hébergés en 2025, Framapad est sans doute l’un des plus gros services Etherpad au monde !
Framapad permet de rédiger à plusieurs sur un même document. Framapad en chiffres, c’est :
- Près de 5 millions de visites en 2025
- 1 079 633, la barre du million de pad hébergés à l’instant « t » est donc franchie, c’est tout de même 400 000 pads de plus que l’an passé.
- Plusieurs millions de pads hébergés depuis le lancement du service (rappelons qu’une grande partie des pads « expirent » au bout d’un temps défini s’ils ne sont plus modifiés)
- 369 000 comptes sur MyPads (+ 32 000 par rapport à 2024)
🧮 Framacalc
💪 Malgré une interface plutôt rébarbative, Framacalc est peut-être la plus grosse base Ethercalc au monde ( ?)
Framacalc permet de créer des tableurs collaboratifs. Framacalc en chiffres, c’est :
- 4 841 036 visites en 2025
- 223 220 calcs hébergés
Graphique présentant l’évolution des visites sur Framacalc
💬 Framateam
💪 Avec près de 200 000 canaux de discussions, Framateam est probablement l’une des plus grosses instances Mattermost/MostlyMatter au monde !
Framateam est un service de tchat, et permet une organisation d’équipe par canaux (une alternative à Slack, si vous préférez). Framateam en chiffres, c’est :
- 1 856 877 visites en 2025 (+30 % par rapport à 2024)
- 178 770 utilisateurs et utilisatrices sur le service (dont 7 256 se connectent tous les jours), soit 15 000 de plus qu’en 2024
- 33 752 équipes qui s’organisent
- 201 217 canaux de discussions (18 000 de plus que l’an passé)
- Plus de 56 millions de messages échangés (dont plus de 7 millions cette année)
- Fun fact : Framasoft (qui utilise Framateam comme outil de communication) compte 482 032 messages échangés au total sur près de 200 canaux. Cela fait en moyenne plus de 5 messages chaque heure depuis le lancement de Framateam. Presque 20 si on ne considère que les heures de travail.
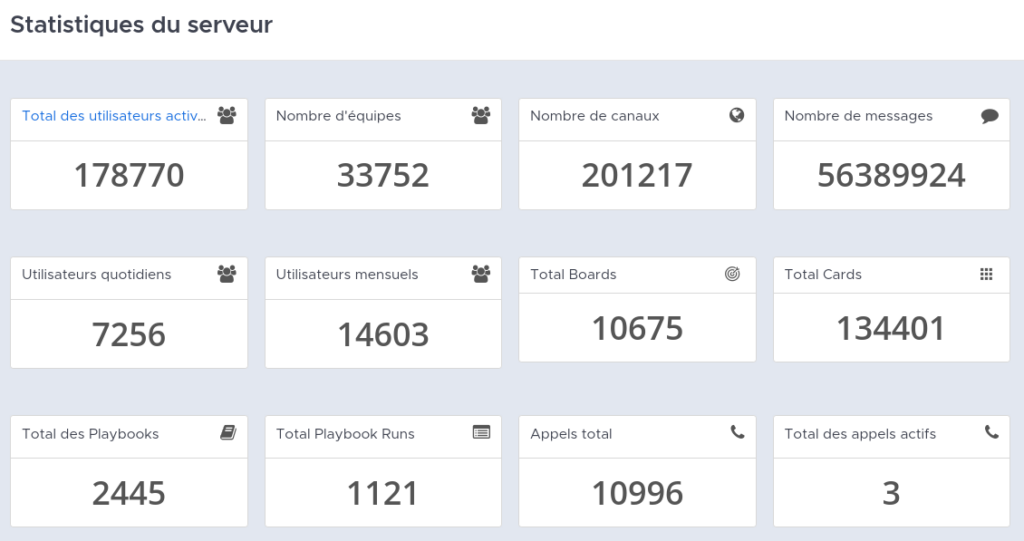
Statistiques de Framateam, notre instance Mattermost/Mostlymatter
🔀 Framagit
💪 Avec près de 85 000 projets hébergés, Framagit est probablement une des plus grosses forges logicielles de France (et fait a priori partie du Top10 des Gitlab mondiaux).
Framagit est une forge logicielle, où développeurs et développeuses peuvent publier leur code et contribuer à celui des autres. Framagit en chiffres, c’est :
- 1 546 973 visites
- 84 096 projets hébergés (7 000 projets de plus qu’en 2024)
- 55 052 utilisateurs et utilisatrices (2 000 de plus)
- 11 076 forks
- 170 032 issues
- 113 412 Merge requests
- 1,95 million de notes
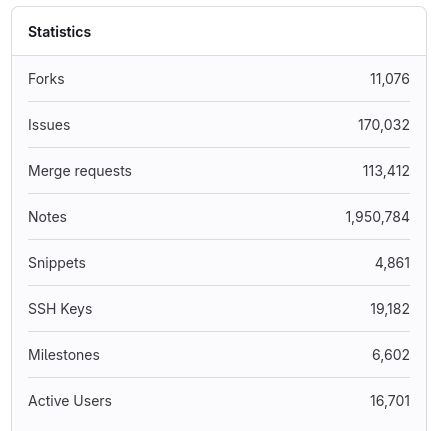
Capture écran du tableau d’accueil de Framagit
🗳️ Framavox
Framavox est probablement une des plus grosses instances existantes de l’excellent logiciel Loomio, avec près de 20 000 communautés.
Framavox permet à un collectif de se réunir, débattre et prendre des décisions, dans un seul endroit. Framavox en chiffres, c’est :
- 157 050 visites en 2025 (+14 %)
- 135 939 utilisateurs et utilisatrices, soit 7 000 de plus qu’en 2024
- 18 634 communautés, ce qui fait plus de 5 000 nouvelles communautés accueillies en 2025

Framavox – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
📍 Framacarte
Framacarte permet de créer des cartes géographiques en ligne. Et en chiffres, c’est :
- 2 654 245 visites en 2024 (-17 % par rapport à 2024. Ah ! enfin un site dont les stats baissent ! )
- 11 950 8 764 utilisateurs et utilisatrices (+ 3 186 en un an)
- 216 750 cartes hébergées (+ 19 772 en un an)
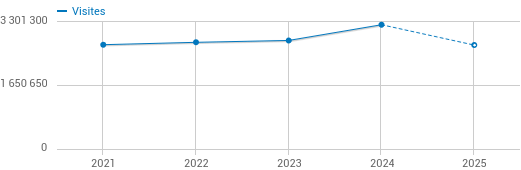
Graphique présentant l’évolution des visites sur Framacarte depuis 2021
🗣️ Framatalk
Framatalk permet de créer ou rejoindre un salon de vidéoconférence. Et en chiffres, c’est :
- 98 146 visites en 2025 (+50 %)
- 84 000 sessions depuis le début de l’année visioconférences hébergées en 2025, initiées par 15 800 utilisateurs
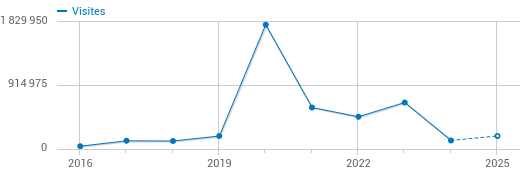
Graphique présentant l’évolution des visites sur Framatalk (remarquez cet énorme pic pendant l’année des confinements !)
🧠 Framindmap
Framindmap permet de créer des cartes mentales. En chiffres, Framindmap c’est :
- 259 655 visites en 2025 (-9 %)
- Environ 1,5 million de cartes mentales hébergées
- Environ 600 000 utilisateurs et utilisatrices
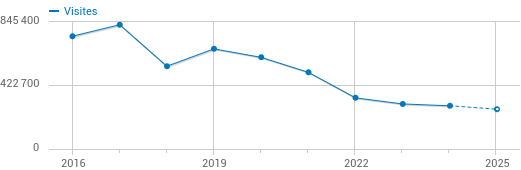
Graphique présentant l’évolution des visites sur Framindmap
📅 Framagenda
L’outil est basé sur Nextcloud, et en terme de comptes (150 000), c’est ce qu’on peut appeler une « grosse instance »
Framagenda permet de créer des calendriers et événements, ainsi que de gérer des contacts en ligne. Framagenda en chiffres, c’est :
En chiffres, c’est :
- 200 536 visites
- près de 314 000 calendriers (environ 15 000 calendriers de plus)
- plus de 150 000 utilisateurices (c’est environ 30 000 de plus que l’an passé). 33 000 utilisateurs actifs cette année.
- 27 millions d’événements (incluant événements des souscriptions)
- 2,6 millions de contacts
- 1 558 équipes
- 20 000 decks (tableaux utilisant la méthode Kanban)
- 66 600 salons de discussion
📁 Framadrive
Framadrive, service de stockage de documents, n’est plus ouvert aux inscriptions, mais fonctionne toujours ! Et en chiffres, c’est :
- 8,6 millions de fichiers
- 7 200 utilisateurs et utilisatrices (1 126 actifs en 2025)
- 21 000 partages par lien public
🎉 Mobilizon
Mobilizon est une alternative aux groupes et événements Facebook. Nous avons transmis le code à la communauté, et notamment à l’association Kaihuri, en 2024. En chiffres, les données du réseau Mobilizon, c’est :
- 366 136 événements
- 46 487 utilisateurs et utilisatrices (soit 63 % de plus qu’en 2024 !)
- 86 instances (8 de plus qu’en 2024)
- 5 341 groupes (plus de 1 000 groupes supplémentaires)
Pour notre instance https://mobilizon.fr, qui reste gérée par Framasoft, les chiffres sont :
- 103 963 visites (+15 %)
- 15 479 événement publiés
- 13 952 utilisateur⋅ices
- 2 329 groupes

Mobilizon – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
🐘 Framapiaf
Framapiaf, installation du logiciel de micro-bloging Mastodon, n’est plus ouvert aux nouvelles inscriptions mais reste bien actif. En chiffres, c’est :
- 347 049 visites (+66 %, merci Elon !)
- 793 utilisateurs et utilisatrices s’étant connecté·es dans les 30 derniers jours
- 2 650 000 messages postés depuis la mise en place de l’instance.
Framasoft en tant qu’éditeur logiciel
Malgré un dépôt Framagit contenant près de 35 projets logiciels, aujourd’hui, Framasoft n’édite officiellement qu’un seul logiciel « phare » : PeerTube (ainsi que son application mobile).

Dessin dans le style d’un jeu vidéo de combat, où s’affronte le poulpe de PeerTube et le monstre de YouTube, Twitch et Viméo.
📺 PeerTube
💪 PeerTube est l’une des rares alternatives crédibles aux plateformes vidéos centralisatrices. Près de 1 800 installations actives du logiciel, hébergeant 1,3 million de vidéos, qui dépasseront bientôt le milliard de vues.
PeerTube est une alternative aux plateformes vidéo type YouTube, Twitch, Dailymotion ou Vimeo.
NB : nous avons changé notre méthode de comptage, ce qui rend la comparaison avec l’année précédente caduque. Les statistiques ci-dessous ne contiennent que les données remontées volontairement par les instances PeerTube.
Et en chiffres c’est :
- 721 517 utilisateurs et utilisatrices, soit 300 000 de plus qu’en 2024
- En termes de comptes actifs, cela donne 5 384 quotidiennement, 17 465 par semaine, 38 897 par mois.
- 1 368 408 vidéos
- 1 782 instances publiques
- 384 742 commentaires sur les vidéos
- 827 695 635 millions de vues (on compte une vue à partir de 10 secondes de lecture sur la vidéo). Nous devrions donc atteindre le milliard de vues en 2026.
- 858 To de fichiers
- 345 issues résolues en 2025 (sur 5 257 issues traitées au total)
- 533 365 visites sur JoinPeerTube.org (contre 441 591 l’an passé, soit une progression de 8,5 %)
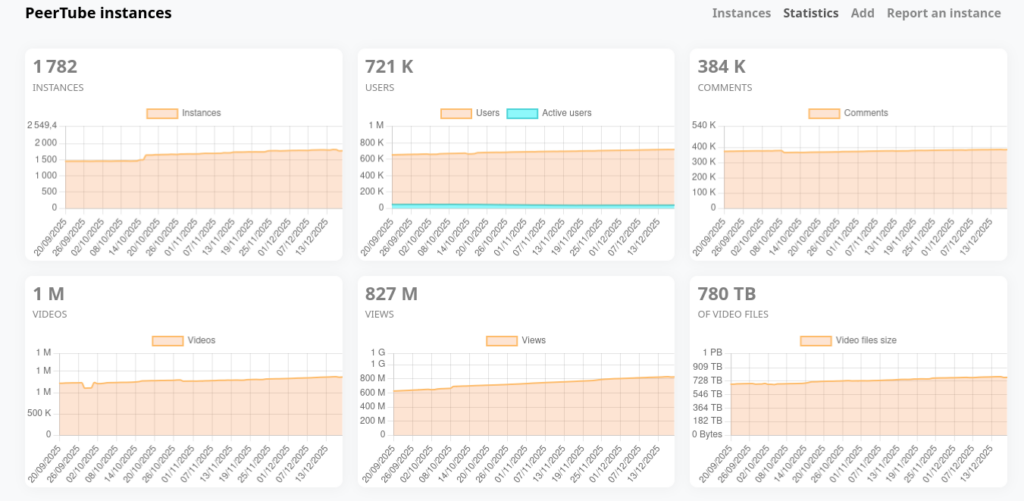
Statistiques PeerTube des derniers mois de 2025 : instances, utilisateurices, commentaires, vidéos, vues et poids des vidéos
📱 PeerTube App
Nous développons depuis maintenant plus de deux ans une application mobile pour PeerTube (iOS/Android).
La nouvelle version vient tout juste d’être publiée.
- nombre de téléchargements : 160 448
- iOS : 56 400
- App Store : 104 048
- F-Droid : (F-Droid ne communique pas de statistiques)
Les petits nouveaux !
Framasoft a sorti des nouveaux services fin 2025 !
Les statistiques sont forcément peu impressionnantes car ils viennent d’éclore. Cependant, tant qu’à être transparent⋅es, on vous donne les chiffres !

Dorlotons Dégooglisons – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
✍️ Framapetitions
Framapetitions, c’est notre alternative éthique à Change.org ou Avaaz. Le projet est encore très frais, mais on ne doute pas trop de son succès à terme. Lisez l’article d’annonce pour en apprendre plus. En chiffres, c’est :
- 59 232 visites
- 60 pétitions
- 83 utilisateur⋅ices
📄 FramaPDF
FramaPDF est une boite à outils pour manipuler des PDF (compresser, signer, ajouter/retirer/pivoter des pages, etc). Lisez l’article d’annonce pour en apprendre plus. En chiffres, c’est :
- 48 712 visites
- 21 502 visites sur SignaturePDF
- 27 210 visites sur StirlingPDF
💸 Framacount
Framacount, c’est notre alternative à Tricount, histoire de savoir « Qui doit combien à qui ? ». Lisez l’article d’annonce pour en apprendre plus. En chiffres, c’est :
- 16 492 visites
- 571 groupes
- 2 303 participants
- 2 141 dépenses enregistrées
🛠️ FramaToolbox
FramaToolbox est une sorte de « couteau suisse numérique » pour manipuler des fichiers ou du texte. Le service compte plus d’une centaines d’outils pour convertir, compresser, créer des listes, etc. Lisez l’article d’annonce pour en apprendre plus. En chiffres, c’est :
- 13 285 visites

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
🎙️➡️📝 Lokas
Lokas est notre prototype d’application smartphone pour la transcription, qui respecte totalement votre vie privée. Sortie fin 2024, en chiffres, c’est :
- 12 329 visites (+308 % par rapport à 2024)
- Nombre de téléchargements : 4 919
- iOS : 2 260
- App Store : 2 659
- 8 000 transcriptions effectuées
🤪 Parce qu’il est bon de rire, parfois !
🎮 Framagames
Framagames, c’est notre petit site internet, qui regroupe des jeux libres pour jouer sans quitter son navigateur. Framagames en chiffres, c’est :
- 22 jeux (9 de plus qu’en 2024 !)
- 255 000 visites en 2025
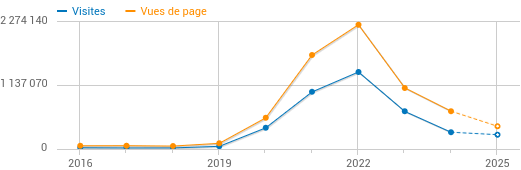
Statistiques de visites de Framagames depuis 2016 – Vous noterez le joli pic pendant le COVID
🌬️ Framaprout
Framaprout est un site réalisé en 48h en plein COVID. Il s’agissait de dégazer un peu l’anxiété causée par cette période très stressante pour nous (et pour tout le monde). Framaprout en chiffres, c’est :
- 12 424 visites (15 % de plus qu’en 2024 )
Pour « Proutify », notre extension qui remplace les noms de personnalités célèbres par « prout »
- Pour Firefox
- 144 utilisateur⋅ices quotidien⋅nes
- une note de 4.7/5 avec 38 avis
- 272 téléchargements dans les 365 derniers jours.
- 1636 téléchargements en tout
- Pour Chrome/Chromium
- 349 utilisateur⋅ices quotidien⋅nes
🤣 Framamèmes
Framamemes.org est un site qui vous permet de générer vos propres mèmes à partir d’images qui ont la particularité d’être sous licence libre. Les mèmes sont générés sans filigrane ni tatouage numérique (watermark), et le générateur est lui-même sous licence libre. Framamèmes en chiffres, c’est :
- 16 illustrations types, réalisées par Gee
- 11 632 visites en 2025 (site publié le…1er avril 2025 !)


IIllustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Je soutiens les services de Framasoft
L’association et les communs culturels
Les services en ligne que nous mettons à disposition du public ne sont pas les seuls à occuper nos journées. Voilà quelques chiffres concernant d’autres actions que nous avons menées à bien cette année.
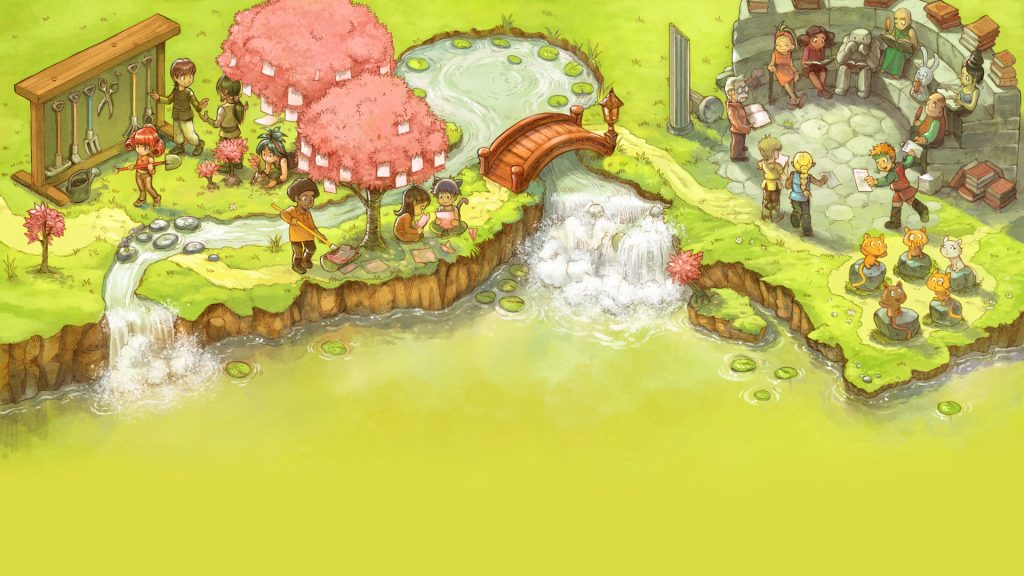
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
🎤🧑🏫 En interne
- 39 interventions en 2025, en présentiel et/ou en ligne sur le numérique, les communs culturels et leurs enjeux
- Plus de 118 articles publiés sur le Framablog en 2025 (une quinzaine de plus qu’en 2024), qui compte 3 173 articles au total
- 305 000 abonné⋅es confirmé⋅es à notre Newsletter
- 6 ouvrages dans notre collection « Des livres en communs »
- 21 manuels, 8 essais, 12 bédés et 16 romans, soit 57 ouvrages dans notre (aujourd’hui archivée) maison d’édition Framabook

Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
🎥 Vidéo non intégrée (JavaScript désactivé).
👉
Voir la conférence « Ce n’est pas l’IA que vous détestez, c’est le capitalisme ! » sur Framatube
🤝 Les projets partagés
- Framasoft cité dans (au moins !) 29 articles francophones et 26 articles non-francophones
- 1 150 notices sur l’annuaire Framalibre, soit 22 de plus que l’an passé
- 54 prestataires (3 de plus qu’en 2024) en capacité d’accompagner des associations dans leur émancipation numérique recensés sur le site emancipasso.org
- 2 MOOC « Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle ? » et « Développer une offre de services pour accompagner les associations dans leur transition numérique éthique »
- La poursuite de la transmission de la coordination après 8 années d’animation du collectif CHATONS, regroupant actuellement 86 hébergeurs alternatifs
- L’hébergement de sites « amis » comme celui d’Affordance (de l’ami Olivier), qui vient de passer les 3 000 articles publiés, ou celui de Grisebouille (de l’ami Gee, avec même pas 700 articles, au boulot fainéant !). Ou encore l’hébergement des vidéos de nos ami⋅es de Datagueule.
- Comme chaque année, Framasoft a aussi contribué activement à de nombreux autres projets autour du libre et des communs (sous forme de code, notamment à Nextcloud, ou de soutien financier à d’autres structures).
✨ IAller ou pas ?
L’un des sujets de 2025 aura sans conteste été l’Intelligence artificielle ! Dès fin 2024, et encore plus en 2025, nous avons travaillé sur le sujet. Notamment pour démystifier l’IA générative et la placer dans une perspective historique et économique.
-
Publication du site d’information Framamia (32 000 visites en 2025, contre 6 250 en 2024)
-
Production d’une conférence fleuve « Ce n’est pas l’IA que vous détestez, c’est le capitalisme ! »
-
https://lokas.app : prototype d’application smartphone pour la transcription (8 000 transcriptions réalisées)
-
Des projets étudiants dans le cours LowNum
- Mais aussi une veille partagée conséquente :
-
- Au travers de la revue hebodmaire Khrys’Presso
- Au travers de nos FramIActus
- Avec la republication (autorisée) de numéros du média « Dans les algorithmes » : https://framablog.org/tag/dans-les-algorithmes/
- La participation à de nombreux événements (caféIA, NEC ESS, …) ou interviews (Humanité, Reporterre, …)
Conférence « Ce n’est pas l’IA que vous détestez, c’est le capitalisme ! »
Une des multiples interventions données par Framasoft en 2025.
🎥 Vidéo non intégrée (JavaScript désactivé).
👉
Voir la conférence « Ce n’est pas l’IA que vous détestez, c’est le capitalisme ! » sur Framatube
Je soutiens les actions de Framasoft
🏗️ Infrastructure technique
Framasoft est, à notre connaissance, le plus gros hébergeur associatif de services en ligne au monde !
En chiffres :
- 68 serveurs physiques et 61 machines virtuelles qui hébergent nos services en ligne (soit 5 serveurs physiques de plus qu’en 2024)
- Environ 500 To de stockage provisionné
- 171 noms de domaines (on ne remercie pas les typosquatteurs)
- 52 TB entrants et 119 TB sortants pour les IP du réseau Framasoft et 69 TB et 399 TB sortants pour les sous réseaux (ces données n’incluent pas décembre 2025)
- 0,7 tonne équivalent CO2 pour la consommation électrique annuelle de notre infrastructure technique (notre hébergeur Hetzner utilisant des énergies renouvelables hydroélectriques et éoliennes). Cela est évidemment loin d’être négligeable, mais rappelons que cela fait 0,03g équivalent CO2 par visiteur⋅ices et par mois.
- 1 administrateur systèmes et réseaux (seulement ! ) à temps plein et 2 personnes en soutien (à temps très très partiel) à cet adminsys
- 1 personne au support (seulement ! ) à temps plein
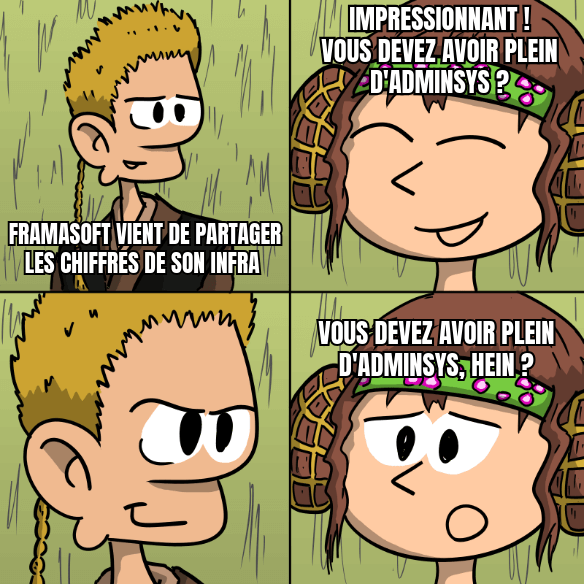
– Anakin : « Framasoft vient de partager les chiffres de son infrastructure technique. » (68 serveurs dédiés, 61 machines virtuelles)
– Padmé : « Impressionnant, vous devez avoir plein d’administrateurs systèmes ? »
– Anakin regarde Padmé avec un sourire en coin. (1 seul adminsys à Framasoft)
– Padmé, inquiète : « Vous devez avoir plein d’administrateurs systèmes, hein ? »
— Mème Framamemes.org
🧑🤝🧑 Richesses humaines
(parce que nous ne sommes pas des ressources :-P )
Framasoft, c’est :
- Une association de 35 adhérent⋅es
- 26 bénévoles qui interviennent ponctuellement ou régulièrement sur :
- la représentation publique (stands, conférences, webinaires)
- la communication (relecture, écriture d’articles, interviews, relai de messages)
- la gestion de projets (tels que « Des livres en communs »)
- la stratégie associative
- l’administration de l’association
- etc
- 9 salarié⋅es
- 1 personne au support, pour répondre à vos questions (surtout lorsqu’elles sont polies !), qui participe à la communication (Newsletters, notamment)
- 1 personne à la direction (largement aussi développeur à ~20 % de son temps plein)
- 1 personne aux tâches administratives et comptables (mais aussi aux tâches logistiques)
- 1 personne « couteau suisse », notamment sur la communication (mais aussi en backup adminsys)
- 1 personne pour coordonner les différents services en ligne (mais aussi largement en représentation publique et institutionnelle, ainsi qu’en support communication)
- 1 personne pour développer PeerTube (oui oui, une seule personne)
- 1 personne pour développer l’application mobile PeerTube (qui file aussi un coup de main à notre adminsys)
- 1 personne en alternance, notamment sur le développement d’applications pour Framaspace
- 1 personne en administration systèmes, pour gérer les différents serveurs et services (oui oui, cette personne est un peu le coeur de Framasoft)
- Une communauté de contributeur⋅ices pour :
- Les traductions d’articles ou de chaînes logicielles
- Le support sur nos forums
- Des coups de mains ponctuels sur les stands
- ❤️ Environ 9 000 personnes qui nous soutiennent financièrement chaque année ! ❤️
- 26 bénévoles qui interviennent ponctuellement ou régulièrement sur :

IIllustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
En soutenant Framasoft, vous choisissez de remettre la technologie à sa place : le numérique est au service de l’humain, et non du capitalisme. Vous aidez à maintenir un Internet où la culture et le savoir peuvent se diffuser librement, où l’on partage des outils plutôt que de les monétiser. Vous offrez aux plus démunis l’accès à des services numériques respectueux, quand d’autres les en priveraient faute de rentabilité.

Nous estimons avoir besoin de récolter 250 000 € d’ici le 31 décembre pour pouvoir poursuivre et étendre nos actions en 2026. En date du 23 décembre 2025, il vous reste donc 8 jours pour vous mobiliser et nous soutenir.
En animant cette campagne de dons 2025, nous faisons appel à toutes celles et ceux qui refusent de rester spectateur⋅ices du capitalisme de surveillance, de l’emmerdification d’internet. En faisant un don, vous choisissez le camp du commun et affirmez qu’un autre numérique est possible.
23.12.2025 à 08:24
Framasoft in numbers, 2025 edition
Framasoft
Texte intégral (5430 mots)
What tangible impact does our association have ? This is the question we like to explore at the end of each year (see our figures for 2016, 2018, 2022, 2023, and 2024). Looking at the numbers helps us better understand the real-world value of what we do. Welcome to Framastats 2025 !
Thanks to your donations (66 % tax-deductible in France), Framasoft has been working for over 20 years to promote a more ethical, friendly, and human-centered web. Below, we highlight some of our actions in 2024.
➡️ Read all articles from this campaign (Nov. – Dec. 2025)
Part of the traffic data comes from our self-hosted analytics tool, Matomo. As with many privacy-respecting analytics solutions, these figures tend to underestimate actual usage.
Additional statistics are sourced directly from the software we run, or from manual SQL queries on our databases.
Finally, data collection took place between December 8 and December 18, meaning that roughly two to three weeks of activity are missing (about 5 % of the year).
Our online services at a glance
More than 2 million people use Framasoft websites every month, roughly the population of a large European capital like Paris. It’s both humbling and energizing to realize how many people rely on the tools we maintain.

De-google-ify the Internet – Illustration CC BY-SA by David Revoy
So what does this look like, service by service ?
🗓️ Framadate
💪 One of the largest scheduling and polling platforms of its kind worldwide, with nearly 1.5 million polls created in 2025
Framadate helps groups and communities find the right time to meet through simple, accessible polls. In 2025, we also rolled out a major redesign.
In 2025 :
- 1.4 million polls hosted across our infrastructure
- 38.5 million visits over the year
☁️ Framaspace
💪 To our knowledge, the world’s largest non-profit-operated Nextcloud ecosystem
Framaspace provides collaborative digital workspaces for small non-profits, grassroots organizations, and informal collectives looking for alternatives to Big Tech platforms.
In 2025 :
- 2,502 organizations chose Framaspace instead of Google-based tools
- 864 new Nextcloud instances were deployed
- Over 7 million files stored across the platform

📝 Framaforms
💪 A major player in online forms, with hundreds of thousands of new forms created every year
Framaforms enables individuals, collectives and organizations to create online surveys and questionnaires without ads, tracking or data exploitation.
In 2025 :
- Over 15 million visits (+68 % compared to 2024)
- Nearly 800,000 forms hosted in total
- More than 217,000 new forms created during the year
- Over 520,000 user accounts
📨 Framalistes & Framagroupes
💪 Among the largest non-commercial mailing list services in operation today, outside of Big Tech platforms
Framalistes and Framagroupes allow groups to create and manage email discussion lists, a simple but still essential communication tool.
As the original Framalistes infrastructure reached its limits, Framagroupes was launched in 2023 to ensure continuity of this service.
In 2025 :
- About 1.4 million users
- Nearly 70,000 active mailing lists
- Roughly 440,000 emails sent every working day
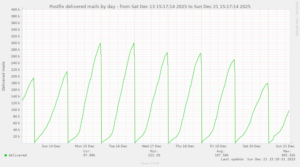
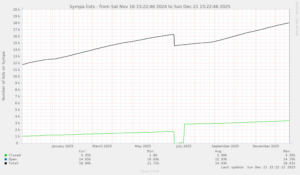
🗒️ Framapad
💪 One of the largest Etherpad-based collaborative writing services worldwide
Framapad allows multiple people to write together on the same document in real time, without requiring accounts or complex setup.
In 2025 :
- Nearly 5 million visits
- More than 1 million active pads hosted at any given time
- Hundreds of thousands of new pads created compared to the previous year
🧮 Framacalc
💪 Possibly the largest EtherCalc deployment in the world, despite its spartan interface
Framacalc provides collaborative online spreadsheets, often used for quick calculations, collective budgeting or shared data tables.
In 2025 :
- Nearly 5 million visits
- Over 220,000 spreadsheets hosted
💬 Framateam
💪 One of the world’s largest Mattermost-based team chat instances
Framateam is a team chat service that helps groups organize discussions into channels, without surveillance or advertising.
In 2025 :
- Almost 1.9 million visits (+30 % year-on-year)
- Nearly 180,000 users, including several thousand daily active users
- More than 200,000 discussion channels
- Over 56 million messages exchanged in total
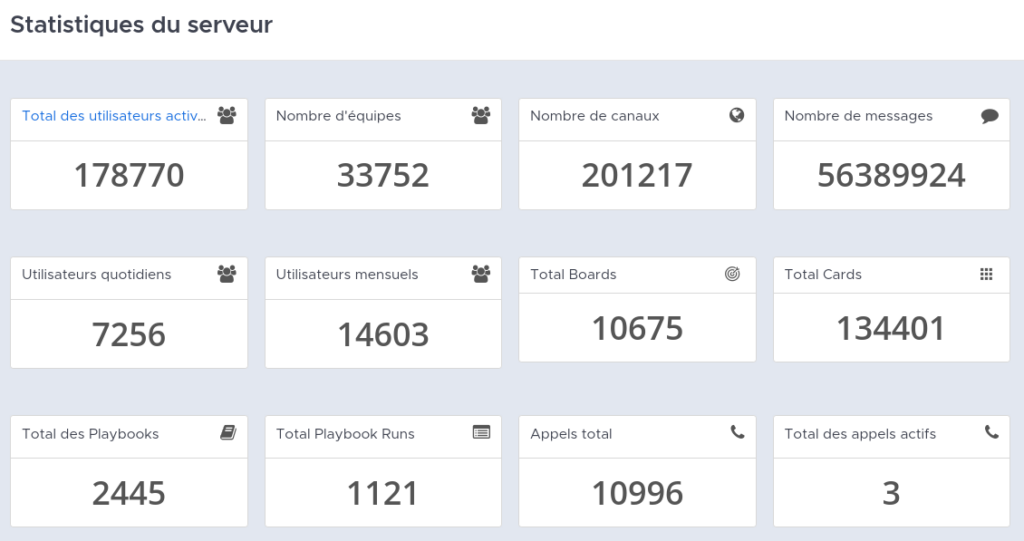
🔀 Framagit
💪 One of the largest non-commercial Git hosting platforms in France
Framagit is a collaborative software forge where developers can publish code, manage issues and contribute to shared projects.
In 2025 :
- More than 84,000 hosted projects
- Over 55,000 users
- Tens of thousands of forks, issues and merge requests
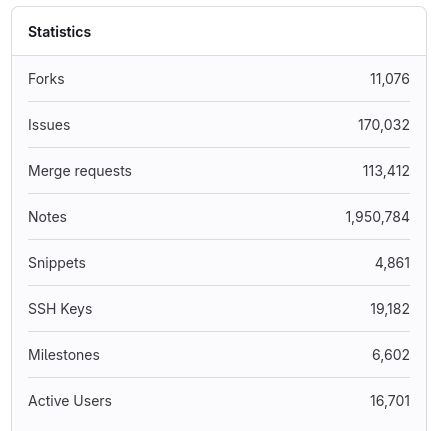
🗳️ Framavox
Framavox is one of the largest existing instances of the Loomio decision-making software, with nearly 20,000 communities.
Framavox enables collectives to meet, discuss and make decisions together in a single shared space.
In 2025 :
- 157,050 visits (+14 % compared to 2024)
- 135,939 users, around 7,000 more than in 2024
- 18,634 communities, including more than 5,000 created during the year

📍 Framacarte
Framacarte allows users to create and share custom online maps for projects, events or collective initiatives.
In 2025 :
- 2,654,245 visits (-17 % compared to 2024)
- 11,950,764 users (+3,186 in one year)
- 216,750 hosted maps (+19,772 in one year)
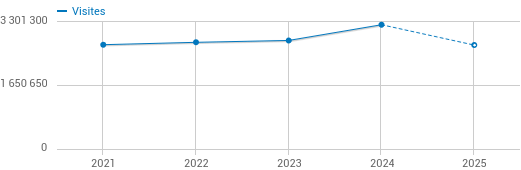
🗣️ Framatalk
Framatalk allows users to create or join video-conferencing rooms without installing software or creating accounts.
In 2025 :
- 98,146 visits (+50 % compared to 2024)
- 84,000 video-conferencing sessions hosted during the year
- Sessions initiated by 15,800 users
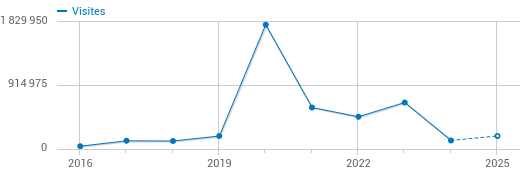
🧠 Framindmap
Framindmap enables users to create mind maps online, individually or collaboratively.
In 2025 :
- 259,655 visits (-9 %)
- 1,361,130 mind maps hosted in total
- 223,000 new mind maps created during the year
- 588,584 users, around 100,000 more than in 2023
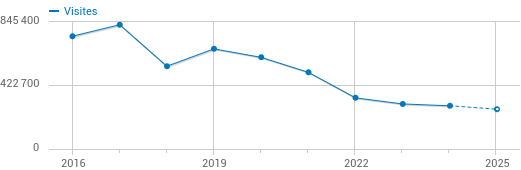
📅 Framagenda
A large-scale Nextcloud-based calendar and contact service
Framagenda allows users to manage calendars, events, contacts and collaborative tools online.
In 2025 :
- 200,536 visits
- 314,000 calendars (about 15,000 more than in 2024)
- More than 150,000 user accounts, including 33,000 active users during the year
- 27 million events (including subscription events)
- 2.6 million contacts
- 1,558 teams
- 20,000 decks (Kanban-style boards)
- 66,600 discussion rooms
📁 Framadrive
Framadrive is a document storage and sharing service. While it is no longer open to new registrations, it remains fully operational.
In 2025 :
- 8.6 million files stored
- 7,200 users, including 1,126 active users
- 21,000 public link shares
🧑🤝🧑 Mobilizon
Mobilizon is a federated alternative to Facebook groups and events. In 2024, Framasoft handed over the codebase to the community, notably to the Kaihuri association.
Across the Mobilizon network :
- 366,136 events
- 46,487 users (+63 % compared to 2024)
- 86 instances (8 more than in 2024)
- 5,341 groups (over 1,000 additional groups)
For the instance operated directly by Framasoft (mobilizon.fr) :
- 103,963 visits (+15 %)
- 15,479 published events
- 13,952 users
- 2,329 groups

🐘 Framapiaf
Framapiaf is Framasoft’s Mastodon instance. Although it is closed to new registrations, it remains very active.
In 2025 :
- 347,049 visits (+66 %)
- 793 users who logged in during the last 30 days
- 2,650,000 messages posted since the instance was launched
🎮 Framagames
Framagames is our little website, which brings together free games that you can play without leaving your browser. Framagames in figures :
- 22 games (9 more than in 2024 !)
- 255,000 visits in 2025
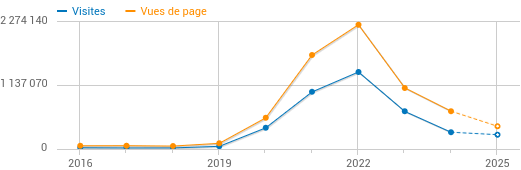
Framasoft as a software publisher
Despite maintaining a Framagit repository with nearly 35 software projects, Framasoft currently officially publishes a single flagship application : PeerTube (along with its mobile app).

Drawing in the style of a fighting video game, where PeerTube’s octopus battles the monster of YouTube, Twitch, and Vimeo.
📺 PeerTube
💪 One of the rare, credible alternatives to centralized video platforms
PeerTube is a decentralized alternative to platforms such as YouTube, Twitch, Dailymotion or Vimeo.
Important note : our counting methodology has changed, making year-to-year comparisons unreliable. The statistics below only include data voluntarily reported by PeerTube instances.
In 2025 :
- 721,517 users, around 300,000 more than in 2024
- Active accounts : 5,384 daily, 17,465 weekly, 38,897 monthly
- 1,368,408 videos
- 1,782 public instances
- 384,742 comments posted on videos
- 827,695,635 views (a view is counted after 10 seconds of playback)
- We therefore expect to reach one billion views in 2026
- 858 TB of video files stored
- 345 issues resolved in 2024 (out of 5,257 issues handled overall)
- 533,365 visits on JoinPeerTube.org (+8.5 % compared to 2024)
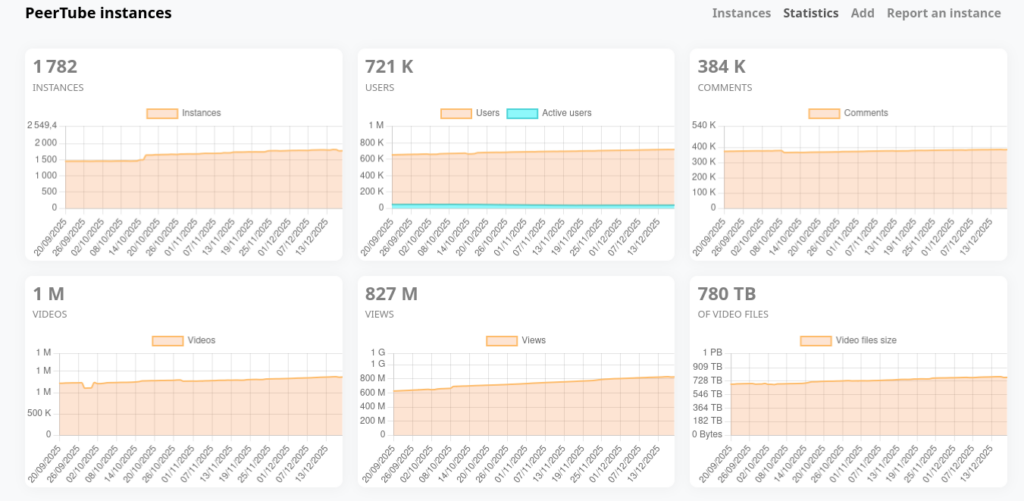
PeerTube statistics for the last months of 2025 : instances, users, comments, videos, views and storage volume
📱 PeerTube App
We have been developing a mobile application for PeerTube (iOS and Android) for over two years.
The latest version has just been released.
- Total downloads : 110,448
- iOS : 56,400
- Android (Play Store) : 104,048
- F-Droid : statistics not available
The newcomers
At the end of 2025, Framasoft launched several new services.
Since these tools are still very recent, their figures are naturally more modest. Still, transparency matters to us, so here are the numbers !

Dorlotons Dégooglisons – Illustration CC BY-SA by David Revoy
✍️ Framapetitions
Framapetitions is our ethical alternative to platforms like Change.org or Avaaz.
Although the project is still young, we are confident in its long-term relevance. You can read the announcement article for more context.
In 2025 :
- 59,232 visits
- 60 petitions
- 83 users
📄 FramaPDF
FramaPDF is a toolbox for working with PDF files (compressing, signing, adding, removing or rotating pages, and more).
More details are available in the announcement article.
In 2025 :
- 48,712 visits
- 21,502 visits on SignaturePDF
- 27,210 visits on StirlingPDF
💸 Framacount
Framacount is our alternative to Tricount. A simple way to keep track of shared expenses and answer the question : “Who owes how much to whom ?”
In 2025 :
- 16,492 visits
- 571 groups
- 2,303 participants
- 2,141 recorded expenses
🛠️ FramaToolbox
FramaToolbox is a kind of “digital Swiss army knife”, offering more than a hundred small tools to manipulate files or text (conversion, compression, formatting, etc.).
In 2025 :
- 13,285 visits
🎙️➡️📝 Lokas
Lokas is our prototype mobile application for audio transcription, designed with privacy in mind.
Released at the end of 2024, it recorded the following figures in 2025 :
- 12,329 visits (+308 % compared to 2024)
- 4,919 downloads
- iOS : 2,260
- Android (Play Store) : 2,659
- 8,000 transcriptions completed
The association and cultural commons
The online services we provide are only part of Framasoft’s work. Here are a few figures related to other activities we carried out in 2025.
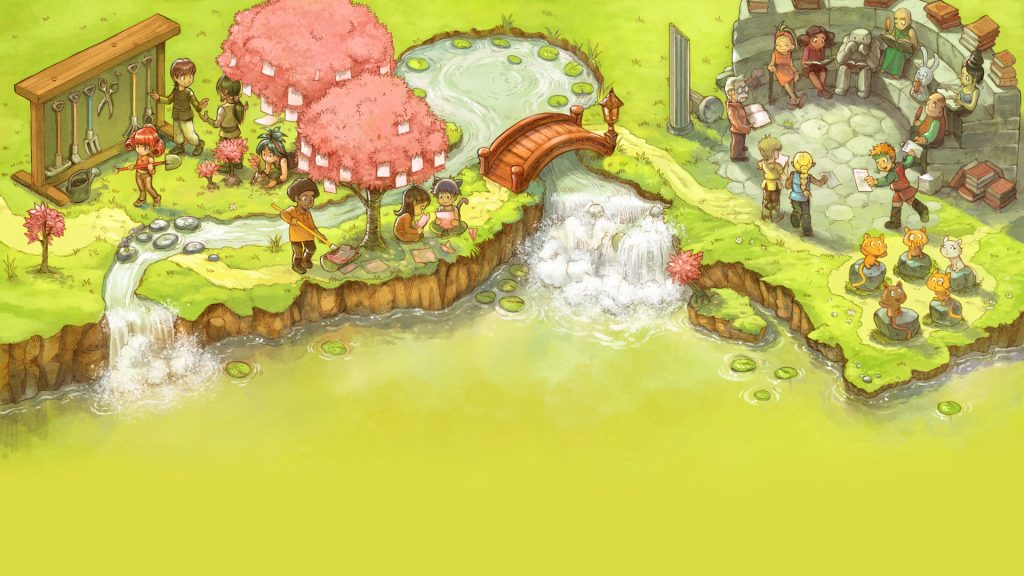
Illustration by David Revoy – License : CC-BY 4.0
🎤🧑🏫 Internal activities
- 39 talks and workshops in 2025, held both in person and online, on digital issues and cultural commons
- Over 118 articles published on the Framablog during the year
- 305,000 confirmed subsribers to our newsletter
- 6 publications in our “Des livres en communs” collection
- 21 textbooks, 8 essays, 12 comic books, and 16 novels, for a total of 57 publications in our (now archived) Framabook publishing house

🤝 Shared projects and partnerships
- Framasoft mentioned in at least 29 French-language articles and 26 articles in other languages
- 1,150 entries listed in the Framalibre directory
- 54 service providers supporting non-profits in their digital emancipation, listed on emancipasso.org
- Continued transfer of coordination after eight years of facilitating the CHATONS collective, now bringing together 86 alternative hosting providers
- Ongoing contributions to many free software and commons-oriented projects, through code, documentation and financial support
🏗️ Technical infrastructure
To our knowledge, Framasoft is the largest non-profit host of online services in the world.
In 2025 :
- 68 physical servers and 61 virtual machines hosting our services
- 52 TB of inbound traffic and 119 TB of outbound traffic on the main network, plus 69 TB inbound and 399 TB outbound on subnets (excluding December 2025)
- 0.7 tonnes of CO₂ equivalent for annual electricity consumption (our host, Hetzner, relies on renewable hydro and wind energy)
- 1 full-time systems and network administrator, supported by two part-time contributors
- 1 full-time support staff member
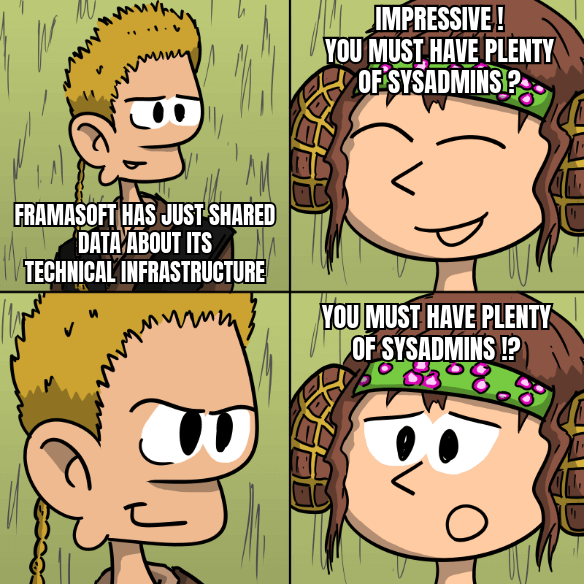
– Anakin : “Framasoft has just shared the numbers for its technical infrastructure.” (68 dedicated servers, 61 virtual machines)
– Padmé : “Impressive, you must have lots of system administrators ?”
– Anakin looks at Padmé with a smirk. (Only 1 sysadmin at Framasoft)
– Padmé, concerned : ”You must have lots of system administrators, right ? »
— Meme Framamemes.org
👥 Human resources (or rather, human wealth)
Framasoft is :
- An association of 35 members, including :
- 26 volunteers involved in public outreach, communication, project management, governance and administration
- 9 employees, covering support, development, system administration, coordination and management roles
- A broader community of contributors helping with translations, forum support, public events and outreach
- ❤️ Around 9,000 people providing financial support every year ❤️
By supporting Framasoft, you help put technology back in its rightful place : at the service of people, not profit. You contribute to an Internet where culture and knowledge can circulate freely, where tools are shared rather than monetized, and where ethical digital services remain accessible to everyone.

We estimate that we need to raise €250,000 by December 31 in order to continue and expand our actions in 2026. As of December 23, 2025, this leaves just a few days to mobilize and support us.
By running this 2025 donation campaign, we are reaching out to everyone who refuses to remain a passive spectator of surveillance capitalism and the enshittification of the Internet. By donating, you choose the side of the commons and affirm that another digital future is possible.
22.12.2025 à 09:56
Framacount : partagez l’addition sans partager vos données
Framasoft
Texte intégral (1935 mots)
Que ce soit pour un voyage entre ami⋅es, une colocation, en couple ou pour un resto, nous avons parfois besoin de noter qui a dépensé quoi à un moment donné. Si vous préférez le faire sans vous demander comment sont exploitées vos données, vous pouvez utiliser Framacount : nous ne faisons rien de vos données ;)
Voyage en Baie de Sommes
Imaginons que vous ayez une envie d’évasion en allant explorer la Picardie avec votre meilleur⋅e ami⋅e : essence, péages, gratin de chicons, musée des jeux picards, balades sur les plages à la rencontre (de loin pour ne pas les déranger) des phoques (bon, ça c’est gratuit, mais vous avez acheté des glaces en passant), etc. Les bons comptes faisant les bons amis, vous créez un groupe sur Framacount, en cliquant simplement sur le bouton Créer un groupe, pour garder traces des dépenses.
Vous devrez alors, au moins, indiquer un nom à ce groupe (pour le retrouver : « Vacances en Picardie », « Bas de l’Aisne » ou autre) et modifier / supprimer les participant⋅es.
Vous pouvez aussi ajouter des indications dans le champ Informations sur le groupe, changer la devise Euros par défaut (pas nécessaire pour la Picardie, aux dernières nouvelles), et indiquer la personne qui paie par défaut, si nécessaire (si jamais une personne se propose à avancer souvent les frais). Et voilà, vous avez un espace commun où noter qui paie quoi à qui sans prise de tête et sans l’oublier (on vous voit là, les personnes qui « oublient » bizarrement ce qu’elles doivent).
Une fois le groupe paramétré, vous pouvez donner le lien vers celui-ci pour que les participant⋅es ajoutent leurs dépenses (pas besoin d’installer une application au moindre lien qu’on vous envoie – on ne vise aucune alternative propriétaire, bien sûr). Pour ce faire :
- cliquez sur l’icône de partage
- copiez le lien à donner
Gardez bien le lien de partage : le service Framacount n’a pas de compte. Les liens pour accéder à vos groupes sur Framacount sont ainsi uniquement stockés dans votre navigateur ! Nous ne pourrons pas vous les récupérer si vous en perdez l’accès (par exemple en changeant de navigateur ou en supprimant les données de navigation). La personne qui perd ce lien paie sa tournée de tartes aux maroilles !
Vous pouvez désormais commencer à déguster un bon gratin d’endives et l’ajouter aux dépenses !
En vous identifiant avec le lien de partage du groupe vous pourrez voir tous les paiements dans l’onglet Dépenses avec, en évidence, celles que vous avez faites et celles que vous devez rembourser :
Quand vient le moment de faire les comptes, l’onglet Équilibres vous montre qui doit combien à qui. Plus besoin de sortir une calculette ! Framacount propose une répartition claire :
Pour rembourser, cliquez sur Marquer comme payé : cela ouvrira la dépense en cochant la case c’est un remboursement. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton Créer pour valider ce remboursement.
Gérez vos dépenses sans concéder vos données
Les données et métadonnées associées à vos dépenses peuvent être des données très sensibles (révélant vos habitudes quotidiennes, vos goûts, vos voyages, vos déplacements…), mais contrairement à des alternatives propriétaires comme Tricount, nous n’en faisons rien. Nous n’avons pas moult pisteurs pour identifier vos habitudes et les transformer en publicités ciblées, vous réduisant à de simples marchandises.
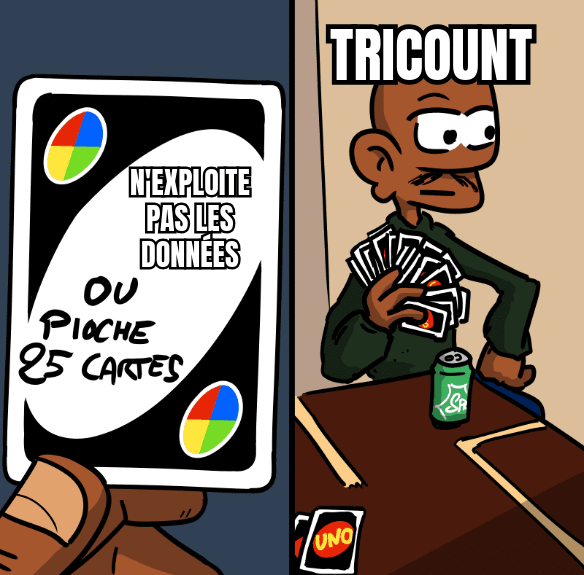
Tricount et l’exploitation des données. Généré grâce à Framamèmes.
À l’inverse de Tricount, et de sa politique de « confidentialité » (😅) qui permet d’« Identifier les utilisateurs et les services auxquels ils ont souscrit afin d’identifier les opportunités de vente et de marketing » (c’est-à-dire exploiter ces données), nous sommes une association qui allons à contre-courant d’une vision capitaliste où les données personnelles sont source d’enrichissement de multinationales. Et nous ne sommes évidemment pas possédés par une banque (mais qu’est-ce qu’une banque pourrait bien avoir envie de faire d’une application qui permet de gérer des dépenses… ? ! 🤔 ).
Un nouveau service libre dans un écosystème à soutenir
Si vous n’avez pas tout dépensé dans votre séjour et que vous estimez que, quand même, Framacount vous a bien servi et vous a libéré de prises de têtes comptables, n’hésitez pas à nous faire un don avant le 31 décembre (date de fin de notre campagne). Si vous êtes imposable sur le revenu en France, grâce à la déduction d’impôts de 66 %, votre don de 80 € vous coûtera 27 €.
Nous savons bien qu’en fin d’année vous êtes sollicité⋅es de toutes parts par les associations et nous vous remercions d’avance de considérer nous donner ! À la sortie de cet article, nous en sommes à 205 514 € collectés sur un total de 250 000 !
Les illustrations (hormis le Framamème) ont été conçues par David Revoy et sont sous licence CC-BY 4.0.
22.12.2025 à 07:42
Khrys’presso du lundi 22 décembre 2025
Khrys
Texte intégral (10676 mots)
Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.
Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)
Brave New World
- Après la dissuasion : le nouvel âge nucléaire (legrandcontinent.eu)
Les arsenaux nucléaires augmentent en volume et en performances — les doctrines flottent. La dissuasion nucléaire, qui a fait l’histoire des soixante-quinze dernières années, ne semble plus savoir l’histoire qu’elle fait.
- Report : Over 33 % of All Food Produced Globally is Wasted (medium.com/@hrnews1)
- National cabinet agrees to sweeping overhaul of Australia’s gun laws in response to Bondi massacre (theconversation.com)
- Australia’s Social Media Ban Was Pushed By Ad Agency Focused On Gambling Ads It Didn’t Want Banned (techdirt.com)
We’ve talked about the Australian social media ban that went into effect last week, how dumb it is, and why it’s already a mess.But late last week, some additional news broke that makes the whole thing even more grotesque : turns out the campaign pushing hardest for the ban was run by an ad agency that makes gambling ads. The same gambling ads that were facing their own potential ban—until the Australian government decided that, hey, with all the kids kicked off social media, gambling ads can stay.
- Inaction climatique : 450 Japonais·es attaquent leur gouvernement en justice (reporterre.net)
- Man who filmed Uyghur concentration camps now fights for his own freedom in the United States (hrichina.substack.com)
“If he gets sent back, he’s really dead”
- Les talibans font leur show (guitinews.fr)
Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans multiplient les exécutions de condamné·es en public. Ces mises en scène macabres s’inscrivent dans une stratégie de légitimation de leur interprétation radicale de la charia. Malgré les condamnations internationales, le régime persiste, transformant la justice en spectacle et la violence en outil de contrôle.
- La technosphère de Poutine : le projet de hub technologique eurasiatique du Kremlin avec les BRICS (legrandcontinent.eu)
- Les Kovaltchouk, gardiens du corps – et du portefeuille – de Poutine (revue21.fr)
Médias, banque, nucléaire, recherche sur le gène et l’immortalité, conseil en stratégie… Les deux frères Kovaltchouk, Mikhaïl et Iouri, intimes du président russe depuis les années 1990, sont de tous les coups, combats et rêves de l’autocrate. Ce qui ne les empêche pas de penser activement à l’avenir.
- Russia open to Ukraine joining EU after peace deal, US officials say (independent.co.uk)
- Zelenskyy : US considers giving Ukraine security guarantees corresponding to NATO Article 5 (politico.eu)
- Guerre en Ukraine : les négociations sur le projet de Donald Trump se poursuivent en Floride (humanite.fr)
- Military transports to take priority, delaying Dutch trains for hours from late 2026 (nltimes.nl)
The Dutch cabinet has decided that urgent military trains will be given priority over passenger and freight services from late 2026, a shift that could halt regular rail traffic for hours at a time, as the government also warns that the country’s rail network remains ill-prepared for large-scale military transport
- Le Syndicat des Semences : la bataille pour contrôler ce que les agriculteurices kenyan·es peuvent planter (portail.basta.media)
- Au Maroc, au moins 37 morts et une quinzaine de blessés dans les pires inondations de la décennie (franceinfo.fr)
La ville de Safi, sur la côte atlantique du Maroc, a été touchée, dimanche, par de très violentes crues et inondations. Des intempéries que les experts jugent liés au réchauffement climatique.
- En Espagne, ce nouvel abonnement de transport va rendre jaloux les Français·es (huffingtonpost.fr)
« Tous les citoyens pourront acheter un abonnement leur permettant de voyager dans tout le pays et d’utiliser l’ensemble des trains de moyenne distance, des trains de banlieue et des bus nationaux pour un tarif unique de 60 euros par mois pour les adultes » […] Cette offre tombera à « 30 euros pour les jeunes de moins de 26 ans »
- Des autorisations éternelles pour les pesticides : la Commission européenne persiste et signe (reporterre.net)
- L’Union européenne renonce à interdire la vente de véhicules thermiques en 2035 (reporterre.net)
Deuxième grand recul coup sur coup dans la même journée. Après que le Parlement européen a voté un texte qui détricote le devoir de vigilance des entreprises, quelques heures plus tard, mardi 16 décembre, la Commission européenne a décidé de revenir sur l’interdiction de la vente de voitures neuves essence et diesel à partir de 2035.
- La loi « Omnibus » ou le brutal démantèlement de normes environnementales et sociales en Europe (amnesty.fr)
- L’accord UE-Mercosur reporté en janvier (humanite.fr)
Tandis que les paysan·nes manifestaient en France et à Bruxelles le 18 décembre, la présidente de la Commission européenne a annoncé dans la soirée le report en janvier 2026 de la signature finale de l’accord de libre-échange entre l’Europe des 27 et les quatre pays du Mercosur.
- Devoir de vigilance : le cadeau de Noël de l’Europe aux multinationales (reporterre.net)
- 29 European Countries Will Now Require Biometric Data For Entry (travelnoire.com)
- Creating apps like Signal or WhatsApp could be ‘hostile activity,’ claims UK watchdog (techradar.com)
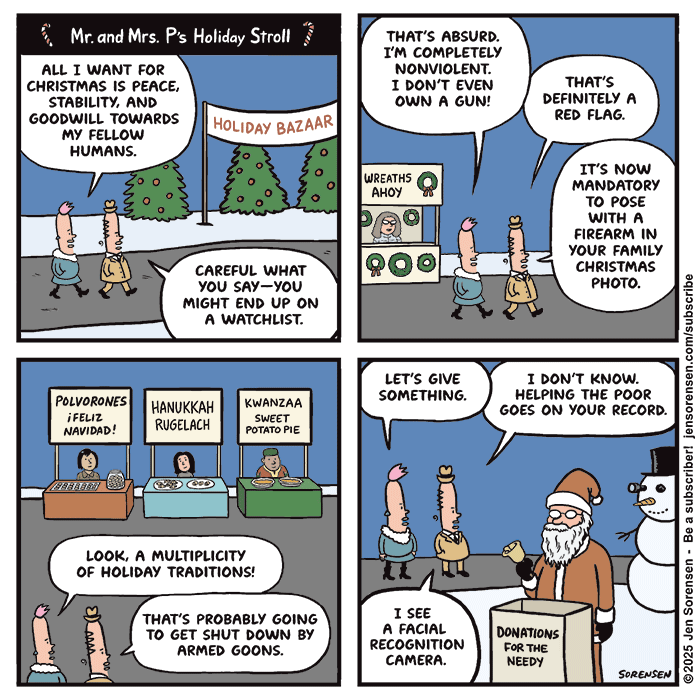
- Un explosif rapport allemand affirme que stocker ses données en Europe ne suffit plus à les protéger des USA (clubic.com)
Un avis juridique commandé par Berlin révèle l’étendue du contrôle américain sur les données cloud européennes. Même stockées dans des datacenters en Europe, vos informations restent accessibles aux autorités US.
Voir aussi C’est officiel : stocker vos données en Europe ne sert à rien face aux USA (mac4ever.com)
Une expertise juridique commandée par le ministère allemand de l’Intérieur confirme ce que beaucoup redoutaient : les autorités américaines peuvent accéder aux données stockées sur des serveurs européens. La localisation physique des données ne protège en rien contre la surveillance américaine.
- Les États-Unis menacent l’UE de représailles si elle maintient sa régulation numérique (france24.com)
L’administration Trump fustige une régulation européenne sur les services numériques “discriminatoire”, qui a valu d’importantes amendes aux géants américains du secteur. Si l’UE maintient sa législation, “les États-Unis n’auront d’autre choix que d’utiliser tous les outils à disposition pour contrer ces mesures déraisonnables”, menace la Maison Blanche.
- Hackers access Pornhub’s premium users’ viewing habits and search history (theguardian.com)
ShinyHunters group reportedly behind the hack affecting data of 200m users thought to be from before 2021
- Is Your Vibrator Spying on You ? (wired.com)
You download a new app, eager to get past the sign-in page and all the pop-ups asking you if you’re super sure you don’t want to pay for the premium version. When you’re almost there, the app asks you to agree to a lengthy privacy policy […] you hastily check yes and move on.This scenario is becoming an increasingly common problem as more gadgets require companion apps to control them. And sex toys are no exception.
Voir aussi Faites attention à votre sextoy, il y a des chances pour qu’il vous espionne (slate.fr)
- TikTok owner signs deal to avoid US ban (bbc.com)
- Depuis le retour au pouvoir de Trump, 900 millions de dollars ont été engagés pour des contrats publics attribués à Palantir (legrandcontinent.eu)
- Aux États-Unis, le gouvernement Trump est « le plus riche de l’histoire moderne » avec 12 milliardaires (huffingtonpost.fr)
Dans les ministères, les administrations ou les ambassades, Donald Trump a placé de nombreux ultrariches dans son administration.
- La Maison Blanche s’attaque encore aux personnes trans (huffingtonpost.fr)
Le ministre de la Santé de Donald Trump a pris des mesures visant à interdire de facto l’accès aux traitements de transition de genre aux jeunes Américain·es.
- Raz-de-marée démocrate dans les villes américaines : un avertissement pour Trump ? (theconversation.com)
En Floride, l’État de résidence de Trump, l’élection de la démocrate Eileen Higgins à la mairie de Miami, première femme à obtenir ce poste, est particulière : elle met fin à 28 ans de règne républicain. […]La Gringa […] a mis l’accent sur le logement abordable tout en exprimant ses préoccupations concernant les opérations de contrôle de l’immigration par l’ICE
- Aux États-Unis, un professeur spécialiste de la fusion nucléaire au MIT tué par balle à son domicile (lefigaro.fr)
Selon l’université, ses recherches portaient sur la meilleure façon d’« exploiter l’énergie des plasmas en fusion pour réaliser le rêve d’une énergie propre et presque illimitée ».
- Debunking the NRA’s 9 Favorite Gun Myths (lets-address-this-with-qasim-rashid.ghost.io)
We live in an America in which gun violence since 1968 has killed more Americans than all Americans killed in all wars in American history — combined. It does not have to be this way.
- Starlink and Chinese satellites narrowly miss each other (ndependent.co.uk)
SpaceX’s Starlink satellites narrowly avoided a collision with recently launched satellites from Chinese firm CAS Space, coming within 200 metres of each other.
- Pour la première fois, une personne en fauteuil roulant s’est envolée dans l’espace (huffingtonpost.fr)
Ce samedi 20 décembre, Michaela Benthaus, ingénieure aérospatiale allemande devenue paraplégique à la suite d’un accident, s’est envolée quelques minutes dans l’espace à bord d’une fusée de Blue Origin, la société spatiale du multimilliardaire américain Jeff Bezos.
- Trump a annoncé mardi 16 décembre un « blocus total » contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. (huffingtonpost.fr) – voir aussi ‘They took all of our oil not that long ago. And we want it back’ : Trump demands Venezuela return seized assets (fortune.com)
- Nobel de la paix attribué à l’opposante vénézuélienne : Julian Assange porte plainte contre la fondation Nobel (rfi.fr)
Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a porté plainte contre la fondation Nobel après la décision d’octroyer le prix Nobel de la paix à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Julian Assange accuse trente responsables liés à la fondation Nobel d’avoir transformé « un instrument de paix en instrument de guerre ». La police suédoise a annoncé vendredi 19 décembre qu’elle n’ouvrirait pas d’enquête à la suite de cette plainte.
- Le nouveau président du Chili, un désastre annoncé pour l’écologie (reporterre.net)
Le candidat d’extrême droite José Antonio Kast a été élu président du Chili dimanche 14 décembre. Fils de nazi et admirateur de Pinochet, il promet de faciliter les projets miniers et de s’attaquer aux réglementations environnementales.
Spécial IA
- iRobot dépose le bilan : le fabricant de Roomba est racheté par son sous-traitant chinois (journaldugeek.com)
- Bursting AI bubble may be EU’s “secret weapon” in clash with Trump, expert says (arstechnica.com)
- Un quart des Français·es visitent les sites d’infos générées par IA recommandés par Google (next.ink)
- Faux coup d’État en France : qui est ce Burkinabè à l’origine de la vidéo virale générée avec l’IA (huffingtonpost.fr)
Emmanuel Macron avait saisi en vain les géants de la tech pour faire supprimer ces vidéos relayant de fausses informations. Mais c’est l’auteur de la vidéo qui s’en est finalement chargé.[…] il postait tout et n’importe quoi sur ses réseaux sociaux afin de « percer ».
- AI Is Inventing Academic Papers That Don’t Exist — And They’re Being Cited in Real Journals (rollingstone.com)
The proliferation of references to fake articles threatens to undermine the legitimacy of institutional research across the board
- Publisher under fire after ‘fake’ citations found in AI ethics guide (archive.ph)
A book published by Springer Nature includes dozens of questionable citations, including references to journals that do not exist
- 8 Million Users’ AI Conversations Sold for Profit by “Privacy” Extensions (koi.ai)
- LG forced a Copilot web app onto its TVs but will let you delete it (theverge.com)
The TV-maker will ‘take steps to allow users to delete the shortcut icon if they wish.’
- Microsoft made another Copilot ad where nothing actually works (theverge.com)
the whole ad campaign is selling a fantasy. Believing that Copilot can do what Microsoft says it can — or that any of these AI assistants can — is like believing in Santa Claus.
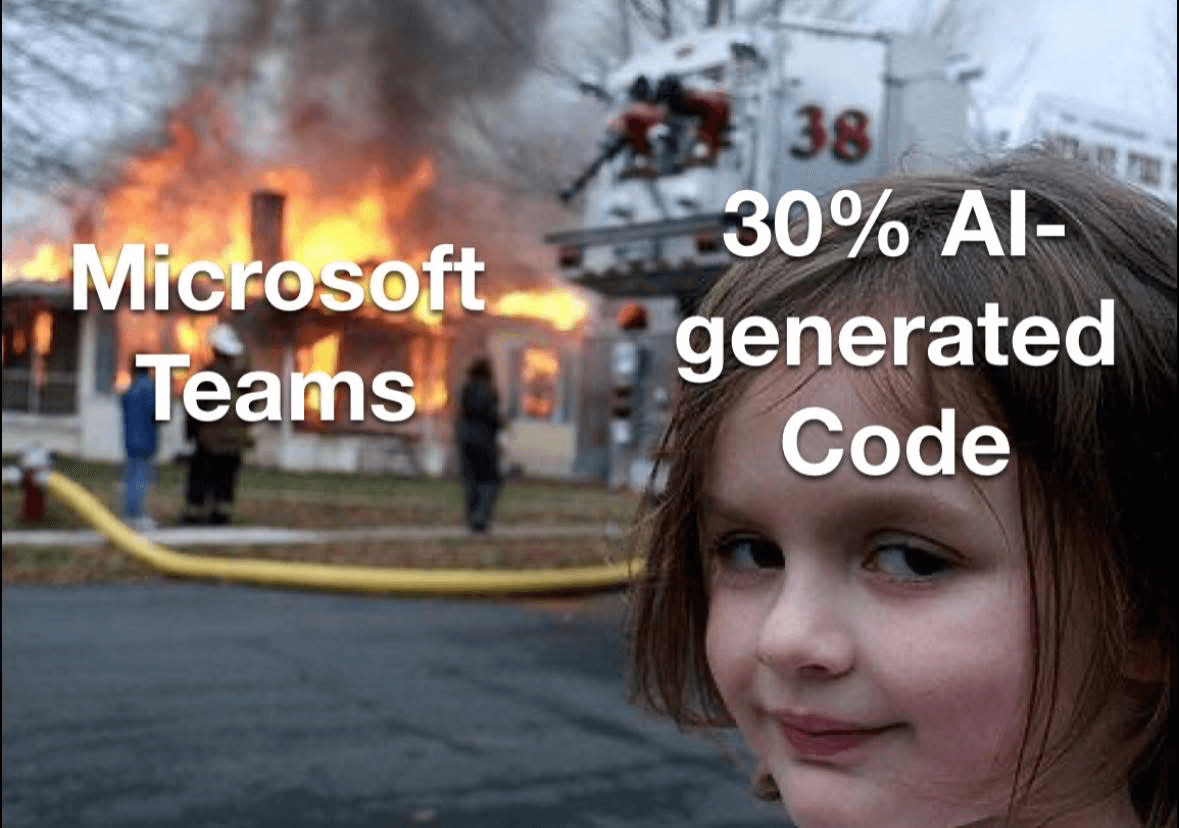
- Microsoft Scales Back AI Goals Because Almost Nobody Is Using Copilot (tech.yahoo.com)
- Anthropic’s AI Lost Hundreds of Dollars Running a Vending Machine After Being Talked Into Giving Everything Away (slashdot.org)
Anthropic let its Claude AI run a vending machine in the Wall Street Journal newsroom for three weeks as part of an internal stress test called Project Vend, and the experiment ended in financial ruin after journalists systematically manipulated the bot into giving away its entire inventory for free.
- UK actors vote to refuse to be digitally scanned in pushback against AI (theguardian.com)
Equity says vote signals strong opposition to AI use and readiness to disrupt productions unless protections are secured
- Adobe hit with proposed class-action, accused of misusing authors’ work in AI training (techcrunch.com)
Like pretty much every other tech company in existence, Adobe has leaned heavily into AI over the past several years. The software firm has launched a number of different AI services since 2023, including Firefly — its AI-powered media-generation suite. Now, however, the company’s full-throated embrace of the technology may have led to trouble, as a new lawsuit claims it used pirated books to train one of its AI models.
- Google AI summaries are ruining the livelihoods of recipe writers : ‘It’s an extinction event’ (theguardian.com)
AI Mode is mangling recipes by merging instructions from multiple creators – and causing them huge dips in ad traffic
- Les éditions Harlequin testent la traduction avec l’IA (radio-canada.ca)
Les éditions Harlequin, célèbres pour leurs romans sentimentaux, ont mis fin ces dernières semaines à leur collaboration en France avec des traducteurices. Ils souhaitent les remplacer par une agence utilisant l’intelligence artificielle […] L’éditeur, qui appartient au groupe américain HarperCollins, assure qu’il s’agit de « tests » à ce stade.
Voir aussi France : Harlequin switches to AI (ceatl.eu)
A number of French translators have been working for Harlequin for years, often exclusively. This decision places them in an extremely precarious position, without proper notice or compensation.
- They graduated from Stanford. Due to AI, they can’t find a job (latimes.com)
- AI coding is now everywhere. But not everyone is convinced. (technologyreview.com)
a July study by the nonprofit research organization Model Evaluation & Threat Research (METR) showed that while experienced developers believed AI made them 20 % faster, objective tests showed they were actually 19 % slower.For Mike Judge, principal developer at the software consultancy Substantial, the METR study struck a nerve. For six weeks, he guessed how long a task would take, flipped a coin to decide whether to use AI or code manually, and timed himself. To his surprise, AI slowed him down by an median of 21 %—mirroring the METR results […] “You remember the jackpots. You don’t remember sitting there plugging tokens into the slot machine for two hours” […] For the foreseeable future, humans will still need to understand and maintain the code that underpins their projects. And one of the most pernicious side effects of AI tools may be a shrinking pool of people capable of doing so.
- Writing Code Is Fun (davidcel.is)
I became a software engineer because writing code is fun. Thinking through hard problems, designing elegant solutions, seeing the things you’ve built working for the first time… these moments are all deeply satisfying, so why in the world would I ever surrender them to AI ?
- AI’s Unpaid Debt : How LLM Scrapers Destroy the Social Contract of Open Source (quippd.com)
The big tech AI company LLMs have gobbled up all of our data, but the damage they have done to open source and free culture communities are particularly insidious. By taking advantage of those who share freely, they destroy the bargain that made free software spread like wildfire.
- GNOME bans AI-generated extensions (theverge.com)
A glut of extensions from programmers who don’t understand their AI-written code has delayed reviews.
- Firefox veut devenir un navigateur IA : les utilisateurs sont furieux (commentcamarche.net)
Mozilla accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans Firefox. Une stratégie présentée comme inévitable, mais qui déclenche une fronde rare chez des utilisateurices historiquement attaché·es à l’indépendance du navigateur.
Voir aussi Mozilla’s New CEO Bets Firefox’s Future on AI (tech.slashdot.org) et Mozilla’s new CEO is doubling down on an AI future for Firefox (theverge.com)
Anthony Enzor-DeMeo says he thinks there’s room for another browser, even an AI browser — as long as you can trust it.
- Après Tor, Mozilla se met un autre fork de Firefox à dos (clubic.com)
Le nouveau PDG de Mozilla Anthony Enzor-DeMeo a été clair : il veut faire de Firefox un navigateur centré sur l’intelligence artificielle. Une annonce qui provoque la réaction ferme d’Alex Kontos, le créateur de Waterfox, lequel refuse catégoriquement cette direction pour son fork de Firefox.
- AI Controversy Forces End of Mozilla’s Japanese SUMO Community (linuxiac.com)
The SUMO Japanese team quits en masse, accusing Mozilla’s AI system of erasing years of community translation work.

- Firefox Will Ship with an “AI Kill Switch” to Completely Disable all AI Features (9to5linux.com)
Mozilla said that all the AI features that are or will be included in Firefox will also be opt-in.
- L’IA qu’on nous enfonce dans la gorge (blogs.mediapart.fr)
la formation que j’ai suivie insiste sur le fait qu’on ne peut pas se fier aux productions des IA génératives ; c’est à moi de contrôler que les références bibliographiques produites sont correctes. Vérifier des références bibliographiques est une tâche ingrate, répétitive, et qu’on devrait pouvoir automatiser, vu que les articles scientifiques sont indexés dans des bases de données publiques. Autrement dit, on a automatisé (assez approximativement) la tâche qui est intellectuellement intéressante (comprendre les recherches d’une autre personne suffisamment pour les présenter superficiellement) mais on n’a pas automatisé la tâche ingrate, répétitive et sans réflexion. C’est le monde à l’envers.
- Karen Hao : « Les empires de l’IA étouffent l’innovation » (next.ink)
- L’empathie artificielle : du miracle technologique au mirage relationnel (theconversation.com)
Une étude du MIT Media Lab sur 981 participant·es et plus de 300 000 messages échangés souligne un paradoxe : les utilisateurices quotidien·nes de chatbots présentent, au bout de quatre semaines, une augmentation moyenne de 12 % du sentiment de solitude et une baisse de 8 % des interactions sociales réelles.
- I’m Kenyan. I Don’t Write Like ChatGPT. ChatGPT Writes Like Me. (marcusolang.substack.com)
Or, more accurately, it writes like the millions of us who were pushed through a very particular educational and societal pipeline, a pipeline deliberately designed to sandpaper away ambiguity, and forge our thoughts into a very specific, very formal, and very impressive shape.[…]The very things you identify as the fingerprints of the machine are, in fact, the fossil records of our education. The machine, in its quest to sound authoritative, ended up sounding like a KCPE graduate who scored an ‘A’ in English Composition. It accidentally replicated the linguistic ghost of the British Empire.
- Racks of AI chips are too damn heavy (theverge.com)
Old data centers physically cannot support rows and rows of GPUs, which is one reason for the massive AI data center buildout.Legacy data centers cannot bear the weight of the latest AI technology. The racks that house computer chips or AI chips are simply too damn heavy for the floors, and they would crack under the weight.the projected milestone weight of an AI rack is 5,000 pounds.
- Governments welcomed data centers. Now they’re grappling with the fallout (restofworld.org)
The boom in AI data centers is colliding with weak power grids, soaring energy demand, and growing local pushback.
- We mapped the world’s hottest data centers (restofworld.org)
In 21 countries, all data centers are located in climates that are too hot.
- Le charbon pour nourrir l’IA : nouvelle lubie de Trump en territoire navajo (journal-labreche.fr)
Pour alimenter les besoins énergétiques de l’IA, Donald Trump vient de signer un décret pour relancer « la belle énergie du charbon propre de l’Amérique » en terre autochtone, avec le soutien du président de la nation Navajo, Buu Nygren. Un texte qui fait rejaillir de vieux démons entre réalité économique et saccage écologique d’un territoire qui n’oublie pas de résister.
- AI’s water and electricity use soars in 2025 (theverge.com)
A new study estimates the environmental impact of AI in 2025 and calls for more transparency from companies on their pollution and water consumption.
Spécial Palestine et Israël
- Sud-Liban. La guerre israélienne contre l’environnement (orientxxi.info)
Outre les pertes humaines et matérielles, les bombardements israéliens incessants sur le sud du Liban provoquent un désastre écologique qui aggrave la pénurie d’eau et l’insécurité alimentaire des populations locales.
Spécial femmes dans le monde
- Roots of Resilience : The Women Preserving Asia’s Ancient Mangrove Forest (reasonstobecheerful.world)
- Accords de paix sur la RD Congo : où sont passées les femmes congolaises ? (theconversation.com)
- Droit à l’avortement en Tunisie, Selma Hajri : « Les régressions sont très importantes » (medfeminiswiya.net)
La Tunisie reste une exception sur la rive sud de la Méditerranée : le droit à l’avortement y est légal et encadré depuis 1973. Pourtant, le parcours des Tunisiennes pour interrompre une grossesse non désirée est loin d’être un long fleuve tranquille.
- L’avortement, un droit fondamental : une double reconnaissance historique (lesnouvellesnews.fr)
La France et l’Europe ont, à quelques heures d’intervalle, posé deux actes politiques forts en faveur du droit à l’avortement. D’un côté, une loi française réhabilitant les femmes condamnées avant la loi de 1975. De l’autre, une résolution européenne visant à garantir l’accès à l’IVG à toutes les Européennes, dans le sillage de l’initiative citoyenne « Ma voix, mon choix ».
- Santé reproductive des femmes et applis : quand l’intime devient une donnée à exploiter (theconversation.com)
- Le télétravail freinerait davantage la carrière des femmes que celle des hommes (slate.fr)
- Household labor inequality is a political issue, not a personal one (zawn.substack.com)
Household inequality is not trivial, not an accident, and not a communication problem. It’s foundational to women’s oppression
- Dossier Epstein : la publication tant attendue de milliers de documents très critiquée (huffingtonpost.fr)
de larges passages sont dissimulés, dont une liste de 254 « masseuses » aux noms caviardés « pour protéger la victime » ou les 119 pages d’un document judiciaire émanant d’un tribunal de New York, biffées sans explication.

Spécial France
- Crimes contre l’humanité en RD Congo : l’ex-chef rebelle Roger Lumbala condamné à Paris (france24.com)
Roger Lumbala, ancien chef rebelle congolais, a été condamné, lundi, par la cour d’assises de Paris à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité des crimes contre l’humanité commis par ses soldats en 2002-2003 en RD Congo. L’accusé, qui a dix jours pour faire appel, a refusé d’assister à son procès.
- Adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026 : quelle est la suite ? (projetarcadie.com)
- Rachat de Warner Bros : en coulisse, une banque française joue très gros pour Netflix (presse-citron.net)
À Wall Street, HSBC, Wells Fargo et la banque française BNP Paribas ont déverrouillé une somme monstre de 59 milliards de dollars pour supporter l’offre de Netflix, annoncée quelques heures après le début des négociations.
- La 2G vit ses derniers mois, mais 2,66 millions de terminaux l’utilisent encore (next.ink)
- Piratage chez SFR : encore un accès non autorisé ! (zataz.com)
- Les piratages de données personnelles se multiplient dans l’indifférence politique générale. (projetarcadie.com)
- Train : le prix d’un billet Ouigo a augmenté de 73 % depuis 2017 (reporterre.net)
l’offre globale a en parallèle décru de 1,6 %. […] l’augmentation des Ouigo ne compense pas la diminution globale de 17,5 % de l’offre TGV Inoui.Un bilan d’autant plus déconcertant que, dans le même temps, le nombre de passagers de la grande vitesse en France sur les trains Inoui et Ouigo a augmenté de 13 % entre 2017 et 2023.
- « C’est du jamais vu » : Le tribunal de commerce de Nantes franchit le seuil des 1 000 entreprises à la peine (ouest-france.fr)
Une hausse de plus de 27 % d’entreprises en difficulté en 2025 par rapport à l’an passé.
- Continuité de revenus : les éditeurs volontaires pour une hausse de la “contribution diffuseur” (actualitte.com)
Depuis de longues années, les audits s’empilent pour pointer la précarisation extrême des artistes. […]Un projet de loi, la continuité de revenus des artistes-auteurs, permettrait de sortir de cette situation. Il s’inspirerait du principe de l’intermittence. Il permettrait aux artistes d’être rattachés au régime de l’assurance chômage en cas de période sans ressource.
- Multiprimée et Palme d’or, Simonetta, autrice, touchera 374 euros de retraite (basta.media)
Simonetta Greggio est autrice, a publié de nombreux livres à succès, mais a découvert que la sécurité sociale des auteurs n’avait jamais cotisé pour sa retraite. L’injustice concerne 200 000 personnes, qui se mobilisent pour leurs droits sociaux.
- « De très nombreux produits sont concernés » : de Séphora à Nocibé, les marques de cosmétiques exposent clientEs et salariéEs à des nanoparticules toxiques (humanite.fr)
De « Poussières d’étoiles » de chez Nocibé à « Poudre d’or » de chez Sephora, en passant par « Lait soin sublimant nacré » de chez Petit Marseillais, plusieurs produits cosmétiques sont accusés de contenir une substance chimique soupçonnée notamment d’avoir des effets toxiques pour l’ADN.
- « Réduire l’usage des pesticides autour des écoles doit devenir une priorité » : plus de 1,7 million d’élèves soumis à une forte « pression » de ces produits chimiques (humanite.fr)
- Le chantier de l’A69 va être partiellement suspendu (reporterre.net)
Un tournant dans le dossier de l’A69 ? Le concessionnaire Atosca était une nouvelle fois convoqué devant la justice le 19 décembre.[…] Le parquet a requis la suspension des travaux « sur tous les terrains où des infractions ont été relevées » et une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier.
- Patrimoine : des châteaux de la Loire, comme celui de Blois, sont devenus impossibles à assurer (franceinfo.fr)
- Disparition du loup de Valberg : 5 ans plus tard, on connaît enfin la clé du mystère (humanite.fr)
Après sa disparition mystérieuse en 2021, le loup de Valberg a été abattu par un tir de défense autorisé […] En 2026, l’État va inaugurer un assouplissement de sa politique de régulation de la population lupine en permettant aux éleveurs de tuer ces animaux sans son autorisation préalable, obligatoire jusqu’alors.
Spécial femmes en France
- L’Assemblée nationale engage la réhabilitation des homosexuel·les et des femmes condamnées pour IVG (humanite.fr)
- PMA, transition : les corps queers à l’épreuve des lois (politis.fr)
En France, les lois qui encadrent les droits reproductifs sont soumises, implicitement, à la logique méritocratique, reproduisant au passage des discriminations homophobes et transphobes.
- Monts du Lyonnais : comment les luttes féministes tentent de se faire une place (rue89lyon.fr)
- L’agacement de Lena Situations, cyberharcelée pour avoir recadré le streamer Anyme en interview (huffingtonpost.fr)
- Après avoir été démise de sa délégation au Département, Régine Komokoli désormais exclue de la majorité (actu.fr)
La majorité départementale estime, notamment, que l’élue s’est « désolidarisée » de l’exécutif. Régine Komokoli fustige la méthode, qu’elle juge méprisante.
Voir aussi De sans-papiers à élue départementale, l’ascension d’une Rennaise œuvrant pour les droits des femmes (france3-regions.franceinfo.fr – article de mars 2025)
- Des demandeuses d’asile enceintes à la rue, l’État hors-la-loi (rembobine.info)
Dans la région lyonnaise, l’État français laisse des femmes en demande d’asile, parfois enceintes ou avec des bébés, dormir à la rue. Une pratique qui contrevient à ses obligations légales d’héberger les demandeurs d’asile les plus vulnérables.
- Le déni des inégalités salariales femmes/hommes en direct (frustrationmagazine.fr)
Le 12 novembre dernier, dans la matinale d’Europe 1, un chroniqueur, Samuel Fitoussi – si jeune, et déjà si rance – expliquait à une heure de grande écoute le prétendu « mythe » des inégalités salariales. Une chronique ahurissante, saturée de fausses informations, d’interprétations erronées et de raccourcis presque risibles. Tout cela sous le regard complaisant et approbateur du journaliste Dimitri Pavlenko.
- « Il vaut mieux même pas d’excuse » : Brigitte Macron ravive la polémique #salesconnes (huffingtonpost.fr)
Il y a excuse et excuse et parfois, mieux vaut garder le silence. C’est l’avis de beaucoup ce mardi 16 décembre au lendemain de la réaction de Brigitte Macron

- Violences conjugales : 42 % des plaintes sont classées sans suite par la justice, révèle une étude statistique inédite (franceinfo.fr)
RIP
- Michèle Audin, pour mémoire (contretemps.eu)
Mathématicienne, écrivaine, passionnée de la Commune de Paris, avec une capacité unique à tisser ensemble ces trois fils dans ses nombreux ouvrages historiques et littéraires
Spécial médias et pouvoir
- Bardella, Sarkozy… Comment Fayard, propriété de Bolloré, inonde certaines librairies et fausse le marché du livre (20minutes.fr)
- La convergence médiatique des droites (acrimed.org)
- « À travers les journalistes, les procédures-bâillons visent aussi les citoyens et leur droit à l’information » (multinationales.org)
Le média Disclose attaqué en diffamation par l’entreprise Thales, trois plaintes en deux semaines contre StreetPress… Les procédures judiciaires à l’encontre des médias se multiplient.
- « Les digues sautent » : le journaliste Mathieu Molard et StreetPress ciblés par des messages haineux d’extrême droite (humanite.fr)
- Carte de presse « islamophobe » : la Défenseure des droits donne raison aux associations (stup.media)
la Défenseure des droits (DDD) a partagé l’analyse concernant les règles discriminatoires de la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels. Cette dernière demande aux journalistes portant le foulard de se découvrir sur leurs photos de carte de presse.
- Malgré « un acharnement politique », la subvention aux librairies finalement votée à Paris (basta.media)
D’abord rejetée par le Conseil de Paris en novembre, une subvention à 40 librairies indépendantes a été adoptée ce 18 décembre. Parmi elles, Violette and Co, victime de nombreuses attaques, et radiée des projets soutenus par la Région.
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- “Le Désespéré” : comment le célèbre autoportrait de Gustave Courbet a été vendu au Qatar dans la plus grande discrétion (franceinfo.fr)
- Pourquoi la France redevient une société d’héritier·es (alternatives-economiques.fr)
Les inégalités de patrimoine sont redevenues vertigineuses en France, et vont encore se creuser si une imposition plus efficace des gros héritages n’est pas rétablie. Mais il faut déjà la réhabiliter dans l’opinion.

- Budget 2026 : Bernard Arnault se prépare à sabler le champagne (france.attac.org)
La commission mixte paritaire (CMP), largement dominée par la droite, se réunit aujourd’hui pour proposer un nouveau projet de budget 2026 en partant de la copie votée par le Sénat. Ce dernier a balayé, lundi 15 décembre, les maigres avancées proposées lors du débat à l’Assemblée nationale.
- Pourquoi l’échec de la CMP sur le budget est un vrai revers pour Sébastien Lecornu (huffingtonpost.fr)
Le budget de l’État n’a pas été adopté par les députés et les sénateurs qui se réunissaient en commission mixte paritaire (CMP) ce vendredi 19 juillet. Le fiasco est tel que les échanges n’auront même pas duré une demi-heure, chacun constatant rapidement l’ampleur des désaccords.
- La réforme de l’assurance chômage a raccourci à 18 mois la durée maximale d’indemnisation : le nombre de personnes en fin de droit a depuis bondi de 77 % (bfmtv.com)
- La souveraineté numérique attendra : la DGSI renouvelle son contrat avec Palantir pour « garantir la sécurité des Français » (numerama.com)
- Le ministère de l’Intérieur piraté, un groupe revendique l’exfiltration du TAJ et du FPR (next.ink) – voir aussi Piratage du ministère de l’Intérieur : les fichiers TAJ et FPR ont bien été consultés (next.ink) et Piratage du ministère de l’Intérieur : la France sous la menace d’une fuite de données “sans précédent” (clubic.com)
le ministère de l’Intérieur se retrouve dans l’étau de cybercriminels qui promettent « l’impact le plus important jamais vu en France ». […] les hackers ne laissent à l’exécutif que 48 heures pour négocier avec eux. À défaut, ils s’estiment libres de divulguer 16 millions de données très sensibles.
- Cyberattaque contre le ministère de l’intérieur : Laurent Nuñez annonce que « des fichiers importants, dont le traitement des antécédents judiciaires », ont été consultés ; deux enquêtes ouvertes (lemonde.fr)
- Fuite de données CAF : Pass’Sport identifié, 3,5 millions de foyers exposés (lesnumeriques.com)
Le fichier couvre 4 ans et exposerait 3,5 millions de foyers uniques.
- “Ce serait le tracé de route le plus cher de France” : un projet autoroutier en Haute-Vienne à 132 millions d’euros pour 6,5 km fait polémique (franceinfo.fr)
- Outremers : Laboratoire d’un ultralibéralisme dévastateur (lundi.am)
- Pourquoi le colonialisme est toujours au coeur de l’État français (frustrationmagazine.fr)
- Rétractation de Ziad Takieddine : le PNF requiert un procès contre Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy et Mimi Marchand (lemonde.fr)
Le parquet requiert le renvoi de l’ancien chef de l’Etat pour « association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée » et « recel de subornation de témoin ».
- Nicolas Sarkozy en voyage privé en Guadeloupe pour une semaine… sous contrôle judiciaire (la1ere.franceinfo.fr)
- Rachida Dati « a toute sa place au gouvernement » : perquisitions et enquête pour « corruption » dans l’affaire GDF-Suez visant la ministre, l’exécutif ne voit pas le problème (humanite.fr)

Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Les député·es votent la prolongation de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique jusqu’à la fin de 2027 (lemonde.fr) – voir aussi Au prétexte des Jeux olympiques 2030, l’Assemblée prolonge la surveillance algorithmique au moins jusqu’en 2027 (humanite.fr)
Vidéosurveillance algorithmique, interdiction de paraître… L’Assemblée nationale a adopté mercredi le volet sécuritaire du projet de loi sur l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Au grand dam de députés de gauche qui ont dénoncé des mesures liberticides.
- Procès du « train bloqué » : 12 activistes face à des poids lourds de l’agro-industrie (basta.media)
En 2022, des militants stoppaient un train de blé pour dénoncer les dérives de l’agro-industrie. 12 personnes sont jugées ce 15 décembre. Un des inculpés revient sur l’action et ce qui a suivi : perquisition, contrôle judiciaire, mise sur écoute.
- 46 heures de garde à vue et 30 gendarmes pour un tag écolo (basta.media)
Huit activistes comparaissent lundi 22 décembre à Saverne, en Alsace. Accusés d’avoir peint le message « Stocamine contamine » sur un pont, ils ont passé deux jours en cellules et risquent jusqu’à sept ans d’emprisonnement, pour un tag.
- Moben, transféré dans un quartier de haute sécurité pour avoir écrit un livre de recettes en prison (streetpress.com)
- Mila, militante d’extrême droite, a été condamnée à 2 000 euros d’amende avec sursis pour un tweet raciste (lemonde.fr)
- À propos de Anti-Tech Résistance : mi-fafs mi-réacs ? (offensive.eco)
- Ultras, militaires et bastonneurs… qui se cache derrière « Talion Brest », une bande d’extrême droite violente (splann.org)
- Deux policiers condamnés à trois ans de prison avec sursis pour avoir percuté un motard sur l’autoroute (franceinfo.fr)
Le tribunal a prononcé une peine supérieure aux réquisitions, écartant les arguments des agents qui avaient plaidé “une faute de conduite” involontaire.
- « Il m’a confondu avec un sanglier » : dans la Drôme, un joggeur grièvement blessé par un tir de chasseur (vert.eco)
Le 23 novembre dernier, alors qu’il courait entre deux villages de la Drôme, Simon Eichenberger, 25 ans, a été blessé par un tir de chevrotine. Immobilisé plusieurs mois et marqué à vie, le jeune homme espère aujourd’hui provoquer une prise de conscience sur la sécurité à la chasse. […] « On n’est pas dans un pays en guerre, on ne devrait pas risquer de se prendre une balle en sortant de chez soi »
Spécial résistances
- Défendons les libertés académiques contre un maccarthysme à la française (contretemps.eu)
Les enseignant·es et chercheur·euses qui résistent au cours autoritaire, militariste et raciste du monde, doivent aujourd’hui faire face à une vague de censure, de menaces et de procédures juridiques qui visent à les apeurer et à les faire taire. Ces remises en cause des libertés académiques, parfois orchestrées depuis le sommet de l’État, doivent être comprises dans la séquence de fascisation des élites et de l’État, de radicalisation islamophobe de l’Occident impérialiste, de répression de la solidarité avec le peuple palestinien contre la guerre génocidaire, et d’alliance entre les néolibéraux et les néofascistes.
- Vers une nouvelle explosion de colère chez les agriculteurs-trices ? (lepoing.net)
Alors que les actions d’agriculteurs-trices se multiplient contre les abattages liés à la dermatose nodulaire, une colère plus large semble ressurgir. À la croisée d’une crise sanitaire, d’un modèle agricole fragilisé et des négociations commerciales avec le Mercosur, le monde agricole pourrait-il replonger dans une mobilisation d’ampleur ?
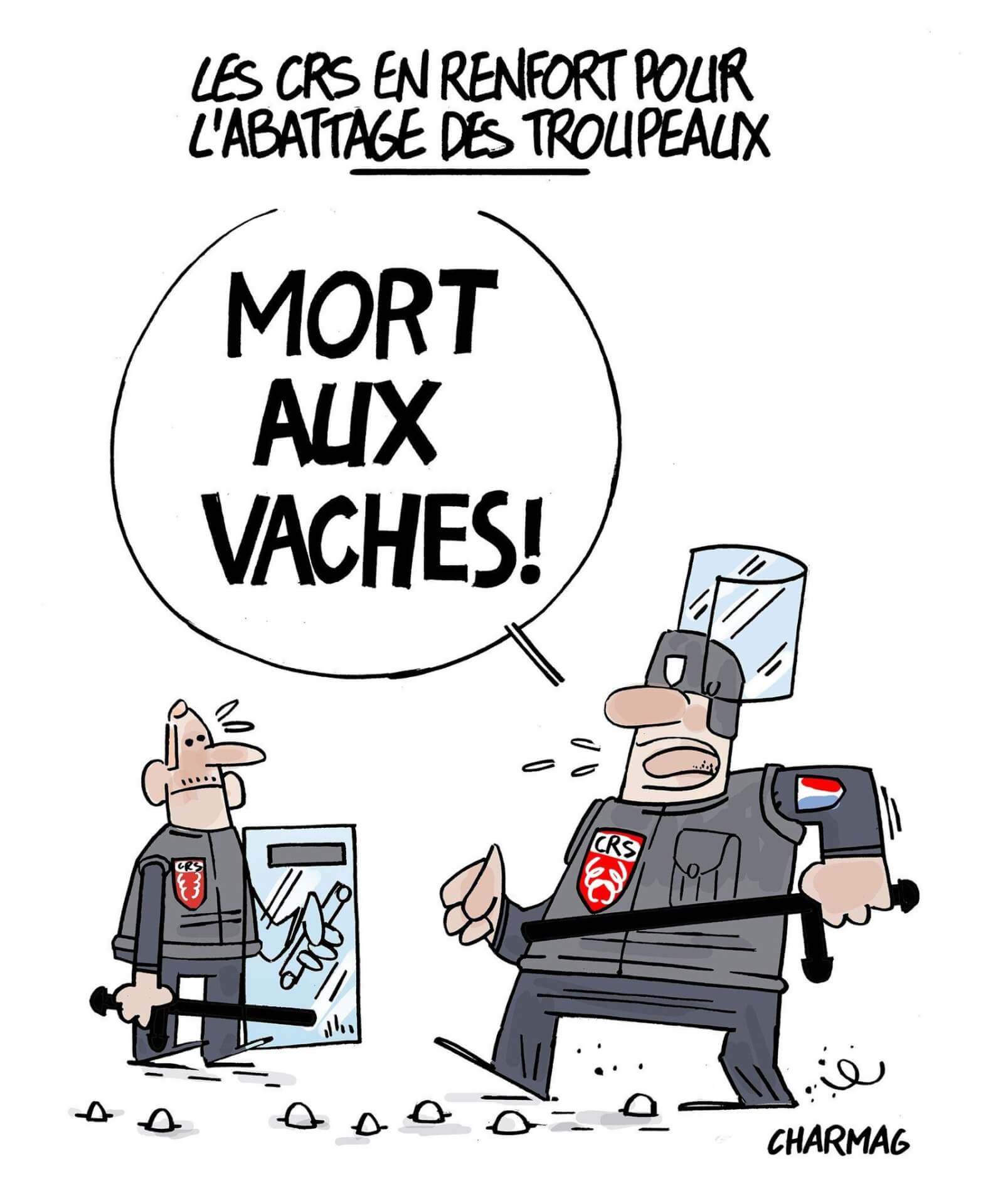
- Dermatose nodulaire : comprendre la crise agricole en dix points (basta.media)
- Une Europe des agriculteurs-trices en révolte contre le libre-échange, non sans ambiguïtés (lepoing.net)
Spécial outils de résistance
- Strategies for Resisting Tech-Enabled Violence Facing Transgender People (eff.org)
- Le guide de conversation pour survivre aux fêtes de fin d’année (solidaires.org)
Spécial GAFAM et cie
- Tout le Web dépend de l’hébergeur AWS ? (24joursdeweb.fr)
- X et l’illusion du combat en terrain hostile (derriere-le-vacarme.com)
Les autres lectures de la semaine
- Monster of 2025 : Endless Subscriptions (motherjones.com)
Welcome to the age of subscription captivity, where an increasing share of the things you pay for actually own you.[…] What vexes me are the companies that sell physical products for a hefty, upfront fee and subsequently demand more money to keep using items already in your possession. This encompasses those glorified alarm clocks, but also : computer printers, wearable wellness devices, and some features on pricey new cars.
- Invisible infrared surveillance technology and those caught in its digital cage (apnews.com)
When you unlock a phone, step into view of a security camera or drive past a license plate reader at night, beams of infrared light – invisible to the naked eye — shine onto the unique contours of your face, your body, your license plate lettering. Those infrared beams allow cameras to pick out and recognize individual human beings.
- Qui suis-je et quelle est mon identité ? (framablog.org)
- Les Nabatéens ont-ils fêté Noël plusieurs siècles avant les chrétiens ? (theconversation.com)
Dans l’ouvrage intitulé « Panarion » où il recense ce qu’il considère comme des hérésies, Épiphane de Salamine, théologien chrétien du IVᵉ siècle, nous apprend qu’une fête nocturne se déroulait chaque année à Pétra, capitale du royaume des Nabatéens, au sud de l’actuelle Jordanie, pour y célébrer la naissance du dieu Doushara (Dousarès, en grec). […] le mot « Noël » nous vient du latin Natalis dies qui signifie « Jour de la naissance ». Épiphane de Salamine entendait ainsi condamner la religion des Nabatéens qui pouvait apparaître comme concurrente du christianisme. […] Le danger pour le théologien était aussi que les détracteurs de la religion du Christ accusent les auteurs chrétiens de plagiat, le culte de Doushara étant antérieur de plusieurs siècles à celui de Jésus.
- 15 ans après les printemps arabes : ce qui ne s’est pas éteint (regards.fr)
- Au Rwanda, l’empreinte oubliée de la colonisation allemande (slate.fr)
Avant que l’Empire colonial belge n’administre le Rwanda jusqu’en 1962, c’est l’Allemagne qui a eu la mainmise sur le pays, entre 1894 et 1916. Si l’épisode allemand reste aujourd’hui moins en mémoire, il a néanmoins posé les bases d’un système centralisé et inégalitaire, dont les traces perdureront dans le temps.
- La bactérie et la goutte de pluie : une autre histoire des cycles de l’eau (terrestres.org)
L’une des découvertes les plus incroyables de ces dernières décennies est que le cycle de l’eau n’existe et ne se renouvelle que grâce au vivant. […] Une récente mission de la NASA (la mission « GRACE ») a montré, via deux satellites, que la variation de la gravité terrestre entre 2002 et 2017 est directement liée au niveau d’extraction des nappes d’eau souterraines, à l’échelle planétaire.
- Quand les nappes montent : enquête en BD sur un phénomène invisible qui va bouleverser nos territoires (portail.basta.media)
- L’humanité a-t-elle commencé à cultiver… pour faire plus de bière ? (slate.fr)
Aux débuts du Néolithique, nos ancêtres ont soudain troqué la débrouille des chasseurs-cueilleurs contre la sédentarité et les champs de céréales. Et si, derrière l’une des plus grandes révolutions de notre histoire, se cachait simplement une petite envie d’alcool ?
- Logique du capitalisme logistique, de la plantation à l’entrepôt (terrestres.org)
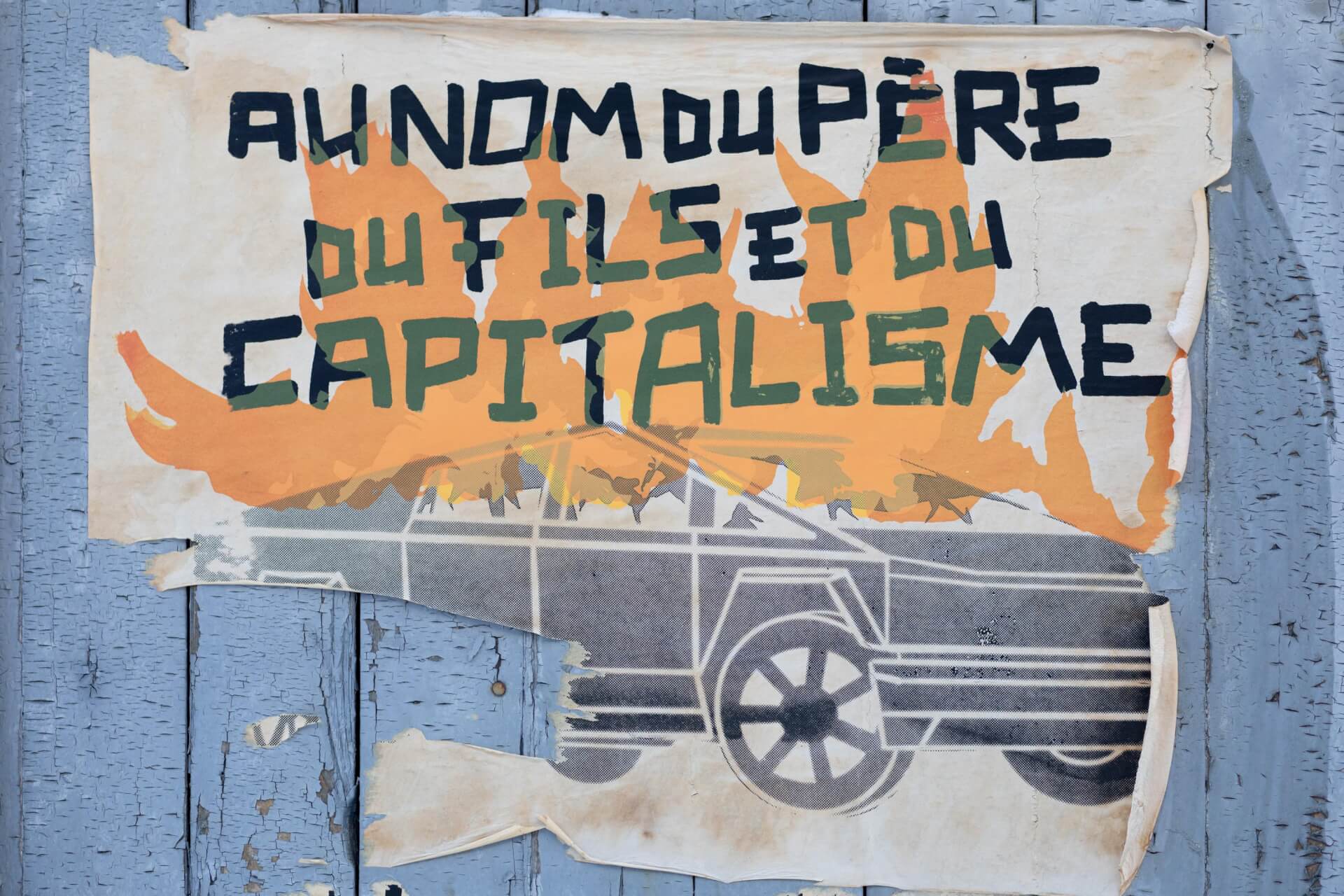
- The evolution of expendability : Why some ants traded armor for numbers (arstechnica.com)
as ant societies grew in complexity and numbers, they didn’t just make their workers smaller—they also made them cheaper.
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
- Dati
- Excuses
- Vaches
- Guillotine
- AI code
- Evil
- Mozilla
- Before
- Epstein
- To be clear
- Uber Eats
- Stroll
- Capitalisme
Les vidéos/podcasts de la semaine
- Guide pour répondre au #NotAllMen (binge.audio)
- Fascisation sécuritaire, impérialisme et guerre contre les peuples (partie 1) (spectremedia.org)
- Pourquoi la couleur a disparu de notre quotidien (radiofrance.fr)
- Sneakernet : le réseau hors internet (arte.tv – disponible jusqu’au 15/12/2028)
- A Visual Timeline of World History : Watch the Rise & Fall of Civilizations Over 5,000 Years (openculture.com)
Les trucs chouettes de la semaine
- Ce pêcheur artisanal a vaincu les chaluts de fond en larguant d’immenses blocs de béton en mer (lareleveetlapeste.fr)
Face aux ravages des chaluts de fonds sur son paradis d’enfance, le pêcheur italien Paolo Fanciulli a décidé d’agir. De la dénonciation aux autorités publiques à l’attaque frontale des chalutiers, Paola a eu une idée de génie : il a fait larguer 800 blocs de béton pour empêcher les chaluts de racler les fonds marins.Assez pour obliger les chalutiers à contourner la zone : « nous avons stoppé le chalutage illégal dans la zone à 90 % », sourit Paolo. Grâce à sa détermination, la vie marine est revenue.
- Change in Motion : Our community shaping technologies for social, gender and environmental justice (apc.org)
- Backing up Spotify (annas-archive.li)
Anna’s Archive normally focuses on text (e.g. books and papers). We explained in “The critical window of shadow libraries” that we do this because text has the highest information density. But our mission (preserving humanity’s knowledge and culture) doesn’t distinguish among media types. Sometimes an opportunity comes along outside of text. This is such a case.
- Mi Koz : et si La Réunion avait son propre Duolingo ? (parallelesud.com)
Née d’un parcours familial marqué par le rapport complexe à la langue, Mi Koz est une application réunionnaise qui entend faciliter l’apprentissage du créole, pour les enfants comme pour les adultes. Un projet à la croisée de l’intime, du culturel et du numérique.
- Donnez de l’écho à votre voix avec Framapétitions ! (framablog.org)
- Publiez vos vidéos avec PeerTube sur mobile ! (framablog.org)
Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).
20.12.2025 à 13:00
Qui suis-je et quelle est mon identité ?
Stéphane Bortzmeyer
Texte intégral (3247 mots)
On parle souvent dans le monde numérique, par exemple à propos de l’Internet, d’identité. Un ministre annonce qu’on va avoir une « identité numérique ». Un article dans les médias dit qu’un harceleur en ligne utilisait « une fausse identité ». On vous explique qu’une fuite de données peut augmenter le risque d’« usurpation d’identité ». On vous dit que Google ou Meta sont « fournisseurs d’identité ». Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ?
Avertissement ajouté en dernière minute :
Le thème de l’identité est d’actualité en ce mois de décembre 2025, avec de nombreuses fuites de données personnelles, y compris depuis des organismes publics ou para-publics. Et ceci dans l’indifférence la plus totale des politiciens.
Ce n’est pas directement le sujet de cet article, mais cela donne à réfléchir sur la sécurité de l’identité « officielle », étatique.

Ah, mais c’est pas un méchant ! C’est Stéphane !
Il y a deux points importants derrière l’identité et notamment l’identité numérique : quelle est la source de l’identité et comment prouver son identité.
Définition approximative
Il existe d’innombrables définitions du concept d’identité (rien que la page Wikipédia sur l’identité numérique en liste beaucoup). Je me limiterai ici à l’identité au sens concret, ce que les autres voient de vous et qui se prouve par des moyens techniques en ligne.
L’identité, c’est ce qui permet d’avoir une traçabilité de ses actions et donc de sa réputation ou de ses droits et devoirs. Si je lis un article de Zythom et que je le trouve très intéressant, l’identité derrière ce nom va me permettre de juger, dans le futur, si je vais lire un nouvel article ou pas. Auprès de votre banque (ou de votre place de marché en cryptomonnaies), l’identité est ce qui fera que votre banque acceptera, ou pas, de faire un paiement, et pour quel montant : la banque a tracé vos précédentes actions (ajouter de l’argent sur le compte, en retirer), et déduira de la somme de ces actions si elle accepte l’opération demandée.
L’identité se matérialise souvent dans un identificateur, une suite de caractères qui vous est unique. Cela peut être « Toto45632 », « @bortzmeyer:underworld.fr », « Jean Durand » ou « 1709900166642 ». Dans certains cas, un identificateur simple ne suffit pas, et on ajoute des détails (« Jean Durand, né le 1 janvier 1970 à Chérence »).
Un point important est qu’une personne physique (ou une organisation) peut avoir plusieurs identités, pas forcément reliées entre elles, et que c’est à la fois légal et légitime. Aucune de ces identités n’est plus « réelle » qu’une autre, elles reflètent différents aspects de la personne. Pensez à la notion de marque pour une entreprise : la Société Anonyme des Huiles Duchmoll (que personne ne connaît) commercialise les pastilles « DuGenou » (dont tout le monde a entendu parler). Elle peut sortir un nouveau produit, sous une nouvelle marque (« DeCoude »), et ce sera une nouvelle « identité », une de plus. Pour une personne physique, « Toto45632 » peut être son identité sur Instagram et « Marine Dupont, cheffe de projet » son identité sur LinkedIn et elle ne souhaite pas forcément qu’on relie ces identités.

« Je parie qu’il pense à Toto45632 »
S’il n’y a pas de traçabilité, si vos actions en ligne ne peuvent pas être reliées les unes aux autres, c’est l’anonymat. Contrairement à ce qu’affirme un discours sécuritaire très répandu chez les politiciens et les médias, l’anonymat en ligne est extrêmement difficile à atteindre. Toute action laisse une trace numérique, qu’on peut, plus ou moins facilement, corréler à d’autres traces. Être anonyme, en ligne, nécessite des compétences techniques pointues et un soin de tous les instants. En général, quand un ministre ou un député parle de l’anonymat qui serait soi-disant la règle sur l’Internet, il parle juste de la difficulté à relier les identités en ligne à l’identité officielle de l’État. Et même cette difficulté cède vite lorsque l’enquête est menée sérieusement, comme le découvrent régulièrement des harceleurs qui se sont attaqués à une personnalité publique, croyant qu’ils étaient anonymes, et qui se retrouvent devant les tribunaux.
La source de l’identité
La source de l’identité, c’est le mécanisme social qui va attribuer à une personne, ou une organisation une identité et, en général, un identificateur. Si vous créez un compte Gmail en choisissant l’identificateur « rebeccaDu95 », c’est Google, propriétaire de Gmail, qui va décider si vous pouvez utiliser cet identificateur. Il pourrait être refusé pour des raisons syntaxiques (interdiction de certains caractères), sémantiques (certains mots peuvent être tabous) ou tout simplement parce qu’il est déjà pris. Par la suite, c’est la source de l’identité, le fournisseur d’identité, qui va vérifier, par divers moyens techniques, que c’est bien votre identité. Si vous avez déjà correspondu avec « rebeccaDu95@gmail.com », vous lirez ces messages (ou pas) en fonction de ces interactions préalables et, sinon, vous traiterez cette personne en inconnue. Le fait que « rebeccaDu95@gmail.com » soit, ou pas, la même personne que « Jean Durand, né le 1 janvier 1970 à Chérence » n’est pas forcément une information pertinente. Ce sont des identités différentes.
Le point important est que, contrairement à ce que peuvent faire croire certains discours, l’identité n’est pas forcément l’identité étatique, celle attribuée par l’état civil à votre naissance, et que l’État présente souvent comme « la seule vraie », comme « l’identité réelle ». Croire ou faire semblant de croire que « identité » désigne forcément cette identité étatique est un choix politique (et un mauvais choix, je précise).
Si vous êtes fan de Johnny Hallyday ou de Léna Situations, vous n’avez pas forcément besoin de connaître leur identité étatique (parler de leurs « vrais noms » serait erroné ; en quoi seraient-ils plus vrais que l’identificateur qu’ielles ont choisi, et sur lequel a été fondé leur carrière ?)
Des identificateurs comme « rebeccaDu95 » ou « Toto45632 » sont parfois qualifiés de « pseudonymes ». Le terme a l’intérêt de faire la différence avec l’anonymat, mais il est contestable parce qu’il privilégie une seule identité, en général l’identité étatique (comme « Jean-Philippe Smet » et « Lena Mahfouf »), reléguant les autres au statut de « pseudonymes ».
On peut parfois avoir une identité même sans avoir explicitement créé son compte et sans avoir d’identificateur. Meta crée ainsi un « profil fantôme » des utilisateurs qui interagissent avec ses plates-formes sans avoir de compte, profil fondé sur les informations disponibles, et qui servira si un jour cette personne se crée un compte Facebook ou autre.
On parle parfois d’« identité souveraine » lorsqu’elle a été définie uniquement par vous, sans aucune participation d’une entité extérieure à vous. C’est le cas par exemple avec des logiciels de communication pair-à-pair.
Prouver son identité
Ce n’est pas tout d’avoir une identité, on peut être obligé de la prouver, ce qu’on appelle s’authentifier. Si je me présente à la porte de l’Élysée en disant que je suis Emmanuel Macron, président de la République, gageons qu’on ne me laissera pas entrer sans vérification. Même chose si je me connecte au site Web de ma banque pour retirer de l’argent, ou bien si je veux me connecter à mon instance fédivers (un réseau social décentralisé) pour ensuite envoyer des messages. Si n’importe qui pouvait le faire, la réputation du titulaire de l’identité en souffrirait injustement.
Prouver son identité, ou bien certaines caractéristiques liées à l’identité, comme l’âge, la nationalité ou d’autres attributs, est un problème ancien. Les Romains de l’Antiquité y pensaient déjà. (Comment Saint Paul prouvait-il qu’il était citoyen romain ?)
Il existe des cadres de gestion de l’authentification comme l’eIDAS de l’Union Européenne mais je ne trouve pas qu’ils éclaircissent cette question très riche, c’est plutôt le contraire.
Souvent on confond la source de l’identité avec le mécanisme de preuve, d’authentification. Ainsi, des systèmes comme eIDAS cités plus haut ne créent pas du tout de nouvelle identité (cela reste l’identité étatique classique), uniquement des nouveaux moyens (numériques et non plus papier) de la prouver et donc de l’utiliser.
Les différentes méthodes pour prouver une identité ont des caractéristiques très différentes : elles sont plus ou moins sûres, et plus ou moins pratiques d’utilisation. En outre, comme souvent dans le monde numérique, les commerciaux qui essaient de vous vendre telle ou telle technique d’authentification n’expliquent pas forcément bien ces caractéristiques, en admettant qu’ils les comprennent eux-mêmes.
En ligne, sur des réseaux comme l’Internet, une des techniques les plus utilisées pour prouver son identité est le classique mot de passe. C’est une technique simple, aussi bien pour la personne qui programme le système d’authentification que pour la personne qui s’authentifie. Par contre, elle a plusieurs défauts de sécurité : le mot de passe doit être difficile à deviner (donc, il ne faut pas utiliser « azerty123 »), il faut le mémoriser (il est très recommandé d’utiliser un logiciel gestionnaire de mots de passe) et il faut le communiquer au service auprès duquel on s’authentifie (comme disait ma grand-mère, un secret qu’on partage n’est plus un secret). Par exemple, en cas d’hameçonnage (vous savez, le message qui dit « ici votre banque, nous avons détecté un mouvement de fonds suspect, connectez-vous en https://secure-bank.example.ly/confirm pour vous authentifier et confirmer que c’est bien vous »), une fois que le mot de passe a été transmis à la fausse banque, il a fuité, il n’y a pas d’autres solution que de le changer.
Pour la même raison, toute méthode d’authentification qui, comme les mots de passe, repose sur une information que vous envoyez à la plate-forme d’en face, et qu’elle pourra réutiliser, est dangereuse. Envoyer une copie de ses documents d’identité étatique est par exemple très imprudent. (Au moins, ajoutez un filigrane, comme le permet l’excellent service https://filigrane.beta.gouv.fr/.)
Il existe d’innombrables autres méthodes d’authentification. Aucune n’est parfaite, quoi que puisse en dire le marketing, qui nous assomme régulièrement de propagande sur le thème « plus besoin de mémoriser un mot de passe grâce à notre méthode sophistiquée absolument sécure ». Si vous entendez de tels discours publicitaires, il faut creuser pour voir quels sont les inconvénients de cette méthode d’authentification. Il y en a forcément, puisqu’on ne vit pas dans un monde idéal. Par exemple, la biométrie, qui a souvent été présentée comme méthode idéale, cumule les inconvénients : en cas de compromission, on ne peut pas changer ses empreintes digitales ou sa rétine et elle est réutilisable par le serveur auprès duquel on s’est authentifié.
Comme exemple d’une méthode d’authentification qui ne nécessite pas d’envoyer des informations qu’un attaquant pourrait réutiliser, on peut citer WebAuthn (ex-FIDO), où les merveilles de la cryptographie dite « asymétrique » sont utilisées pour prouver votre identité à un service en ligne sans lui donner d’information d’authentification. Ainsi, même si sa base de données est complètement piratée, le pirate ne pourra pas se faire passer pour vous. Mais cela veut dire qu’il faut prendre soin de la clé privée que vous devez garder (sur un ordinateur ou bien un petit truc spécialisé que vous mettez dans le port USB de l’ordinateur). Si vous perdez cette clé privée, vous ne pouvez plus vous connecter, si elle est prise par un attaquant, il peut se faire passer pour vous. Je le répète, il n’y a pas de solution idéale.
On suggère parfois de combiner deux techniques, ce qu’on nomme l’authentification à deux (ou plus) facteurs. Le risque d’usurpation devient alors plus faible, mais le risque de ne pas pouvoir se connecter, parce qu’on a perdu un des deux facteurs, augmente.
Puisqu’on a parlé de cryptographie asymétrique, notons qu’il existe donc des techniques d’authentification très sûres et qui ne nécessitent pas d’utiliser l’identité étatique. Elles sont par exemple utilisées pour les cryptomonnaies (votre identité sur Bitcoin est une clé privée qui, comme son nom l’indique, n’est jamais transmise, à personne). C’est une très bonne solution technique mais, comme indiqué plus haut, si vous perdez la clé privée, vous ne pourrez plus vous authentifier. Ces identités souveraines, et authentifiées par cryptographie asymétrique, sont également utilisées dans des systèmes comme PGP (Pretty Good Privacy, pour la sécurité du courrier électronique), Signal ou SimpleX (messagerie instantanée).
L’authentification peut être déléguée à un ou plusieurs fournisseur(s) d’identité, ce qui augmente la souplesse du système. C’est le cas du système FranceConnect. Il n’existe pas de « compte FranceConnect ». Quand un site Web veut vérifier votre identité étatique via FranceConnect, ce dernier agira uniquement comme intermédiaire avec des fournisseurs d’identité comme les impôts ou Ameli (la Sécurité Sociale) et ce sont ces fournisseurs qui vous authentifieront, pas FranceConnect.
(Attention à ne pas confondre FranceConnect avec FranceConnect+, qui est très différent.)
Je l’ai dit, il n’existe pas de solution d’authentification parfaite et le choix va donc dépendre des critères qu’on privilégie. Ainsi, certaines techniques d’authentification peuvent être néfastes pour la vie privée. Si, pour empêcher les mineurs d’accéder aux sites Web pornographiques, on demande qu’un tiers puisse prouver aux sites en question que vous êtes majeur, la seule inscription auprès de ce tiers montrera votre intention de visiter des sites porno, ce qui n’est pas idéal pour la vie privée. (Même si parfois certains essaient de brouiller le problème en parlant de « double anonymat ».)
De même, certaines solutions d’authentification soulèvent des problèmes quant à l’autonomie stratégique des utilisateurices, et des pays. Si vous gérez un site Web et que vous proposez une authentification par le fournisseur d’identité qu’est Google, vous agissez comme rabatteur bénévole pour cette grosse entreprise étatsunienne, puisque vous encouragez vos visiteurs à confier des données à Google.
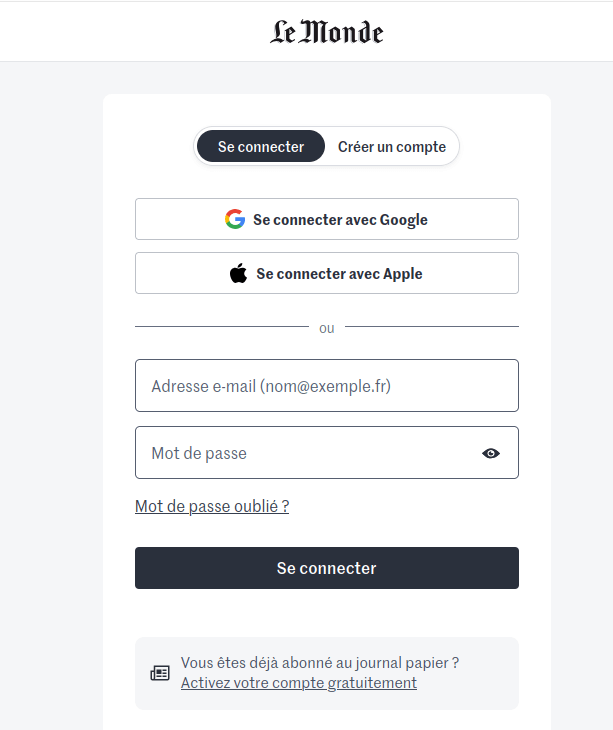
Le quotidien Le Monde propose d’abord de s’authentifier en utilisant un compte Google ou un compte Apple.
Conclusion
Ce n’était qu’un bref survol de la question très riche et très complexe de l’identité, notamment numérique. Je voulais surtout insister sur le fait que l’identité n’était pas forcément l’identité étatique, et qu’il faut bien séparer la définition d’une identité, de la ou des technique(s) qui seront utilisées pour vérifier cette identité.
18.12.2025 à 10:28
FramaPDF : modifiez, manipulez, signez vos PDF simplement
Framasoft
Texte intégral (2340 mots)
Si vous suivez notre campagne de dons de cette année, vous êtes probablement déjà au courant : nous avons mis en place un service vous permettant facilement et sans rien installer, de modifier, manipuler, et signer vos PDF.
Nous aurions pu laisser FramaToolbox faire tout le boulot mais avec vos retours pendant les tests (quand le logiciel était sur le banc d’essai Framalab) et le fait que les PDF aient envahi nos vies administratives, on s’est dit qu’un service dédié ne serait pas de trop.
La marche forcée vers la numérisation à tout prix (« quoiqu’il en coûte ») de nos vies a laissé sur le côté un trop grand nombre de personnes n’étant pas à l’aise avec l’informatique. Combien de « personnes qui s’y connaissent en informatique » ont été appelées par un⋅e proche parce qu’un document ne passait pas sur le site de telle ou telle institution parce que « trop lourd » ? Et quid des personnes n’ayant personne pour les aider ?
Si faire une recherche sur le web est généralement le premier réflexe, trouver le bon site est une autre paire de manches : soit il est truffé de publicités, ou il faut finalement payer, ou accepter tous les cookies reliés aux 47892 partenaires du site.
Utiliser un logiciel, alors ? OK, mais lequel ? Et comment faire ? Et pourquoi y a des pubs dans ce logiciel ? Et non je ne veux toujours pas de vos cookies !
Simple utilisation et utilisation simple
Pour éviter tout burnout numérique, vous pouvez utiliser FramaPDF (basé sur le logiciel Signature PDF édité par la société coopérative 24ème) :
Vous voulez signer, parapher, tamponner, compléter un PDF ? Cliquez sur Signer un PDF.
Réduire le poids d’un PDF (pour que l’administration l’accepte) ? Cliquez sur Compresser un PDF.
Organiser (fusionner, trier, pivoter, supprimer, extraire des pages) le PDF… ? Bref, vous avez compris.
Juste ces 3 fonctionnalités devraient couvrir la grande majorité de vos besoins et faire baisser votre niveau de phobie administrative. Adieu crises de larmes et hurlement de terreur et bonjour la sérénité d’un document tout propre, envoyé en temps et en heure !
Si vous êtes plusieurs à devoir signer un même document, vous pouvez partager le lien du PDF en cliquant sur Partager pour signer à plusieurs puis sur Démarrer le partage. Vous pourrez ainsi copier le lien à partager avec les autres personnes devant signer.
La fonction signature vous laisse le choix entre :
- une signature à la main directement (si vous maîtrisez l’art de signer sur une tablette ou à la souris)
- saisir un texte
- importer une image (d’une signature faite sur papier et numérisée, par exemple)
En cliquant sur le bouton Transmettre ma signature vous la ferez apparaître pour les autres personnes à qui vous avez donné le lien, qui pourront donc ajouter la leur à côté de la votre.
Utilisation avancée
Si vous vous sentez plus à l’aise à manipuler les fichiers PDF, vous pouvez aussi utiliser la version avancée (qui utilise pour le moment Stirling PDF, mais dont le changement de licence en open-core nous enjoint à passer prochainement à Bento PDF – mais les fonctionnalités seront sensiblement identiques) :
- Organisation
- Ajuster l’échelle ou la taille
- Fusionner deux PDF
- Pivoter (le PDF plutôt que l’écran)
- Redimensionner (pas la peine d’avoir une affichage de salle de cinéma pour un téléphone)
- Supprimer les pages inutiles de votre PDF (comme les pages blanches)
- etc.
- Convertir vers le format PDF des fichiers : docx, XLS, PPT, TXT, PNG, JPEG, Markdown, les fichiers pour liseuses CBZ et CBR, etc.
- Convertir dans l’autre sens, des fichiers PDF en CSV, JPG, PNG, Markdown, doc(x), ODT, etc.
- Signature et sécurité :
- Ajouter un filigrane à votre PDF (sur la photocopie de votre carte d’identité par exemple, pour ajouter « Copie pour AssuTruc » dessus comme le fait https://filigrane.beta.gouv.fr)
- Ajouter un tampon (pour les factures)
- Ajouter un mot de passe (pour garder secret vos documents secrets)
- Caviarder (manuellement ou automatiquement, pour vous donner un air d’agent⋅e secret⋅e)
- Signer (pour vos contacts)
- etc.
- Voir et modifier : ajouter des numéros de pages, des images, des pièces jointes, extraire ou supprimer des images, supprimer des pages vierges, etc.
- Mode avancé :
- Ajuster les couleurs
- Compresser un PDF – si c’est possible (vous pouvez même indiquer le poids souhaité)
- Modifier la table des matières
- Réparer un PDF cassé ou corrompu
Vous pourrez alors créer votre certificat de doctorat en PDF avec votre signature et votre photo !
ℹ️ Pour retrouver plus facilement vos outils préférés, vous pouvez les ajouter en favoris :
- cliquez sur l’étoile
- cliquez sur le + à côté de l’outil à ajouter
- l’outil se place dans la colonne des favoris
Soutenir pour l’avenir
Si jamais vous avez besoin d’un PDF pour tester FramaPDF, on en produit justement un très sympa : votre reçu de don 😛
En effet, si nous pouvons vous proposer ce service sans publicités, sans ciblages, qui ne stocke pas vos données et ce, gratuitement, c’est grâce à vos dons !
Vos dons nous permettent de payer les serveurs, le temps de travail, et surtout de garder ces outils accessibles à toustes, y compris aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un abonnement pour des services similaires fournis par une grosse boîte privée.
C’est d’ailleurs parce que nous croyons fondamentalement à l’importance d’une société solidaire que nous avons basé notre modèle économique sur celui-ci. Nos outils en ligne (que ce soit FramaPDF, Framadate, Framaspace ou autres…) servent, chaque mois, plus de 2 millions de personnes. C’est grâce à votre solidarité que nous avons pu proposer FramaPDF et pouvons chercher à construire un numérique enviable.
Pour nous permettre d’appréhender le futur sereinement et garder ces outils accessibles à toustes, il vous reste jusqu’au 31 décembre pour participer à notre campagne de dons (déductibles des impôts à hauteur de 66 %) !
Nous savons bien qu’en fin d’année vous êtes sollicité⋅es de toute part par les associations et nous vous remercions d’avance de considérer nous donner ! À la sortie de cet article, nous en sommes à 167 799 € collectés sur un total de 250 000 € !
17.12.2025 à 09:03
Donnez de l’écho à votre voix grâce à Framapétitions
Framasoft
Texte intégral (5009 mots)
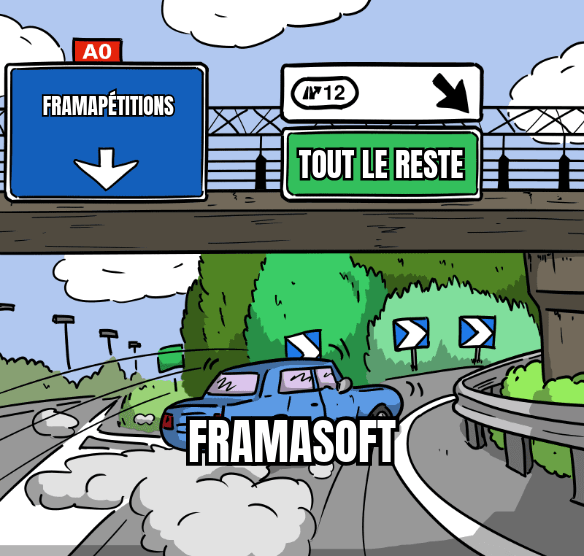
Notre difficulté à trouver du temps pour Framapétitions. Allégorie. Dessin par Gee pour Framamèmes. Licence CC-0.
En quoi Framapétitions est important ?
C’est pourquoi, nous pensons qu’il est important de fournir un service de pétition respectueux de toustes.
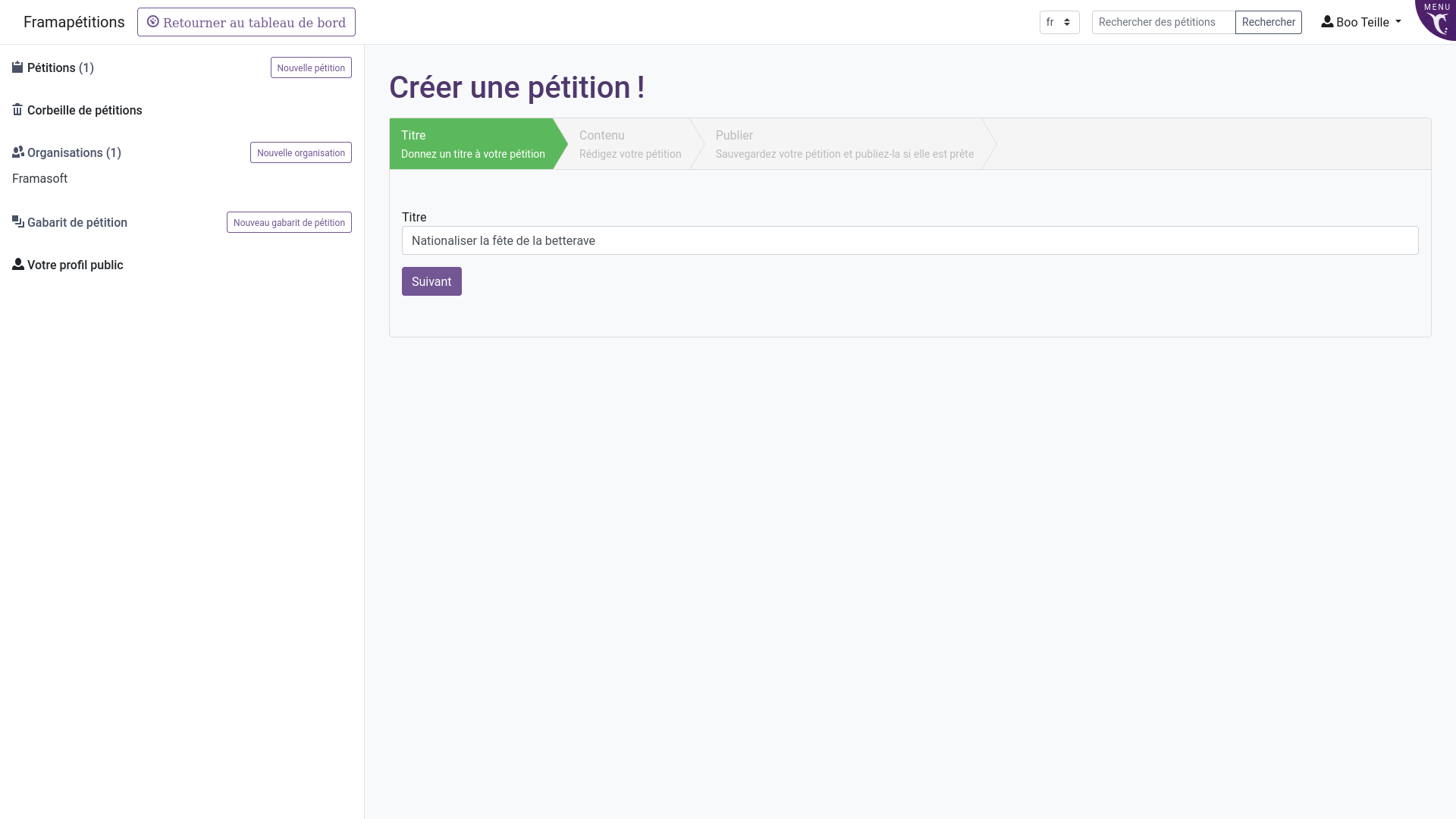
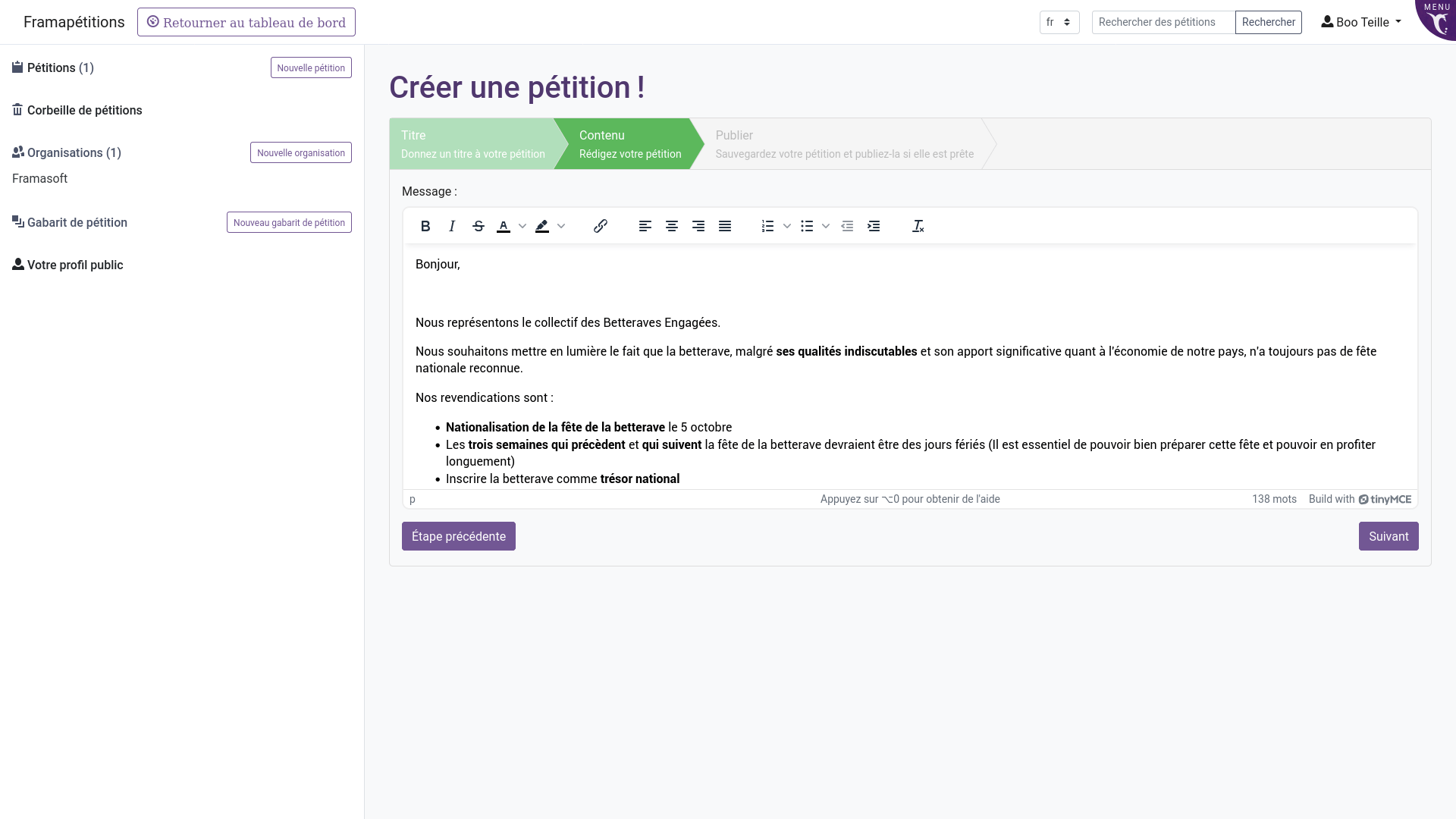
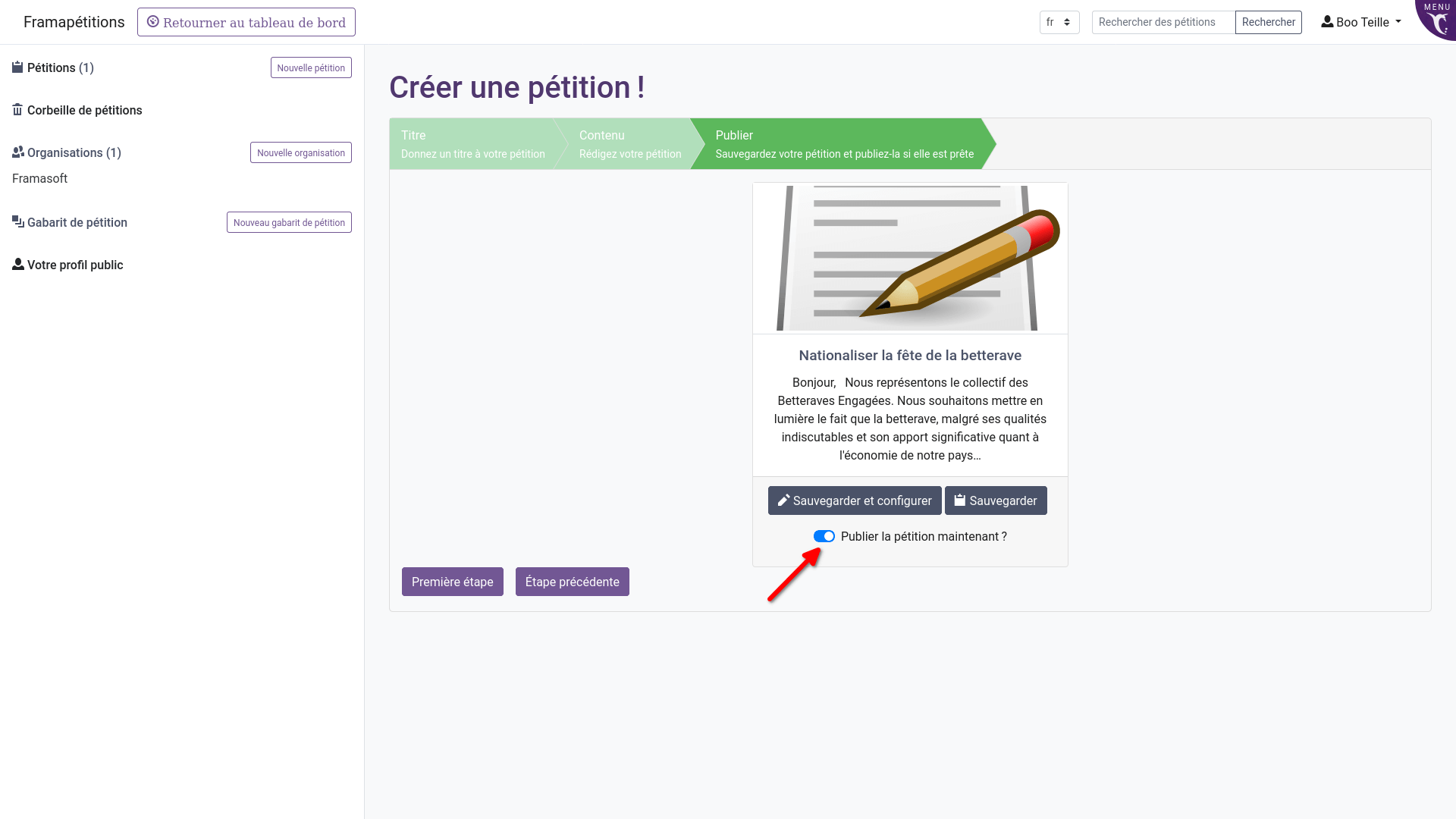
Essayer Framapétitions Soutenir Framasoft
Nous avons besoin de récolter 250 000 € d’ici le 1
Les illustrations ont été conçues par David Revoy et sont sous licence CC-BY 4.0.
16.12.2025 à 10:02
Publish your videos with PeerTube for mobile !
Framasoft
Texte intégral (3841 mots)
Publish your videos wherever you are
This was our commitment during last May’s crowdfunding campaign : to add a « creator mode » to the PeerTube app so you can upload your videos wherever you are, directly from your smartphone !
You will now find a « Creator » page in the app. From there, you can manage your channels and videos !

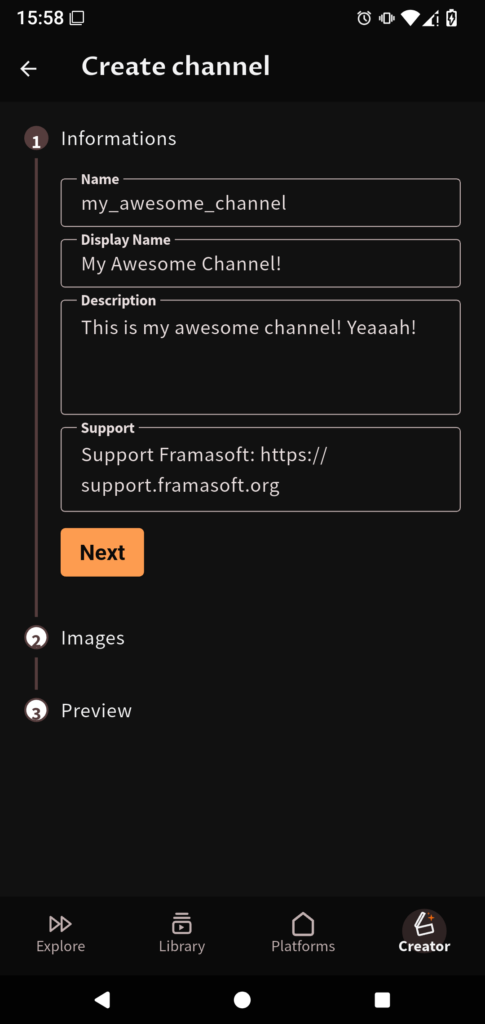
In the middle of the page is a list of all your videos. Each video has a menu that allows you to perform actions on it. From there, you can edit the video information, download the video, add it to a playlist, or delete it.
Finally, at the bottom of the page, you will find the « Publish » button, which allows you to… publish a new video. (Which is surprising, indeed !
When you click on it, a menu will pop, allowing you to choose a file from your phone or record a new video directly through the app.
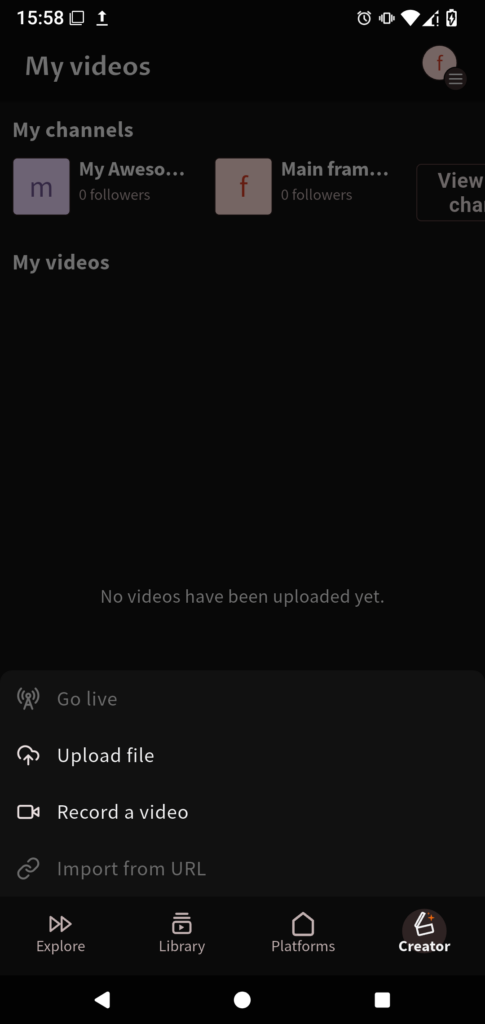
Displaying the menu for publishing a video. Only the “Upload file” and “Record a video” options are available at this time.
After selecting the video, you will be able to preview its content.
You will then receive a notification that your video is uploading in the background. While you wait, you can do something else in the PeerTube app or elsewhere on your smartphone. The upload will continue even if you are using another app !
Finally, on the last two pages, you can edit your video’s information : thumbnail, subtitles, chapters, description, etc.
As with PeerTube for the Web, the mobile app lets you enter all the necessary information !
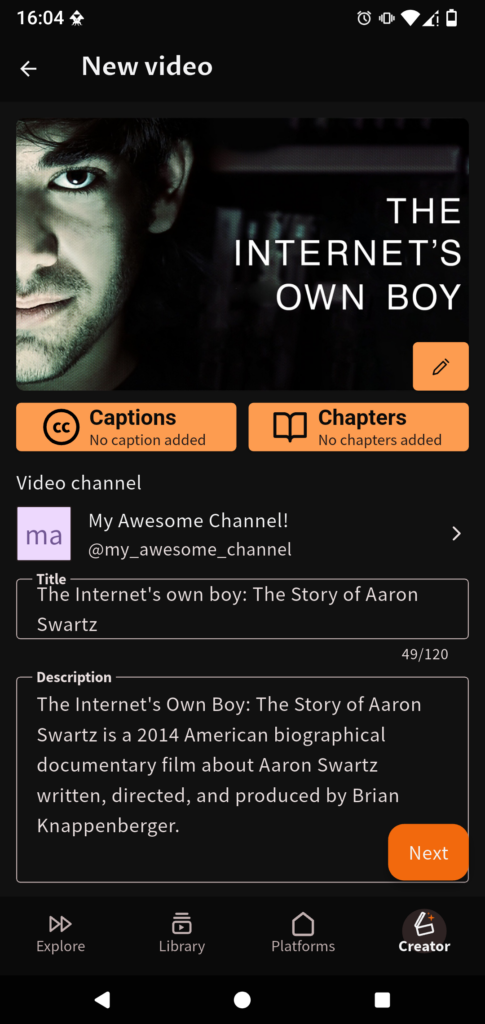
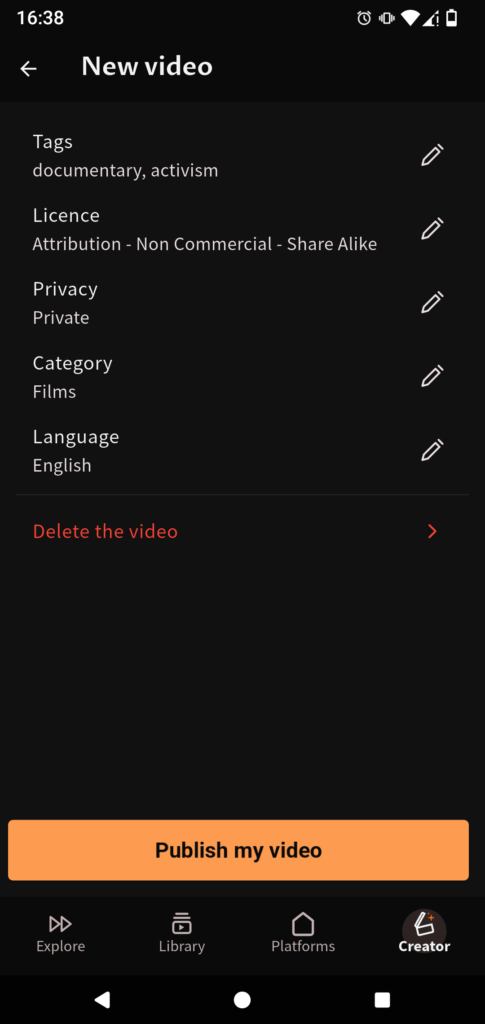
After clicking on « Publish my video », you will be redirected to the « Creator » page. There, you will find your new video and the upload status, if it is not yet complete.
As you can see, it’s quick and easy to upload a video with the PeerTube app !
Of course, we can (and want to) improve the process even more. The paint is still wet, so we expect a few minor bugs. We will spend the next few weeks fixing them.
We also plan to add several new features. These include live streaming and the PeerTube studio, for example. There are two other major features, but they require a lot of work.
In any case, we are thrilled to finally allow you to upload your videos within the app. We look forward to continuing our work to improve your experience with PeerTube on mobile !
Download the app Support Framasoft
Last year, we announced the release of our official PeerTube mobile app. Thanks to your support and that of the NLnet Foundation, we were able to hire Wicklow, a junior developer who had just completed an internship with us, to develop the app.
From the beginning, our plan was to move forward in stages. We focused on the main building blocks first, gradually adding new features and improving the app based on community feedback.
Developing a widely accessible application for PeerTube is no easy task. Its decentralized and federated nature of the platform is difficult for many people to grasp because they are accustomed to the centralized applications of Big Tech companies.
That’s why we chose to work with La Coopérative des Internets. They designed the application to ensure its “decentralized” aspect causes minimal friction.
Thus, each new element added to the application is preceded by discussions and mock-ups created by a designer. We are delighted to have been able to integrate this process into the project !
This decentralized aspect of PeerTube not only poses a challenge in terms of user experience, but also presents a real headache when it comes to getting past the restrictions imposed by Google and Apple’s app stores. For this reason, the list of available platforms in the app was limited for several months after its launch.
Needless to say, these restrictions were as frustrating for you as they were for us. Fortunately, we were able to publish an unrestricted version on F-Droid (although publishing on F-Droid was no easy task either, for other reasons… 😅).
Wicklow shared his experience in developing the app in two articles : Part 1 and Part 2.
Despite the many difficulties encountered during this journey, the PeerTube application is making steady progress ! Since the beginning of the year, we have added the following features :
- enjoy playlists ;
- report problematic videos ;
- access your viewing history ;
- download videos (on platforms that allow it) ;
- use gestures to change the volume and brightness ;
- as well as many other diverse and varied improvements…
All these improvements were made possible thanks to your support ! Thanks to crowdfunding in May, we raised the necessary funds to continue developing the application.
However, it is also the year-round donations made to Framasoft that finance the PeerTube project as a whole and allow us to look forward to the future of PeerTube with confidence.
If you can and want to contribute to PeerTube’s robustness, consider making a donation and sharing our support page !
Download the app Support Framasoft
More to come…
Among the recent improvements to the app (including creator mode), several were part of our May commitments.
However, we haven’t delivered everything yet ! Several features are still in the pipeline and will arrive in the coming months.
These include, as mentioned above, the ability to play videos in the background (so you can turn off your screen while listening to a podcast), the ability to broadcast live directly via the app, and the release of a tablet-friendly version of the app.
PeerTube is an ambitious project.
Creating software that allows users to build alternative video platforms to those of the digital giants, centered around users (rather than the financial interests of a company), is a monumental challenge.
However, after ten years of development, more and more organizations recognize PeerTube as a reliable solution for distributing their videos.
Our solidarity-based economic model has given us a considerable advantage, allowing us to develop software we are proud of, without pleasing investors and submitting to their endless quest for quick returns.
You are our compass. Thanks to your feedback, we are developing PeerTube to best meet your needs.
The PeerTube mobile app follows the same model as the web app : we are building our vision of a digital world designed for everyone, brick by brick.
Admittedly, there is still a long way to go… but the path is Free !
Download the app Support Framasoft
Let’s build the robustness of PeerTube and Framasoft
Framasoft (and therefore PeerTube) relies on your donations for funding !
By supporting our solidarity-based model, you are not only ensuring a secure, commercial-free future for PeerTube. You are also enabling Framasoft to provide 23 alternative, free services to more than 2 million users !
To achieve this, we need to raise €250,000 by the end of the year.
Thanks to over 3,000 donors, we have already raised around €150,000 ! 🥳
Help strengthen Framasoft by making a donation (66 % of which is tax-deductible for French taxpayers) and spreading the word to your friends and family !
Together, let’s prove that a non-commercial digital world accessible to all is possible !
Download the app Support Framasoft
The illustrations were designed by David Revoy and are licensed under CC-BY 4.0.
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Romain LECLAIRE
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD