20.02.2024 à 13:04
Une brève histoire de l’évolution des recommandations algorithmiques
Hubert Guillaud
Texte intégral (2806 mots)
Le billet sur l’effondrement de l’information que je publiais en janvier a fait beaucoup réagir, notamment des journalistes – certainement parce qu’ils ont été nombreux à se retrouver dans la description, assez sombre j’en conviens, que je dressais des évolutions en cours dans le monde de l’information. Quand Steven Jambot, animateur de l’Atelier des médias sur RFI (cette belle émission qui a 20 ans, animée longtemps par Philippe Couve puis Julien le Bot et Ziad Maalouf…) m’a proposé de venir en parler… je n’ai pas hésité. L’émission (à écouter ici) m’a donné l’occasion de tenter de rassembler une petite histoire de l’évolution des recommandations algorithmiques.
L’exercice n’est pas facile (surtout à l’oral) et je me dis que cela vaut le coup d’essayer de caractériser simplement cette histoire. L’idée n’est pas de faire une thèse sur le sujet, juste d’essayer de faire saisir simplement les évolutions que nous avons vécu ces 20 dernières années, pour mieux saisir la situation de blocage où les ajustements algorithmiques nous ont conduit.
L’âge de la souscription et le modèle des recommandations simples (2000-2010)
La première génération de systèmes de recommandation commence à être assez ancienne. C’est celle du filtrage collaboratif qui consiste à apparier les produits entre eux par exemple. C’est une fonction qui existe encore sur Amazon, le fameux, “les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté tel autre produit”. C’était également le principe sous lequel fonctionnait Netflix quand il était encore une entreprise qui envoyait des DVD par la poste, qui créait une moyenne entre les notes, les genres, les nouveautés et les demandes locatives pour produire des recommandations assez simples pour orienter l’utilisateur dans les contenus à louer. Les systèmes de recommandation étaient alors sommaires, fonctionnant principalement sur la modalité de la souscription et de l’abonnement : sur les premiers médias sociaux comme dans la blogosphère, on s’abonne aux gens qui nous intéressent et on reçoit des notifications de ce qu’ils ont publié.
Ces méthodes vont peu à peu se complexifier et s’ajuster en fonction des critères disponibles, comme la popularité, les préférences ou la qualité. Mais elles vont également être très tôt manipulées par les plateformes. Chez Amazon par exemple en exagérant la recommandation de produits similaires pour déclencher l’achat (beaucoup de gens achètent des produits dissociés, Amazon va favoriser la recommandation d’un DVD d’un même réalisateur par exemple plutôt qu’une recommandation d’un produit trop alternatif pour favoriser le passage à l’achat du produit supplémentaire). Chez Netflix en diminuant les recommandations des nouveautés au profit des titres de la longue traîne bien moins louées et bien plus disponibles. Dans les médias sociaux en recommandant les profils les plus populaires sur ceux qui le sont moins.
On peut faire courir cette première période des années 2000 à 2010. Signalons cependant l’évolution, en 2006, de la “factorisation matricielle”, c’est-à-dire l’invention de systèmes de recommandations plus complexes. C’est le cas du concours lancé par Netflix à l’époque pour améliorer son système de recommandation qui va générer des combinaisons d’attributs pour caractériser les contenus qui vont très bien fonctionner sur des catalogues limités, mais pas du tout pour caractériser les messages infinis publiés sur les médias sociaux.
L’âge du réseau et du modèle des propagations (2010-2016)
Dans le modèle de réseau, la propagation d’un message ne dépend plus seulement des personnes auxquelles vous êtes abonnées, mais est amplifiée ou rétrogradée par les effets de réseaux. Plus un message est relayé, plus il est amplifié. Ce sont les réactions des autres qui structurent la recommandation. C’est l’effet de la prise en compte du like, du commentaire et du partage sur Facebook avec le lancement en 2010 de l’Edge Rank qui va attribuer une note aux contenus pour les classer selon l’intérêt des utilisateurs… ou la prise en compte du commentaire et du RT sur Twitter qui vont être prédominants dans les recommandations jusqu’en 2016. Ce scoring des contenus selon l’intérêt des utilisateurs va faire monter certaines catégories de contenus, par exemple les photos et les vidéos sur FB, mais également favoriser les polémiques en faisant remonter les posts ou les tweets les plus commentés. Dans l’âge du réseau la prime va à la visibilité : on accroît la portée de ce qui fonctionne le mieux, comme l’expliquait Arvind Narayanan. En 2015, Youtube intègre à son tour l’apprentissage automatique de Google Brain ce qui va transformer les recommandations de son moteur en privilégiant le temps passé (le temps passé à regarder une vidéo devient le critère de qualité).
L’âge algorithmique et le modèle de la similarité (2016-2021)
L’intégration d’ajustements algorithmiques prenant en compte de plus en plus de critères transforment à nouveau les moteurs de recommandation. Durant cette période, les ajustements algorithmiques sont réguliers, continus produisant des recommandations en mouvement permanent, comme l’expliquait Arvind Narayanan en observant les révélations sur le fonctionnement de Twitter, l’année dernière. Mais la transformation principale de cette période consiste à mobiliser l’apprentissage automatique pour prédire la similarité.
Dans le modèle algorithmique, les utilisateurs ayant des intérêts similaires (tels que définis par l’algorithme sur la base de leurs engagements passés) sont représentés plus près les uns des autres. Plus les intérêts d’un utilisateur sont similaires à ceux définis, plus il est probable que le contenu lui sera recommandé. Le contenu ne dépend donc plus des gens auxquels on est connecté ou des mouvements de foule, mais d’un calcul de similarité de plus en plus complexe et mouvant.
Cette similarité consiste à calculer le comportement, c’est-à-dire à tenter de regarder ceux qui apprécient les mêmes choses que nous pour favoriser l’engagement. Forts de données plus massives sur leurs utilisateurs, les plateformes affinent leurs recommandations. En introduisant par exemple la mesure des “interactions sociales significatives” en 2018, Facebook devient capable de prédire les contenus que vous allez liker ou commenter pour vous les proposer. Le poids de la souscription (les personnes auxquelles on est abonné) ou du réseau (les contenus viraux) sont dégradés au profit d’un calcul plus complexe qui tente de prendre en compte le sujet, sa qualité, les réactions des autres…
Avec ces modèles, le nombre d’utilisateurs des plateformes explose… et chacune affine ses principes d’engagements valorisant des comportements très différents les uns des autres. TikTok par exemple valorise les vidéos regardées jusqu’au bout et donc des vidéos courtes, mais valorise également la pulsion, la réaction immédiate via le swipe, qui va avoir tendance à favoriser certains contenus sur d’autres. Le flux des contenus proposé est ajusté pour favoriser également de la diversité.
Dans cette complexité nouvelle, les contenus rétrogradés sont rendus opaques et invisibles, car la portée naturelle du contenu dépend de fortes variations et les utilisateurs ne peuvent savoir si les contenus qu’ils ne voient pas ont été rétrogradés ou l’ont été parce qu’ils sont moins bons. La logique de la viralité demeure néanmoins le point fort des réseaux sociaux : la majorité des engagements proviennent toujours d’une petite fraction des contenus (20% des vidéos les plus vues font 70% des vues sur TikTok ou YouTube). Dans cette complexité, les plateformes néanmoins gardent la main : en augmentant la portée des contenus publicitaires dont elles ont de plus en plus besoin pour dégager des bénéfices et en rétrogradant certains types de contenus…
L’âge du cynisme, des distorsions de marché et de l’emballement du modèle commercial (depuis 2021…)
On pourrait dire que la recherche d’un engagement optimal ou idéal s’effondre en 2021. Le symbole, c’est l’éviction de Trump de FB et Twitter, mais cet engagement avait déjà été mis à mal avec la pandémie, quand les plateformes ont été contraintes de mieux qualifier leurs contenus et de produire des contenus vérifiés. Confrontées à leurs effets, les plateformes se mettent à se détourner de certains types de contenus, notamment politiques. Elles dégradent volontairement la performance de l’information (et des hyperliens) des grands sites de presse pour promouvoir des interactions qui peuvent sembler apolitiques. Elles semblent en revenir aux racines des réseaux sociaux, c’est-à-dire privilégier les discussions entre utilisateurs, à l’image du réseau social Threads. Le rachat de Twitter par Musk en 2022 et les transformations que va subir Twitter depuis vont dans le même sens, puisque sur Twitter désormais, ce sont les comptes qui payent qui vont être mis en avant. La qualité et la viralité “naturelle” sont dégradées. Les plateformes ne cherchent plus à promouvoir l’intérêt général, mais ne se focalisent plus que sur l’amplification de leur modèle commercial. En 2021, FB avait tenté de mesurer la qualité des messages qu’il proposait, mais en faisant disparaître les messages les plus négatifs qui avaient également la plus grande portée, les utilisateurs étaient insatisfaits. FB a fait marche arrière, assumant son cynisme commercial.
C’est ce qu’explique d’ailleurs un passionnant article signé Tim O’Reilly, Illan Strauss et Mariana Mazzucato qui constate que dans les rentes d’attention algorithmiques, les plateformes se focalisent désormais sur le service aux annonceurs plus que sur la qualité de l’expérience utilisateur (qui lui, préfère l’âge de la souscription et du réseau, l’âge d’avant l’emmerdification algorithmique – “l’emmerdocène” – comme dit Cory Doctorow, parce que ces modèles permettaient aux utilisateurs de construire des relations et d’en rester maître). Ce qui a changé, c’est que les plateformes sont désormais bien moins en concurrence qu’en situation de monopole, et qu’il est difficile pour les utilisateurs de les quitter totalement. Dans des marchés sans grande concurrence, les plateformes n’ont plus à se soucier que leurs algorithmes soient équitables. Les clics des utilisateurs restent dirigés vers les premiers résultats que les plateformes proposent, donnant un pouvoir considérable aux classements qu’elles mobilisent et notamment à la mise en avant publicitaire dans des environnements où l’utilisateur ne paye pas. Quand l’augmentation du nombre d’utilisateurs ralentit, l’augmentation des bénéfices devient fonction de la quantité de publicité délivrée ou repose sur le fait de faire payer les utilisateurs. Pour les plateformes, l’enjeu désormais n’est plus de fournir la meilleure correspondance de la recommandation, mais la plus rentable. Sur Google, les résultats publicitaires n’ont cessé de grimper au sommet des recommandations et de s’invisibiliser par rapport aux résultats “naturels” (en 2011, 94 % des clics sur Google étaient organiques et seulement 6 % étaient dirigés vers des publicités… Il serait intéressant de connaître le résultat actuel !). Chez Amazon, tous les résultats sont désormais issus de positionnements publicitaires (¾ des vendeurs d’Amazon Market Place paient pour obtenir de la visibilité) et là encore le fait que ce soit des résultats publicitaire devient complètement invisible à l’utilisateur. Amazon a ainsi gonflé ses prix publicitaires tout en diminuant leur rendement (“En 2022, la publicité est devenue une activité très rentable pour Amazon se montant à 37,7 milliards de dollars. Le coût moyen par clic sur les publicités Amazon a doublé, passant de 0,56$ en 2018 à 1,2$ en 2021: 30 cents doivent désormais être dépensés en publicités pour générer 1$ de ventes.”).
Pour O’Reilly, Strauss et Mazzucato, nous sommes désormais entrés dans des plateformes de distorsion des marchés, où les préférences et les possibilités de paramétrages des utilisateurs disparaissent de plus en plus – justifiant la réaffirmation d’un droit au paramétrage, comme le proposent Célia Zolynski et Jean Cattan (et Ethan Zuckerman il y a quelques années). L’attention des utilisateurs est désormais majoritairement pilotée au profit de ceux qui sont disposés à payer, au détriment de l’emplacement ou de la réputation qui sont de plus en plus dévalorisées. Ainsi, si vous cherchez des pneus, Google va vous recommander les grands annonceurs très loin devant votre garage de proximité.
Dans leur article, O’Reilly, Strauss et Mazzucato estiment que pour remédier à ces distorsions de concurrence, il faudrait que les régulateurs puissent comparer le classement “organique” d’un produit avec son classement payant, favoriser le prix final pour écarter les fausses promotions… mais surtout, ils s’interrogent sur l’idée de définir un rendement publicitaire maximal. Reste que l’appareil réglementaire en la matière est confronté à une lacune béante : le manque d’information régulière et obligatoire des plateformes sur leurs paramètres opérationnels permettant de contrôler le niveau de monétisation de l’attention des utilisateurs ! Or, les plateformes connaissent la charge publicitaire, connaissent les ratios clics organiques/clics publicitaires et l’évolution de ces mesures dans le temps… C’est au régulateur d’armer sa mesure de la régulation ! Ils en appellent également à des mesures plus précises, géographiquement et par produit. Google dispose de 9 produits qui ont plus d’un milliard d’utilisateurs, mais les informations sur la publicité qu’elles rapportent ne fait pas de distinguo entre ces services ! Dans leurs préconisations, les auteurs recommandent également de permettre aux utilisateurs d’avoir des préférences persistantes, proche du droit au paramétrage que défendent chez nous Célia Zolynski et Jean Cattan.
O’Reilly, Strauss et Mazzucato concluent sur les perspectives problématiques que vont générer sur ces marchés déjà opaques, l’arrivée des contenus synthétiques de l’IA, avec le risque d’un renforcement de l’autorité algorithmique et rendre plus difficile encore la détection des comportements problématiques des plateformes, c’est-à-dire les distorsions qu’elles accomplissent.
Reste encore un élément à prendre en compte dans ces évolutions. Malgré tous leurs efforts, l’efficacité de ces modèles demeure extrêmement faible. Le taux d’engagement, c’est-à-dire la probabilité qu’un utilisateur s’intéresse à un message qui lui est recommandé, demeure partout extrêmement faible : il est de moins de 1% sur la plupart des plateformes. Malgré le déluge d’analyse de données, les gens demeurent peu prévisibles. Les plateformes savent identifier les contenus viraux et les contenus de niches, mais c’est à peu près tout. Quant au taux de clic publicitaire, il est encore plus bas. Cela n’empêche pas les plateformes de centrer leur performance sur ce qui leur rapporte. A défaut d’avoir changé le monde, elles se sont converties à leur seule réussite économique.
Hubert Guillaud
20.02.2024 à 12:21
Le code contre le texte
Hubert Guillaud
Texte intégral (668 mots)

Ce récit d’une écrivaine à la découverte du code a la fraîcheur du béotien qui va à la rencontre d’un monde qu’il ne comprend pas où qu’il prétend ne pas saisir. Dans Python (P.O.L., 2024), la romancière Nathalie Azoulai s’interroge sur cette langue vivante “qui pourtant ne se parle pas”, sur cette révolution graphique et la fascination qu’elle provoque. Que ce soit pour ces jeunes codeurs, absorbés dans leur monde, comme de la puissance de la science sur les lettres. Azoulai multiplie les saillies, les réflexions que lui inspirent ce monde et ces gens. Souvent avec une belle pertinence, comme quand elle pointe que le langage humain semble être devenu secondaire… Cette défaite des lettres sur la science, semble être aussi pour Azoulai, la défaite d’une génération sur une autre. Le code incarne à la fois la jeunesse et le futur. Une autre forme d’art qui ne parle plus qu’aux machines ou un nouveau pouvoir sur le monde, capable de le façonner, de l’exécuter, sans qu’on sache si c’est pour le transformer ou pour le terminer. Coder, c’est comme le contraire de la littérature, puisque c’est tenter d’enlever son ambiguïté au monde, en réduire le sens pour mieux le dominer.
Le livre de Nathalie Azoulai n’est pourtant pas sec comme une page de code, au contraire. L’écrivaine va à la rencontre des jeunes humains de ce monde, tente de les entendre, même si la “daronmancière” semble plus fascinée par la portée érotique de leur jeunesse que par ce qu’ils produisent. C’est peut-être la limite de l’exercice : Azoulai ne parvient pas entrer dans le vide que construit ce monde, que ce soit le flow du codeur, mais plus encore, à regarder la pauvreté de ce que les data assemblent. Leur puissance en reste au niveau du fantasme romantique… Et celui-ci, faute d’avoir percé le code, ne parvient pas à sortir d’une fascination déçue, à l’image de la convocation finale de ChatGPT, bien trop convenue.
Avec sa naïveté feinte à la Xavier de la Porte, elle nous embarque pourtant. Azoulai regarde avec désir le monde qui vient, comme pour assouvir ou retrouver un instant la puissance perdue des lettres. Elle oublie (tout en ne cessant de le montrer) que cette puissance n’est que jeunesse. Qu’elle est aussi feinte que l’a été la puissance des lettres. De la figure du poète à celle du codeur, nous sommes confrontés à un même héroïsme feint, celle d’une puissance à dire le monde, à le réduire, à l’instrumentaliser plus qu’à le libérer.
Hubert Guillaud
A propos du roman de Nathalie Azoulai, Python, P.O.L., 2024.
06.02.2024 à 16:28
Améliorer la démocratie
Hubert Guillaud
Texte intégral (3697 mots)
Dans Pour en finir avec la démocratie participative (Textuel, 2024), les consultants Manon Loisel et Nicolas Rio, cofondateurs du cabinet Partie Prenante, dressent un diagnostic pertinent et passionnant sur nos impasses démocratiques actuelles. Ils expliquent que la démocratie participative s’est imposée comme le remède à la crise de notre démocratie représentative, mais sans que cette médecine ne réussisse à produire un remède efficace ni aux défaillances de la démocratie représentative ni à donner de la force à la participation. Grand débat et Convention citoyenne pour le Climat ont surtout démontré leur impuissance à transformer le système politique. Loisel et Rio nous proposent donc d’arrêter avec la participation et de nous concentrer plutôt à réformer la démocratie représentative. L’enjeu n’est pas tant d’améliorer la participation que de démocratiser l’action publique.
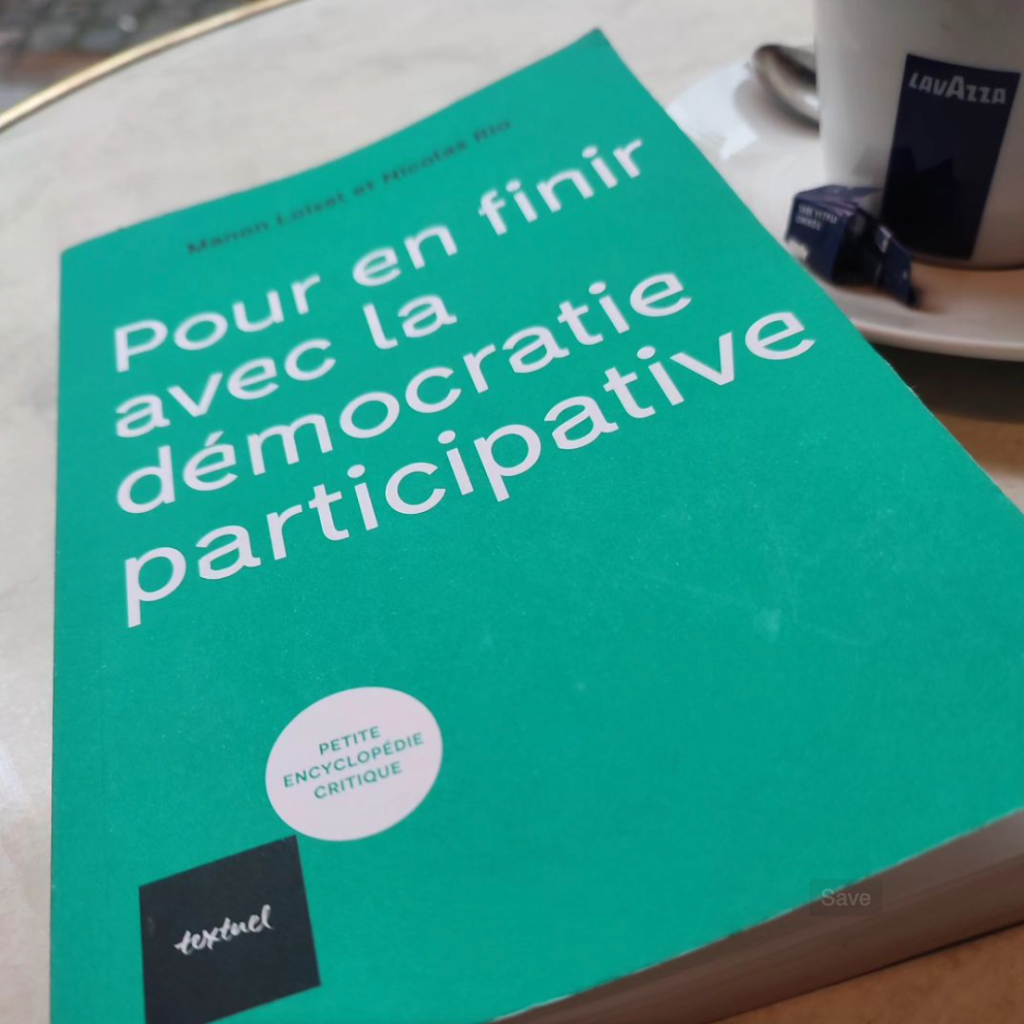
Ce constat rappelle beaucoup celui que dressait récemment Thomas Perroud dans son livre Services publics et communs qui invitait déjà à un élargissement démocratique capable de dépasser la fausse participation. La force du petit livre de Manon Loisel et Nicolas Rio est d’être particulièrement concret, puisqu’ils accompagnent depuis longtemps des collectivités dans la mise en place de processus participatifs.
De l’impuissance
Leur livre est une réaction à l’impuissance que produisent ces dispositifs. La participation ne parvient pas à rendre l’action publique plus démocratique. Au contraire, elle relève bien souvent de la diversion, à l’image du Grand Débat, cette réponse pour reléguer la crise des gilets jaunes, et faire s’exprimer d’autres catégories sociales que celles qui manifestaient leur colère en décembre 2018. La Convention citoyenne pour le climat, malgré la qualité du processus mis en place, n’a pas produit plus que le Grand Débat. Les autres dispositifs de participation (réunion publique, enquête publique, conseils de quartier, budgets participatifs, panels citoyens…) ne produisent ni plus ni mieux. Partout, les formats l’emportent sur les effets. La participation devient une politique comme une autre dont le cadre et les règles du jeu sont strictement délimités pour justement ne produire aucun effet. La standardisation des dispositifs permet justement à l’acteur public d’être en contrôle afin que rien ne déborde.
Cette impuissance des dispositifs accentue la crise démocratique que la démocratie participative est censée résoudre, estiment les auteurs. Elle ne produit rien d’autre que de la désillusion. “L’exercice jupitérien du pouvoir et la participation des citoyens appartiennent d’un même processus”, puisque l’un comme l’autre relèguent dans les marges la société civile organisée et légitiment leur contournement. Les dispositifs participatifs ne produisent aucun contre-pouvoir… et ces dispositifs ne disposent d’aucun mandat pour contrôler que leurs propositions se traduisent en actions. Ils permettent surtout de faire croire que les institutions sont à l’écoute des citoyens.
Modifier les publics, redistribuer le pouvoir
Pour Manon Loisel et Nicolas Rio, l’enjeu n’est pas tant de faire participer que “d’atténuer les asymétries qui existent entre les citoyens dans leur capacité à faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits”. Le grand problème des dispositifs participatifs, malgré tous leurs efforts pour aller vers tous les citoyens, c’est qu’ils mobilisent “toujours les mêmes”, c’est-à-dire finalement des gens déjà très insérés dans la vie démocratique. La participation ne parvient pas à faire ce qu’on lui prête, c’est-à-dire à modifier les publics. Pire, elle invisibilise bien souvent qui parle et au final permet d’invisibiliser la sélectivité sociale à l’œuvre. Elle renforce une écoute des institutions et des élus déjà sélective, alors qu’elle devrait d’abord permettre de redistribuer l’attention des institutions vers les publics les moins représentés. La démocratie participative devrait être un moyen de donner de l’audience aux inaudibles pour qu’ils soient réintégrés à l’intérêt général et à la production de l’action publique. Elle devrait permettre d’aller chercher les publics que la démocratie représentative n’arrive pas à représenter, à sortir voire à atténuer les mécanismes de domination, à permettre de prendre en compte les absents et notamment les abstentionnistes, notamment parce que plus les publics sont silencieux moins les politiques leurs sont destinées.
Loisel et Rio plaident également non seulement pour un empowerment des acteurs affaiblis, mais également pour un “disempowerment des acteurs établis”. Pour eux, les dispositifs devraient être là pour redistribuer le pouvoir. “La participation n’est démocratique que lorsqu’elle parvient à donner de la voix aux absents et à élargir le spectre des points de vue en présence”, à redonner une place à ceux qui ne sont pas écoutés et qui n’ont pas de strapontin à la table des négociations. Les institutions n’ont pas besoin d’entendre des centaines de citoyens ni de recueillir des millions de doléances, que d’écouter ceux qui ne participent pas. Et faire de manière à ce qu’ils disent soit entendu, agisse sur l’action publique.
Déni d’opposition
“L’avènement de la démocratie administrée s’accompagne d’une répression croissante des autres formes d’expression citoyenne”. Les citoyens doivent de plus en plus parler là où on leur dit de faire et nulle part ailleurs. C’est comme si la démocratie participative laminait toutes autres formes d’expressions démocratiques, et notamment le droit de manifester, si mis à mal ces dernières années que ce soit par la multiplication des interdictions de manifester comme par leur répression. La protestation est désormais considérée comme “un trouble à l’ordre public”, et il n’est pas loin que le simple désaccord le devienne également. Les mouvements sociaux sont de plus en plus criminalisés, comme le montrait le sociologue Julien Talpin dans Bâillonner les quartiers, pointant la dérive autoritaire de nos démocraties. Fermeture de locaux, chantages aux subventions, refus d’agréments… Les autorités ont renforcé le déni de leur contestation, à l’image du contrat d’engagement républicain des associations très largement critiqué. C’est comme si nous étions entrés dans un déni d’opposition. Tous ceux qui ont un discours trop frontal sont écartés des tables de discussion, les poussant à se radicaliser plus encore. Ceux qui ne sont pas d’accord sont partout considérés comme des Ayatollahs. Leurs arguments, quels qu’ils soient, sont écartés par principe. En rendant l’opposition impossible, c’est la discussion qui le devient.
“La crise démocratique est une crise de l’écoute”, expliquent-ils parfaitement. Mais également une crise de réponse à cette écoute, à l’image de metoo qui a libéré la parole des victimes de violences sexistes sans que nous ne modifions le fonctionnement de nos institutions collectives pour y répondre, renvoyant celles qui osent parler à leur seule responsabilité individuelle. C’est également une crise du déni, où la démocratie n’est plus vue comme le lieu d’un compromis entre ses parties prenantes, mais comme la lutte d’un clan contre un autre, à l’image du refus de discussion sur la réforme des retraites, les bassines, etc. A force de déni et de dévitalisation, les institutions perdent leurs interlocuteurs traditionnels, associations et corps intermédiaires… au risque de n’avoir plus personne à qui parler, autre que les lobbies, c’est-à-dire que les intérêts financiers les plus forts !
La démocratie participative permet de collecter une parole à laquelle personne ne répond. Nos institutions semblent produire de plus en plus un dialogue de sourds. C’est un peu comme si nos institutions niaient l’existence de divergences d’intérêts, ce qui se traduit par une conflictualité en hausse, par une radicalisation des positions, par une tension permanente et épuisante. L’apaisement n’est plus un mode de gouvernement. Dans le déni de l’écoute, des réponses et du compromis, les protestations mêmes légitimes ont tendance à devenir colère voire réactions violentes. “L’incapacité à écouter débouche sur une incapacité à agir”.
Rendre l’écoute fonctionnelle
Pourtant, il existe des leviers pour rendre à nouveau l’écoute fonctionnelle, rappellent les auteurs en prenant l’exemple du Défenseur des droits (on pourrait évoquer également le rôle de la Commission d’accès aux documents administratifs voire en partie des missions de la Cnil et de quelques autres autorités administratives indépendantes, auxquelles il faudrait ajouter les médiateurs de services publics que l’on trouve désormais dans plusieurs institutions publiques). Les médiateurs se font souvent le relais institutionnel des inaudibles : ils viennent non seulement écouter mais également accompagner les usagers en difficultés en proposant leur médiation dans les conflits. “Cette fonction de médiation à l’échelle individuelle vient alimenter une fonction d’interpellation, plus collective”, à l’image des travaux et saisines du Défenseur des droits. Les remontées de problèmes permettent de mettre en visibilité les difficultés structurelles, de passer du subjectif à l’objectif… et surtout souvent de résoudre les situations de blocage individuelles… En assurant le suivi des cas, ces médiateurs viennent refluidifier l’écoute et la réponse que nous sommes en droit d’attendre des acteurs publics. Pour Loisel et Rio, c’est ce processus de transformation du vécu subjectif à l’analyse objectivée qui manque dans la participation citoyenne, c’est le moyen d’assurer que les propositions obtiendront bien une réponse. Et la solution des autorités indépendantes permet de montrer que c’est parce qu’elles ont un pouvoir garantit et établit, opposable, qu’elles peuvent agir. Leurs fonctions n’est pas qu’une fonction de médiation, elle est bien d’abord une fonction de résolution de problèmes. Ces médiateurs ont souvent un pouvoir qu’ils utilisent pour remettre de l’asymétrie dans une relation qui ne l’est plus. Elles ont les moyens, juridiquement garantis, de remettre un dossier sur une table, de provoquer des réponses.
Pour Loisel et Rio, ces agences, à l’écoute des citoyens, montrent que également que l’audition (et pas seulement celle des experts) est un levier pour faire remonter la parole et le vécu des citoyens dans les décisions. C’est l’addition de récits qui transforme nos sociétés, à l’image de ce qu’à produit la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Idéalement, le procès, momentum de la justice, est également une expérience d’écoute et de réponse. “Remplacer les plateformes participatives par des témoignages à la première personne permettrait de préciser ce qui est attendu des citoyens. L’objectif n’est pas d’avoir leur avis (c’est le rôle des élus) ou de prendre leurs idées (c’est le rôle de l’administration), mais de comprendre leur expérience vécue et la façon dont elle éclaire les politiques mises en place”. La confrontation des témoignages permet d’avoir une vision plus complète de la réalité, d’éclairer les angles morts de la décision, et de les porter pour que le politique en tire les conclusions
Les deux consultants plaident également, comme le juriste Thomas Perroud, pour faire entrer l’administration en démocratie, en faisant là encore entrer la contre-expertise, la diversité des points de vue, pour faire surgir les controverses là où elles sont, plutôt que de les mettre sous le tapis. Seule l’existence de contre-pouvoirs permet de rendre l’écoute opposable. Il faut donc que les témoignages comme les mobilisations permettent d’alimenter des contre-pouvoirs pour peser sur les choix d’action publique. Ils sont le moyen de rappeler l’importance du “pas pour nous sans nous” qui mobilise l’action citoyenne. Dans un monde où tout le monde ne veut voir que des solutions, il faut rappeler que celles-ci n’existent pas sans revendications. L’acteur public ne devrait pas tant chercher des solutions, que confronter les revendications.
Négocier plutôt que gérer
“Pour rendre l’action publique plus démocratique, ce n’est pas la place des citoyens qu’il faut interroger, mais celle de leurs représentants”, expliquent Loisel et Rio. Pour eux, il y a un malentendu sur la fonction des élus. Il faut réhabiliter leur fonction délibérative, plaident-ils, en montrant que la délibération politique, c’est-à-dire le débat contradictoire qui précède la prise de décision, est quasi inexistante. Partout, les instances démocratiques deviennent de plus en plus des chambres d’enregistrement qui n’ont plus prises sur les enjeux, à l’image des tristes séances de conseils municipaux où s’égrainent une suite sans fin de délibérations. Les décisions se passent ailleurs. Dans des bureaux, dans des négociations opaques. Partout, les décisions semblent déjà prises.
Si la proposition est forte, il me semble ici que l’on trouve l’une des rares faiblesses du livre, qui semble minimiser la politisation des élus, leurs convictions qui pèsent sur les choix auxquels ils procèdent. Les faire passer du rôle de manager, de chef de projets qui ont tout pouvoir à un rôle de diplomates, de négociateurs avec les parties prenantes est une proposition très stimulante et idéale. Ce n’est effectivement qu’en invitant les différents points de vue à s’exprimer, à dialoguer, à trouver des compromis qu’on pourra lever les blocages de nos sociétés. Mais ce n’est pas le rôle que leur confèrent nos institutions pour le moment. Loisel et Rio illustrent cela en évoquant les problématiques de l’accès à l’eau qui aujourd’hui se règle sans que les débats entre les acteurs (citoyens, industriels, agriculteurs…) ne soient organisés. Sans organiser les confrontations, les blocages l’emportent. Les objectifs restent cantonnés dans des documents stratégiques sans capacité à les atteindre. Les enjeux de mise en œuvre sont trop souvent négligés. “L’action publique est avant tout une affaire de négociation”. Sur la question de la raréfaction de l’eau, la baisse des consommations ne se décrète pas, elle se négocie, au risque sinon de ne jamais atteindre les objectifs qu’on se fixe. “Démocratiser l’action publique, c’est passer de la concertation à la négociation”.
Pour Loisel et Rio, nous devons sortir de l’obsession du consensus pour trouver les modalités concrètes des compromis. Pour cela, la démocratie doit savoir organiser la confrontation d’intérêts divergents. C’est pourtant bien par le compromis qu’on amène chacun à s’engager et donc à obtenir des engagements opposables, c’est-à-dire qui permettent d’obliger ceux qui ne les respectent pas. Dans le domaine de la gestion de l’eau, “la démocratie ne peut pas se réduire à une somme d’arrêtés préfectoraux de restrictions, appliqués à géométrie variable en fonction du poids de chaque lobby sans aucun processus de délibération”. Il nous faut sortir de la gestion de crise permanente que produit l’évitement démocratique. Le politique doit revenir à la table des négociations pour faire discuter les acteurs concernés, afin que chacun puisse préciser leurs contributions effectives. “Les institutions sont là pour organiser la confrontation publique des intérêts privés”. Ce qui n’est pas si simple quand nos institutions favorisent aussi l’accès au pouvoir de représentants de ces intérêts particuliers.
*
Manon Loisel et Nicolas Rio signent une belle défense d’une démocratie vivante à un moment où elle semble si épuisée, depuis une analyse puissante et concrète des blocages politiques où nous sommes coincés. Les revendications que formule le livre ne sont pas simples à mettre en œuvre. Elles ne consistent pas à sortir des solutions (même s’ils en font plusieurs, par exemple d’améliorer la représentation par le tirage au sort depuis le niveau d’absentéisme pour corriger le déficit de représentativité), mais à nous interroger sur comment dépasser les blocages de nos société et le risque d’une dérive autoritaire. En cela, c’est un livre qui nous montre comment sortir de trop d’échecs démocratiques.
L’ouvrage n’en est pas moins assez idéaliste parfois et semble minorer le fait que la politique soit d’abord des positions politiques qui s’affrontent. Le déni de certaines positions ne se résoudra pas seulement par le retour de la négociation, mais d’abord par le retour d’une affirmation de la légalité des contre-pouvoirs. Or, c’est bien ces garanties démocratiques qui sont mises à mal, notamment quand on interdit de manifester ou qu’on surcontrôle certaines manifestations plutôt que d’autres afin de rendre la contestation impossible. Loisel et Rio militent pour plus de représentation, plus de garantie et de pouvoir à ces représentations, alors que nous assistons depuis trop longtemps à l’exact inverse. La dévitalisation de notre démocratie représentative reste, quoi qu’on en dise, d’abord la conséquence d’un recul des fonctions représentatives.
Derrière le paravent participatif, trop souvent, c’est la représentativité qui est mise à mal. Loisel et Rio ne souhaitent pas se débarrasser de la démocratie avec l’eau du bain de la démocratie participative, au contraire. Ils font le constat que le développement de la démocratie participative est un écran de fumée et que c’est la démocratie qu’il faut défendre. Pour cela, il faut renforcer les garanties, les contre-pouvoirs, la représentativité quand ce sont elles qui se délitent. Loisel et Rio nous invitent à un “réarmement” démocratique, qui me semble le réarmement dont on manque le plus. Ils nous montrent également que celui-ci ne passe pas nécessairement par de nouveaux droits, mais par la capacité à trouver les moyens de les rendre plus effectifs qu’ils ne sont.
En regardant la liste des autorités administratives indépendantes, je me dis qu’il y a encore bien trop de secteurs qui n’en disposent pas. A l’heure où les associations, représentants professionnels et syndicats sont à la peine (ce qui ne doit pas nous dispenser de trouver les modalités pour les renforcer plutôt que les dévitaliser !), avoir des autorités indépendantes qui viennent les renforcer (voir des déclinaisons locales) est une perspective plutôt stimulante, pour autant que ces autorités soient dotées de moyens, de droits et de capacités d’action. Dans le numérique, cela permettrait en tout cas d’aller plus loin que les conseils de surveillance, les comités d’éthique et les rapports de transparence… à défaut d’avoir une vraie représentation des parties prenantes, on pourrait au moins envisager des autorités indépendantes avec des capacités d’écoutes, d’actions et de contrôle des réponses apportées.
Hubert Guillaud
A propos du livre de Manon Loisel et Nicolas Rio, Pour en finir avec la démocratie participative, Textuel, 2024, 18,9 euros, 192 pages. A compléter par leurs riches interviews chez Autrement Autrement, Acteurs Publics ou Médiapart…
26.01.2024 à 09:31
Au fond du trou extractiviste
Hubert Guillaud
Texte intégral (3317 mots)
Il faut beaucoup de courage au lecteur pour descendre dans les profondeurs du livre de la journaliste Celia Izoard, La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l’ère de la transition (Seuil, 2024, 342 p, 23 euros). Du courage parce que c’est un livre qui dresse des constats éprouvants pour comprendre le monde. Le livre parle très concrètement de l’extractivisme, du capitalisme, des mines, de notre voracité sans limite et de ses conséquences.
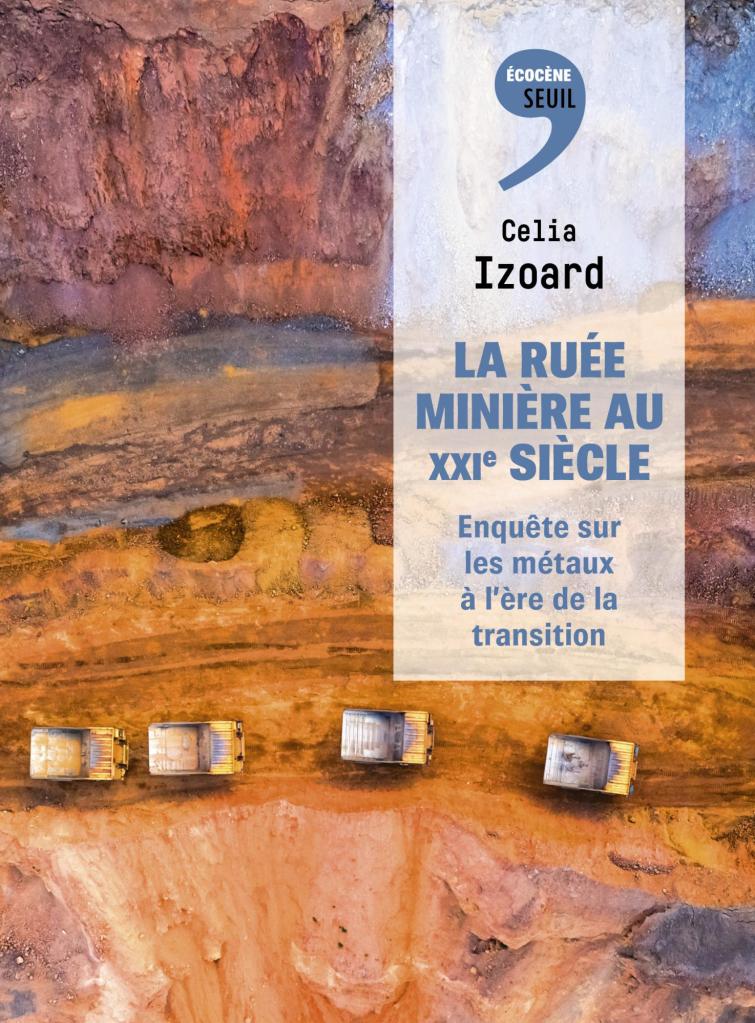
La mine du XXIe siècle ne ressemble plus à Germinal. Plus grand monde ne descend dans des fosses. Désormais, nous arrasons les montagnes. Nous broyons les roches. Nous construisons des bassins de déchets que nous ne savons pas gérer, irréversiblement toxiques et très sensibles au changement climatique. Les accidents liés à ces bassins et digues de rétentions des déchets sont innombrables, tant et si bien qu’il faut considérer cette pollution et ces accidents comme faisant partie de l’extractivisme minier… Les ruptures, les coulées, les “liquéfactions instantanées”, les conséquences de la pollution sur les populations… sont parmi les passages les plus glaçants du livre… nous rappelant que le monde industriel propose toujours des solutions à court terme et crée des problèmes à très long terme.
L’impératif minier crée des états d’exception pas des zones de responsabilité
Contrairement aux mythes de la dématérialisation et de la désindustrialisation, nous n’avons jamais autant extrait de métaux et nous prévoyons d’en extraire plus encore. Nous ne sommes pas dans l’après-mine, mais au contraire dans une relance minière inédite, plus vorace et extractive qu’elle n’a jamais été. Cet extractivisme sans précédent a trouvé une nouvelle justification explique la journaliste : l’extractivisme renforcé est le moyen pour assurer la transition bas carbone, qu’importe si en réalité cette transition est un leurre. Assurer la transition est la nouvelle idéologie qui succède au Salut ou au Progrès et qui justifie plus avant l’accumulation et l’artificialisation du monde. Comme les précédentes, elle fonctionne sous le régime de la promesse pour acheter le statu quo, explique-t-elle très pertinemment. Le livre de Celia Izoard est rempli de chiffres qui donnent le tournis pour nous rappeler combien notre monde extractiviste est insoutenable. Mais surtout, sa grande force est de nous amener jusque dans les mines elles-mêmes, pour nous montrer leurs fonctionnements et leurs terribles effets. Elle explique que contrairement à ce que nous font croire quelques données peu informées, nous n’allons en rien vers des mines responsables. Toutes produisent des catastrophes écologiques, à l’image du projet Montagne d’Or en Guyane qu’elle avait documenté dans un formidable numéro de la revue Z. “L’après-mine est déjà une autre planète, faite de main d’homme”. Mais c’est une planète stérile, toxique, invivable. Avant de terraformer Mars, nous stérilisons notre propre planète. La mine industrielle ne cohabite avec aucun être vivant. Elle participe au dérèglement climatique et est très sensible à celui-ci, à l’image des innombrables ruptures des barrages de résidus, ces montagnes de déchets broyés qui n’ont plus de roches pour résister à l’action du temps. Les données numériques convoquées pour la surveillance ne servent qu’à améliorer encore les rendements, qu’à diminuer encore les coûts d’exploitation, sans rapport aucun avec leur coût environnemental. Les innovations dans la mine ne la rendent pas plus responsable, elles la rendent plus efficace. Elles permettent de creuser plus et plus vite avec moins de main-d’œuvre, comme l’expliquent les dossiers de l’association SystExt. Le modèle minier se “radicalise bien plus qu’il ne se responsabilise”. Et “plus la teneur des gisements baisse, plus la mine est polluante”.
La relocalisation des mines en Europe, au prétexte d’une souveraineté pour la transition, n’assure que d’une bien faible responsabilité réglementaire. Elle ne vise qu’à étendre encore notre voracité puisque nul ne parle de fermer ailleurs les mines qu’on réouvrirait ici. Il ne s’agit que “d’une course à la délocalisation des émissions carbones”. Pourtant, en matière de responsabilité, c’est l’inverse auquel on a assisté, explique-t-elle. La réforme des codes miniers imposés par le FMI et la Banque mondiale aux pays du Sud endettés a levé les législations protectrices à l’égard de la main-d’œuvre et de l’environnement. L’extractivisme s’est renforcé avec la dette. Les plans du FMI et de la Banque mondiale ont imposé la privatisation des mines, le gel des lois sur le travail et l’environnement… Elles ont développé la mine géante, exemptée de taxes, et ont facilité l’accès aux zones minières et les investissements étrangers. Là où les mines se sont étendues, la pauvreté n’a pas été réduite, les revenus de l’extraction n’ont pas profité aux communautés. Au contraire. Elles ont produit de nouvelles “zones de sacrifices” environnementales ! L’impératif minier crée des états d’exception pas des zones de responsabilité.
Le pillage des ressources de l’ère coloniale a continué sous forme d’une reconquête. Cette délocalisation a permis d’éteindre les luttes ouvrières des anciens bastions miniers et de désarmer les contestations des mouvements environnementaux des pays riches. Les problèmes ont été laissés aux sous-traitants, comme le disait avec cynisme Michael Scott, PDG d’Apple. Au XXIe siècle, avec la hausse des coûts des matières, la matérialité de notre monde s’est rappelée à nous. La Chine a diminué ses exportations, la pénurie minière s’est fait sentir. Derrière la fable des métaux pour la transition, la réalité de la mine est qu’elle est bien plus au service de la Défense et du capitalisme numérique que de la transition écologique. La transition semble surtout un paravent qui ne sert qu’à “justifier l’accélération du modèle extractiviste”.
Le régime minier : un régime de sacrifices
Izoard nous rappelle que le capitalisme est l’histoire d’une civilisation extractiviste. Nous sommes le produit d’un régime minier, d’une guerre contre la nature qui consiste à construire un monde hors-sol. La croissance industrielle est devenue l’objet même de la politique.
La nouvelle promesse de relocaliser les mines pour assurer notre souveraineté et une meilleure responsabilité tient de la fable, tance Izoard. Les déchets et leur toxicité ne sont pas compressibles. Et à mesure que nous exploitons des gisements avec moins de teneurs en métaux nous produisons encore plus de déchets. Là où elles existent ou s’installent, les mines dévorent leur environnement, assoiffant et empoisonnant les communautés locales. Le modèle minier a toujours fonctionné sur la dépossession et le sacrifice des populations, à l’image des constats éprouvants qu’elle dresse de la mine “responsable” de Bou-Azzer au Maroc. Les labelisations de responsabilisation sont des coquilles vides produites par des ensemble de données “qui n’ont jamais vu la moindre population”. La réalité de la mine reste invisible, opaque. Nous ne connaissons même pas le nombre de mines réellement en exploitation de part le monde. Malgré une automatisation sans précédent, la mine est responsable de 8% des accidents mortels au travail, alors qu’elle n’emploie que 1% de la main-d’œuvre mondiale.
La mine a été l’activité coloniale par excellence. Elle le reste. Elle a été la matrice du capitalisme. Longtemps exploitées par des communautés villageoises sous formes de guildes puissantes, l’augmentation de la demande à la fin du XVe siècle va nécessiter des équipements plus coûteux pour creuser plus profondément… et va conduire les organisations de mineurs à ouvrir la propriété des mines pour obtenir des capitaux. A la fin du XVe siècle, les compagnies de mineures étaient devenues des sociétés par action, bien avant la création de la Compagnie anglaise des Indes orientales en 1600. Dès le XVIe dans ces mines de Saxe, de Bohème et du Tyrol sont introduites les premières machines. Là où le capital se répand, l’intensification de la rentabilité suit… Sauf qu’elles s’épuisent également et deviennent moins rentables. On comprend alors l’appel d’air que constitua la découverte de l’Amérique, qui va devenir une mine à l’échelle du continent, une “économie minière esclavagiste”. “Un siècle après le premier voyage de Colomb, les principaux centres miniers de la planète s’étaient déplacés de l’Europe centrale à l’Amérique, où ils pouvaient se développer hors de toute contrainte sociale grâce aux régimes d’exception esclavagistes de la Conquête.” En retour, cet extractiviste va produire les capitaux pour l’essor industriel européen. Les systèmes extractifs se généralisent. Les régimes d’exceptions miniers que l’on retrouvait sur des fronts pionniers, sont intégrés au fonctionnement normal de la production. La machine à vapeur de Watt sert d’abord à évacuer l’eau des mines puis le minerai, bien avant que de faire avancer un train. La violence sociale du monde colonial va être rapatriée dans le monde minier. “La main-d’œuvre aussi est un minerai que l’on peut broyer”. Le courant industrialiste s’impose, alliance inédite entre l’Etat, la bourgeoisie et la science. La loi donne à l’Etat le droit de disposer du sous-sol. Nous passons d’un régime agraire à un monde minier… Et nos légumes désormais doivent moins à la terre “qu’à la production de pétrole et d’engrais phosphatés.” L’extractivisme est devenu notre matrice de développement, qu’importe s’il produit sur terre des conditions d’hostilité totale à la vie.
Ralentir ou Périr
Dans la dernière partie, Izoard ne se dérobe pas. Elle tente d’esquisser des solutions du tableau apocalyptique qu’elle a dressé. Le régime minier, extractiviste, est en train de se renforcer et de se radicaliser plus que de s’éloigner. Il s’étend, notamment à l’eau. Pour la journaliste, “il n’y aura pas de solution minière à la crise climatique”.
Pour la journaliste, il nous faut trouver les moyens d’une désescalade de la consommation de métaux. Nous ne devons pas attendre de passer le pic productif. “Le spectre de la pénurie a plutôt pour effet d’encourager la spéculation et l’exploration minière”. La décroissance de l’extraction ne doit pas attendre la déplétion physique des matières : elle demeure une décision politique, un rapport de force. La perspective d’un meilleur recyclage est également compliquée, notamment du fait de la dispersion des minerais dans les produits. Pour l’instant, elle peut certes être améliorée, mais les progrès sont difficiles du fait de la dégradation des matériaux, des pertes fonctionnelles et surtout de la toxicité du recyclage. Le recyclage reviendrait à construire des mines urbaines tout aussi problématiques que les mines lointaines quant à leurs besoins en eau, en énergie et à leur production de polluants.
Pour Izoard, la décroissance minérale est notre seule perspective. Mais elle n’est pas acquise. “Pour quiconque réfléchit à l’écologie, il est gratifiant de pouvoir proposer des remèdes, de se dire qu’on ne se contente pas d’agir en négatif en dénonçant des phénomènes destructeurs, mais qu’on est capable d’agir de façon positive en énonçant des solutions. Le problème est que dans ce domaine, les choses sont biaisées par le fonctionnement de la société”. Dans les années 70, les mouvements écologistes ont dénoncé la société fossile et nucléaire et ont défendu des techniques alternatives comme l’éolien ou le solaire. Ils combattaient la surconsommation d’énergie, mais ce n’est pas elle que nos sociétés ont retenues. Le capitalisme a adopté “les alternatives techniques en ignorant le problème politique de fond qui remettait en question la croissance industrielle”. Les éoliennes et centrales solaires à petites échelles sont devenues des projets industriels. La sobriété et la décroissance ont été oubliées. “Avant de se demander comment obtenir des métaux de façon moins destructrice, il faut se donner les moyens d’en produire et d’en consommer moins”. C’est bien notre société qu’il faut changer. Et nous n’avons pas vraiment fait de pas dans la direction de la sobriété, comme le remarquait l’historien Jean-Baptiste Fressoz, qui constate également, dans Sans transition qui paraît au même moment, que le discours sur la transition dépolitise la question climatique.
Pour Izoard, la mine responsable est une “chimère bureaucratique”. Les règlementations et les remèdes technologiques ne rendront pas viables, responsables ou éthiques, les mines industrielles. “Les problèmes qu’elles posent ne sont pas des anomalies, mais le fruit d’un système”. Il n’est pas possible d’exploiter des gisements avec si peu de matières sans créer des problèmes insurmontables. En 2017, le Salvador a interdit l’exploitation de mines métalliques afin de préserver l’eau, dans un pays où 90% des sources sont polluées. “La meilleure stratégie pour s’opposer à la mine industrielle semble consister à obtenir des décisions démocratiques”, comme le montrent toutes les luttes du continent américain, où plusieurs pays, suite à référendums ont fait fermer des mines. Il nous faut augmenter le coût financier, moral et politique de l’extraction, plaide Izoard. La mine industrielle a une faiblesse : elle est très coûteuse en infrastructure et une fois construite, son exploitation doit être garantie et ne plus être contestée. Mining Watch Canada et le London Mining Network travaillent eux à rendre visible la prédation en allant aux AG des extracteurs pour y porter la parole des communautés locales qui subissent les effets de l’activité minière.
Nous avons besoin d’un sevrage métallique et énergétique. Nous avons sur-minéralisé notre quotidien, à l’image de notre emblématique smartphone qui concentre plus de 50 métaux en son cœur, disséminés dans plus de 80 composants différents. Les tentatives de Fairphone de pousser le recyclage et augmenter la durée de vie de ses appareils montrent surtout combien ce rêve est impossible. On ne peut pas produire de téléphone hors de l’écosystème industriel. “Dès qu’on prend au sérieux la question des métaux, la croissance effrénée du monde connecté devient un problème central”. Et la journaliste d’inviter à produire des bilans métaux comme nous produisons des bilans carbones, afin de mieux souligner la surconsommation de métaux, trop absente du débat public, où l’on parle bien plus de reconquête industrielle et minière que de sobriété… et en explorant plus avant la distinction à produire entre émissions de luxe et émission de subsistance, comme y invite Andreas Malm dans Comment saboter un pipeline, ou encore en démultipliant les conventions citoyennes pour le climat et la décroissance… “Tant que la décroissance n’arrivera pas à s’imposer comme mot d’ordre, urgent et impératif, le capitalisme industriel continuera d’interpréter les revendications des mouvements sociaux comme des défis techniques”. “On ne peut pas se satisfaire d’améliorer l’efficacité énergétique du stockage de données tant que le trafic internet augmente de manière exponentielle. On ne peut pas continuer de déployer en masse des satellites en se disant qu’une partie d’entre eux permettront de mieux comprendre la déforestation…” Nous devons sortir des cages dorées qui nous rendent aveugles aux finalités. “La technique doit sortir de deux siècles d’envoûtement extractiviste”.
*
Le livre de Célia Izoard est éprouvant, mais il est aussi mobilisateur. C’est aussi un manuel pour armer les luttes contre l’extractivisme à venir. Les mines ne sauveront pas la planète. Notre difficulté consiste à nous opposer à cet extractivisme. Dans les mines modernes, l’automatisation a fait disparaître le rapport de force social qui existait, comme on le trouve dans Germinal. Ce ne sont plus les populations employées qui peuvent s’opposer au minage, mais celles qui sont sacrifiées par les impacts de la mine. Ce déplacement de la lutte sociale à la lutte environnementale, des luttes locales aux luttes lointaines, explique certainement nos difficultés à réduire leur déploiement, car elle nécessite une mobilisation plus large. Nous devrions être concernés par ce qu’il se passe à Bou-Azzer au Maroc, à Butte dans le Montana, à Rio Tinto en Andalousie… Ce n’est pas le cas.
La ruée minière au XXIe siècle regarde le monde tel qu’il est. Et il n’est pas beau.
Hubert Guillaud
A propos du livre de Célia Izoard, La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l’ère de la transition, Seuil, “Ecocène”, 2024, 342 p, 23 euros.
- Persos A à L
- Carmine
- Mona CHOLLET
- Anna COLIN-LEBEDEV
- Julien DEVAUREIX
- Cory DOCTOROW
- Lionel DRICOT (PLOUM)
- EDUC.POP.FR
- Marc ENDEWELD
- Michel GOYA
- Hubert GUILLAUD
- Gérard FILOCHE
- Alain GRANDJEAN
- Hacking-Social
- Samuel HAYAT
- Dana HILLIOT
- François HOUSTE
- Tagrawla INEQQIQI
- Infiltrés (les)
- Clément JEANNEAU
- Paul JORION
- Michel LEPESANT
- Persos M à Z
- Henri MALER
- Christophe MASUTTI
- Jean-Luc MÉLENCHON
- MONDE DIPLO (Blogs persos)
- Richard MONVOISIN
- Corinne MOREL-DARLEUX
- Timothée PARRIQUE
- Thomas PIKETTY
- VisionsCarto
- Yannis YOULOUNTAS
- Michaël ZEMMOUR
- LePartisan.info
- Numérique
- Blog Binaire
- Christophe DESCHAMPS
- Louis DERRAC
- Olivier ERTZSCHEID
- Olivier EZRATY
- Framablog
- Tristan NITOT
- Francis PISANI
- Irénée RÉGNAULD
- Nicolas VIVANT
- Collectifs
- Arguments
- Bondy Blog
- Dérivation
- Économistes Atterrés
- Dissidences
- Mr Mondialisation
- Palim Psao
- Paris-Luttes.info
- ROJAVA Info
- Créatifs / Art / Fiction
- Nicole ESTEROLLE
- Julien HERVIEUX
- Alessandro PIGNOCCHI
- Laura VAZQUEZ
- XKCD