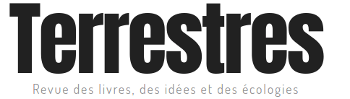Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique
23.05.2025 à 13:59
Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis
Laurence Marty
Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.
L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (8598 mots)
Temps de lecture : 19 minutes
Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».
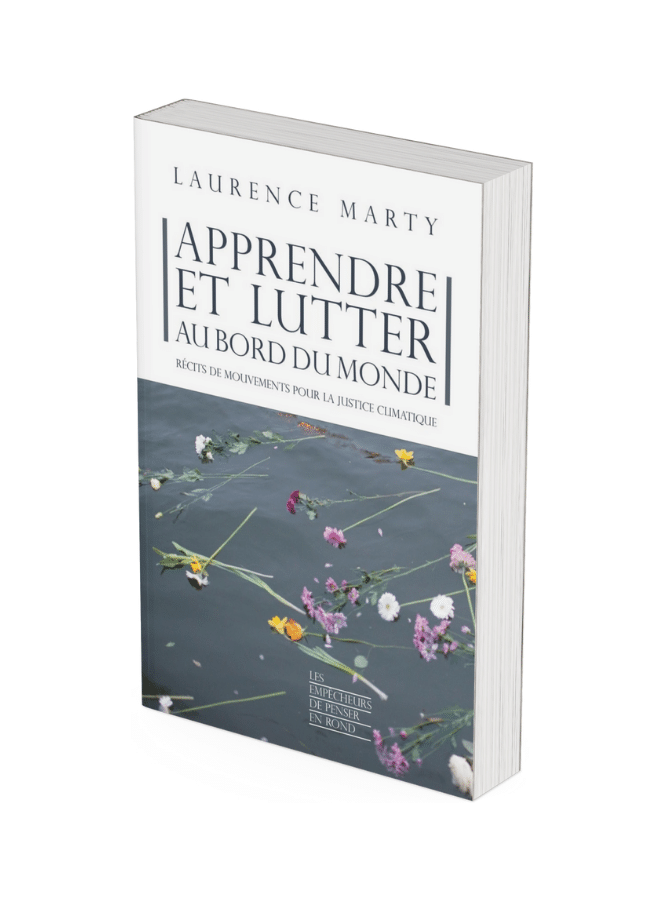
Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis
Mercredi 24 septembre 2014, 20 h 30, Saint‑Denis, 42 rue de la Boulangerie, première réunion du collectif Toxic Tour Detox 93 (TTD93). Pour suivre l’émergence du cadrage de la justice climatique au sein du mouvement français, il nous faut repartir de la fin de l’été 2014, un an et demi avant la COP21. C’est en suivant les liens tissés à l’Aubépine – un lieu de vie collectif agricole – et en rejoignant le TTD93 que je serai confrontée pour la première fois à cette façon particulière de penser le dérèglement du climat et les questions environnementales avant tout comme des questions de justice – de race, de classe, de genre. Pour l’heure, j’ignore encore ces déplacements et même comment m’orienter dans Saint‑Denis : la nuit est en train de tomber et moi de me perdre dans les ruelles dionysiennes. Je finis par trouver le 42 rue de la Boulangerie, avec une dizaine de minutes de retard. On dirait une sorte d’épicerie, une épicerie bio, ou de produits locaux peut‑être. La réunion n’a pas commencé, mais dans l’arrière‑boutique, une petite vingtaine de personnes sont déjà assises autour de tables disposées en rectangle. Je trouve une chaise et m’assois, intimidée. Le point de départ du collectif, comme l’expliquent Agathe, Éric et George ce soir‑là, c’est que le sommet Paris climat 2015, cette grande conférence internationale censée déboucher sur un nouvel accord mondial dans un an et demi ou COP21, ne se tiendra pas à Paris comme son nom l’indique, mais au parc des expositions du Bourget, en Seine‑Saint‑Denis – ici. Or, les habitant·es de ce département, parmi les plus pauvres de France, sont aussi victimes d’inégalités environnementales (sols pollués par son passé industriel, pollution de l’air causée par la circulation automobile et le trafic aérien, précarité énergétique, pollution sonore, résidus radioactifs) et, de plus en plus, d’inégalités climatiques.
« Nous savons que le dérèglement climatique n’est pas qu’un problème de suraccumulation de particules de CO2 en 2100 : c’est une urgence sociale et de santé dès aujourd’hui », écriront sur tous leurs tracts les membres du TTD93. Ce qu’iels proposent de faire, en réponse, c’est d’organiser des visites guidées des lieux de pollution qui quadrillent le département – qui sont aussi des lieux d’émission de gaz à effet de serre et donc de dérèglement du climat –, et des opérations détox pour mettre en avant les luttes et alternatives des Séquano‑Dionysien·nes1 d’hier et d’aujourd’hui. Éric le répète souvent, c’est important de montrer le positif : « Le sentiment que c’est mort n’a jamais été très mobilisateur2. » Si iels savent qu’« à la fin du sommet, les décisions prises ne seront pas les bonnes », les membres du TTD93 sont déterminé·es à faire entendre leurs voix à travers les « déambulations informatives, rageuses et joyeuses » qu’iels vont organiser jusqu’à la COP3.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Comme le raconte George ce soir de septembre, ignorer que la Seine‑Saint‑Denis est un territoire pollué est une chose impossible pour celles et ceux qui l’habitent. « Ce que nous connaissons moins, c’est la géographie de ces pollutions, l’histoire des infrastructures qui les produisent (bien plus nombreuses en Seine‑Saint‑Denis que partout ailleurs en Île‑de‑France), et celle des luttes contre leurs nuisances. » Ce que propose le TTD93 en conséquence, c’est d’apprendre, d’apprendre en marchant, en faisant l’expérience de – les toxic tours detox sont avant tout des « expériences sensibles » comme le rappellera Quentin au cours d’une réunion de décembre. La rencontre avec des collectifs agissant déjà localement sur ces enjeux de pollutions sera décisive dans ces apprentissages – du collectif Lamaze luttant pour l’enfouissement de l’autoroute A1 à Saint‑Denis au collectif Romeurope 93 qui défend les droits des personnes Roms vivant en squats ou bidonvilles, en passant par Urbaction 93 composé de riveraines de data centers à La Courneuve4. C’est avec elleux que le TTD93 élabore ses « balades toxiques » et pense les différentes prises de parole qui les rythment. Elles porteront successivement sur l’autoroute A1, la mémoire des luttes écocitoyennes dans le 93, les data centers de La Courneuve, l’aéroport d’affaires du Bourget, et les terres agricoles du Triangle de Gonesse menacées par le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity.

Il y a des découvertes qui feront date pour le collectif, tant elles résument à elles seules ce qu’il essaie de démontrer : la station de mesure d’Airparif, qui en bordure de l’autoroute A1, en plein Saint‑Denis, enregistre les taux les plus élevés de pollution d’Île‑de‑France5 ; la note de l’Agence de l’énergie et du climat de Plaine Commune sur les enjeux locaux de la crise climatique qui révèle que la Seine‑Saint‑Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité pendant la canicule de 20036 ; entre autres. De quoi rendre tangible l’intuition, que oui, ici aussi, pollution et dérèglement climatique sont des inégalités de plus. À Agathe d’en conclure, un soir d’avril 2015 où elle présente les actions du collectif dans un théâtre parisien, que « dans les quartiers de la Seine‑Saint‑ Denis comme dans les autres régions pauvres du monde, on peut dire que les injustices environnementales et climatiques s’ajoutent aux injustices sociales, qui sont beaucoup aussi des injustices raciales et des injustices de genre ».
Lire aussi sur Terrestres : Margaux Le Donné et Enno Devillers-Peña, « Où est la maison ? Ende Gelände : récit d’une excursion », novembre 2019.
Je sors de la réunion du 24 septembre 2014 avec le sentiment que ce qui se trame ici est important : j’y découvre pour la première fois les termes d’« inégalités environnementales » et d’« inégalités climatiques » dont le cadrage m’aimante – j’écris dans mon carnet le soir même (non sans en sourire aujourd’hui) : « Ça, c’est légitime politiquement et mobilisateur. » Dans l’arrière‑boutique le soir de cette première réunion, se trouvaient réuni·es des activistes du climat et des habitant·es en lutte contre les infrastructures qui les empoisonnent, une cohabitation que je n’avais jamais vue jusque‑là. Par chance, j’habite aussi le 93 – à l’est et non au nord, mais dans le 93 quand même. Je trouverai rapidement une place au sein du collectif en construction. Sous l’impulsion d’Éric, je proposerai notamment, en décembre, de me lancer dans une brochure qui reprendrait les principaux éléments des tours et qui serait, de fait, aussi une brochure sur les inégalités environnementales et climatiques qui touchent le département.

Il me faudra plusieurs mois, la tête dans le guidon à parcourir en long et en large la Seine‑Saint‑Denis et avaler des kilomètres de littérature scientifique francophone émergente7), pour m’apercevoir de l’épaisseur des luttes pour la justice environnementale et climatique dont le TTD93 s’inspire, et dont nous n’avons que si peu hérité jusqu’ici, en France. Ce n’est pas faute d’avoir mentionné ces luttes en chaque début de balade. À George de contextualiser le modèle des toxic tours au cours du premier tour sur « l’autoroute de Saint‑Denis », le dimanche 26 octobre 2014, armée d’un mégaphone pour couvrir les bruits de la circulation autour de la place de la Porte de Paris :
« Les toxic tours, c’est un format qui existe depuis une vingtaine d’années dans d’autres pays : aux États‑Unis, au Canada, en Équateur, en Afrique du Sud, entre autres – d’où leur nom anglais. Ces tours font partie d’un mouvement plus général qui s’appelle le mouvement pour la justice environnementale. »
« Ramener l’écologie à la maison » n’a rien d’anecdotique. Surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.
Pourtant, ce n’est qu’en lisant quelques mois plus tard l’article de la philosophe Émilie Hache « Justice environnementale ici et là‑bas » que je comprendrai les spécificités et l’ampleur de ce que déplace le mouvement pour la justice environnementale dans les luttes écologistes8. De cette lecture et de celles qui suivront, je comprendrai combien cela n’a rien d’anecdotique de « ramener l’écologie à la maison » pour reprendre les mots de la sociologue Giovanna Di Chiro9 – du moins de la ramener dans le territoire dans lequel on vit, surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

L’histoire des militant·es du mouvement pour la justice environnementale est celle d’une double dépossession pour reprendre les mots d’Émilie Hache : « dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ». Elle raconte comment, dans les années 1990, des membres d’une mobilisation contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue de Los Angeles – principalement des femmes racisées de classe populaire – allèrent solliciter l’aide d’associations environnementales états‑uniennes très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental Defense Fund (le Fonds pour la défense de l’environnement), qui leur répondirent dans un premier temps que leur combat portait sur des questions de santé publique, et non environnementales, et leur refusèrent dès lors leur soutien.
Les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de la justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » […] loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent.
Emilie Hache
Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes.
Exit une écologie par le haut et le dehors, centrée sur la « nature » – ou wilderness – des grandes organisations conservationnistes composées essentiellement d’hommes blancs de classes moyenne et supérieure – que Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier appellent « l’environnementalisme des riches »10. Welcome une écologie par le milieu, grassroots (littéralement enracinée dans le sol), portée principalement par des femmes racisées de milieu populaire luttant pour leur survie et celle de leurs enfants – celle de leur communauté humaine et plus‑qu’humaine – contre les industries et les politiques qui ne semblent pas considérer que leurs vies comptent11.
Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes12. Le mouvement pour la justice climatique transnational, qui se compose à partir des années 2000, reprend ce double renouvellement. C’est de ces déplacements que le TTD93 tente de s’inspirer.

Parce qu’il est l’un des collectifs français qui a le plus à cœur d’importer et de traduire ce qui se trame dans les mouvements pour la justice environnementale et climatique transnationaux, le TTD93 est une source d’intérêt pour de nombreux·ses militant·es. Il y a toutes les personnes qui viennent marcher avec nous les dimanches après‑midi des balades toxiques (une soixantaine par tour en moyenne, parfois plus). Il y a toutes les sollicitations de collectifs qui souhaitent reproduire le format des toxic tours ailleurs. Et il y a les invitations de différents membres de la Coalition Climat 21 (CC21) à venir rejoindre la préparation des mobilisations qui auront lieu pendant la COP21. Pour Agathe, « c’est le côté grassroots qui leur parle, et aussi le fait que des actions du style toxic tour et le travail que l’on fait sur les inégalités pourraient plaire à des organisations internationales pour la justice environnementale ». Surtout, ce que tente de faire le TTD93 fait écho aux « chantiers » que se donne la CC21 pour décembre prochain : élargir la mobilisation, en convainquant « bien au‑delà des cercles habituels de l’écologie » (et tenter de ne plus être que ce mouvement climat majoritairement blanc de classes moyenne et supérieure) ; et « s’appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain » ou « communautés impactées » (la traduction la plus courante de « frontline communities » centrale dans le mouvement anglo‑saxon). Je saisirai l’enjeu immense pour certain·es membres de la coalition de ne pas/plus faire sans ces personnes et de transformer le mouvement climat en profondeur pour laisser émerger celui d’une justice climatique.
Lire aussi sur Terrestres : Alyssa Battistoni, « Le Léviathan et le climat », septembre 2019.
Il y a ce vif intérêt dans le mouvement pour l’espace d’enquête, d’apprentissage et de mobilisation autour de la justice climatique que constitue le TTD93, et il y a aussi les critiques qui lui seront adressées, et dont je mettrai plus de temps à percevoir les échos. De l’enthousiasme, certain·es militant·es passent à la condamnation après avoir participé à un tour (ou avoir entendu quelqu’un parler d’un tour) : les toxic tours ressembleraient à des « groupes de touristes bobos blancs en balade dans le 9‑3 ». Je caricature, mais pas tant que ça : on reproche au collectif TTD93 de manquer son objectif de « sortir de l’entre‑soi », de ne pas réussir à mobiliser les « premier·es concerné·es » par les pollutions et les inégalités qu’il dénonce, et d’être dès lors « hors‑sol » (par opposition à « grassroots », ce pour quoi il était potentiellement intéressant plus tôt). Comme si les membres du TTD93 n’étaient pas conscient·es de ce risque dans leur démarche et que ce n’était pas une tension pour elles et eux.

Mardi 4 novembre 2014, 20 heures, troisième réunion du TTD93, dans une grande salle illuminée aux néons du bâtiment colossal qu’est la Bourse du travail de Saint‑Denis. Sont présent·es les membres du TTD93 ainsi que des représentant·es du collectif Lamaze et du comité Porte de Paris, deux collectifs d’habitant·es de quartiers riverains de l’A1, avec qui le premier tour a été organisé. On débriefe. Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » – on était presque une centaine, des élus et des médias étaient présents, les différentes prises de parole se sont bien articulées, le goûter au parc Cachin était une très belle façon de conclure le tour – mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric. Je me souviens notamment d’une silhouette aperçue derrière une fenêtre des premiers étages d’une tour semblant épier notre cortège qui contrastait fortement avec le peu de personnes marchant dans les rues et boulevards que nous arpentions. Je me souviens plus encore de notre stationnement le temps d’une prise de parole au niveau d’un carrefour de l’avenue du Docteur‑Lamaze qui était lui, très passant, et des différentes réactions qu’il avait suscitées chez les piétons (essentiellement des hommes noirs et arabes à ce moment précis) que nous avions croisés : celle de nous contourner (nous prenions presque toute la place), celle de prendre un tract sans s’arrêter, voire de le refuser (tracter, c’est la solution que nous avions trouvée avec Aldo pour endiguer notre gêne). Et je me souviens enfin de ce constat partagé avec Agathe à la fin du tour : la plupart des personnes présentes, à l’exception des membres des collectifs locaux, n’étaient pas des riverain·es mais des militant·es écologistes parisien·nes intéressé·es par notre démarche. Cet intérêt n’est pas un problème en soi (au contraire), le problème c’est ce à quoi il nous fait ressembler (effectivement) : un groupe de blanc·hes de classe moyenne en vadrouille dans des quartiers populaires habités majoritairement par des personnes racisées précarisées.
Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric.
Au cours de cette première réunion de débrief, on cherche des solutions pour faire le lien avec l’ensemble des habitant·es : on pourrait afficher sur le parcours au préalable, ou encore tracter tout au long de la marche. Didier, du collectif Lamaze, rappelle qu’on a tout de même distribué plus de trois mille tracts sur les marchés et dans des endroits clés de Saint‑Denis, et qu’on avait annoncé le tour dans le Journal de Saint-Denis, « le journal le plus lu de la ville », précise‑t‑il (il m’expliquera à la fin de la réunion que l’hebdomadaire est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des Dionysien·nes et est une véritable « institution »). George renchérit en soulignant que les toxic tours detox sont « un projet qui s’inscrit dans la durée ». « C’est l’accumulation des tours qui est importante ». Mais pour certain·es membres du collectif, on peut d’ores et déjà aller plus loin et travailler à construire davantage les balades avec les habitant·es des quartiers qu’on sillonne. Agathe évoque ainsi une piste pour le prochain tour sur l’A1 (le collectif Lamaze souhaiterait le reproduire lors de l’événement « Lamaze enlève tes bretelles » qui aura lieu fin juin13). Elle a rencontré le directeur d’une salle de spectacle de Saint‑Denis qui a grandi dans la cité Joliot‑Curie, située en bordure de l’autoroute. Il a proposé de nous mettre en contact avec les éducateur·ices de la cité qu’il connaît bien. Et c’est ce qu’on fera : plusieurs rencontres mèneront à l’organisation d’ateliers photos avec les enfants de la cité, une soirée sur le mouvement pour la justice climatique, et la prise de parole d’une mère et membre d’une association d’aide aux devoirs du quartier au toxic tour de juin.

Si les membres du TTD93 se mobilisent en tant qu’habitant·es de la Seine‑Saint‑Denis (« On se mobilise en tant qu’habitant·es, c’est le point de départ », répètent‑iels), iels ont aussi besoin de laisser la place et la parole à d’autres Séquano‑Dionysien·nes pour que les toxic tours detox fonctionnent (politiquement et pratiquement) : les collectifs de riverain·es des infrastructures dénoncées et, plus largement, les habitant·es des quartiers arpentés. Les savoirs et la légitimité des premiers (les collectifs locaux) sont indispensables pour construire les balades. Comme l’explique Éric au cours de la soirée « Toxic Tour Detox mode d’emploi » de mars 2015 dans un restaurant îlo‑dionysien : « On n’agit pas ex nihilo, on est contre ça. Et ce pour deux raisons : on veut rendre publics des collectifs et des structures qui ont déjà accumulé énormément de connaissances, et aussi parce qu’on ne vient pas en experts écolos. On fait les balades avec eux. » La présence des seconds (les habitant·es des quartiers arpentés en général) et le fait de les intéresser (du moins autant que les militant·es écologistes blanc·hes que nous sommes) sont, en revanche, toujours des défis à relever. Un défi incontournable si le TTD93 veut éviter que ses toxic tours detox soient des sortes de « zoo sociaux » pour reprendre l’expression de Luc, impliqué dans le collectif. Depuis ce rebord, les membres du collectif tentent des choses, ratent, essaient à nouveau, réussissent ou ratent encore – un processus qui se rejoue pour chaque nouvelle balade qui arrive avec le contexte et les enjeux qui lui sont propres.
Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis.
Il y a quelque chose de difficile à tenir pour le collectif TTD93, entre sa toute récente naissance, son énergie limitée, les attentes à son égard (que ce soit celles de ses membres ou celles d’autres activistes du mouvement climat) et son contexte politique. Il faut bien partir de quelque part pour construire un mouvement pour la justice environnementale et climatique en France, et la situation de laquelle part le TTD93 n’a rien d’évident : s’il rencontre des collectifs de riverain·es dénonçant les impacts (sociaux et de pollutions chimique comme sonore) des infrastructures dont ils sont voisins, aucun d’entre eux ne mobilise le cadrage de la justice environnementale et climatique (quasi inexistant en France à l’époque), ni ne se définit comme « communautés impactées ». Presque aucun d’entre eux ne fait le lien avec le dérèglement du climat avant sa rencontre avec le TTD93 (et l’arrivée de la COP21, en fait). Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis, sans tomber dans le piège de l’imposition d’un cadre surplombant et déconnecté14, ni dans celui de l’idée reçue que les enjeux environnementaux n’intéressent pas les habitant·es des quartiers populaires15. C’est à ce croisement que se trouve le pari des toxic tours. Ensuite, comme le rappelait déjà George pendant la réunion de novembre 2014, il faut du temps pour s’enraciner et trouver les façons de problématiser ensemble ce qui ne l’avait que peu été jusque‑là. C’est sûr que, d’ici la COP, ça va être juste pour « mobiliser les quartiers populaires » dans le mouvement climat (du moins massivement), et organiser une grande « marche des intoxiqué·es », de cette façon. C’est en tout cas l’avis d’autres activistes du mouvement qui tenteront d’ouvrir, en parallèle, d’autres sentiers.

Dans la suite du chapitre dont est extrait ce passage, Laurence Marty décrit l’émergence, tout au long de l’année 2015, d’un mouvement pour la justice climatique en France à l’image de celui qui s’étend en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde depuis les années 2000.
Des activistes membres de l’alliance de collectifs étasuniens Grassroots Global Justice viennent en Ile-de-France pour présenter leur action.
Un « Appel pour la justice climatique » est lancé depuis l’ONG 350.org, appelant à « partir des luttes qui se mènent dans les quartiers depuis des années ».
Une « marche mondiale pour le climat » est préparée à Paris sur le modèle de la People’s Climate March, qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New-York en 2014. Cette marche est annulée en raison des attentats du 13 novembre et de la promulgation de l’état d’urgence – à la place, une chaîne humaine est organisée à la hâte.
La COP21 passée, l’autrice revient sur une année et demi de mouvement.
À l’issue des mobilisations de la COP21, la question du sujet politique du mouvement naissant pour la justice climatique reste en suspens, comme le raconte l’une des salarié·es de la CC21 [Coalition Climat 21] à l’assemblée de bilan du mercredi 16 décembre, quelques jours seulement après la clôture des négociations et des manifestations : « Si l’organisation de la marche de New York nous a permis d’avancer plus vite en posant la question de qui sont les communautés impactées en France, elle reste irrésolue. » D’autres questions sont aussi posées : les organisations de la coalition sont‑elles parvenues à devenir une rampe de lancement pour un mouvement pour la justice climatique « fort et durable » en France16 ? Le mouvement est‑il parvenu à « sortir des cercles habituels de l’écologie » ? Comment prolonger les efforts faits pour « construire des espaces de convergence sociaux et climatiques » dans les mois à venir ? Ou encore : comment faire face à l’impensé colonial du mouvement ? Il est peut‑être encore un peu tôt pour répondre à ces questions, et ce que les militant·es se promettent surtout au cours de cette assemblée et ailleurs, c’est de poursuivre les efforts déployés dans ces directions. Nous sommes au début de quelque chose.
Image d’ouverture : photographie réalisée à l’occasion de la manifestation À nos mort·es – Climate Justice for Life, Bassin de la Villette, Paris, 28 novembre 2015. © Bruno Serralongue et Air de Paris, Romainville.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Il s’agit du nom donné aux habitant·es du département de la Seine‑Saint‑Denis, à ne pas confondre avec Dionysien·nes qui est celui des habitant.es de la ville de Saint‑Denis
- Notons ici que la volonté d’Éric de valoriser le territoire du 93 est au centre de ses engagements : il fait partie de l’association Accueil banlieues (dont les membres reçoivent des touristes à domicile dans le but de changer l’image des quartiers dans lesquels ils vivent) et anime des visites guidées en Seine‑Saint‑Denis avec Tourisme 93. Ces expériences et compétences seront essentielles dans la construction du collectif.
- Les deux citations sont extraites du premier tract du collectif annonçant le tour sur l’autoroute A1, consultable ici : <toxictourdetox93. wordpress.com/>.
- Les data centers sont des entrepôts qui abritent les serveurs informatiques qui font tourner internet. Voir Clément Marquet, « Ce nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les data centers à Plaine Commune », Tracés, 35, 2018. Les autres collectifs locaux avec lesquels a travaillé le TTD93 sont, entre autres, le Comité Porte de Paris (luttant pour un réaménagement du quartier Porte de Paris), des représentant·es de la lutte contre l’usine d’équarrissage de la Saria de laquelle émanait une odeur pestilentielle dans Saint‑Denis au début des années 2000, l’Association de défense contre les nuisances aéroportuaires (ADVOCNAR) de Saint‑Prix.
- La station de mesure Airparif (observatoire de la qualité de l’air en Île‑de‑France) mesure deux jours sur trois des quantités de particules fines et de dioxyde d’azote qui dépassent les seuils autorisés. Cause de ces mesures record : l’A1 et ses 200 000 véhicules par jour ; et non loin l’A86, qui compte 200 000 véhicules par jour également.
- On renvoie ici notamment à Jade Lindgaard, « À + 5 °C, des morts à la pelle en Seine‑Saint‑Denis », Mediapart, 28 juin 2014. L’Agence régionale de santé a diagnostiqué que l’augmentation de la mortalité pendant la canicule de 2003 avait été croissante avec l’âge, plus marquée chez les femmes que chez les hommes, et a aussi identifié des facteurs majeurs de risque : l’état de santé lié au niveau de vie, la qualité du logement, l’échec de la diffusion de l’information, ainsi que l’urbanisation dense, sans végétation et sans canal de refroidissement.
- Par exemple, Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, op. cit. et la note d’Éloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France », Fondation de l’écologie politique, 2014. (J’ai vent du travail de la sociologue Caroline Lejeune mais elle n’a encore rien publié à l’époque.
- Émilie Hache, « Justice environnementale, ici et là‑bas », loc. cit. Toutes les citations d’Émilie Hache dans les paragraphes qui suivent sont extraites de cet article.
- Giovanna Di Chiro, « Ramener l’écologie à la maison », in Émilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, op. cit., p. 191‑220.
- Voir Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier, « L’environnementalisme des riches », in Émilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Éditions Amsterdam, Paris, 2012, par opposition à « l’environnementalisme des pauvres » théorisé par le second.
- On renvoie aux « Principes pour la justice environnementale » : « The principles of environmental justice », loc. cit.
- Sylvia N. Tesh parle à ce titre d’un deuxième âge de ces mobilisations dans son article « Environmentalism, pre‑environmentalism and public policy » (Policy Sciences, 26, 1, 1993, p. 1‑20).
- « Lamaze enlève tes bretelles » est une fête des quartiers nord‑est de Saint‑Denis au cours de laquelle la bretelle d’insertion d’autoroute est bloquée pendant une journée.
- On renvoie par exemple, sur ce risque au sein des luttes pour la justice climatique, à l’article d’Hamza Hamouchene, « Que signifie se battre pour la justice climatique au Maghreb ? », Nawat, 20 août 2016. Selon lui, les concepts anglo‑saxons de la justice environnementale et climatique sont inintelligibles. Il préfère formuler ces enjeux en termes de questions de subsistance et de souveraineté de ressources, plus immédiatement compréhensibles et déjà mobilisés dans les luttes au Maghreb.
- S’ils n’intéressent pas, c’est qu’ils ont été mal formulés par les militant·es écologistes. Voir par exemple ici le travail de Fatima Ouassak qui propose d’élargir l’écologie dans les quartiers populaires au rapport à l’espace et au corps ; si lutte écologique il y a dans ces quartiers, elle concerne d’abord la possibilité de se rassembler dans l’espace sans s’y sentir menacé par la police. Fatima Ouassak, La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La Découverte, Paris, 2020.
- Je m’appuie ici notamment sur l’après‑midi de l’assemblée du 7 novembre consacrée au thème de « Construisons la suite », et celle du 16 décembre dédiée, entre autres, à un premier bilan des manifestations.
L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.
14.05.2025 à 16:19
Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes
Ailton Krenak
Survivant d’un peuple massacré par la colonisation, Ailton Krenak est devenu un acteur de premier plan du réveil politique des peuples autochtones du Brésil à partir de la fin des années 1970. Dans "Futur ancestral" et "Le Réveil des peuples de la Terre", il revient sur la naissance de l’Alliance des peuples de la forêt qui a permis de résister à la colonisation de l'Amazonie.
L’article Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9311 mots)
Temps de lecture : 24 minutes

Ce texte et ces deux entretiens sont extraits des livres d’Ailton Krenak, Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre. Traduits par Julien Pallotta, ils viennent d’être publiés aux Éditions Dehors.
Parmi les riches écrits d’Ailton Krenak, le choix de la rédaction de Terrestres pour ces bonnes feuilles a été de mettre l’accent sur trois textes qui proposent un récit à la fois historique, anthropologique et philosophique de l’expérience des alliances nouées en Amazonie autour des peuples de la forêt. Une contribution riche d’enseignements à l’heure des questions urgentes de composition des luttes et des stratégies.
Alliances affectives
Extrait de Futur ancestral, pp. 53-62
Le terme citoyenneté est bien connu : il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et dans de très nombreuses constitutions dans le monde. Il fait partie du répertoire, disons, blanc du droit. Le mot florestania lui est né dans un contexte régional, à un moment où la lutte sociale menée par des personnes qui vivaient dans la forêt Amazonienne était très active. Quand Chico Mendes et d’autres seringueiros1 ont commencé à se réunir avec des indigènes, ensemble ils ont compris que ce pourquoi ils luttaient ne devait pas être confondu avec la citoyenneté – il s’agissait de revendiquer des droits nouveaux dont ils devaient inventer le champ (après tout, le droit naît de la volonté d’une communauté à anticiper la compréhension que quelque chose devrait être considéré comme un droit, mais ne l’est pas encore). C’était à la fin des années 1970, nous vivions encore sous la dictature militaire, le gouvernement brésilien a cherché à découper en parcelles de grandes étendues de forêts dans le sud de l’Amazonie et en Acre, près des frontières avec la Bolivie et le Pérou. Pour arriver à leurs fins, ils ont déployé un procédé assez classique consistant à ouvrir des routes et à accueillir des colons. Et dans une tentative de privatisation de la zone de manière discrète et efficace, inspirée par Jarbas Passarinho2 et sa bande, l’INCRA3 (Institut national de la colonisation et de la réforme agraire) a commencé par offrir des parcelles de terre à ceux qui étaient déjà là.
Des femmes, des enfants, des hommes, des personnes de tous âges se sont placées entre les arbres et les tronçonneuses, elles ont bloqué les pistes qui devaient permettre de créer des lignes de démarcation à l’intérieur de la forêt.
Mais lorsqu’ils sont arrivés avec leurs engins pour percer des lignes de colonisation, les personnes rassemblées aux côtés de Chico Mendes se sont soulevées, ils étaient la florestania et, comme Gandhi et ses disciples, ils ont organisé une résistance pacifique aux actions de l’État. Des femmes, des enfants, des hommes, des personnes de tous âges se sont placées entre les arbres et les tronçonneuses, elles ont bloqué les pistes qui devaient permettre à la main de l’urbain – celle des géographes, des topographes ou des sismographes – de pointer des lignes de démarcation à l’intérieur de la forêt. Elles ne voulaient pas de piquets ou de parcelles, elles défendaient la fluidité du fleuve, la continuité de la forêt.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Les indigènes vivaient dans des zones qui leurs étaient réservées et les seringueiros, qui étaient pour la plupart des habitants du Nord-Est ayant migré vers la forêt amazonienne à la fin du xix e siècle, comprenaient bien cette différence. Après quatre, cinq, six générations à habiter la forêt, ce qu’ils désiraient, c’était vivre comme les Indiens. Alors il s’est produit ce que -j’appelle une contagion positive de la pensée et de la culture, et commença une réflexion sur les terres en communs où les seringueiros avaient créé leurs exploitations de caoutchouc. Ils cherchèrent à transformer le statut des « unités de conservation4 » qu’ils occupaient, en celui de territoires indigènes. Mais nous savons que la propriété collective n’existe pas au Brésil : même les terres occupées par les populations indigènes appartiennent à l’Union5. Le cancer du capitalisme n’admet que la propriété privée et est incompatible avec toute autre perspective d’utilisation collective de la terre. Défendre un droit nouveau suppose de mettre en mouvement l’appa-reil d’État, ses registres et certifications, ses notaires… mais dans leur volonté de constituer une florestania, les seringueiros ne voulaient pas même avoir à présenter de pièce d’identité.
Ce qui a poussé ces peuples à s’unir, c’est la compréhension du fait qu’ils partageaient, entre Indiens et non Indiens, les mêmes conditions de travail esclavagistes. Face à eux, ils avaient des patrons, qui étaient aussi des propriétaires terriens, qui revendiquaient la possession d’immenses étendues de forêt et les plantations de caoutchouc. Une constellation de peuples comme les Kaxinawa, les Ashaninka, les Huni Kuin et bien d’autres vivaient opprimés par cette situation favorisée par le capital, dans laquelle un patron pouvait vivre à São Paulo, à Londres ou n’importe où dans le monde, en exploitant la forêt amazonienne et ses habitants. En unissant nos forces pour éliminer la figure du patron, nous avons rendu possible ce soulèvement. L’Alliance des Peuples de la Forêt est née de la recherche de l’égalité dans cette expérience politique6.
Ce qui a poussé ces peuples à s’unir, c’est la compréhension du fait qu’ils partageaient, entre Indiens et non Indiens, les mêmes conditions de travail esclavagistes.
Le mot politique descend du mot grec ancien pólis (la cité). Il se trouve que, lorsque des êtres non politiques pensent, ils arrivent à imaginer d’autres mondes qui ne sont pas politiques, ou, du moins, qui ne sont pas conformes à la politique telle que nous l’entendons généralement. Le langage est une chose déterminante dans les interactions, et tout ce qui émane de la pólis se présente comme un rassemblement d’égaux où l’expérience politique converge avec cette aptitude. Cela m’inspire une observation : la pólis se revendique toujours comme étant le monde de la culture, et la nature c’est le monde sauvage. C’est à cet autre monde que je m’intéresse, et non à la convergence qui a lieu dans la pólis. J’imagine des puissances qui convergent vers un endroit, qui le traversent, mais n’y restent pas piégées.
Lire aussi sur Terrestres : Philippe Colin et Cristina Moreno, « Contester l’ordre et l’héritage colonial avec Manuel Quintín Lame », mai 2024.
Je pense que ce que voulaient les zapatistes7, c’était aussi la florestania, mais leur revendication a été comprise comme une rébellion, ils ont été traités comme des ennemis et réprimés brutalement. Aujourd’hui ils sont contraints de porter un passe-montagne pour masquer leur visage et d’une certaine manière, assumer la place limitée que leur geste de rébellion leur a assuré. Les zapatistes doivent vivre dans la forêt Lacandone ou dans les montagnes et ils se sont retrouvés pris dans le piège de leur pensée insurrectionnelle parce qu’il n’existe de zapatistes qu’au Chiapas. La florestania ne peut pas être une franchise, si nous voulons provoquer une profonde remise en question par la force d’une insurrection, nous ne pouvons pas devenir prisonniers des mouvements que nous créons. C’est pourquoi nous nous sommes demandés jusqu’où nous pourrions aller avec l’Alliance des peuples de la forêt : devenir un syndicat ? un parti ? Les alliances politiques nous contraignent à des formes d’égalités qui peuvent elles-mêmes devenir oppressives, même celles qui admettent l’existence de la diversité.
Le concept alliances affectives présuppose le partage d’affects entre des mondes qui ne sont pas semblables. Ce mouvement reconnaît une altérité intrinsèque en chaque personne, en chaque être.
L’expérience de cet engagement profond dans l’Alliance a duré plus de vingt ans, jusqu’à ce que je commence à remettre en question cette recherche constante de la confirmation de l’égalité [igualdade] et que je comprenne pour la première fois le concept d’alliances affectives – qui présuppose le partage d’affects entre des mondes qui ne sont pas semblables [iguais]. Ce mouvement ne revendique pas l’égalité, au contraire, il reconnaît une altérité intrinsèque en chaque personne, en chaque être, il introduit à l’inégalité radicale devant laquelle nous sentons que nous devons nous arrêter – un peu comme nous sentons que nous devons enlever nos chaussures avant d’entrer chez notre hôte. Cela a été ma façon d’échapper à la parabole du syndicat et du parti (quand un pacte commence à faire payer un tribut, il a perdu son sens). Alors je suis parti expérimenter la danse des alliances affectives, qui m’implique moi et une constellation de personnes et d’êtres dans laquelle je disparais : je n’ai plus besoin d’être une entité politique, je peux juste être une personne au sein d’un flux capable de produire des affects et du sens.
C’est uniquement de cette façon que l’on peut conjuguer le verbe mundizar (mondiser), ce verbe exprime le pouvoir d’expérimenter d’autres mondes, d’autres cosmovisions et notre capacité à imaginer des plurivers. Il a d’abord été utilisé par Alberto Costa et d’autres penseurs andins, il décrit la manière dont les mondes peuvent s’affecter mutuellement, par exemple, que la rencontre avec la montagne soit vécue non pas comme une abstraction, mais comme une dynamique d’affects dans laquelle elle n’est pas seulement un objet, mais aussi douée d’initiative. Cet autre « nous » possible ébranle la place centrale accordée généralement à l’humain ; soyons clair, tout ce qui existe ne peut pas dépendre de l’anthropocentrisme qui marque, nomme, catégorise et dispose de tout – y compris de ses semblables considérés comme des presque humains.
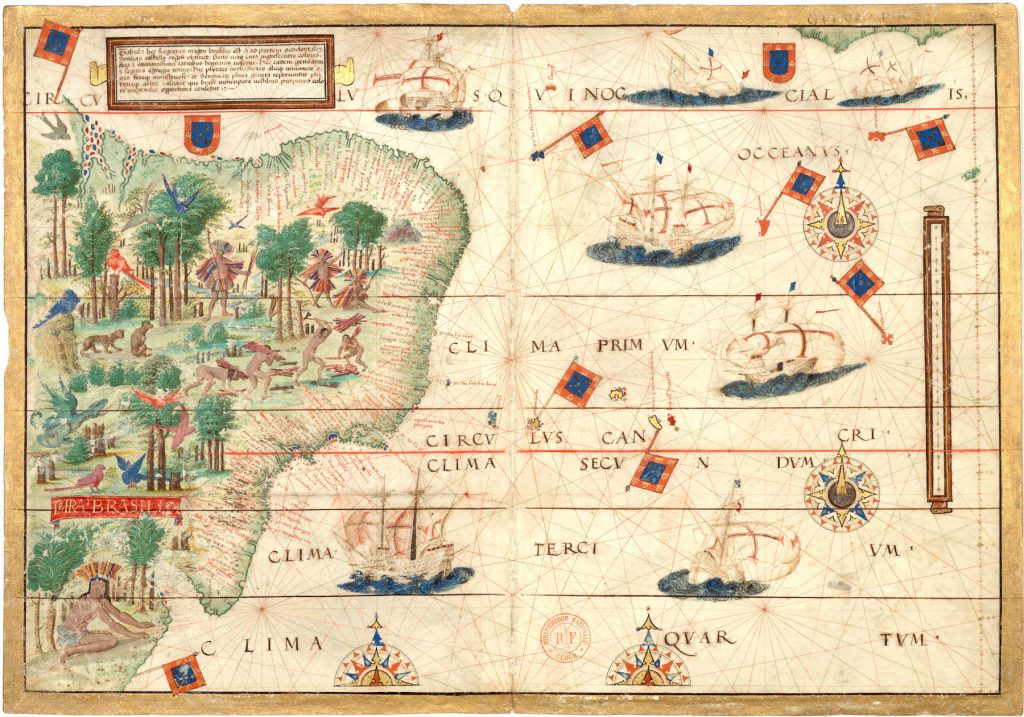
Le désir pour ce monde a toujours été présent dans l’humanité, il est même au cœur de la colonisation de tous les continents. Il arrive que, lorsqu’il est associé à une logique occidentale, il oppose l’idée de culture à celle de nature. Les tentatives de dialogue au xvie siècle entre les amérindiens et l’église catholique qui nous ont été rapportées – c’était un peu après que les rois catholiques d’Espagne et le pape ont mis fin au dernier émirat de la péninsule ibérique, et sont partis à la conquête de nouveaux corps à coloniser –, montrent clairement que chacun parle d’un monde impossible à reconnaître pour l’autre. Prenons comme exemple le discours attribué au chef Seattle adressé à un représentant du gouvernement de Washington en 1854 :
Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu’ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu’ils respectent la terre, dites à vos enfants qu’elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes.
Et c’est exactement ce que la pensée coloniale a produit. L’Anthropocène accumule tant de déchets, tant de désastres, qu’il a rendu le monde malade. C’est pourquoi, bien qu’ayant cherché à échapper à la politique de la pólis, je suis malgré tout avec enthousiasme ce qui se passe au Chili8, qui prolonge des discussions qui ont déjà eu lieu dans d’autres pays andins comme l’Équateur ou la Bolivie. On y parle de refondation de la nation sur la base d’un État plurinational et Elisa Loncón, une femme Mapuche, a été élue à la présidence de l’Assemblée constituante – au Chili, un pays historiquement autoritaire et réfractaire à toute mondialisation.
Mais il faut rester vigilant et fort. Le sens commun nous pousse à croire que la démocratie est quelque chose que l’on adopte et qui nous suit pour toujours – ce n’est pas le cas. Au Chili déjà, alors que Salvador Allende était élu président, le siège du gouvernement a été bombardé et les militaires ont envahi La Moneda. Aux États-Unis – bien connus pour être la plus grande démocratie du monde –, un policier enfonce son genou sur le cou d’un Afroaméricain et le tue en l’asphy-xiant, mais ce pays est le premier exportateur de la démocratie, car il en a énormément à offrir, mais surtout à vendre. Il faut cesser d’utiliser ces expressions de manière aussi approximative. Si vous tombez sur une pancarte « DÉMOCRATIE, ENTREZ », il y a de bonnes chances que ce soit n’importe quoi, et si vous entrez, vous prenez le risque qu’on vous frappe le visage à coups de poing. Les poètes disent que la démocratie est une utopie, quelque chose que l’on cherche mais que l’on ne parvient jamais à atteindre. C’est une épreuve que toute forme de société doit exercer comme une expérience quotidienne. Tout comme l’idée de liberté, d’intégrité d’un peuple, la démocratie doit être constamment réinventée, elle ne possède pas le don de s’installer par elle-même et elle est sujette à toutes sortes d’attaques.
Pendant ce temps, dans le Brésil des années 2020, se met en place un surprenant processus de négation identitaire. Les symboles mêmes de la nation, imposés par le colonialisme, tels que le drapeau national (qui, dans toute république, symbolise un bastion de l’identité), ont été appropriés par un groupe de personnes autoritaires qui n’ont pas l’intention de les partager. Il s’agit d’un club d’hommes qui ont un penchant particulier pour les armes à feu, une série de préjugés et toutes sortes de fondamentalismes9. Cette privatisation des symboles nationaux serait-elle un nouveau scandale capitaliste ? Une bonne façon de les combattre est de remettre en question les vérités coloniales : « Mon pays, ma langue. » Caetano Veloso chante : « Ma langue est ma patrie / Et je n’ai pas de patrie, j’ai une matrie / Et je veux une fratrie. » Alors, puisque le Quechua est une langue continentale, vive la Pachamama ! et à bas le nationalisme ! Nous changeons, nous devons changer le monde, même si ce changement passe par les expériences limitées de la démocratie.
Le Brésil doit être refondé en un État plurinational, car notre vieil État colonial a l’ADN d’un pillard : il est né pour manger les autres.
Le Brésil doit être refondé, nous devons ici aussi défendre l’idée d’un État plurinational, car notre vieil État colonial a l’ADN d’un pillard, d’un bandeirante : il est né pour manger les autres. Je suis étonné que la plupart des dirigeants politiques, non seulement au Brésil, mais dans une grande partie de la planète, soient si aliénés qu’ils ne se rendent pas compte que si nous ne nous ouvrons pas à cette vaste matrice culturelle, nous ne ferons que nous enfoncer un peu plus dans le désastre qu’ils appellent aussi crise environnementale. Ces États nationaux sont fondés sur des idées très limitées, très pauvres. Nous devrions être capables de traverser tout cela et de nous rassembler. Qui sait, peut-être que la présence des peuples indigènes dans la construction du nouveau constitutionnalisme latino-américain, à partir des Andes, apportera d’autres perspectives sur ce que nous appelons un pays et une nation.

Car les peuples indigènes peuvent contribuer autrement à la discussion, tant à propos de la pólis que sur les idées de nature, d’écologie et de culture. Si nous sommes capables de nous ouvrir à toute cette richesse, l’activité politique deviendra une autre dimension de l’existence, et elle ne se limitera pas à cette obsession prédatrice, comme elle l’a été pour tant d’hommes politiques au xxie siècle, le siècle du néolibéralisme, dont l’avènement n’a servi qu’à appareiller les corps et à renforcer la servitude. Échapper à la servitude, c’est aussi s’ouvrir à l’idée d’occupation, occuper l’espace du politique, occuper l’État, et j’espère que nous pourrons contribuer à oxygéner ces milieux, à l’image de nos rivières qui partagent généreusement leur puissance et convergent. Puissions-nous apprendre à ne pas rester coincés dans un barrage. Alors, sans oublier nos chers amis zapatistes, qui ont toujours inspiré d’importants débats en Amérique latine, juste avant de crier « ¡Viva Zapata! », je crie « ¡Abya Yala! », c’est ainsi que nos frères et nos sœurs saluent la terre et le ciel en Quechua.
L’Alliance des peuples de la forêt
Entretien issu de La Réveil des peuples de la Terre, initialement paru dans Povos Indígenas no Brasil, 10 mai 1989 avec Osmarino Amâncio. Propos recueillis par Beto Ricardo et André Villas Boas, pp. 49-75.
Notice. Les seringueiros sont des récoltants du latex d’hévéa (arbres à caoutchouc), présents en Amazonie depuis le xix e siècle. Dans les années 1970, leur activité et leurs terres sont menacées par la déforestation liée au développement de l’agriculture et à la mise en place de différents programmes gouvernementaux. Le Syndicat des travailleurs ruraux de Xapuri est créé en 1976 pour défendre le mode de vie des seringueiros et leur exploitation des hévéas. Ils manifesteront de façon pacifique en s’interposant entre les entreprises de déboisement et les arbres par un type d’action qu’ils appelleront les empates (qui peut être traduit par blocage ou neutralisation). Leurs préoccupations rejoindront celles des communautés indigènes de la région et ensemble ils formeront l’un des fronts pionniers de défense de la forêt amazonienne. L’Alliance des peuples de la forêt apparaîtra dans ce contexte. Carlos Alberto (Beto) Ricardo (1950) est anthropologue et environnementaliste, il a fondé plusieurs associations de défense des droits des peuples indigènes et de protection de la forêt amazonienne, comme le CEDI (Centro ecumênico de documentação e informações), qui publie cet article et qui publiera la « Déclaration des peuples de la forêt » en 1989.
Beto Ricardo : Qu’est-ce que l’Alliance des peuples de la forêt ? Quel est son esprit, quelle est son histoire, comment est-elle née ?
Ailton Krenak : Les peuples originaires de la forêt sont les peuples indigènes. Nos tribus sont constituées de peuples qui ont toujours vécu dans la forêt. Cela concerne aussi les peuples qui ne vivent pas nécessairement dans des régions de grandes forêts comme l’Amazonie ; il y a des tribus qui vivent dans le Cerrado* (savane), celles qui vivent dans des régions de Capoeira (pleine), ce sont des peuples de la forêt, ce sont des peuples de la brousse, et la culture de notre peuple, son économie, est organisée autour de ce que la nature peut nous offrir, ce qu’elle donne aux humains. Pendant longtemps nous avons été le seul peuple de la forêt. Au cours de ces cinq cents dernières années, d’autres peuples sont arrivés au Brésil et ont construit une économie et même une culture liée à l’exploitation du latex qui fait partie des ressources de la forêt. Le peuple qui s’est le plus approché de nous, dans le sens qu’il a le plus appris auprès du peuple indigène, c’est celui des seringueiros* (ouviers-récoltants du latex). Les seringueiros ont été incités à s’installer en Amazonie à partir du xix e siècle, pour l’occuper et ils considéraient, à leur arrivée, les peuples indigènes comme des êtres étranges. Ils se sont battus contre nous, et à de nombreuses reprises ils se sont mis au service de leurs patrons, les seringalistas, pour « libérer » ces régions des indigènes et réduire nos tribus à l’esclavage.
Les seringueiros (ouviers-récoltants du latex), après avoir tenté de coloniser l’Amazonie, sont devenus les principaux alliés du peuple indigène dans la défense de la forêt et des pratiques traditionnelles qu’elle abrite.
Ces seringueiros n’ont pas réussi à s’imposer comme des colonisateurs de l’Amazonie, ils ont été humanisés par la forêt, la forêt a humanisé ces gens, ils ont appris à vivre avec le peuple indigène, ils se sont inspirés de leurs habitudes et de leurs coutumes durant une longue période. Et aujourd’hui nous pouvons dire que les seringueiros ont une culture qui les différencie, par exemple, des travailleurs ruraux sans terre et qui les différencie des autres colons. Ce ne sont pas des colons, ils ont élaboré un mode de vie qui les rapproche beaucoup plus des Indiens que de toute autre partie de la population brésilienne. Et c’est cela qui fait des seringueiros les principaux alliés du peuple indigène dans la défense de la forêt et des pratiques traditionnelles qu’elle abrite. Le peuple indigène a toujours défendu la forêt. Les alliés les plus récents du peuple indigène sont les seringueiros.
Beto Ricardo : Et les ribeirinhos* (peuple traditionnel qui vit sur les rives des fleuves) ?
Ailton Krenak : Les ribeirinhos représentent une partie très importante de la population de l’Amazonie et sont dispersés le long des fleuves, ils n’ont pas encore réussi à constituer un type d’organisation comme celle des seringueiros, qui sont représentés par un Conseil national des seringueiros (CNS*) qui leur permet d’agir comme une organisation telle que l’Union des nations indigènes (UNI*). Nous avons pu nous allier aux seringueiros parce qu’ils ont développé ce type d’organisation qui correspond au mode de fonctionnement des organisations indigènes. Nous espérons que les ribeirinhos pourront participer à cette Alliance dès qu’ils auront défini leurs propres projets et ce qu’ils défendent. J’irais même jusqu’à affirmer que si les seringueiros persévéraient dans leurs pratiques traditionnelles sans rechercher un dépassement du modèle extractiviste comme unique fondement de leur économie, ils ne pourraient probablement pas participer à cette alliance avec le mouvement indigène, parce que le mouvement indigène est précisément un mouvement de défense de la forêt. Ce qui est nouveau pour les communautés indigènes, ce sont leurs manières de lutter pour renforcer leurs pratiques traditionnelles tout en les articulant à l’économie locale et au marché régional. Les communautés indigènes ne se présentent pas seulement comme des victimes d’un modèle économique, elles sont une composante active et même significative d’une autre économie régionale.
Il y a cent quatre-vingts tribus indigènes au Brésil. Dans certains cas, les anciens d’une tribu ont été les bourreaux des anciens d’une autre tribu, mais aujourd’hui toutes ces tribus composent l’Alliance des peuples de la forêt ou l’Union des nations indigènes.
Beto Ricardo : Tu ne trouves pas que dans cette affaire d’alliance des Indiens avec les seringueiros, les conflits sont encore trop récents ? Dans toute l’Amazonie il y a des groupes indigènes dont les anciens ont combattu à mort les seringueiros et ces conflits sont encore latents. Pas seulement avec ces récoltants du latex, mais aussi avec les castanheiros (récoltants des noix du Brésil) et toutes ces populations extractivistes. Cette idée d’alliance, n’est-elle pas un peu rhétorique, parce qu’en réalité vous n’avez pas la base sociale qui vous permettrait de faire avancer les choses ?
Ailton Krenak : Bon, je vais répondre très clairement à cette question. Il y a cent quatre-vingts tribus indigènes au Brésil dans lesquelles, dans certains cas, les anciens d’une tribu ont été les bourreaux des anciens d’une autre tribu, mais aujourd’hui toutes ces tribus composent l’Alliance des peuples de la forêt ou l’Union des nations indigènes. Quand j’étais dans le village Suruí pour discuter avec le chef Suruí de l’Union des nations indigènes, il m’a demandé si l’Union signifiait que désormais les tribus allaient être ensemble et qu’elles allaient travailler ensemble. Je lui ai répondu que oui, que cela signifiait que nos tribus allaient avancer ensemble, que nous allions associer nos forces pour protéger nos peuples. Alors il m’a dit : « Cela signifie que je ne pourrai plus tuer les Zoró ? » Les Zoró sont les voisins des Suruí et leurs ennemis traditionnels. Je peux aussi te raconter comment les Tapirapé ont réagi en voyant le visage de Kremoro descendre de l’avion pour les rencontrer au village, ils sont partis en courant, parce que la dernière fois qu’ils s’étaient vus, vingt ans plus tôt, c’était au cœur d’un conflit, une lutte au cours de laquelle les Kayapó ont écrasé les Tapirapé. Alors pour ce qu’il en est de ta mise en garde concernant les seringueiros, tu pourrais être un peu plus généreux, tu pourrais l’étendre à tout le monde, aux cent quatre-vingts tribus indigènes. Nous sommes tous des ennemis traditionnels. Vous n’avez peut-être pas encore compris que, dans la psychologie des Indiens, on préserve peut-être davantage l’ennemi traditionnel que l’ami traditionnel. Vous pouvez perdre à tout moment un ami traditionnel, mais l’ennemi traditionnel se garde. Je préserve mes ennemis traditionnels jusqu’au bout. Tu sais, la coiffe à plumes qui commence avec une plume verte ici, puis elle varie en couleurs, il y a une plume bleue là et encore une autre verte au bout, eh bien l’ami traditionnel est ici, et l’ennemi traditionnel est là : il n’y a pas deux types plus proches l’un de l’autre que l’ami traditionnel et l’ennemi traditionnel. Les autres sont des personnes indifférenciées.

Habiter la dystopie
Entretien issu de Le Réveil des peuples de la Terre, Habiter la dystopie, Seconde partie, 7 novembre 2022, propos recueillis et traduits par Julien Pallotta, pp. 243-273.
Julien Pallotta : Bonjour Ailton, j’aimerais que tu développes aujourd’hui la question de la relation entre le mouvement indigène et le mouvement noir. Hier, tu as suggéré l’idée que le mouvement noir, plus spécifiquement le quilombolisme, propose aussi une critique du mode d’être dominant, une résistance alternative.
En effet, j’ai parlé de la dispora noire au Brésil par contraste avec les peuples de la forêt, qui peuvent être des seringueiros*. Les Noirs ont été arrachés à la terre d’Afrique pour être réduits en esclavage ici dans les plantations. Certains ont réussi à s’enfuir et à se rassembler dans des villages, les quilombos*. Mais ce que j’observe c’est qu’ailleurs, ils ont commencé à reproduire des maisons, des rangées de maisons. Après l’abolition de l’esclavage, c’est le mode de vie urbain qui a été dominant chez eux et même s’ils constituent des communautés, ce sont des communautés urbaines, et beaucoup d’entre elles sont installées dans le centre des grandes villes. La plus grande partie de la population noire du Brésil vit aujourd’hui en milieu urbain dans le Nord-Est ou dans le Sud-Est, à l’exception de ceux qui se sont « quilombolisés », qui sont restés dans les anciens quilombos. Je t’ai parlé de Nêgo Bispo10, un de mes amis originaires d’un quilombo appelé Saco-Curtume. Il est situé dans la municipalité de São João do Piauí. Son histoire est celle de Noirs qui se sont mélangés aux indigènes et qui ont décidé de ne pas partir et de ne pas s’urbaniser. Ils ne veulent pas de l’urbanisation. Ils sont même critiques des programmes sociaux et des politiques publiques dont l’orientation est intégrationniste. Comme penseur et leader de ce quilombo, Nêgo Bispo a participé avec moi à des débats publics à plusieurs reprises et a toujours revendiqué une identité du peuple de la forêt. C’est quelque chose de vraiment très intéressant. On parle ici d’un quilombo qui a toujours cette culture forestière.
Les Noirs n’ont pas constitué d’alliance avec les peuples de la forêt parce qu’ils ont une culture urbaine et parce qu’à l’intérieur de la forêt vivent des communautés humaines qui ont une perspective cosmopolitique différente.
Nous pouvons penser à la ville comme un puits sans fond énergétique, qui consomme tout, qui mange tout, et rend impossible toute expérience continue de la forêt. Quand nous pensons à la ville, nous pensons à São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Manaus, mais la ville ce n’est pas seulement cela. La ville c’est également les micro-villes, les villages qui reproduisent le même comportement consumériste que dans les grandes villes, qui ont besoin d’électricité, de gaz et achètent dans les supermarchés des aliments transformés par des industriels. Ainsi, ce mode de vie, en imposant une certaine relation au travail, à d’autres dépendances, finit par empêcher les gens de vivre de leur propre culture.
Mon commentaire plus général sur la relation entre mouvement noir et mouvement indigène est le suivant : les Noirs n’ont pas constitué d’alliance avec les peuples de la forêt parce qu’ils ont une culture urbaine (même s’ils voulaient effectuer un retour vers la forêt, expérimenter un devenir–urbain de la forêt), et parce qu’à l’intérieur de la forêt vivent des communautés humaines qui ont une perspective cosmopolitique différente. Cette vision est très nouvelle pour le monde emmuré de la ville qui est devenue un puits sans fond en besoin énergétique. Parce que la ville, ce n’est pas uniquement ce qui se trouve au cœur des métropoles, ce sont aussi ces réseaux d’infrastructures qui dévorent le paysage : les barrages hydroélectriques, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les routes qui servent aussi de front de colonisation.
Julien Pallotta : Tu suggères que les différentes formes de résistances sont d’abord des manières différentes d’habiter ?
Cette image de l’impossibilité pour nous de penser nos différences au regard de la question urbaine m’est apparue de manière très vive lors de la visite que Davi Kopenawa et moi-même avons effectuée en Grèce. Je me suis rendu dans le « berceau de la civilisation occidentale » dans les années 1990 pour recevoir le prix de la Fondation Onassis. J’avais la possibilité d’être accompagné par quelqu’un dans ce voyage, j’ai donc proposé à Davi Kopenawa Yanomami de m’accompagner. C’était pour moi l’occasion de le mettre en contact avec le secrétaire général de l’ONU qui devait aussi être présent à cette cérémonie. Nous voulions l’alerter sur la situation en Amazonie. Dans les années 1990, on comptait déjà huit mille orpailleurs qui menaçaient les territoires Yanomami et la forêt. Aujourd’hui, il y en a vingt mille. Ils forent dans la terre, brisent les roches, creusent sans se donner aucune limite. Dans le livre La Chute du ciel, Kopenawa affuble les Blancs du sobriquet de troupeau de pécaris11. Il a établi une analogie entre la façon dont les pécaris se nourrissent et la structure antique qui se trouve sur l’Acropole à Athènes. Lorsque nous sommes arrivés au temple de Zeus, nous avons découvert des colonnes brisées sur le sol. C’est là un témoignage architectural de l’âge d’or de la culture grecque qui a ensuite été exportée dans toute l’Europe par les Romains et que l’on retrouve dans la colonisation de notre continent. Lorsqu’on se rend à Washington, dans cette ville bâtie au xviii e siècle aux États-Unis, on retrouve ces colonnes grecques. Ils ont voulu ainsi signifier qu’ils sont les héritiers d’une civilisation qui trouve là son origine.
Lire aussi sur Terrestres : Barbara Glowczewski, « Le pluriversel à l’ombre de l’universel », novembre 2018.
Davi a vu également cela dans le temple de Zeus. En quittant le site, il m’a regardé et a dit : « Maintenant je sais d’où viennent les orpailleurs qui nous envahissent et détruisent la forêt. » La ville pollue les eaux des rivières, elle pollue l’air, elle mange tout ce qu’elle rencontre, elle mange la pierre, elle mange les montagnes, elle mange les forêts, elle mange la vie. Aujourd’hui, le changement climatique montre clairement que ces agglomérations urbaines, où sont entassées plusieurs millions de personnes, ne sont pas viables.
Si vous n’apprenez pas à vos enfants à « fouler délicatement la terre », vous vous réveillerez un jour immergés dans votre propre crachat, dans vos propres déchets.
Les décennies de luttes auxquelles j’ai contribué ici au Brésil pour défendre les droits de nos peuples à vivre sur leur terre et dans leur culture sont aussi des années passées à défendre un autre comportement à l’égard de la Terre, une autre façon de l’habiter. La Terre n’est pas une marchandise, la Terre est notre mère, elle a toujours existé. Un monde sans humains a déjà existé et continuera probablement à exister dans le futur. Si vous n’apprenez pas à vos enfants à « fouler délicatement la terre12 », vous vous réveillerez un jour immergés dans votre propre crachat, dans vos propres déchets. Il n’y a pas d’image plus terrifiante que l’humanité immergée dans ses propres déchets.
« Où vont les villes ? Où vont les gens ? » Ces ruines du temple de Zeus inspirent une lecture ou une relecture de cette civilisation qui a produit cette expérience qui a échoué. Mais nous insistons pour la répéter. C’est un « répétiteur », comme l’écrit le poète Carlos Drummond de Andrade13, un « répétiteur » éternel. Dans le poème « O homem ; as viagens » [« L’homme ; les voyages »], il parle de cette tendance humaine à la répétition. Il fait une critique de l’espèce humaine, non pas d’une communauté humaine particulière, mais de l’espèce dans son intégralité. Il critique le spécisme des humains. Les humains pensent que la Terre est une chose matérielle, physique, sur laquelle nous pouvons nous reposer pour favoriser notre bien-être et la jouissance d’une vie fondée sur la marchandise. C’est pourquoi Davi Kopenawa Yanomami appelle la société du napë [Blanc] la civilisation de la marchandise. C’est sa façon de décrire ce mode de vie qui a conquis désormais le monde, de la même manière que le poète Carlos Drummond de Andrade parle de la « machination du monde ».
Photo d’ouverture : Tuíra Kayapó met en garde le directeur de la société Eletronorte lors d’une rencontre avec les peuples autochtones mobilisés contre la construction du barrage du Belo monte, Protásio Nenê, 1989.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Seringueiros est le nom donné aux ouvriers récoltant du latex d’hévéa en Amazonie. Chico Mendes est un leader syndical qui a incarné, dans les années 1980, le combat des seringueiros et la protection de la forêt amazonienne. Il a été assassiné en 1988 du fait de la menace qu’il représentait pour les grands propriétaires terriens.
- Jarbas Passarinho (1920-2016) a été président du Sénat et plusieurs fois ministre pendant la dictature militaire (1964-1985).
- L’Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a été créé en 1970 pour mettre en place la réforme agraire. Il a notamment été accusé, pendant la dictature, de s’en prendre aux terres autochtones et de favoriser les grandes exploitations agricoles, souvent proches du pouvoir politique.
- Les unités de conservation [unidades de conservação] désignent des zones délimitées pour la protection de l’environnement qui ne comprennent pas les terres autochtones et les quilomboles qui relève d’autres administrations fédérales.
- L’Union désigne le gouvernement central de l’État fédéral brésilien, il est responsable de la gestion des affaires nationales et internationales. Il a également en charge les questions foncières telles que la gestion des terres publiques et la réforme agraire.
- L’Alliance des peuples de la forêt a émergé dans les années 1980 et a été officialisée en 1987. Ailton Krenak fait partie de ses fondateurs qui a trouvé sa plus haute expression dans la figure Chico Mendes.
- Zapatiste est le nom donné aux communautés autochtones du Chiapas qui se sont soulevées en 1994 pour défendre leur autonomie à l’égard de l’État mexicain. Le mouvement a été impulsé par l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN).
- Elisa Loncón, a été élue le 4 juillet 2021 à la présidence de l’assemblée chargée de doter le Chili d’une nouvelle Constitution. Celle-ci a été convoquée à la suite d’intenses mouvements sociaux qui traversaient le pays depuis 2019. Le jour de son élection elle a déclaré que cette nouvelle constitution « transformera le Chili en un État plurinational, interculturel, qui ne bafouera plus les droits des femmes et qui protègera la Terre Mère et les eaux ». Le 4 septembre 2022, 62 % des Chiliens voteront contre son adoption.
- Ailton Krenak fait référence ici au gouvernement de Jair Bolsonaro, président du Brésil entre 2018 et 2022. Sa campagne a notamment été soutenue par les églises évangéliques, les élites militaires et financières et la droite libérale.
- Nêgo Bispo (1959-2023) est un leader quilombola*, connu pour la défense des droits des quilombos et pour son œuvre philosophique (il est notamment à l’origine de l’idée de « contre-colonisation »).
- Le pécari est un mammifère qui vit sur le continent américain et qui ressemble à un sanglier. Comme lui, il retourne la terre pour se nourrir, entre autres choses, de racines et de tubercules.
- Cette expression fait écho aux paroles de la chanson « Alguém me avisou » (1981) de Dona Ivone Lara (1921-2018). La formule « fouler délicatement la terre » [pisar suavemente na terra] a été utilisée pour le titre du film documentaire de Marcos Colón (2022).
- « O homem ; as viagens » figure dans le recueil As Impurezas do Branco (1973). Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) est l’un des poètes brésiliens, lié au mouvement moderniste, les plus importants du xx e siècle.
L’article Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes est apparu en premier sur Terrestres.
10.05.2025 à 21:22
Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil
Erika Campelo
Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l’élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l’extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.
L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5624 mots)
Temps de lecture : 14 minutes
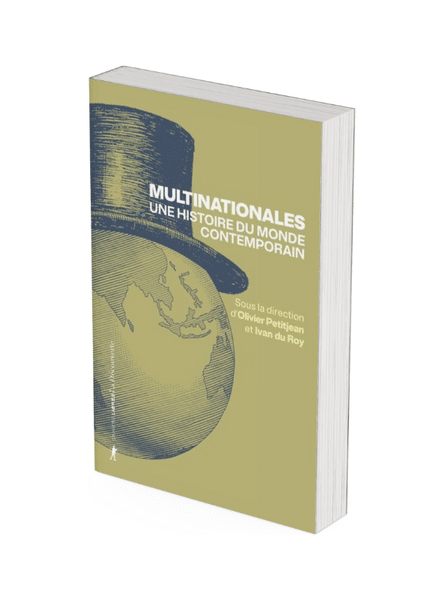
Ce texte constitue le dernier chapitre du livre Multinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.
Le 5 juin 2022, aux confins de l’Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu’ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d’Amazonas), un affluent indirect de l’Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l’environnement dans le Val do Javari, l’une des plus grandes réserves autochtones du pays, d’une superficie équivalente à celle de l’Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l’enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l’arrestation de plusieurs suspects faisant partie d’un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l’extraction minière et l’abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.
Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s’ajoutent à la longue liste des défenseurs de l’environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l’environnement recensés dans le monde par l’organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu’ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l’un d’entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d’État à l’environnement dans l’État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d’assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d’affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l’industrie du bois, de holdings de gestion d’actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l’accaparement de terres protégées, la corruption d’élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.
Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l’intense pression économique qui s’exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l’illégalité, ou se rendent directement coupables d’activités criminelles se dessine l’ombre du puissant secteur brésilien de l’agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Viandes et soja
L’agrobusiness brésilien est l’un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l’État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d’installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s’est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald’s, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d’immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d’organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l’exporter, notamment dans l’Union européenne.

Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d’une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n’a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l’importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.
Lire aussi sur Terrestres, Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.
Travail esclave
En plus de constituer une menace pour les écosystèmes, l’agriculture intensive recourt au travail forcé. Celui‑ci s’appuie le plus souvent sur une forme de servitude par la dette, plaçant des travailleurs pauvres ou migrants (y compris pour des migrations internes au Brésil) à la merci de recruteurs travaillant pour des propriétaires terriens ou des fournisseurs de grandes marques. Recrutés dans les régions périphériques du bassin amazonien, ils sont envoyés à des centaines de kilomètres de leurs villes ou villages d’origine contre la promesse d’un emploi, sont sous‑payés, travaillent dans des conditions indignes et doivent s’endetter auprès de leur employeur pour leur logement et leur nourriture, ce qui les maintient sous leur emprise. Ces pratiques sont qualifiées de « conditions analogues à l’esclavage » et sont souvent désignées au Brésil par le terme « travail esclave », quand le travailleur est soumis à des conditions dégradantes, à un travail épuisant, à la servitude pour dettes, au travail forcé ou à la restriction de sa liberté de déplacement (l’esclavage a été aboli tardivement au Brésil, par une loi de 1888). Ces pratiques se retrouvent dans l’élevage, la déforestation ou l’extraction minière en Amazonie, mais concernent aussi d’autres secteurs comme la construction ou l’industrie du textile.
De même, le soja brésilien exporté vers l’Asie ou l’Europe — où il sert essentiellement à l’alimentation animale dans les élevages intensifs — constitue l’une des causes majeures de déforestation et d’appauvrissement des communautés locales. Cargill et Bunge, qui figurent parmi les géants mondiaux du négoce de matières premières, en particulier alimentaires, sont des acteurs incontournables de la culture et de l’exportation du soja brésilien. Bunge joue ainsi un rôle majeur dans la destruction du Cerrado, selon une étude menée par la fondation environnementale Mighty Earth (basée à Washington) publiée en juin 2023. Le Cerrado est une vaste savane tropicale, en périphérie de la forêt amazonienne, qui couvre près de 20 % du territoire brésilien. Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, il abrite des milliers d’espèces végétales et animales, dont beaucoup sont endémiques. Le Cerrado contribue de manière cruciale à l’équilibre écologique continental, notamment en régulant le cycle de l’eau, et en stockant du carbone pour atténuer le changement climatique. Selon Mighty Earth, les fournisseurs de Bunge ont causé la déforestation de dizaines de milliers d’hectares dans la région de Matopiba, au centre du Brésil, entre 2021 et 2023, malgré l’engagement « zéro déforestation » de la multinationale de négoce.

Pour lutter contre ce fléau, le Brésil a mis en place en 2003 la « lista suja » (liste noire), un registre public des employeurs reconnus coupables de travail esclave destiné aux entreprises qui s’approvisionnent en soja, sucre ou café et qui veulent éviter des fournisseurs recourant au travail esclave. La constitutionnalité de cette liste a été confirmée par la Cour suprême en 2020 malgré les tentatives de suppression par les lobbyistes de l’agrobusiness et de l’immobilier. L’inclusion d’une entreprise ou d’une marque sur cette liste peut entraîner la suspension de financements publics et de contrats commerciaux. « L’esclavage moderne persiste parce qu’il y a une logique économique derrière : générer plus de profit avec le moindre coût possible, sans aucun respect pour la dignité humaine », estime Leonardo Sakamoto, journaliste brésilien et activiste engagé dans la lutte contre le travail esclave, fondateur du média indépendant Repórter Brasil. Plusieurs grandes multinationales ont été accusées d’implication directe ou indirecte dans des pratiques de travail esclave : la découverte d’ateliers clandestins dans l’État de São Paulo qui confectionnait des vêtements pour Zara (groupe Inditex) fait scandale en 2011. En 2019 et 2020, des ranchs où est pratiqué le travail forcé vendent leur bétail à JBS. Des révélations régulières concernent des usines de bioéthanol ou de sucre (approvisionnant notamment la coopérative agricole française Tereos et sa marque Beghin‑Say).
Pollution minière
L’exploitation minière représente un autre vecteur de destruction en Amazonie, et dans d’autres régions du pays, comme l’État du Minas Gerais. Des multinationales telles que Vale et Anglo American dominent ce secteur, extrayant principalement du fer, de l’or et du cuivre. Les projets miniers nécessitent souvent la construction de barrages, de routes et d’infrastructures qui fragmentent l’habitat naturel et perturbent les modes de vie des communautés locales.
Vale est fondée au Brésil en 1942 sous le nom de Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) par le régime de Getúlio Vargas pour exploiter les mines de fer d’Itabira (Minas Gerais). Elle devient ensuite l’une des plus grandes entreprises minières au monde et le premier producteur de minerai de fer ou de nickel. Elle est privatisée en 1997 puis simplifie son nom en 2009, pour « Vale ». Basée à Rio de Janeiro, la société opère dans quatorze États brésiliens et sur les cinq continents, et possède neuf terminaux portuaires. En 2006, elle acquiert le canadien Inco, plus grand producteur mondial de nickel. Derrière ce succès économique, ses pratiques environnementales et sociales sont très critiquées. Vale a été nommée « pire entreprise du monde » en 2012 par les ONG Greenpeace et Déclaration de Berne (Public Eye aujourd’hui).

La compagnie minière est tristement célèbre au Brésil pour deux catastrophes industrielles dans l’État du Minas Gerais, en 2015 puis en 2019, dans une zone où Vale possède de multiples concessions minières. À Mariana, la rupture d’un barrage minier du groupe Samarco (détenu par Vale avec le groupe australien BHP Billiton) provoque la mort de dix‑neuf personnes et le déversement de boues toxiques sur plusieurs centaines de kilomètres en aval, dans la rivière Rio Doce, celle‑là même qui a donné son nom à la multinationale. Trois ans plus tard, à Brumadinho, l’effondrement des bassins de rétention de boues toxiques cause la mort de plus de 300 personnes et une dévastation environnementale massive en aval sur plus de 500 km jusqu’à l’océan Atlantique. En mars 2024, le leader autochtone Merong Kamakã Mongoió est retrouvé mort à Brumadinho. Il aurait été victime de persécutions de la part de policiers militaires et de gardes de sécurité au service de la multinationale, selon des témoignages d’amis et de membres de sa famille. Bien que ces désastres écologiques et humains soient survenus en dehors de l’Amazonie, ils illustrent les risques que posent toujours les activités minières à grande échelle, tant pour l’environnement que pour les populations humaines. D’autant que Vale et d’autres compagnies possèdent plusieurs vastes concessions minières en Amazonie. Barcarena, un district industriel à proximité de Belém, en Amazonie brésilienne, abrite ainsi des installations industrielles telles que la plus grande fonderie d’aluminium au monde, opérée par Hydro Alunorte (filiale de la norvégienne Norsk Hydro), et une usine de kaolin appartenant à l’entreprise française Imerys. Ces installations provoquent des pollutions répétées depuis deux décennies, menaçant la santé des habitants, polluant les rivières et les nappes phréatiques, et altérant les écosystèmes locaux. En deux décennies, au moins vingt‑six accidents industriels et fuites de polluants ont été recensés, principalement liés aux bassins de décantation, contaminant les eaux locales, et rendant la pêche et l’accès à l’eau potable difficiles, voire impossibles.

Norsk Hydro, avec sa fonderie d’aluminium Hydro Alunorte, est une source majeure de pollution. Les « boues rouges » issues de la transformation de bauxite en alumine contiennent des métaux lourds. En février 2018, après des pluies intenses, l’entreprise est accusée de déverser illégalement des effluents contaminés dans la forêt et les rivières. Les conséquences sont graves : acidification des eaux, mortalité des poissons, et risques sanitaires pour les habitants. Les actions juridiques menées par l’autorité fédérale contre les multinationales sont compliquées par un manque de moyens, les enquêtes en cas d’accidents ne sont pas systématiques. Les communautés affectées, principalement les quilombolas (descendants d’esclaves) et les caboclos (métis d’Amérindiens et d’Européens), résistent aux pressions pour quitter leurs terres. Elles revendiquent le droit de rester et demandent la dépollution des eaux et une compensation juste pour les dommages subis. En réponse, l’État du Pará envisage de les délocaliser pour « les protéger des pollutions chroniques », ce qui permettrait d’étendre la zone industrielle de ces deux multinationales. Ce projet de délocalisations forcées s’accompagne de menaces et d’intimidations, exacerbant les tensions locales.
« De la multitude de matières premières qui transitent par leur territoire, les habitants n’en supportent que les retombées négatives », constate au moment de ces pollutions Marcel Hazeu, professeur en sciences environnementales à l’université fédérale du Pará, dans un reportage réalisé par le média Basta !. En plus de supporter les destructions de leur environnement et les pollutions générées par les activités agricoles ou minières, les communautés locales ne bénéficient que très rarement des infrastructures mises en place pour les multinationales (réseau d’électricité, accès à l’eau courante…). Et ne profitent pas forcément des emplois directs ou indirects créés. Les 100 000 employés de JBS au Brésil, qui travaillent dans les abattoirs ou les usines de transformation, perçoivent un salaire moyen de 1 700 Réais (environ 300 euros), très légèrement au‑dessus du salaire minimum, qui demeure très faible au regard du coût de la vie. Dans onze des douze municipalités brésiliennes où JBS possède d’importants sites de production, une recherche menée par l’anthropologue Raísa Pina (université de Brasilia) montre que la pauvreté a progressé de 50 %. La chercheuse précise que son étude ne démontre pas une causalité directe entre les implantations de JBS et l’augmentation de la pauvreté mais met en lumière le paradoxe d’une « nation qui abrite la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec un slogan “ nourrir le monde ”, tout en connaissant une augmentation de la faim ».
De l’Amazonie à Brasilia
Cette pression physique continue sur l’Amazonie et les communautés qui y vivent se double d’un important lobbying à Brasilia, au parlement fédéral, pour affaiblir ou entraver la moindre politique de protection de l’environnement ou de sanctuarisation de territoires au profit des populations autochtones. Des coalitions ad hoc rassemblant des députés ou des sénateurs de plusieurs partis y défendent spécifiquement les intérêts des groupes agro‑industriels et des grands propriétaires terriens. Ainsi, le FPA (Front parlementaire pour l’agriculture) rassemble en 2024 environ 300 députés (sur 513), issus des partis centristes, de droite libérale, conservateurs ou de droite extrême — également appelé la bancada ruralista (le banc rural) à l’Assemblée nationale — et une cinquantaine de sénateurs (sur 81). Les députés membres du FPA entretiennent un lien privilégié avec un think tank, l’Instituto Pensar Agro (IPA). Celui‑ci ébauche des projets d’amendements et des rapports à destination de ces députés lors de projets de loi, comme celui réautorisant plusieurs pesticides ou celui sur l’exploitation minière des terres indigènes. Or l’IPA est financé par les organisations professionnelles de l’agrobusiness, qui regroupent producteurs, entreprises et géants des secteurs agro‑industriels, comme JBS, Cargill, Bunge, Nestlé, ou de la chimie, tels BASF et Bayer.

Lors du mandat du président Jair Bolsonaro (2019‑2023), les députés du FPA ont tenu pas moins de 160 rencontres officielles avec les délégués de l’IPA et des représentants du ministère de l’Agriculture, dont vingt réunions en présence de la ministre Tereza Cristina, elle‑même porte‑voix des intérêts agro‑industriels quand elle était députée. Cet intense lobbying a été documenté par l’Observatoire de l’agrobusiness au Brésil (De Olho nos Ruralistas), un média indépendant. À ces réunions s’ajoutent les rendez‑vous bilatéraux entre multinationales et membres du gouvernement. Syngenta, multinationale suisse désormais propriété de ChemChina, se distingue avec quatre‑vingt‑une réunions avec le ministère de l’Agriculture, suivie de JBS avec soixante‑quinze rencontres, puis Bayer, leader du marché brésilien des pesticides, avec soixante entrevues. Bayer a également tenu seize réunions en dehors des registres officiels, incluant une audience directe avec le président Bolsonaro et la participation de la ministre Tereza Cristina à une vidéo institutionnelle de la multinationale.
Pendant la présidence Bolsonaro, les députés membres de la bancada ruralista ont joué un rôle majeur dans le démantèlement des lois protégéant l’environnement. Le code forestier de 2012 a ainsi été modifié sous la pression des lobbyistes de l’agrobusiness pour faciliter la déforestation légale au profit de l’expansion des cultures de soja et des pâturages pour le bétail. La bancada ruralista a également soumis des projets de loi comme celui visant à reclasser des zones protégées en « zones d’occupation anthropique » en vue de les ouvrir à l’exploitation agricole, ou permettre l’extraction minière et la construction de barrages hydroélectriques au sein des territoires sanctuarisés pour les populations autochtones. La corruption et les soupçons d’implication dans des activités économiques criminelles, constatées au cœur de l’Amazonie, remontent aussi au plus haut niveau du pouvoir brésilien. Le ministre de l’Environnement du gouvernement Bolsonaro, Ricardo Salles, a dû démissionner de son poste en 2021 alors qu’il est ciblé par deux enquêtes de la Cour suprême fédérale pour commerce illégal de bois et… violation de la législation environnementale dans des espaces protégés. Ces enquêtes ne l’ont pas empêché d’être réélu député fédéral en 2023.
Lire aussi sur Terrestres, Oiara Bonilla, « La vitalité des possibles face à l’extrême droite au Brésil », novembre 2018.
Le réseau d’influence tissé par la FPA et l’IPA met en lumière comment les intérêts économiques des multinationales pèsent lourdement sur les décisions politiques au Brésil, au détriment des régulations environnementales et des droits des peuples autochtones et communautés locales. Le cas brésilien illustre l’énorme pression économique qu’exercent de nombreux acteurs économiques, en premier lieu les multinationales de l’agroalimentaire et de l’extraction minière, sur de vastes zones naturelles comme l’Amazonie et le Cerrado. Les diverses formes que prend cette pression — des menaces qui pèsent sur les défenseurs de l’environnement et les communautés locales jusqu’à la déforestation massive, en passant par les pollutions industrielles, des conditions de travail indignes, ou la destruction de précieuses zones de biodiversité — se manifestent bien au‑delà du Brésil, que ce soit dans d’autres États amazoniens d’Amérique du Sud, dans les forêts tropicales d’Afrique équatoriale ou d’Asie du Sud‑Est, dans le vaste territoire canadien ou les steppes de Sibérie, et parfois même au nom de la transition écologique. Mettre en place et faire respecter de véritables politiques de préservation et de lutte contre le réchauffement climatique, quitte à contraindre l’appétit des multinationales, constitue l’un des défis majeurs du nouveau siècle.
Pour aller plus loin
Pour mieux comprendre le fonctionnement politique brésilien, l’Observatoire de la démocratie brésilienne propose un glossaire du vocabulaire politique brésilien.
Campelo Erika et du Roy Ivan, « Polluées, menacées, déplacées : ces communautés amazoniennes aux prises avec des multinationales européennes », Basta !, 25 septembre 2018.
De Olho nos Ruralistas, « Os Financiadores da Boiada: como as multinacionais do agronegócio sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental », Rapport, juillet 2022
Mighty Earth, « Monitoring deforestation in Brazilian supply chains », Rapport, mars 2024.
Pina Raísa, « Alimentando a desigualdade : os custos ocultos do monopólio industrial da carne », Rapport, avril 2024.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.
16.04.2025 à 10:08
Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes
Collectif les Navettes
“Dans quoi me suis-je embarqué·e ?”, s’est-on demandé la première fois qu’on y est allé. Et puis on n’a cessé d’y revenir, on y a même habité. Et quand on était loin, on brûlait d’y aller. De l’initiation politique à la violence des expulsions en passant par les chantiers ou les fêtes, extraits d'un récit à huit voix sur la zad de Notre-Dame-des-Landes, aussi captivant que beau.
L’article Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10944 mots)
Temps de lecture : 27 minutes
Ces textes sont extraits d’un livre écrit à huit et paru en 2022 sous le titre « Fragments de zad. Récits croisés d’allers et retours à Notre-Dame-des-Landes (2011-2018)1 ». L’ouvrage est signé du Collectif les Navettes, en référence aux navettes aller et retour entre la zad et le dehors de ses auteurices, qui ont été régulièrement à Notre-Dame-des-Landes ou y ont habité.
Les histoires qui suivent s’étendent sur huit années et racontent la zad depuis la première arrivée sur place de chacun·e jusqu’aux expulsions de 2018. Véritable archive décalée de l’occupation depuis le point de vue de celleux qui passent, les récits situés (et féministes) qui la composent racontent la zone comme un lieu de transformations, de vies qui bifurquent, d’apprentissages mais aussi de manques. Alors que des zads ne cessent d’ouvrir des brèches et des luttes, faisant face à une répression toujours plus dure, nous partageons ces histoires parfois trébuchantes, pour nourrir les récits de ce qui s’y trame et se donner la force de continuer.
Les mêmes questions nous étaient posées chaque fois que nous revenions de la zad de Notre-Dame-des-Landes : « Et ça ressemble exactement à quoi ? », « N’importe qui peut vraiment débarquer sans prévenir ? », « Mais qu’est-ce que vous avez bien pu faire de vos journées ? » Nous n’avons pas cherché à simplifier les réponses à ces questions. Ce récit n’est ni une zad-mode d’emploi, ni un voyage enchanté en terre promise. Dans ce texte, nos personnages trébuchent, glissent, planent, résistent, se laissent aspirer, happer – jusqu’à faire corps, pour certain·es d’entre nous, avec la zone.
Nous n’habitons pas ou plus à la zad aujourd’hui, et pourtant cet espace n’a cessé de nous absorber. Rendre compte de ces mouvements entre l’intérieur et l’extérieur de la zone, c’est montrer que la zad dont il est question ici (entre 2011 et 2018) n’était pas un espace clos : à travers les nombreuses « navettes » qui y circulaient, et dont nous n’étions qu’une infime partie, la zad produisait des effets qui ne s’arrêtaient pas brutalement une fois passé le bourg de Notre-Dame-des-Landes.
C’est peut-être cela que signifie l’énigmatique formule « zad partout ».
On aurait pu raconter cette histoire selon les codes habituels des sciences sociales, puisque c’est autour de la pratique des sciences sociales que nous nous sommes rencontré·es. Mais la zad nous a métamorphosé·es et cette expérience nous a intimé de changer de méthode et de format.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
ARRIVER
Facette n°2
Arriver sans se perdre.
Arriver à poser son sac à dos au sec.
Arriver à se donner une contenance avec sa mine toute fraîche.
Arriver à surmonter l’épreuve cinglante de ne rien comprendre.
Arriver à saisir (sans se décourager) qu’on n’est en fait pas du tout arrivé et que la zone de la zone, où on pensait enfin se poser, est un cran plus loin ou plus bas.
Arriver à revenir, arriver à rester, à repasser sans rester, c’est encore d’autres étapes.
Il y a quelque chose d’élastique ou de tout simplement adhésif dans cette zone.
On n’en finit pas d’arriver, parce que la zone a mille facettes. C’est irritant, absurde ou merveilleux, selon son humeur, sa plus ou moins connaissance des lieux, son histoire militante, ses contraintes hors zone.
Dans tous les cas, arriver, c’est plonger dans le lagenn2.

Voyage en terre inconnue – Audrey, vendredi 29 mars 2013
Je pars un vendredi matin en covoiturage pour Nantes. Nous sommes cinq personnes entassées dans une petite voiture. Je n’aurais pas dû dire où je vais passer mon week-end : le conducteur me sermonne sur les nombreux emplois que générerait selon lui la construction de l’aéroport. Je bafouille que j’y vais justement pour me faire une idée par moi-même de ce qui s’y passe. Et c’est vrai que je ne connais pas grand-chose de la zad et de son univers, ni d’ailleurs d’aucun milieu militant. À 29 ans, ma récente reprise d’études en master de socio me pousse à m’interroger de façon plus globale qu’avant sur le monde qui m’entoure, sur mon pouvoir d’agir dans la société dans laquelle je vis, sur les rapports de pouvoir et la politique. Ma réflexion et mon engagement sont en pleine construction.
Je vais rejoindre un ami de longue date, Tom, qui vit sur la zone depuis quelques mois. Il est clair que je ne me serais jamais aventurée toute seule dans cet endroit, dont je ne connais que l’aspect « lutte environnementale », si je n’avais pas connu quelqu’un sur place. Le fait que Tom habite ici éveille ma curiosité et me rend l’idée de venir plus accessible. C’est l’occasion d’aller rendre visite à mon pote, de me la jouer révolutionnaire du dimanche, et de confronter un peu mes idéaux à la réalité.
La réalité, là maintenant, c’est qu’il fait gris, froid, et qu’il pleut. Super. Et dire que j’ai une copine qui vit à Nantes, dans une vraie maison chauffée où je pourrais passer le week-end bien confortablement. Dans quoi je me suis embarquée ?
Descendue du car au village de La Paquelais, je remonte une route toute défoncée. Sous le ciel hivernal, les barricades en matériaux de récupe, les inscriptions sur le bitume, les tours de garde font une synthèse étrange entre une zone de guerre et le village des enfants perdus de Peter Pan. Aucune voiture. Je croise juste une fille, à pied, vêtue d’un imperméable et de bottes en caoutchouc. Je lui dis bonjour, elle me répond « salut ».

Je retrouve Tom qui m’amène dans le lieu où il vit, les Cent Noms. Dans le champ, je découvre une yourte, et un cabanon en planches attenant, dans lequel je pose mon sac. Derrière, une cuisine/salle à manger ouverte sur l’extérieur, construite en bois et matériaux récupérés. Il y a une grande table et des bancs, des décorations hétéroclites, telles que des affiches Wanted avec les portraits de François Hollande ou Jean-Marc Ayrault. Sur une façade en plexiglas est affiché un planning de tâches à accomplir avec des noms. Un peu plus loin dans le champ, il y a une sorte de petit poêle bricolé avec une bouteille de gaz vide et qui sert de cuisinière (j’apprendrai plus tard que ça s’appelle un rocket-stove). Il est protégé de la pluie par un auvent. Tom me dit que c’est hyper pratique parce que ça consomme très peu de bois. À un autre endroit du champ se trouve le « bloc sanitaire », en bois et panneaux d’OSB (des lamelles de bois liées par de la résine), composé de deux cabines de toilettes sèches fermant par un rideau ou une porte battante en bois (c’est la première fois que je vois des toilettes sèches), et d’une petite salle de douche, reliée à un tuyau d’eau (froide, évidemment). À l’extérieur, il y a un lavabo (non relié à un réseau d’eau), mais en cette période de fin d’hiver, il faut casser la glace le matin dans un seau d’eau pour se laver le visage… Ça ne me fait pas rêver. Le champ comprend aussi des parties aménagées en potager, avec plusieurs tunnels.
Avant toute chose, nous allons au Sabot pour me chercher une paire de bottes. Là-bas, il y a un freeshop.
– Si on trouve pas ta taille ici, on ira en chercher à celui de la Chateigne, me dit Tom.
Finalement, je trouve chaussures à mon pied. On m’explique que la cabane du Sabot existait déjà avant l’installation des Cent Noms : elle a été construite et occupée par des personnes qui étaient impliquées dans la lutte contre l’aéroport avant 2012. C’est un lieu emblématique de la zone car c’est l’un des premiers potagers collectifs et squattés : le jour de l’« ouverture », en mai 2011, fut l’occasion d’une manif-défrichage organisée conjointement par des habitant·es de la zone et le réseau Reclaim the Fields. C’est un réseau né dans les années 1990 au Royaume-Uni qui réunit des paysan·nes en devenir et des sans-terre qui militent pour la réappropriation de la production alimentaire – en français on dit Ramène Ta Fourche. Après la destruction des cultures et des installations à l’automne 2012, la plupart de ses occupant·es sont parti·es, traumatisé·es par l’intervention policière.
La réalité, là maintenant, c’est qu’il fait gris, froid, et qu’il pleut. Super. Et dire que j’ai une copine qui vit à Nantes, dans une vraie maison chauffée où je pourrais passer le week-end bien confortablement. Dans quoi je me suis embarquée ?
Nous retournons ensuite aux Cent Noms, où je sors le gâteau aux noix que j’ai apporté. Je m’étais un peu questionnée avant de venir sur le genre de choses que je pouvais apporter pour ne pas venir les mains vides et, pensant naïvement que les zadistes étaient forcément des écolos, j’avais fait un gâteau avec tous les produits bio que j’avais chez moi. Les quelques mecs qui sont là l’engloutissent sans demander la liste des ingrédients. Ça discute. Il est question de récupérer des semences et des poules à une association locale. Ils préparent aussi la manifestation qui aura lieu dans deux semaines : Sème ta zad. Ce sera une manif un peu particulière : les habitant·es appellent à venir cultiver les terres de la zone collectivement, en proposant de participer à divers chantiers agricoles3.
En fait, je ne comprends pas grand-chose à ce qu’ils racontent. J’ai l’impression qu’ils parlent une langue étrangère, et je n’ose pas les interrompre pour leur demander de traduire. Je me sens un peu mal à l’aise, une sorte d’intruse un peu potiche, au milieu de ce groupe qui se connaît bien et vit un quotidien commun, très éloigné du mien et dont je ne possède pas les codes.
Pendant ce temps, nous voyons par moment des hélicoptères survoler la zone. Cela n’a pas du tout l’air de perturber les habitant·es.
Pour dormir le soir, il y a le choix entre le Sabot et la yourte qui, à mes yeux, comporte l’avantage – non négligeable – d’être chauffée par un petit poêle, ce qui me tente pas mal. On est six ou sept à y dormir en rond. En fait, la yourte n’est pas si confortable, il n’y a que des couvertures au sol mais pas de matelas donc j’ai mal au dos et, s’il y fait très chaud lorsque nous nous endormons, il fait très froid quelques heures plus tard. Il me faut une force surhumaine pour m’extirper de mon duvet et chausser des bottes pour aller pisser au milieu de la nuit.

CHANTIER
La cabane féministe : la force de frappe – Sélène, mardi 28 mai 2013
Arrivées sur le chantier, Bass et moi, on cherche des yeux celle qui nous paraît « diriger » les opérations – en silence : demander qui est la « boss » du moment, ça nous aurait semblé comme prononcer une insanité politique. Notre investigation ne dure pas longtemps : on voit bien qu’il y a des meufs qui savent où sont les outils, comment les faire marcher et quoi faire exactement avec, à ce moment précis de l’avancement des travaux. Et la personne qui semble la plus informée de l’après-midi, c’est Béatrice – celle qui a fait l’annonce sur le fonctionnement du repas et la passation de consignes. Elle propose à Bass et moi de faire un banc ou une table. Elle nous montre le matériel dont on aura besoin pour construire ces meubles.
Manon nous propose une visite des lieux. Le chantier a commencé il y a une semaine, nous dit-elle, et il y a eu « dix jours de prépa ». Prépa ? Préparation du chantier : recherche du matériel, mise en place des toilettes sèches, de la cuisine extérieure au Gourbi, formation à l’usage des instruments. Les toilettes sèches ont été le premier gros chantier lancé, avec un bétonnage du sol. Manon nous y conduit pour qu’on admire le résultat. Une meuf avec une petite caméra et un micro nous demande si ça nous dérange pas qu’elle nous suive : elle veut faire une vidéo pour un site féministe (elle ne filmera que nos pieds). On accepte. Je suis heureuse de voir que la vidéaste n’est pas éjectée du site, qu’elle est bien accueillie. J’ai vu des personnes se faire insulter pour avoir pris des photos, même sans personne dessus.
Manon nous montre ensuite les fondations de la cabane : des poteaux de bois brûlés pour que cela ne pourrisse pas.
– Les meufs qui ont fait les plans ne sont pas là sur le chantier, nous explique-t-elle. Mais on est en contact avec elles à distance.
Elles ont fait les plans en fonction du matériel disponible. Les fondations et le sol sont faits de palettes rembourrées de terre-paille, le mur nord va bientôt être posé. La mezzanine est en cours de fabrication. Reste le mur sud à faire.
Tout semble très bien organisé. Il y a même les plans de la future cabane, scotchés sur une porte vitrée.
Manon clôt la visite en nous montrant les étagères où sont entreposés les outils, sous des bâches qui délimitent un espace d’une trentaine de mètres carrés, avec des bancs et des chaises à l’abri. Avec la pluie qu’il peut tomber ici, c’est nécessaire d’avoir un endroit sec.
Des bruits courent que toute la zad sera détruite en juillet et qu’il y aura une nouvelle vague d’expulsions. Mon diaphragme se contracte de rage : j’ai été harponnée par cette lutte.
Manon nous prévient qu’il y a une petite démotivation, en ce moment dans le chantier : il y a des bruits qui courent que toute la zad sera détruite en juillet et qu’il y aura une nouvelle vague d’expulsions. Je suis affectée par cette nouvelle, j’avais le sentiment que la partie était gagnée pour un an de plus.
Froissement intérieur. Mon diaphragme se contracte de rage : j’ai été harponnée par cette lutte.
– De toute manière, la zad est IM-PRE-NABLE : aussitôt détruite, aussitôt reconstruite, m’empressai-je d’ajouter.
À la mine prudente de mes interlocutrices, je vois bien que cette parole bravache est un peu ridicule, mais ça m’est venu sans réfléchir : cette petite phrase, je l’ai martelée tant de fois comme une formule magique auprès de personnes dubitatives (hors zad) que c’est devenu un leitmotiv – une croyance non-négociable.
Deux Italiennes font un mélange terre-paille. Des meufs expérimentées coupent du bois à la scie radiale, d’autres plantent des clous sur des planches destinées à faire une cabine de douche. D’autres encore rentrent d’une opération récupe avec des étagères, dépitées de n’avoir trouvé rien d’autre en guise de matériel de construction. Francine est au téléphone pour prendre rendez-vous avec quelqu’un·e qui donne un plancher. Le chantier fourmille de meufs autonomes, concentrées sur leur ouvrage. C’est jubilatoire.
[…]

Chercher les bons clous, trouver les bons marteaux prend un temps certain. Francine qui nous voit tourner en rond nous rassure : au moins, aujourd’hui, il y a assez d’outils pour tout le monde, parce qu’il y a eu des jours où il y avait trop de personnes volontaires pour le matériel disponible.
Comme on travaille en binôme, on a le temps de lever les yeux et de regarder autour de nous les à-côtés de ce chantier champêtre. Le soleil, caché par des nuages de plus en plus épais, devient intermittent. Deux meufs jouent de la musique (accordéon et djembé). Édith, qui s’est occupée du repas du midi au Gourbi, lézarde un peu. Elle cause avec Régine. Béatrice discute avec Arsène, une meuf du groupe féministe de la zad. Manue (une autre meuf du groupe féministe) arrive comme un bolide pour annoncer qu’à 17h, il y a une réunion sur la fonction de la cabane féministe et qu’elle n’en sera pas, parce qu’elle a une autre réu’. Son absence déçoit d’autres meufs – signe que sa présence est importante.
L’échelle terminée, on la place contre un arbre, on la fait tester à Francine qui peut monter sans problème. On n’est pas peu fières.
L’avantage d’être nombreuses sur d’infimes tâches, c’est que mises bout à bout, ça finit par faire une cabane habitable, avec le loisir de faire des pauses, puisqu’il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre. Bass et moi, on se met au repos.
Ambre arrive. Elle fait un tour sur le chantier, en nous faisant un petit signe de reconnaissance. On avait discuté longuement avec elle en mars. Une autre meuf se lance dans la construction d’une table – pas une table basique, mais avec des pieds encastrés dans des poutres. Elle utilise le ciseau à bois. Anne la rejoint, voyant qu’on n’est pas motivées pour faire les étagères. Bass et moi, on décide d’aller gonfler notre matelas. Ça va, ça vient. Ça usine, ça procrastine.

Une fille, habillée chic pour la zad (avec une veste en cuir cintrée, toute neuve) passe pour déposer le Zad News – sous la forme de feuillets A4, transmis de la main à la main sur la zone avec le planning des activités de la semaine 4. Elle fait la bise à Francine et Édith, qui loge le journal sous le bras et place les deux doigts dans la bouche pour siffler de joie.
– Le Coin a droit à sa première distribution de Zad News !
Le Coin. C’est la première fois que j’entends le nom de la cabane en situation. Nous voici donc en train de construire la cabane du Coin.
Une meuf arrive, pieds nus, avec un enfant sur les épaules et s’assied sur un banc avec Francine et Édith. Elle reste une heure et s’en va.
La présence de cet enfant me fait penser à l’absence des miens – au fait que je n’ai pas envisagé de les emmener, que rien sur l’annonce de ce chantier sur le site zad.nadir ne laissait pas penser qu’on pouvait venir avec des enfants. J’aimerais bien pouvoir parler du fait que j’ai des enfants, que j’aurais bien aimé venir avec eux, que ce n’est pas rien pour moi, de partir et de les laisser, mais quelque chose me retient. Je me sens soudainement d’une normalité coupable.
Lire aussi sur Terrestres : Christophe Bonneuil, « Comment la ZAD nous apprend à devenir terrestres », mai 2018.
Béatrice (qui a participé à la conception de la charpente) lance un appel général pour aider au levage du mur nord. Il est terminé et tout le monde doit venir aider à le porter pour pouvoir l’installer sur le plancher de la cabane et le clouer. Il faut des personnes pour lever, deux personnes pour vérifier les niveaux, et quatre personnes pour clouer au plancher la poutre du bas du mur. Je me porte volontaire pour clouer. J’aime bien clouer. Dix filles sont mobilisées autour de Béatrice pour porter la structure en poutres. Cette structure sera ensuite comblée avec des palettes et de la paille, si j’ai bien compris, puis couverte d’un bardage en bois, récupéré d’une scierie. Manue se porte volontaire pour le fil à plomb en disant qu’elle ne sait pas s’en servir. Il faut être nombreuses pour porter la structure car il ne faut pas que les poutres ploient. Donc il faut tout porter ensemble à la même vitesse, à la même hauteur. L’opération de levage est réussie. On pose la structure au ras du plancher. Avec le niveau, on vérifie que c’est droit et on cloue.
Le levage du mur nord sera le seul moment de l’après-midi où tout le chantier sera mobilisé. Nous sommes une vingtaine. C’est un moment collectif fort qui me plonge dans l’imagination des chantiers d’antan où tout le village venait donner un coup de main. L’absence de machines obligeait alors toutes les forces disponibles et valides, quelles que soient leur force, à coopérer. En ce mois de mai 2013, nous sommes une vingtaine de meufs (grandes, petites, habiles, malhabiles) et on a une sacrée puissance d’agir.

DEAMBULER
Holstein #1 – Sandhi, jeudi 17 novembre 2011
Il est tôt. Fañch va partir pour la journée, il a deux ou trois réunions à la suite. La vie de révolutionnaire anti-aéroport n’est pas de tout repos. Comme il devait avoir mauvaise conscience de me laisser toute seule avec son poster des 24h du Mans, il m’a rencardée avec Jakez, un vieux copain à nous qui habite dans un autre squat de la zone. Vieux, tout est relatif : j’ai 23 ans et eux, pas plus de 30.
Avant d’enfourcher son vélo pour partir à sa réunion n°1, Fañch me fourre une carte de la zone dans les mains et m’indique vaguement le chemin.
– On est là, qu’il me montre, à la Pointe. Ici c’est les voisines de la Maison Rose. Toi tu vas là-bas, au Rosier.
Bien. Très bien. J’ai même droit à un vélo. Encore mieux. Une chicorée soluble et je pars pour le Rosier au guidon du vieux vélo de route sans freins et trop grand pour moi. Au bout d’un kilomètre, j’ai déjà failli me casser la gueule quatre fois et je me rends compte que le pneu arrière n’est pas du tout gonflé. Ça commence mal. J’abandonne le vélo dans un fossé.
En vrai, c’est loin. Je sais pas si c’est la carte qui est pas à jour ou moi qui suis nulle en orientation – ou les deux – mais je traverse plusieurs ronciers qui avaient pourtant l’air d’être des chemins. Je patauge dans de nombreuses flaques. Les champs sont grands mais pas immenses, entourés de talus, entrecoupés de bois. C’est assez joli.
C’est drôle parce que, d’un côté c’est bêtement la campagne – des champs, des maisons en parpaings, de la boue, des tracteurs et des Holstein – et d’un autre côté, je croise des gens de moins de 80 ans, à pied ou à vélo, qui se parlent. Sur la route, les voitures passent lentement. C’est très perturbant. C’est comme la campagne, mais une campagne vraiment habitée, où il y aurait des gens. Qui ne font pas que passer, je veux dire.
Je ne sais pas combien de temps je marche. Peut-être deux heures. Jakez n’est pas du tout étonné de me voir arriver si tard, mais beaucoup plus que je sois venue à pied. Il nous fait une chicorée. Je fais sécher mes chaussures de rando à côté du poêle. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu·es. On parle de sa vie sur la zad. De cette maison, qui a été la première de la zone à être squattée. De la lutte en cours et des menaces d’expulsions. Des citoyennistes qui s’offusquent à chaque œuf de peinture lancé sur une façade de bâtiment public. Des assemblées générales interminables.
Sur la route, les voitures passent lentement. C’est très perturbant. C’est comme la campagne, mais une campagne vraiment habitée, où il y aurait des gens.
– C’est fou comme on a changé nos manières de réfléchir certaines choses, il m’explique. Quand on s’oppose aux carottages qu’ils font pour analyser le sol et voir par où ils commencent leurs travaux, on cale nos rendez-vous en fonction de l’heure de la traite, pour que les paysan·nes puissent participer. Moi comment dire, jusqu’à y a pas longtemps, l’heure de la traite des vaches c’était pas vraiment un truc qui m’intéressait dans la vie, alors m’organiser en fonction de ça…
Euh… oui, en effet l’heure de la traite c’est pas un truc auquel je pense moi non plus quand j’organise une manif. On pèle des châtaignes pour faire de la crème de marrons. Ça prend des plombes. On se refait une chicorée.

Facette n°16
Visiter des lieux de vie, à la vitesse de l’escargot, en glissant d’un champ à l’autre, plutôt que de converger dans un lieu centripète, c’est un geste politique très singulier : la déambulation peut se muer en micro-assemblée nomade – impromptue – qui tâte avec les pieds, la bouche et les yeux des particules de vie radicalement différentes. C’est promener son ignorance, échanger des nouvelles, intercepter une idée, régler un malentendu, transborder un objet et repartir avec des bouts de voisinage dans l’estomac. L’air de rien, ça crée une sorte de liant (visqueux et scintillant) dont il devient difficile de se défaire.
Facette n° 17
Les identités que l’on a l’habitude de coller hâtivement aux dégaines que l’on croise dans la rue pour savoir comment interagir, volent en éclat sur zone. Déduire en un coup d’œil de la tête aux pieds le pedigree d’une personne qui déambule (D’où vient-elle ? Que fait- elle ?), c’est une opération franchement hasardeuse et énergiquement contestée. Il y a pourtant bien des codes militants assez visibles, qui se lisent dans les manières de parler et le choix de son lieu de vie, mais il y a ici tant de passages et de turn-over, tant d’exceptions qui confirment la règle, tant d’événements qui agrègent des profils hétéroclites, que le jeu des catégorisations est très fortement perturbé : la zone est mouvante.
Lire aussi sur Terrestres : Earth First, « Une décennie de ZAD en Angleterre », juin 2020.
KAFETA
Facette n° 19
Kafeta [kaˈfeːta] (vb. intransitif). En breton : boire le café, à plusieurs. Par extension : discuter de façon interminable, raconter sa vie, colporter des rumeurs, faire une pause dans sa journée de travail pour aller voir la voisine.
Facette n° 20
Ici, pas de bar, pas de kebab au coin de la rue. Même pas de rue, en fait. Mais des volontaires motivé·es pour convoyer du matériel par tous les temps, sans assurance de branchement électrique et de raccordement à l’eau, nourri·es d’une forte expérience de banquets-concerts-teufs-festoù-noz dansants. Toutes les luttes n’ont pas la chance d’allier les forces du monde paysan, du monde des squats, de l’autonomie, du bien-vivre écolo et bricolo, et l’amour du dancefloor.
Facette n° 21
Loin de nous l’idée de faire des festivités à la zad uniquement des parties de plaisir où les rapports de pouvoir, comme les conflits politiques ou interpersonnels, seraient suspendus et disparaîtraient comme par magie. L’alcool peut rapidement devenir un enjeu de lutte (Qui en achète ? Comment se le procurer ? Comment le répartir ? Vendu à prix fixe ou à prix libre ?), avec son lot de déboires.
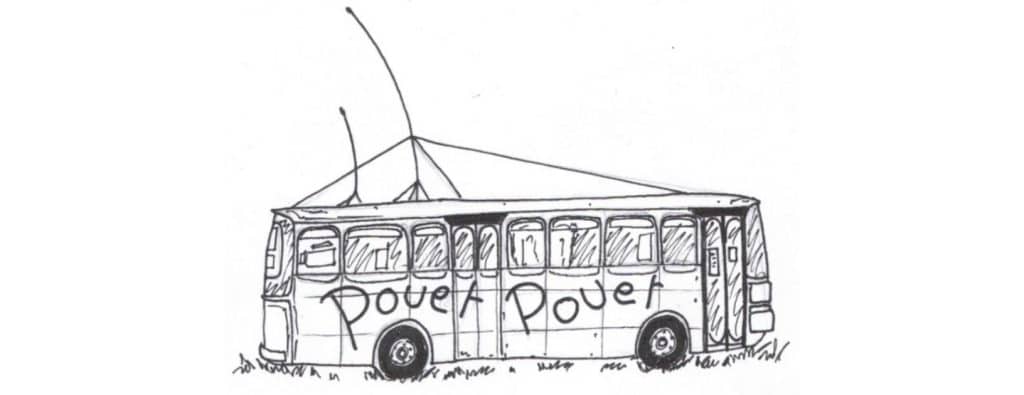
« Dormir, c’est lutter » – Luce, lundi 28 janvier 2013
Il est 5h du mat’. On a promis avec un copain du Port qu’on prendrait la relève à la barricade Sud (ou Bison futé) à 5h30. Merde, il pleut encore. Je cherche à tâtons mes affaires : formidable, elles sont encore trempées de la veille. Le temps de remplir un thermos de tisane brûlante et on s’aventure sur les chemins boueux et encore givrés. Quand on arrive sur la D281, le ciel commence à se découvrir. On arpente la route plutôt que de stagner quelque part : il fait trop froid.
Le jour se lève au rythme de nos pas et des gorgées de tisane. Vers 8h30, quelques fourgons de flics stationnent au niveau du Bois Rignoux (à environ 500 mètres de Bison Futé). Ils semblent venir dans notre direction. Ils s’approchent puis repartent. Manœuvre incompréhensible, s’il en est. Est-ce qu’ils veulent juste nous montrer qu’ils sont là et maintenir la pression ? Est-ce qu’ils cherchent des brèches ? Un copain nous dit qu’ils sont venus détruire certaines barricades vers 4h du matin.
On rentre en fin de matinée au Port. Le soleil nous fait grâce de quelques-uns de ses rayons qui réchauffent un peu la cabane. On se fait des tartines, qu’on trempe dans du café en écoutant Radio Klaxon. On entend passer la chanson de Jean-Jacques Goldman « Encore un matin, un matin pour rien […], un matin ça ne sert à rien ». Je ne sais pas si c’est la fatigue, mais je n’arrive plus à m’arrêter de rigoler.
Toutes les luttes n’ont pas la chance d’allier les forces du monde paysan, du monde des squats, de l’autonomie, du bien-vivre écolo et bricolo, et l’amour du dancefloor.
Myrtille se réveille tout juste, elle ouvre un œil, nous voit, replonge sa tête dans le matelas en grommelant :
– J’ai pas envie de faire la guerre.
Le copain avec qui j’ai passé la matinée remonte se coucher pour bouquiner. Mathieu se met à cuisiner le poisson de la récupe pour les chiens. Inna fait bouillir de l’eau pour faire la vaisselle. Myrtille traîne au lit. Elle est descendue chercher une tartine puis remontée pour écrire dans un cahier où il y a marqué « Rêves » dessus. Aïmti passe pour prendre un peu de tabac.
Je demande à Myrtille ce qu’elle pense faire aujourd’hui. Elle me dit qu’elle veut aller sur le chantier de l’Observatoire, mais pas tout de suite. Elle descend et s’affale sur le canapé :
– Dormir, c’est lutter.

« Boom ! » féministe à la No-TAVerne – Gio, samedi 16 mars 2013
The-place-to-be, ce soir, c’est la No-TAVerne.
Derrière le comptoir, deux filles servent des bières et du vin chaud à qui le demande. Tout est à prix libre, à déposer dans la tirelire sur la table. On est vite à l’étroit dans cette petite cabane. Ambiance chalet de montagne sur zone humide.
Au fond, il y a « le groupe des barricades », assis sur un banc. Il n’y a là que des mecs, sauf une fille qu’on avait aperçue avant. Le contraste est frappant, entre ce groupe de mecs assis au fond et toutes les filles qui sont debout autour du bar.
Pour le reste, c’est une vraie boum comme on les aime qui commence. Au-dessus de nos têtes, il y a la boule à facette fabriquée par les Suisses, faite de bouts de miroirs. On la fait tourner à la main pendant qu’on danse. Les petites enceintes crachent un mix éclectique de musiques plus ou moins engagées et dansantes. S’y retrouvent pêle-mêle du Casey, M.I.A, La Gale, Le Tigre.
Les petits groupes se font et se défont : on trinque, on chante, on échange, on danse. Édith, qu’on a pas mal croisée ces derniers jours, notamment la veille au Gourbi, parle avec Bass autour de la table du fond. Elle a la cinquantaine bien tassée et porte une grosse parka contre le froid. Un mec l’interpelle.
– Tu ne vois pas que tu nous interromps ? J’étais en train de parler.
Son ton est sec, mais pas méchant et même si le type a l’air complètement saoul, il encaisse la réprimande sans broncher. Édith parle des barricades :
– Qui doit s’occuper des barricades ? Est-ce qu’on provoque ou pas les flics ? Ça devrait être décidé collectivement. C’est un problème qu’on puisse identifier un groupe des barricades, ça devrait tourner, il faut pas qu’il y ait des spécialistes des barricades.
Édith n’a pas vraiment d’endroit fixe. On est assez admiratif·ves de cette capacité à vivre sans un vrai chez soi, un endroit où tu peux te retrouver seul·e. Elle nous rétorque qu’elle marche beaucoup toute seule dans la journée, que ça lui suffit.
Je croise d’autres gens, des Norvégien·nes qui passaient par là et ont un discours très idéalisant sur la zad.
– That’s crazy! You have built cabins on a very big area and it works! Imagine if we could do this everywhere! If we would do this in Norway… C’est dingue ! Vous avez construit des cabanes sur un territoire hyper large et ça marche ! Imaginez si on pouvait faire ça partout ! Si on faisait ça en Norvège…
On parle également d’une lutte contre un projet de mine là-bas. Ielles ont essayé d’occuper le terrain aussi mais c’était beaucoup plus petit et ça n’a pas fonctionné.
À l’inverse de cette binarité construite médiatiquement entre les « zadistes » et les « gens normaux », il y a ces navettes, ces circulations, ces lignes de crêtes sur lesquelles on apprend à déceler des marges.
Plus tard dans la soirée, une embrouille éclate lorsqu’un jeune mec parle du patriarcat. Il dit que les hommes aussi sont opprimés dans cette société et que, quand même, ça va mieux maintenant : les inégalités ne sont pas aussi violentes qu’avant. Un autre homme s’emporte : il ne supporte pas ce genre de discours qui minimise l’oppression des femmes. Il se casse. Débute une longue discussion avec Édith sur la place de la pédagogie dans le militantisme féministe. Mon avis c’était que les mecs doivent faire de l’éducation avec les relous, plutôt que de faire des sorties spectaculaires. Elle, au contraire, pense que c’est important de porter le conflit : il vaut mieux leur gueuler dessus un bon coup, histoire de leur passer l’envie de dire n’importe quoi.
Facette n°27
À l’inverse de cette binarité construite médiatiquement entre, d’un côté, les « zadistes5 » boueux·ses et hargneux·ses qui vivent du RSA au fond de la forêt, et de l’autre, les « gens normaux » qui travaillent et s’insèrent dans la société, il y a ces navettes, ces circulations, ces lignes de crêtes sur lesquelles on apprend à déceler des marges. Des couloirs, des brèches, de vastes parcelles. L’idée, c’est moins de créer des zones, avec un dedans et un dehors, que de multiplier les canaux et les courants qui se croisent, brassent. Nous revendiquons la joie de voyager entre les mondes, d’être multiples, plurilingues et incohérents. Nous refusons de choisir si nous en sommes ou pas : nous en sommes, c’est tout.

EXPULSIONS
Facette n°39
Ce chapitre n’était pas prévu. Le 12 avril 2018, nous avions rendez-vous pour avancer sur ce livre. On a bien été obligé·es d’annuler : l’opération d’expulsion de la zone a commencée le lundi 9 avril à 3h du matin et à partir de là, tout a basculé : nous nous sommes retrouvé·es à défendre la zad, sur place ou ailleurs, comme on pouvait. Le travail de rédaction a été suspendu durant quatre mois avec un accord tacite : il faut finir ce livre. Et une évidence : on ne peut pas ne pas raconter comment nous, ici et là-bas, on a vécu la violence de ces expulsions.
C’est moins léger, c’est plus intense.
On n’a pas cherché à polir les bords trop rugueux de certaines formules pour emboîter nos points de vue. Il est fort probable que le lissage de nos différences de perception soit impossible ni même souhaitable. Il est à la source même de cet assemblage.
C’est rare d’écrire à plusieurs bords et de tenir le pari de l’entre-bords jusqu’à la dernière ligne. On espère que ces récits en stimuleront d’autres pour que l’histoire s’écrive à mille voix.

Êtres expulsé·es – Yael, lundi 9 avril 2018
Il est 2h55 quand mon réveil sonne. J’allume le talkie, sors le téléphone de son silence. Des dizaines de textos, les flics sont partout. Ils quadrillent, encadrent, nassent la zone de leurs centaines de fourgons, de leurs trois blindés et de leurs chiens de garde. J’enfile un pull et la voix des ami·es aux entrées est de la zone :
– Ils nous ont allumé le spot dans la gueule, on enflamme la première barricade !
Cœur qui court après ses battements. Ma cohabitante et moi, on sort en catastrophe de notre cabane. L’hélicoptère est juste au-dessus de nos têtes et un faisceau brillant nous douche de son indiscrétion. Je les hais déjà.
3h02, la deuxième. Puis quelques minutes plus tard, la troisième barricade de la D281 est allumée. L’angoisse dans la voix des copaines derrière les talkies. La route est vite envahie de flics. Ielles sont si peu sur place, à donner l’alerte, à déclencher les premières étapes de la résistance. 3h10 peut-être, ce message surréaliste :
– Le blindé traverse la troisième barricade enflammée.
Tout va déjà trop vite. De tous les scénarios que l’on a ruminés pendant des années, c’est celui du blitzkrieg qu’ils semblent avoir adopté.
Et boum, boum, boum font les premières grenades.
Un instant je suis perdue, au milieu de la cour de la ferme où je vis depuis plus de deux ans. Ce n’est pourtant pas faute de connaître ma mission, de l’avoir préparée depuis l’automne 2016, avec les groupes dans lesquels je m’organise. Je sais bien ce que j’ai à faire dans ces premières heures de guerre. Mais mon cerveau rame, après la pauvre sieste d’une heure qui m’a servie de nuit. Et sous mes côtes, ça respire difficilement.
Ces voix que je reconnais derrière les appels talkie : c’est l’image de mes ami·es qui surgit violemment devant mes yeux. Ielles se feront peut-être arrêter dans les minutes, les heures, les jours à venir. C’est plus que de la panique, c’est être submergé·e par un tsunami de répression. Tout ça pour une poignée d’hectares et quelques irréductibles optimistes qui pensent que le monde est encore rattrapable.
De l’art de la proportion en territoire français.
Le téléphone dans une main et le talkie dans l’autre, mon regard jongle et je retransmets instantanément ce que j’y entends à ma cohabitante, qui semble elle aussi être rentré dans un moment de flottement. Elle va d’un hangar à un autre, en passant par son véhicule. Pendant quelques minutes, elle tourne en carré. Elle s’active finalement pour aller faire une marmite de café. Rappel au devoir, mes neurones se reconnectent. J’ai, moi aussi, des missions, un rôle à tenir.
On s’embrasse, on se souhaite bon courage. Quelque chose se tord à l’intérieur de moi, quand je pense que je ne sais pas quand je la reverrai.
Boum, boum, boum, continuent les grenades. Les détonations sont tantôt assez légères (lacrymos) tantôt incroyablement fortes (GLI-F4, assourdissantes, désencerclantes), au point de résonner sous mes pas. Il doit être 3h15, 3h20 au maximum. La nuit est chargée d’un noir épais, on ne voit pas à quelques mètres, même à la frontale. J’avance mécaniquement, relayant tout ce que je peux au talkie. Je pense à mes ami·es proches, dont je n’entends pas la voix, nulle part. J’ai peur pour tout le monde, d’un coup. J’ai peur que la nuit les emporte loin, dans un fourgon bleu marine peuplé de truands de la démocratie, de brutes assoiffées de vengeance. J’ai peur de ce qui peut arriver à tout le monde, sauf peut-être à moi.

Tous les dessins sont de Milo.
Certains de ces textes et bien d’autres sont à retrouver sur le site internet de Fragments de zad.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Éditions PETRA, collection « Textes en contexte ». Une partie des textes sont disponibles sur le site internet de Fragments de zad.
- Lagenn (n.f.) [ˈlaɢɛnː]. En breton : cloaque, bourbier, endroit humide et collant dont on n’arrive pas à se dépêtrer. « Être dans le lagenn » : par extension, en français local de Basse-Bretagne, être en mauvaise posture, être dans le pétrin.
- Voir l’appel pour cette première édition de Sème ta zad qui se déroulera le 13 avril 2013 (y est fait référence à la manif d’occupation potagère de la ferme maraîchère du Sabot de mai 2011 dans la lignée de laquelle Sème ta zad s’inscrit).
- D’abord pas plus élaboré qu’une feuille A4 pliée en deux bien souvent écrite à la main, et fort, quelques années plus tard, de dizaines de pages imprimées à plus de quatre-vingts exemplaires et distribuées sur quelque quatre-vingt-dix lieux de vie, le ZN, c’était le canard hebdomadaire local de référence pour qui vivait ou passait sur la zone. Souvent critiqué pour son contenu (qui n’a jamais eu vocation à être consensuel, puisque la politique était de publier tout ce qui était soumis), c’était à la fois un outil d’information interne (avec un agenda, des annonces, des comptes rendus de réunions, des articles concernant des luttes camarades…) mais aussi de « dialogues » contradictoires (voire franchement de règlements de comptes). Les Unes étaient souvent la production d’artistes locales·aux discret·es ou de sessions collectives de dessin. Le contenu était récupéré grâce à une boîte mail ainsi que des boîtes aux lettres physiques. Le lundi après-midi, des facteur·ices éphémères allaient se perdre, carte en main, à travers le bocage et distribuaient la feuille de chou attendue, en l’échange parfois d’un café et de quelques explications contextuelles des embrouilles et enjeux en cours.
- « À la base, le mot “zadiste” était revendiqué par certains occupants et il s’est répandu à partir de 2012. Au moment où a fleuri le slogan “ZAD partout”. C’est un truc d’identification qui donne de la force. Mais assez vite, on se dit que ça peut aussi être piégeux. Après la mort de Rémi Fraisse, tout le monde parle de la ZAD. Se crée alors une identité figée du “zadiste”. La force de la composition du mouvement contre l’aéroport, c’est de bouleverser les identités de chaque composante : paysans, riverains, squatteurs et de les mélanger. À des moments, l’identification est une force d’affirmation et à d’autres, elle te fige dans un folklore. Au moment où il se diffuse le plus largement, l’usage par les médias et les politiques du mot “zadiste” devient plus hostile ». (source : « La ZAD, ça marche, ça palabre, c’est pas triste », Jade Lindgaard, Médiapart, 15 avril 2017). En 2016, le Petit Robert crée une case pour ranger les habitant·es de la zad : « Militant qui occupe une ZAD pour s’opposer à un projet d’aménagement qui porterait préjudice à l’environnement ».
L’article Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr