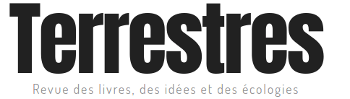05.02.2026 à 18:45
La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse
La rédaction de Terrestres
Souhaitable, la réindustrialisation ? Déroutées par la course impériale à la puissance, les élites ultralibérales chantent le retour de l'industrie en Europe. Et si on réfléchissait plutôt à la dynamique technologique incontrôlable et à ses effets de domination ? Pour cette sixième rencontre Terrestres, retour sur la pensée du philosophe Herbert Marcuse.
L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (2677 mots)
Temps de lecture : 5 minutes
Table-ronde le jeudi 5 février avec les philosophes Aurélien Berlan, Haud Gueguen et Jean-Baptiste Vuillerod. Une rencontre organisée par Terrestres à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30). Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.
Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.
Qui connaît encore le philosophe allemand Herbert Marcuse (1898-1979) ? À la mort de celui-ci, André Gorz, figure de l’écologie politique alors en pleine ébullition, lui rend hommage : « Nous sommes tous enfants de Marcuse ». Peut-on lire cette formule comme une invitation à voir dans Marcuse un intellectuel qui a contribué à nourrir le fond théorique et politique de l’écologie politique ?
Cette sixième Rencontre Terrestres explorera cette hypothèse en revenant sur son œuvre, relue à l’aune de l’effondrement écologique et de notre dépendance extrême aux technologies. Dès 1955, alors que l’enchantement par la consommation de masse domine, Marcuse développe depuis les États-Unis une critique du consumérisme et du type d’être humain qu’il produit.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Dans Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964), Marcuse analyse la nature de la technologie moderne afin de comprendre dans quelle mesure elle participe d’un projet politique et capitaliste de domination. Cet examen le conduit à développer des thèses ambivalentes, voire contradictoires : il perçoit à la fois le caractère aliénant du pouvoir technologique, mais également ses potentialités émancipatrices dans l’optique d’une révolution permettant une réappropriation de l’infrastructure du capitalisme industriel. Dans ces conditions, comment hériter de Marcuse ? Comment actualiser les chantiers théoriques et politiques qu’il a ouverts ? Comment le lire à l’heure de la prédation généralisée et de l’emballement technologique et climatique ?
Dans un colloque intitulé « Écologie et révolution » et organisé à Paris par André Gorz en 1972, Marcuse proposait de voir dans la « guerre contre la nature » le phénomène central pour analyser le capitalisme dans sa contradiction avec les écosystèmes et les milieux de vie. À l’heure de la catastrophe écologique, il est urgent de redécouvrir les leçons stratégiques de cet auteur en vue de s’atteler à la grande tâche politique qui demeure plus que jamais la nôtre : en finir avec le productivisme et les formes de subjectivité qui en soutiennent la destructivité.

La rencontre abordera les thèmes suivants :
1/ Pourquoi relire Marcuse aujourd’hui ? Les intervenant·es nous parleront de leur intérêt pour cette œuvre et analyseront le renouveau éditorial qu’il suscite dans divers pays.
2/ Retour sur le contexte de l’écriture de l’œuvre de Marcuse : rappel biographique ; brève présentation de la théorie critique de l’Ecole de Francfort et de son rapport à Theodor W. Adorno-Max Horkheimer ; engagement politique de Marcuse aux côtés des mouvements de jeunesse des années 1960-1970 et découverte de la question écologique.
3/ Discussion autour du diagnostic de Marcuse sur la technologie moderne : quelle est la nature de l’ordre socio-technique produit par la dynamique de rationalisation et d’industrialisation ? Comment le travail, l’ordre politique et les sujets sont-ils façonnés par le développement continu des forces productives ? Comment penser avec Marcuse une transformation du travail et des techniques, au service de l’émancipation et de l’autonomie ?
4/ Analyse de la pensée écologique de Marcuse : son élaboration théorique se fait en lien étroit avec une réflexion sur le féminisme, l’anticolonialisme et l’anti-autoritarisme, dans la mesure où il s’agit à chaque fois de mettre au jour une dimension spécifique de la domination capitaliste. Penser l’Anthropocène et le Capitalocène avec Marcuse signifie qu’une écologie politique conséquente est nécessairement anticapitaliste, féministe et anticoloniale.
5/ Comment articuler une critique du mode de production capitaliste et une critique de la modernité fondée sur un partage du monde où les êtres et les choses sont hiérarchisés selon la distinction nature/culture ? On fera ici dialoguer Marcuse avec les critiques contemporaines de la nature et du naturalisme (Descola, Latour) : le philosophe allemand défendait une approche où l’idée de nature, réélaborée dans le sillage de Marx, offre un point d’appui essentiel pour appréhender et penser la domination sociale et capitaliste de la nature. Dans cette perspective, le concept de nature est indépassable ; c’est le fondement à partir duquel on peut critiquer à la fois la modernité et le capitalisme.
Le jeudi 5 février 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des mariages – 2 place Baudoyer – 75004 Paris.
Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.
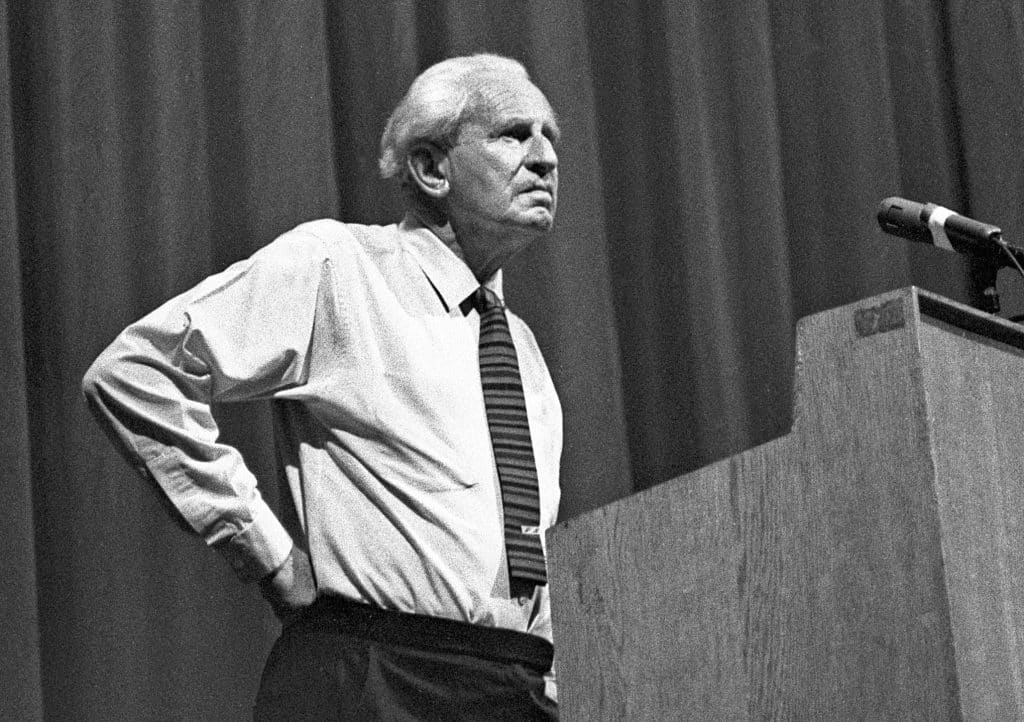
Intervenant·es :
Aurélien Berlan est maître de conférence au département de sciences économiques et gestion de l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Il a contribué aux écrits du Groupe Marcuse (De la misère humaine en milieu publicitaire, La Découverte, 2004 ; La Liberté dans le coma, La Lenteur, 2013). Il a publié un essai sur la critique de la modernité industrielle par les sociologues allemands : La Fabrique des derniers hommes (La Découverte, 2012), et une théorie de la liberté articulée au féminisme de la subsistance : Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021).
Il a notamment écrit dans Terrestres : Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance et Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre.
Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Ses travaux portent sur les sciences humaines et sociales du possible et sur l’histoire du néolibéralisme. Elle a notamment publié Herbert Marcuse. Face au néofascisme (Paris, Amsterdam, 2025) ; avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), et avec Laurent Jeanpierre : La Perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).
Elle a notamment écrit dans Terrestres : Désirer après le capitalisme.
Jean-Baptiste Vuillerod est agrégé et docteur en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie de Hegel et ses réceptions dans les pensées critiques contemporaines : la philosophie française des années 1960, l’École de Francfort, les théories féministes, l’écologie politique. Il a notamment écrit Theodor W. Adorno : La domination de la nature (Amsterdam, 2021).
Il a écrit dans Terrestres : L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes.
Pour écouter les anciennes Rencontres Terrestres, c’est ici.
Photo d’ouverture : Herbert Marcuse with his then UC San Diego graduate student Angela Davis, 1969. Crédits : Monoskop.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.
20.01.2026 à 10:58
Comment faire bifurquer la recherche scientifique ?
Bernadette Bensaude-Vincent
La recherche scientifique joue un rôle central pour documenter l’étendue et la gravité de la catastrophe écologique. Mais la science n’est-elle pas aussi un moteur de cette crise ? Dans son livre “Décroiscience”, Nicolas Chevassus-au-Louis revient sur l’époque charnière des années 1970, où s’est développé un double mouvement d’autocritique de la science et de l'économie.
L’article Comment faire bifurquer la recherche scientifique ? est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5995 mots)
Temps de lecture : 14 minutes
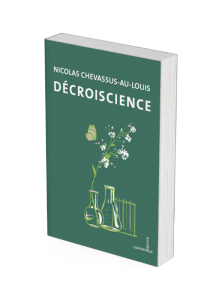
À propos du livre Décroiscience de Nicolas Chevassus-au-Louis, paru aux éditions Agone en 2025.
En 2016, Nicolas Chevassus-au-Louis livrait un diagnostic pessimiste sur l’état de la recherche scientifique dans Malscience. Fraudes, dérapages, malversations, compétition, quelque chose est pourri dans le royaume des sciences. Près de dix ans après, la situation ne s’est guère améliorée, tandis que l’état de la planète ne fait qu’empirer. Une analyse critique du régime normal de production scientifique sous l’angle de la crise planétaire est donc bienvenue. Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à cette crise, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ? Autant de questions qu’un journaliste « critique de science » comme Nicolas Chevassus-au-Louis aborde courageusement avec l’humour du dessinateur Stéphane Humbert-Basset qui illustre agréablement chaque chapitre. L’ouvrage évite l’écueil des polémiques entre les gardiens autoproclamés de la raison et prétendus complotistes en rapprochant l’histoire de la décroissance économique de celle des autocritiques de scientifiques. L’alliance entre les deux se noue autour de la figure d’Alexandre Grothendieck. Ce célèbre mathématicien, lauréat de la médaille Field en 1966, qui cesse de publier ses recherches à partir de 1972, année du rapport Meadows, pour se consacrer à l’enseignement et au militantisme écologique, est le véritable héros de Décroiscience.
Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à la crise planétaire, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ?
Le titre accrocheur, Décroiscience (néologisme introduit par Jaques Testart1), est source de malentendu. Car le champion incontesté de la décroiscience en 2025 est Donald Trump. Depuis le début de son deuxième mandat à la Maison Blanche il met tout en œuvre pour porter un coup d’arrêt au régime normal de la recherche scientifique. Réduction des crédits aux agences de recherche, censure de programmes, atteintes à la liberté académique, refus de coopérations internationales… Ces mesures affecteront la dynamique de croissance des connaissances sur plusieurs générations. Assurément, ce n’est pas le genre de décroiscience que propose ce livre. Il reste que l’analogie suggérée par le titre entre décroissance économique et décroissance de la production scientifique est discutable. Les limites auxquelles se heurte l’augmentation du savoir scientifique ne sont pas de même nature que les limites planétaires de la croissance économique. Par-delà le coût environnemental des activités de recherche et d’innovation, ce sont surtout des choix politiques qui sont à questionner. Or la politique de Trump vise moins à étouffer la recherche scientifique qu’à la mettre au pas, au service de ses intérêts et de ses idées. Il finance les recherches compatibles avec ses objectifs. Michael Kraitsos, conseiller scientifique du président, se présente en restaurateur de « la Gold Standard Science » rappelant les principes de l’intégrité scientifique. La brutalité de ces mesures révèle en fait la vulnérabilité des communautés scientifiques, entièrement dépendantes des politiques pour leur fonctionnement et leurs orientations de recherche. La situation de subordination de la science aux impératifs politiques n’est pas vraiment diagnostiquée dans le livre, bien qu’elle soit au cœur de la question de la contribution de la science à la crise planétaire actuelle.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
L’argument du livre suppose en toile de fond l’évolution de la recherche scientifique depuis la Seconde Guerre mondiale, qu’il est utile de rappeler en quelques phrases. Le rôle clé de la science pour la puissance nationale et le rôle stratégique de l’état dans la poursuite de la science sont, en effet, deux grandes leçons retenues de cette guerre. La recherche scientifique devient une affaire d’état. Le plan Vanevar Bush – Science the Endless Frontier – aux États-Unis, comme les grands plans stratégiques lancés en France durant les années gaulliennes illustrent ce régime de « patronage » de la recherche par les gouvernements. Mais patronage n’implique pas pilotage. Dans ce schéma qu’on appelle « modèle linéaire », les gouvernements financent, soutiennent et régulent la recherche académique sans attendre un retour immédiat sur investissement. Dans les années 1970, suite au rapport de Harvey Brooks à l’ODCE, Science croissance et société (1971), les politiques scientifiques changent de cap. D’une part, le généreux financement de la recherche par les états commence à faiblir. Le modèle linéaire tend à être remis en question : il faut se préoccuper de rentabiliser la recherche, s’ouvrir à l’économie comme à la société. D’autre part, les objectifs stratégiques militaires cessent d’être privilégiés et c’est la compétitivité industrielle qui devient la priorité. Dans les années 1990 s’amorce un deuxième tournant, avec l’entrée en scène de l’Union européenne. Le Livre blanc de Jacques Delors en 1993 suggère de créer un « espace européen de la recherche » qui serait non pas une entité juridique mais une collaboration compétitive jouant de la diversité européenne et de l’émulation entre pays. En 1997, la Commission européenne publie un rapport signé par deux économistes : Society, the Endless Frontier2. Et l’agenda défini par l’Union européenne à Lisbonne en mars 2000 fixe comme objectif : « Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale3 ». L’ambition de porter le budget de la recherche à 3% du PIB de chaque état-membre n’a pas été tenue, mais le régime de compétitivité s’est durci avec les tensions géopolitiques.
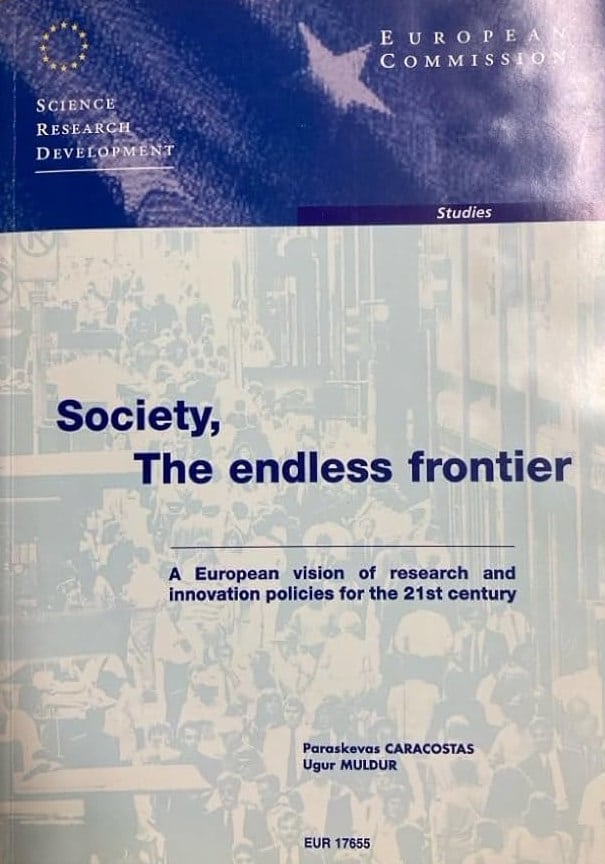
La force de ce livre réside, à mes yeux, dans le flash-back sur les années 1970, riches de protestations et d’autocritiques. La conjonction entre la remise en cause de la croissance économique dans le rapport Meadows de 1972 ou dans le livre pionner de Nicholas Georgescu Roegen4 et la contestation interne à la recherche scientifique fait surgir un horizon de possibles. Le 3 novembre 1971, Grothendieck ouvre son cours de mathématiques au Collège de France par une séance intitulée « Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle : allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». Ouverture d’une fenêtre, vite refermée. Ce geste spectaculaire a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle auxquels Chevassus-au-Louis a consacré un autre ouvrage5. L’ambition du présent livre est de rouvrir la fenêtre, de réactiver le possible esquissé dans les années 1970, en réfléchissant sur les raisons de l’échec de deux mouvements d’autocritique : des milieux économiques, d’une part, dans le rapport Meadows, et des milieux scientifiques, d’autre part. Tirer des leçons de l’histoire récente est essentiel pour bifurquer. Le rapport Meadows a été critiqué, fustigé, puis balayé par le slogan de « développement durable » fondé sur la promesse que de nouvelles technologies pouvaient repousser les limites de la planète. La magie de ce pari technosolutionniste opère toujours en 2025 dans la mobilisation pour l’intelligence artificielle, malgré l’accumulation des promesses non tenues par les OGM, les nano et biotechnologies. Chevassus-au-Louis souligne à juste titre que l’évolution de la crise écologique valide a posteriori le diagnostic du rapport Meadows discrédité par les analyses de l’OCDE, justement parce qu’il ne prenait pas en compte le pouvoir du progrès technologique, ce qui lui a été longtemps reproché pour le discréditer.
Le geste spectaculaire de Grothendieck a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle.
Le parallèle avec le sort des mouvements d’autocritique de la science des années 1970 pareillement balayés par l’OCDE et les politiques de recherche technoscientifique est si remarquable qu’il aurait mérité de plus amples développements. Les protestations contre l’alliance entre la science et le militaire mise en place dès 1945 aux États-Unis dans la foulée du projet Manhattan cristallisent en effet au début des années 1970, sous diverses formes qui ont ouvert des fenêtres. Par exemple, la mise en place d’instances d’évaluation technologique (Technology Assessment) aux Etats-Unis6. En France, l’autocritique attisée par le programme nucléaire national est en grande partie animée par des physiciens comme Jean-Marc Lévy-Leblond qui a développé d’autres formes d’activisme depuis lors7. Pour pouvoir vraiment tirer des leçons de l’histoire récente, Chevassus-au-Louis aurait pu évoquer une autre fenêtre entr’ouverte dans les décennies suivantes par les études sur les Science Technology Studies (STS) qui ont rendu poreuse la ligne de démarcation entre science et société dans leurs travaux sur les controverses, la circulation des connaissances, leurs modes de légitimation dans différents espaces publics, et les modes de construction conjointe des connaissances et des publics. Au tournant des années 2000, les STS se sont engagées dans l’aventure de la co-construction des technosciences et de la société au travers d’une participation active aux programmes de recherche lancés par la Commission européenne. Ainsi le programme Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) a tenté d’orienter les choix technologiques en incluant la société civile, dans le but de changer la politique en actionnant le levier des technologies8. Les sciences humaines ont cru pouvoir changer d’un seul coup et la recherche et la société. Une tentative vite enlisée dans le soft power de slogans creux comme Public Engagement in Science, ou Responsible Research and Innovation destinés à rassembler les parties prenantes sur un modèle managérial issu de l’économie néolibérale9. D’autres leçons seraient à tirer du gâchis des politiques de recherche sur les énergies alternatives – solaire, éolien, hydrogène – initiées après la crise du pétrole de 1973 qui ont été abandonnées dès que le prix du pétrole a baissé dans les années 198010.

Car l’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de Décroiscience. L’ouvrage s’appuie sur les travaux qui dénoncent la gestion managériale de la recherche et « les ravages du productivisme scientifique »11. Mais il se distingue par la volonté d’activer l’histoire récente au lieu de la survoler, de faire réfléchir sur les rapports de forces en présence au lieu d’étaler les scandales.
L’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de “Décroiscience”.
Lutter contre l’amnésie des politiques de recherche n’est pas le seul bienfait de ce livre. Chevassus-au-Louis a aussi le mérite de pointer et de bien formuler les problèmes dans son analyse de la situation contemporaine de la recherche. Ainsi note-t-il dès la page 20 que le savoir ne fonde plus les décisions politiques. C’est un élément clé de ce que les médias désignent comme « crise de confiance dans la science ». De fait, ce n’est pas un problème de confiance : les sondages attestent que le public européen a toujours confiance en la Science, un imaginaire de science idéale, neutre. Mais ce qui semble brisé ou du moins très menacé, c’est le lien entre savoir et action, entre science et politique qui fonde le recours aux experts convoqués pour « dire le vrai au pouvoir » et orienter les décisions. Ce lien postulé dans la formule d’Auguste Comte : « savoir pour prévoir, afin de pouvoir » repose lui-même sur le postulat de la neutralité des résultats scientifiques à l’égard des opinions partisanes. Les scientifiques en rébellion contre l’inaction des politiques face aux rapports d’expertise du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) adhèrent toujours à ces deux postulats qui sont sans cesse démentis par l’actualité et qui demandent à être sérieusement questionnés.
➤ Lire aussi | Sortir des labos sans lâcher la recherche・Des scientifiques en rébellion (2024)
Au lieu de se lamenter sur les contestations de l’autorité des experts, Chevassus-au-Louis établit une relation entre ce nouveau rapport à la vérité et deux autres problèmes : celui de la liberté académique et celui de la valeur sacrée de la connaissance. C’est le nœud entre les questions épistémiques, écologiques et politiques qui fait tout l’intérêt de cet ouvrage et qui justifie d’ailleurs la préface du philosophe Pascal Engel. Concernant la liberté académique, Chevassus-au-Louis est très réservé, comme le suggèrent deux chapitres tout en contrastes, l’un sur l’impasse des moratoires, l’autre sur l’efficacité des interdictions politiques. L’appel de quelques chercheurs au moratoire sur le génie génétique à la conférence d’Asilomar en 1975 et ses lointains avatars comme le bref moratoire sur les recherches impliquant des virus fonctionnalisés en 2011 ou le récent appel au moratoire sur les bactéries miroir en 202512, sont d’une efficacité nulle et ne servent finalement qu’à favoriser la publicité de telles recherches. Chevassus-au-Louis ne défend pas la liberté académique à tout prix car la « république des sciences » ayant ses propres normes a plutôt tendance à se placer au-dessus du commun et à préférer l’auto-régulation aux normes ou interdits imposés par les politiques. Il salue, en revanche, l’efficacité des interventions étatiques imposant des interdits ou des normes strictes sur certaines pratiques de recherche comme l’expérimentation animale ou l’utilisation d’embryons humains. Clairement il opte pour une stricte règlementation politique de la recherche. Ce qui pose problème car c’est précisément ce que fait Trump.
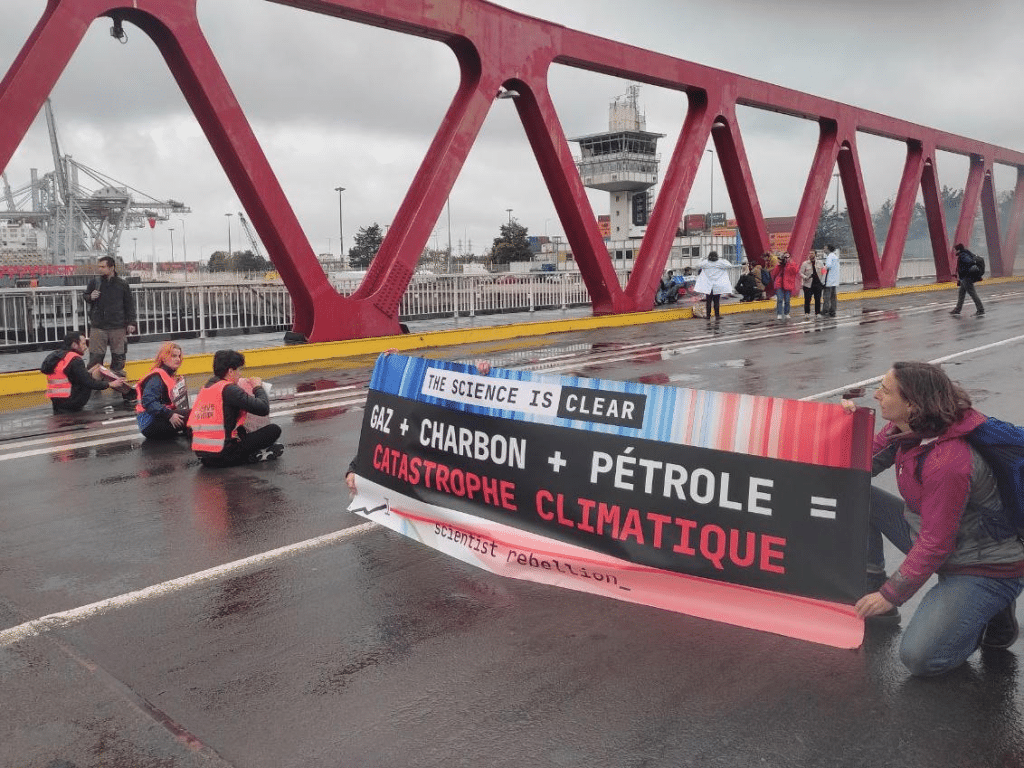
D’une manière générale, les mesures proposées dans les deux derniers chapitres pour une politique de décroiscience ne sont pas à la hauteur du diagnostic. Animé par un souci de « partir de l’existant », Chevassus-au-Louis se borne à déterminer « un certain niveau » de recherche nécessaire pour lutter contre les maladies et préserver l’environnement. Il prône par exemple de renoncer aux manipulations de virus et aux expériences de géoingénierie, ce qui relève de la prudence. Mais il n’affronte pas vraiment la question du prix de la connaissance en disant qu’il « va falloir se résigner à renoncer à certaines recherches » (p. 204) ayant un coût environnemental élevé en astrophysique ou en physique des hautes énergies ou même en proposant une Cour des comptes écologiques chargée d’évaluer le coût environnemental des programmes de recherche, sur le modèle de leur coût financier (p. 205).
C’est un premier pas, mais l’évaluation des impacts environnementaux de la recherche est une pratique déjà recommandée par plusieurs organismes comme l’Autorité Internationale des Fonds Marins par exemple. En amont de la recherche on doit évaluer son empreinte carbone, ses impacts potentiels sur l’objet d’étude, impacts environnementaux, sociétaux et géostratégiques. Une telle évaluation met en jeu la responsabilité des communautés de recherche dans l’aggravation de la situation climatique mais aussi leur non-contribution à la recherche de solutions. Il faudrait aller plus loin et dénoncer le recours aux instruments les plus high-tech et les plus performants pour publier des résultats crédibles. La course aux innovations technologiques qui sous-tend le régime actuel de recherche comme l’économie de marché absorbe une grande partie des budgets de recherche et en plus exclut de la compétition scientifique les pays du Sud. Aller plus loin c’est aussi et surtout s’interroger sur la valeur de la connaissance dès lors qu’elle est un moyen en vue d’une fin explicite comme la conquête de marchés, le leadership, la puissance. Ainsi reconfigurée dans le cadre de la compétition économique, la connaissance a perdu sa valeur intrinsèque. Cette question n’est pas suffisamment approfondie et c’est dommage car cela conduit l’auteur à des conclusion paradoxales. Alors que tout le livre critique la soumission des politiques de recherche aux impératifs de la croissance économique, il érige les bilans-carbone en outil pour amorcer la décroiscience : « Ce livre soutient que l’empreinte carbone de toute activité scientifique pourrait être un critère de cette appréciation du « certain niveau » (p. 25). Cette métrique instaurant une compatibilité universelle où tout devient commensurable et scalable est, à mes yeux, le parangon de la logique économique, comptable, qui domine aujourd’hui tous les champs de recherche. Or, elle n’est jamais questionnée.
Le livre encourage une orientation low science en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels.
L’ouvrage propose seulement des mesures de bon dosage visant à ralentir la course instaurée par le productivisme et l’inflation des publications scientifiques. Il reprend le slogan de la Slow Science Academy créée dans les années 2000 par un groupe de chercheurs allemands, qui a posté sur la toile un manifeste dénonçant les orientations de la recherche vers la compétition, la course aux publications, les évaluations de chercheurs à coup de dispositifs bibliométriques (indices de citations, classement des revues, facteur h…). Plus original, il encourage une orientation low science sur le modèle des low tech labs en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels (p. 198)
Prôner le ralentissement et la sobriété cela ne permet pas de s’interroger sur la temporalité propre à la recherche scientifique. On a vu pendant la pandémie de COVID combien la hâte de publier des résultats a conduit à des publications peu fiables qu’il a fallu rétracter. Cette course dans un climat d’urgence et de compétition a contribué à accroître la méfiance envers la science. Dans quelle mesure est-il légitime de financer des recherches au long cours qui demandent des années pour produire des résultats stabilisés et robustes ? Chaque secteur d’activité sociale économique et politique a son régime temporel propre mais c’est une affaire de pouvoir et relèvent de choix politiques13.
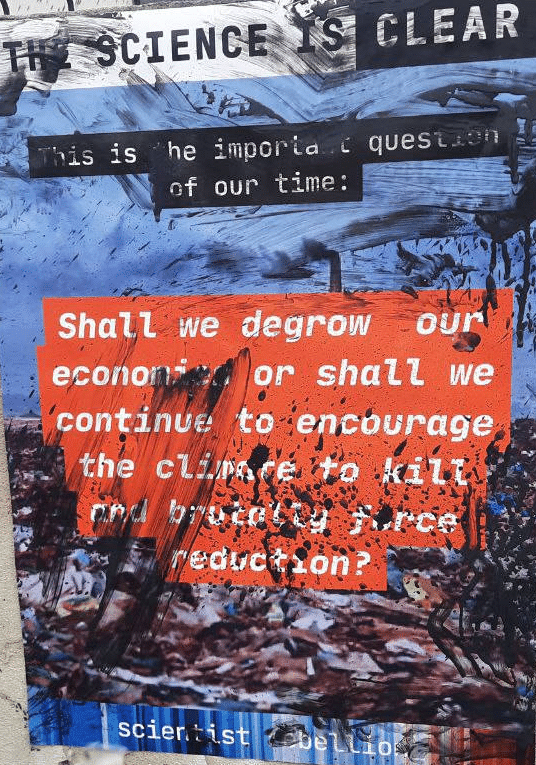
Enfin, les citoyennes et citoyens sont totalement absents de ce beau travail de critique de science. Vouloir planifier la décroiscience témoigne d’une grande confiance dans le pouvoir des institutions politiques mais où est passée la société civile ? Quel peut être le rôle des organisations non-gouvernementales, des associations de patients, de riverains, de consommateurs ? N’ont-elles pas ouvert des fenêtres et parfois inséré un coin pour empêcher de les refermer ?
Bref, ce livre soulève une bonne question – dans quelle mesure la science contribue-telle à la crise planétaire – et il y répond partiellement en dénonçant la soumission des milieux scientifiques aux impératifs économiques. Toutefois il ne va pas jusqu’au bout des problèmes ni des mesures à envisager pour mener des recherches plus soutenables. C’est en tous cas une lecture agréable et stimulante, susceptible d’inspirer de nouvelles propositions pour transformer en profondeur le régime actuel de la recherche scientifique.
Photo d’ouverture : manifestation « Printemps Bruyant », 5 avril 2025, Paris. Crédits : Scientifiques en rébellion.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Jacques Testart, « La recherche entre guerres sanitaires et décroissance », Le Club de Mediapart, novembre 2021.
- Parakskevas Caracostas, Ugur Muldur rapporteurs (Commission européenne/DG/XII R&D), Society, the Endless Frontier (trad. fr. : La Société, ultime frontière : une vision européenne des politiques de recherche et d’innovation pour le XXIe siècle, Études, Luxembourg, OPOCE, 1997).
- Lisbon European Council, « Presidency conclusions [The Lisbon Strategy] », 2000.
- Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press, 1971 ; Traduction du chapitre 1 en français dans La décroissance – Entropie – Écologie – Économie, éd. 2006, ch. I, p. 63-84.
- Nicolas Chevassus-au-Louis, Les Briseurs de machines. De Ned Ludd à José Bové, Paris, Le Seuil, 2006.
- Armin Grunwald (ed) Handbook of Technology Assessment, Edward Elgar Publishing, 2024.
- Alain Jaubert et Jean-Marc Lévy-Leblond (ed.) (Auto)critique de la science), Paris, Seuil, 1973. Depuis Lévy-Leblond s’attache à promouvoir « la culture scientifique » c’est-à-dire une approche publique des sciences, nouant recherche, culture et politique avec la revue Alliage publiée sans interruption depuis 1981 et plusieurs essais. Voir aussi Sezin Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Seuil, 2013.
- Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) 2006-2008. https://cordis.europa.eu/project/id/28837/reporting
- Bernadette Bensaude-Vincent et Andrée Bergeron, « Science for the people ? Perspectives des STS sur la question sciences et publics », in Sciences et Techniques en Sociétés, dir. Soraya Boudia, Ashveen Peerbaye, ISTE éditions, 2024, p. 83-102. Bernadette Bensaude-Vincent « The politics of buzzwords at the interface of technoscience, market and society. The case of ‘public engagement in science’ », Public Understanding of Science, 23 (3) Avril 2014 : 238 – 253.
- Voir par exemple Nicolas Simoncini, « Histoire de la recherche sur les piles à combustible en France des années soixante aux années quatre-vingt », Thèse de l’Université technologique de Belfort-Montbéliard-Université de Bourgogne Franche-Comté, 2018.
- Isabelle Bruno, A vos marques, prêts…cherchez. La stratégie européenne de Lisbonne, Vers un marché de la recherche, Paris, Le Croquant, 2008. Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Benchmarking. L’État sous pression statistique, Paris, Zones-La Découverte, 2013. Dominique Pestre, Sciences, argent et politique, un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003. A contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil, 2013.
- Voir Lise Barnéoud, « De l’autre côté du miroir la vie fait peur », Médiapart, novembre 2025.
- Ulrike Felt, Academic Times, Contesting the Chronopolitics of Research, Palgrave, McMillan, 2025.
L’article Comment faire bifurquer la recherche scientifique ? est apparu en premier sur Terrestres.
09.10.2025 à 11:27
« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel
Jean-Baptiste Fressoz
Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4029 mots)
Temps de lecture : 9 minutes
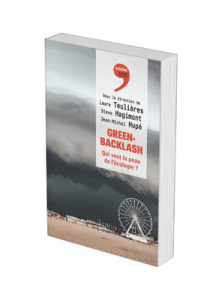
Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.
Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »
Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».
Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
La résignation climatique sous couvert de « transition »
À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.
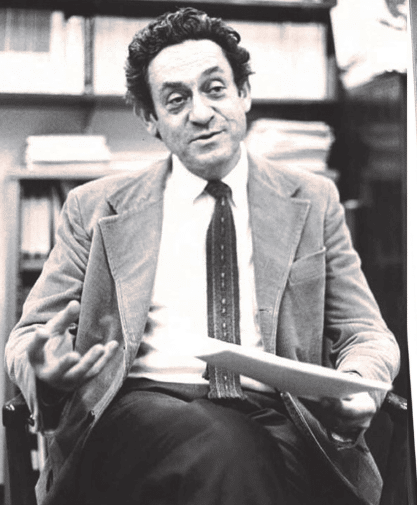
Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.
En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.
➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)
À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui-même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.
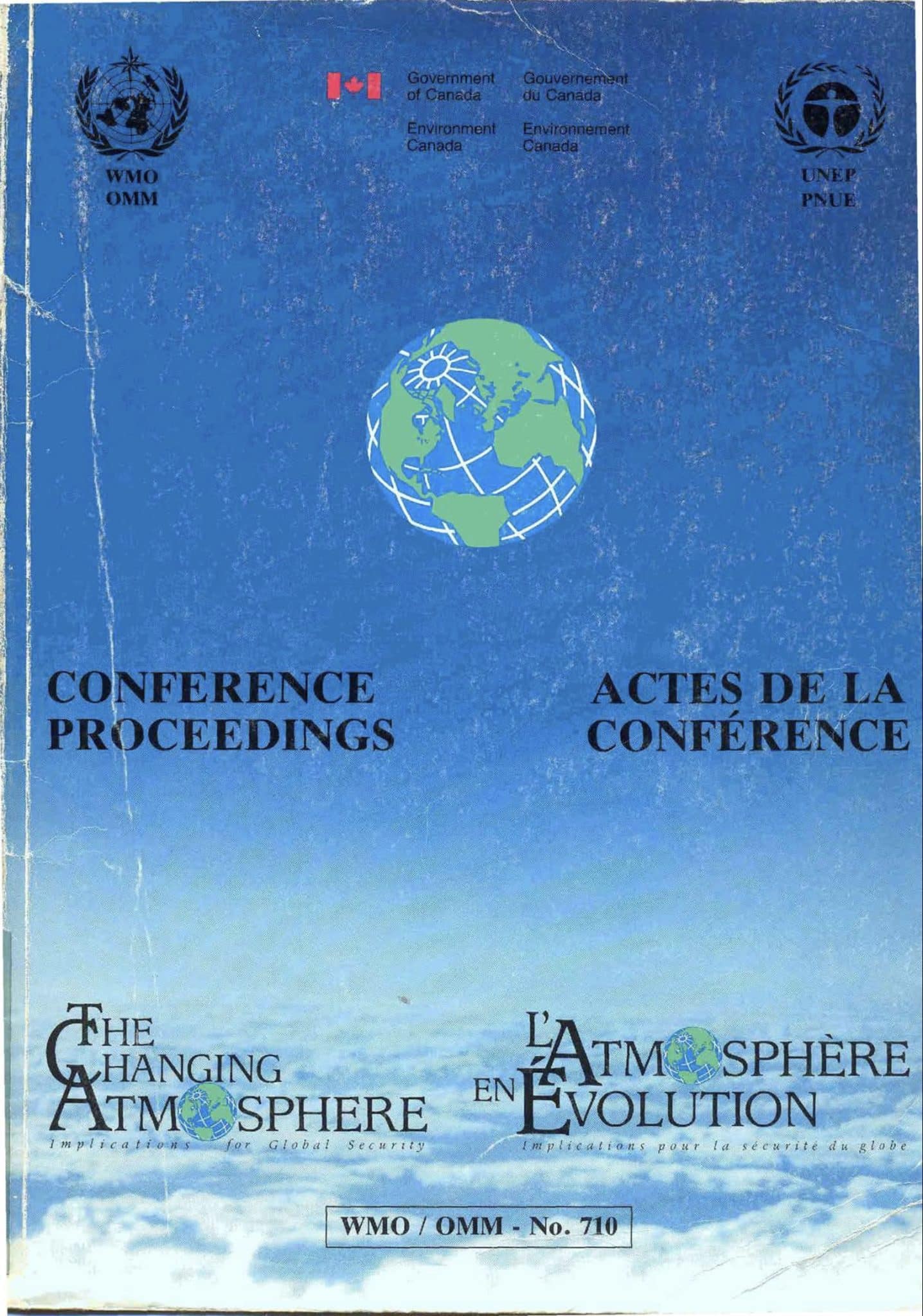
Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.
Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?
Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.
➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)
Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.
En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »
L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.
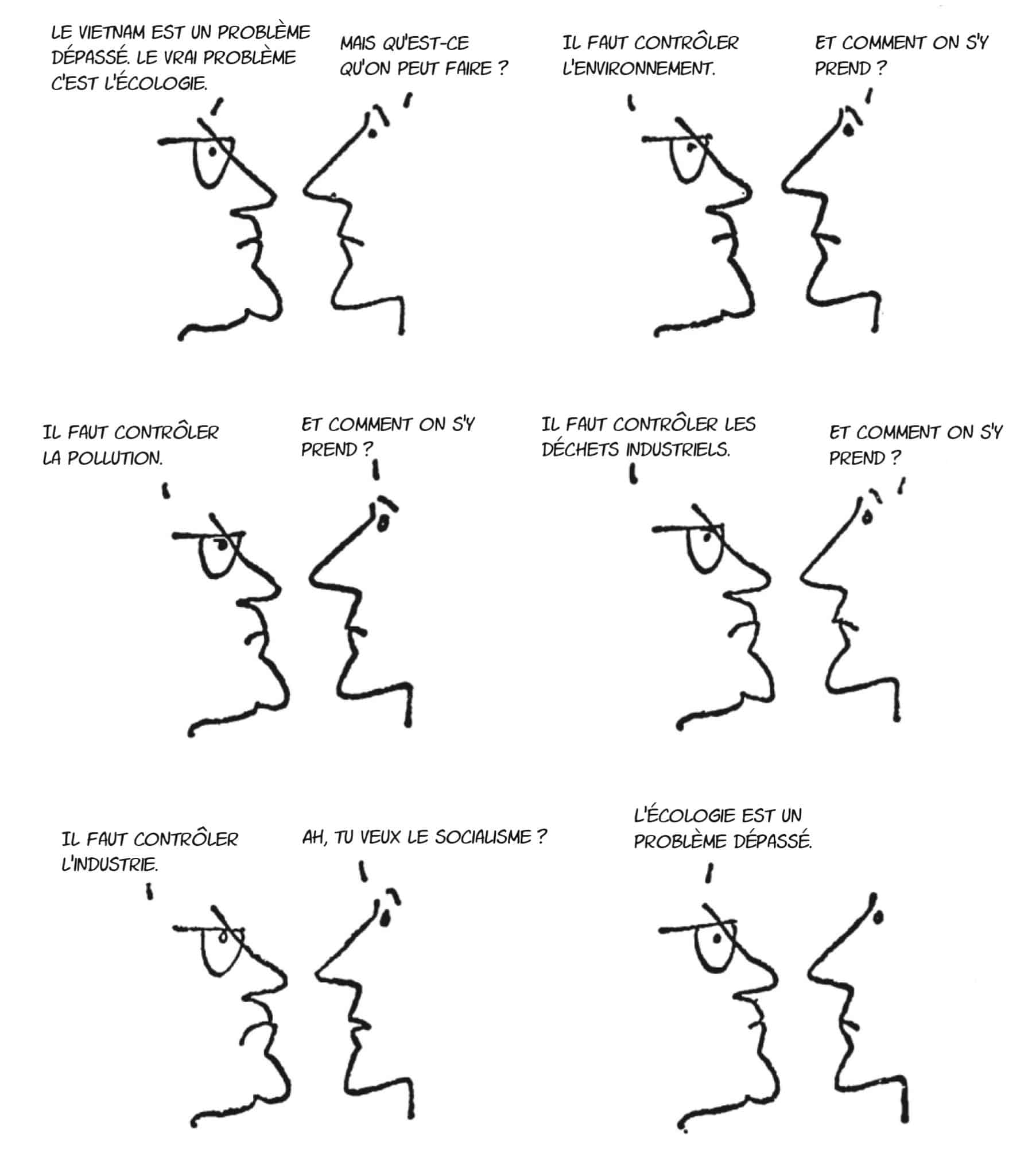
Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)
➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
22.07.2025 à 11:31
En finir avec l’« architecture-as-usual »
Mathias Rollot
Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.
L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (8256 mots)
Temps de lecture : 17 minutes
On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1.
En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible.
En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ?
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Bullshit ordinaire
La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens.
À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention.

Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ?
Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ?
De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.
Sur la compensation de tout par n’importe quoi
Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives.
Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.
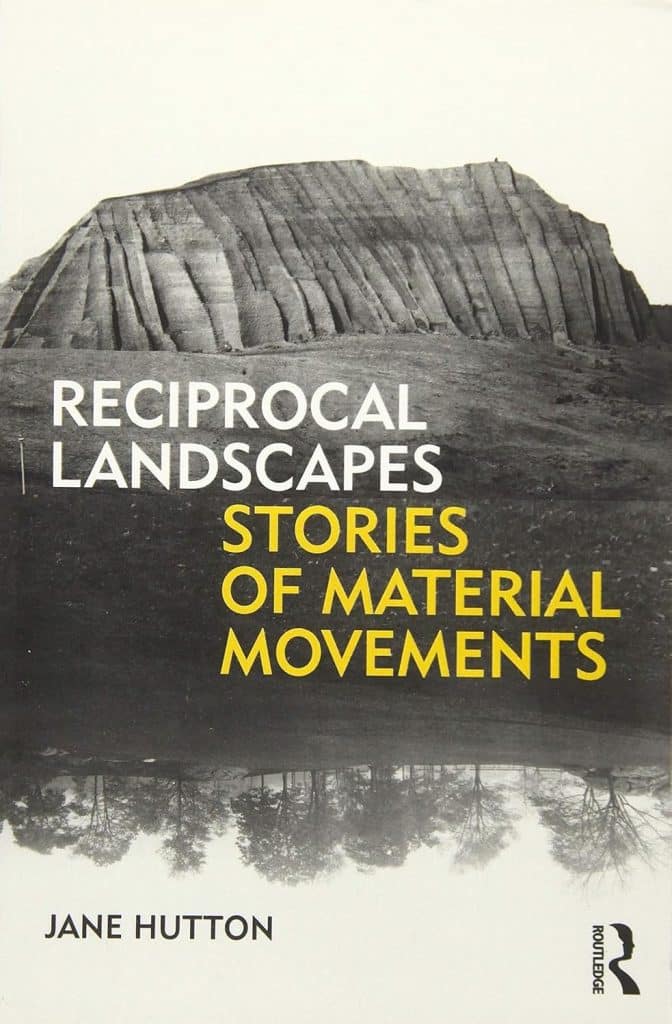
La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction.
Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.
Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction.
L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.
Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5
À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée.
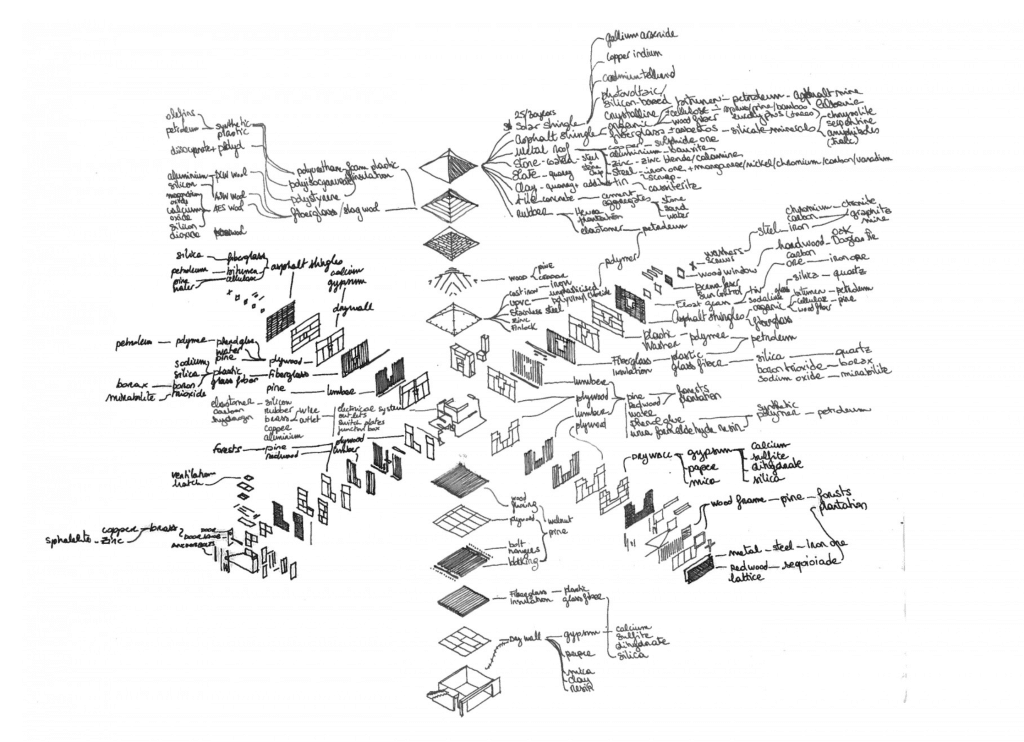
Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas.
La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié.
Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ».

La tentation de l’architecture-as-usual
Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment.
Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ?
Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices.
On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21

Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court.
En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture.
Photographie d’ouverture : Mathias Rollot.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Tous mes remerciements à Philippe Simay pour toutes les stimulantes réflexions que nous avons eues ces derniers mois, qui ont beaucoup nourri ces lignes. Et tous mes remerciements à Nils Le Bot, Emeline Curien, Sophie Gosselin, Jeanne Etelain et Martin Paquot pour leurs retours sur des premières versions de l’article et leurs riches suggestions pour l’améliorer. Merci enfin à Emilie Letouzey qui a édité ce texte et m’a accompagné avec beaucoup de bienveillance dans les dernières étapes avant publication. Cela étant dit, les faiblesses du texte – puisqu’il y en a toujours – n’engagent évidemment que moi.
- Voir son site Internet : https://www.icade.fr/groupe
- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, 1981 ; Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, L’Herne, 2007.
- Jane Hutton, Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, Routledge, 2019.
- Écho au titre de l’anthologie d’écologie politique consacrée à André Gorz (Seuil, 2020).
- « Potentiellement intéressante, la compensation présente néanmoins de multiples difficultés théoriques et pratiques. Nombre d’études réalisées ces dernières années mettent en doute l’efficacité de la compensation, pointent le flou qui entoure son évaluation et les effets pervers qu’elle peut entraîner. De plus, on observe chez les acteurs de la compensation des pratiques contestables tant sur le plan technique qu’éthique, ce qui rend le système de la compensation encore plus problématique et controversé. Le bilan de la compensation est ainsi très mitigé. ». Adriana Blache, Frédéric Boone et Étienne-Pascal Journet, « Compensation. Notre impact sur la biosphère peut-il être l’objet d’un jeu comptable ? », dans Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p. 62.
- Magali Weissgerber, Samuel Roturier, Romain Julliard, Fanny Guillet, « Biodiversity offsetting : Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain », Biological Conservation, vol. 237, septembre 2019, pp. 200-208. Pour une littérature plus accessible sur le sujet, voir plutôt Marie Astier, « Grands projets destructeurs : l’esbroufe de la « compensation écologique » », Reporterre, 2019.
- Voir notamment Stéphane Foucart, « Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires », Le Monde, 29 janvier 2023 ; Alice Valliergue, Compensation carbone. La fabrique d’un marché contesté, Sorbonne Université Presses, 2021 ; Augustin Fragnière, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 2009.
- À la lecture de ces lignes, un confrère commente : « Je ferais l’hypothèse de l’aliénation, d’un mélange subtil entre : une cohabitation morbide et résignée des individus avec le spectacle désolant de l’hégémonie capitaliste ; une anxiété de réussite-survie dans un système qui broie les derniers de cordée ; et un renoncement intellectuel face à une société qui ne mobilise plus la raison (science) et l’éthique pour gouverner. ».
- Charlotte Malterre-Barthes, A moratorium on new construction, Steinberg Press, 2025.
- Philippe Simay, Bâtir avec ce qui reste, Terre Urbaine, 2024.
- Philippe Madec, Mieux avec moins, Terre Urbaine, 2021.
- « Dé-designer », appel à contributions de la Revue Azimuts – Design Art Recherche.
- Mathias Rollot, « Onze pistes vers une métamorphose décoloniale de l’architecture », AA’, 2025.
- Solène Marry (dir.), Architectures low-tech. Sobriété et résilience, Parenthèses/Ademe, 2025 ; Mireille Roddier, « Degrowth, Energy Sobriety, Low-Tech : Towards an Architecture of Conviviality », Places Journal, 2024.
- Mathias Rollot, « Pourquoi enseigner l’alternatif ? », AMC, 2024.
- Mathias Rollot, « Urgence écologique : quel impératif éthique pour la recherche architecturale ? » (document pdf), dans Emeline Curien, Cécile Fries-Paiola (dir.), Humains, non-humains et crise environnementale, Rencontres interdisciplinaires Mutations 02, ENSA Nancy,mars 2021 ; Mathias Rollot, « Pourquoi chercher ? » (document pdf), La Recherche architecturale, éditions de l’Espérou, 2019, pp. 263-300.
- Sur le greenwashing et le « greenwishing » en architecture, voir l’introduction du livre Charlotte Malterre-Barthes (éd.), « On Architecture and Greenwashing », The Political Economy of Space Vol. 01, Hatje Cantz, 2024.
- Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, La Découverte, 2023, pp. 24-25.
- Mathias Rollot, Décoloniser l’architecture, Le Passager Clandestin, 2024.
- Très intéressante est, à cet égard, la contribution d’Hélène Jannière au récent ouvrage collectif La Critique à l’œuvre. En appui sur les discours de Pierre Joly (1925-1992), l’historienne montre bien à quel point les années 1960 pouvaient déjà souffrir d’une « absence de critique » architecturale, de « discussions restées intérieures à la discipline » et plus globalement d’un « entre-soi » appauvrissant pour l’architecture, pour les architectes et pour la société elle-même. Hélène Jannière, « à la recherche de l’opinion publique : polémiques françaises sur la critique, 1958-1969 », dans Denis Bilodeau, Louis Martin, La Critique à l’œuvre. Fragments d’un discours architectural, éditions de la Villette, 2025, pp. 20-42, p. 21.
- Stella Baruk, L’Age du capitaine. De l’erreur en mathématiques, Seuil, 1998.
L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.
19.07.2025 à 11:27
Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique
Un groupe d'amis du Delta
De l'assèchement à la submersion, il n'y a souvent qu'une brève parenthèse. Dans ce texte mosaïque, un collectif de chercheurs et d'écrivains italiens enquête sur la manière dont le changement climatique et la montée du niveau de la mer bouleverse un territoire, le Delta du Pô, dont l'histoire récente est intimement liée à la gestion industrielle de ses eaux.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10344 mots)
Temps de lecture : 23 minutes
Ce texte a été distribué pour la première fois, sous la forme d’une brochure le 31 octobre 2024, à la Factory Grisù de Ferrare, lors de la première présentation du roman Gli uomini pesce par Wu Ming 1 (Einaudi, 2024). La diffusion du document s’est poursuivie en novembre, à l’occasion d’autres événements dans la Basso Ferrarese1, dans la Polésine et au nord de Bologne. Il a été publié pour la première fois en ligne sur le site Giap et nous espérons qu’il voyagera, qu’il provoquera des discussions et qu’il sollicitera des commentaires dans d’autres territoires.
Il a été écrit par un groupe informel et pluridisciplinaire et il est le premier fruit de deux années de discussions, de lectures partagées et surtout d’errances dans les territoires décrits ici.
Bonne lecture, bonnes déambulations.
Ce texte a été écrit par Sandro Abruzzese (enseignant et écrivain) ; Marco Belli (enseignant, écrivain et photographe, directeur artistique de l’Elba Book Festival) ; Davide Carnevale (enseignant-chercheur en anthropologie visuelle, Université de Ferrare) ; Cassandra Fontana (chercheuse en études urbaines, Université de Florence) ; Sergio Fortini (architecte-urbaniste, cofondateur de Metropoli di Paesaggio) ; Marco Manfredi (comédien, vagabond, spécialiste des relations entre cinéma, récits et territoire) ; Michele Nani (historien, chercheur au CNR — Ferrare) ; Giuseppe Scandurra (anthropologue, Université de Ferrare) et Wu Ming 1 (écrivain et essayiste, originaire du Basso Ferrarese).
La présente traduction de l’italien a été réalisée par Michele Nani et Niccolò Mignemi.

Carte du delta du Pô, réalisée par les auteur·es. Pour visualiser la situation de l’Italie nord-orientale en 2100 avec la mer Adriatique plus élevée d’un mètre par rapport au niveau actuel, voir le projet interactif élaboré par l’artiste Alex Tingle depuis 2006.
On raconte qu’au siècle dernier, dans les mines de charbon de diverses régions du monde, face au danger du grisou et en l’absence de systèmes de ventilation, les mineurs emportaient avec eux un canari en cage. Beaucoup plus petit et donc plus sensible au gaz, le canari commençait à agoniser bien avant que les mineurs ne ressentent les effets de ce qu’ils inhalaient. Lorsque l’oiseau commençait à suffoquer, c’était le signe qu’il fallait évacuer la mine.
D’où la métaphore bien connue du « canari dans la mine », également utilisée par le météorologue Luca Mercalli lors d’une conférence donnée il y a quelques années dans un centre du Basso Ferrarese2. Le Delta est le canari, c’est-à-dire la zone la plus exposée, celle qu’il faut regarder pour mieux comprendre les effets du changement climatique.
Dans le Delta
1. Par Delta du Pô, on entend ici…
Par Delta du Pô, nous entendons le delta historique, ou Delta grande, c’est-à-dire l’espace géographique façonné au fil des siècles par les crues et les débordements du fleuve et par le déplacement progressif de son bras principal vers le nord.
Le Delta grande est un ensemble de lits où le fleuve coule encore, d’autres — souvent invisibles à l’œil nu — qu’il a abandonnés et d’autres encore qui sont devenus artificiels, c’est-à-dire transformés en canaux, comme ce fut le cas pour la branche du Pô de Volano.
Le Delta grande n’a pas de frontières nettes, mais il comprend certainement la partie orientale de la zone de la Polésine de Rovigo, la partie orientale de la province de Ferrare et une partie du territoire de Ravenne. Le long de la côte, il s’étend de la limite nord de la municipalité de Rosolina — le dernier tronçon du fleuve Adige — à la limite sud de la municipalité de Cervia. Près d’un million de personnes vivent dans cette zone, en ne comptant que les résidents.
Le Delta est une région géo-historique, géo-économique et géo-culturelle aux caractéristiques propres. Il se distingue par la présence de zones humides résiduelles — qui ont échappé aux travaux d’assèchement et drainage — ainsi que par des risques hydrauliques propres et par sa morphologie de plaine ininterrompue, différente du reste de l’Italie, pays composé en grande partie de montagnes et de collines3.
2. Des impasses communes
Les territoires du Delta ont des histoires et des problèmes similaires. Ils ont également en commun d’avoir emprunté des voies sans issue, d’avoir misé sur des modèles de développement local qu’il convient aujourd’hui de repenser : le tourisme balnéaire de masse, une certaine agriculture intensive, un certain développement industriel. Certains modèles se sont avérés depuis longtemps des échecs, et les territoires les ont payés par l’émigration et le dépeuplement ; d’autres ont généré des retombées économiques pendant quelques décennies, mais se révèlent aujourd’hui insoutenables, voire catastrophiques.
C’est le cas de la basse vallée du Pô qui, à partir du XIXe siècle, est passée de zone humide à une vaste étendue de terres cultivables. Un processus qui ne peut jamais être considéré comme achevé, mais reste ouvert et toujours réversible, ce qui rend la zone du Delta particulièrement fragile à divers égards, aussi bien environnementaux que sociaux.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
3. Dans la terre de la bonifica
Nous avons grandi, nous nous sommes installés ou nous travaillons aujourd’hui sur des terres transformées par la bonifica4. Nous avons vécu ou nous sommes passés tous les jours devant les stations de drainage et les autres technologies de gestion des eaux, mais pendant longtemps nous n’y avons pas prêté attention, pendant longtemps nous avons tenu pour acquise cette utilisation des terres, ce complexe « territoire-machine », pour citer la géographe Federica Letizia Cavallo5.
Cette terre, la partie émergée, le paysage de la basse plaine, était pour nous une évidence alors que nous vivions dans une parenthèse entre des terres qui ont été submergées et qui, mutatis mutandis, le seront à nouveau.

4. Les parenthèses s’ouvrent et se referment
En rapportant chaque durée à celle de notre vie, nous percevons comme anciens des phénomènes qui, en fait, ne se sont manifestés que récemment, peut-être peu avant notre naissance. Pour les mêmes raisons, nous tenons ces phénomènes comme acquis et percevons les processus dont ils dépendent comme achevés, définitifs, alors qu’ils sont toujours en cours et plus ouverts que jamais.
Depuis le siècle dernier, l’idée d’une temporalité unique et linéaire a été remise en cause dans tous les domaines de la connaissance. Elle ne survit que dans l’idée de développement qui anime les politiques économiques. Mais les temporalités sont multiples, les parenthèses s’ouvrent et se referment, elles se situent à l’intérieur ou à côté d’autres parenthèses. L’histoire du monde est une coprésence de temporalités.
5. On ne comprend pas vraiment la bonifica si…
On ne comprend pas vraiment la bonifica, dans ses différentes phases, et l’héritage qu’elle nous a laissé, si nous ne tenons pas compte de ses contradictions internes, de la façon dont elle s’est imposée, des résistances qu’elle a dû abattre et de celles qui l’ont arrêtée au fur et à mesure que la situation et les sensibilités évoluaient.
Dans les discours actuels sur la bonifica, une erreur de raisonnement connue sous le nom de biais des survivants opère : pour évaluer une situation, on ne considère que les éléments résultants d’un processus de sélection ; cependant, ces éléments ne véhiculent pas nécessairement plus d’informations par rapport à ceux qui n’ont pas survécu. Ce qui a été occulté, et qui est resté longtemps en dehors de la représentation dominante, il est aussi bien un objet de recherche historique et un vecteur de savoir. Une fois sorties de l’oubli, ces histoires nous parlent, enrichissent notre connaissance et notre capacité de transformer le réel.
Au XIXe siècle, le Delta et, plus en général, la partie nord-orientale de l’Italie connurent une résistance populaire à la bonifica qui effaçait brutalement les biens communaux, les droits collectifs et les économies locales, en faisant éclater les communautés. Grâce à l’historien Piero Brunello, nous connaissons désormais les luttes contre la bonifica – menées entre 1853 et 1861 – dans les valli6 de Cona et de Cavarzere, deux communes aujourd’hui situées dans la ville métropolitaine de Venise7. Nous pouvons également citer l’opposition d’une partie de la population de Massa Fiscaglia, dans le territoire du Basso Ferrarese, à la bonifica de la valle Volta, une lutte menée par tous les moyens et qui a duré de 1874 à 18808.
D’autres batailles, conduites cette fois-ci par des associations de protection de l’environnement et du territoire comme Italia Nostra, furent menées exactement cent ans plus tard, au milieu des années 1970, dans le Delta de Ferrare, lorsqu’il apparut distinctement que l’Ente Delta Padano9 était en mode pilote automatique, avec l’intention d’assécher toutes les zones humides encore existantes, en premier lieu les valli de Comacchio, au nom de modèles de développement qui commençaient à montrer des signes d’essoufflement. Le changement de perception et la prise de conscience fut un facteur déterminant, au point que la dernière vague prévue de bonifica n’eut finalement pas lieu10.
6. Des connaissances « augmentées »
Cette connaissance « augmentée » s’enrichit de ce qui n’était pas connu à l’époque et qui est aujourd’hui un fait acquis : les zones humides font partie des écosystèmes qui stockent le mieux le dioxyde de carbone : un marais en séquestre cinq fois plus qu’une forêt. Les zones humides ne couvrent que 1% de la surface de la planète, mais elles captent cinq-cents fois plus de CO2 que les océans11.
Rétrospectivement, l’assèchement des marais et des valli dolci et salse12 a contribué à accélérer le réchauffement climatique. Cette prise de conscience, parmi tant d’autres aujourd’hui indispensables, suggère la nécessité d’étudier les expériences de restauration des zones humides dans le territoire du Delta du Pô comme ailleurs dans le monde, afin de façonner les pratiques d’intervention futures.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Inondations et barrages dans la Vallée de la Vesdre : l’aménagement du territoire en question » de Marie Pirard, juin 2023.
7. Une autre parenthèse : vivre sur le littoral
La « littoralisation » de la population, un phénomène qui s’est surtout produit au XXe siècle, est également une parenthèse. Aujourd’hui, nous constatons que le niveau de la mer monte, et sa montée est un problème car le phénomène touche aussi les agglomérations, parfois densément peuplées. Il fut un temps où, à l’exception de quelques villes portuaires, les côtes étaient vierges de toute présence humaine : à l’époque, nous n’aurions pas remarqué la montée, alors qu’aujourd’hui cette parenthèse des côtes peuplées risque de prendre fin de manière catastrophique.

8. Poubellocène
Nous devons à l’historien de l’environnement Marco Armiero le concept de poubellocène13, pour signifier non seulement l’ère de l’immense accumulation d’ordures, mais aussi l’ère centrée sur les déchets, comprise comme des relations d’exclusion, au sein desquelles certaines communautés et localités sont désignées comme susceptibles d’être sacrifiées. Sur ces communautés sont déversés, souvent littéralement, les « coûts externes » du développement, c’est-à-dire la pollution, les résidus toxiques, les marchandises qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et deviennent des déchets.
Par sa nature et sa situation, le Delta est aujourd’hui l’avant-dernier réceptacle — le dernier étant la mer Adriatique — des coûts externes du développement dans la plaine du Pô. Il l’est matériellement, parce que le Pô et d’autres cours d’eau rejoignent la mer remplis de pollutions industrielles et agro-industrielles, et culturellement, parce qu’il est l’expression d’une Italie mineure et subalterne.
Dans l’histoire de l’Italie, les pouvoirs publics ont essayé de faire de la plaine du Pô la zone industrielle par excellence. Pour atteindre ces résultats, des millions de personnes ont été poussées à émigrer, d’abord des zones internes du Nord lui-même, puis du Mezzogiorno, exacerbant les déséquilibres déjà existants entre le Nord et le Sud de l’Italie, enfin depuis l’Europe de l’Est et le Sud du monde.
Aujourd’hui, le territoire paie pour ces choix et doit faire face à des politiques économiques qui l’ont dévasté et à des concentrations méphitiques de particules. La plaine du Pô est de loin la zone la plus polluée d’Europe occidentale et l’une des plus polluées de tout le continent14. C’est la zone qui compte le plus grand nombre de décès prématurés causés par des concentrations excessives d’ozone, de NO2 (dioxyde d’azote) et de PM2,5 (particules)15. C’est de loin la zone la plus bétonnée du pays16.

Le Basso Ferrarese
9. Une focalisation territoriale précise
Une focalisation territoriale précise est nécessaire pour penser et agir dans un lieu donné. En même temps, cet effort centripète n’a de sens que s’il a aussi des effets centrifuges. Il s’agit de commencer par le Basso Ferrarese et, en même temps, élargir le champ d’action à l’ensemble du Delta du Pô et au-delà.
Le Basso Ferrarese va du chef-lieu de la province à la mer et se situe entre deux fleuves : le Pô au nord et le Reno au sud. Le Pô et le Reno sont des frontières ouvertes : revenons à la conception des fleuves tels qu’ils étaient autrefois : des lieux de passage et d’échange.
10. Le territoire avec les sols les moins artificialisés
La grande anomalie du Basso Ferrarese, une anomalie qui peut aujourd’hui être tournée à son avantage, est que pour diverses raisons — non pas du fait des vertus de ses administrateurs, mais de dynamiques historiques complexes — il est resté le territoire avec les sols les moins artificialisés de toute la plaine du Pô, exception faite bien sûr de la blessure des Lidi, ce littoral marqué par la présence d’établissements balnéaires, où la spéculation immobilière a commencé dans les années 1960 et s’est accélérée à partir des années 1980.
11. « Rien à voir » ?
Celui du Basso Ferrarese est un paysage en large partie « aménagé », construit par la bonifica. À un premier regard, il peut paraître parfaitement plat et vide, dépourvu de tout signe particulier, de ce que le géographe Eugenio Turri appelait des « iconèmes17 ».
« Il n’y a rien à voir », tel est le cliché que nous entendons renverser grâce à nos pérégrinations car c’est au fil des regards que ce territoire surprend, se révélant plein de détails, marqué par des lignes, subtilement entaillé par des dénivelés (berges, bassins de valli asséchées, anciens lits de fleuves), des réalités cachées et des « zones d’incertitude ». Et les iconèmes sont nombreux, à partir des artefacts de la bonifica jusqu’aux maisons abandonnées dont la province est aujourd’hui remplie.
En outre, les espaces naturels et protégés couvrent 13 % du territoire de la province. Ils sont pour la plupart des zones humides qui ont survécu à la fièvre du drainage.
Mais il ne faut pas oublier non plus certains interstices le long du grand fleuve, des interzones sans juridiction où l’on ne sait pas ce qui se trame, des lieux où des communautés inattendues s’arrêtent et s’installent.
12. Dépaysements
L’émigration, la raréfaction sociale qui en résulte et la perte de sens de l’habiter ont créé une sens de dépaysement. En un mot, celles et ceux qui vivent dans ces landes ne connaissent plus le territoire. Il est nécessaire de le re-connaître car, même sans en être pleinement conscient, on se sent dépossédé.
Pour réfléchir à l’organisation politique et sensible autour des fleuves, vous pouvez lire aussi dans Terrestres le texte collectif « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.
Territoires en marge, territoires inexprimés
13. Sans voix
Le Delta du Pô est un territoire marginal, un territoire inexprimé. Les territoires en marge sont des espaces subalternes — économiquement, socialement, culturellement — au monde urbain et aux imaginaires métropolitains, à une seule et unique idée de la modernité. Subalternes, donc incapables — reprenons ici une catégorie du sociologue Franco Cassano — d’être des sujets de pensée. Ces territoires ont du mal à trouver leur propre voix malgré leurs spécificités et leurs particularités, au point que leur avenir reste inexprimé.
Dans ces régions, les dysfonctionnements de la modernité ne trouvent pas leur explication dans des raisons structurelles, mais plutôt dans des stéréotypes et des préjugés. Il en résulte des complexes d’infériorité et des pulsions à l’émulation : des villes et de la civilisation technologique, on emprunte l’amour du pouvoir et de tous les signes de « réussite ». Des zones de prospérité économique, on tire des modèles prétendument « exportables » : l’histoire des Lidi Ferraresi, reproduction maladroite et tardive d’un modèle de tourisme à fort impact environnemental, en est un exemple18.
Faute de pouvoir répondre à l’imaginaire médiatique, à une représentation unidimensionnelle du monde et aux attentes des jeunes générations, les territoires en marge sont frappés par le dépeuplement, l’abandon, les dépressions, l’anomie. Ils subissent des processus et des projets d’en haut et troquent la chimère de l’emploi contre la pollution, contre les grands chantiers, éventuellement contre le fait de devenir un dépôt pour les déchets dangereux. En Italie, les territoires marginaux se trouvent dans les Apennins, dans les Alpes, sur les îles, le long des frontières, dans les basses terres déprimées.
14. L’attente perpétuelle de pseudo-solutions
Dans la crise climatique, les territoires en marge se trouvent ébranlés et abasourdis. Ils subissent les conséquences immédiates de cette crise, alors que leur situation de départ est déjà défavorisée. Ils sont victimes de modèles hétéronymes. Influencés par de lourdes interdépendances, ils ne peuvent pas s’exprimer en tant que sujets capables d’une pensée autonome. Ils n’ont droit qu’à attendre des solutions venues de l’extérieur, toujours pensées comme des techno-raccommodages.

Ce qui arrive
15. Le retour de la mer
Toute la côte occidentale de la Haute Adriatique et les plaines de son arrière-pays sont des territoires en équilibre face à l’aggravation de la crise climatique. Un nombre croissant d’études confirment qu’au cours du XXIe siècle, l’élévation du niveau de la mer Adriatique (eustatisme) — combinée à l’affaissement de la surface terrestre et à d’autres phénomènes en cours — dévastera toute la région, des Marches jusqu’au golfe de Trieste.
16. Les barrages et le vénitiano-centrisme
Pendant des décennies, le discours public national s’est concentré sur Venise, un lieu emblématique en matière de montée des eaux.
Certains espèrent qu’avec les barrages mobiles du MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), le problème sera en grande partie résolu. Mais les prémisses même de cette approche sont biaisées par ce qu’Evgeny Morozov appelle le « solutionnisme technologique », avec la suppression des symptômes sans diagnostiquer le mal, c’est-à-dire l’illusion que les effets peuvent être atténués sans intervenir sur les causes19.
En outre, le débat sur le MOSE a toujours été « Venise-centré », comme si la lagune de Venise ne faisait pas partie d’un système beaucoup plus vaste de zones humides et de territoires en équilibre entre la terre et l’eau. Au contraire, si Venise a une valeur, c’est en tant que synecdoque, en tant que partie d’un tout. Au nord et au sud de la ville, sur plus de trois cents kilomètres de littoral, le territoire risque de subir le même sort. La différence est qu’il court ce risque dans le silence et l’inconscience générale. Et à quoi va servir le MOSE si l’eau entre et se répand tout autour ?
17. Au-delà du chiffre rond
Les estimations vont de +80 à +140 centimètres de montée de la mer Adriatique d’ici 210020. Des cartes topographiques ad hoc montrent la situation hypothétique cette année-là : le littoral actuel a disparu, l’eau a pénétré dans l’arrière-pays, elle a même gagné — dans certaines régions, comme les provinces de Ferrare et de Rovigo (la Polésine) — des dizaines de kilomètres21.
Le chiffre rond de 2100 contribue à produire un instantané, au sens multiple du terme : une secousse soudaine, un pas en avant rapide dans la perception du problème et un instantané d’un moment dans le temps qui permet une vue d’ensemble ; dans le même temps, il détourne l’attention du fait que ces processus sont déjà en cours et se poursuivront même après cette date.
18. Les conséquences
Abandon des agglomérations côtières et de l’arrière-pays proche. Migrations climatiques vers d’autres régions d’Italie ou vers l’étranger. Perte de milliers d’hectares de terres agricoles. Perte de nappes d’eau potable. Destruction des écosystèmes d’eau douce et des zones naturelles et protégées, telles que les deux parcs régionaux du Delta du Pô, la lagune de Venise, les lagunes de Marano et de Grado, etc. Un changement climatique radical.
19. Il ne s’agit pas seulement d’eau
Il est important de garder à l’esprit qu’on ne parle pas d’« eau », mais de boues toxiques et contaminées. Le littoral de l’Adriatique-nord est densément urbanisé et industrialisé. Avec la montée des eaux, la mer pénètrerait dans des zones bâties, elle ferait donc voler en éclats les égouts, elle entraînerait des déchets, des produits chimiques, des carburants, des plastiques de toute sorte, des carcasses d’animaux, comme elle l’a déjà fait en 2023 et en 2024. Ce que l’on a vu à Conselice, bourg de la Romagne submergé pendant des semaines par la boue chargée de toutes sortes de poisons et de cocktails bactériologiques, sera amplifié de plusieurs ordres de grandeur.
La crue la plus impétueuse d’un cours d’eau des Apennins n’est rien comparée à la masse d’eau d’une mer : non seulement la pollution de l’Adriatique augmenterait de façon exponentielle, mais elle créerait des « grands Conselice », de vastes zones « amphibies » emprisonnées dans la boue, dont les miasmes se propageraient sur plusieurs kilomètres alentour.
20. En attendant…
C’est le scénario envisagé en l’absence totale d’action. En attendant, la montée des eaux est déjà en cours et considérée, dans une large mesure, comme inéluctable. Elle est déjà en train de se produire.

Ce qui se passe déjà
21. Les avant-gardes de l’avancée de la mer
Biseau salé, orages de plus en plus intenses et tempêtes de mer sont les signes avant-coureurs de la mer qui avance, et les manifestations de la crise climatique elle-même.
I. Biseau salé : en période de sécheresse, les rivières s’affaiblissent, la mer remonte les cours d’eau et les remplit de sel, avec de graves répercussions sur les écosystèmes, l’agriculture et les nappes d’eau potable.
II. Tempêtes, souvent de type downburst, fréquemment confondues avec les tornades. Leur intensité et leur fréquence accrues sont un symptôme du nouveau climat. L’Adriatique devient plus chaude : au cours de l’été 2024, elle a atteint plusieurs fois 30°C. Cela augmente l’évaporation et l’humidité dans l’atmosphère. Lorsque des courants plus froids arrivent, leur impact sur l’air chaud et humide libère de grandes quantités d’énergie et provoque de violentes précipitations. C’est ce que les médias italiens appellent les bombe d’acqua (bombes d’eau).
III. Affaissement et érosion des côtes : alors que le sol continue de s’affaisser en raison d’une combinaison de causes naturelles et anthropiques, l’artificialisation des sols et l’impact du tourisme intensif érodent le littoral, qui est de plus en plus vulnérable aux tempêtes de mer et à d’autres événements « extrêmes », qui en réalité sont désormais récurrents et font partie d’une nouvelle « normalité ».
22. Les « infos » sont un problème
Les médias « décomposent » la crise climatique en unités isolées, en épisodes distincts appelés « nouvelles » mais bénéficiant d’une attention et d’un accent inégal. Par exemple, la sécheresse et les bombe d’acqua sont des moments d’un même phénomène, appelé whiplash effect ou effet coup de fouet, mais la première attire moins l’attention que les secondes.
La sécheresse menace notre avenir de manière différée, des reportages lui sont consacrés avec des images de rivières asséchées, mais elle ne crève pas l’écran, surtout en ville, loin des lieux de production de la nourriture et des écosystèmes en souffrance. Tant que l’eau sort du robinet à la maison, le problème n’est pas suffisamment perçu.
Les tempêtes et les inondations, en revanche, nous touchent immédiatement et directement. Leurs effets sont visibles et tangibles, de sorte que leur couverture médiatique met en avant la dimension choquante, émotionnelle, sensationnaliste et généralement déconnectée de la sécheresse. Cette séparation nous empêche de saisir le lien intime entre les deux phénomènes et la totalité du processus.

23. Il ne faut pas défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui
Il n’est pas possible de faire face à ce qui se profile en prolongeant les mêmes logiques du présent. Ces logiques ont engendré la catastrophe, en s’appuyant sur des expédients éphémères et des escamotages technologiques. La crise climatique n’est pas un problème d’inadéquation technologique momentanée : c’est une crise sociale, le résultat d’un modèle socio-économique erroné, l’accumulation des contradictions dans le mode de production actuel.
La logique du raccommodage, du solutionnisme technologique pour défendre l’existant est totalement inadaptée.
La réponse la plus simple et la plus rapide à ce qui se profile sera d’installer des barrages et des vannes mobiles dans le style du MOSE, d’augmenter et de rendre plus puissantes les stations de pompage etc.
Tout cela vise à défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui. Mais « tel qu’il est aujourd’hui » est justement une partie du problème. Ce que nous dit la crise climatique, c’est que le territoire doit être radicalement repensé et transformé.
Une « fédération » de territoires inexprimés serait le sujet le plus qualifié pour une telle refonte, capable de dessiner une ligne d’horizon plausible pour intervenir.
24. L’inconscience
Dans les territoires qui subiront l’avancée de l’Adriatique d’ici 2100, la prise de conscience de la situation va de minime à inexistante. L’inadéquation des connaissances et de la perception face à la catastrophe climatique n’est certainement pas un problème uniquement local : il est planétaire. Mais dans les zones qui nous occupent, il présente des caractéristiques particulières.
25. Quatre mises au point
Nous sommes en train de raisonner et de formuler des hypothèses sur les modes d’intervention, en alternant quatre échelles différentes.
Territoires en marge → Zone nord-adriatique → Delta du Pô → Basso Ferrarese
Le Delta comme lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique (Notes)
26. Quand le Delta était une cause à défendre
Au début des années 1950, une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes de Ferrare et d’ailleurs décida de s’occuper du Delta et d’en faire un enjeu majeur dans le débat national. Ces personnalités firent du Delta leur « question méridionale22 ». En voyageant vers l’est, ils découvrirent leur « Sud », un territoire marginal situé à quelques dizaines de kilomètres de leur ville.
De cette mobilisation culturelle et politique, il demeure d’actualité l’intention de transformer la perception d’un territoire « en marge » en un lieu central d’analyse, de changement et de revanche sociale.
27. Soixante-dix ans plus tard
Soixante-dix ans plus tard, il est à nouveau nécessaire de remettre le delta du Pô au cœur des débats. Les conditions ont changé radicalement et nous en sommes conscients : dans les années 1950, derrière les intellectuels du Delta, il y avaient des partis de gauche, des forces syndicales et d’autres sujets collectifs proches du mouvement ouvrier et de la grande force représentée par la masse des braccianti. Derrière nous, à l’heure actuelle, il n’y a rien de comparable. Mais cela ne peut pas être un alibi.
28. Miser sur les spécificités du territoire : réinonder, naturaliser
Aujourd’hui, contrairement à hier, il ne s’agit certainement pas d’invoquer la bonifica. Au contraire, il faut aller à l’encontre de ce modèle : le territoire bénéficierait grandement — en termes de biodiversité, de capture de CO2, d’inauguration de différents modèles socio-environnementaux — d’un réalignement progressif et d’une renaturalisation contrôlée au moins dans les zones asséchées au cours de la seconde moitié du XXe siècle, comme les valli du Mezzano. Bien entendu, ces terres devraient d’abord devenir propriété publique ; ensuite, leur transformation devrait s’inspirer de la deuxième acception du verbe bonificare : « ramener un territoire fortement pollué à des conditions d’équilibre naturel » (Dictionnaire De Mauro de la langue italienne).
29. Décimenter, restaurer
Il est tout aussi urgent de décimenter le littoral afin d’éviter le scénario décrit au point 19. Dans les zones libérées du béton, les écosystèmes antérieurs devraient être restaurés autant que possible, ce qui signifie libérer les rares dunes qui subsistent de la pression de l’urbanisation et les reconstituer là où elles ont été rasées. C’est l’une des meilleures défenses contre la montée de la mer Adriatique.
Certains demandent : « Qu’en sera-t-il de l’économie des Lidi ? ». On peut leur répondre que les emplois dans le secteur du tourisme intensif — souvent précaires, surexploités, sous-payés, au noir — seront remplacés par de nouveaux emplois moins frustrants, ceux générés par un grand projet de réhabilitation et de réaménagement écologique du territoire, suivis d’un travail permanent d’entretien des écosystèmes : des activités en accord avec les caractéristiques spécifiques de ces lieux.
30. Ce ne sont que quelques exemples
Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont on peut tirer parti des spécificités du territoire, de sa conformation et de son histoire, voire de sa fragilité, pour en faire un formidable lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique, même en termes d’aménagement du territoire.
31. Pas besoin d’escamotages
Cela n’a rien à voir avec le solutionnisme technologique. Ce que nous préfigurons, ce ne sont pas des « coup de génie », mais des solutions ouvertes, lentes, non orientées vers le profit. Surtout, elles partent de l’identification des causes sociales et politiques de la crise et se détournent des modèles suivis jusqu’à présent.

32. Rapports de force
C’est une question de rapports de force. C’est précisément parce qu’ils se heurtent à l’existant que ces scénarios peuvent paraître inacceptables à la grande majorité des administrateurs et, surtout, aux dirigeants de nombreuses associations professionnelles. Il faut cependant rappeler que toutes les réformes sociales, même les plus banales aujourd’hui (école de masse ? retraites ? suffrage universel ?), sont nées de propositions à première vue subversives et utopiques.
33. Prolonger
Ces propositions, calibrées sur la partie émilienne-romagnole du Delta, peuvent être étendues, en les remodelant, à l’ensemble du Delta et à toute la zone nord-adriatique.
Cette façon de formuler les problèmes et de préfigurer des solutions peut être utile à celles et ceux qui agissent dans d’autres territoires en marge et non exprimés, en Italie et ailleurs dans le monde.
34. Faire pleuvoir à l’envers
Par une lutte consciente, les territoires en marge peuvent nous rendre une partie de ce que nous avons perdu : environnement, écologie des relations, durabilité des modes de vie. Dans un monde où tout nous tombe dessus d’en haut, agir dans les territoires en marge signifie la possibilité, pour citer le regretté écrivain, journaliste et activiste Luca Rastello, de faire pleuvoir à l’envers23. Ainsi, par exemple, le monde conçu comme une maison commune conduit à s’opposer à l’exclusion, la connaissance comme forme de participation à l’imposition technocratique, le soin de l’humain et de son environnement à la négligence néolibérale.
35. Un long voyage
Ce document se voudrait le premier étape d’un long parcours, à la fois multidisciplinaire et interstitiel, lancé pour générer des doutes avant même d’apporter des réponses, conscients qu’il n’est pas facile, d’un point de vue émotionnel, d’accepter l’urgence d’un changement aussi délicat qu’inéluctable.
Les modes de vie, les dynamiques de travail et les relations sociales sont destinés à se transformer : les communautés — à commencer par les plus marginales en apparence, qui sont en réalité des avant-postes conflictuels décisifs — doivent alors revendiquent leur centralité dans le processus pour gouverner et orienter l’inévitable changement de paradigme. Elles doivent endosser une responsabilité sociale et culturelle, fondement d’une société qui veut se penser comme « civile ».

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Partie orientale de la province de Ferrare, située dans le territoire du Delta du Pô.
- Mercalli a donné une conférence dans le cadre de la 71e édition de la Fiera di Migliarino, en septembre 2018. On trouve également une référence au « canari d’alarme » dans Canzone della nocività de Paolo Ciarchi et Dario Fo, pour le spectacle Ordine ! Per DIo,ooo.ooo.ooo (1972).
- Les données de l’institut national de la statistique (ISTAT) sur les zones altimétriques, provenant des bureaux provinciaux de l’Agenzia del territorio (sur la base des plans cadastraux), indiquent que les collines et les montagnes occupent respectivement 42% et 35% du territoire, pour un total de 77% (ISTAT, Annuario statistico italiano, 2023, « Territorio », chapitre 1, p. 8).
- Le terme italien bonifica désigne ici l’assèchement des terres marécageuses (bonifica delle paludi), mais il signifie plus largement l’amélioration, la mise en valeur des sols pour les activités humaines (NDLR).
- Federica Letizia Cavallo, Terre, acque, macchine. Geografie della bonifica in Italia tra Ottocento Novecento, Diabasis, 2011.
- Dans le contexte de la plaine orientale du Pô, le terme italien valle (ou valli, au pluriel) ne désigne pas une vallée de montagne mais plutôt une « dépression marécageuse située près du delta d’un fleuve ou d’une lagune » (Grande dizionario della lingua italiana, v. 21, p. 640).
- Piero Brunello, Ribelli, questuanti e banditi: Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866, Cierre edizioni, 2011 [1e éd. 1981].
- Alessandro Roveri, Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel Ferrarese, 1870-1920, La Nuova Italia, 1972.
- Organisme créé sous le contrôle du ministère de l’Agriculture et des Forêts pour mettre en œuvre, dans le territoire du delta du Pô, la loi de 1950 qu’en Italie on appelle traditionnellement de « réforme agraire ».
- Aucune publication monographique sur cet épisode n’existe encore. Voir Giorgio Bassani, « Il litorale emiliano-romagnolo : Problemi e prospettive », Bollettino di Italia Nostra, XII, 75-76, septembre-octobre 1970, Associazione Italia Nostra, Rome, p. 27-29. Republié dans Giorgio Bassani, Italia da salvare. Gli anni della Presidenza di Italia nostra (1965-1980), Feltrinelli, 2018; Piero Dagradi et Bruno Menegatti, Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell’Emilia Romagna, Pàtron, 1979.
- Données issues de : R. J. M. Temmink, L. P. M. Lamers, C. Angelini, T. J. Bouma, C. Fritz, J. Van De Koppel, R. Lexmond, M. Rietkerk, B. R. Silliman, H. Joosten et T. Van Der Heide, « Recovering wetland biogeomorphic feedbacks to restore the world’s biotic carbon hotspots », Science, 376(6593), eabn1479, 2022.
- Les valli se distinguaient par la qualité de leurs eaux : dans les dolci (douces), on cultivait le roseau ; dans les salse (salées, plutôt saumâtres et légèrement salées), on pratiquait la pisciculture.
- Marco Armiero, Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets, Lux Éditeur, 2024 (traduit depuis l’édition anglaise de 2021).
- Matthew Taylor et Pamela Duncan, « Revealed : almost everyone in Europe is breathing toxic air », The Guardian, 20 septembre 2023. « Eastern Europe is significantly worse than western Europe, apart from Italy, where more than a third of those living in the Po valley and surrounding areas in the north of the country breath air that is four times the WHO figure for the most dangerous airborne particulates ».
- Selon le rapport 2023 de l’Agence européenne pour l’environnement, environ 46 800 décès causés par les particules PM2,5 ont été enregistrés en Italie en 2021, dont 14 000 dans la seule plaine du Pô (89 pour cent mille habitants).
- La plaine du Pô s’étend précisément à l’intérieur des frontières administratives des quatre régions italiennes — la Lombardie, la Vénétie, le Piémont et l’Émilie-Romagne — les plus bétonnées d’après les rapports annuels de l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sur l’artificialisation des sols.
- Eugenio Turri, Semiologia del paesaggio italiano (1e éd), Marsilio, 2014. Voir aussi son article dans l’ouvrage collectif Mimmo Jodice et Eugenio Turri (dir.), Gli iconemi. Storia e memoria del paesaggio, Electa, 2001.
- Carlo Cencini, « Il litorale ferrarese : dai Lidi al Parco del Delta », in Forme del territorio e modelli culturali in Emilia-Romagna : per una nuova geografia regionale, Lo Scarabeo, 1994.
- Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, FYP Éditions, Limoges, 2014.
- F. Antonioli et al., « Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains : Flooding risk scenarios for 2100 », Quaternary Science Reviews, 158, 2017, p. 29-43.
- Il convient de rappeler que 44 % de la province de Ferrare se trouve en dessous du niveau de la mer.
- Voir la notice Wikipédia pour une présentation générale de la place de la question méridionale dans l’histoire italienne.
- Luca Rastello, Piove all’insù, Bollati Boringheri, 2017.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
16.06.2025 à 14:51
Appel à s’organiser contre l’informatisation de la société
Comité 15 Juin
L'emprise et les méfaits du numérique s'accentuent chaque jour : surveillance, dépendance, aliénation, troubles de l'attention, empreinte écologique et matérielle colossale, militarisation... N'est-il pas temps d'abandonner les illusions à propos d'un réseau numérique pouvant être orienté dans un sens émancipateur ? Cette tribune invite à participer à des rencontres sur ce thème en Limousin du 27 au 29 juin prochain.
L’article Appel à s’organiser contre l’informatisation de la société est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3837 mots)
Temps de lecture : 8 minutes
« Nous, « public », « usagers », « simples citoyens », avons été placés devant le fait accompli. Ou plus exactement, comme c’est la règle en matière de nouvelles technologies, le débat n’a pas existé, car la technologie n’est pas censée être politique. […] Il n’existe ni lieu ni moment pour en débattre ».
Célia Izoard, Merci de changer de métier, éditions de la Dernière lettre, 2020
Le 15 juin 2021, la répression « antiterroriste » (SDAT, GIGN et autre PSIG) s’abattait en Limousin sur plusieurs personnes soupçonnées d’avoir provoqué des incendies pour dénoncer le déploiement du compteur Linky puis de la 5G. Il est frappant de constater que les moyens policiers employés pour mener l’enquête qui a conduit aux arrestations reposent sur les mêmes dispositifs techniques que ceux qui étaient dénoncés par les sabotages : traçabilité des citoyens par l’utilisation du réseau mobile et de la surveillance de l’espace public, élaboration et mise en correspondance de fichiers de renseignements, dépense d’énergie faramineuse, etc.
Cette affaire, parmi tant d’autres, montre à quel point l’informatique a permis de construire un monde fermé sur lui-même, sans alternative possible, verrouillé dans une accélération mortifère qui ne semble pas avoir de fin. Commercialisation massive des ordinate :urs dans les années 80, distribution générale de l’Internet dans les années 90, déferlement des smartphones dans les années 2000, accélération permanente des calculateurs et des réseaux, et désormais avènement de l’incompréhensible « I.A. »… La technologie et ses exigences matérielles ont envahi tous les territoires de la Terre et de la vie sociale. Est-il encore possible d’arrêter cette boucle infernale ?
Le « nuage » et ses réalités
En à peine deux générations, nous sommes ainsi entrés dans un monde où celles et ceux qui ne vivent pas (encore) derrière un écran sont nécessairement gouverné·es et surveillé·es par celles et ceux qui le font. Cette politique embarque pourtant avec elle, dans ses conditions de possibilités comme dans ses effets, une série de réalités délétères.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
C’est le travail des paysans, des éleveuses, des forestiers, contraint par l’obligation de pucer les bêtes et de numériser leurs parcelles ; c’est le travail des ouvrières et employées aliéné une seconde fois par l’automatisation, le découpage et le minutage des tâches ; c’est le travail des enseignants saboté par l’obligation de fichage des élèves et la validation numérique de leurs « compétences », les parents et les élèves noyés dans ProNote ou ParcoursSup ; ce sont les conseillères de France Travail qui en viennent à se comparer elles-mêmes à des « cliqueuses professionnelles », les travailleurs des entrepôts péri-urbains qui se vivent comme des « robots » soumis aux ordre de casques à commande vocale, c’est la suppression des guichets administratifs qui prive les gens de l’accès à leurs droits et à la solidarité. C’est l’ubérisation généralisée et les purges numériquement assistées dans les « ressources humaines » de tous les secteurs.

La logique numérique et calculatrice s’est déployée dans tous les secteurs de la vie, transformant le travail autant que le gouvernement, l’économie autant que les échanges sociaux, les relations avec l’environnement autant que le cours des guerres. Sur ce dernier point, il devrait suffire d’observer les innovations militaires qui se sont mises en place ces dernières années (depuis les frappes de l’armée israélienne déterminées par les calculs de l’I.A. jusqu’à la course à l’équipement technologique qui sous-tend le conflit russo-ukrainien) pour reconnaître que démilitarisation et dénumérisation n’ont jamais été aussi imbriquées.
En parallèle, plus personne n’ignore que la plus grande arnaque de la « dématérialisation » est en fait sa formidable matérialité. En effet, celle-ci consiste avant tout à produire des puces, des circuits, des câbles, des centrales, des objets connectés de plus en plus variés, puis à distribuer ces produits à l’échelle mondiale, à renouveler encore ces machines et les réseaux qui permettent de les faire fonctionner, puis à les redistribuer encore. La réalité écologique de la « dématérisalisation » est ainsi celle d’une destruction sans frein des sols et des cours d’eau, qui ne cesse de s’accélérer au nom même de la « transition » et du solutionnisme technologique. Ce sont les fermes de serveurs qui consomment autant d’énergie que des villes entières, et dont on nous promet encore la multiplication. C’est le projet StarLink qui déploie des milliers de satellites, au point de masquer les étoiles elles-mêmes, au nom du « besoin » de couvrir les zones blanches. C’est aussi le verrouillage, au nom de la « continuité de service », de l’ensemble des systèmes sociaux par une mise en dépendance criminelle envers des infrastructures imposées – comme pour le nucléaire ? Mais en plus du nucléaire.
Il est essentiel de considérer l’ensemble des conséquences désastreuses de l’informatisation de la société, ainsi que de trouver des voies pour nous y opposer.
La consommation d’énergie du secteur numérique augmente de 9% par an, et est appelée à augmenter encore du fait du développement de la prétendue intelligence artificielle. La durée de vie des objets du monde numérique, toujours plus nombreux, est sans cesse plus courte. Le coût humain de toute cela, enfin, c’est celui des suicidés des usines Foxconn, des travailleurs déshumanisés qui entraînent à longueur de journée le Copilot de Microsoft ou les caméras à reconnaissance faciale, des populations entières exploitées ou déplacées pour l’exploitation des minerais, des guerres et des politiques coloniales pour l’accès à ces ressources.
Pour toutes ces raisons, il nous semble essentiel de considérer avec le sérieux qu’elles méritent l’ensemble des conséquences désastreuses de l’informatisation de la société, ainsi que de trouver des voies pour nous y opposer.
La résistance a toujours été là
Si les analyses de cette catastrophe historique ne manquent pas, les actions et mobilisations pour tenter de l’empêcher non plus. À commencer bien sûr par les pratiques individuelles par lesquelles de nombreuses personnes cherchent à se dégager de l’emprise numérique sur leur quotidien, percevant bien que « l’apprentissage machine », le « big data » et la « surveillance globale » dépendent pour partie de leur contribution bénévole et de celle de leurs contemporains.
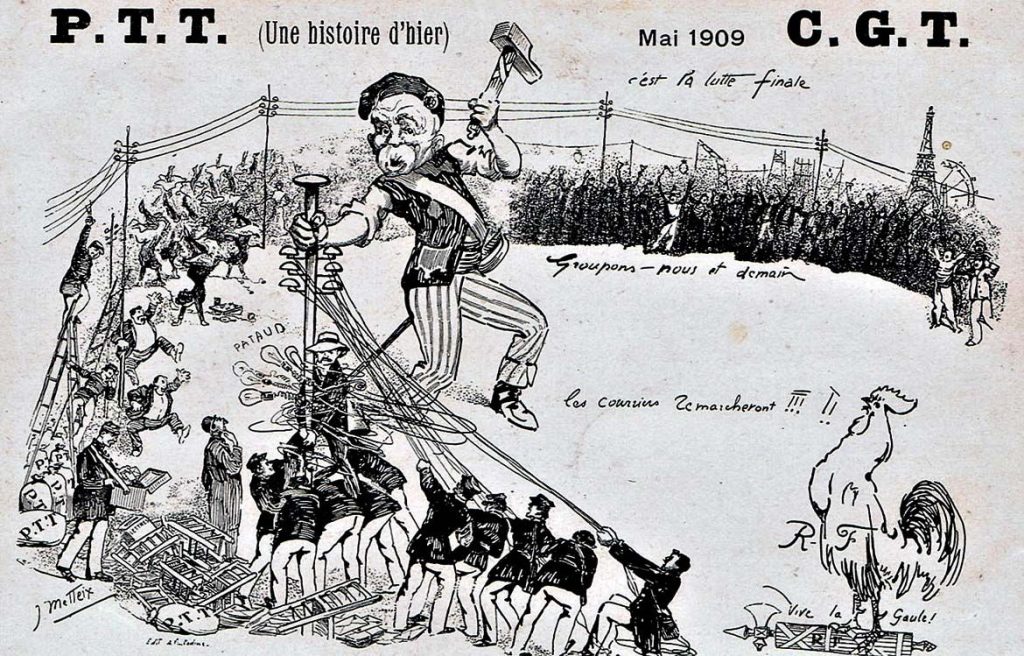
Au reste, on ne saurait oublier que le déferlement numérique a aussi été confronté depuis ses débuts à une multitude d’oppositions collectives : mobilisations syndicales contre la dépossession de l’outil de travail, manifestations contre les premières tentatives de fichage de masse (dont une des issues, bien insuffisante, fut la création de la CNIL), sans oublier diverses actions de sabotages, comme les destructions et incendies de machines revendiqués dans les années 80 par le Comité pour la Liquidation ou le Détournement des Ordinateurs, le CLODO, à Toulouse. Ces oppositions n’ont d’ailleurs pas cessé jusqu’à aujourd’hui d’accompagner les phases ultérieures du déploiement de la « méga-machine » : dénonciation de l’accumulation des lois de surveillance (par exemple avec la Quadrature du Net), sabotages et incendies contre le déploiement de la 5G, de la fibre optique et des infrastructures de l’hyper-connexion (qui ont eu lieu par centaines ces dernières années), luttes collectives contre l’extractivisme minier et hydrique (par exemple avec les collectifs Stop Mines en France et les nombreuses mobilisations dans le monde entier), mise en évidence des liens organiques entre les conflits armés et l’industrie technologique (avec le collectif Génération Lumières), critique publique du déferlement numérique et de ses effets destructeurs (avec des collectifs comme Écran Total ou Lève les Yeux)…

À bien y regarder, il n’est presque plus un seul mouvement d’opposition dans le monde qui ne se trouve amené à faire le lien entre l’oppression qu’il dénonce et les effets antisociaux de l’informatisation générale.
Sortir des brumes, affronter le réel
Nous pensons d’ailleurs que c’est dans cette capacité à relier toutes ces dimensions délétères que réside la possibilité d’aller encore au-delà, et d’envisager l’indispensable construction d’une critique massive et internationale.
Il n’est presque plus un seul mouvement d’opposition dans le monde qui ne se trouve amené à faire le lien entre l’oppression qu’il dénonce et les effets antisociaux de l’informatisation générale.
En novembre 2024, se tenait à Marseille le festival « Le nuage était sous nos pieds », au cours duquel à partir de la dénonciation de la construction de nouveaux « data centers », ont été proposés divers moments de réflexion et de débat public pour documenter les réalités matérielles de la numérisation générale.
Au mois de mars dernier, des rencontres à Grenoble autour de « L’Impossible relocalisation » ont réuni des centaines de personnes de plusieurs pays pour partager et mettre en lien les témoignages des désastres et des résistances liés au déploiement de la méga-machine dans le monde entier. Une grande manifestation et des actions concrètes se sont tenues afin de dénoncer l’extension des deux usines de puces électroniques, révélant au passage la chaîne d’interdépendances qui relie la guerre civile en RDC (dans un contexte de concurrence sur les ressources minières), les collusions entre le pouvoir politique et techno-industriel, l’accaparement des ressources en eau pour la fabrication des puces, et l’usage militaire d’une partie de cette production.
Lire aussi sur Terrestres : François Jarrige, « Rapiécer le monde. Les éditions La Lenteur contre le déferlement numérique », décembre 2019.
À l’instar de ces mobilisations, il s’agit désormais de sortir des brumes et d’affronter le réel. C’est pourquoi les personnes et les collectifs signataires de cette tribune invitent à multiplier les espaces dans lesquels l’informatisation de la société, et toutes les réalités qu’elle implique, pourront rencontrer la critique et l’opposition qu’elles méritent.Dans cette perspective, ils et elles invitent chacun·e à participer aux rencontres proposées en Limousin du 27 au 29 juin prochain par le comité 15 juin, ainsi qu’à soutenir activement les personnes poursuivies pour leurs actions dans ce cadre.


Mai 2025
contact : comite15juin@riseup.net
PREMIERS SIGNATAIRES
—————————-
Nicolas Bérard, journaliste (l’Âge de faire), auteur de « Ce monde connecté qu’on nous impose »
Dominique Egrot (Stop Mines 03)
Comité 03 – Soutien aux raflé.e.s du 15 juin en Limousin
OCL Moulins – Organisation Communiste Libertaire
Claire Lhermitte – Génération Lumière
Fabien Lebrun, chercheur en sociologie, auteur de « Barbarie numérique – Une autre histoire du monde connecté »
Serge Quadruppani, essayiste et romancier, auteur de « La politique de la peur »
Celia Izoard, autrice
Matthieu Amiech, éditeur, auteur de « Peut-on s’opposer à l’informatisation de nos vies ? »
Bertrand Louart, Radio Zinzine
Alain Dordé, rédacteur (le Chiffon)
Gary Libot, journaliste (le Chiffon)
Pierre Bance, auteur de La Fascinante démocratie du Rojava et de La Grande Fédération. Démocratie directe et vie fédérale.
Stéphane Lhomme, Directeur de l’Observatoire du nucléaire , Animateur du site web Refus Linky Gazpar
Le collectif Bassines Non Merci 63
Jacky Chabrol, auteur de « Déconnectons nous » et « Sortir de la toile, est-ce possible ? »
Sabine Duguet, comité 15 juin
Hélène Autret
L’Atelier Paysan
Christine Thiollet, SNES
Collectif ACCAD (Anti Compteurs Communicants Artois Douaisis)
Coordination Stop 5G Lyon / Vers une Désescalade Numérique
Collectif Ecran Total Lyon
Groupe Technopolice Lyon
CRAAM Grenoble, Lyon, Saint Etienne (Coordination Régionale Anti Armement et Militaire)
Sandrine Larizza, syndiquée CGT engagée dans le contre sommet de l’IA du 10/02/25 à Paris
Association Résistance 5G Nantes
Les citoyens nantais de vigilance citoyenne (CNVC)
Les citoyens nantais pour une social-écologie critique (CNPSE)
Collectif Nantes1 anti-Linky5G
Collectif 44 Nantes contre Linky
Elisabeth Alexandre. Journaliste
ATTAC 87/23
Les soulèvements de la Terre en Corrèze
Michelle Estorge
François Jarrige, historien
ATTAC 19
Barbara Métais-Chastanier, dramaturge
Collectif Halte au contrôle numérique
Association Robin des Toits
Michel Kokoreff, sociologue, auteur de « La diagonale de la rage »
Aurélien Berlan, enseignant-chercheur à l’Université de Toulouse
Illustration d’ouverture : Illustration de Ludd, leader fictif des luddites, publiée en mai 1812 par Messrs. Walker and Knight, Sweetings Alley, Royal Exchange

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article Appel à s’organiser contre l’informatisation de la société est apparu en premier sur Terrestres.
27.05.2025 à 18:33
Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique
La rédaction de Terrestres
La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.
L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3846 mots)
Temps de lecture : 10 minutes
Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.
Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.
Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.
Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.
Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.
De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.
Geneviève Azam
► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.
Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.
Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.
Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.
Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.
« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »
Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :
Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.
Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.
Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.
Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…
C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.
Virginie Maris
► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017
Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée
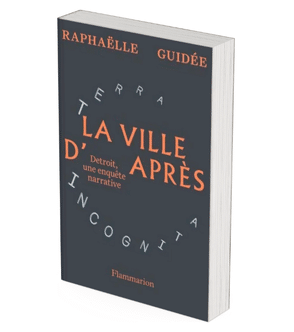
Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».
La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?
Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.
Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.
Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).
Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.
Quentin Hardy
► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024
BD · Environnement toxique · Kate Beaton
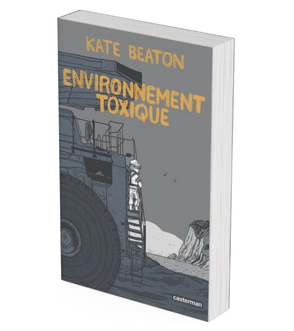
Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.
En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.
En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.
50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.
Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.
Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.
Emilie Letouzey
► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.
10.05.2025 à 21:22
Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil
Erika Campelo
Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l’élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l’extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.
L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5703 mots)
Temps de lecture : 14 minutes
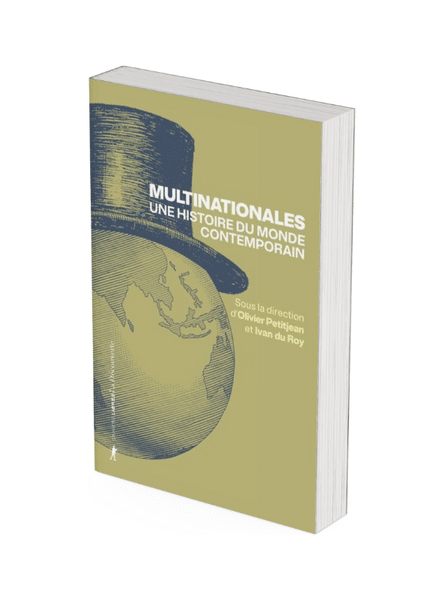
Ce texte constitue le dernier chapitre du livre Multinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.
Le 5 juin 2022, aux confins de l’Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu’ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d’Amazonas), un affluent indirect de l’Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l’environnement dans le Val do Javari, l’une des plus grandes réserves autochtones du pays, d’une superficie équivalente à celle de l’Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l’enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l’arrestation de plusieurs suspects faisant partie d’un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l’extraction minière et l’abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.
Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s’ajoutent à la longue liste des défenseurs de l’environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l’environnement recensés dans le monde par l’organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu’ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l’un d’entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d’État à l’environnement dans l’État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d’assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d’affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l’industrie du bois, de holdings de gestion d’actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l’accaparement de terres protégées, la corruption d’élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.
Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l’intense pression économique qui s’exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l’illégalité, ou se rendent directement coupables d’activités criminelles se dessine l’ombre du puissant secteur brésilien de l’agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Viandes et soja
L’agrobusiness brésilien est l’un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l’État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d’installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s’est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald’s, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d’immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d’organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l’exporter, notamment dans l’Union européenne.

Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d’une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n’a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l’importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.
Lire aussi sur Terrestres, Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.
Travail esclave
En plus de constituer une menace pour les écosystèmes, l’agriculture intensive recourt au travail forcé. Celui‑ci s’appuie le plus souvent sur une forme de servitude par la dette, plaçant des travailleurs pauvres ou migrants (y compris pour des migrations internes au Brésil) à la merci de recruteurs travaillant pour des propriétaires terriens ou des fournisseurs de grandes marques. Recrutés dans les régions périphériques du bassin amazonien, ils sont envoyés à des centaines de kilomètres de leurs villes ou villages d’origine contre la promesse d’un emploi, sont sous‑payés, travaillent dans des conditions indignes et doivent s’endetter auprès de leur employeur pour leur logement et leur nourriture, ce qui les maintient sous leur emprise. Ces pratiques sont qualifiées de « conditions analogues à l’esclavage » et sont souvent désignées au Brésil par le terme « travail esclave », quand le travailleur est soumis à des conditions dégradantes, à un travail épuisant, à la servitude pour dettes, au travail forcé ou à la restriction de sa liberté de déplacement (l’esclavage a été aboli tardivement au Brésil, par une loi de 1888). Ces pratiques se retrouvent dans l’élevage, la déforestation ou l’extraction minière en Amazonie, mais concernent aussi d’autres secteurs comme la construction ou l’industrie du textile.
De même, le soja brésilien exporté vers l’Asie ou l’Europe — où il sert essentiellement à l’alimentation animale dans les élevages intensifs — constitue l’une des causes majeures de déforestation et d’appauvrissement des communautés locales. Cargill et Bunge, qui figurent parmi les géants mondiaux du négoce de matières premières, en particulier alimentaires, sont des acteurs incontournables de la culture et de l’exportation du soja brésilien. Bunge joue ainsi un rôle majeur dans la destruction du Cerrado, selon une étude menée par la fondation environnementale Mighty Earth (basée à Washington) publiée en juin 2023. Le Cerrado est une vaste savane tropicale, en périphérie de la forêt amazonienne, qui couvre près de 20 % du territoire brésilien. Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, il abrite des milliers d’espèces végétales et animales, dont beaucoup sont endémiques. Le Cerrado contribue de manière cruciale à l’équilibre écologique continental, notamment en régulant le cycle de l’eau, et en stockant du carbone pour atténuer le changement climatique. Selon Mighty Earth, les fournisseurs de Bunge ont causé la déforestation de dizaines de milliers d’hectares dans la région de Matopiba, au centre du Brésil, entre 2021 et 2023, malgré l’engagement « zéro déforestation » de la multinationale de négoce.

Pour lutter contre ce fléau, le Brésil a mis en place en 2003 la « lista suja » (liste noire), un registre public des employeurs reconnus coupables de travail esclave destiné aux entreprises qui s’approvisionnent en soja, sucre ou café et qui veulent éviter des fournisseurs recourant au travail esclave. La constitutionnalité de cette liste a été confirmée par la Cour suprême en 2020 malgré les tentatives de suppression par les lobbyistes de l’agrobusiness et de l’immobilier. L’inclusion d’une entreprise ou d’une marque sur cette liste peut entraîner la suspension de financements publics et de contrats commerciaux. « L’esclavage moderne persiste parce qu’il y a une logique économique derrière : générer plus de profit avec le moindre coût possible, sans aucun respect pour la dignité humaine », estime Leonardo Sakamoto, journaliste brésilien et activiste engagé dans la lutte contre le travail esclave, fondateur du média indépendant Repórter Brasil. Plusieurs grandes multinationales ont été accusées d’implication directe ou indirecte dans des pratiques de travail esclave : la découverte d’ateliers clandestins dans l’État de São Paulo qui confectionnait des vêtements pour Zara (groupe Inditex) fait scandale en 2011. En 2019 et 2020, des ranchs où est pratiqué le travail forcé vendent leur bétail à JBS. Des révélations régulières concernent des usines de bioéthanol ou de sucre (approvisionnant notamment la coopérative agricole française Tereos et sa marque Beghin‑Say).
Pollution minière
L’exploitation minière représente un autre vecteur de destruction en Amazonie, et dans d’autres régions du pays, comme l’État du Minas Gerais. Des multinationales telles que Vale et Anglo American dominent ce secteur, extrayant principalement du fer, de l’or et du cuivre. Les projets miniers nécessitent souvent la construction de barrages, de routes et d’infrastructures qui fragmentent l’habitat naturel et perturbent les modes de vie des communautés locales.
Vale est fondée au Brésil en 1942 sous le nom de Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) par le régime de Getúlio Vargas pour exploiter les mines de fer d’Itabira (Minas Gerais). Elle devient ensuite l’une des plus grandes entreprises minières au monde et le premier producteur de minerai de fer ou de nickel. Elle est privatisée en 1997 puis simplifie son nom en 2009, pour « Vale ». Basée à Rio de Janeiro, la société opère dans quatorze États brésiliens et sur les cinq continents, et possède neuf terminaux portuaires. En 2006, elle acquiert le canadien Inco, plus grand producteur mondial de nickel. Derrière ce succès économique, ses pratiques environnementales et sociales sont très critiquées. Vale a été nommée « pire entreprise du monde » en 2012 par les ONG Greenpeace et Déclaration de Berne (Public Eye aujourd’hui).

La compagnie minière est tristement célèbre au Brésil pour deux catastrophes industrielles dans l’État du Minas Gerais, en 2015 puis en 2019, dans une zone où Vale possède de multiples concessions minières. À Mariana, la rupture d’un barrage minier du groupe Samarco (détenu par Vale avec le groupe australien BHP Billiton) provoque la mort de dix‑neuf personnes et le déversement de boues toxiques sur plusieurs centaines de kilomètres en aval, dans la rivière Rio Doce, celle‑là même qui a donné son nom à la multinationale. Trois ans plus tard, à Brumadinho, l’effondrement des bassins de rétention de boues toxiques cause la mort de plus de 300 personnes et une dévastation environnementale massive en aval sur plus de 500 km jusqu’à l’océan Atlantique. En mars 2024, le leader autochtone Merong Kamakã Mongoió est retrouvé mort à Brumadinho. Il aurait été victime de persécutions de la part de policiers militaires et de gardes de sécurité au service de la multinationale, selon des témoignages d’amis et de membres de sa famille. Bien que ces désastres écologiques et humains soient survenus en dehors de l’Amazonie, ils illustrent les risques que posent toujours les activités minières à grande échelle, tant pour l’environnement que pour les populations humaines. D’autant que Vale et d’autres compagnies possèdent plusieurs vastes concessions minières en Amazonie. Barcarena, un district industriel à proximité de Belém, en Amazonie brésilienne, abrite ainsi des installations industrielles telles que la plus grande fonderie d’aluminium au monde, opérée par Hydro Alunorte (filiale de la norvégienne Norsk Hydro), et une usine de kaolin appartenant à l’entreprise française Imerys. Ces installations provoquent des pollutions répétées depuis deux décennies, menaçant la santé des habitants, polluant les rivières et les nappes phréatiques, et altérant les écosystèmes locaux. En deux décennies, au moins vingt‑six accidents industriels et fuites de polluants ont été recensés, principalement liés aux bassins de décantation, contaminant les eaux locales, et rendant la pêche et l’accès à l’eau potable difficiles, voire impossibles.

Norsk Hydro, avec sa fonderie d’aluminium Hydro Alunorte, est une source majeure de pollution. Les « boues rouges » issues de la transformation de bauxite en alumine contiennent des métaux lourds. En février 2018, après des pluies intenses, l’entreprise est accusée de déverser illégalement des effluents contaminés dans la forêt et les rivières. Les conséquences sont graves : acidification des eaux, mortalité des poissons, et risques sanitaires pour les habitants. Les actions juridiques menées par l’autorité fédérale contre les multinationales sont compliquées par un manque de moyens, les enquêtes en cas d’accidents ne sont pas systématiques. Les communautés affectées, principalement les quilombolas (descendants d’esclaves) et les caboclos (métis d’Amérindiens et d’Européens), résistent aux pressions pour quitter leurs terres. Elles revendiquent le droit de rester et demandent la dépollution des eaux et une compensation juste pour les dommages subis. En réponse, l’État du Pará envisage de les délocaliser pour « les protéger des pollutions chroniques », ce qui permettrait d’étendre la zone industrielle de ces deux multinationales. Ce projet de délocalisations forcées s’accompagne de menaces et d’intimidations, exacerbant les tensions locales.
« De la multitude de matières premières qui transitent par leur territoire, les habitants n’en supportent que les retombées négatives », constate au moment de ces pollutions Marcel Hazeu, professeur en sciences environnementales à l’université fédérale du Pará, dans un reportage réalisé par le média Basta !. En plus de supporter les destructions de leur environnement et les pollutions générées par les activités agricoles ou minières, les communautés locales ne bénéficient que très rarement des infrastructures mises en place pour les multinationales (réseau d’électricité, accès à l’eau courante…). Et ne profitent pas forcément des emplois directs ou indirects créés. Les 100 000 employés de JBS au Brésil, qui travaillent dans les abattoirs ou les usines de transformation, perçoivent un salaire moyen de 1 700 Réais (environ 300 euros), très légèrement au‑dessus du salaire minimum, qui demeure très faible au regard du coût de la vie. Dans onze des douze municipalités brésiliennes où JBS possède d’importants sites de production, une recherche menée par l’anthropologue Raísa Pina (université de Brasilia) montre que la pauvreté a progressé de 50 %. La chercheuse précise que son étude ne démontre pas une causalité directe entre les implantations de JBS et l’augmentation de la pauvreté mais met en lumière le paradoxe d’une « nation qui abrite la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec un slogan “ nourrir le monde ”, tout en connaissant une augmentation de la faim ».
De l’Amazonie à Brasilia
Cette pression physique continue sur l’Amazonie et les communautés qui y vivent se double d’un important lobbying à Brasilia, au parlement fédéral, pour affaiblir ou entraver la moindre politique de protection de l’environnement ou de sanctuarisation de territoires au profit des populations autochtones. Des coalitions ad hoc rassemblant des députés ou des sénateurs de plusieurs partis y défendent spécifiquement les intérêts des groupes agro‑industriels et des grands propriétaires terriens. Ainsi, le FPA (Front parlementaire pour l’agriculture) rassemble en 2024 environ 300 députés (sur 513), issus des partis centristes, de droite libérale, conservateurs ou de droite extrême — également appelé la bancada ruralista (le banc rural) à l’Assemblée nationale — et une cinquantaine de sénateurs (sur 81). Les députés membres du FPA entretiennent un lien privilégié avec un think tank, l’Instituto Pensar Agro (IPA). Celui‑ci ébauche des projets d’amendements et des rapports à destination de ces députés lors de projets de loi, comme celui réautorisant plusieurs pesticides ou celui sur l’exploitation minière des terres indigènes. Or l’IPA est financé par les organisations professionnelles de l’agrobusiness, qui regroupent producteurs, entreprises et géants des secteurs agro‑industriels, comme JBS, Cargill, Bunge, Nestlé, ou de la chimie, tels BASF et Bayer.

Lors du mandat du président Jair Bolsonaro (2019‑2023), les députés du FPA ont tenu pas moins de 160 rencontres officielles avec les délégués de l’IPA et des représentants du ministère de l’Agriculture, dont vingt réunions en présence de la ministre Tereza Cristina, elle‑même porte‑voix des intérêts agro‑industriels quand elle était députée. Cet intense lobbying a été documenté par l’Observatoire de l’agrobusiness au Brésil (De Olho nos Ruralistas), un média indépendant. À ces réunions s’ajoutent les rendez‑vous bilatéraux entre multinationales et membres du gouvernement. Syngenta, multinationale suisse désormais propriété de ChemChina, se distingue avec quatre‑vingt‑une réunions avec le ministère de l’Agriculture, suivie de JBS avec soixante‑quinze rencontres, puis Bayer, leader du marché brésilien des pesticides, avec soixante entrevues. Bayer a également tenu seize réunions en dehors des registres officiels, incluant une audience directe avec le président Bolsonaro et la participation de la ministre Tereza Cristina à une vidéo institutionnelle de la multinationale.
Pendant la présidence Bolsonaro, les députés membres de la bancada ruralista ont joué un rôle majeur dans le démantèlement des lois protégéant l’environnement. Le code forestier de 2012 a ainsi été modifié sous la pression des lobbyistes de l’agrobusiness pour faciliter la déforestation légale au profit de l’expansion des cultures de soja et des pâturages pour le bétail. La bancada ruralista a également soumis des projets de loi comme celui visant à reclasser des zones protégées en « zones d’occupation anthropique » en vue de les ouvrir à l’exploitation agricole, ou permettre l’extraction minière et la construction de barrages hydroélectriques au sein des territoires sanctuarisés pour les populations autochtones. La corruption et les soupçons d’implication dans des activités économiques criminelles, constatées au cœur de l’Amazonie, remontent aussi au plus haut niveau du pouvoir brésilien. Le ministre de l’Environnement du gouvernement Bolsonaro, Ricardo Salles, a dû démissionner de son poste en 2021 alors qu’il est ciblé par deux enquêtes de la Cour suprême fédérale pour commerce illégal de bois et… violation de la législation environnementale dans des espaces protégés. Ces enquêtes ne l’ont pas empêché d’être réélu député fédéral en 2023.
Lire aussi sur Terrestres, Oiara Bonilla, « La vitalité des possibles face à l’extrême droite au Brésil », novembre 2018.
Le réseau d’influence tissé par la FPA et l’IPA met en lumière comment les intérêts économiques des multinationales pèsent lourdement sur les décisions politiques au Brésil, au détriment des régulations environnementales et des droits des peuples autochtones et communautés locales. Le cas brésilien illustre l’énorme pression économique qu’exercent de nombreux acteurs économiques, en premier lieu les multinationales de l’agroalimentaire et de l’extraction minière, sur de vastes zones naturelles comme l’Amazonie et le Cerrado. Les diverses formes que prend cette pression — des menaces qui pèsent sur les défenseurs de l’environnement et les communautés locales jusqu’à la déforestation massive, en passant par les pollutions industrielles, des conditions de travail indignes, ou la destruction de précieuses zones de biodiversité — se manifestent bien au‑delà du Brésil, que ce soit dans d’autres États amazoniens d’Amérique du Sud, dans les forêts tropicales d’Afrique équatoriale ou d’Asie du Sud‑Est, dans le vaste territoire canadien ou les steppes de Sibérie, et parfois même au nom de la transition écologique. Mettre en place et faire respecter de véritables politiques de préservation et de lutte contre le réchauffement climatique, quitte à contraindre l’appétit des multinationales, constitue l’un des défis majeurs du nouveau siècle.
Pour aller plus loin
Pour mieux comprendre le fonctionnement politique brésilien, l’Observatoire de la démocratie brésilienne propose un glossaire du vocabulaire politique brésilien.
Campelo Erika et du Roy Ivan, « Polluées, menacées, déplacées : ces communautés amazoniennes aux prises avec des multinationales européennes », Basta !, 25 septembre 2018.
De Olho nos Ruralistas, « Os Financiadores da Boiada: como as multinacionais do agronegócio sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental », Rapport, juillet 2022
Mighty Earth, « Monitoring deforestation in Brazilian supply chains », Rapport, mars 2024.
Pina Raísa, « Alimentando a desigualdade : os custos ocultos do monopólio industrial da carne », Rapport, avril 2024.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.
18.03.2025 à 11:20
Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens
Michael Löwy
Que vous détestiez Marx parce qu'il incarne le prototype du théoricien dogmatique ou que vous voyiez en lui un penseur incontournable pour saisir notre modernité, ce livre est fait pour vous ! Dans un roman passionnant, « Marx en Amérique », Christian Laval conçoit une histoire alternative : et si Marx n’était pas mort en 1883 à Londres ? Laval imagine un Marx réinventant complètement sa vie et sa philosophie en allant s’installer chez les Indiens sénécas…
L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3152 mots)
Temps de lecture : 7 minutes
Introduction à l’ouvrage de Christian Laval, Marx en Amérique (Champ Vallon, 2025), suivie d’un extrait.

Voici un livre étonnant, hors du commun. À la fois roman, récit ethnographique et manifeste politique, il nous propose un autre Marx, un Marx communiste, certes, mais très éloigné du partisan du progrès et des forces productives de certains écrits très (trop) connus. L’auteur s’appuie, certes, sur ses Cahiers de Notes Ethnographiques, sur ses dernières lettres sur la Russie, mais il s’agit quand même d’un Marx inconnu, produit de l’imagination romancière.
Marx se rend aux États-Unis et devient l’ethnologue d’une communauté indienne
Le sociologue Christian Laval nous propose un Marx, qui, après avoir organisé en 1883 un faux enterrement, avec la complicité de ses filles et de Friedrich Engels, part en Amérique pour rencontrer les Iroquois dont parlait si bien l’anthropologue américain Lewis Morgan (1818-1881). Déguisé en George Tullok, ethnologue anglais d’origine germanique, il découvre au village de Tecumseh, dans l’État de New York, une communauté de Senecas, derniers descendants de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires. Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans cette communauté, par épouser White Wing, une institutrice veuve, et par prendre une nouvelle identité : le Seneca Clever Fox. Sa solidarité avec les Iroquois va même le conduire à faire sauter le bureau d’une entreprise de spéculation foncière responsable de l’expropriation des terres indigènes : « la dynamite, voilà l’ultime arme de la critique »…
Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans une communauté issue de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires.
Ce nouveau Marx reçoit après quelques années la visite de son ami Engels, qui l’accuse d’être devenu rousseauiste, et de sa fille Eleanor (« Tussy ») qui le compare à son ami William Morris. Devant sa fille, « Clever Fox » se livre à un bilan auto-critique : j’ai cru, dit-il, que la liberté passait par l’esclavage du capital, j’ai même osé parler de la « grande influence civilisatrice du capital » et du rôle révolutionnaire de la colonisation anglaise de l’Asie. Sa nouvelle conception de l’histoire est inspirée d’un célèbre passage de Morgan : « la nouvelle société de l’avenir sera une résurrection, sous une forme supérieure, de la liberté, égalité, fraternité des anciennes gentes ».

Rêvant d’une nouvelle Confédération de tous les autochtones de l’Amérique du Nord, et, pourquoi pas, de toutes les nations du monde, le vieux Clever Fox décide, à la fin du siècle, de mettre fin à ses jours en plongeant dans les chutes du Niagara. Dans un « Cahier de notes » (imaginaire) à la fin du livre, Marx explique sa nouvelle conception dialectique de l’histoire, en rupture avec l’idéologie bourgeoise du progrès : on doit revenir en arrière pour aller de l’avant. Le communisme est un mouvement backforward, un principe antérieur élevé à un niveau supérieur.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Un des aspects les plus intéressants – et actuels – du livre sont les réflexions de Marx sur la dimension « écologique » du mode de vie des Iroquois : le respect pour la nature, l’amour pour la Terre mère, un rapport non-propriétaire au monde, la solidarité avec tous les êtres vivants, bref, un « communisme du vivant » aux antipodes de la culture de la rapine, du gaspillage et du vandalisme de la modernité capitaliste.
Comment passer de l’expérience de vie de cette petite communauté seneca (300 âmes) à une transformation de toute la société ? Marx, ou « Clever Fox », n’a pas de réponse, mais suggère que les tentatives communistes doivent se concevoir comme des éléments d’une stratégie d’ensemble, qui combine l’expérimentation locale et la révolution.
Lire aussi sur Terrestres : Michael Löwy, « Marx, prophète de la décroissance ? », décembre 2024.
« On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir »
Le passage qui suit est un extrait de « Marx en Amérique » (pp. 355-357). L’ouvrage se termine par un cahier imaginaire de Marx intitulé « Notes sur la démocratie communiste des Iroquois ». Dans ces pages, Marx reconnaît s’être trompé dans sa philosophie de l’histoire, linéaire et téléologique, et esquisse une auto-critique de ses propres thèses à la lumière des travaux de l’anthropologue américain Lewis Morgan qu’il avait lu attentivement.
L’erreur partait d’une idée juste selon laquelle le capital dans son développement continu allait détruire toutes les bases antérieures de la société en les intégrant dans son propre mouvement, et par cette intégration, les transformer radicalement en conditions de son propre développement. Car telle est sa force, qui est de poser sans cesse les conditions de son propre élargissement en disposant de ce qui existe et en le rendant « utile ». L’ancien monde était conservé parfois, mais rarement, comme vestige inutile et plus souvent comme dimension de l’accumulation du capital mais sous une forme méconnaissable.
À cela, j’ajoutais le point décisif, qui tranchait avec toute la pensée bourgeoise du progrès, que ce mouvement même qui consiste à poser les conditions d’une accumulation toujours plus vaste n’était jamais en même temps que le mouvement de poser les conditions de sa propre fin, pas seulement par la répétition de crises toujours plus profondes mais par l’existence d’un prolétariat toujours plus nombreux et conscient qui porterait en lui, comme le capital de l’autre côté, la puissance de poser les conditions de sa victoire. Tout ceci passait par pertes et profits ce qui dans les anciennes sociétés était pourtant comme le dit Morgan le germe de la démocratie souhaitable. Mais comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur, alors que tout laisse à penser maintenant qu’il ne peut donner qu’un monde bien pire sous beaucoup d’aspects ? Il ne s’agit d’ailleurs pas ici de plus et de moins, ni de bien et de mal. Mais d’être et de non être. C’est bien ce que dit Morgan si on le lit bien. La propriété dissout la société, elle conduit au pur et simple chaos, à la destruction de ce qui fait l’humanité.
Comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur ?
Morgan remet tout en place quand il écrit que la société future naîtra d’une « reviviscence » des anciens modes de vie. C’est lumineux. Ce n’est pas la propriété qui engendre la non- propriété directement, c’est la non-propriété qui engendrera la non-propriété par un sursaut révolutionnaire de ce qui ne veut pas mourir.
L’histoire ne va pas en ligne droite, pas en zigzag non plus, elle suit un étrange mouvement, assez complexe il faut bien le dire : on doit revenir en arrière pour aller plus loin en avant. Avant-arrière, arrière-avant. C’est le « retour-avant », le « Fore-return » ou le « Vor-Rückkehr ». C’est une dialectique qui n’a rien à voir avec les jeux de mots à la Hegel, ce n’est pas de la spéculation, ce sont les processus réels. J’avais vu ça il y a longtemps lorsque j’avais écrit quelques pages sur la Révolution française, je m’étais surtout moqué de ces bourgeois qui se prenaient pour Périclès, Caton ou Cicéron. Je n’avais pas com- pris encore la nécessité et l’universalité du « retour-avant ». Les Russes me l’ont fait comprendre par leurs questionnements et leurs angoisses : « faut-il attendre le plein développe- ment du capitalisme pour espérer une révolution socialiste ? » Malheureusement en dépit de ce que j’ai un peu maladroitement essayé de leur expliquer, les meilleurs se sont ralliés à un « marxisme » amoureux du capital ! Engels me l’a confirmé.
Il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, ce qu’il y avait de mieux dans le passé.
Échec donc. Mais en y réfléchissant plus longuement, je me suis aperçu que les héros de la Commune de Paris avaient aussi suivi la dialectique du « retour-avant », en se replongeant dans les vieilles traditions de l’autonomie communale contre l’État centralisateur, ils ont réellement inventé quelque chose de nouveau. Tout colle : il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, « supérieure » dit Morgan, ce qu’il y avait de mieux dans le passé, ce qu’on veut sauver, ce qu’on veut prolonger et étendre. On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir. Avancer en régressant, marcher en reculant. Hegel avait eu l’intuition de ça sans doute, comme de bien d’autres choses, mais il n’a pas été jusqu’à faire l’analyse des « retours- avant » comme il faudrait la faire. C’est ce que font les Red Guns [les indiens], certes dans les conditions les plus défavorables : un « retour-avant », concept clé de la dialectique du temps, si j’ai le temps de la rédiger (ce qui m’étonnerait car j’ai bien d’autres choses à faire ou à ne pas faire !). […] »

Lire aussi sur Terrestres : Kai Heron, « La sortie du capitalisme en débat chez les écosocialistes », mai 2024.
Photo d’ouverture : réplique d’une maison sénéca en construction sur le site historique de l’État de Ganondagan New York, 1997. Crédits : Peter Flass, CC BY 4.0.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.
22.02.2025 à 10:50
Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants
Mireille Bruyère
Le capitalisme exploite le travail des humains... et des non-humains. Une transformation radicale du travail est donc nécessaire, soutient le philosophe Paul Guillibert, qui appelle à une alliance entre anticapitalistes, antiracistes et écologistes pour un « communisme du vivant ». Comment faire communauté autour de l’autonomie et de la subsistance dans un monde désormais majoritairement urbain ?
L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (5329 mots)
Temps de lecture : 13 minutes
À propos de l’ouvrage de Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », paru en 2023 aux Éditions Amsterdam.
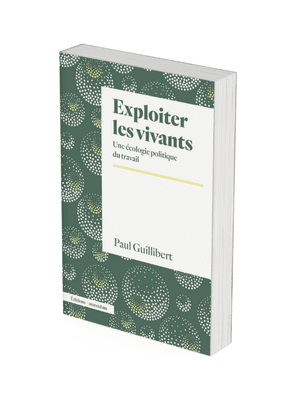
Le dernier ouvrage du philosophe Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », est présenté par l’auteur comme une suite exploratoire de son premier livre, « Terre et capital, pour un communisme du vivant » publié aux mêmes Éditions Amsterdam en 2021. Dans ce nouveau livre, Paul Guillibert se propose d’éclairer avec les moyens de la philosophie marxienne les conditions d’une alliance anticapitaliste entre la classe ouvrière et les mouvements écologistes. Il s’agit de « repolitiser le travail en écologie politique » (p. 199) – et, pourrait-on ajouter, de « repolitiser l’écologie politique par le travail ».
Construire une écologie politique du travail
En philosophe rigoureux, l’auteur ne cherche pas la construction théorique d’une nouvelle classe révolutionnaire au sens marxien du terme, dans la mesure où tous les humains et non-humains dominés par le capitalisme ne sont pas à la même place, ne tiennent pas le même rôle dans le rapport de production et de reproduction capitaliste. Tous ces différents groupes dominés ne peuvent donc pas être une « classe en soi », car ils n’ont pas les mêmes intérêts matériels et économiques. Leur alliance repose alors sur une analyse théorique fondée sur les concepts marxiens que sont l’exploitation, l’appropriation et l’aliénation, depuis les différentes positions des dominés. Le livre est une tentative de les relier dans le concept plus général d’« exploitation du vivant », qui prend le statut de mot d’ordre fédérateur et d’aiguillon d’une nouvelle alliance universelle anticapitaliste, antiraciste et écologiste.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Pour parvenir à cette proposition, l’auteur présente un arpentage de la majorité des approches de l’écologie politique et de l’anticapitalisme. Sa capacité à les exposer de manière claire, rigoureuse et synthétique est indiscutablement la grande force de ce livre, qui pourrait compter comme un ouvrage de référence destiné à celles et ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la connaissance des liens entre l’écologie politique et le marxisme. La plume de Paul Guillibert n’est jamais polémique : il discute avec honnêteté les limites de chaque proposition, non pas en elle-même mais dans sa capacité à s’articuler à d’autres propositions théoriques.
L’auteur prend comme point de départ les deux grandes impasses actuelles de l’écologie, qu’il cherche à dépasser. La première tient à l’espérance du salut dans le technosolutionnisme. La deuxième, nommée « écologie domestique » et destinée à réussir la transition écologique, en appelle presque exclusivement à l’éthique individuelle. Il présente ensuite succinctement la majorité des courants de l’écologie politique qu’il synthétise par un arbre des pensées de l’écologie humaine (p. 36). C’est en parcourant toutes les branches de cet arbre avec les outils de la critique marxiste que Paul Guillibert tente de construire une « écologie politique du travail ».
Lire aussi sur Terrestres : Frédéric Keck, « Animaux de tous les pays, unissez-vous ! », mars 2024.
L’ouvrage est divisé en trois chapitres. Le premier expose les différentes théories critiques du capitalisme susceptibles de nous éclairer sur les causes profondes de l’écocide en cours. Citant Éric William, un penseur marxiste : « Pas une seule brique de la ville de Bristol n’a été façonnée sans le sang d’un esclave » (p. 52), il part du constat que l’exploitation ouvrière dans les pays occidentaux est complémentaire de l’esclavage et du colonialisme.
Pour autant, l’auteur estime que le concept de plantationocène de Donna Haraway et Anna Tsing est bien trop englobant et homogène pour saisir toute la diversité des modes d’aliénation et d’exploitation du capitalisme. Il s’appuie sur les approches féministes et écoféministes sur le travail de reproduction pour considérer l’économie comme une activité scindée en deux sphères distinctes et inséparables, condition l’une de l’autre : celle du travail majoritairement masculin, producteur de valeur économique, et celle du travail majoritairement féminin dit de « reproduction », à l’intérieur de l’espace domestique ou bien dans des espaces domesticisés. Alors que nombre de propositions féministes interprètent la séparation entre espace productif et espace reproductif comme une technique de pouvoir, pour les écoféministes du courant de la subsistance, le travail dit de « reproduction » est un des lieux privilégiés de la résistance au capitalisme et de la construction de l’autonomie matérielle et politique, d’entretien et soin du vivant. Ce travail perd ainsi la connotation négative d’un travail seulement aliénant, dominé, et contraire à l’émancipation. L’auteur en déduit que le dépassement de la dualité entre production et reproduction ouvre des « voies normatives plus concrètes en termes de réorganisation de la vie quotidienne ».

Au terme de cette partie, Paul Guillibert présente le capitalisme comme un double processus : l’exploitation du travail salarié, et l’appropriation du travail de reproduction et des forces naturelles. Il s’agit alors de « réintégrer la critique des forces productives dans la critique du capital », au sens où l’analyse marxiste doit dépasser la seule critique de l’exploitation du travail en l’intégrant dans une approche plus large du capital. Quant au capital, il est entendu comme rapport social total incluant un rapport au travail comme exploitable et source de valeur et un rapport à la nature comme appropriable et sans valeur (p. 79).
La nature travaille-t-elle ? Redéfinir le travail
La deuxième partie du livre se penche plus précisément sur le concept de travail, central dans le champ marxiste afin de construire un pont entre critique des forces productives et critique du capital. L’auteur passe en revue de nombreuses contributions en commençant par rappeler que le concept de travail défini comme activité séparée et élargie à la production de tous les besoins sociaux est une invention de la modernité. Il propose de définir le travail moderne dans le capitalisme comme une activité pénible, technique, fondée sur la division du travail, marque de la modernité capitaliste. En effet, le travail défini comme simple activité technique et pénible existe dans d’autres sociétés que les sociétés capitalistes.
Pour Paul Guillibert, on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature. Mais on ne peut pas dire que la nature dans son ensemble travaille.
Le propre du capitalisme étant de séparer le travail du reste des activités humaines, le travail est inséparable de la division du travail. Celle-ci est une conséquence de l’appropriation privée des moyens de production. Cette définition permet à Paul Guillibert d’affirmer que les animaux de l’élevage agro-industriel travaillent, et que l’on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature (p85). Par contre, on ne peut pas aller jusqu’à dire, à l’instar de Jason Moore1, que la nature dans son ensemble travaille.
Cette clarification posée, l’auteur se met à distance de deux propositions théoriques du rapport entre humains et non-humains qu’il estime être des impasses stratégiques : d’une part l’antispécisme, qui se cantonne à une dénonciation morale et non politique, et d’autre part les philosophies du vivant, qui postulent la primauté du concept « vivant » et écrasent la dimension politique de l’écologie.
Lire aussi sur Terrestres : Paul Guillibert, « Jason W. Moore, cosmologie révolutionnaire et communisme de la vie », mai 2024.
Pour lui, la mise au travail du vivant et l’appropriation de la nature par le capitalisme procèdent d’une subsomption réelle en ce sens qu’elle change profondément la manière dont la dynamique productive du vivant et de la nature fonctionnent pour en tirer le maximum de productivité. Par exemple, la modification de la vie à l’échelle de l’ADN « marque une rupture historique dans les formes d’appropriation ». L’auteur note pertinemment que le maïs transgénique MON810 de Monsanto, qui modifie profondément les processus d’engendrement du vivant, suppose conjointement des appareillages et connaissances scientifiques poussées issues du privé, et des droits de propriété sur ce vivant nouvellement engendré. C’est par cette subsomption réelle et surtout totale de la nature que le capitalisme se définit. Ce parcours permet à Paul Guillibert de proposer une cartographie et un schéma des usages productifs de la nature (p. 130) afin d’identifier la spécificité des usages capitalistes.
Grève, communs et décroissance : les piliers du « communisme du vivant »
La troisième partie de l’ouvrage explore les pistes et les stratégies possibles d’émancipation des humains et du vivant hors des griffes du capitalisme. L’auteur propose pour cela une écologie de la classe ouvrière qui repose sur trois piliers, trois praxis : la grève, les communs et la décroissance. L’articulation de ces trois piliers constitue ce qu’il appelle le « communisme du vivant ».
Contre les écomodernistes marxistes comme le géographe étasunien Matt Huber, l’auteur estime à juste titre que la décroissance de la production et de la consommation est une dimension incontournable de l’émancipation et que le communisme ne peut être qu’un « communisme de la décroissance » (p. 154), ainsi que le formule l’économiste japonais Kohei Saito. Cette décroissance n’est pas principalement quantitative, elle est d’ordre structurel : c’est une « transformation radicale de l’organisation du travail » (p. 155).

La transition serait alors engagée moyennant le maintien de revenus de transition pour les travailleurs des secteurs en décroissance et durant le temps pendant lequel que la sphère de la subsistance et de l’autonomie se développe. Cependant, cette proposition stratégique, qui n’est pas neuve, est présentée trop rapidement. Elle reste prise dans une contradiction difficile à lever : comment faire décroître la production si on maintient des niveaux de revenus qui soutiennent la consommation ? Certes, l’auteur espère que la baisse nécessaire et drastique des hauts revenus va contribuer à la baisse de la production des biens les plus artificiels et polluants, mais nous savons que cela ne sera pas suffisant en termes de limites écologiques. En effet, la décroissance ne peut pas se limiter à un changement dans la répartition des revenus car ce sont aussi les modes de vies de la classe moyenne qui sont actuellement fondés sur des logiques productives insoutenables.
Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la production et de démanteler des infrastructures qui sont à la source de son pouvoir ?
C’est là que se trouve la principale limite de ce livre : l’auteur entend extraire des pistes stratégiques à partir de la théorie, alors même que la sortie du capitalisme nécessite une transformation radicale, voire révolutionnaire, des institutions. Or, cette transformation ne saurait être une simple technique, ni la mise en application d’une feuille de route. Elle est création du nouveau non réductible à un processus stratégique : c’est une praxis instituante. Comme le formule Cornelius Castoriadis, elle est ce « faire dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie2 ». Les mots de « fins » et de « moyens » comme moments séparés sont impropres quand il s’agit de praxis. Cette séparation entre fin et moyens appartient à l’activité technique qui vise une fin posée à l’avance, une « fin finie et définie3 ». La praxis, seule forme possible de l’activité politique, est commencement. Elle s’appuie sur un savoir fragmentaire et surtout provisoire car la praxis, pour nous – les mouvements et les luttes anticapitalistes et écologistes –, « fait surgir constamment un nouveau savoir, car elle fait parler le monde dans un langage à la fois singulier et universel4 ».
Lire aussi sur Terrestres : Geveviève Azam, « Planification écologique : frein d’urgence ou administration de la catastrophe ? », septembre 2023.
Conscient de la difficulté de proposer une alliance autour du mot d’ordre de « décroissance », Paul Guillibert propose le mot d’ordre de « communisme du vivant », plus positivement connoté. Ce « communisme du vivant » est une « cosmologie qui insère la lutte des classes dans les mondes vivants dont elle dépend, une politique de la vie ou une biopolitique par en bas contre la croissance illimitée du profit » (p. 175).
Il s’agit d’une transition « civilisationnelle et pas seulement économique ou énergétique », qui, au vu de notre héritage infrastructurel, nécessite selon l’auteur une dose de planification étatique, un « moment étatique » (p. 175).
La démarche purement philosophique de l’auteur trouve certainement ici une de ses limites. Conscient que la construction théorique du mot d’ordre de l’alliance est insuffisante en soi, il est poussé à faire des propositions stratégiques qui ne peuvent donc avoir qu’une nature technique éloignée de la praxis. Il est vrai en logique, déduite de la théorie, que la transition vers le communisme du vivant nécessite un moment de planification de taille nationale et donc étatique. Mais comment imaginer en réalité un tel moment ? Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la productivité, de la production, de démanteler des infrastructures inutiles, de permettre la réappropriation commune des moyens de production et donc finalement de baisser la masse totale des revenus alors que ces revenus et ses infrastructures sont la source de son pouvoir ? Ils lui permettent de payer ses fonctionnaires, ses policiers, ses élus, ses militaires… tous nécessaires à sa puissance et à sa raison d’être.
Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation.
Si on peut imaginer que le rapport de force au sein des institutions du capitalisme peut conduire à infléchir les politiques publiques vers plus de solidarité, de réduction des inégalités, de protection des plus faibles, en revanche cet infléchissement s’arrête au seuil de la décroissance économique, la croissance étant la source de la puissance de ces institutions.
Si la décroissance est incontournable, elle ne peut pas se penser dans un moment étatique mais plutôt dans un moment révolutionnaire, comme une fracture institutionnelle venant ouvrir des possibles, laisser se développer des fragments, des germes du communisme du vivant avec un État en recul, en décomposition, en déconcentration, en crise, un moment d’État ingouvernable plutôt qu’en planification nationale. C’est la condition pour laisser l’espace à l’inouï, à l’imprévisible qu’est la décroissance matérielle dans un monde porté depuis trois siècles par l’imaginaire de l’expansion illimitée.
Comment penser les alliances politiques entre des groupes éloignés ?
Dans sa conclusion, Paul Guillibert appelle à un rapprochement entre luttes ouvrières, luttes écologiques et luttes anticoloniales et antiracistes. Cet arpentage théorique contribue à clarifier les débats et les controverses qui traversent les mouvements de contestation. Cela permet de dépasser l’opposition superficielle entre l’exploitation ouvrière et la destruction de la nature. En ce sens, c’est un livre utile pour les luttes écologiques anticapitalistes.
Mais ce travail théorique n’est pas suffisant pour contribuer à forger les collectifs, les communautés qui défendront le « communisme du vivant ». Comme le pointe l’auteur dans sa conclusion, ce projet politique est vain sans constitution d’une nouvelle communauté politique qui le porte.
Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation. La communauté politique n’émerge pas, n’est pas la conséquence d’un effort de théorisation mais d’une praxis dont l’effort de théorisation n’est qu’une dimension, souvent limitée.
Pour reprendre la célèbre phrase de Marx, « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, il s’agit de la transformer ». Il pourrait être utile de faire un pas de plus et penser aussi les conditions d’une praxis instituante de cette communauté politique, une praxis « comme expression même de l’action émancipatrice », ainsi que le formulait Marx.

C’est au cœur d’une praxis qui articule les pratiques des militants écologiques, les luttes ouvrières et les expérimentations d’alternatives et d’autonomie de subsistance que pourra naître cette nouvelle communauté. Or, relier théorie et pratique nécessite un territoire, un sol à taille humaine, et pas seulement une carte stratégique afin que cette relation devienne une réalité sensible, incarnée, un chemin de transformation et de création qui se sédimente dans les corps par l’expérience.
C’est une autre limite de ce livre qui se propose de trouver les concepts de l’alliance. Le territoire d’une praxis ne peut pas être trop grand sans perdre la possibilité d’une action transformatrice réelle et radicale. Dans la conclusion, l’auteur déplore « l’absence de solidarité contre l’opération Wuambushu5 dans un contexte de radicalisation écologiste et de forte mobilisation sociale » (p. 196). On peut le rejoindre sur la dénonciation de cette opération abjecte et raciste, aussi nécessaire que la dénonciation des opérations de répression policière de la lutte contre l’autoroute A69 Toulouse-Castres. Cette dénonciation est nécessaire, pas seulement pour une question morale mais parce que, ainsi que Paul Guillibert le montre clairement dans son livre, ce qui se passe à Mayotte a un lien avec ce qui se passe sur le tracé de l’A69.
Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ?
Mais cette dénonciation pose question : comment, alors que les habitants concernés vivent sur deux territoires si éloignés, faire émerger une alliance et une communauté politique concrète ? Certes, les luttes lointaines sont des sources d’inspirations incontournables pour les luttes locales. Mais « inspiration » n’est pas synonyme d’« alliance stratégique concrète ». Les luttes nécessitent une socialisation politique réelle, physique, immédiate et sensible qui dépasse le moment d’inspiration et d’imaginaire. C’est la force matérielle du capitalisme que d’être capable d’aliéner à la même logique autant de groupes humains et non humains si éloignés, limitant de fait les alliances pratiques et durables et les communautés politiques de résistance.
Même au sein du territoire de la métropole déjà vaste, les alliances concrètes butent sur la distance géographique et l’inscription dans le territoire du capitalisme, modelé par la métropolisation qui sépare les groupes sociaux et les moments sociaux. Nous savons qu’il faut faire ces alliances. Mais l’obstacle n’est pas d’ordre philosophique, il est d’ordre matériel. Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ? Alors que l’urbanisation est le phénomène le plus massif du capitalisme moderne ?
Personne ne peut y répondre globalement, juste donner quelques pistes, quelques jalons théoriques possibles à la praxis des luttes et des expérimentations. Lu en ce sens modeste, le livre de Paul Guillibert est très utile.
Image d’accueil : Femmes triant et classant des pêches pour la vente au marché, Ontario, Canada, 1986. Wikimedia commons.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, traduit par Robert Ferro, Les Éditions de l’Asymétrie, 2020.
- Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975, p. 103.
- Ibid, p. 104
- Ibid.
- Opération policière et coloniale de l’État français à Mayotte en avril 2023.
L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview