13.02.2026 à 15:34
La Coupe du monde de cricket : un événement autant géopolitique que sportif
Raphaël Le Magoariec, Géopolitologue, spécialiste des sociétés de la péninsule Arabique et du sport, CITERES-EMAM, Université de Tours
Texte intégral (2413 mots)
Alors que l’Inde et le Pakistan se sont affrontés à coups de missiles en mai 2025, leurs sélections nationales de cricket vont se rencontrer ce dimanche dans le cadre de la Coupe du monde organisée par l’Inde et le Sri Lanka. Ce match très attendu a bien failli ne pas avoir lieu du fait des menaces de boycott exprimées par la partie pakistanaise. La compétition revêt également une importance majeure pour les pays du Golfe, qui accueillent d’importantes diasporas sud-asiatiques et qui cherchent à développer leur influence dans cette région.
Les Jeux olympiques d’hiver viennent de démarrer ; mais vu d’Asie du Sud, l’événement majeur de l’année se joue à des milliers de kilomètres des neiges italiennes, sur les pelouses indiennes et sri lankaises. Samedi 7 février, Jay Shah, président de l’International Cricket Council (ICC) et du Board of Control for Cricket in India (BCCI), et aussi fils du ministre indien de l’intérieur, a déclaré aux côtés de l’ancien capitaine indien Rohit Sharma, la Coupe du monde de cricket Twenty20 ouverte.
De New Delhi aux Caraïbes, loin de la vision olympique européenne, le cricket impose sa propre lecture du monde issue du Commonwealth, mêlant culture et sport dans une expression unique et éclatante.
Cette Coupe du monde, qui apparaît une nouvelle fois comme l’expression de l’hyperpuissance indienne dans le cricket, est marquée par le contexte géopolitique.
De l’annonce de la co-organisation du tournoi par l’Inde et le Sri Lanka, en 2021, à son lancement, en 2026, cet événement de premier plan révèle les ambitions de puissance des uns et des autres, qui viennent s’articuler autour de ce théâtre symbolique que constitue le stade de cricket. Pour bien comprendre cette dimension, il faut commencer par décortiquer ce qu’est ce sport, qui pour des populations n’étant pas originaires du Commonwealth apparaît étranger, et décrypter la signification de son qualificatif Twenty20.
Le b.a.-ba d’un sport mal connu hors du Commonwealth
Sport hérité de l’Empire britannique, le cricket oppose deux équipes de onze joueurs. Celle qui marque plus de points que l’adversaire remporte la rencontre. Basé sur l’affrontement entre batteurs et lanceurs, il suit des règles codifiées dès le XVIIIe siècle et valorise stratégie, patience et fair-play. Longtemps sport des élites, il trouve son expression la plus complète dans le test cricket, disputé sur quatre à cinq jours, qui récompense endurance, tactique et maîtrise du temps long. Ce format noble demeure néanmoins peu adapté aux exigences médiatiques et financières contemporaines.
Sous l’influence de la dérégulation économique et des impératifs d’audience, des formats plus courts émergent, culminant en 2003 avec l’apparition du Twenty20 (T20), où chaque équipe dispose de vingt séries de lancers, ce qui réduit la durée des matchs à environ trois heures. Plus spectaculaire et plus accessible, le T20 transforme le jeu et devient la vitrine du cricket mondialisé.
Ce support est privilégié par l’Inde afin d’accroître la massification de ce sport en vue de projeter son influence sportive et financière. La Coupe du monde T20 a ainsi été lancée par l’ICC en 2007, dans l’objectif de multiplier les compétitions et d’accroître les retombées financières. L’attribution de l’édition 2026 de cet événement bisannuel à l’Inde et au Sri Lanka, décidée en 2021, est venue appuyer cette logique. L’annonce de cette attribution a été faite à Dubaï, au siège de l’ICC, au cœur de ce hub, emblème de la dérégulation de l’économie mondiale et nouveau centre névralgique du cricket mondial depuis 2005, ce qui traduit la quête d’un profit économique sans limites.
De Londres à l’océan Indien
Cet ancrage de l’ICC dans le Golfe illustre la bascule de l’histoire du cricket au tournant des années 2000 de la métropole britannique vers ses anciennes colonies. Désormais, le centre de gravité économique de ce sport se trouve sur le pourtour de l’océan Indien, entre le sous-continent indien, la péninsule Arabique et l’Afrique australe.
Cette recomposition est portée par l’Inde qui, en raison de son poids démographique et de la puissance de son marché médiatique, génère aujourd’hui entre 70 et 80 % des revenus de l’ICC. Cette domination se traduit institutionnellement par une captation d’environ 38,5 % des revenus redistribués par l’ICC au profit du BCCI sur le cycle 2024-2027, soit plus d’un milliard de dollars. New Delhi s’impose ainsi comme l’hegemon du cricket mondial, et les diasporas issues du sous-continent indien deviennent dans les pays où elles résident (à commencer par ceux du Golfe) d’importants marchés pour les droits de diffusion et le sponsoring.
Le déménagement du siège de l’ICC de Londres à Dubaï en 2005 ne s’explique pas seulement par des considérations d’ordre fiscal ; il s’agit aussi, et surtout, de trouver un point d’ancrage dans un hub où réside la deuxième plus grande diaspora indienne. La présence de celle-ci est si manifeste qu’il n’est pas rare que Dubaï soit surnommée « Dumbaï », en référence à Mumbai (nom de Bombay depuis 1995), la plus grande ville indienne. En outre, située au cœur des réseaux mondiaux, Dubaï constitue une interface de choix avec la région de l’océan Indien.
Un trait d’union entre l’Inde et le Sri Lanka
Dans ce contexte, la co-organisation de la Coupe du monde par l’Inde et le Sri Lanka prend une signification particulière. Attribuée, en 2021, alors que le clan Rajapaksa est encore au pouvoir à Colombo, elle s’appuie sur la légitimité sportive du Sri Lanka, héritée notamment de sa victoire lors de la Coupe du monde 1996. Pensé comme un partenariat structuré autour de l’hyperpuissance du cricket, l’Inde, l’accueil conjoint de cet événement par les deux pays reflète la stratégie diplomatique du gouvernement sri lankais de l’époque, à savoir équilibrer ses relations entre l’Inde et la Chine pour maximiser sa marge de manœuvre régionale.
Après le renversement du clan Rajapaksa en 2022, et les bouleversements politiques internes qui s’en sont suivis, la coorganisation a été maintenue, l’enjeu allant bien au-delà du cas de gouvernants corrompus et destitués.
Pour Colombo, cette Coupe du monde représente une garantie de visibilité internationale, de légitimité symbolique et de reconnaissance de sa diplomatie régionale. Dans un océan Indien marqué par des rivalités croissantes, le cricket fonctionne ainsi comme un instrument d’influence non coercitif, permettant à l’Inde de projeter son leadership sous les apparences d’une coopération sportive, tandis que le Sri Lanka conserve un statut d’acteur crédible sur la scène internationale, le cricket apparaissant comme un support des relations entre élites.
Le Golfe : quasi inexistant sur le terrain, omniprésent sur les panneaux publicitaires
Dès la cérémonie d’ouverture, sur le bord du terrain, les sponsors golfiens dominent. Emirates et DP World, les deux fleurons du transport de Dubaï, ainsi qu’Aramco, le géant pétrolier saoudien, sont en haut de l’affiche. Sobha, la société du promoteur immobilier originaire du Kerala, Palath Narayanan Menon, basée à Dubaï, complète cet ensemble.
Entre gain d’influence et ambitions de puissance étatique, ces sociétés du Golfe influent sur le cricket mondial. Sobha s’affirme comme l’incarnation de l’influence des réseaux indiens aux Émirats arabes unis. À travers ces investisseurs, pour Dubaï, puis à l’arrière-plan Abu Dhabi et maintenant l’Arabie saoudite, le cricket rime avec diversification. Avec ce sport, leur tropisme penche vers l’est, il est conçu pour parler à l’Asie du Sud en vue de poursuivre l’édification de leur vision multipolaire.
Le cricket apparaît pour les monarchies du Golfe comme un vecteur d’influence au service de leur diversification économique et de la sécurisation de leur environnement régional. Il s’affirme comme un espace de convergence avec les milieux économiques et politiques du sous-continent indien dont le marché et leurs capacités militaires sont devenus indispensables. Mais sur le terrain, c’est une autre géopolitique qui se joue.
Une tension palpable, le boycott comme arme
Inde-Pakistan : le match tant attendu, prévu pour le 15 février, a bien failli ne pas se jouer. Shehbaz Sharif, le premier ministre pakistanais, avait annoncé, le 5 février, que la sélection pakistanaise ne prendrait pas part à cette rencontre historique, déclarant qu’elle ne jouerait pas contre l’Inde en signe de solidarité avec le Bangladesh après le retrait de ce dernier du tournoi.
Le boycott de la compétition par le Bangladesh avait été annoncé fin janvier 2026. Les autorités de Dacca avaient justifié cette décision par des craintes sécuritaires liées au déplacement de la sélection nationale en Inde, évoquant non seulement des risques logistiques pour les joueurs et le staff, mais aussi un climat de tensions politiques croissant, alimenté par le nationalisme hindou promu par le premier ministre Narendra Modi et des incidents récents perçus comme menaçants pour les sportifs bangladais. Islamabad a alors saisi l’occasion pour accentuer la pression sur l’ICC, cherchant à obtenir l’absence de sanctions à l’encontre du Bangladesh et une reconnaissance institutionnelle de sa position, tout en annonçant son intention de boycotter cette affiche parmi les plus emblématiques et lucratives du cricket mondial.
Pour le Pakistan, ce boycott motivé par la contestation de la puissance indienne, Islamabad ne manquant aucune occasion pour protester contre sa mainmise sur le cricket mondial, n’était que temporaire. Cette action eut néanmoins l’avantage de tendre une épée de Damoclès au-dessus de ce duel rare et de ce fait si lucratif, très recherché tant par les institutions du cricket que par les diffuseurs, pour lesquels ce match constitue un temps fort en termes d’audience et de revenus.
Face à la crise, l’ICC a engagé de longues discussions avec le Pakistan Cricket Board (PCB) et d’autres parties prenantes pour préserver l’intégrité du calendrier et maintenir ce rendez‑vous tant attendu. Au terme de ces négociations, le Pakistan a finalement renoncé à son boycott et accepté de jouer, permettant ainsi au match de se tenir comme prévu lors de cette édition 2026.
Cette opposition s’inscrit toujours dans un climat de tensions latentes, ce qui contribue à son attrait médiatique et populaire. Le terrain devient alors, pour Islamabad comme pour New Delhi, un espace central d’instrumentalisation politique et symbolique, où gouvernants, hommes d’affaires, artistes et sportifs contribuent à mettre en scène leurs aspirations nationalistes dans un contexte géopolitique chargé. Ainsi, en février 2025, alors que le Pakistan accueillait l’ICC Champions Trophy, la cérémonie de remise du trophée a été organisée pour des questions de sécurité en terrain délocalisé, à Dubaï, et aucun représentant du PCB n’était présent au pied du podium, comme il est de coutume.
Les crispations se sont accentuées à la suite de l’opération « Sindoor », à savoir une série de frappes de missiles indiens ayant eu lieu, du 7 au 10 mai 2025, contre plusieurs cibles situées au Pakistan et au Cachemire sous administration pakistanaise. Les affrontements ont encore dégradé les relations bilatérales à l’approche de la Coupe du monde. C’est dans ce climat de tensions exacerbées que la compétition s’est ouverte, la perspective de la tenue (ou non) de la rencontre au sommet Inde-Pakistan occupant une place centrale dans les esprits des observateurs et des supporters.
Après de nombreuses discussions entre l’ICC et le PCB, et au terme d’une séquence diplomatique largement médiatisée, le Pakistan, on l’a dit, a finalement infléchi sa position. Cette volte-face est intervenue après que l’ICC s’est engagée à ne pas pénaliser le Bangladesh pour son retrait et à lui accorder, à l’avenir, l’organisation d’un événement majeur.
La rencontre aura donc bien lieu. Le cricket demeure néanmoins soumis à une pression géopolitique constante, structurée par les rivalités internes à l’espace de l’océan Indien, dans lequel l’Inde exerce une hégémonie qui pourrait, durant cette Coupe du monde, être remise en cause… sur le plan sportif uniquement.
Raphaël Le Magoariec a reçu des financements d'IHEDN.
13.02.2026 à 10:09
Comment Bad Bunny a porté l’activisme sur la scène du Super Bowl
Belinda Zakrzewska, Assistant Professor of Marketing, University of Birmingham
Flavia Cardoso, Associate Professor in Business and Economics
Jannsen Santana, Assistant Professor in Marketing, TBS Education
Texte intégral (1466 mots)
Le show de mi-temps du Super Bowl signé Bad Bunny n’a pas seulement battu des records d’audience. À travers une mise en scène chargée de symboles, le rappeur portoricain a transformé un spectacle grand public en manifeste culturel, articulant mémoire coloniale, identité et activisme.
Après plusieurs jours de controverse – au cours desquels Donald Trump s’était plaint du choix des artistes, avait déclaré qu’il n’assisterait pas à l’événement, et qu’une programmation alternative « 100 % américaine » serait mise en avant –, le rappeur portoricain Bad Bunny est monté sur scène lors du très attendu spectacle de mi-temps du Super Bowl, dimanche 8 février.
Les attentes étaient élevées, comme en témoigne le nombre inédit de téléspectateurs. Le show de Bad Bunny a généré plus de 135,4 millions de vues, surpassant les 133,5 millions de Kendrick Lamar en 2025 et les 133,4 millions de Michael Jackson en 1993.
À lire aussi : Bad Bunny is the latest product of political rage — how pop culture became the front line of American politics
Les médias ont principalement présenté l’événement comme une célébration de la diversité, suscitant en retour une réaction hostile chez les partisans de Donald Trump et certains commentateurs conservateurs. Les critiques visaient Bad Bunny non seulement pour son opposition ouverte à l’administration Trump, mais aussi au motif qu’il ne serait « pas un artiste américain » (comprendre : « états-unien »), malgré le fait que Porto Rico est un territoire des États-Unis. Sa performance a montré comment l’authenticité peut se construire à travers un activisme anticolonial.
Si l’authenticité est souvent vue comme quelque chose de réel, vrai ou sincère, elle repose en réalité sur une qualité relationnelle qui peut être liée au comportement d’une personne de trois façons : par la connexion aux personnes ou aux lieux ; par la conformité aux conventions ou leur remise en cause ; et par la cohérence entre le message et les actions. Lors de la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny a incarné ces trois dimensions.
L’authenticité comme connexion
L’authenticité s’est manifestée notamment par la présence de canne à sucre sur scène, une culture qui a façonné les économies coloniales des Caraïbes. Les plantations appartenaient aux colonisateurs et reposaient sur l’exploitation violente des peuples autochtones et des Africains réduits en esclavage. En mettant la canne à sucre au centre du décor, la performance a rappelé les fondements de la richesse coloniale et a réhabilité un symbole d’oppression en tant que vérité historique plutôt que comme mémoire idéalisée.
La présence de l’icône portoricaine Ricky Martin a renforcé ce sentiment de connexion lorsqu’il a interprété Lo Que Le Pasó A Hawaii, de Bad Bunny. Par ses paroles, la chanson met en garde les Portoricains contre la perte de leur identité culturelle face aux pressions d’assimilation à l’influence états-unienne. La performance de Martin a souligné ce message, en présentant la préservation culturelle comme une forme essentielle de résistance anticoloniale.
Lady Gaga a ajouté une dimension symbolique forte. Sa robe bleu clair renvoyait à la version originale de 1895 du drapeau portoricain, avant que sa teinte ne soit assombrie pour s’aligner sur celle du drapeau des États-Unis. Elle portait un hibiscus rouge – emblème national de fierté et de résistance – ainsi que des fleurs blanches, évoquant ensemble les couleurs du drapeau. Elle incarnait ainsi le respect, la participation et la solidarité plutôt que la séparation ou l’effacement.
L’authenticité comme conformité
Les artistes naviguent souvent entre conformité et transgression, et Bad Bunny a parfaitement maîtrisé cet équilibre. En tant qu’artiste portoricain évoluant dans une industrie qui pousse souvent à abandonner ses origines, il a au contraire créé un espace culturel hybride : un spectacle de mi-temps du Super Bowl en espagnol. Il a ainsi agi au sein du système tout en remettant en cause l’idée que l’anglais doive dominer et que les figures grand public doivent correspondre à un modèle culturel étroit.
L’artiste a également bousculé le récit dominant qui réduit l’« Amérique » aux États-Unis, en reconnaissant l’ensemble du continent américain. Après avoir déclaré « God Bless America », il a énuméré tous les pays du continent, du sud au nord.
En citant les pays, Bad Bunny a inversé la hiérarchie géopolitique traditionnelle. Ce geste évoquait l’œuvre América Invertida de l’artiste uruguayen Joaquín Torres-García et son idée selon laquelle « le Sud est notre Nord », remettant en cause l’idée que la légitimité culturelle ou politique doive venir du « Nord ».
L’authenticité comme cohérence
Enfin, la cohérence s’est manifestée par des clins d’œil à l’activisme de longue date de Bad Bunny. L’explosion d’un lampadaire avant l’interprétation d’El Apagón renvoyait directement à son clip de 2022, qui prend la forme d’un documentaire dénonçant la négligence des infrastructures et la privatisation de l’électricité par des entreprises états-uniennes. Ce moment reliait le divertissement aux réalités coloniales vécues à Porto Rico.
La brève apparition d’El Sapo Concho, mascotte de son dernier album, a ajouté une autre dimension symbolique. Presque disparu en raison des perturbations écologiques liées à l’exploitation coloniale des ressources, ce crapaud portoricain est devenu un symbole de survie face aux dommages structurels. Sa présence dans le show rappelait que l’impact du colonialisme est autant environnemental que culturel.
De la même façon, lorsque Bad Bunny a remis un Grammy à une version plus jeune de lui-même, il renforce son message : « Si je suis ici, c’est parce que j’ai toujours cru en moi. » Dans un contexte où les populations issues de nations colonisées font face à la discrimination et à la marginalisation, beaucoup ont vu la culture des colonisateurs comme un moyen d’ascension sociale. Son geste a ainsi réaffirmé la confiance en soi comme un acte de résistance.
« This is America »
À la fin du spectacle, un panneau lumineux affichait « The only thing more powerful than hate is love » (La seule chose plus puissante que la haine, c’est l’amour). Bad Bunny tenait alors un ballon de football portant l’inscription : « Together, We Are America. » (Ensemble, nous sommes l’Amérique.)
Cette image proposait un idéal panaméricain fondé sur la solidarité plutôt que sur la domination. À travers des symboles de résilience collective, l’artiste présentait ainsi l’authenticité comme une forme d’activisme anticolonial ancrée dans l’amour, la mémoire et la communauté.
Ces choix visuels étaient intentionnels et s’inscrivaient dans des années de prises de position publique, de musique et d’engagement. Chaque élément renforçait un récit cohérent de résistance, démontrant que l’authenticité n’est pas seulement une performance, mais le résultat d’un activisme anticolonial constant.
En imbriquant histoire, symbolismes et convictions personnelles à chaque instant de sa performance, Bad Bunny a démontré que l’art peut devenir un vecteur d’action politique et culturelle, fondé sur l’amour, la tolérance et l’inclusion.
Flavia Cardoso a reçu des financements du gouvernement chilien (Fondecyt) et de la Fondation Luksic.
Belinda Zakrzewska et Jannsen Santana ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
12.02.2026 à 16:11
Chine-Inde : le face-à-face des géants
Emmanuel Lincot, Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (3347 mots)
Les relations entre la Chine et l’Inde s’inscrivent dans une longue histoire politique et culturelle. Bouddhisme, colonisation occidentale puis décolonisation et héritages de la guerre froide : les deux géants asiatiques partagent un immense passé commun. Dans son ouvrage Chine-Inde. La guerre des mondes, Emmanuel Lincot, sinologue, professeur à l’Institut catholique de Paris et directeur Asie de l’Iris, revient sur les rivalités et les interdépendances sino-indiennes. Extrait.
Prolégomènes
En guise de préambule général à cette étude très générale concernant les relations entre la Chine et l’Inde, il est primordial de restaurer la place occupée par l’imaginaire dans l’histoire culturelle de ces deux pays, car lui seul expliquerait la puissante attirance qui s’est exercée entre eux, à l’origine de leur porosité même. Cette attirance correspond à une épistémè. Elle s’ouvre sur près d’un millénaire, depuis l’introduction du bouddhisme en Chine sous les Han de l’Est (IIe siècle de notre ère), par l’intermédiaire tout d’abord des missionnaires et marchands kouchans, jusqu’aux invasions islamiques ghaznévides et la destruction hautement symbolique de ce lieu d’études bouddhistes que fut Nalanda dans la province du Bihar vers 1200.
Cette longue période est marquée par toute une série d’échanges, dans le domaine de la pensée et de l’esthétique notamment. C’est ce que retient l’historiographie la plus courante, sous la forme de prodigieux inventaires dont on retiendra ceux réalisés à l’initiative du gouvernement indien, fruit d’une collaboration académique sino-indienne remarquable éditée il y a dix ans, et si le bouddhisme dans ces échanges finit par être marginalisé, c’est qu’en Inde même il entrait dans une phase irréversible de déclin par rapport à l’hindouisme tandis que le néoconfucianisme en Chine, sous la dynastie Song, dans ses formes les plus réactionnaires, se muait en une politique de rejet vis-à-vis de cette religion d’origine étrangère.
En apparence tout au moins, car ce bouddhisme première manière qui avait emprunté ses thèses sur la vacuité des choses attribuées au grand penseur Nagarjuna (IIe siècle de notre ère), se voit transformé dans son contact avec la Chine par la puissance d’une toute autre tradition, l’herméneutique tibétaine. Celle-ci, jusqu’au début du XXe siècle, nourrit à la Cour sino-mandchou de Pékin tout un ordonnancement qui allie à la fois le rite au mythe. Ce dernier tient lieu d’explication, de fabulation, de facteur de mobilisation, mais aussi de mode discursif permettant d’élaborer toute une variante de représentations, politiques notamment.
Lorsque Xi Jinping convoque la mémoire bouddhiste de son pays à Xi’an (2015) ou que Narendra Modi lui rendant la pareille s’attache à commémorer la figure de Bodhidharma à Mahabalipuram (2019), chacun souligne des analogies structurelles, sans se préoccuper des différences historiques, ce qui relève bel et bien d’une préoccupation avant tout idéologique. Ce qui vaut pour les périodes anciennes vaut pour les périodes les plus récentes. Ainsi, et pour s’en tenir à un événement de la seconde moitié du XXe siècle important dans l’histoire des relations internationales, Bandung est l’un des grands mythes continuant à nourrir les imaginaires politiques à la fois indien et chinois. Cette conférence qui vit en 1955 New Dehli et Pékin défier l’Occident, au nom des intérêts du Tiers Monde, demeure l’une des grandes références idéologiques que le Sud Global a cœur encore aujourd’hui à cultiver.
C’est que ces deux États ont une histoire commune et douloureuse vis-à-vis de l’Occident. Elle est liée au déploiement des voies de communication et partant, des échanges les plus divers. Échanges suivant le cheminement des convoyages de l’opium à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans une trajectoire géographiquement parallèle à celle des imprimés, lesquels sont symptomatiques d’une accélération de l’histoire. En définitive, cette accélération de l’histoire n’est pas autre chose qu’une accélération de la médiation. Transnationale, cette histoire voit le jour avec le capitalisme international et la colonisation des espaces indien et chinois que l’Europe marchande convoite. Elle bouleverse les représentations traditionnelles chinoise et indienne du monde. Respectivement marquées par un rapport centre/périphérie que traduisent les spéculations indiennes sur le symbole du mandala ou pour la Chine par un marquage identitaire fort et que personnifie la Grande Muraille, ces représentations volent en éclat lorsqu’au XIXe siècle les Européens s’imposent avec des normes, une supériorité technique et un calendrier que ne maîtrisent ni les Indiens ni les Chinois.
Ce qui change aussi c’est une culture impériale vernaculaire que remettent en cause les Européens. C’est vrai, côté chinois, avec les Guerres de l’Opium ou du côté indien dès la prise de New Dehli (1857) et la délégitimation des dynasties régnantes (Qing et Moghole). Désormais, les décisions pour l’Inde et la Chine se prennent à Londres et à Paris. Les puissances conquérantes morcellent de leur emprise territoriale des régions entières. Encore à ce jour, l’Inde et la Chine n’ont de cesse que de vouloir les réintégrer dans leur propre espace de sécurité ou, à défaut, d’en chasser définitivement toute présence étrangère qui viendrait à s’y exercer.
La reconfiguration des espaces stratégiques n’est pas le seul héritage des transformations liées à l’entrée brutale de l’Inde et de la Chine dans l’ère moderne. L’exemple de l’islam indien, sous la colonisation britannique, et ses ramifications jusqu’en Chine à travers la présence de communautés basées à Hongkong ou celui, beaucoup plus récent, galvanisant les mouvements contestataires de la Milk Tea Alliance depuis les marges des mondes indien et chinois, sont en cela des plus probants.
Mais l’évocation de ces faits ne saurait faire oublier que cette histoire partagée se bâtit sur des omissions sélectives. Si c’est particulièrement vrai pour la Chine eu égard à l’histoire du « siècle de la honte » (bai nian guo chi), autrement dit le XIXe siècle dans son rapport conflictuel aux puissances européennes, cela l’est davantage pour l’épisode traumatisant que représentent les ratées du maoïsme, et que le régime entend faire disparaître d’un trait. Cette amnésie peut être identifiée, également en Inde, comme une source possible de pratiques discriminatoires à l’encontre du passé moghol et musulman en l’espèce ici. Dans les faits, cette discrimination commence très tôt avec une référence forte à l’hindutva. Son terreau idéologique né dans le contexte colonial britannique du début du XXe siècle sera le fil directeur, on le sait, de toute l’extrême droite hindouiste.
Atavisme géographique et héritages de la guerre froide
Cette radicalité n’est évidemment pas la seule que l’on observe. La perception de l’espace stratégique de chacun de ces pays change tout autant. Ainsi, jusqu’au XIXe siècle la menace existentielle pour l’empire chinois se situe dans les régions du Nord et de l’Ouest, régions associées dans les mémoires collectives, au danger du monde barbare. Elles redeviendront prioritaires et stratégiques à l’issue du schisme sino-soviétique, dans les années soixante, alors que Mao Zedong craignait par-dessus tout une invasion par les troupes de Moscou depuis la Mongolie et la Sibérie et ce, après un intermède d’un siècle qui avait été marqué par le dépeçage de l’empire à l’instigation des puissances européenne et japonaise, c’est-à-dire sur son flanc Est.
Comparativement, pour l’Inde et à la suite de l’effondrement de l’URSS en 1991, ce schéma s’inverse. Pour New Dehli, le danger provient en effet beaucoup moins de la mer et du littoral que du grand Nord et de ses régions limitrophes qui l’opposent à la Chine et au Pakistan. La guerre froide aura toutefois laissé de part et d’autre des préjugés et des appréhensions tenances qui échappent à ces considérations géographiques, qu’il s’agisse de la relation établie par Pékin ou New Dehli vis-à-vis de Washington et de Moscou. Pour des raisons historiques, une grande partie de l’armée indienne doute de la fiabilité américaine à son endroit.
Des incartades voire de spectaculaires revirements de la Maison Blanche, elle a été ébranlée par trois fois. La première, lorsque les Américains se sont engagés en 1954 à apporter une assistance militaire au Pakistan, qui, en contrepartie, a participé au système d’alliances occidentales (Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), puis pacte de Bagdad). La deuxième, lorsque les Américains ont soutenu les Pakistanais contre les sécessionnistes du Bangladesh en 1971 ; ces derniers bénéficiant en revanche de l’aide des Indiens et de leur partenaire soviétique. La troisième enfin, est liée à la question tibétaine. Depuis 1959, le Dalaï-lama s’est réfugié à Dharamsala dans le Nord de l’Inde et la CIA conduit des commandos tibétains depuis le territoire indien contre des intérêts chinois.
Lorsque Richard Nixon rencontre son homologue Mao Zedong en 1972, Tibétains et Indiens assistent impuissants au lâchage de ces hommes. Malgré les critiques proférées par Pékin contre Washington et Moscou, la Chine, elle, reste à la fois pragmatique et prudente vis-à-vis des États-Unis. D’une part en raison d’une antériorité de liens sino-américains profonds qui remontent à la seconde guerre mondiale alors que Washington soutenait les Chinois dans leur effort de guerre contre les Japonais avec l’envoi notamment des premières escadrilles de volontaires américains commandés par le Général Chenault, les Flying Tigers.
À ce précédent s’ajoute la collaboration discrète dans les années quatre-vingt entre la CIA et les services chinois afin de renseigner les Moudjahidines afghans en lutte contre les Soviétiques. L’idylle sino-américaine est ternie par les massacres des étudiants à Tiananmen en 1989. Washington impose un embargo sur la vente d’armes à Pékin. Il est encore en vigueur aujourd’hui. Dans le même temps, Washington semble donner des signes d’encouragement en faveur de la démocratisation de Taïwan, île avec laquelle les Américains ont signé le très important Taïwan Relations Act. Avec Moscou, l’Inde entretient des relations privilégiées dès son indépendance et la relation militaire au sein de leur partenariat stratégique occupe une place de premier rang.
Depuis l’instauration du régime en 1949, l’État-Parti chinois s’est quant à lui à la fois inspiré de l’URSS défunte ou s’y est référée comme repoussoir. Ainsi, se confondant avec les structures de l’État, le Parti fonctionne sur un mode stalinien. Dans ses choix de développement, y compris dans la volonté de se doter de l’arme nucléaire à partir de 1964, Moscou est le modèle vers lequel les premières générations de communistes et stratèges chinois se tournent. Quitte à devoir renoncer, comme dut s’y plier Mao Zedong, à l’usage de la guérilla au profit d’une modernisation de l’Armée Populaire de Libération et ce, en suivant des modalités plus conventionnelles, c’est-à-dire en optant pour un programme de nucléarisation qu’appelait de ses vœux le Maréchal Peng Dehuai.
Notons que cet usage de la guérilla d’inspiration chinoise a fait bien des émules en Inde même avec le développement d’une mouvance, les Naxalites. Dès les années soixante, elle a recours à une lutte armée de nature asymétrique, et revendique pleinement sa filiation idéologique avec le maoïsme chinois en vue d’instaurer une démocratie directe et défendre les intérêts des paysans. Si cette mouvance s’essouffle aujourd’hui, elle ne constitue pas moins, dans ses modalités profondes, une opposition structurée au modèle de la démocratie représentative et le modèle d’une utopie rurale vivace quoi que malmenée par les bouleversements en Inde liés au développement du capitalisme, la privatisation de l’économie à partir des années quatre-vingt dix et l’explosion des cultures urbaines.
Sur le plan international, que ce soit en Inde ou en Chine, la chute du Mur de Berlin en 1989 puis la chute, trois ans plus tard, de l’URSS est de toutes les mémoires. C’est sur ses cendres (dont la décomposition est à l’origine de l’indépendance de quinze États) qu’Evguenij Primakov, alors ministre des Affaires étrangères de la toute jeune fédération de Russie, devient l’ardent avocat de la multipolarité, en tant qu’alternative à l’hégémonie mondiale exercée par les États-Unis. Ce choix demeure une constante pour Moscou. Cette volonté russe s’est parfois plus clairement exprimée sur la nécessité de constituer un axe « Moscou-Pékin-Delhi ». Véritable serpent de mer, cette idée de « trilatéralisme » n’a pas toujours fait l’unanimité. Ainsi, Pékin a longtemps fait prévaloir le principe de « coexistence pacifique » (heping gongchu, une expression empruntée par Mao Zedong aux Soviétiques) avant d’employer, beaucoup plus tard, celle d’« ascension pacifique » (heping jueqi) sous la présidence (2003-2013) de Hu Jintao, comme doctrine caractérisant ses choix de politique étrangère.
Quelles perspectives ?
Alors que la Chine et l’Inde s’apprêtent en cette fin de XXe siècle à souscrire aux règles de la mondialisation, et à poursuivre le développement de voies alternatives à l’Occident, chacune cherche à consolider sa présence sur ses marges. La Look East Policy pour l’Inde et la volonté pour la Chine de sanctuariser ses intérêts dans le Sud de la mer de Chine en sont la parfaite illustration. Bien que la Russie fasse figure de matrice référentielle à ces velléités de coopération trilatérale, la rivalité systémique qui oppose pour l’heure la Chine à l’Inde augure mal d’une structure pérenne commune aux trois États.
Toutefois, chacun de leurs dirigeants se projette déjà dans une ère post-américaine pour définir leur rôle dans les relations internationales. On en veut pour preuve leur rencontre fortement médiatisée lors du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Tianjin en août 2025. Cette projection leur sera d’autant plus aisée que les axes de leur politique étrangère, sur bien des aspects convergent, et sont même parfois très proches.
Si leur attachement à la défense de leurs intérêts et à leur souveraineté est un premier point commun, leur souhait d’accompagner la mondialisation pour gagner en influence sur la scène internationale en est un autre. Cette idée d’une trilitéralité entre les trois États sera encouragée par Vladimir Poutine et trouvera des échos favorables auprès de Pékin. Tandis que la Chine y verra le moyen de contrer l’unipolarité américaine qu’elle commencera ouvertement à contester, l’Inde se verra chaque année davantage acculée à des choix cornéliens dans le choix de ses priorités de partenariat tout en gardant un avantage, celui d’être ramenée au centre de toutes les attentions. La signature des accords de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne en janvier 2026 confirme cette observation et montre le souhait de l’Inde à privilégier un nouvel équilibre avec ses partenaires européens.
Et pour cause, les faits sont têtus : partageant avec la Chine 3800 kilomètres de frontière commune avec la Chine, New Dehli et Pékin n’ont toujours pas su apaiser leurs litiges frontaliers. Ils s’ajoutent à ceux qui opposent au Cachemire l’Inde au Pakistan, de nouveau entrés en guerre pour une brève période en avril 2025. Pour Pékin, ce foyer de crise constitue avec son prolongement himalayen, « une nouvelle frontière ». Alors que la Chine a réglé la plupart de ses contentieux frontaliers, l’Himalaya est la dernière région de sa périphérie où ses frontières ne sont pas stabilisées. Cette instabilité est liée à une problématique plus profonde, celle que pose l’intégration de deux régions situées sur ses confins. Elles se heurtent aux paradigmes historiques et culturels proprement chinois. Ce sont les provinces du Tibet et du Xinjiang. Elles comptent encore aujourd’hui parmi les régions les plus déshéritées du pays.
Rappelons que chacune est d’autant plus importante, qu’elle ouvre respectivement vers le subcontinent indien et l’Asie centrale. Se comprend d’autant mieux le fait que les questions ouïgoure et tibétaine soient moins traitées par les analystes indiens sous l’angle des droits de l’Homme, comme le font leurs homologues occidentaux, que sécuritaires. Le seul Tibet représente 13 % du territoire chinois. La province est en contact avec l’Inde, le Bhoutan, le Népal, le Myanmar et le Pakistan, sa position en surplomb, ses ressources minières et en eau offrent à Pékin un ascendant considérable par rapport à New Dehli. Le développement du grand Ouest programmé dès la fin des années quatre-vingt-dix par le gouvernement central confère au Tibet une place particulière en tant que province frontalière mais aussi dans les moyens alloués en vue de son essor sur le plan économique. C’est cette région du monde qui verra sans doute de prochaines déflagrations.
Emmanuel Lincot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.02.2026 à 16:10
Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever
Serge Rabier, Chargé de recherche Population et Genre, Agence Française de Développement (AFD)
Texte intégral (2506 mots)
L’Afrique de l’Ouest fait face à une expansion démographique accélérée : près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Les défis – insertion sur le marché du travail, transformations urbaines et, à plus long terme, accroissement sensible du nombre des personnes âgées – que pose ce phénomène sont nombreux. S’ils sont relevés, la jeunesse pourra être un véritable moteur pour le développement de la région.
D’ici à 2050, le continent africain devrait compter plus de 2,4 milliards d’habitants, soit presque un milliard de plus qu’aujourd’hui. Cette dynamique est marquée en Afrique subsaharienne et tout particulièrement en Afrique de l’Ouest et centrale (AOC), dont environ 33 % de la population se situe dans la tranche d’âge 10-24 ans en 2025.
L’expansion démographique s’accompagne de transformations économiques, sociales et territoriales majeures : urbanisation rapide et non planifiée, migrations accrues, profondes inégalités de revenus ou d’accès aux services essentiels comme la santé ou l’éducation… Cette expansion peut représenter, pour l’Afrique de l’Ouest, non pas un handicap mais, au contraire, une opportunité de développement à saisir. Mais pour cela, quatre défis devront être relevés.
Défi nunéro 1 : accompagner la transition démographique
Si la mortalité infantile a diminué, la fécondité reste élevée. Les normes sociales pèsent lourdement et les bilans des politiques de planification familiale sont mitigés.
Le mariage demeure une norme sociale centrale, avec un âge moyen au mariage compris entre 18 et 21 ans. Au Mali, 53 % des femmes sont mariées avant 18 ans. Au Niger et au Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes filles sont concernées par les mariages précoces. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique australe, où l’âge moyen au mariage est d’environ 31 ans. En Afrique de l’Ouest, les normes encadrant le mariage et la stigmatisation des grossesses hors mariage freinent l’autonomie des filles et leur maintien dans le système éducatif. L’assignation pour les femmes mariées à avoir un nombre d’enfants élevé et de prendre en charge les besoins domestique du ménage reste encore largement prédominante. Un grand nombre de jeunes filles quittent le système éducatif dès le secondaire et ne terminent pas le cycle allant jusqu’au baccaluréat.
Les interventions en planification familiale mises en place par les États visent à étendre la couverture contraceptive et à changer les normes reproductives. Mais la baisse de la fécondité reste lente. Les normes culturelles et sociales ainsi que les contraintes financières et logistiques limitent la demande et l’accès à la contraception. Selon l’institut Guttmacher, 23 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en Afrique subsaharienne présentent un besoin non satisfait de contraception. Du côté de l’offre, les systèmes publics de santé, souvent sous-financés et peu développés, accordent une place limitée à la distribution de contraceptifs modernes.
Des différences existent cependant entre milieu urbain et milieu rural. Les femmes urbaines – notamment dans les grandes agglomérations – et disposant d’un niveau d’instruction plus élevé présentent généralement des taux de fécondité plus faibles. Entre 2010 et 2019, les femmes ont eu en moyenne 2,7 enfants à Dakar et 3,4 à Abidjan, contre 5,9 en milieu rural au Sénégal comme en Côte d’Ivoire.
L’éducation des filles apparaît comme un autre levier majeur de réduction de la fécondité. Déjà en 2013, l’Unesco soulignait qu’en Afrique de l’Ouest, les femmes pas ou peu éduquées avaient en moyenne 6,7 enfants. Celles ayant achevé le cycle primaire en avaient environ 5,8 et celles ayant suivi des études secondaires 3,9. Une année supplémentaire dans le cycle secondaire pouvait représenter 2 à 3 enfants de moins par femme. Mais le système éducatif connaît de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de l’offre ou sur celui de la demande en Afrique de l’Ouest :
Sur le plan de l’offre, les systèmes éducatifs souffrent d’infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, de programmes mal alignés avec les réalités économiques locales et d’une pénurie criante d’enseignants qualifiés. Les conflits, les crises sociales et l’instabilité politique perturbent aussi les calendriers scolaires et limitent l’accès à l’éducation dans certaines régions.
Du côté de la demande, l’accès à l’éducation est fortement limité par la pauvreté et les coûts directs et indirects de la scolarisation. De nombreux ménages privilégient des stratégies de survie à court terme, comme le travail des enfants, au détriment de l’investissement éducatif. Ces contraintes, combinées aux normes sociales défavorables, aux conflits et à l’insécurité, expliquent les forts taux d’abandon scolaire, en particulier en milieu rural et chez les filles.
À lire aussi : Au Bénin, ces enfants qui quittent l’école pour apprendre un métier
Défi numéro 2 : favoriser l’insertion professionnelle de la jeunesse
La jeunesse africaine, toujours plus nombreuse, est confrontée aux défis du développement. Les jeunes entrants (15-24 ans) sur le marché du travail entre 2025 et 2040 seront par exemple de 93 millions pour le Nigeria et de 13 millions pour la Côte d’Ivoire. La part de la population en âge de travailler augmente progressivement, ce qui exacerbe le besoin de création d’emplois décents.
Les marchés du travail peinent à absorber cette nouvelle main-d’œuvre : derrière le taux de chômage officiel des jeunes, qui est de 8,7 % (2019), se cache un sous-emploi estimé à 35 %. L’économie reste dominée par l’informalité économique, souvent synonyme de précarité et de salaires insuffisants pour sortir de la pauvreté.
Le secteur formel stagne face à un climat des affaires défavorable et une absence de diversification industrielle.
Trois types d’interventions stratégiques pourraient dynamiser l’insertion économique des jeunes en Afrique de l’Ouest face à l’urgence démographique régionale : la formation technique et l’apprentissage, de façon à renforcer les compétences locales pour anticiper les emplois du futur tout en « collant » aux exigences du marché du travail ; la modernisation agricole, pour transformer le secteur rural en un moteur d’emploi stable grâce à des modèles combinés de l’agro-écologie et de l’agro-industrie, encore très polarisées ; enfin, la révolution numérique et le soutien aux start-up pour favoriser l’innovation technologique chez les nouveaux diplômés.
Défi numéro 3 : gérer l’urbanisation et les migrations
L’expansion démographique s’accompagne d’une urbanisation rapide et de mobilités accrues au sein de la sous-région. Entre 2020 et 2050, la population urbaine devrait passer de 54 à 130 millions d’habitants (+140 %) tandis que le nombre d’agglomérations – une agglomération étant entendue comme une zone où la population est de 10 000 habitants ou plus, et où les bâtiments sont espacés de moins de 200 mètres les uns des autres – augmentera de 900 à 1 700.
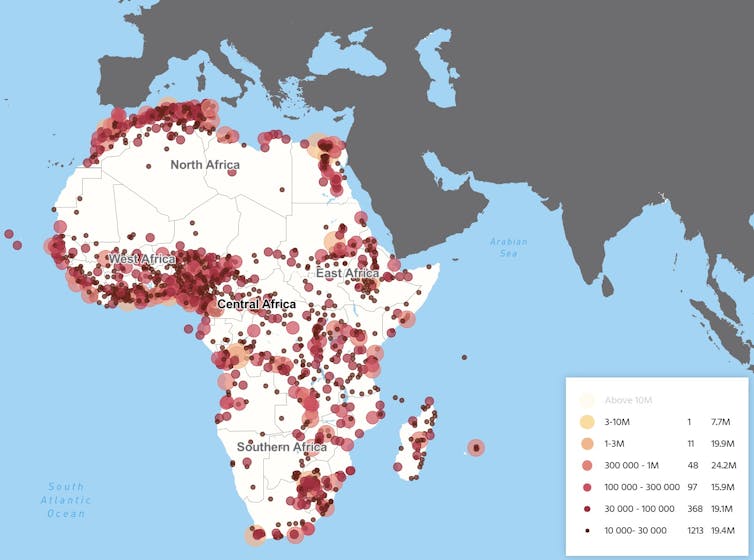
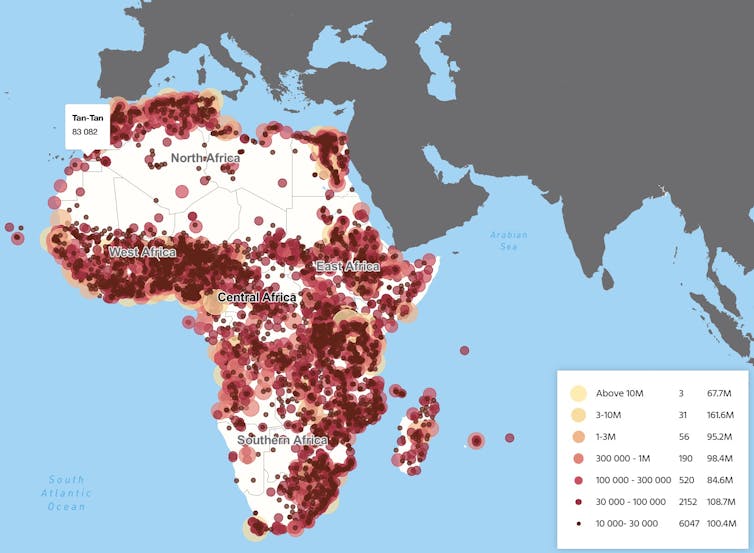
Cette expansion urbaine rapide fait du foncier un enjeu central, tant pour le logement que pour les infrastructures (transports, assainissement), les services publics et la gestion des déchets. L’enjeu majeur réside moins dans le nombre d’habitants que dans leur localisation et le caractère souvent informel de leurs activités. La gestion des villes, en pleine expansion, supposera un encadrement plus strict du foncier et une planification de long terme des investissements publics.
Par ailleurs, les mobilités sous-régionales sont importantes : si 19 millions d’Africains vivent hors du continent, plus de 21 millions résidaient en 2024 dans un autre pays africain. En Afrique de l’Ouest, deux pays concentraient à eux seuls 51 % des migrants internationaux en 2020 : la Côte d’Ivoire (34 %) et le Nigeria (17 %). Et si la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) demeure un espace majeur de mobilités économiques et de travail, les dynamiques migratoires sont de plus en plus façonnées par les enjeux sécuritaires et climatiques. Selon la Banque mondiale, plus de 32 millions de personnes pourraient être déplacées à l’intérieur de leurs pays d’ici 2050 en Afrique de l’Ouest, du fait de la pénurie d’eau, du recul de la productivité agricole et de l’élévation du niveau de la mer.
Ces facteurs s’ajoutent aux conflits armés, aux crises sécuritaires et aux violences politiques.
Défi numéro 4 : anticiper le vieillissement encore marginal, mais qui pourrait s’intensifier
Si l’Afrique de l’Ouest reste jeune, elle devra affronter le vieillissement de sa population. D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter environ 8 % de la population.
Le principal défi reste l’extension de la couverture sociale. Aujourd’hui, elle est la plus faible au monde, 20 % de la population étant couverte. Cette situation s’explique par le poids de l’économie informelle, surtout en milieu rural, qui limite les systèmes contributifs.
L’évolution des systèmes de protection sociale, santé et retraite dépend du recouvrement fiscal et du développement du salariat formel, encore absent en Afrique, et freinant la soutenabilité future des politiques publiques.
La vitalité démographique exceptionnelle de l’Afrique de l’Ouest pourrait devenir une force motrice du développement. Mais la difficile émergence de politiques publiques (santé, éducation, genre, climat) fragilise son potentiel et alimente les tensions. Sans la mise en œuvre ou le renforcement de ces politiques publiques, l’Afrique de l’Ouest pourra-t-elle parvenir à tirer pleinement parti de sa croissance démographique ?
Serge Rabier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.02.2026 à 16:21
Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne
Alexandra Colombier, Spécialiste des médias en Thaïlande, Université Le Havre Normandie
Texte intégral (2868 mots)
**Les élections législatives et le référendum constitutionnel organisés le 8 février 2026 en Thaïlande ont conduit à une recomposition du paysage parlementaire. Le parti Bhumjaithai, avec Anutin Charnvirakul, le premier ministre sortant candidat à sa propre succession, s’impose comme la première force politique, devant le Parti du peuple, héritier du parti progressiste Move Forward, et Pheu Thai, formation issue du clan de l’ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Si le référendum, qui s’est tenu le même jour, a validé le principe d’une réforme constitutionnelle, sa mise en œuvre s’inscrit dans un cadre institutionnel fortement contraint par les rapports de force parlementaires et sénatoriaux.
¨¨
Le 8 février 2026, les électeurs thaïlandais ont été appelés aux urnes pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des représentants et se prononcer simultanément sur un référendum constitutionnel. Le Parti de la fierté thaïe (Bhumjaithai) est arrivé en tête avec 193 sièges, devant le Parti du peuple (Phak Prachachon, 118 sièges) et Pour les Thaïs (Pheu Thai, 74 sièges).
Ces élections, qui se sont déroulées dans un contexte économique fragile et marqué par de fortes incertitudes régionales, notamment le conflit frontalier avec le Cambodge, confirment une recomposition du paysage politique thaïlandais et marquent un tournant symbolique. Anutin Charnvirakul, qui occupait le poste de premier ministre depuis seulement cinq mois au moment du scrutin, a su transformer une position gouvernementale fragile en victoire électorale décisive pour son parti.
Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la stabilité et l’ordre se sont imposés comme valeurs centrales du débat électoral, dans un contexte où le nationalisme et la promesse de continuité institutionnelle ont primé sur les revendications réformistes.
Bhumjaithai, d’un parti à ancrage territorial à un pivot conservateur du système
La victoire de Bhumjaithai, qui n’avait obtenu que 71 sièges aux précédentes législatives, tenues en 2023, confirme la trajectoire d’un parti longtemps perçu comme périphérique. Fondé en 2008 par Newin Chidchob après sa rupture avec Thaksin Shinawatra, le parti s’est construit comme une organisation de pouvoir local fondée sur le patronage et les dynasties politiques, solidement ancrée à Buriram, dans l’Isan (Nord-Est du pays). Depuis ses bastions initiaux, Bhumjaithai a progressivement étendu son influence à l’ensemble de la région.
Le contrôle de ministères clés, notamment la santé publique, les transports puis l’intérieur, lui a permis de tisser des réseaux durables avec les administrations locales et les exécutifs provinciaux. Cette stratégie a été renforcée par une participation active aux élections des Provincial Administrative Organizations (PAO), organes décentralisés élus au niveau provincial qui gèrent le développement local, les infrastructures et les services publics, et constituent des relais essentiels du pouvoir dans les provinces. Elle explique la capacité du parti à transformer un soutien électoral diffus en victoires décisives.
Cette dynamique a culminé en septembre 2025 avec l’accession de Bhumjaithai au cœur du pouvoir parlementaire après la destitution par la Cour constitutionnelle de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, et son remplacement par Anutin Charnvirakul.
Bhumjaithai s’est imposé comme l’acteur central de la recomposition conservatrice. L’effondrement progressif des partis pro-militaires issus du coup d’État de 2014 – qui avait renversé le gouvernement de Yingluck Shinawatra et instauré une junte dirigée par Prayut Chan-o-cha –, notamment le Palang Pracharath et le Ruam Thai Sang Chart, affaiblis par leurs divisions internes et leur perte de soutien populaire, a laissé un vide que le parti a su occuper. La domination de ses réseaux lors de l’élection sénatoriale de 2024 a débouché sur un Sénat largement aligné sur ses intérêts. Dans un système où la Chambre haute conserve un pouvoir décisif, toute stabilité gouvernementale passe désormais par Bhumjaithai.
Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un travail ciblé en direction des classes moyennes et supérieures. Bhumjaithai a opéré ce repositionnement en s’entourant de figures technocratiques issues des élites administratives et économiques – Ekniti Nitithanprapas aux finances, Suphajee Suthumpun au commerce et Sihasak Phuangketkeow aux affaires étrangères –, ce qui a permis au parti de projeter une image de compétence économique et de crédibilité internationale. Cette configuration, explicitement assumée durant la campagne, a contribué à rendre Bhumjaithai politiquement acceptable pour un électorat jusque-là réticent.
La campagne électorale a combiné deux registres complémentaires. Sur le plan économique, le parti a promis le redressement de la croissance, la restauration de la confiance des investisseurs et une gestion budgétaire rigoureuse. Sur le plan sécuritaire, les tensions frontalières avec le Cambodge ont été instrumentalisées pour hiérarchiser les priorités autour de l’ordre et de la souveraineté nationale. Anutin a donné carte blanche à l’armée lors des affrontements de juillet et décembre 2025, présentant le conflit comme une « guerre contre l’armée des arnaques », visant les casinos cambodgiens utilisés pour la cybercriminalité.
Parallèlement, le parti a mobilisé le registre de la peur : instabilité politique chronique, risque d’ingérence étrangère (illustré par le scandale de l’appel entre Paetongtarn Shinawatra et Hun Sen), et menace supposée de bouleversement radical incarnée par le Parti du peuple. Le vote en faveur de Bhumjaithai s’est ainsi structuré autour d’une promesse de stabilité, de compétence technocratique et de fermeté face aux menaces extérieures.
Le Parti du peuple : le choix du pragmatisme
Le Parti du peuple arrive en deuxième position avec 118 sièges, ce qui constitue un recul par rapport aux 151 sièges gagnés en 2023 par Move Forward, auquel il a succédé après que celui-ci a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2024. Ce résultat reflète une transformation de cette formation : née des mobilisations de rue et ancrée dans les mouvements sociaux, elle s’est progressivement tournée vers une approche plus pragmatique, au risque de perdre une partie de sa base militante.
En 2023, Move Forward promettait une transformation structurelle : réforme de l’article 112 du code pénal (qui punit de trois à quinze ans de prison toute critique, insulte ou menace envers le roi, la reine, l’héritier du trône ou le régent), démantèlement des monopoles, abolition de la conscription militaire. Trois ans plus tard, le Parti du peuple a opéré un virage stratégique. En septembre 2025, sa décision de soutenir Anutin Charnvirakul a déçu nombre de ses partisans.
Thanathorn Juangroongruangkit, cofondateur de Future Forward (dissous en 2020, dont Move Forward était l’héritier direct) devenu conseiller du parti, avait justifié ce choix par la nécessité de se montrer pragmatique. En échange, sa formation avait négocié un calendrier pour un référendum constitutionnel et une dissolution du Parlement dans les quatre mois.
Les dissolutions répétées ont affaibli les structures participatives. Le Parti du peuple s’est appuyé sur les réseaux sociaux et sur un leadership centralisé. Sur les listes de 2026, technocrates et entrepreneurs ont remplacé les militants. Le parti avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Natthaphong Ruengpanyawut, leader du parti, Sirikanya Tansakun, économiste et dirigeante adjointe du parti, et Veerayooth Kanchoochat, économiste. Aucun n’a réussi à recréer l’engouement de la campagne de 2023. Même le retour lors de la dernière semaine de Pita Limjaroenrat, ancien leader de Move Forward lors des élections de 2023, n’a pas suffisamment galvanisé l’électorat.
C’est Ruckchanok Srinok, 31 ans, qui a incarné l’énergie de la campagne. Candidate sur la liste proportionnelle nationale (100 sièges répartis entre les partis en fonction de leur score national, contrairement aux 400 sièges de circonscription attribués au candidat arrivé en tête localement), elle a exposé la corruption systémique, notamment les détournements de fonds au sein du Bureau en charge de la sécurité sociale, qui ont affecté 24,5 millions de personnes. Son comportement tranche avec les conventions politiques thaïlandaises : elle se déplace simplement à vélo, ne porte pas de vêtements de créateurs, ne provient pas d’une famille célèbre et n’a pas hérité d’une quelque fortune. Mais sa condamnation à six ans de prison pour lèse-majesté (elle est en liberté sous caution) incarne le dilemme du parti : comment réformer un système qui criminalise la réforme ?
Le résultat du 8 février 2026 est donc en deçà des espérances. Le Parti du peuple fait face à une question cruciale : né de la défiance contre l’establishment conservateur, peut-il s’appuyer sur le pragmatisme sans perdre son identité ?
Pheu Thai, l’échec d’une reconquête territoriale
Pheu Thai, parti populiste à l’identité idéologique aujourd’hui brouillée par ses alliances avec les conservateurs, arrive en troisième position avec 74 sièges, un recul très marqué par rapport aux 141 obtenus en 2023. Pour un parti qui se présentait encore récemment comme une force dominante, ce résultat constitue une défaite électorale nette. Il met en lumière l’échec de la stratégie de reconquête de ses bastions historiques dans le Nord du pays.
Le parti a mobilisé ses ressources habituelles, en s’appuyant sur des candidats sortants, des héritiers de dynasties politiques locales et des figures issues de ses réseaux traditionnels. Pheu Thai avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Yodchanan Wongsawat, neveu de Thaksin Shinawatra (premier ministre de 2001 à 2006, renversé par coup d’État, exilé pendant quinze ans, rentré en 2023 et actuellement incarcéré pour corruption), Julapun Amornvivat, le chef du parti, et Suriya Juangroongruangkit, ancien ministre des transports. Le parti a également cherché à élargir son audience par des politiques populistes, dont un projet de loterie quotidienne de 9 millions de bahts (près de 250 000 euros) adossée à un dispositif fiscal numérique. Cette mesure a suscité de nombreuses critiques et n’a pas produit les effets escomptés.
De plus, la campagne s’est déroulée dans un contexte politique fortement dégradé pour Pheu Thai. La divulgation d’une conversation téléphonique où Paetongtarn Shinawatra adoptait un ton informel et conciliant à l’égard de Hun Sen, ancien premier ministre cambodgien, aujourd’hui sénateur et père de l’actuel premier ministre Hun Manet, avait provoqué la chute du gouvernement en août 2025 et sérieusement ébranlé la crédibilité du parti. Tout au long de la campagne, cet épisode a été abondamment exploité par les adversaires de Pheu Thai. Cette fragilisation s’est trouvée accentuée par l’incarcération de Thaksin Shinawatra depuis le 9 septembre 2025, ce qui a privé le parti de sa figure tutélaire.
Le Parti démocrate survit et Kla Tham entre au Parlement
Au-delà des trois partis arrivés en tête, le scrutin de février 2026 a révélé deux évolutions importantes : le Parti démocrate a enregistré des résultats contrastés mais notables et Kla Tham a réalisé une percée lors de sa première participation électorale nationale d’ampleur.
Après plusieurs cycles de recul électoral, le Parti démocrate a opéré un repositionnement sous la direction d’Abhisit Vejjajiva. L’ancien premier ministre (2008-2011) avait quitté la direction du parti en 2019, à la suite d’une lourde défaite électorale et de divisions internes persistantes. Pour ces élections, il s’est entouré de figures technocratiques telles que Korn Chatikavanij, ancien ministre des finances, et Karndee Leopairote, spécialiste des politiques économiques. Leur stratégie s’est fondée sur la rigueur institutionnelle, la discipline budgétaire et la lutte contre la corruption.
En apparence, le résultat du Parti démocrate peut sembler décevant. Le parti a perdu des sièges par rapport à 2023. Avec seulement huit députés sortants au moment de la dissolution, il faisait face à un défi majeur pour remporter des sièges en circonscription. Mais ce résultat global masque une dynamique importante. Sur les listes proportionnelles, le parti a obtenu environ 3,6 millions de voix, un score très proche de sa performance de 2019. En quelques mois seulement après son retour à la tête du parti, Abhisit Vejjajiva est parvenu à reconquérir une part importante de l’électorat démocrate. Pour un parti en difficulté depuis plusieurs années, ce résultat constitue une forme de stabilisation.
Kla Tham a effectué une entrée marquante au Parlement avec 58 sièges de circonscription. Le parti n’a obtenu que deux sièges proportionnels. Thammanat Prompao dirige cette formation. Cette figure controversée possède un passé judiciaire chargé. Il a joué un rôle central dans les négociations de coalition sous Prayut Chan-o-cha. Le parti s’est structuré comme un véhicule électoral. Plus de la moitié de ses candidats avaient concouru sous d’autres étiquettes lors de scrutins précédents.
Sa campagne s’est appuyée sur l’implantation territoriale de ses candidats et sur une stratégie de continuité, faisant de la politique locale la racine d’une politique plus large. Les propositions programmatiques ont joué un rôle secondaire, l’accent étant mis sur le travail de terrain et l’ancrage dans les réseaux locaux. L’entrée de Kla Tham au Parlement s’opère dans un contexte de soupçons persistants liés aux financements politiques et aux liens de certains cadres avec des intérêts économiques controversés. Le soir du scrutin, Thammanat a souligné la position charnière de sa formation dans les négociations à venir.
Le référendum constitutionnel et ses contraintes politiques
Organisé simultanément aux élections législatives, le référendum constitutionnel portait sur l’ouverture d’un processus de réécriture de la Constitution de 2017. 58,3 % des votants se sont prononcés en faveur de ce processus, contre 30,8 % d’opposition et 8,3 % de votes blancs. Ce vote exprime une attente de réforme constitutionnelle, sans pour autant constituer un mandat précis sur la nature ou l’ampleur des changements à venir.
Le cadre institutionnel demeure particulièrement contraignant. La procédure implique plusieurs étapes successives, combinant un vote parlementaire à majorité qualifiée, la désignation d’un comité de rédaction, puis l’organisation de nouveaux référendums. Dans ce processus, le Sénat conserve un rôle central.
Le rapport de forces issu des élections législatives pèse directement sur l’interprétation politique du référendum. La victoire de Bhumjaithai et sa position dominante au Parlement et au Sénat orientent le processus vers une gestion étroitement encadrée de la réforme constitutionnelle. Les positions défendues par Bhumjaithai et par Kla Tham, favorables au maintien des principaux mécanismes institutionnels, suggèrent que les dispositifs centraux du système apparaissent peu susceptibles d’être substantiellement remis en cause.
Alors que la bataille des coalitions s’ouvre, le référendum de 2026 engage une séquence institutionnelle sans en déterminer l’issue. Il met en évidence un décalage entre une demande de réforme et les équilibres conservateurs qui dominent le système politique.
Alexandra Colombier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.02.2026 à 16:19
Catatumbo’s ‘Care-Land’: how local initiatives sustain humanitarian relief amid escalating violence in Colombia’s borderland with Venezuela
Silke Oldenburg, Senior Researcher in Anthropology, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Anna Leander, Professor, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Nora Doukkali, Doctoral Researcher in International Relations and Political Sciences
Texte intégral (1461 mots)
Drones hover low over coca fields in Catatumbo, a remote region in northeastern Colombia along the border with Venezuela, tracing invisible lines of control across the land. They are joined by rumours circulating on social media, naming alleged collaborators, announcing new allegiances, warning of imminent violence. Together, drones and rumours kill arbitrarily: they determine who can move, who must flee, and who disappears. This is the texture of war in Catatumbo today.
The fragile border region has experienced a sharp escalation of armed conflict since early 2025, as multiple illegal armed groups, including the ELN, dissident factions of the FARC, and elements linked to the Clan del Golfo, vie for control of territory long marked by weak state presence and lucrative illicit economies. Civilians have been displaced, confined, and threatened with violence, including forced recruitment and targeted attacks. Local communities report that armed actors’ actions have disrupted food production, limited mobility, and hindered access to basic services, while official humanitarian relief remains scarce. These conditions have left communities to rely on their own initiatives and networks for survival Norwegian Refugee Council (NRC).
Last year’s humanitarian emergency briefly pushed Catatumbo into the national spotlight. Slogans such as ‘Al Catatumbo Nada lo Tumba’ (nothing can strike down Catatumbo) were painted on walls across Colombia in a loud and clear show of solidarity. The government declared a ‘conmocion interior’ state of emergency allowing for exceptional humanitarian measures. By April 2025 it had ended, but the violence had not. On January 3 2026, the collapse of the Maduro regime in neighbouring Venezuela acted as a further trigger for unrest.
According to estimates by OCHA and the Norwegian Refugee Council, more than 100,000 people have been displaced from Catatumbo since January 2025. As armed actors continue to fight for territorial control, and exceptional humanitarian relief is shrinking, the responsibility for survival falls back onto those who live on and from the land itself.
Catatumbo’s ‘care-land’ history
Humanitarian relief is not delivered to Catatumbo; it is improvised from within the land. Here we trace the terrain of survival that shows how humanitarian care operates when merged into a land, fractured by violence and sustained through its connections.
In Catatumbo, care and land are inseparable. Access to food, health, protection, and dignity depends on the ability to inhabit, move through, and claim territory under conditions of violence. For the local Peasant Farmer Association Ascamcat, the guiding principle remains: “Life, dignity, land tenure, and permanence in the territory”.
Returning to care-land
Catatumbo sits at the crossroads of multiple crises. It is one of the world’s most productive coca-growing regions, a strategic corridor along the Venezuelan border, and a territory where state presence has long been fragile. It experienced egregious violence during the ongoing Colombian armed conflict, including mass executions and furnaces built to dispose of bodies. Left largely to its own devices, local institutions have long relied on a patchwork of humanitarian programmes, community organisations, and civil society platforms to fill persistent gaps.
As a result, responsibility for care and humanitarian relief has been returned to the land itself. Homegrown initiatives such as the Zona de Reserva Campesina- legally recognised rural reserve zones created under Colombian law to support small‑scale farming and campesino territoriality; and the Pacto Catatumbo have played a central role: stabilising rural livelihoods, formalising land rights, and anchoring development plans in community priorities. Human rights defenders and regional civil society organisations including Ascamcat, describe these arrangements as uneven and incomplete, yet indispensable; systems that made life bearable without ever delivering security or peace. In crises, these initiatives are the only option that enables humanitarian care to work at all. The fragile ‘care-land’ they sustain is now under acute strain. As fighting intensifies, it is at breaking point.
Fracturing care-land
In Catatumbo, armed clashes between the National Liberation Army (ELN) and dissident factions of the former FARC have escalated. Criminal groups, from the region-wide Tren de Aragua to local youth gangs, further fuel the violence. Drones and social media intensify these dynamics. In Catatumbo, bomb’s fall from the sky and mines are placed in the ground. The fractures ripple through care systems.
Access to medical and humanitarian supplies is increasingly blocked. Ambulances cannot reach remote areas, roads are mined, and infrastructure like schools, clinics, administrative offices is neglected or destroyed. Local contacts or staff from regional humanitarian networks report that billions of Colombian pesos are spent on arms while essential services languish. These blockages are embedded in the region’s topography, shaping who can survive.
Care networks are breaking down. Local, legally-recognised community organisations such as the Juntas de Acción Comunal (JAC) are disintegrating. Social leaders are fleeing or disappearing, and with them the work they sustained. Families abandon their homes with little more than the hope that aid awaits in shelters and registration centres in towns near the border with Venezuela such as El Tarra, Tibú, Ocaña, or the departmental capital, Cúcuta. Some remain to protect land, crops, or elderly relatives. The fractures run deep.
Connecting care-land
Yet continuity of care is patched together across Catatumbo. Families, neighbours, and local organisations improvise systems of mutual support that extend beyond village boundaries and displacement routes. Community leaders coordinate relief, share information, and maintain connections between rural areas and shelters in nearby cities. Care here is fragile and constantly renegotiated, yet it persists.
The Mesa Humanitaria, established in 2018, illustrates how such care is coordinated under these conditions. As a recognised governance platform in Colombia, it brings together Indigenous resguardos, women’s organisations, municipal authorities, and international observers to negotiate access to humanitarian aid, document violations, and coordinate relief in areas otherwise cut off. Through the Mesa, strategies emerge to distribute food and medicine, verify incidents of displacement or violence, and advocate for basic rights.
While formal, the Mesa depends on informal practices and social ties: neighbours checking on one another; connections between those who have fled and those who stayed; the sharing of scarce resources; exchanges of information about risks and safe passage; pooling medical supplies; or collectively monitoring landmines. These connections hold care-land together across fractures, weaving humanitarian action into the terrain itself. Any engagement in Catatumbo must work with these connections rather than around them.
Care-land at stake
Today, this care-land is under direct threat. Armed groups, shifting geopolitics along the Colombian border with Venezuela, where conflict dynamics between armed groups extend across the frontier, the shadow of US interventions, and a diminishing humanitarian presence erode the fragile conditions under which care can be sustained. What remains is not continuity secured by institutions, but care unevenly patched together across fractured territory. Humanitarian relief in Catatumbo is neither stable nor assured. It is living on the brink of violence and abandonment. Hanging on, as one human rights activist puts it, by little more than half a hope.
Silke Oldenburg a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».
Anna Leander a reçu des financements du Fond National Suisse pour le project 'The Future of Humanitarian Design' (CRSII5_213546)
Nora Doukkali a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».
10.02.2026 à 16:50
« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (2229 mots)
La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.
Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »
Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.
À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.
Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé
Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.
Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.
Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.
La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.
Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein
L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.
Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.
Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.
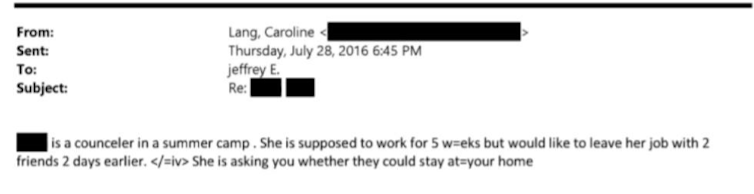
La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.
La recevabilité sociale d’Epstein repose sur cette accumulation de relations redevables. Chaque figure prestigieuse qui le fréquente renforce l’illusion de normalité. Ce cercle autoréalisateur transforme la condamnation judiciaire en détail marginal, absorbé par le poids du réseau.
Le « Si j’avais su » permet ensuite d’effacer cette dynamique. Il transforme une relation structurée par des échanges matériels et symboliques en simple erreur de jugement. Il neutralise la question des bénéfices reçus. Il évite surtout d’interroger la responsabilité collective d’un système fondé sur l’évitement du savoir.
Le « Si j’avais su » et la théorie du complot
La posture du « Si j’avais su » ne se limite pas à une stratégie individuelle de protection réputationnelle. Elle produit des effets politiques et cognitifs profonds sur la perception du pouvoir et alimente directement la défiance contemporaine envers les élites. En affirmant qu’ils ignoraient des faits pourtant publics, documentés et accessibles, les acteurs concernés installent un décalage troublant entre leur position sociale et leur responsabilité informationnelle. Cette dissonance nourrit un soupçon durable : si ceux qui disposent du plus fort capital culturel, médiatique et relationnel disent ne pas savoir, alors soit ils mentent, soit ils bénéficient d’un régime d’exception.
C’est dans cet espace de flou que prospèrent les théories complotistes. Le « Si j’avais su » crée une zone d’indétermination discursive, dans laquelle l’absence d’explication systémique laisse place à des récits alternatifs. En refusant de reconnaître les mécanismes ordinaires de complaisance, de silence et de redevabilité, cette posture alimente l’idée d’un mensonge organisé et d’une vérité volontairement dissimulée au public. Là où une analyse sociologique mettrait en évidence des logiques de réseau et de protection mutuelle, l’opinion perçoit un système opaque, intentionnellement dissimulé.
La défiance envers les puissants s’en trouve renforcée. Plus le statut de celui qui invoque l’ignorance est élevé, plus cette ignorance devient suspecte. Le « Si j’avais su » ne rassure pas ; il confirme l’idée que les élites vivent dans un monde séparé, soustrait aux contraintes morales ordinaires. En ce sens, cette posture ne désamorce pas la crise de confiance démocratique : elle l’aggrave. En l’absence de reconnaissance claire des angles morts et des responsabilités collectives, le discours officiel laisse le champ libre aux interprétations complotistes, qui trouvent dans cette ignorance proclamée l’un de leurs principaux arguments de crédibilité.
Comment peut-on ne pas savoir ?
Reste enfin une question centrale, rarement abordée frontalement : comment peut-on réellement ne pas savoir, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? Depuis le milieu des années 2000, les informations sur Epstein sont accessibles en quelques clics. Articles de presse, archives judiciaires, bases de données publiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux : jamais l’accès à l’information n’a été aussi large, aussi rapide, aussi durable.
Ne pas savoir suppose alors un choix implicite. Celui de ne pas chercher. Celui de ne pas vérifier. Celui de considérer que certaines informations, bien que disponibles, ne méritent pas d’être intégrées. L’ignorance devient active. Elle repose sur une hiérarchisation des savoirs dans laquelle la respectabilité sociale l’emporte sur la vigilance morale.
Dans ce contexte, l’argument de l’ignorance perd sa dimension défensive pour devenir un révélateur. Il ne dit pas ce que les acteurs ignoraient, mais ce qu’ils acceptaient de ne pas vouloir savoir. À l’ère numérique, l’ignorance n’est plus un manque. Elle est une stratégie.
L’affaire Epstein ne révèle donc pas seulement des crimes, mais une culture du non-savoir partagée, rendue possible par la redevabilité, la proximité avec le pouvoir et la dissociation morale. Le « Si j’avais su » n’est pas une excuse. C’est le symptôme d’un système.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:50
La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?
Éric Martel-Porchier, Enseignant chercheur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Texte intégral (3194 mots)
La supériorité militaire apparente d’une armée peut devenir une faiblesse lorsqu’elle nourrit un excès de confiance et une rigidité organisationnelle. L’exemple de la France vaincue en 1940 par une armée allemande reconstituée de fraîche date met en évidence le rôle décisif de l’adaptation, de l’innovation et de la capacité industrielle. Transposé à la rivalité sino‑américaine, ce précédent montre que la Chine, portée par une base industrielle très puissante et une doctrine centrée sur les drones et les systèmes autonomes, pourrait en cas de conflit ouvert compenser l’avance technologique américaine.
Cet article est la suite d’un article publié en 2020 qui posait déjà la question de la puissance économique de la Chine.
Aujourd’hui, il ne semble faire aucun doute que les États-Unis sont, de très loin, la première puissance militaire mondiale, en raison de l’importance de leurs dépenses annuelles, de leur nombre de bases à l’étranger et de la taille de leur armée. Celle-ci est aussi reconnue pour son expertise opérationnelle et ses performances technologiques. Malgré cela, cette puissance a priori majeure se trouve, dans les faits, en situation d’infériorité industrielle vis-à-vis de la Chine.
Dans l’hypothèse d’un conflit entre Washington à Pékin, il est fréquent d’entendre que, si à court terme la Chine subirait des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, à long terme sa victoire serait acquise. L’histoire montre pourtant que les ressorts d’une victoire sont plus subtils que la simple comparaison des capacités militaires des belligérants au début du conflit. Il est même fréquent que la supériorité militaire perçue par un acteur soit à l’origine de sa défaite.
L’étrange défaite de la France en 1940
Juste après la bataille de France, en juin 1940, Marc Bloch, qui a été pendant l’invasion allemande officier de l’armée française, rédige un ouvrage de référence sur cette question. Dans l’Étrange défaite, il donne de précieuses indications sur la manière dont une organisation militaire peut être vaincue lorsqu’elle surestime sa puissance.
Ce n’est pas le seul exemple d’une armée défaite alors qu’elle se croyait toute puissante. Mais la description que fait Bloch des dysfonctionnements de l’état-major et de la société française en 1940 permet de comprendre avec précision les causes de la défaite. On l’attribue aujourd’hui volontiers à une infériorité numérique, en oubliant qu’elle n’était pas perçue comme telle par les généraux français, ce qui les a conduits à de graves erreurs. On oublie aussi que, lors de la Première Guerre mondiale, la supériorité militaire de l’Empire allemand était évidente, ce qui ne l’a pas empêché d’être vaincu.
Marc Bloch montre comment l’excès de confiance de l’armée française a été la cause principale de son échec en 1940. Il décrit un mécanisme social par lequel une armée qui se considère comme puissante peut être vaincue par une armée nouvelle venant de se construire. Si l’on se réfère aux chiffres de l’époque, à l’exception de l’armée de l’air, la situation était plutôt favorable aux forces alliées : l’armée française disposait d’une supériorité en chars de combat et en véhicules, et les bombardements aériens n’étaient pas aussi efficaces que ceux de l’artillerie, même si leur effet psychologique était bien réel.
L’infériorité renforce les armées, la supériorité les affaiblit
Ce paradoxe d’une armée défaite par excès de confiance en sa propre puissance peut être transposé à l’actualité. Si l’on compare aujourd’hui l’état de l’armée américaine et celui de l’armée chinoise, on retrouve un phénomène similaire. Les Américains disposent d’une supériorité en avions de chasse, porte-avions et chars de combat, mais un paramètre nouveau rend ce critère de suprématie beaucoup moins pertinent : la transformation des guerres contemporaines, marquées par l’omniprésence des drones et l’usage croissant de systèmes militaires autonomes.
En 1940, l’armée française restait imprégnée de sa grande victoire de 1918. Elle avait alors été la première armée du monde, par sa performance technologique et organisationnelle. Très efficace, elle avait dirigé les armées alliées et appris aux Américains à mener une guerre de grande envergure avec les premiers chars réellement efficaces, comme les Renault FT.
Vingt-deux ans plus tard, la société et les militaires français n’ont pas compris que les méthodes de la guerre s’étaient complètement transformées. La victoire de 1918 tenait en partie à une certaine flexibilité et à une capacité d’innovation face à une armée allemande alors plus rigide. Paradoxalement, cette armée allemande, contrainte par le traité de Versailles à dissoudre une grande partie de ses effectifs et de son équipement, a dû, après l’avènement du nazisme, se reconstruire avec une grande flexibilité en tirant les enseignements de sa défaite. Lorsqu’une armée a le temps de comprendre les causes d’une défaite, elle en retire souvent des leçons décisives et peut devenir, quelques années plus tard, une force redoutable.
Devenue flexible et innovante sur le plan technologique, développant un nouvel art de la guerre fondé sur la rapidité et un système de communication très performant, l’armée allemande permet à des unités dotées d’une certaine autonomie d’agir avec une grande efficacité. À l’inverse, l’armée française souffre de graves problèmes de communication, aggravés par un management très centralisé. Au lieu de réagir immédiatement à une agression, il lui faut souvent deux ou trois jours pour donner des instructions pertinentes. Tandis que l’armée allemande a réellement innové, l’armée française reste figée dans un schéma hérité de la Première Guerre mondiale.
Si l’on compare aujourd’hui l’armée américaine et l’armée chinoise, on retrouve ces caractéristiques. La première tend à souffrir d’un sentiment de supériorité, persuadée que son expérience des combats lui confère une véritable flexibilité. La seconde se construit sur un sentiment d’infériorité qui l’amène à développer intensément ses capacités industrielles pour compenser ses faiblesses. Lorsque la Chine engage une guerre, en 1979 contre le Vietnam, les combats débutent d’ailleurs par une défaite, alors même que sa supériorité quantitative est avérée et que le Vietnam sort de quinze années de guerre contre les États-Unis.
Copier l’ennemi, puis innover
Cette expérience défavorable a pourtant un effet positif, renforcé par un sentiment d’infériorité à l’égard de la puissance américaine. Elle pousse la Chine à s’inspirer d’abord de l’armée américaine, à copier certains outils et systèmes, puis à se détourner de ce modèle pour construire sa propre logique militaire. Cette logique – copier, puis innover à partir de ce qui est copié – est d’ailleurs fréquente dans l’industrie. Après avoir débuté dans la production de voitures thermiques, la Chine est devenue leader dans la fabrication de voitures électriques.
À lire aussi : Véhicules électriques : la domination chinoise en 10 questions
Si l’on observe la remise en route de l’armée allemande entre 1919 et 1939, on est frappé par la similarité de cette logique. Il faut d’abord comprendre le fonctionnement de l’armée ennemie, puis s’en libérer pour concevoir son propre modèle, qui surprendra l’adversaire.
La Chine a pris grand soin d’étudier la guerre d’Ukraine et de développer des technologies militaires issues de ces observations. Elle a compris la spécificité d’un conflit où l’usage de drones, aujourd’hui automatisés, transforme profondément les logiques militaires. Elle en a tiré la certitude qu’il est nécessaire de disposer d’une industrie militaire innovante et très flexible. Chaque année, son industrie est ainsi en mesure de proposer des modèles d’armes améliorés ou nouveaux.
Comment la supériorité affaiblit la flexibilité managériale
À cette souplesse en matière d’innovation s’ajoute une autre dimension essentielle : l’efficacité de la supervision militaire. Incapable de reconnaître sa faiblesse, l’armée française, marquée par sa victoire de 1918, souffre en 1940 d’une réelle incompétence managériale. Elle illustre un biais récurrent : toute armée qui se perçoit comme très supérieure à son ennemi se fragilise. Elle ne déploie pas d’efforts frénétiques pour le vaincre et ne cherche pas à se transformer en permanence, convaincue de la solidité de son système de commandement.
Or, comme l’avait montré l’armée française en 1914, c’est la capacité à se réorganiser rapidement et à démettre les officiers incompétents qui fonde l’efficacité. Ce syndrome de supériorité affecte ensuite l’armée nazie qui, dès 1942, ne comprend plus la montée en puissance de l’armée soviétique et commet de nombreuses erreurs stratégiques, à commencer par la bataille de Stalingrad.
On manque d’éléments précis pour juger de l’efficacité managériale chinoise, sinon les purges militaires récentes, poursuivies encore en 2025 et 2026, qui témoignent d’une préoccupation réelle pour la discipline et la loyauté de l’armée. Du côté américain, plusieurs indices suggèrent que la supervision des forces reste marquée, comme lors de la guerre du Vietnam, par un fonctionnement administratif rigide et peu flexible.
Faut-il préférer la supériorité technologique à la supériorité industrielle ?
En 1944, l’armée allemande se trouve confrontée à une nouvelle forme d’art militaire conçue par les Américains. S’appuyant sur leurs capacités industrielles, ceux-ci assurent un renouvellement permanent de leur matériel grâce à un développement sans précédent de la logistique. Les ingénieurs allemands sont frappés par l’infériorité technique apparente de l’équipement américain, mais certains comprennent le véritable danger : un véhicule américain peut être réparé en quelques heures, voire remplacé dès le lendemain, alors que la perte d’un engin allemand a des conséquences lourdes.
Avec l’omniprésence d’armes automatisées comme les drones et les missiles, qui obéissent à une logique industrielle quantitative, et la flexibilité industrielle chinoise, c’est aujourd’hui la Chine qui assume ce rôle. Les Américains, comme les Allemands en 1944, misent sur la supériorité technologique et se heurtent à de réelles difficultés de production et donc de remplacement des engins perdus. La guerre d’Ukraine a montré que détruire un drone bon marché avec un missile antiaérien coûteux peut être problématique.
L’idée selon laquelle la Chine pourrait gagner une guerre contre les États-Unis sur le long terme, tout en subissant seule des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, apparaît alors illusoire. En cas de conflit ouvert, l’armée et l’économie américaines devraient très probablement, elles aussi, supporter de terribles pertes. Au vu du grand défilé qui a eu lieu à Pékin, le 8 septembre dernier et de la nouvelle logique militaire chinoise, on peut s’interroger sur la capacité de l’armée américaine à résister à une attaque de la part de la RPC.
L’illusion de la supériorité
Si l’on considère l’armée américaine aujourd’hui, elle semble souffrir d’un syndrome de supériorité, nourri par des opérations conduites contre des États du tiers monde et par un fort investissement technologique. L’armée irakienne, qu’elle a aisément vaincue en 1990, était, au-delà de sa faiblesse matérielle, minée par de graves problèmes organisationnels. Plus récemment, des frappes contre des puissances militaires faibles comme l’Iran ou le Yémen peuvent entretenir l’idée qu’elle reste la première armée du monde. Or l’histoire montre que ce type de conflits ne renforce pas durablement une armée ; on peut penser, par exemple, à la déroute de 1870 d’une armée française pourtant aguerrie par de nombreuses campagnes antérieures, le plus souvent victorieuses.
À cela s’ajoute un élément quantitatif : le budget militaire américain est infiniment supérieur à celui des autres nations, tout comme le nombre de chars, d’avions, de navires et d’unités. Pourtant, la guerre d’Ukraine a mis en lumière les limites de certaines technologies américaines, comme les chars Abrams ou les systèmes antiaériens Patriot, qui ne sont pas toujours plus performants que ceux de leurs adversaires, même si l’armée américaine n’a pas été directement engagée.
L’incident militaire survenu au Pakistan en mai 2025 nous révèle que les militaires chinois bénéficient d’une grande variété d’armements et d’une capacité avérée à introduire chaque année des innovations. C’est ainsi que l’on découvre que la supériorité industrielle et la diversité des arsenaux deviennent déterminants pour tenir dans un conflit de haute intensité.
De leur côté, de par leur compréhension rapide des conséquences de la guerre d’Ukraine les Chinois ont développé un système de chars modernes assistés par des véhicules spécialisés dans la lutte anti-drones. L’armée américaine, en revanche, semble moins capable de transformer rapidement son système militaire. La capacité de la Chine à produire massivement des drones et à les intégrer dans sa doctrine laisse entrevoir une supériorité potentielle.
Enfin, les États-Unis restent profondément attachés à la guerre aérienne comme vecteur de supériorité globale et laissent ainsi à l’armée chinoise l’initiative du combat terrestre. Cette confiance excessive dans la puissance aérienne est en soi problématique. La guerre du Vietnam leur avait pourtant montré l’inefficacité d’un contrôle aérien massif pour emporter une victoire politique, tout en entretenant l’illusion de pouvoir infliger des dommages décisifs à l’ennemi. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux indices suggèrent que cette foi dans la supériorité aérienne ne peut avoir, à terme, que des effets négatifs. La Chine a fait de sérieux efforts pour développer ses systèmes antiaériens et mettre en place des armées de drones capables de contester efficacement l’aviation américaine.
Suivant sa logique stratégique, il apparaît que l’armée chinoise ne montrera sa vraie puissance qu’une fois confrontée à un ennemi ayant perdu sa rationalité. En attendant, elle laisse son adversaire conserver sa supériorité illusoire.
Éric Martel-Porchier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 12:55
« Trump est fou » : les effets pervers d’un pseudo-diagnostic
Olivier Fournout, Maître de conférence HDR, département Sciences économiques et sociales, chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (CNRS), Télécom Paris – Institut Mines-Télécom
Texte intégral (3523 mots)
Qualifier Donald Trump de « fou », comme c’est régulièrement le cas ces derniers temps, tend à détourner l’attention de la cohérence de la politique conduite par l’intéressé depuis son retour à la Maison-Blanche et du fait qu’il constitue moins une anomalie individuelle qu’un produit typique d’un système économique, médiatique et culturel qui valorise la domination, la spectacularisation et la marchandisation du monde. Il convient de se détourner de cette psychologisation à outrance pour mieux se concentrer sur les structures sociales qui ont rendu possible l’accession au pouvoir d’un tel individu.
C’est devenu en quelques jours du mois de janvier 2026 la note la plus tenue de l’espace médiatique : Trump est fou. Une élue démocrate au Congrès des États-Unis tire la sonnette d’alarme sur X, le 19 janvier : le président est « mentalement extrêmement malade », affirme-t-elle. Fox News, média proche de Donald Trump sur le long terme, reprend les propos dès le lendemain sur un ton factuel. Le 22 janvier, lendemain du discours de Trump à Davos, durant lequel il a demandé « un bout de glace » (à savoir le Groenland) « en échange de la paix mondiale », l’Humanité fait le titre de sa une avec un magnifique jeu de mots : Trump « Fou allié ».

Le 23 janvier, des messageries relayent ce qui déjà se diffuse largement dans la presse : « Déclaration de représentants démocrates au Congrès US : la santé mentale de Donald Trump est altérée ; c’est pire que Joe Biden, c’est un cas de démence ».
Le 24 janvier, la une de l’hebdomadaire The Economist montre un Donald Trump torse nu à califourchon sur un ours polaire – message de folle divagation en escalade mimétique avec Poutine et ses clichés poitrine à l’air, l’animal du Grand Nord soulignant en l’occurrence les prétentions du locataire de la Maison Blanche sur le Groenland.
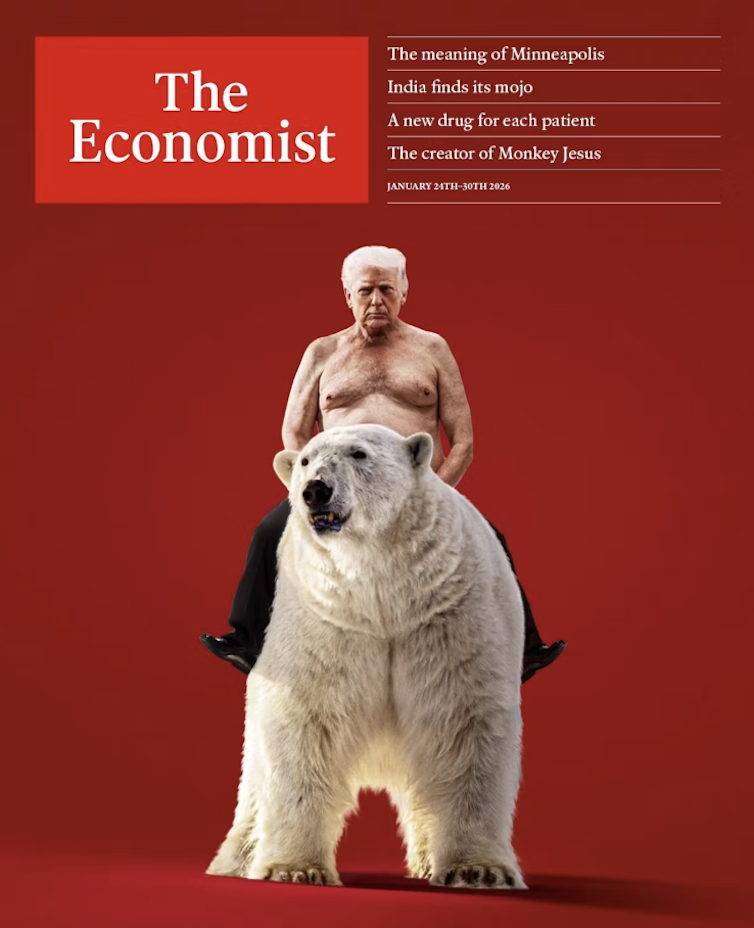
Même le premier ministre slovaque Robert Fico, pourtant un allié du milliardaire new-yorkais, l’aurait jugé « complètement dérangé » après l’avoir rencontré le 19 janvier à Mar-a-Lago. Le cas Trump est donc désormais régulièrement examiné à l’aune de la folie par des élus, des journalistes, mais aussi des psychiatres.
Il y a pourtant matière à être dubitatif sur les accusations de folie portées contre Trump. Non seulement elles n’ont guère contribué jusqu’ici à le neutraliser, mais elles ont même fait son succès et empêchent de penser le vrai problème. Les arguments en leur défaveur méritent un tour d’horizon.
Quelle légitimité du discours médicalisant ?
Il peut sembler contestable, même quand on est psychiatre et a fortiori quand on ne l’est pas, de déclarer quelqu’un malade mental sans l’avoir examiné selon des protocoles précis.
Quand le 5 mars 2025 le sénateur français Claude Malhuret, qui est médecin, traite Trump de « Néron » et de « bouffon » à la tribune du palais du Luxembourg – une intervention qui deviendra virale aux États-Unis –, le discours est de belle facture rhétorique, mais il n’est pas médical.
Le sénateur ne se réfère d’ailleurs pas à l’Académie. À ce stade, en l’absence d’examen effectué par des professionnels dont les résultats auraient été rendus publics, qualifier Trump de fou relève plus de la tournure politique que médicale.
Une rhétorique inefficace
Les déclarations sur la folie de Trump se succèdent sur le long cours sans avoir montré la moindre efficacité pour le combattre. Dès la première année de son premier mandat, la rumeur bruisse d’une possible destitution pour raison mentale sur la base d’avis d’experts qui n’ont pourtant pas eu d’entretiens avec le principal intéressé. Aucune procédure de destitution ne sera engagée sur ces bases.
Une nouvelle sortie collective de professionnels sur le déclin cognitif de Trump, lui trouvant un « désordre sévère et incurable de la personnalité », eut lieu en octobre 2024. Ce qui ne l’empêcha pas d’être élu assez aisément le mois suivant face à Kamala Harris. Quant à la défaite de 2020, elle arriva en pleine vague Covid et fut moins la conséquence des assertions selon lesquelles le président sortant était fou que de sa gestion désastreuse de la pandémie : sous-estimation de l’ampleur des contagions et de la mortalité, refus ostensible du port du masque.
Un jour, sans doute, Trump quittera-t-il le pouvoir, mais les effets des jugements de maladie mentale sur sa carrière politique – et en particulier sur sa victoire de 2024, qui se produisit alors que les électeurs avaient toute connaissance de son profil personnel – ont été nuls jusqu’à aujourd’hui.
Des attaques qui font le jeu de Trump
Pis encore : ces attaques ne sont pas seulement inefficaces, elles servent Trump. Le cœur de sa technique – qu’il a explicitée dès les années 1980 dans The Art of the Deal – consiste à semer la controverse pour faire parler de lui et de ses projets. Lui répondre sur ce terrain qui est le sien, en le traitant notamment de psychopathe (ou d’aberrant, de monstrueux, de stupide, ou de lunaire – le dernier vocable à la mode), c’est tomber dans le piège : il se pose ensuite en victime et ramasse les suffrages. Le sujet d’étonnement est que, depuis dix ans, aucune leçon n’ait été tirée de ces échecs à répétition dans la lutte contre Trump.
« Je fulmine et m’extasie comme un dément, et plus je suis fou, plus l’audimat grimpe »,
s’autopitchait Trump pour son émission de téléréalité, The Apprentice (source : Think Big and Kick Ass: In Business and Life, D. Trump et B. Zanker, 2007). Folie ? Non. Mise en scène éprouvée qui attire l’attention à son profit.
Mais le bénéfice s’enclenche aussi pour les commentateurs et les chambres d’écho. Et c’est là que le bât blesse : les « coups de folie » de Trump sont en réalité des diversions où les médias, les oppositions, les politiques et, souvent, les experts s’engouffrent pour le buzz.
Trump est à l’image de la société
Au-delà de la télé, les méthodes de Trump sont typiques de conseils de vie qui circulent largement dans la société, émanant de bien d’autres agents que lui. On pense, par exemple, aux classiques Swim With the Sharks Without Being Eaten Alive (1988), de Harvey Mackay, ou The Concise 33 Strategies of War (2006), de Robert Greene.
On pense aussi aux métaphores guerrières qui se glissent dans des ouvrages de management plus pondérés ; « les salles de commandement en temps de guerre » décrivent les réunions des équipes « successful », dans X-Teams (2007) ; donner plus de pouvoir au manager est recommandé pour qu’il ne se retrouve pas « face à dix ennemis avec une seule balle dans son fusil », dans Smart simplicity (2014).
De ce point de vue, Trump est « banal, trop banal ». Il est typique d’une « héroïcomanie hypermoderne », porté par une « trumpisation du monde » qui le dépasse. La conséquence de ce constat sociologique est que le problème est beaucoup plus profond qu’une folie idiosyncrasique, si perturbante soit-elle.
Déclarer Trump fou fait oublier à quel point le mode opératoire trumpiste est, pour une part non négligeable, partagé transversalement par la société. Ainsi, Trump privilégie-t-il les rapports de force. Il a toujours été sans équivoque sur ce point qui lui apporta la réussite dans le business, la télévision, le marché du leadership, et maintenant en politique. Mais cela ne se réalise pas contre la société américaine, comme par accident, mais en miroir d’un vaste spectre de celle-ci.
La négociation le revolver sur la tempe alimente quantité de traités de développement personnel, de management et de communication au travail. Elle est la matrice scénaristique assurant la popularité des films hollywoodiens (non seulement les westerns mais aussi les « propositions qui ne se refusent pas » du film le Parrain). Rien, là, de fou ou d’aberrant. Juste un éthos dominant qui a sa rationalité et qui n’a jamais été soft.
Aussi, aucune surprise si la rencontre d’un pouvoir fort est seule susceptible de faire fléchir Trump. Là encore, il est explicite sur ce point depuis longtemps. Lorsqu’il fut proche de la faillite dans les années 1990, il courbe l’échine devant les banquiers : « Quand vous devez de l’argent à des gens, vous allez les voir dans leur bureau […] Je voulais faire n’importe quoi sauf aller à des dîners avec des banquiers, mais je suis allé dîner avec des banquiers » (in Think big, 2007). Rationalité strictement instrumentale, certes, mais rationalité. L’article de fond « Ice and heat » récemment publié par The Economist sur l’affaire du Groenland relève que la menace européenne de déclencher l’instrument anti-coercition a joué, pour l’instant, dans le recul de Trump.
Révéler la structure pour mieux la combattre
Pour contrer l’Amérique de Trump, il conviendrait d’abord plutôt de se pencher sur la rationalité de ses lignes directrices. Son action, aussi bien en diplomatie qu’en politique intérieure, aussi bien en politique économique qu’en gestion des ressources naturelles, découle d’une stratégie claire et constante, pensée et volontariste. C’est sur ce terrain qu’il faut se battre pour défaire Trump, et non par des coups d’épée dans l’eau qui donnent bonne conscience à bon compte, sont repris en boucle, mais n’apportent rien de consistant face au fulminant showman.
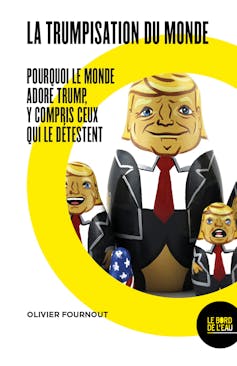
Du discours de Trump à Davos, le 21 janvier 2026, ressortent plusieurs traits qui n’ont rien de mentalement dérangé. D’une part, il apporte un momentum aux extrêmes droites européennes déjà au pouvoir ou aux portes de celui-ci. D’autre part, une Europe qui se réarme et qui reste toujours globalement « alliée » des États-Unis débouche sur une situation stratégique plus favorable du point de vue américain : tel est le résultat, objectif, de la séquence historique actuelle.
Enfin, la demande d’avoir un « titre de propriété » sur le Groenland réussit à installer, même si elle n’aboutit pas, l’horizon indépassable du monde selon Trump : « La terre, comme les esclaves d’Ulysse, reste une propriété », comme l’écrivait Aldo Leopold, pionnier de la protection de la nature aux États-Unis, dans Almanach d’un comté des sables, publié en 1948 (traduction française de 2022 aux éditions Gallmeister). Trump est dans son élément, en parfaite maîtrise du vocabulaire pour fragiliser la transition ou bifurcation écologique. Comme l’exprime Estelle Ferrarese dans sa critique de la consommation éthique, « dans aucun cas la finalité n’est de mettre certaines choses (comme la terre) hors marché ».
Question ouverte pour l’Histoire
En insistant sur la supposée folie de Trump, les commentaires se rabattent sur un prisme psychologisant individuel. Peut-être Trump est-il fou. La sénilité peut le guetter – il en a l’âge. Des centaines de pathologies psychiatriques sont au menu des possibles qui peuvent se combiner.
Mais l’analyse et l’inquiétude ont à se pencher, en parallèle, sur le symptôme structurel de notre temps, sur ce système qui, depuis cinquante ans, propulse Trump au zénith des affaires, des médias, des ventes de conseils pour réussir, et deux fois au sommet du pouvoir exécutif de la première puissance mondiale.
La prise de distance avec l’accusation de folie portée contre Trump ouvre un chantier de réflexion où le problème n’est plus la folie personnelle du leader élu, mais une stratégie dont Trump est, en quelque sorte, un avatar extrême mais emblématique. Le regard se détache de l’événementiel chaotique – trumpiste ou non trumpiste – pour retrouver le fil d’une analyse structurelle. Sans conteste, Trump fragilise l’ONU et l’OMS, mais à l’aune de l’histoire longue, il ressort qu’une « impuissance structurelle » persévère, selon laquelle « dans le cas des États-Unis, c’est un grand classique que de bouder (au mieux) et de torpiller (autant que possible) toutes les démarches multilatérales dont ils n’ont pas pris l’initiative ou qu’ils ne sont pas (ou plus) capables de contrôler » (Alain Bihr, l’Écocide capitaliste, tome 1, 2026, p. 249).
Les psychés peuvent être « débridées », mais ce sont les « structures sociales » qui « sélectionnent les structures psychiques qui leur sont adéquates ». Trump n’est plus alors une anomalie foutraque, sénile, troublée, en rupture avec ce qui a précédé et à côté des structures sociales, mais la poursuite d’une marchandisation du monde à haut risque, dont le diagnostic est à mettre en haut des médiascans, pour discussion publique.
Olivier Fournout ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 00:05
La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen Âge
Rachel Delman, Heritage Partnerships Coordinator, University of Oxford
Texte intégral (2914 mots)

Dans deux films récents consacrés à la vie des femmes au Moyen Âge, on observe la présence de faucons, symboles de pouvoir et, au risque d’employer un anachronisme, d’émancipation avant l’heure.
Les faucons prennent leur envol au cinéma. Dans deux adaptations littéraires récentes — Hamnet et H is for Hawk —, ces oiseaux sont intimement liés à la vie et aux émotions de leurs héroïnes respectives : Agnes Shakespeare (née Hathaway) et Helen Macdonald.
La symbolique des rapaces est au cœur de ces deux nouveaux films : Hamnet, l’adaptation par Chloé Zhao du roman de Maggie O’Farrell paru en 2020, et H is for Hawk, tiré des mémoires de Macdonald publiés en 2014 et traduits en français par M pour Mabel. Dans ces films, les faucons deviennent des figures complexes et ambivalentes.
Si Hamnet se déroule à l’époque élisabéthaine, H is for Hawk prend place dans le monde contemporain. Mais une histoire encore plus ancienne retrace la relation entre femmes et oiseaux de proie. Mes recherches montrent qu’au Moyen Âge déjà, cette relation était multiforme. Bien plus qu’un accessoire de mode, les faucons offraient aux femmes un moyen d’affirmer leur genre, leur pouvoir et leur statut social dans un monde largement dominé par les hommes.

Au Moyen Âge, le dressage des faucons — subtil jeu d’équilibre entre contrôle et liberté — était fréquemment associé à la cour amoureuse entre hommes et femmes.
La dimension romantique de la fauconnerie transparaît dans les œuvres d’art, les objets et la littérature de l’époque. Des scènes d’hommes et de femmes chassant ensemble à l’aide de faucons figurent parmi un large éventail d’artéfacts médiévaux : tapisseries ornant murs de châteaux, étuis décorés servant à protéger les miroirs à main…
La plus grande tapisserie des Devonshire Hunthing Tapestries — un ensemble de quatre tapisseries du XVe siècle — est entièrement consacrée à la fauconnerie. Des amoureux y sont représentés en train de se promener bras dessus bras dessous, pendant que leurs oiseaux chassent le gibier.
Deux étuis à miroir du XIVe siècle, conservés au British Museum et au Metropolitan Museum of Art, représentent des couples à cheval, tenant des faucons. Ces miroirs ont probablement été offerts comme gages d’amour. La littérature médiévale regorge elle aussi de références à des femmes accompagnées de faucons, voire représentées comme tels.
Mais la figure de la femme-faucon qu’il faudrait « dompter et contrôler » ne renvoie toutefois pas à une soumission féminine. Au contraire, la fauconnerie et sa symbolique permettaient aux femmes de l’élite médiévale d’exprimer leur autorité et leur autonomie.
Se définir à travers l’image
Lorsque les femmes de haut rang avaient la possibilité de se représenter à travers la culture visuelle, elles choisissaient souvent d’y inclure des oiseaux de proie. Cela était notamment visible sur les sceaux, cachets officiels souvent utilisés à l’époque médiévale pour authentifier les documents juridiques. Le sceau constituait la marque d’identification de la personne qui l’apposait, et renvoyait à son statut social et à son autorité. L’iconographie des sceaux et les matrices servant à les produire reflétaient la manière dont les femmes de haut rang voulaient être perçues par le monde.
Elizabeth de Rhuddlan, la plus jeune fille du roi Edouard Ier d’Angleterre et d’Eleonore de Castille, a choisi pour la matrice de son sceau personnel, un motif particulièrement répandu chez les femmes du XIIIe siècle : une femme debout, corps légèrement tourné vers un rapace docile posé sur sa main gauche.
Une autre matrice du même siècle montre Elizabeth, dame de Sevorc, à cheval, assise en amazone, tenant un faucon dans une main et la serre d’un aigle dans l’autre.
À travers ces sceaux, les femmes médiévales affirmaient leur maîtrise des rapaces, mais surtout, leur appartenance à un cercle féminin puissant.

Des archives montrent par ailleurs que reines et dames ont créé et administré des parcs et domaines de chasse. Elles pratiquaient la fauconnerie ensemble, dressaient les rapaces et les offraient même parfois en cadeau.
Certaines petites espèces, comme le faucon merlin, étaient jugées plus convenables pour les femmes. Dans le film H is for Hawk, Helen (Claire Fory) refuse de se contenter d’un faucon merlin, qu’elle rejette comme « oiseau de dame ». Effectivement, les femmes du Moyen Âge n’acceptaient pas toujours, loin de là, de se plier aux règles prescrites par les manuels de bonne conduite.
Margaret Beaufort, la grand-mère paternelle d’Henry VIII, possédait de nombreux rapaces : faucons merlins, lanerets… mais aussi de grandes espèces comme des autours et des faucons lanier.
Le parc à daims qu’elle fit aménager autour de son palais de Collyweston, dans le Northamptonshire, se prêtait parfaitement à la fauconnerie. Sa belle-fille, la reine Elizabeth de York, qui disposait de ses propres appartements au palais, chassait quant à elle avec des autours.
Dans certains cas, les femmes semblent même avoir été reconnues comme de véritables expertes dans le domaine de la fauconnerie. Les Heures Taymouth, un livre d’heures enluminé du XIVe siècle, probablement destiné à une femme d’origine royale, montre des femmes coiffées de parures, chassant le colvert à l’aide de grands rapaces. Leur posture affirme leur autorité, leur savoir-faire et leur contrôle sur les oiseaux.
Au siècle suivant, Dame Juliana de Berners, prieure du monastère de Sopwell, est considérée comme l’autrice — en partie — du Boke of St Albans, un ouvrage traitant de la chasse et de la fauconnerie.

Des recherches menées par English Heritage ont par ailleurs révélé que certaines femmes pouvaient gagner leur vie grâce à leur expertise en matière de dressage de faucons. Au milieu du XIIIe siècle, une femme nommée Ymayna était la gardienne des faucons et des chiens du comte de Richmond. En échange de ses services, elle et sa famille obtinrent le droit d’exploiter des terres voisines.
Si Ymayna constitue une figure exceptionnelle dans un milieu largement masculin, son parcours laisse penser que d’autres femmes ont exercé des fonctions similaires, bien que leurs noms soient absents de tout document historique.
Certaines pourraient figurer parmi les propriétaires de couteaux dont les manches sont conservés dans des musées européens. L’un des plus remarquables, sur lequel est sculptée une femme noble serrant contre son cœur un petit rapace, date du XIVe siècle et est exposé à l’Ashmolean Museum d’Oxford.
Les textes littéraires révèlent que la fauconnerie favorisait la socialisation et la solidarité entre femmes. Dans le poème Sir Orfeo, écrit en moyen anglais, Orfeo aperçoit un groupe de soixante femmes à cheval, chacune tenant un faucon.

Dans Hamnet, Agnes explique à son mari William Shakespeare que son gant de fauconnerie lui a été offert par sa mère. Les femmes du Moyen Âge et du début de l’époque moderne s’offraient des cadeaux entre elles, y compris des gants. Mes recherches suggèrent toutefois que les oiseaux de proie étaient plus fréquemment offerts comme cadeaux entre femmes et hommes.
Margaret Beaufort donnait et recevait des rapaces de la part de parents et de proches masculins, parmi lesquels son jeune petit-fils, le futur Henri VIII. Les rapaces étaient considérés comme étant des cadeaux convenables lors d’occasions et évènements marquants. En 1525, Margaret Pole, comtesse de Salisbury, offrit par exemple trois faucons à son neveu Henry Courtenay pour célébrer son accession au titre de marquis d’Exeter.
Le fait que des femmes puissantes propriétaires de terres aient pris part aux échanges rituels de rapaces avec des hommes montre que la fauconnerie ne relevait pas uniquement d’une expression féminine du pouvoir. En possédant des domaines de chasse et en donnant ou recevant des oiseaux de proie, elles s’inscrivaient dans un univers traditionnellement masculin : celui de la chasse et de la générosité seigneuriale.
Rachel Delman a reçu des financements du Arts and Humanities Research Council (2013-2016) et du Leverhulme Trust (2019-2022).
09.02.2026 à 23:08
René Cassin, un héritage moral très actuel
Julien Broch, Maître de Conférences HDR en Histoire du droit et des institutions, Aix-Marseille Université (AMU)
Texte intégral (2266 mots)
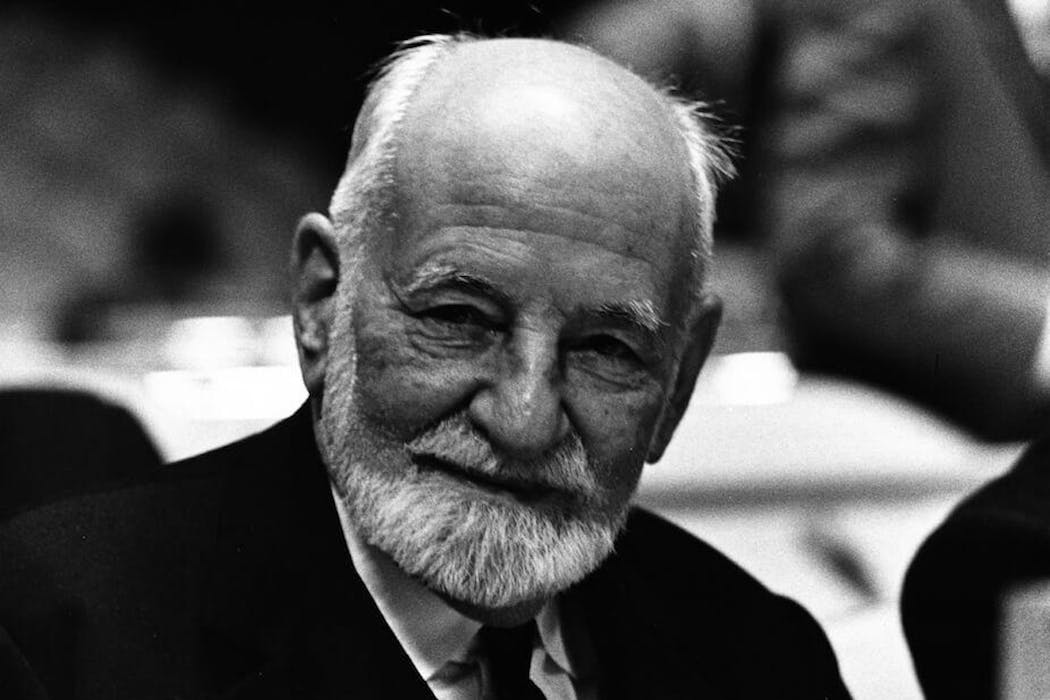
Le juriste et diplomate René Cassin, dont on s’apprête à commémorer le cinquantième anniversaire de la disparition, a consacré sa vie à la défense de la dignité humaine et de la paix, alliant idéalisme et réalisme. Résistant et proche de de Gaulle, il a joué un rôle clé au sein de la France libre puis contribué à la création de l’ONU et à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix, vingt ans plus tard. Sa pensée et son action restent aujourd’hui une source d’inspiration pour relever les défis internationaux et renforcer la solidarité entre les peuples.
Le 20 février prochain, cela fera tout juste cinquante ans que disparaissait le juriste internationaliste René Cassin (1887-1976), prix Nobel de la paix 1968.
Alors que nous sommes confrontés à un monde devenu sans boussole autre que la force pour ce qui est de la conduite des relations internationales, il est rafraîchissant de revenir à la pensée et à l’action de cet universitaire passé par les universités d’Aix-Marseille, Lille et Paris, que François Mitterrand présenta comme un « professeur d’espoir » lors de son entrée au Panthéon le 5 octobre 1987.
Espoir, parce que, résilient, il a fait preuve d’optimisme de la volonté lors du déchaînement de l’hitlérisme. Ce grand blessé de la Première Guerre mondiale, qui a dû porter toute sa vie une ceinture abdominale, a cherché à se rendre utile en se faisant l’avocat à la fois idéaliste et réaliste de la dignité humaine et de la paix.
L’œuvre de celui qui a dirigé plusieurs des éminentes juridictions françaises et internationales (Conseil d’État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme…) rappelle assez qu’il est illusoire de croire en la force du droit. Elle n’est qu’une incantation. Le droit n’est fort que lorsqu’il est juste et qu’il se trouve des bonnes volontés pour le défendre.
La paix, grande affaire de tous
Que dit Cassin à nous autres du XXIe siècle ?
D’abord que quand la valeur « paix » cesse d’être la grammaire du monde, il est crucial de la rendre désirable aux peuples. C’est la raison pour laquelle, à la tête de mouvements d’anciens combattants, il s’est attaqué, d’abord officieusement, puis à partir de 1924 officiellement en tant que membre de la délégation française aux assemblées de la Société des Nations, à la « dernière tranchée », celle des droits sociaux, au sein du Bureau international du travail.
Son idée ? Mettre autour de la table les vétérans des ex-pays belligérants pour les faire travailler sur des problèmes concrets, tels que les emplois réservés pour les estropiés, l’accès aux prothèses et aux soins médicaux, la prise en charge des pupilles de la Nation, etc. C’est dire assez qu’il appartient présentement à la société civile de jeter les ponts au-dessus des océans et des autres frontières pour, en dépit du mauvais vouloir de certains grands de ce monde et de leurs idéologues, sauver ce qui peut l’être et bâtir de nouvelles coopérations.
Ensuite, face aux nouveaux « États-Léviathan », qui sont des concentrations de puissance n’ayant d’autre morale que la leur, et qui s’assoient sur le droit international dès lors qu’il s’agit de déchaîner leur force pour acquérir des ressources et des territoires, ou lorsqu’il leur plaît d’imposer sur un mode agressif leur politique commerciale aux pays tiers, il ne faut jamais renoncer à donner de la voix et à agir. Immédiatement après ce grand renoncement qu’ont été les accords de Munich, signés le 29 septembre 1938, Cassin, tout en reprenant son bâton de pèlerin du multilatéralisme et du droit international, en a appelé à la signature de partenariats stratégiques – y compris avec l’URSS – pour tenir en respect le Reich hitlérien. Et d’écrire, vu la tiédeur de certains partenaires de Paris :
« Le sort de la sécurité française est, en premier lieu, dans les mains des Français eux-mêmes. »
Une affirmation qui fait sens au moment où il est question du rétablissement partiel d’une forme de service militaire dans notre pays.
Qui plus est, l’expérience de la Société des Nations créée par le traité de Versailles en 1919 et des accords de Locarno, ratifiés le 1er décembre 1925, visant à assurer la sécurité collective en Europe, révèle à Cassin que les organismes et mécanismes internationaux, si audacieux soient-ils, restent lettre morte tant qu’ils n’obtiennent pas l’assentiment des opinions publiques nationales.
Face à des dirigeants ayant perdu le sens de la mesure, les peuples, prenant conscience du développement de la solidarité internationale dans les faits – parfois sous les radars de la politique et du droit –, doivent se prendre en main, mais aussi se tendre la main les uns aux autres. Il faut éduquer justement les peuples à la paix et aux droits de l’homme, leur inculquer ce qu’est la dignité humaine, et que les droits et libertés bénéficient à tous sans exception, donner à chacun le sens de ses responsabilités en tant que citoyen et en tant qu’homme ou femme. On comprend dès lors que René Cassin contribuera activement à la mise en place de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), institution onusienne spécialisée créée le 16 novembre 1945. Ce travail pédagogique est plus que jamais utile aujourd’hui. Il est de la responsabilité de tous, médias compris.
Les deux pôles du monde nouveau : la démocratie et les droits de l’homme
Par ailleurs, René Cassin, enfant des « trois frontières » (Pyrénées, Alpes, Rhin), n’a jamais opposé le patriotisme, qu’il avait chevillé au corps, à l’internationalisme (l’« esprit de Genève »).
La mondialisation des échanges commerciaux et des communications lui a fait augurer que dans le futur ce phénomène déboucherait sur une société mondiale fortement intégrée, dotée d’instances de gouvernement et d’une police commune chargées de punir les gouvernements agresseurs. Il a défendu de toutes ses forces la Société des Nations, ainsi que les traités internationaux sur le recours à l’arbitrage et la mise de la guerre hors-la-loi, en dépit de leurs imperfections. La communauté universelle aurait, selon l’universitaire juriste, un droit de regard sur l’application des droits de l’homme en tous points du globe. Mais il ne doutait pas que c’est au premier chef à chaque État qu’il appartient de garantir l’effectivité des droits fondamentaux. Il n’opposait pas, comme on a tendance parfois à le faire, l’État de droit aux droits du peuple, car il considérait que le premier est au service de la sécurité et du bien-être de tous.
Enfin, premier civil ayant rejoint de Gaulle à Londres en 1940, il a été le juriste du général, travaillant avec les armes du droit, la plume et le micro de Radio Londres à ce que la France libre soit reconnue par les Alliés. Le risque était que, compromis du fait du collaborationnisme, le régime de Vichy soit discrédité au point de signer l’effacement de la France et de ses intérêts de la scène internationale. Il s’agissait donc de garantir la restitution intégrale de son indépendance dans l’avenir.
Les accords Churchill-de Gaulle du 7 août 1940, négociés par Cassin, ont fait de la France libre la seule organisation qualifiée pour représenter la France restée au combat. Restait à convaincre les autres interlocuteurs internationaux, et notamment le président américain F. D. Roosevelt. Le professeur s’est employé pour cela à délégitimer le pouvoir maréchaliste au motif que celui-ci s’était asservi aux nazis et avait trahi les valeurs (la liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, la démocratie et la République) et la mission historique (protéger les peuples opprimés) de la France.

L’embryon de gouvernement qui a trouvé refuge à Londres, à Brazzaville, puis à Alger a fonctionné dans le respect de ces principes éminents, d’où, par exemple, l’Ordonnance du 9 août 1944, portant rétablissement de la légalité républicaine, dont Cassin a été l’un des principaux artisans.
Chargé du portefeuille de la justice et de l’éducation au sein du cabinet gaulliste durant la guerre, il a convié des savants à réfléchir sur la régénération morale du monde une fois que celui-ci aura été libéré, et notamment sur les droits de l’homme, érigés en but de guerre par les Alliés dans la Déclaration des Nations unies du 1ᵉʳ janvier 1942.
La victoire sur les puissances de l’Axe obtenue, ce sera justement le rôle de l’Organisation des Nations unies d’articuler la paix avec les droits de l’homme ainsi que les progrès politiques et sociaux, toutes choses qui n’ont rien d’un luxe ou d’un élément accessoire. Aux côtés d’Eleanor Roosevelt et d’autres, René Cassin a pris une part très active à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée solennellement à Paris, au Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948.
Est ainsi vérifiée la locution qui dit qu’un travail acharné vient à bout de tout. C’est sans doute encore vrai aujourd’hui, quoique les informations qui nous parviennent quotidiennement soient décourageantes. Rendons alors grâce à René Cassin de nous inspirer par toute une vie consacrée aux valeurs de dignité et de solidarité humaines.
Julien Broch ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 16:00
La Chine, leader de la décarbonation des économies du Sud
Mary-Françoise Renard, Professeur d’économie, Université Clermont Auvergne (UCA)
Texte intégral (2037 mots)
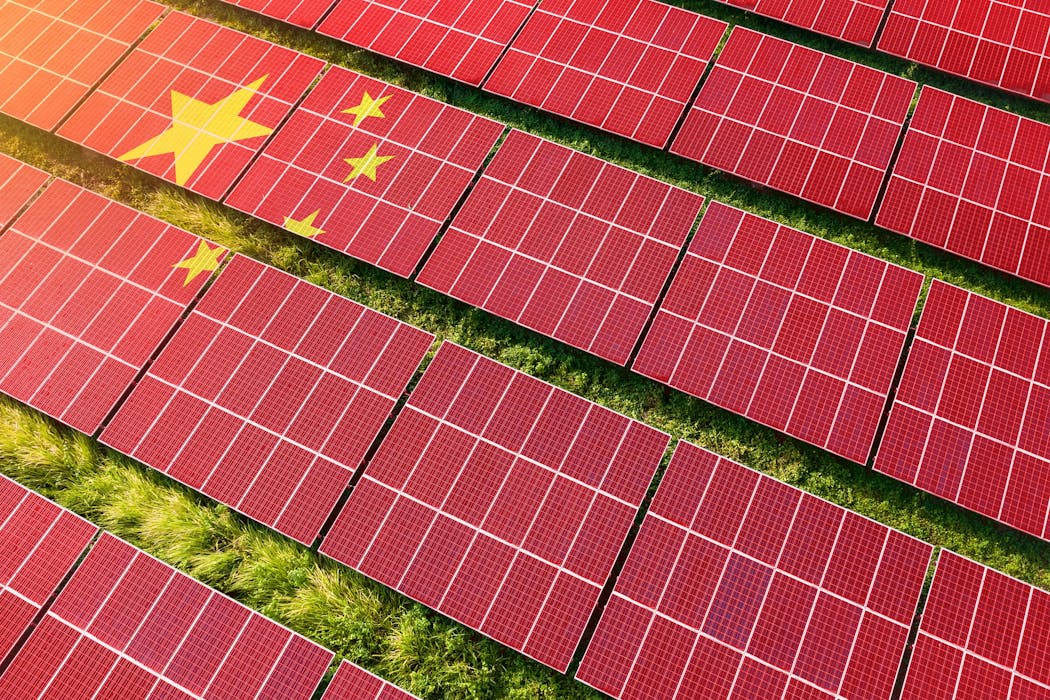
Très engagée dans la décarbonation de son économie, la Chine est devenue la première, et la plus innovante, productrice mondiale d’énergies vertes. Cette position lui permet de conforter ses relations avec les pays du Sud, en répondant à leurs besoins tout en servant ses propres objectifs d’étendre son influence, d’écouler sa production et d’approfondir l’internationalisation de sa monnaie. L’objectif : être la première puissance mondiale en 2049.
L’image d’une alliance entre grands pays du Sud global lors de la rencontre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi pendant la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin en septembre 2025, est un message aux pays du monde occidental : il existe une alternative au multilatéralisme.
L’importante délégation chinoise à la COP 30 en novembre 2025, au Brésil, et l’organisation dans ce cadre, d’un évènement sur la coopération Sud-Sud relatif au climat, illustre l’un des principaux vecteurs de cette coopération. La Chine est devenue le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables.
Cette stratégie vise à servir l’ambition chinoise de devenir la première puissance économique mondiale en 2049. Elle doit notamment lui permettre de jouer un rôle majeur dans la définition des normes et des standards internationaux.
Une stratégie offensive pour concurrencer l’Occident
L’affaiblissement des économies occidentales lors de la crise financière de 2007 a été concomitante de la volonté des pays du Sud de monter en puissance dans la gouvernance mondiale.
La création des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2009 et le discours de Wen Jiabao, alors premier ministre de Hu Jintao, à Davos la même année, illustrent cette volonté d’être leader de ce mouvement. La Chine est progressivement passée d’une stratégie « profil bas » avec Deng Xiaoping à la stratégie offensive d’une économie innovante pouvant concurrencer les économies développées dans de nombreux secteurs.
À lire aussi : Qu’est-ce que la « civilisation écologique » que revendique le pouvoir chinois ?
À l’heure où les États-Unis se marginalisent dans la lutte contre le réchauffement climatique et où l’Europe souffre de ses désaccords, la Chine se positionne comme le fournisseur de technologies vertes aux pays du Sud et le défenseur de leurs intérêts. Elle peut leur permettre d’accélérer la décarbonation de leur économie à un coût assez faible, de bénéficier d’investissements qui créent des emplois et peuvent générer des transferts de technologie. Elle sert un double objectif :
offrir des débouchés pour écouler ses surproductions, poursuivre la montée en gamme de son industrie et renforcer sa position de leader dans les technologies vertes ;
accroître l’internationalisation de sa monnaie, pour limiter les dépendances à l’extraterritorialité du dollar.
Une demande croissante de technologie chinoise par les pays du Sud
Éoliennes, panneaux solaires, batteries, la Chine est le premier producteur d’énergies vertes dans le monde. C’est principalement par la technologie que la Chine envisage la décarbonation de l’économie. Par exemple, en matière de panneaux solaires, la Chine dispose de 80 % de la capacité de production mondiale à chaque stade de la chaîne de valeur. La domination est encore plus forte dans les batteries avec 85 % de maîtrise de la chaîne de valeur.
Elle dispose d’un quasi-monopole dans la technologie de traitement des terres rares qu’elle possède en grande quantité. Sa compétitivité en matière de transports décarbonés illustre les efforts faits dans ce domaine grâce aux différents plans, notamment Made in China 2025.
S’agissant des véhicules électriques, on retrouve la traditionnelle intégration des pays d’Asie et des entreprises chinoises – BYD, China’s Sunwoda Electric Company, China’s Zhejiang Geely Holding Group, etc. Ces dernières ont créé des usines de voitures électriques et de batteries en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie. Les investissements de l’entreprise China’s Sunwoda Electronic Company et de Chery doivent permettre respectivement à la Thaïlande et au Vietnam de devenir des acteurs majeurs dans la chaîne de valeur des véhicules électriques.
À lire aussi : Le bond en avant de l’industrie automobile chinoise de 1953 à nos jours
Dans ce domaine, c’est tout un écosystème qui est proposé par Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), la plus grande usine chinoise de batteries, s’appuyant sur une joint-venture (coentreprise) sur le nickel avec l’Indonésie pour construire des capacités locales grâce à l’expertise chinoise.
Internationalisation de sa monnaie, le renminbi
Entre 2000 et 2023, la Chine a prêté 36,67 milliards d’euros aux pays africains pour développer l’accès à l’électricité sur le continent.
La construction de centrales hydroélectriques concentre 63 % des financements chinois de production d’électricité en Afrique entre 2020 et 2023, notamment en Zambie et en Angola. Les entreprises chinoises ont là aussi une position très dominante sur les chaînes de valeur de la transition énergétique, qu’il s’agisse des panneaux photovoltaïques ou des systèmes de stockage par batteries.
Sa compétitivité dans ce domaine lui permet de servir un autre objectif : l’internationalisation de sa monnaie. L’Arabie saoudite a accepté que le pétrole qu’elle vend à la Chine lui soit payé en renminbi (RMB) et attend en échange des investissements chinois dans les énergies renouvelables.
Obligations « pandas »
Grâce à des obligations libellées en renminbi, la Chine peut soutenir des projets dans les pays du Sud sur trois marchés : le marché obligataire panda onshore, le marché obligataire dim sum offshore et le marché obligataire offshore des zones de libre-échange (free-trade zones, FTZ), qui connaissent une forte croissance. Rappelons qu’une obligation est une dette émise par un État, une entreprise ou une collectivité locale sur un marché financier. Lorsqu’un étranger émet une dette sur un marché financier chinois, en renminbi, elle est qualifiée d’« obligation panda ». Lorsque ce titre de dette en renminbi est émis sur un marché étranger (off-shore), c’est une « obligation dim sum ».
En 2023, l’Égypte émet une obligation panda durable d’un montant de 3,5 milliards de renminbi (362 millions d’euros), avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII).
En 2024, c’est l’entreprise brésilienne de pâte à papier Suzano qui émet 1,2 milliard de renminbi (140 millions d’euros) en obligations vertes pandas, avec l’aide de la Banque de Chine. Ces fonds ont été affectés à des plantations d’eucalyptus qui séquestrent le carbone tout en protégeant les forêts indigènes.

Ces obligations panda sont particulièrement adaptées aux projets à grande échelle comme les fermes solaires et les stations d’épuration des eaux usées. La Chine accroît sa présence dans des financements en partie délaissés par les États-Unis, et qui sont de plus en plus souvent le fait de banques commerciales.
Elle fournit aussi des services de conseil. La Tunisie a fait appel à la Chine pour l’aider à lutter contre la pollution industrielle. Le gouvernement tunisien compte ainsi sur les capacités d’expertise chinoises pour éradiquer la pollution d’une usine de produits chimiques de Gabès (près de Sfax, au sud-est du pays) émettant des gaz toxiques entraînant des problèmes de santé pour les riverains, .
Objectif de leadership
Si la Chine participe activement à la décarbonation de l’économie, en servant un intérêt global, la lutte contre le réchauffement climatique, elle sert aussi son objectif de leadership. La domination des entreprises chinoises se renforce au fur et à mesure que les pays investissent dans les projets hydroélectriques, solaires, nucléaires notamment, comme en Afrique australe.
La Chine conforte son influence sur les pays du Sud en répondant à leur demande et en offrant une alternative à leurs relations avec les pays occidentaux, même si cela s’accompagne d’une certaine méfiance et de nombreuses tensions.
Mary-Françoise Renard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 15:59
La statue de la Liberté (1886-2026) : un anniversaire sous tension
Laurence Nardon, responsable du programme Amériques, IFRI (Institut français des relations internationales)
Texte intégral (1305 mots)

Cet article est publié en partenariat avec France Inter. Retrouvez Laurence Nardon, spécialiste de la politique américaine, dans le podcast « L’épopée de Lady Liberty », qui relate l’histoire épique de la statue de la Liberté, une idée française devenue le symbole de l’Amérique. Au fil des dix épisodes de ce poscast, Philippe Collin propose un long voyage dans le temps, un récit mouvementé à travers une amitié transatlantique autour de valeurs à défendre.
L’année 2026 marque les 140 ans de l’inauguration de la statue de la Liberté à New York, le 28 octobre 1886. Cette figure majestueuse, installée sur une île à l’embouchure de l’Hudson, est l’un des monuments préférés des New-Yorkais et des touristes, accueillant quatre millions de visiteurs par an. Au cours du temps, elle a su symboliser tour à tour la libération des esclaves et le triomphe de la république à l’issue de la guerre de Sécession (1861-1865), l’accueil des immigrants et le progrès social dans les années 1930, la lutte du « monde libre » et des démocraties libérales contre le totalitarisme pendant la guerre froide, ou encore la résilience de la ville après les attentats du 11-Septembre…
Cadeau de la France aux États-Unis, Lady Liberty incarne aussi le lien entre ces deux pays. Sa construction est imaginée en 1865 par un groupe d’amis français sous la houlette du professeur de droit Édouard de Laboulaye et du sculpteur Auguste Bartholdi, qui souhaitent célébrer la démocratie libérale américaine au lendemain de la guerre de Sécession. Leur projet exprime plus largement leur adhésion aux valeurs des Lumières et, implicitement, une critique du régime impérial de Napoléon III. Il mettra plus de vingt ans à se réaliser. Grâce à la vente de produits dérivés et aux dons du grand public des deux côtés de l’Atlantique, la statue elle-même est financée par la France, son socle par les Américains.
Une amitié franco-américaine compromise par le populisme trumpiste
La commémoration de son inauguration aurait pu donner lieu cette année à une célébration conjointe de l’amitié franco-américaine, d’autant plus qu’une autre date anniversaire se profile en 2026, celle de la Déclaration d’indépendance. Proclamée le 4 juillet 1776, cette dernière aura cette année 250 ans. On sait que la France a été le premier allié déclaré des rebelles nord-américains, dépêchant Lafayette, Rochambeau et l’amiral de Grasse à la tête de 10 000 hommes pour aider les révolutionnaires dans leur combat pour l’indépendance. On aurait donc pu imaginer dans les mois qui viennent des discours, des fleurs et des embrassades sincères devant la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus et devant celle de Bartholdi au cimetière du Montparnasse.
Hélas, les relations entre Paris et Washington se sont dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025. À vrai dire, l’hostilité de la Maison-Blanche ne concerne pas seulement la France, mais toute l’Europe. Les hausses de droits de douane, les désaccords sur le soutien à l’Ukraine et le projet d’achat du Groenland refusé par le Danemark ne sont que les manifestations concrètes d’une remise en cause beaucoup plus fondamentale : la contestation idéologique du modèle libéral hérité des Lumières par le camp populiste MAGA (Make America Great Again) autour du président Trump. À Munich en février 2025, le vice-président J. D. Vance a ainsi dénoncé le « déclin civilisationnel » du Vieux Continent via le « wokisme » et l’immigration, laissant stupéfait le parterre d’Européens auquel il s’adressait.
Affirmer l’espoir de jours meilleurs
Dans ce contexte, les Européens n’ont désormais plus d’autre choix que de se penser seuls. C’est un choc pour certains de nos voisins : ceux qui sont très proches culturellement des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ou ceux qui se perçoivent comme particulièrement vulnérables vis-à-vis de la Russie, tels que la Pologne ou les pays baltes. Ces derniers avaient compris les avancées russes, de l’annexion de la Crimée en 2014 à l’invasion de l’Ukraine en 2022, comme la preuve qu’il fallait absolument maintenir la protection américaine, impliquant un alignement politique et stratégique, l’achat d’armements américains, etc. Le fait que les États-Unis de Trump soient devenus une puissance menaçante pour le Vieux Continent conduit ces mêmes pays européens à modifier en profondeur leur approche sécuritaire.
Cette rupture est sans doute plus facile à penser pour la France, qui a été historiquement habituée aux frictions avec Washington – c’est pour garantir son indépendance qu’elle a, avant même le retour de de Gaulle au pouvoir en 1958, lancé son propre programme de bombe nucléaire. La situation actuelle entraîne en tout cas des propositions inédites. Ainsi, le premier ministre canadien a proposé, lors du sommet de Davos de janvier 2026, que les puissances moyennes s’unissent pour tenir tête aux grandes puissances inamicales ou devenues inamicales. Si l’on considère qu’une telle alliance existe déjà avec l’Union européenne, cette dernière doit désormais avancer résolument dans la voie de la puissance géopolitique.
Mais sans doute faut-il aussi garder à l’esprit que le populisme trumpiste ne sera qu’un moment, peut-être un cycle, de l’histoire des États-Unis. La société civile américaine a connu deux cent cinquante ans de pratique démocratique ininterrompue et compte dans ses rangs une majorité de personnes « décentes ». Ces dernières auront du mal à accepter un glissement durable vers l’illibéralisme et l’agressivité internationale. Tocqueville ajoute encore que les Américains sont finalement peu intéressés par les passions politiques, tendant à se retirer tôt ou tard dans leur sphère privée.
Dès lors, les symboles conservent toute leur importance. Célébrer cette année la statue de la Liberté et les valeurs qu’elle incarne, c’est aussi affirmer l’espoir de jours meilleurs pour les États-Unis comme pour leurs alliés.
Laurence Nardon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 15:58
Défendre la démocratie à Prague : comment un président et 100 000 manifestants ont mis le camp illibéral en échec
Jan Rovny, Professor of Political Science, Centre d’études européennes et de politique, Sciences Po
Texte intégral (2202 mots)
La République tchèque vit depuis octobre 2025 une cohabitation tendue entre le président (aux pouvoirs constitutionnellement réduits) Petr Pavel et le gouvernement illibéral conduit par le milliardaire Andrej Babiš. Cette tension vient de connaître un épisode dont les leçons vont au-delà du seul cas tchèque : appuyé par l’opinion publique, le président a réussi à tenir bon et à empêcher la nomination au gouvernement d’un politicien particulièrement extrémiste.
La semaine dernière, la République tchèque a été le théâtre d’une confrontation politique intense entre le président et le gouvernement, qui a finalement conduit quelque 100 000 personnes dans les rues de Prague.
Ces événements, déclenchés par la tentative de nomination d’un politicien controversé à un poste ministériel, ont incarné un clivage politique typique entre des illibéraux cherchant sans scrupules à dominer la scène politique et des défenseurs de l’ordre démocratique libéral – un clivage qui se décline aujourd’hui sous des dizaines de formes dans les démocraties développées. Les événements de Prague sont remarquables en ce qu’ils montrent comment les démocrates libéraux peuvent l’emporter.
Que s’est-il passé ?
Le cœur du différend réside dans le refus du président tchèque Petr Pavel de nommer Filip Turek, président d’honneur du parti des Motoristes – membre junior de la coalition gouvernementale – au poste de ministre de l’environnement. Turek, homme d’affaires et pilote automobile, est connu pour avoir vendu des médicaments alternatifs contre le Covid, pour collectionner des objets du Troisième Reich et banaliser le nazisme, ainsi que pour une longue série de propos racistes, sexistes et homophobes. Dans sa déclaration de rejet de la candidature de Turek, le président a invoqué l’incompatibilité des opinions et des actes de Turek avec les principes fondamentaux de la Constitution et de l’ordre juridique de la République tchèque.
Le différend s’est intensifié lorsque le chef des Motoristes, le ministre des affaires étrangères Petr Macinka, a critiqué le président Pavel et laissé entendre que lui-même et son parti cesseraient toute communication avec la présidence, limitant ainsi la capacité du chef de l’État à participer aux activités de politique étrangère.
Après une levée de boucliers de l’opposition, l’organisation civique « Un million de moments pour la démocratie » a réagi en appelant à une manifestation de soutien au président Pavel et contre le chantage politique de Macinka. Celle-ci a rassemblé environ 100 000 personnes dans la vieille ville de Prague, le 1er février 2026.
Des sondages d’opinion antérieurs indiquent que plus de 60 % des Tchèques considèrent Turek comme un candidat inapproprié à un poste ministériel, tandis que le président Pavel demeure le responsable politique le plus digne de confiance, avec 58 % de soutien dans l’opinion publique.
Peu après, Petr Pavel a rencontré le premier ministre milliardaire Andrej Babiš qui, sensible à l’opinion publique, a accepté la position du président et appelé à une nouvelle proposition de nomination ministérielle, mettant de facto les Motoristes et le ministre des affaires étrangères Macinka sur la touche.
Quel est le contexte ?
Comme tant de démocraties aujourd’hui, la République tchèque est traversée par un fossé entre, d’un côté, des forces politiques illibérales qui remettent en question les bénéfices de la démocratie libérale, de la coopération internationale et de l’intégration européenne, et, de l’autre, un camp libéral convaincu du caractère irremplaçable de l’ordre démocratique libéral fondé sur l’État de droit et la protection des droits humains et des libertés civiles.
Après les élections législatives d’octobre 2025, un nouveau gouvernement composé de trois partis illibéraux disparates est arrivé au pouvoir — en République tchèque, c’est le gouvernement qui dispose de l’essentiel des leviers de l’exécutif. Toutefois, le président Petr Pavel, général à la retraite qui a battu Andrej Babiš lors de l’élection présidentielle de 2023, constitue un important correctif constitutionnel.
Mais ce gouvernement est un mariage de convenance qui représente déjà un casse-tête pour Babiš. Comme je l’ai soutenu précédemment, son succès électoral pourrait encore s’avérer une victoire à la Pyrrhus. Les trois partis au pouvoir partagent certes une critique illibérale du statu quo ; mais ils divergent sur des points importants.
Le principal parti gouvernemental, ANO (Action des citoyens mécontents), formation technocratique de Babiš, est organisé pour servir de manière opportuniste les intérêts économiques de son dirigeant. Compte tenu des diverses procédures judiciaires visant Babiš, le rôle actuel d’ANO est de garantir le maintien de son immunité parlementaire. Son illibéralisme est donc avant tout stratégique. Sa critique sélective de l’Europe, ses allusions à la migration illégale ou son opposition à la régulation climatique se combinent à un soutien social ciblé à certains segments de la population. Cet illibéralisme modéré mobilise l’électorat d’ANO parmi les votants moins diplômés et ruraux, sans heurter directement les intérêts économiques ouest-européens de Babiš, ses contacts au sein de l’Union européenne (qui incluent le président Macron) ni son modèle économique fondé sur les subventions de l’État et de l’UE.
Le second parti gouvernemental, le SPD (Liberté et démocratie directe), classé à l’extrême droite, est plus dogmatiquement centré sur l’opposition à la migration, à l’internationalisme — en particulier à l’UE, qu’il souhaite quitter — et de plus en plus, aussi, au soutien tchèque à l’Ukraine. Son chef, Tomio Okamura, récemment désigné président de la Chambre basse du Parlement, appelle à donner la priorité aux citoyens tchèques avant tout. Son discours du Nouvel An, dénonçant les initiatives tchèques de soutien à l’Ukraine, qualifiant le gouvernement ukrainien de « junte autour de Zelensky » et affirmant que l’UE se dirige vers une « troisième guerre mondiale », a constitué une gêne pour le gouvernement. Le SPD combine ses appels nativistes avec un soutien social ciblé aux groupes défavorisés dans des domaines tels que les retraites, l’accès au logement abordable et le contrôle du coût de la vie.
Les Motoristes constituent la troisième composante du gouvernement. Fondés par un groupe de conservateurs de droite désabusés, ils combinent des positions économiques libertariennes avec un traditionalisme masculiniste. Ils aiment les gros moteurs thermiques et les faibles impôts. Cette dernière position, toutefois, peut les mettre en porte-à-faux avec leurs partenaires de coalition, dont les politiques sociales nativistes exigent des niveaux de dépenses plus élevés.
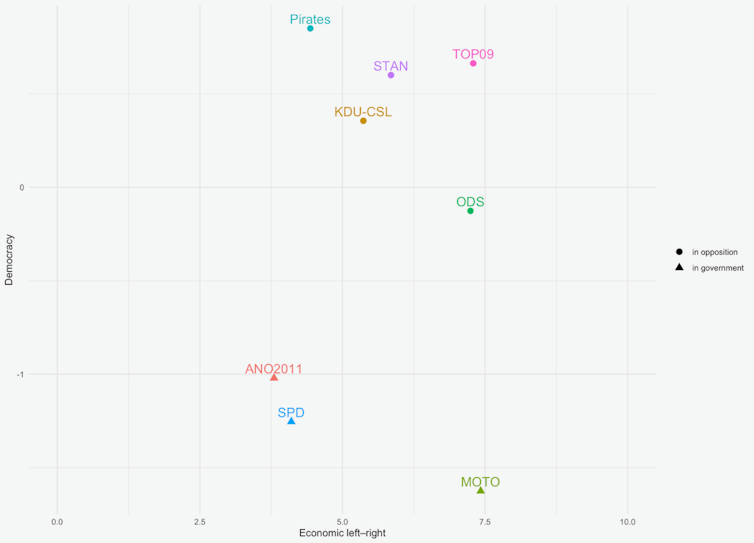
La figure ci-dessus, fondée sur les travaux de l’équipe du Chapel Hill Expert Survey présente les positions des partis gouvernementaux (triangles) et d’opposition (cercles) tchèques en matière de soutien à la démocratie libérale (axe vertical) et de positionnement économique gauche-droite (axe horizontal). Elle montre que l’espace politique tchèque est relativement resserré sur les questions économiques, mais plus dispersé sur la question démocratique. Alors que les formations d’opposition soutiennent clairement les principes constitutionnels libéraux — particulièrement un exécutif contraint et une justice indépendante — du pays (nombre de leurs dirigeants se sont exprimés en faveur du président Pavel), les trois partis gouvernementaux se situent du côté illibéral du spectre — les Motoristes étant en tête sur ce plan (notons que ces données ont été collectées début 2025, avant les dernières élections).
La figure met également en évidence les divisions du gouvernement sur les questions économiques. Alors qu’ANO et le SPD se situent à l’extrémité gauche de l’espace politique tchèque, les Motoristes — qui oscillent entre libertarianisme économique et autoritarisme culturel — comptent parmi les plus à droite.
La fragilité de cette coalition gouvernementale, divisée entre hommes d’affaires en quête de profits, radicaux nativistes et marginaux fascinés par le nazisme, ainsi que sur des priorités économiques fondamentales, a conduit Andrej Babiš à minimiser le conflit politique avec la présidence et à rechercher une remise à zéro politique.
Pourquoi cela importe-t-il ?
Les récents événements à Prague constituent une scène mineure dans le drame des luttes démocratiques qui se jouent aujourd’hui dans la plupart des démocraties développées. La semaine écoulée met toutefois en lumière la manière dont la démocratie peut se protéger contre des tentatives sans scrupules de contournement des normes libérales. La position inébranlable, guidée par la Constitution, des forces politiques de contre-pouvoir, combinée à une mobilisation civique organisée, a laissé les challengers illibéraux sur la touche.
Le président Pavel est resté fidèle à sa ligne tout au long du conflit de nomination, tout en précisant qu’il ne céderait que sur injonction de la Cour constitutionnelle. Son argumentation claire, se référant explicitement à la Constitution et à la jurisprudence constitutionnelle, a rendu toute riposte difficile pour les partisans des Motoristes. Parallèlement, l’organisation civique « Un million de moments pour la démocratie », désormais un groupe aguerri qui avait mené les grandes manifestations contre Babiš en 2019, a développé un maillage efficace et maintenu une large audience à travers le pays. Cela lui a permis de mobiliser 100 000 manifestants à un moment clé, offrant un important soutien populaire au président et forçant la main au premier ministre.
Ce n’est certainement pas le dernier acte de ce drame démocratique, mais un acte qui devrait être étudié par tous les responsables politiques et les citoyens qui continuent de penser que la démocratie libérale — la séparation des pouvoirs politiques et la protection des droits et libertés individuels — est préférable aux alternatives disponibles.
Jan Rovny a reçu des financements de recherche de l'Union Européenne.
09.02.2026 à 08:16
La NFL débarque à Paris : signe avant-coureur d'une américanisation de la « fan experience » en France ?
Boris Helleu, Maitre de conférences, spécialiste de marketing du sport, laboratoire NIMEC, Université de Caen Normandie
Texte intégral (3337 mots)
Les fans français de football américain auront l’occasion d’assister à un match officiel de NFL en octobre prochain en se rendant au Stade de France. Ce sera une première en France, mais la NFL comme les deux autres grandes ligues sportives états-uniennes que sont la NBA (basket) et la MLB (baseball), mais aussi des organisations comme l’UFC (sports de combat) et la WWE (catch), organisent déjà depuis des années des événements majeurs dans de nombreux pays étrangers. Au menu : une « fan experience » pensée dans les moindres détails ; ce modèle américain, désormais accessible régulièrement en Europe et notamment en France, va-t-il se diffuser massivement dans « nos » sports ?
Dans la nuit de dimanche à lundi, les Seattle Seahawks ont remporté la 60e édition du Super Bowl. En octobre 2026, la France accueillera pour la première fois une rencontre de saison régulière de la National Football League (NFL). Si cet événement s’inscrit dans la volonté des ligues nord-américaines de globaliser leur marque, assiste-t-on pour autant à une américanisation de l’expérience du fan ?
Le 2 février, la NFL a annoncé que les Saints de la Nouvelle-Orléans disputeront un match au Stade de France. Cette ligue a déjà organisé plus de 60 matchs de saison régulière en dehors des États-Unis (Londres, Berlin, Munich, Francfort, Madrid, Dublin, São Paulo, Mexico City, Toronto). Ces rencontres officielles s’inscrivent dans le calendrier des International Series, qui visent à générer de nouveaux revenus commerciaux et à développer de nouvelles fanbases locales dans de grandes villes de par le monde.
La NFL estime que la France est son troisième marché européen avec 14 millions de fans potentiels, derrière l’Allemagne (20) et le Royaume-Uni (19), mais devant l’Espagne (9). La franchise de Louisiane, ancienne colonie française, dispose des droits marketing internationaux en France depuis 2023 dans le cadre du programme Global Market ; autrement dit, elle exerce une forme d’exclusivité en France pour y développer son image de marque. Ainsi, à l’été 2025, une partie de l’équipe s’est déplacée en France pour y renforcer sa présence. Un partenariat stratégique a notamment été conclu avec les Musketeers de Paris qui évoluent dans l’European League of Football.
Le match de l’automne prochain est organisé avec le concours de l’entreprise française d’événementiel GL Events (qui a décroché la concession de l’exploitation du Stade de France en juin 2025), avec le soutien du ministère des sports, de la Fédération française de football américain (FFFA) et de collectivités locales. Selon Brett Gosper, directeur Europe et Asie-Pacifique de la NFL :
« C’est un mini Super Bowl ! On l’appelle comme ça, sans trop en promettre. On essaie de faire le maximum pendant la semaine. Parfois, les équipes arrivent cinq jours avant, ça aide aussi. Les activités dans le centre-ville sont importantes, surtout pour le premier match. Et puis, pour le show de la mi-temps, espérons que ce sera un ou une grand·e artiste. »
En somme, ce n’est pas simplement une rencontre sportive qui sera exportée à Paris, mais une autre façon de voir et vivre un match.
La Fan Experience : un concept académique
La fan experience est l’adaptation au domaine du sport de la notion d’expérience client applicable à divers domaines comme l’hôtellerie ou encore la SNCF. Elle est capitale dans l’industrie du spectacle sportif. Ainsi, Roger Goodel, le grand patron de la NFL, avait-il dès 2017 écrit aux fans pour expliquer comment il songeait améliorer la Fan Experience. Mais la prise en compte de cette Fan Experience dépasse le cadre des États-Unis.
En France, en ce début d’année, l’association Sporsora, qui regroupe les grands acteurs français du sport business, a publié une étude dédiée à l’expérience spectateur. En 2023, le Pôle ressources national sport-innovations du ministère chargé des sports publie une notice intitulée « La “Fan Experience”, outil incontournable des stratégies de développement numérique des acteurs du sport ». Bref, la Fan Experience est partout ; mais elle est aussi un objet d’étude prisé des universitaires spécialistes de marketing du sport.
Ces derniers considèrent que le spectacle sportif n’est pas un bien de consommation comme les autres. Il tire sa singularité de son caractère intangible et imprévisible. En effet, le match est co-produit par des équipes, spectateurs et médias et se consomme et fur et à mesure de sa production. De fait, il génère un bénéfice client de tout autre nature qu’un produit classique. On y recherche excitation, socialisation et évasion sans vraiment savoir si on va assister à un beau match ou si l’équipe qu’on encourage va gagner.
Aussi attractif que soit ce caractère imprévisible, il constitue un défi pour l’organisateur, qui ne peut se contenter de faire reposer la satisfaction de sa clientèle sur un match à l’issue incertaine. Si le match demeure au cœur de l’expérience de consommation, il est nécessaire d’optimiser la qualité de services périphériques (accueil, animation, restauration…) et ainsi, même en cas de défaite, inciter les spectateurs à revenir. Autrement dit, la satisfaction des fans ne repose pas seulement sur la qualité du match ou son issue, mais plus certainement sur la qualité du service.
Dans une étude de 1994 consacrée à la stratégie marketing employée par les franchises NBA pour favoriser les affluences, les auteurs ont identifié 21 techniques. Selon eux, avoir une équipe victorieuse n’est pas forcément ce qui conditionne la venue au stade (même si ça aide !). D’autres chercheurs ont entrepris de différencier la part de la satisfaction des fans qui provient de la qualité du service et celle qui résulte du match. Leur étude, menée au Japon et aux États-Unis, établit un lien puissant entre l’ambiance du match et la satisfaction des fans, laquelle dépend également du personnel du stade et de la facilité d’accès aux services. Dans un article intitulé « Marketing expérientiel et analyse des logiques de consommation du spectacle sportif », les auteurs montrent comment la consommation de spectacles sportifs est façonnée par la recherche d’expériences vécues qui relèvent, les uns comme les autres, de variables individuelles (recherche de sensations, recherche d’esthétisme, besoin de stimulation, implication…) et des variables sociales (recherche d’interactions spectateur/joueur, spectateur/personnes proches…).
La littérature académique a donc conçu de nombreux modèles de l’expérience de consommation des fans. On considère que le produit « match », détaillé en services de qualité, va procurer une bonne expérience émotionnelle, générer de la satisfaction, de la loyauté et de la recommandation. Une étude identifie 11 items classés en trois principales catégories : qualité des interactions (agents de sécurité, buvette, joueurs) ; qualité de l’environnement (interactions sociales, sons et lumières, accessibilité, propreté, places, configuration du stade) ; et la qualité de l’issue du match (ambiance, qualité de la rencontre, divertissements). La fan experience, concept central du marketing du sport, désigne donc l’ensemble des interactions vécues par un spectateur avant, pendant et après un match. Bref, la satisfaction du fan ne repose pas seulement sur la victoire de son club préféré, mais aussi sur la qualité des services périphériques : accueil, restauration, animation, confort, expérience numérique (détaillée ici en 2023) etc.

Ce que Paris peut apprendre de Londres
Olivier Ginon, président du Groupe GL Events qui organisera le match au Stade de France, explique :
« Accueillir le premier match NFL à Paris au Stade de France reflète une ambition partagée et illustre notre capacité à rassembler différentes cultures sportives, à garantir une excellence opérationnelle et à positionner Paris et la France comme une destination de choix pour les plus grands événements sportifs mondiaux. »
Mais, à ce jour, la capitale européenne du sport US est Londres. Si Paris accueille depuis peu des rencontres de NBA (en 2020 puis chaque année depuis 2023), Londres dispose d’une solide expérience dans l’organisation de rencontres de NBA, NFL et MLB. S’appuyant sur la longue histoire de sa relation avec le Royaume-Uni, la NFL y a organisé une quarantaine de matchs depuis 2007 aux stades de Wembley, Twickenham et Tottenham, mobilisant de 60 000 à 86 600 spectateurs selon la capacité des enceintes.
Le stade de Tottenham a d’ailleurs été conçu par le cabinet d’architectes américain Popoulous, qui s’est inspiré de stades états-uniens en prévoyant une pelouse synthétique rétractable, ce qui a permis au club de signer un partenariat de dix avec la NFL pour accueillir deux matchs par an. Après avoir délocalisé des rencontres au Mexique, au Japon et en Australie, la ligue de baseball (MLB) a organisé des matchs de saison régulière en 2019 puis en 2023 et en 2024 au London Stadium, pour des affluences allant de 55 000 à 59 600 spectateurs par match. Dans le même temps, la MLB a renoncé à organiser des rencontres à Paris en 2025.

Au-delà des rencontres, les ligues états-uniennes investissent la capitale britannique en mettant en place des animations à Trafalgar Square, Piccadilly ou encore Regent Street. L’objectif est double : séduire les fans européens et offrir aux Américains expatriés ou en voyage une expérience fidèle à celle des États-Unis.L’idée est de faire vivre aux fans une expérience authentique en concevant une rencontre telle qu’on pourrait la vivre aux États-Unis. Ce faisant, les organisateurs contentent tout à la fois des fans européens venus éprouver l’expérience d’un match comme aux États-Unis et les fans nord-américains qui ont fait le déplacement. Les premiers sont là pour voir un match NFL, les seconds pour encourager leur équipe dans des conditions similaires qu’à la maison.
Les organisateurs s’assurent d’ailleurs, lors d’enquêtes de satisfaction, que le public présent a apprécié les activités proposées (course des mascottes, hymnes nationaux, musique, effets pyrotechniques, spectacle de mi-temps…). La NFL connait un tel succès à Londres que Roger Goodel a évoqué la possibilité d’y organiser un jour un Super Bowl.
Une américanisation du spectacle ?
En octobre 2020 paraît dans le journal suisse Le Temps un article intitulé « La revanche du sport américain : comment “aller au stade” est devenu “partager la fan experience” ». On y lit_ :
« Si les Américains ne parviennent pas à mondialiser leurs sports, ils sont en train d’exporter leur vision du sport-spectacle, que l’on pourrait définir comme un acte de consommation, massive mais passive, du produit d’un secteur de l’industrie du divertissement. […] Depuis une dizaine d’années, la transformation du langage a mis des mots sur ce phénomène d’américanisation de la culture sportive “à l’européenne”. Aller au match est devenu “vivre la fan experience”. »
Trois ans plus tard, dans le média en ligne Konbini, une journaliste relate son expérience d’un match de NFL délocalisé à Londres. L’article est intitulé « J’ai passé le week-end aux États-Unis à essayer de comprendre quelque chose au foot US (mais j’étais à Londres) ». Il faut alors se demander si les modalités de consommation du spectacle sportif s’uniformisent sous l’effet d’une américanisation définie comme une forme particulière de globalisation culturelle dans laquelle les normes et valeurs issues des États-Unis s’imposeraient au niveau international, ou relèvent plutôt d’une forme de glocalisation, c’est-à-dire de l’adaptation de stratégies d’internationalisation aux contextes locaux.

Parler d’américanisation de la consommation de spectacle sportif en Europe paraît abusif. Toutes les bonnes pratiques identifiées dans des rencontres de sport US ne se diffusent pas dans les sports européens. Au-delà de raisons culturelles, logistiques (configuration des stades), il faut considérer que si les événements sportifs européens et américains relèvent du domaine du divertissement, ils sont des produits totalement différents.
Un match de Premier League (deux mi-temps) va durer en moyenne 114 minutes pour 51 % de temps de jeu effectif. Un match NFL (quatre quarts-temps) dure en moyenne 208 minutes pour 8 % de temps de jeu effectif. Un match de baseball (neuf manches) dure en moyenne 225 minutes pour 10 % de temps de jeu effectif. Aussi, les diverses animations habillant une rencontre de sport américain n’apparaissent pas transposables au football européen. Aussi, ce qui est perçu comme une américanisation du sport européen n’est pas tant l’adoption d’animations, musiques ou nourritures existant outre-Atlantique, mais plutôt la prise en compte systématique des variables de l’expérience fan avant, pendant et après le match.
Boris Helleu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.02.2026 à 14:18
La stratégie numérique de l’armée ukrainienne : une mobilisation 2.0
Léo-Paul Barthélémy, Doctorant en sciences de l'information et de la communication, CREM, Université de Lorraine, Université de Lorraine
Texte intégral (3273 mots)
Face à la pression russe, et alors que la guerre totale entame sa cinquième année, l’Ukraine a un besoin constant d’alimenter son armée en hommes et en financements. Elle met en place à cette fin une stratégie numérique extrêmement moderne, à l’esthétique soignée, et non dénuée d’aspects ludiques.
Alors que 2026 marque pour l’Ukraine sa cinquième année de résistance face à l’invasion à grande échelle russe et sa treizième depuis le début de la guerre, les efforts de l’armée ukrainienne se maintiennent et évoluent, avec un appui continu de la société et des partenaires internationaux.
Mais le recrutement, la minimisation des désertions et l’attrait de dons privés, venant d’Ukraine comme de l’étranger, restent des enjeux majeurs. Pour cela, l’armée ukrainienne puise dans de nombreux registres communicationnels, spécialement ceux que connaissent et apprécient les jeunes générations. Entre simplification, esthétisation et gamification, différents moyens sont employés.
Une société connectée
La société ukrainienne est aujourd’hui l’une des plus connectées au monde : près de 96 % de la population possède des compétences numériques. Devenue un véritable hub technologique, toute l’Ukraine, de la société civile à l’armée, en tire profit.
La nomination de Mykhaïlo Fedorov à la tête du ministère de la Défense en janvier 2026 illustre bien cette imbrication : auparavant, il a occupé les postes de vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique. C’est d’ailleurs ce second ministère qui a propulsé l’application civile Diia, en 2020, qui regroupe les services gouvernementaux et les documents dématérialisés. Entre 2018 et 2024, l’Ukraine est passée de la 102e à la 5e place mondiale pour le niveau de développement des services publics numériques, selon l’Online Service Index de l’E-Government Development Index des Nations unies.
Cet élan se retrouve aussi du côté de l’armée, avec le portail Digital Army, une entreprise d’État qui regroupe des initiatives civiles, privées et militaires dans le but de créer un écosystème qui développe des solutions technologiques pour le secteur de la défense et l’armée.
Elle met en réseau des développeurs, des ingénieurs, des entreprises, des industriels et des partenaires internationaux.
En outre, les autorités mettent à la disposition du grand public deux applications : Army+ aide les militaires à régler plus rapidement les formalités administratives, et Reserve+ simplifie le recensement de données des personnes soumises à l’obligation militaire, qu’elles soient conscrites ou réservistes.
Esthétisation de la communication de guerre
Les images sont toujours au cœur des campagnes de communication, y compris celles militaires. Même les formats les plus traditionnels, tels que l’affichage, n’échappent pas à cette règle. En contexte de guerre, ces images sont même essentielles pour attirer l’œil. Les unités recourent à des opérations-séduction par l’affichage pour maintenir un cap de recrutement qui correspond à leurs attentes.

Ces publicités, que l’on peut retrouver à peu près dans toutes les villes ukrainiennes, ne sont pas en reste par rapport aux autres canaux, alors que la question de la mobilisation et du recrutement est sensible dans le pays. Ici, les affiches invitant à rejoindre l’armée bénéficient d’une véritable esthétisation et d’une communication professionnelle et se fondent parmi les publicités des marques de luxe aux alentours.
Elles ne sont en réalité qu’un premier point de contact vers des informations dématérialisées, qui se prolongent dans l’espace numérique. Ainsi, on retrouve quasi systématiquement un QR code et l’adresse d’un site Web, incitant les passants à en découvrir davantage avec un call-to-action accompagné d’accroches publicitaires fortes.
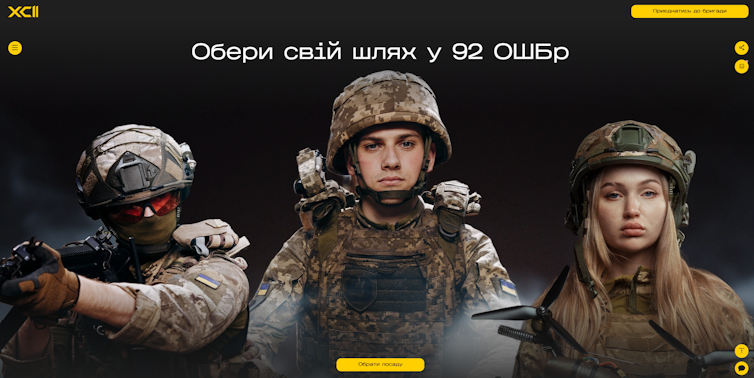
Ces sites Web sont tout aussi travaillés, avec de belles typographies modernes, des photographies éditées et une interface utilisateur simple d’accès. Les témoignages et clips promotionnels ajoutent une dimension humaine pour inciter au recrutement. Très souvent, les éléments discursifs jouent sur l’unité, la camaraderie, l’engagement, la solidarité, la liberté de choisir son poste ou encore l’expérience unique. Les foires aux questions, les réseaux sociaux et les formulaires sont systématiquement mis en évidence lors de la navigation pour inciter les internautes à prendre contact.
Mobilisation citoyenne, mobilisation militaire
Penser l’armée ukrainienne nécessite une vision élargie à la société ukrainienne dans son ensemble, qui se mobilise au pays et à l’étranger en redoublant de créativité et d’innovation pour pallier les difficultés rencontrées par les militaires.
Les réseaux sociaux, souvent mentionnés pour leurs enjeux informationnels, sont aussi de puissants catalyseurs coercitifs et unificateurs. Les moyens d’incitation ne manquent pas pour aider les forces armées, qui recourent à diverses techniques pour lever des fonds ou récupérer du matériel. D’innombrables projets participatifs de type crowdfunding, souvent citoyens et non endossés officiellement par l’armée, étoffent l’effort de guerre, tel que SignMyRocket, par exemple, qui a permis aux donateurs de recevoir une photo d’un obus signé avec un message personnel en échange d’un don.
Soucieuse de la transparence de ces campagnes, la fondation Sternenko, acteur majeur du crowdfunding militaire ukrainien qui fournit des équipements, dont des drones, propose de nombreux rapports détaillés sur la façon dont les dons des citoyens sont mobilisés pour l’armée. À ces opérations s’ajoutent de tout aussi importantes levées de fonds orchestrées par la diaspora ukrainienne, qui soutient logistiquement ou financièrement son armée, même à distance, avec des événements culinaires, musicaux, folkloriques, du merchandising, des flashmobs, des campagnes de sensibilisation, etc.
Par ailleurs, il n’est pas rare de voir des jeux-concours sur des canaux Telegram pour inciter les citoyens à participer aux collectes. Celles-ci, à la durée et à la fréquence variables, permettent de maintenir indirectement le focus sur l’Ukraine. Au-delà de l’argent récolté, c’est aussi l’occasion pour les organisateurs de rappeler dans les sphères médiatiques internationales que la guerre continue et qu’elle ne perd pas en intensité, tant s’en faut.
Une « drone » de guerre compétitive
Incontournables, les drones occupent une place centrale dans la guerre en Ukraine, que ce soit pour les attaques, les opérations de reconnaissance ou encore de ravitaillement. De ce fait, les Forces de systèmes sans pilote (abrégées СБС, soit SBS, en ukrainien) ont créé un « killboard », un tableau qui affiche en temps quasi réel les statistiques de destructions opérées par les différentes unités : soldats ennemis, mais aussi véhicules blindés, motos, radars ou systèmes d’artillerie, liste non exhaustive. Cette initiative illustre ce qu’est la « gamification » de la guerre, à savoir le recours à des mécanismes de jeu dans des environnements non ludiques. Le site est également proposé en anglais pour toucher un public international, avec un lien qui renvoie vers la plate-forme de recrutement du SBS.
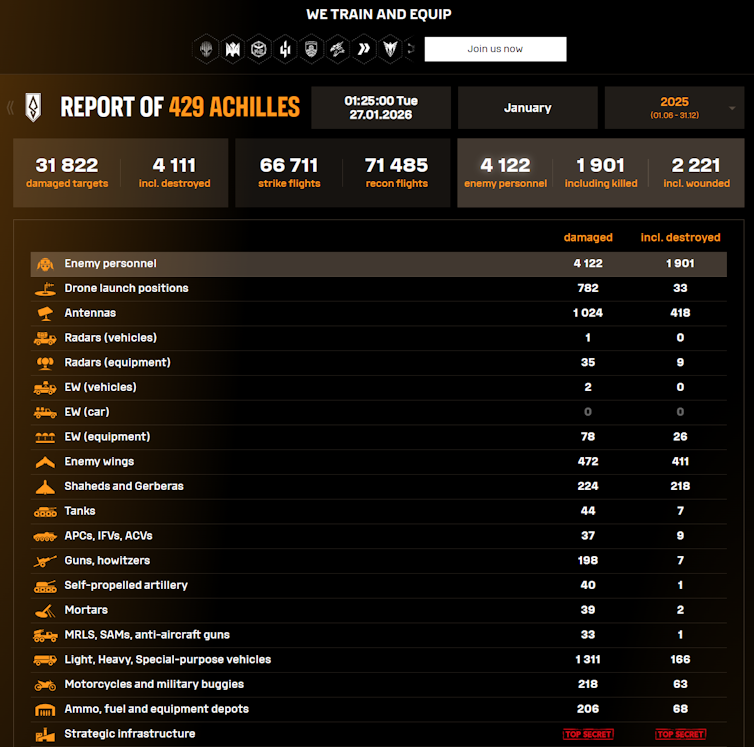
Fleuron de la défense ukrainienne, la plate-forme gouvernementale Brave1 propose depuis 2023 une collaboration entre partenaires, investisseurs et entreprises pour développer l’industrie militaire. Elle fournit des subventions à des projets en phase de R&D, tout en facilitant l’approbation de technologies aux normes, telles que le NATO Stock Number.
Dans cette même logique de ludification, elle s’est étendue avec un marché qui « ressemble à Amazon » et qui connecte directement les fabricants, les développeurs et les unités militaires.
En parallèle, l’armée ukrainienne a lancé le programme « Army of Drones Bonus », soit un système d’e-points utilisables sur Brave1 Market : plus une unité neutralise de cibles (humaines ou matérielles), plus elle gagne de points, et plus elle peut donc les échanger contre des équipements, comme le désormais célèbre drone Baba Yaga.
Avec ce système compétitif, les autorités s’octroient un moyen de motivation pour les troupes tout en rétribuant celles qui contribuent le plus aux efforts défensifs. Les points varient en fonction de la nature de l’attaque : soldat capturé ou tué, tank détruit ou encore élimination d’un pilote de drone ennemi. Il ne s’agit pas de transformer la guerre en jeu, mais cela montre indirectement qu’elle est désormais conduite via des écrans et des algorithmes. Un reportage de la BBC soulignait des retours mixtes de la part des soldats sondés sur ce système : certains estiment que le système est bien pensé pour motiver les troupes, tandis que d’autres jugent que cela ne suffit pas pour lutter contre les désertions.
Dans le même esprit, United24, plateforme gouvernementale de donation pour l’Ukraine, propose au sein de son application un système de financement participatif où les donateurs peuvent suivre les unités qu’ils financent. L’enjeu communicationnel est ici clair : les donateurs sont embarqués au plus près du front au quotidien pour découvrir l’impact de leur soutien financier – témoignages, photos, vidéos ou encore messages de remerciements personnalisés.
Les bienfaiteurs peuvent ainsi choisir l’unité qu’ils souhaitent soutenir. Un classement, cette fois-ci côté donateur, permet une compétition amicale pour voir qui contribue le plus et inciter à aider davantage. De plus, les utilisateurs ont un profil personnalisé, avec un rang, un indicatif et un avatar. Les éléments de langage ne manquent pas pour inciter la communauté à agir, allant jusqu’à qualifier les donateurs de « digital defenders ». Plus qu’un don financier, c’est un combo donnant-donnant qui est ici présenté.
La guerre se matérialise également au travers du jeu vidéo. Très populaires, les drones FPV (first-person view) sont proposés via des simulateurs, à l’exemple du jeu Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) développé par des Ukrainiens et qui tient compte de l’expérience réelle de combat.
Bien que ce jeu n’ait pas été créé directement par l’armée, il montre l’hybridation entre les données captées sur le front et un format ludique, ce qui peut, on l’imagine, susciter une sensibilisation chez les joueurs quant au rôle de ces drones qui dominent le champ de bataille.
D’aucuns vont encore plus loin, à l’instar de la 3e brigade d’assaut, qui a déployé son initiative Killhouse Academy, en proposant des formations d’entraînement, sur place, ouvertes principalement aux civils et aux militaires ukrainiens, notamment pour apprendre à piloter des drones avec la remise d’un certificat. Ce dernier peut servir autant de souvenir que de justificatif de compétences acquises pour l’armée, certaines unités requérant une preuve de capacité en amont pour manier les drones.
Une logique de recrutement et de motivation avant tout
Toutes ces stratégies servent des objectifs clairs : soutenir le développement de l’armée, maintenir un flot continu de recrues, mais aussi booster le moral en luttant contre la fatigue de guerre, dans un contexte où un nombre relativement important de conscrits potentiels cherchent par divers moyens à échapper à l’obligation de servir sous les drapeaux. Outre les recrutements dans les centres prévus à cet effet, ces leviers numériques et cette communication esthétisée permettent d’attirer aussi bien de nouveaux soldats que de nouveaux partenaires, y compris à l’international. Les contenus web de certaines brigades, ainsi que des sites opérés ou soutenus par celles-ci, sont d’ailleurs prévus à cet effet, avec des traductions multilingues, comme le montre par exemple la capture d’écran présentée plus haut.
Dans une guerre résolument hybride qui se manifeste plus que jamais dans le cyberespace, les autorités et les forces armées ukrainiennes travaillent de concert avec la société civile et leurs partenaires pour maintenir un équilibre défensif cohérent. Alors que les négociations diplomatiques s’essoufflent en ce début 2026, l’armée ukrainienne sait qu’elle doit poursuivre ses efforts d’attractivité face à l’invasion russe. Il en va de la capacité de résistance de l’Ukraine et de son peuple.
Léo-Paul Barthélémy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.02.2026 à 17:52
Alors que le droit international est à un « point de rupture », un petit pays s’en prend seul à la junte du Myanmar
Emma Palmer, Associate professor, Griffith University
Texte intégral (1416 mots)
Face aux limites des juridictions internationales, le Timor-Leste choisit la compétence universelle pour viser les dirigeants de la junte birmane.
Il y a à peine quatre mois, le Timor-Leste est devenu officiellement membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Cette semaine, le pays a franchi une étape sans précédent : ses autorités judiciaires ont désigné un procureur chargé d’examiner la responsabilité de l’armée du Myanmar dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il s’agirait de la première fois qu’un État membre de l’Asean engage une telle procédure contre un autre pays du bloc.
La démarche résulte de l’action d’un collectif de victimes, la Chin Human Rights Organisation, qui cherche à obtenir justice pour le peuple chin, une minorité du Myanmar. Lors du dépôt de la plainte, la dirigeante de l’organisation a tenu à saluer et soutenir les efforts historiques du Timor-Leste en faveur de la justice et de l’indépendance.
Les autorités du pays vont désormais déterminer s’il y a lieu d’engager des poursuites contre les dirigeants militaires du Myanmar, dont le chef de la junte, Min Aung Hlaing. Toute éventuelle procédure reposerait sur le principe de la « compétence universelle », qui permet à des juridictions nationales de juger des crimes internationaux, quels que soient le lieu où ils ont été commis, ainsi que la nationalité des victimes ou des auteurs présumés.
Limites des juridictions internationales
Cette semaine, une étude portant sur 23 conflits dans le monde a conclu que le système juridique international destiné à protéger les civils est arrivé à un « point de rupture ». La question de l’avenir même des Nations unies est également posée.
L’efficacité des juridictions internationales pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité est limitée. La Cour pénale internationale (CPI) est critiquée pour des poursuites sélectives, sa lenteur et la faiblesse de ses moyens d’exécution. En vingt ans, la Cour a examiné 34 affaires et rendu 13 condamnations.
Les défenseurs de la Cour estiment toutefois qu’elle fait l’objet de critiques et d’attaques injustifiées, notamment de la part de l’administration Donald Trump, qui lui a imposé des sanctions l’an dernier.
La Cour internationale de justice (CIJ) peut, de son côté, engager la responsabilité des États pour des crimes, mais non celle des individus. La Cour pénale internationale (CPI) et la CIJ ont toutes deux ouvert des procédures concernant le Myanmar, mais celles-ci portent sur des crimes présumés commis contre la minorité rohingya avant le coup d’État. L’enquête de la CPI concerne en partie des faits commis au Bangladesh.
En novembre 2024, le procureur en chef de la CPI a demandé aux juges de la Cour de délivrer un mandat d’arrêt contre le chef de la junte, Min Aung Hlaing. Plus d’un an plus tard, aucune décision n’a encore été rendue.
Des défis pour les juridictions nationales
Dans ce contexte, la compétence universelle pourrait jouer un rôle plus important. Les Nations unies l’ont implicitement reconnue en mettant en place des mécanismes d’enquête pour la Syrie et le Myanmar, chargés de collecter des preuves en vue de poursuites ultérieures devant des juridictions nationales, régionales ou internationales.
De nombreux États disposent de lois leur permettant de poursuivre des crimes internationaux tels que la torture, le génocide ou les crimes de guerre. Ce qui fait défaut, ce sont les ressources nécessaires au financement des enquêtes, ainsi que des critères ou des lignes directrices clairs et transparents pour leur mise en œuvre.
D’autres difficultés apparaissent une fois les procédures engagées. Les juridictions nationales disposent d’une portée limitée. Les arrestations sont difficiles : les hauts responsables peuvent invoquer l’immunité diplomatique ou éviter les pays où ils risquent des poursuites ou une extradition.
Même les poursuites visant des responsables de rang intermédiaire peuvent poser des difficultés politiques. Les procédures sont coûteuses et lourdes, en particulier lorsque les témoins et les preuves se trouvent majoritairement à l’étranger.
L’ampleur et la complexité de ces crimes constituent enfin un défi pour les juridictions pénales nationales, souvent peu expérimentées dans le traitement de ce type d’affaires.
Même si des procès sont engagés, les victimes peuvent continuer à éprouver un sentiment d’injustice, y compris lorsque les procédures ont une portée stratégiques ou symboliques.
Des succès existent toutefois. Il y a près de dix ans, l’ancien président du Tchad, Hissène Habré, a ainsi été condamné pour des crimes internationaux au Sénégal. L’affaire a été jugée sur le fondement de la compétence universelle, sous l’impulsion de réseaux issus de la société civile.
D’autres États appelés à agir
Cette nouvelle initiative du Timor-Leste intervient après d’autres démarches menées par des groupes de victimes dans plusieurs pays afin d’obtenir justice pour la population du Myanmar : notamment en Argentine, où des mandats d’arrêt ont été délivrés contre des dirigeants birmans, ainsi qu’en Turquie et en Allemagne. Dans la région Asie-Pacifique, des avocats ont également tenté d’engager des poursuites en Indonésie et aux Philippines.
Alors que les pays européens recourent de plus en plus souvent à la compétence universelle pour poursuivre des crimes internationaux, d’autres États se montrent plus réticents. Certains estiment ainsi que le Canada et l’Australie pourraient faire davantage pour enquêter sur les crimes de guerre, alors même que leurs cadres juridiques le permettent. Cette situation reporte l’essentiel du travail judiciaire sur d’autres juridictions, parfois dotées de moyens plus limités.
Alors que des atrocités continuent d’être commises dans le monde, il devient plus que jamais nécessaire que les gouvernements ne se contentent pas d’un soutien de principe à la justice internationale, mais démontrent un engagement concret en menant des enquêtes sur leur propre territoire.
Emma Palmer est lauréate d’un Australian Research Council Discovery Early Career Award (projet n° DE250100597), financé par le Gouvernement australien. Les opinions exprimées ici sont celles de l’autrice et ne reflètent pas nécessairement celles du Australian Research Council. Elle est également affiliée à l’Association of Mainland Southeast Asia Scholars.
05.02.2026 à 16:34
Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Texte intégral (2359 mots)
Onéreux, contraints par le réchauffement climatique, survalorisant les pays riches du Nord : au moment où l’Italie de Giorgia Meloni ouvre les JO d’hiver 2026, dans un contexte marqué notamment par les contestations de la présence d’agents de l’ICE (la fameuse police de l’immigration des États-Unis) et par la polémique désormais récurrente sur l’absence des sélections nationales russe et biélorusse, le grand événement hivernal quadriannuel est confronté à de nombreuses crises internationales…
Les XXVe Jeux olympiques (JO) d’hiver seront bien plus que sportifs !
Comme les autres grandes compétitions sportives internationales fortement médiatisées, à l’instar de la récente Coupe d’Afrique des nations de football au Maroc ou de la Coupe du monde de l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ils seront géopolitiques, malgré leur neutralité politique officielle.
De même que les éditions précédentes des JO estivaux comme hivernaux, les XXVᵉ Jeux olympiques d’hiver mettront aux prises les stratégies de soft power des États-Unis (232 athlètes en Italie), de la Chine (125 athlètes) et de leurs rivaux (120 athlètes japonais et 71 de Corée du Sud). Comme pour les JO d’été, le palmarès des médailles sera considéré comme un attribut de puissance.
Organisés par la ville de Milan et la station de montagne de Cortina d’Ampezzo du 6 au 22 février 2026, ils constituent déjà un enjeu international, comme en attestent les nombreuses polémiques qu’ils ont déjà générées : le déploiement en Italie du service états-unien de lutte contre l’immigration, Immigration and Customs Enforcement (ICE), fait débat en Europe, car il est autorisé par un gouvernement Meloni proche de la présidence Trump ; les « éléphants blancs » – ces infrastructures sportives édifiées spécialement pour l’événement et qui risquent de ne plus être utilisées une fois les JO passés –, coûteux financièrement et écologiquement, défraient une nouvelle fois la chronique et irritent les opinions européennes, soucieuses de protection de l’environnement ; en outre, l’apparition dans l’affaire Epstein du nom de Casey Wasserman, président du Comité d’organisation des prochains JO d’été, qui se tiendront à Los Angeles en 2028, suscite le trouble ; classiquement, l’exclusion de la compétition des comités olympiques russe et biélorusse est au centre de l’attention, ainsi que la participation d’un contingent de neuf Israéliens, qui a déjà donné lieu à diverses actions de protestation ; enfin, les autorités italiennes sont vigilantes dans le cyberespace pour éviter intrusions, disruptions et sabotages. Autrement dit, des risques hybrides pèsent sur la très théorique trêve olympique.
Aussi importantes soient-elles, ces polémiques ne donnent pas la mesure des enjeux géopolitiques structurels propres aux Jeux olympiques d’hiver. Ceux-ci sont aujourd’hui confrontés à plusieurs défis mondiaux proprement politiques. Certains sont communs avec les JO d’été et les grandes Coupes du monde (bonne gouvernance, empreinte environnementale, exploitation commerciale, etc.). D’autres leur sont spécifiques : sous le blanc des pistes de ski et de patinage, le feu de la géopolitique contemporaine couve.
Une compétition condamnée à court terme par le réchauffement climatique et les transformations sociétales ?
La viabilité des Jeux olympiques d’hiver est aujourd’hui remise en cause non seulement par les militants écologistes, mais aussi par les citoyens et les édiles des villes potentiellement candidates à l’organisation de ces compétitions.
Non seulement les domaines skiables traditionnels s’amenuisent en Europe, terre de naissance des sports d’hiver, mais en outre, le Comité international olympique (CIO) a parfois bien du mal à recueillir suffisamment de candidatures pour accueillir la compétition en raison de son empreinte environnementale, de son coût financier et de son impact sociétal.
Comme les hôtes de ces événements sont des villes et non des États, la dimension locale est essentielle. Et le prestige des JO d’hiver éclipse de moins en moins leurs coûts environnementaux. En conséquence, les villes candidates sont désormais souvent de très grandes cités éloignées des montagnes : Sotchi en 2014, Pékin en 2022. Comme si les JO d’hiver pouvaient d’affranchir du climat et de la géographie !
Rareté de la neige, inquiétudes écologiques, réticences citoyennes et municipales, etc. : tout concourt à rendre obsolètes les Jeux d’hiver. Ils apparaissent comme une débauche financière et écologique très « XXᵉ siècle » et très « Trente Glorieuses ».
Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de ne pas devenir les otages des débats internationaux entre climatosceptiques et climato-anxieux. Et, inversement, de trouver ce qui, dans l’esprit olympique d’hiver, est adapté aux aspirations des populations locales, de la Gen Z et du grand public en général : respect de la nature, pratique sportive de plein air, valorisation du local… À défaut, ils fondront comme neige au soleil. Les villes organisatrices sauront-elles dépasser le simple greenwashing ou plus exactement le snow-washing ?
Les JO d’hiver, un monde sans le Sud et sans la Russie (depuis 2018) ?
Le deuxième défi international des JO d’hiver est leur représentativité internationale, qui est contestée.
Créés à Chamonix en 1924, soit plus de vingt ans après les JO d’été, ils ont longtemps été une vitrine pour les sélections européennes, concurrencées par d’autres pays de l’hémisphère Nord – États-Unis, Russie et Canada, puis Japon et enfin Chine et Corée. Pour le géopoliticien, ils conservent une tonalité très « guerre froide », notamment marquée par les affrontements entre sélections états-uniennes, canadiennes et soviétiques sur la patinoire de hockey sur glace.
Malgré la première participation d’athlètes du Bénin, des Émirats arabes unis et de Guinée-Bissau aux JO 2026, les sportifs du Sud global sont largement sous-représentés. En outre, plusieurs athlètes en provenance du Nord sont sélectionnés par des pays du Sud.
Les JO d’hiver semblent difficilement pouvoir remplir la mission olympique de contribuer au dialogue sportif mondial quand une bonne partie de l’humanité n’y est pas représentée. La mission revendiquée par le CIO de « promouvoir la paix (§ 4 des missions du CIO selon la Charte olympique) est aujourd’hui précaire tant les délégations du Sud sont réduites au symbole.
À cette division géographique et climatique s’ajoute, depuis plusieurs éditions, une fracture économique : les sports d’hiver sont onéreux, pour les pratiquants amateurs comme pour ceux de haut niveau. L’esprit olympique est, là aussi, écorné, car il est particulièrement difficile de faire des JO d’hiver un instrument du « sport pour tous » (§ 13 des missions du CIO selon la Charte olympique).
La représentativité internationale de l’événement est devenue encore plus contestée depuis l’exclusion du comité olympique russe pour les trois dernières éditions des JO d’hiver et du comité olympique biélorusse depuis deux éditions. Les scandales de dopage, la répression de l’opposition interne puis l’invasion de l’Ukraine ont conduit le CIO à n’admettre que des participations individuelles de ressortissants russes et biélorusses. Cela crée pour les anciennes Républiques socialistes soviétiques (RSS) en tension avec Moscou et Minsk une fenêtre d’opportunité. En Italie, les sélections nationales de l’Estonie (32 athlètes), de la Lettonie (67 athlètes), de la Lituanie (17 athlètes) et de l’Ukraine (46 athlètes) seront particulièrement visibles et donc valorisées.
À lire aussi : Géopolitique du sport : l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine
Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de cesser d’être un « événement pour pays riches » et « une compétition pour pays de l’hémisphère Nord ». L’intégration réussie du Japon et de la Corée du Sud (qui organisèrent l’événement respectivement en 1972 puis en 1998 et en 2018) est un gage d’ouverture et d’attractivité. Toutefois, loin de réunir le monde, pour le moment, les JO d’hiver soulignent sa division entre Nord et Sud ainsi qu’entre riches et pauvres.
Ce clivage s’est manifesté dans les audiences des derniers JO : alors que les JO d’été de Paris 2024 ont rassemblé au total près de 5 milliards de téléspectateurs, les JO d’hiver de Pékin 2022 n’ont, eux, attiré que 2,2 milliards de téléspectateurs, soit moins de la moitié.
Là encore, les villes organisatrices sont placées devant un défi planétaire : celui consistant à organiser des JO d’hiver réellement inclusifs.
Une vitrine pour les « puissances moyennes » ?
Le repositionnement international des JO d’hiver pourrait peut-être venir de la « sur-visibilité » dont y disposent des « puissances moyennes » pour reprendre l’expression traditionnelle de la géopolitique française, remise à l’honneur par le premier ministre canadien à Davos il y a peu. En effet, les superpuissances des JO d’hiver ne sont pas seulement les superpuissances économiques et militaires mondiales.
Les États-Unis et la Chine ont un palmarès impressionnant avec la 3ᵉ et la 4ᵉ place au classement des médailles pour les JO d’hiver de Pékin 2022. Quant à la Russie, elle obtenait à chaque édition, comme l’URSS avant elle, un solide socle de médailles avant son exclusion du CIO. Mais, aux JO d’hiver, les pays dominants sont les pays « petits » ou moyens » : Norvège (1ère au classement des médailles sur l’intégralité des JO d’hiver), Canada (2ᵉ délégation en 2026), Allemagne (2ᵉ au classement des médailles pour les JO 2022), France, Italie, Suisse, etc.
Au contraire, les palmarès des JO d’été reflètent fidèlement la hiérarchie économique et militaire mondiale. Aux JO d’hiver, les « petits » pays peuvent plus aisément déployer une stratégie d’influence. Les grandes délégations de puissances moyennes seront celles de l’Italie (196 athlètes), de l’Allemagne (185 athlètes), de la France (160 athlètes), de la Suède (110 athlètes), de la Finlande (103 athlètes) et de la Norvège (80 athlètes).
À défaut de pouvoir devenir universels, les JO d’hiver pourraient-ils devenir une enceinte où les « puissances moyennes », de moins en moins alignées sur les États-Unis, la Chine et la Russie, se montreraient et se valoriseraient ?
De 2026 à 2034 : réeuropéaniser les JO d’hiver ?
Pour répondre à ces défis mondiaux, les villes organisatrices d’Italie (pour l’édition 2026) et de France (pour l’édition 2030) ont commencé à infléchir les modalités d’organisation des JO. Elles ont essayé de se démarquer du gigantisme de l’édition 2022 organisée par Pékin en ventilant les compétitions entre plusieurs sites (sept pour l’édition 2026). Elles ont également intégré des sports moins consommateurs d’infrastructures comme le ski-alpinisme qui ne nécessite pas de remontées mécaniques. Et elles ont ouvert la compétition à des représentants (symboliques) du sud.
À long terme, ces deux éditions européennes des JO d’hiver réussiront-elles à infléchir la dynamique écologique, économique et politique de cette compétition ? Ou bien les JO d’hiver 2034, qui auront lieu dans l’Utah, reprendront-ils la trajectoire antérieure ? Au CIO comme dans le monde, les Européens réussiront-ils à endosser et promouvoir leur rôle d’avocats du développement durable ? Rappelons qu’en France, les Jeux d’hiver de Grenoble en 1968 et, encore plus, ceux d’Albertville en 1992 s’étaient distingués par ce qu’ils ont laissé en matière d’infrastructures de transport, permettant le désenclavement des Alpes…
Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.02.2026 à 16:33
Comment la corruption s’est installée en Espagne
Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia
Texte intégral (1434 mots)
Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en 2018 dans la foulée d’un scandale de corruption qui avait mis à mal le gouvernement de droite en place jusque-là. Mais au cours des années suivantes, des affaires tout aussi graves ont éclaboussé son entourage le plus proche. Les théories de la criminologie permettent de mieux comprendre le phénomène par lequel la corruption se propage au sein d’une société et, particulièrement, de ses élites politiques.
Depuis plusieurs mois, une gigantesque affaire de corruption secoue l’Espagne au plus haut niveau de l’État. Le premier touché par ce scandale est le premier ministre Pedro Sanchez, élu justement à l’origine pour lutter contre la fraude.
Pour un moraliste, le spectacle ibérique a toutes les apparences d’un vaste roman d’hypocrisie, si minutieusement façonné, si délicatement brodé, qu’on pourrait croire qu’il répond à quelque obscure vocation artistique et vicieuse de l’âme humaine. Mais l’œil du chercheur en criminologie y voit matière à illustrer de nombreuses théories.
La pandémie de Covid-19, contexte favorable à la corruption
Les affaires criminelles trouvent souvent leur origine dans un contexte propice.
Pedro Sanchez fut porté au pouvoir en 2018, à 46 ans, sur les décombres du scandale Gürtel qui avait causé la chute du gouvernement du Parti populaire (PP, droite) conduit par Mariano Rajoy.
Sanchez était alors, aux yeux d’un peuple désolé, semblable à un jeune héros de roman, sauveur d’une Espagne lasse des scandales, baigné d’une lumière moderne, incarnant la promesse d’une transparence immaculée et joyeuse. Il entérina son statut en remportant les élections législatives anticipées d’avril puis de novembre 2019, avant de perdre de peu celles de 2023, demeurant toutefois au pouvoir grâce à des alliances politiques. Quelques années plus tard, le voici prisonnier des mêmes ombres qu’il avait autrefois prétendu combattre.
Le drame de la pandémie de Covid-19 fut un terreau fertile à l’expansion de la corruption. La pandémie, avec son cortège d’angoisse, d’incertitudes et de décisions précipitées, fit exploser les systèmes de contrôle, dernier rempart face à la tentation humaine. Sous le prétexte de l’urgence absolue, les règles furent oubliées, les appels d’offres suspendus, les vérifications enterrées. Un contexte délétère qui fut propice à la montée en puissance du parti d’extrême droite Vox.
Dans cette atmosphère de fin du monde, un homme providentiel, Koldo Garcia, conseiller du ministre des transports de 2018 à 2021, apparut avec l’aura de l’homme de confiance du pouvoir. Grâce aussi à la proximité qui le liait au ministre des transports, José Luis Abalos, fidèle allié de Pedro Sanchez, Koldo Garcia put naviguer sans résistance dans les couloirs de l’administration espagnole apeurée, s’appropriant commandes et contrats, ses relations lui valant brevet de compétences. Les millions se déversaient pour des masques pas toujours fournis, tandis que de multiples commissions secrètes venaient rémunérer les intermédiaires sans scrupules comme Koldo Garcia.
La corruption étendit ensuite ses ramifications jusque dans le cercle le plus intime du premier ministre. Ainsi, Begoña Gomez, l’épouse du chef du gouvernement, s’est trouvée impliquée à son tour dans les ondoiements opaques de l’attribution de certains contrats publics. Un autre scandale concerna le frère du premier ministre David Sanchez, qui a bénéficié d’un poste public, exempt de toute activité réelle, mais chèrement rémunéré.
Les théories du crime, ou la science au chevet de l’âme humaine
Les criminologues, tels des botanistes examinant les évolutions d’une plante vénéneuse, peuvent décortiquer cette affaire selon trois approches.
D’une part, la théorie des activités routinières, développée en 1979 par Cohen et Felson, montre comment la pandémie – en abolissant la vigilance – a facilité l’émergence d’un pacte de corruption grâce à trois composantes : l’existence d’un « agresseur » motivé et d’une cible vulnérable, et l’absence du gardien capable de protéger cette cible. Effectivement, c’est bien un manque de surveillance qui a permis à ces affaires de corruption de prospérer.
D’autre part, la théorie de l’association différentielle, élaborée à partir de 1939 par Sutherland, explique la façon dont, dans certains cercles du parti au pouvoir, la corruption s’est transmise comme une routine mondaine : on y apprenait à considérer la déviance non comme un crime, mais comme une technique administrative souple, semblable à ces « accommodements » subtils auxquels s’adonnent des privilégiés pour sauver les apparences tout en gardant leurs privilèges.
Enfin, la théorie de la neutralisation de Sykes et Matza (1957) révèle ce talent qu’ont les responsables politiques pour justifier la gravité de leurs actes. Les justifications étaient multiples pour annihiler le moindre sentiment de culpabilité : comme dans d’autres cas similaires, les coupables évoquèrent l’urgence, minimisèrent l’ampleur des irrégularités commises ou soulignèrent le respect impérieux des règles de loyauté à l’égard d’un cercle d’amis… malheureusement corrompus.
La façade éthique, ou l’art de sauver les apparences
Lorsque l’affaire de corruption éclata, doublée par un scandale à caractère sexuel, le parti du premier ministre fit montre d’une célérité étrange : il s’est empressé d’exclure de ses rangs des personnalités de premier plan comme José Luis Ábalos et Santos Cerdán, dénoncer et condamner verbalement l’horreur de la corruption.
Mais ces gestes semblaient davantage destinés à produire une impression de vertu qu’à restaurer une réelle moralité. Ce que l’on vit n’était pas un sursaut de conscience, mais l’instauration d’une façade éthique : un vernis discret, apposé pour masquer la pourriture, comme ces touches de peinture que l’on ajoute à un meuble délabré pour qu’il paraisse sous un jour présentable.
L’histoire de Pedro Sanchez et de son cercle intime est moins celle d’une chute spectaculaire que celle, plus triste et plus banale, d’une lente transformation – celle par laquelle le pouvoir, insensiblement, se mue en privilège, et la vertu proclamée pour le faire élire se transforme en opportunité déréglée. Le peuple espagnol, témoin de ce spectacle répétitif, se retrouve à un point de désolation totale, observant avec tristesse et lassitude pessimiste la répétition infinie des mêmes erreurs humaines. Tandis que la vertu se débat dans la boue que l’on avait promis d’assécher, l’Espagne contemple son hiver moral – un hiver qui semble ne devoir finir qu’au prix d’une lucidité douloureuse.
Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 16:13
Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine
Elsa Valle, Doctorante, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (2075 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.
« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »
Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.
L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.
Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.
Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.
L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.
Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international
La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.
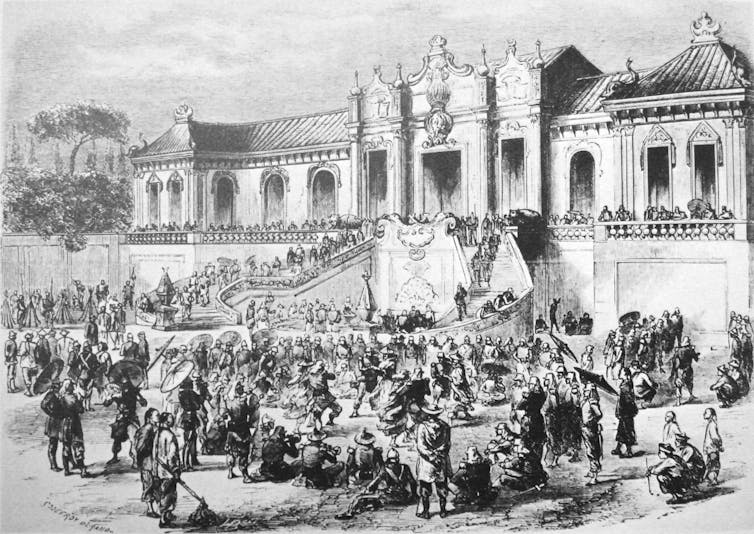
Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.
Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.
Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.
Un trafic illicite toujours actif
Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.
Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.
Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.
Les limites du droit international du patrimoine
La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.
La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.
La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.
Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois
Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.
Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.
Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.
Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.
Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 16:13
Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?
Tilman Ruff, Honorary Principal Fellow, School of Population and Global Health, The University of Melbourne
Texte intégral (2049 mots)
**Dans un contexte international extrêmement tendu, le traité New Start, signé en 2010 entre la Russie et les États-Unis, expire ce jeudi 5 février. Les termes du traité limitent à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1 550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs. Sans nouvel – et improbable à ce stade – accord, les deux parties pourront accroître leurs arsenaux, une perspective qui constitue une source d’inquiétude majeure.
Le traité New Start, le dernier accord visant à limiter le nombre d’armes nucléaires de la Russie et des États-Unis, arrive à son terme ce 5 février 2026. Aucune négociation n’est prévue pour prolonger sa durée. Comme l’a déclaré Donald Trump dans une interview récente, « S’il expire, il expire ».
On ne saurait trop insister sur l’importance du traité New Start. Après que d’autres traités relatifs au contrôle des armes nucléaires ont été abrogés ces dernières années, ce texte était le seul accord prévoyant des dispositifs de notification et d’inspection entre les États-Unis et la Russie. À eux deux, ces pays possèdent 87 % des armes nucléaires mondiales.
La fin du traité mettra un terme définitif à la retenue nucléaire entre les deux puissances. Elle risque également d’accélérer la course mondiale aux armements nucléaires.
Qu’est-ce que New Start ?
Le traité sur les mesures visant à réduire et limiter davantage les armes stratégiques offensives, dit « New Start » ou traité de Prague, a été signé le 8 avril 2010 à Prague, par les présidents Barack Obama et Dmitri Medvedev. Il est entré en vigueur l’année suivante.

Il remplaçait un traité de 2002, le Strategic offensive reduction treaty (SORT), par lequel la Russie et les États-Unis s’étaient engagés à réduire en dix ans le nombre de leurs ogives nucléaires à une quantité comprise entre 1 700 et 2 200 têtes.
Avec New Start, signé pour une durée de dix ans, les deux pays promettaient de réduire leur nombre d’armes nucléaires à longue portée ; en outre, le texte apportait des précisions supplémentaires sur les différents types de lanceurs. Le traité limitait l’arsenal nucléaire à 700 missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et missiles mer-sol balistiques stratégiques (SLBM), 1 550 ogives nucléaires et 800 lanceurs (déployés et non déployés). Ces objectifs ont été atteints dès le 5 février 2018.
Le texte comportait également des dispositifs efficaces d’inspection et de vérification de la conformité des actions des deux parties prenantes aux termes du traité. Il prévoyait deux échanges annuels, ainsi qu’un système continu de notifications mutuelles concernant le mouvement des forces nucléaires stratégiques, qui avaient lieu presque quotidiennement. Les deux parties acceptaient l’inspection réciproque sur site des missiles, ogives et lanceurs couverts par le traité, ce qui fournissait à chacune d’entre elles des informations précieuses sur les déploiements nucléaires de l’autre.
Enfin, l’accord établissait une commission consultative bilatérale et des procédures claires pour la résolution de questions ou de disputes.
Les limitations de l’accord
À l’époque, le traité a été critiqué pour le caractère modeste des réductions qu’il imposait et pour le champ limité des types d’armes nucléaires qu’il couvrait.
Mais sa principale faiblesse était le prix politique qu’Obama avait payé pour obtenir sa ratification par le Sénat américain.
Afin d’obtenir un soutien suffisant de la part des républicains, le président démocrate avait accepté un programme à long terme, d’un coût de plus de 2 000 milliards de dollars, portant sur le renouvellement et la modernisation de l’arsenal nucléaire américain, ainsi que des installations et des programmes de production et d’entretien des armes nucléaires.
Conséquence : avec New Start, les États-Unis s’assuraient de continuer à disposer d’un arsenal nucléaire conséquent et sans cesse modernisé. Les perspectives d’un désarmement total s’évanouissaient.
À l’approche de l’expiration du traité, qui prenait fin en 2021, la Russie avait proposé d’en prolonger la validité de cinq ans, comme le permettaient les dispositions du texte. Donald Trump, qui effectuait alors son premier mandat présidentiel, avait refusé d’y donner suite.
Après sa victoire à l’élection présidentielle de 2020, Joe Biden a finalement accepté la prolongation du traité, le 3 février 2021, soit deux jours seulement avant son échéance. Aucune nouvelle prolongation n’est toutefois prévue par le traité.
En février 2023, la Russie a suspendu l’application de certains aspects clés de l’accord, parmi lesquels l’échange de données sur les stocks et les inspections sur site. Elle ne s’est cependant pas officiellement retirée du traité et s’est engagée à continuer de respecter les limites numériques concernant les ogives, missiles et lanceurs.
Et maintenant ?
En septembre 2025, à l’approche de l’expiration du traité, Vladimir Poutine a fait savoir qu’il était prêt à continuer à respecter les limites fixées pour une année supplémentaire, à condition que les États-Unis fassent de même.
Mis à part une remarque improvisée de Donald Trump – « Cela me paraît être une bonne idée » –, aucune réponse officielle n’a été apportée par Washington à cette proposition russe.
Trump a par ailleurs compliqué la situation en exigeant que toute future négociation sur le contrôle des armes nucléaires inclue la Chine. Or Pékin a toujours refusé cette participation. Il n’existe en outre aucun précédent de négociations trilatérales sur le désarmement ou le contrôle nucléaire, qui seraient longues et complexes. Et si l’arsenal chinois est en expansion, il ne représente aujourd’hui que 12 % de celui des États-Unis et moins de 11 % de celui de la Russie.
Le traité New Start semble désormais voué à expirer sans qu’aucun accord ne soit conclu pour maintenir ses limites jusqu’à la négociation d’un traité de remplacement.
Cela signifie que la Russie et les États-Unis pourraient augmenter, en l’espace de quelques mois, le nombre de leurs ogives déployées de 60 % et 110 % respectivement. Tous deux disposent en effet de la capacité à charger davantage d’ogives sur leurs missiles et bombardiers que ce n’est actuellement le cas. Ils conservent également d’importants stocks d’ogives en réserve ou destinées au démantèlement, mais encore intactes.
S’ils prenaient de telles mesures, les deux pays pourraient pratiquement doubler leurs arsenaux nucléaires stratégiques déployés.
La fin des processus d’échange de données, de vérification et de notification entraînerait une grande incertitude et une méfiance mutuelle. Cela pourrait à son tour conduire à un renforcement supplémentaire des capacités militaires des deux pays, déjà colossales.
Un avertissement inquiétant
L’aspect le plus préoccupant de cette évolution est sans doute le fait que le désarmement nucléaire est désormais moribond.
Aucune négociation sur le désarmement ou même sur la limitation des risques nucléaires n’est actuellement en cours. Aucune n’est prévue.
A minima, après l’expiration du traité de New Start cette semaine, la Russie et les États-Unis devraient convenir de respecter ses limites jusqu’à ce qu’ils négocient de nouvelles réductions.
Et cinquante-six ans après avoir pris, dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), un engagement en faveur du désarmement, les deux puissances devraient œuvrer à la mise en place d’un accord entre l’ensemble des États dotés de l’arme nucléaire afin d’éliminer leurs arsenaux.
Mais la Russie, les États-Unis et les autres puissances nucléaires empruntent aujourd’hui la direction opposée.
Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les actions – du bombardement de l’Iran à l’arrestation du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro – qui témoignent de son mépris pour le droit international et les traités. Elles confirment également sa volonté d’employer tous les leviers de puissance pour affirmer la suprématie américaine.
Vladimir Poutine, de son côté, a eu recours à un IRBM, le fameux Orechnik, contre l’Ukraine, multiplié les menaces de recours à l’arme nucléaire contre Kiev et l’Occident, et opté pour une approche sans précédent et extrêmement dangereuse vis-à-vis des centrales nucléaires ukrainiennes, autour desquelles les combats ont lieu régulièrement et qui fonctionnent désormais dans un environnement très dégradé, ce qui suscite des risques immenses.
Tout cela est de mauvais augure pour le désarmement nucléaire et, au-delà, pour la réduction de l’éventualité d’une guerre nucléaire.
Tilman Ruff est est affilié à l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, à l’Association médicale pour la prévention de la guerre, à Médecins pour l’environnement Australie et à l’Association australienne pour la santé publique.
03.02.2026 à 15:28
Les fichiers Epstein, la boîte de Pandore de la transparence américaine
Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po
Texte intégral (1916 mots)
Plusieurs millions de documents viennent d’être rendus accessibles au grand public dans l’affaire du financier Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison – la cause officielle du décès, un suicide par pendaison, suscitant à ce jour de nombreux doutes. Il faudra beaucoup de temps et d’énergie pour analyser en totalité cet immense afflux d’informations. Au-delà des nouvelles révélations, l’épisode pose d’importantes questions sur l’articulation entre, d’une part, le devoir de transparence et, d’autre part, la nécessité de protéger la présomption d’innocence.
La publication, le 30 janvier 2026, des « Epstein Files » par le département de la justice des États-Unis (DOJ) a eu l’effet de l’ouverture d’une véritable boîte de Pandore, libérant dans l’espace public une masse documentaire d’une ampleur inédite et déclenchant une onde de choc allant bien au-delà du champ judiciaire.
Ce qui était présenté comme un geste de clarté et de responsabilité démocratique s’est transformé en un événement politique et médiatique majeur, révélateur des fragilités contemporaines de la transparence institutionnelle.
Une divulgation de documents d’une ampleur sans précédent
La divulgation s’inscrit dans le cadre de l’Epstein Files Transparency Act, adopté à la fin de l’année précédente par le Congrès à une quasi-unanimité des élus des deux Chambres et ratifié peu après. Ce texte imposait au DOJ la publication de l’ensemble des dossiers relatifs aux enquêtes menées sur Jeffrey Epstein et son réseau, avec l’objectif explicite de mettre un terme aux soupçons persistants d’opacité et de traitement préférentiel favorisant certaines des personnalités concernées. Pour le DOJ, cette publication marque officiellement la fin d’un processus de divulgation long et juridiquement encadré, présenté comme l’ultime étape d’une obligation désormais satisfaite.
Pourtant, loin de refermer l’affaire, cette ouverture massive des archives semble inaugurer une nouvelle phase de controverse, où la transparence affichée nourrit la défiance plus qu’elle ne la dissipe.
L’ampleur des éléments rendus publics est sans précédent. Entre trois et cinq millions de documents, près de 2 000 vidéos et environ 180 000 photographies, issus de procédures civiles, d’enquêtes fédérales, de saisies numériques et de correspondances accumulées sur plusieurs décennies, ont été mis à la disposition du grand public.
Cette profusion donne l’impression d’une transparence totale, presque absolue, mais elle pose immédiatement un problème de lisibilité. Une grande partie des fichiers est partiellement caviardée pour des raisons juridiques, d’autres sont fragmentaires ou dépourvus de contexte précis. Le public se trouve confronté à un matériau brut, massif et hétérogène, difficile à hiérarchiser et à interpréter sans un travail d’analyse approfondi. La transparence promise se heurte ainsi à une réalité paradoxale : montrer beaucoup ne signifie pas nécessairement expliquer clairement.
Cette difficulté est accentuée par l’apparition de nouveaux noms qui viennent s’ajouter à une liste déjà longue de personnalités associées, de près ou de loin, à l’univers relationnel d’Epstein.
La place manque ici pour analyser la portée de la totalité des révélations relatives à ces personnalités qui n’étaient jusque-là pas évoquées, par exemple la future reine de Norvège Mette-Marit et l’ancien premier ministre travailliste de ce même pays Thorbjorn Jagland, ou encore l’ancien ministre slovaque des affaires étrangères Miroslav Lajcak. Parmi les noms qui ont attiré une attention médiatique immédiate figurent trois cas sur lesquels nous nous attarderons particulièrement : ceux de Sarah Ferguson, Peter Mandelson et Caroline Lang.
Des révélations propices à tous les soupçons
Dans le cas de Sarah Ferguson, duchesse d’York et ancienne épouse (1986-1996) du prince Andrew – frère de l’actuel roi Charles et dont la proximité avec Epstein a été largement documentée bien avant les révélations du 30 janvier, au point que son frère lui a retiré le statut de prince en octobre dernier –, les documents font état de relations sociales avec Epstein dans les années 1990 et 2000, notamment des rencontres et des échanges dans des cercles mondains communs.
Certaines accusations relayées par des témoignages évoquent des contacts répétés et des sollicitations financières indirectes, bien que la principale intéressée ait toujours nié toute implication dans des activités illégales et rappelé que ces relations relevaient d’un cadre social sans dimension criminelle établie. La présence de son nom dans les fichiers illustre néanmoins la manière dont des liens sociaux, même anciens ou périphériques, peuvent être réinterprétés à la lumière du scandale.
Peter Mandelson, figure centrale de la vie politique britannique et ancien commissaire européen au commerce (2004-2008), apparaît quant à lui dans des correspondances et des agendas liés à Epstein. Les accusations évoquées dans certains témoignages ne portent pas sur des faits pénaux établis, mais sur des fréquentations répétées et une proximité assumée avec le financier, y compris après la première condamnation de celui-ci en 2008. Mandelson a reconnu publiquement avoir côtoyé Epstein dans un cadre social et professionnel, tout en niant toute connaissance ou participation à des activités criminelles.
La récurrence de son nom dans les fichiers alimente cependant le débat sur la responsabilité morale des élites et sur la persistance de relations avec Epstein malgré les alertes judiciaires déjà connues à l’époque des faits. Après avoir été limogé de son poste d’ambassadeur aux États-Unis en septembre dernier à cause de ses liens avec le criminel américain, Mandelson a annoncé le 1er février qu’il quittait le parti travailliste britannique, dont il était une figure historique.
Le cas de Caroline Lang, fille de Jack Lang et déléguée générale du syndicat de la production indépendante, poste dont elle a démissionné à la suite de la révélation de la présence de son nom dans les dossiers Epstein, est plus opaque et contribue à la confusion générale. Les documents la mentionnent dans des échanges et des listes de contacts liés à l’entourage d’Epstein, sans que son rôle précis soit clairement établi. Certaines accusations évoquent des interactions régulières ou une présence lors d’événements organisés par le financier, mais les fichiers ne permettent pas de déterminer la nature exacte de ces relations ni d’établir une implication pénale.
Cette opacité illustre l’un des problèmes majeurs de la divulgation massive : l’exposition de noms sans cadre interprétatif clair, ce qui laisse place à des spéculations difficilement vérifiables.
L’éternelle tension entre devoir d’information et préservation de la présomption d’innocence
La publication de ces informations met en lumière une tension fondamentale entre le droit à l’information et le devoir de prudence. D’un côté, la société civile réclame une transparence totale, considérant que seule la divulgation intégrale des archives peut permettre un examen démocratique des réseaux de pouvoir ayant entouré Epstein. De l’autre, juristes et journalistes rappellent que la diffusion de documents non contextualisés peut porter atteinte à la présomption d’innocence, nuire à des individus cités sans preuve formelle et détourner l’attention des victimes au cœur de l’affaire. La logique de la liste et de l’exposition nominale tend ainsi à remplacer l’analyse rigoureuse des faits.
Cette tension est d’autant plus forte que les fichiers font référence à Donald Trump à plus de 1 500 reprises. Cette omniprésence alimente la défiance à l’égard du président actuel et ravive les critiques sur la lenteur avec laquelle son administration a accepté la divulgation complète des dossiers. Même en l’absence de preuves nouvelles établissant une responsabilité pénale, la répétition de son nom nourrit les soupçons d’un pouvoir réticent à une transparence totale et accentue la polarisation politique autour de l’affaire.
En définitive, la révélation des fichiers Epstein apparaît moins comme un point final que comme une ouverture brutale et incontrôlée, fidèle à la métaphore de la boîte de Pandore. Elle expose les limites d’une transparence réduite à la publication massive de données et met au défi les institutions, les médias et le pouvoir politique.
Pour Donald Trump, cette affaire constitue un test majeur : démontrer que la transparence peut s’accompagner de clarté, de responsabilité et de respect des principes fondamentaux de l’État de droit, sans nourrir durablement la confusion ni la défiance institutionnelle. Au vu de ses premières réactions – il affirme que la publication du 30 janvier l’absout totalement, tout en s’en prenant avec virulence aux « démocrates pourris » qui, selon lui, étaient « presque tous », de même que leurs donateurs, des visiteurs réguliers de la tristement célèbre île d’Epstein –, le locataire de la Maison-Blanche semble au contraire vouloir utiliser cet épisode pour alimenter le climat extrêmement polémique qui règne aujourd’hui dans la vie politique américaine…
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.02.2026 à 16:23
Le lien direct entre efficacité de la propagande et difficulté de mettre fin à un conflit
Petros Sekeris, Associate Professor in Economics and Finance, TBS Education
Texte intégral (1619 mots)
Les innovations technologiques rendent les propagandes de plus en plus efficaces. Les populations des pays en guerre, mais aussi les dirigeants, ont dès lors plus de peine à accepter les termes d’un accord de paix ou même à envisager une sortie de conflit.
Fin 2024, 88 % des Ukrainiens pensaient que leur armée était capable de remporter la guerre contre le géant russe. Près d’un an plus tard, ils étaient 76 % à y croire pour autant que l’Occident continue à fournir des armes. La même confiance en la patrie semble prévaloir dans le camp adverse : les trois quarts des Russes sont persuadés que leur pays sortira vainqueur du conflit.
Dans de telles conditions, tout compromis acceptable pour l’un des belligérants se heurte à l’intransigeance de l’autre, et les pourparlers piétinent logiquement.
Des propagandes de plus en plus efficaces grâce aux réseaux sociaux et à l’IA
Les propagandes guerrières visant à galvaniser les foules ne datent pas d’hier – on en retrouve trace jusque dans des écrits antiques, mais aussi dans l’art – sculptures, mosaïques ou fresques, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Mais leur efficacité est aujourd’hui particulièrement redoutable, et c’est ce qui explique que la majorité des citoyens des deux pays belligérants veut toujours croire à une possible victoire après quatre ans de guerre, alors que le front, mois après mois, bouge en réalité assez peu et que, déjà, selon des estimations récentes, environ 1,2 million de Russes et 600 000 Ukrainiens auraient été tués, grièvement blessés ou portés disparus au combat.
Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette aspiration continue à la victoire au prix de tant de vies et de ressources. Lors des printemps arabes de 2011, la manière dont les manifestants utilisaient ce nouvel outil avait affolé les gouvernants. Plusieurs États avaient bloqué Internet. Mais aujourd’hui, les États savent parfaitement influer sur les croyances des citoyens.
L’impact des interventions russes sur les réseaux a été mis en évidence dès les élections de 2016 aux États-Unis. Une armée d’influenceurs en ligne avait été mobilisée à l’époque pour faire basculer l’opinion publique américaine. Avec l’intelligence artificielle (IA), une telle mobilisation n’est même pas nécessaire. Des bots peuvent désormais envoyer en un temps record des millions de messages et d’images trafiquées, sous des identités inventées, pour orienter les perceptions des internautes en jouant sur l’émotion. Les citoyens sont d’autant plus vulnérables que les algorithmes les enferment dans des bulles informationnelles, entourées de personnes ou de robots aux avis semblables, créant la surenchère.
L’impact sur les esprits de cette propagande aux moyens jamais vus joue un rôle clé dans les conflits, incitant les dirigeants à adopter des positions plus dures à la table des négociations et rendant les processus de paix plus difficiles.
Des dirigeants prisonniers de leur propre récit triomphaliste
Nos recherches utilisant la théorie des jeux montrent que la propagande ne se contente pas de galvaniser l’opinion : elle peut devenir un catalyseur de guerre.
En diffusant de manière systématique des images de combattants intrépides, de prouesses technologiques ou de « victoires » sur le terrain, les dirigeants cherchent à renforcer la conviction, au sein de la population, que leur armée est supérieure et que l’issue du conflit leur sera favorable. On retrouve ce mécanisme aussi bien dans les vidéos de groupes armés mettant en scène des commandos surentraînés et des arsenaux impressionnants que dans les vastes parades militaires conçues pour projeter une image d’invincibilité.
Ce processus a un effet pernicieux : il lie les mains des dirigeants eux-mêmes. Une fois que les citoyens sont persuadés de la supériorité militaire nationale, ils risquent de rejeter tout accord perçu comme insuffisamment avantageux. Même lorsque des concessions seraient rationnelles pour éviter une escalade meurtrière, elles deviennent alors trop coûteuses à proposer ou à accepter par les dirigeants, car elles menacent leur survie politique, y compris lorsqu’ils sont des autocrates.
Plus préoccupant encore, lorsque les deux camps nourrissent simultanément des perceptions déformées, un accord mutuellement acceptable devient pratiquement impossible. Aucun dirigeant ne va tenter de « refroidir » son opinion publique, car cela le placerait en position de fragilité face à son adversaire. Chaque population surestime donc l’espérance de gains de la guerre et sous-estime ses coûts.
L’intuition centrale de notre modèle est que la propagande n’est pas seulement un instrument de mobilisation intérieure : elle peut aussi servir d’outil stratégique dans la négociation internationale. En renforçant la conviction publique qu’une victoire militaire est probable, l’électorat devient plus intransigeant sur d’éventuelles concessions, ce qui rend plus crédible la fermeté d’un dirigeant à la table des négociations et peut pousser l’adversaire à offrir davantage. Les dirigeants adoptent cette stratégie en connaissance de cause : ils savent qu’elle accroît le risque de guerre, mais estiment que le gain potentiel en pouvoir de négociation peut en « valoir le coût ».
Le problème apparaît lorsque les deux camps font le même calcul. Le durcissement simultané des attentes internes élève les exigences minimales des deux côtés au point qu’aucun compromis n’est politiquement acceptable : l’outil censé renforcer la négociation finit alors par en supprimer l’espace même et rendre la guerre plus probable.
Dans ce cadre, seule une rupture majeure – par exemple, une défaite militaire spectaculaire qui modifie brutalement les croyances, ou l’intervention décisive d’un acteur extérieur imposant une désescalade – peut rouvrir un espace de négociation.
L’histoire offre des illustrations frappantes : au Japon, en 1945, les destructions d’Hiroshima et de Nagasaki brisent la propagande d’invincibilité et entraînent une capitulation rapide, révélant combien la perception publique de force peut être brutalement corrigée par des événements matériels. De manière similaire, lors de la guerre du Vietnam, l’offensive du Têt en 1968, combinée au soutien stratégique et logistique massif de la Chine aux Vietcongs, met en lumière l’écart entre la propagande américaine sur une victoire imminente et la réalité du terrain, conduisant les États-Unis à entamer des négociations de paix à Paris à partir de 1968 et à revoir leur engagement militaire.
Des conflits de plus en plus nombreux
Ce phénomène est d’autant plus problématique que le nombre de conflits est aujourd’hui fortement orienté à la hausse. Selon les données du programme Uppsala Conflict Data (UCDP), hébergé au sein de l’Université d’Uppsala en Suède, l’année 2022 a été la plus meurtrière depuis la fin de la guerre froide si l’on excepte le génocide au Rwanda en 1994 et sa folie sanguinaire. L’année 2023 se situe également à un niveau de conflictualité très élevé, juste après 2022. Pour l’année 2024, le centre comptabilise pas moins de 11 conflits armés. Les calculs pour 2025 ne sont pas encore disponibles, mais il est certain que, du fait de la situation à Gaza et de celle au Soudan, entre autres, cette année aura également été très meurtrière. 2026 s’ouvre sur un durcissement marqué de la posture américaine sur la scène internationale et de nouveaux affrontements sanglants en Syrie, et risque fort de s’inscrire de ce point de vue dans le prolongement des années précédentes.
Cette montée des tensions est liée à l’émergence d’un monde multipolaire, mais plus encore au dérèglement climatique qui produit déjà des effets délétères. Une recherche publiée par la revue Science a établi dès 2013 un lien de causalité entre le réchauffement et la montée des violences interpersonnelles et guerres civiles. La pression migratoire et la lutte interétatique pour les ressources ne font depuis lors que s’accentuer. Dans ce contexte particulièrement belligène, les discours propagandistes versent encore de l’huile sur le feu.
Petros Sekeris ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.02.2026 à 10:18
Thaïlande : une démocratie à marée basse
Arnaud Leveau, Docteur en science politique, professeur associé au Master Affaires internationales, Université Paris Dauphine – PSL
Texte intégral (2467 mots)
À l’approche des élections législatives de février 2026, la Thaïlande s’apprête à voter une nouvelle fois dans un cadre démocratique formellement respecté mais politiquement étroit. Derrière le rituel électoral, ce scrutin révèle surtout les limites structurelles d’un système où le changement reste soigneusement borné.
Le 8 février 2026, les Thaïlandais retourneront aux urnes à la suite de la dissolution anticipée du Parlement par le premier ministre sortant Anutin Charnvirakul. Cette décision, motivée par l’impossibilité de consolider une majorité stable et par la menace d’une motion de censure, s’inscrit dans une longue tradition politique nationale : lorsque l’équilibre parlementaire devient trop incertain, la dissolution apparaît comme un moyen de reprendre l’initiative, tout en renvoyant l’arbitrage formel aux électeurs.
La scène est désormais familière. Les campagnes électorales s’ouvrent dans un climat de relative normalité institutionnelle, avec leurs caravanes sillonnant les provinces, leurs promesses économiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux et le retour de figures bien connues de la vie politique locale. Pourtant, derrière cette mécanique démocratique bien huilée, persiste une interrogation plus fondamentale : dans quelle mesure le vote peut-il réellement transformer le jeu politique thaïlandais, au-delà du simple renouvellement des équilibres partisans ?
Un pluralisme réel mais étroitement encadré
La vie politique thaïlandaise repose sur une compétition partisane bien réelle, contrairement à l’image parfois caricaturale que l’on donne d’elle dans les médias occidentaux. Les élections sont régulières, pluralistes, relativement bien organisées, et la participation demeure élevée. Cependant, cette compétition s’exerce dans un espace strictement délimité, où certaines réformes et certains débats restent structurellement hors de portée.
Trois forces politiques dominent aujourd’hui le paysage. Le camp gouvernemental, emmené par Anutin Charnvirakul et son parti Bhumjaithai, incarne un conservatisme pragmatique. Plus gestionnaire que réformateur, Anutin se présente comme un homme de compromis, capable de maintenir la stabilité dans un environnement politique fragmenté. Sa stratégie repose sur la continuité des politiques publiques, notamment les programmes de soutien à la consommation et aux territoires, et sur une posture de fermeté mesurée sur les dossiers souverains, en particulier les questions frontalières.
Face à lui, le Parti du peuple (People Party), héritier légal du mouvement réformiste Move Forward, dissous par la Cour constitutionnelle en 2024, cristallise les aspirations d’une jeunesse urbaine, connectée et largement acquise aux idéaux d’une démocratie libérale plus transparente. En tête des sondages, très populaire dans les grandes villes et parmi les classes moyennes éduquées, il demeure toutefois structurellement empêché d’accéder au pouvoir. Son renoncement à la réforme de la loi de lèse-majesté, pourtant au cœur de son identité initiale, illustre les lignes rouges que toute force politique doit intégrer pour espérer survivre dans le système.
Le troisième pôle, le Pheu Thai, longtemps dominant, apparaît aujourd’hui affaibli. Historiquement associé au clan Shinawatra, il a bâti sa puissance sur une combinaison de politiques redistributives et de loyautés rurales. Mais cette formule semble désormais épuisée. Les alliances controversées avec des partis proches de l’armée, l’affaiblissement de ses figures historiques et la transformation sociologique de l’électorat ont érodé sa crédibilité. Son déclin symbolise la fin progressive d’un cycle populiste fondé sur la redistribution des rentes étatiques.
Les verrous institutionnels du changement
Ces équilibres partisans s’inscrivent dans un cadre institutionnel où plusieurs acteurs non élus continuent de peser lourdement sur le jeu politique. L’armée, bien qu’elle n’aspire plus nécessairement à gouverner directement comme par le passé, demeure un acteur central. Elle conserve une influence déterminante sur les questions de sécurité, de budget et de politique étrangère, et se pose en garante ultime de ce qu’elle considère comme les fondements de l’État.
La monarchie, quant à elle, reste le pilier symbolique et politique autour duquel s’organise l’ensemble de l’architecture institutionnelle. Au-delà de son rôle cérémoniel, elle incarne une source de légitimité qui structure profondément les limites du débat public. La loi de lèse-majesté constitue, à cet égard, un marqueur puissant de ce qui peut ou ne peut pas être discuté ouvertement dans l’espace politique.
Enfin, la justice constitutionnelle s’est imposée comme un acteur clé du système. Par ses décisions successives de dissolution de partis et de disqualification de dirigeants élus, elle a démontré sa capacité à arbitrer, voire à redéfinir, les rapports de force politiques. Cette jurisprudence interventionniste contribue à instaurer un climat d’incertitude permanente, où chaque victoire électorale reste conditionnelle, soumise à une validation institutionnelle ultérieure.
L’ensemble de ces mécanismes produit une démocratie fonctionnelle mais conditionnelle : les élections déterminent qui peut gouverner, mais rarement ce qui peut être réformé. Le résultat est une succession de scrutins sans rupture majeure, mais riches d’enseignements sur l’état des relations entre société, partis politiques et institutions.
Une économie sous pression, un débat politique contraint
Le contexte économique renforce ces contraintes politiques. Longtemps considérée comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, la Thaïlande affiche désormais une croissance atone, autour de 2 %, nettement inférieure à celle de ses voisins régionaux. La dette des ménages atteint des niveaux préoccupants, limitant la capacité de relance par la consommation, tandis que l’investissement privé peine à repartir.
Le secteur touristique, pilier traditionnel de l’économie nationale, montre également des signes d’essoufflement. Après le rebond post-pandémique, les arrivées de visiteurs internationaux ont marqué le pas, pénalisées par un baht relativement fort, une concurrence régionale accrue et des inquiétudes sécuritaires liées aux tensions frontalières. Les épisodes climatiques extrêmes, notamment les inondations de 2025, ont rappelé la vulnérabilité des infrastructures et renforcé les doutes des investisseurs.
Face à ces défis, les programmes économiques des partis apparaissent largement consensuels et peu différenciés. Tous promettent la transition verte, la numérisation de l’économie et l’innovation technologique. Mais rares sont ceux qui proposent des réformes structurelles ambitieuses, qu’il s’agisse de la remise en cause des oligopoles, de la réforme fiscale ou de la réduction des inégalités régionales. La politique économique thaïlandaise semble ainsi prisonnière d’un conservatisme prudent, qui privilégie la préservation des rentes existantes à la prise de risques politiques.
Une société en mutation lente mais profonde
Les principales dynamiques de transformation se situent peut-être moins dans les partis que dans la société elle-même. La fracture générationnelle est l’un des traits saillants du paysage politique actuel. Une jeunesse urbaine, mondialisée et politisée remet en cause les hiérarchies traditionnelles, réclame davantage de transparence et s’informe massivement via les réseaux sociaux. À l’inverse, une Thaïlande rurale et périurbaine reste attachée à la stabilité, aux hiérarchies locales et aux réseaux clientélistes.
Toutefois, cette opposition binaire tend à s’estomper. Dans les provinces elles-mêmes, les systèmes de patronage traditionnels sont progressivement fragilisés par l’accès à l’éducation, la mobilité sociale et la circulation de l’information. Les grandes familles politiques locales, longtemps dominantes, doivent composer avec une nouvelle génération d’électeurs plus exigeants, moins enclins à voter par habitude ou par loyauté personnelle.
Ces évolutions sont lentes et souvent invisibles à court terme, mais elles s’accumulent. Elles expliquent en partie la résilience de la société civile thaïlandaise, capable de se mobiliser ponctuellement malgré les contraintes institutionnelles et les risques juridiques.
Une élection révélatrice plutôt que décisive
Dans ce contexte, les élections législatives de février 2026 ne devraient pas marquer une rupture politique majeure. Les scénarios possibles sont multiples, mais aucun ne promet de transformation radicale. Une reconduction du camp gouvernemental offrirait une stabilité relative à court terme, sans répondre aux tensions structurelles. Une percée du Parti du Peuple, même significative, se heurterait rapidement aux verrous institutionnels existants. Quant au Pheu Thai, son retour au pouvoir dépendrait de coalitions fragiles, au risque d’accentuer encore la défiance de son électorat.
Ces élections permettront en revanche de mesurer avec précision l’état des forces en présence, l’évolution des attentes sociales et la capacité du système à absorber les frustrations sans basculer dans une nouvelle crise ouverte. Elles constitueront moins un moment de rupture qu’un révélateur des ajustements en cours.
Dans un pays où la politique s’inscrit dans le temps long, chaque scrutin compte moins comme une fin que comme un jalon. La Thaïlande continue d’évoluer à son propre rythme, entre aspirations démocratiques et contraintes institutionnelles, dans une recherche permanente d’équilibre entre autorité, stabilité et souveraineté populaire. Pour l’observateur extérieur, la leçon est peut-être celle de la patience : derrière l’apparente immobilité du système, des transformations lentes mais réelles sont à l’œuvre, appelées à redéfinir, à terme, les contours du jeu politique thaïlandais.
Une élection sous influences régionales et internationales
Si les élections thaïlandaises de février 2026 sont avant tout structurées par des dynamiques internes, elles s’inscrivent aussi dans un environnement régional et international de plus en plus contraignant. La Thaïlande n’évolue pas en vase clos : sa trajectoire politique est étroitement liée aux recompositions en cours en Asie du Sud-Est continentale, aux tensions récurrentes avec ses voisins immédiats et aux rivalités stratégiques entre grandes puissances.
La relation avec le Cambodge constitue à cet égard un révélateur. Les tensions frontalières de 2025, ravivées autour de sites patrimoniaux sensibles et de zones frontalières contestées, ont rappelé combien ces différends restent mobilisables à des fins de politique intérieure, des deux côtés de la frontière. À Bangkok, une posture de fermeté face à Phnom Penh peut servir de levier électoral, en particulier dans un contexte de fragmentation politique et de compétition entre partis conservateurs. Sur ce sujet, les partis conservateurs et le Pheu Thai sont sur la même ligne. Le leader du People Party (réformateur) a également soutenu une ligne par rapport au Cambodge recommandant que les avions de combat Gripen, de fabrication suédoise, dont l’armée thaïlandaise dispose, soient utilisés contre les positions cambodgiennes.
Mais ces tensions ont aussi une portée régionale : elles fragilisent les chaînes économiques transfrontalières, accentuent les déplacements de population et mettent en lumière l’incapacité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) à prévenir ou contenir efficacement les crises entre États membres.
Cette relative impuissance de l’Asean ouvre un espace croissant aux puissances extérieures. La Chine y occupe désormais une place centrale. Premier partenaire commercial de la Thaïlande, acteur clé des infrastructures régionales et garant de facto de la stabilité des corridors continentaux reliant le sud de la Chine au golfe de Thaïlande, Pékin dispose de leviers économiques et politiques que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent égaler à court terme. Pour Bangkok, le rapprochement avec la Chine relève moins d’un alignement idéologique que d’un pragmatisme stratégique : sécuriser les investissements, maintenir la croissance et s’assurer d’un environnement régional stable.
Les États-Unis, pour leur part, restent un allié militaire historique, mais leur influence apparaît de plus en plus sectorielle. La coopération de défense demeure robuste, notamment à travers les exercices conjoints et les ventes d’équipements, mais elle pèse moins sur les choix économiques et sociétaux du pays. Cette dissociation croissante entre sécurité et prospérité nourrit une diplomatie thaïlandaise d’équilibriste, cherchant à préserver l’alliance américaine tout en approfondissant des liens structurants avec la Chine.
Quant à l’Union européenne, elle occupe en Thaïlande un rôle principalement économique et normatif, articulé essentiellement pour le moment autour de la négociation de l’accord de libre-échange UE–Thaïlande. Son une influence politique et sécuritaire directe reste relativement limitée.
Dans ce contexte, les élections de 2026 auront aussi valeur de signal à l’extérieur. Elles diront jusqu’où la Thaïlande souhaite aller dans sa stratégie de balancement, si elle entend consolider son rôle de pivot en Asie du Sud-Est continentale, ou accepter une dépendance plus marquée à l’égard d’arbitrages venus d’ailleurs. Plus qu’un simple rendez-vous électoral, ce scrutin s’inscrit dans un moment charnière, à l’intersection de dynamiques locales, régionales et globales, qui redessinent progressivement la place du pays dans l’Asie du Sud-Est contemporaine ainsi que dans l’Asean.
Arnaud Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
29.01.2026 à 16:01
Une analyse originale de la financiarisation de la santé au Sénégal (1840-1960)
Valéry Ridde, Directeur de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Texte intégral (2045 mots)
Dans la Financiarisation de la santé au Sénégal (1840-1960), aux éditions Science et bien commun (ESBC), Valéry Ridde (Institut de recherche pour le développement, IRD) livre une analyse originale des archives coloniales, de la presse et des publications scientifiques pour démontrer combien les idées libérales du financement des soins à l’œuvre dans ce pays, dans le reste de l’Afrique de l’Ouest mais aussi dans le monde, étaient déjà ancrées dans l’administration coloniale française.
À partir des années 1980, les institutions internationales ont incité les pays africains à recourir à des instruments politiques du financement de la santé inspirés d’une approche libérale. Ainsi, les malades ont été de plus en plus souvent amenés à payer pour leurs soins, les formations sanitaires ont été mises en concurrence, des ristournes et des primes ont été données aux soignant·es, des mutuelles de santé ont été lancées.
La Financiarisation de la santé au Sénégal (1840-1960), paru fin 2025, s’adresse aux historien·nes de la santé comme à toutes les personnes intéressées par la santé publique en Afrique. Dans un souci de justice épistémique et d’accès aux connaissances en langue française, ce livre est publié par les éditions Science et bien commun (ESBC) en accès libre, en différents formats et avec une écriture inclusive.
Des idées libérales du financement des soins déjà ancrées dans l’administration coloniale
Il s’agit de remonter le temps et de comprendre comment ces outils s’inscrivent dans une continuité historique. À partir du Sénégal et avec une analyse originale des archives coloniales, de la presse et des publications scientifiques, cet ouvrage montre que les idées libérales du financement des soins étaient déjà ancrées dans l’administration coloniale française. Elles étaient même présentes à l’échelle de l’Empire et confirment le manque de préoccupation pour l’accès aux soins des populations africaines et des plus pauvres.
Les défis actuels de ces instruments pour la couverture sanitaire universelle, déjà abordés dans l’ouvrage collectif Vers une couverture sanitaire universelle en 2030. Réformes en Afrique subsaharienne (ESBC, 2021), disponible en accès libre, ont donc une histoire ancienne que l’analyse met au jour pour réclamer un changement de paradigme.
Après une préface de l’historien Mor Ndao, professeur à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, le livre est composé de six parties thématiques dont nous présentons les éléments essentiels à retenir.
Une bascule : le principe de faire payer les malades à l’hôpital est formalisé
Dans la première partie, je présente le contexte de rareté des ressources dévolues au secteur de la santé pendant la période coloniale. Non seulement les hôpitaux coloniaux sont rares et ne disposent que de peu de budget, mais ils doivent déjà réaliser des économies. À partir de 1926, s’opère un basculement budgétaire. Les dépenses des établissements de santé sont transférées aux budgets locaux de chaque colonie de l’Afrique occidentale française (AOF), ce qui exacerbe les défis de financement.
L’administration coloniale commence à formaliser le principe et la possibilité pour certaines personnes malades de payer leur hospitalisation, en même temps qu’elle recherche l’efficience de l’organisation des services. L’hospitalo-centrisme était déjà en marche, l’administration coloniale préférant, comme aujourd’hui, les grandes structures aux soins de santé primaires.
La gratuité théorique pour les indigent·es au cœur des luttes actuelles
Dans la deuxième partie, je présente les modalités de paiement des patient·es organisées dans les hôpitaux. Bien que le principe fût la gratuité des soins, les personnes malades qui en avaient les moyens ont toujours eu la possibilité de payer leur hospitalisation. Le paiement était très variable d’un hôpital à l’autre, mais il se concrétisait par des catégories d’hospitalisation reproduisant les catégories militaires, sociales et « raciales » de l’époque.
Les personnes indigentes pouvaient bénéficier d’une prise en charge gratuite, mais au prix de multiples procédures administratives pour confirmer leur statut et dans un contexte budgétaire très restreint. Ces défis n’ont jamais été résolus et sont au cœur des luttes actuelles. Les modalités de financement (retenues sur salaire, paiements des entreprises ou des individus) et leur imputation comptable ne sont pas faciles à mettre en place.
J’ai ainsi pu constater une myriade de procédures administratives pour recouvrir ces créances. Les années de retard de remboursement aux formations sanitaires des politiques de gratuité des années 2000 ou de subvention des adhésions aux mutuelles de santé au Sénégal actuellement n’ont rien à envier à l’histoire administrative coloniale.
À lire aussi : Vers la couverture sanitaire universelle en Afrique subsaharienne : le paradoxe des mutuelles de santé au Sénégal
Des dispensaires ruraux qui renforcent les inégalités
À partir de 1905, la mise en place de l’Assistance médicale indigène (AMI) en AOF est analysée dans la troisième partie. Elle entraîne la création de dispensaires ruraux où le discours colonial présentait les soins comme étant gratuits. Pourtant, l’AMI était largement sous-financée et ne répondait pas aux besoins de la population. Mais surtout, les populations ont été sollicitées pour des paiements directs dans certaines situations.
Comme cela a été généralisé plus tard, dans les années 1980-1990, dans les pays appuyés par l’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il arrivait que les malades paient les soins dans ces dispensaires, ce qui ne faisait que renforcer les inégalités constatées dans les hôpitaux. De plus, l’administration coloniale a imposé une taxe spécifique de 1930 à 1938 pour financer l’AMI, avant de l’intégrer en 1939 à l’impôt (régressif) de capitation (forfait par personne).
Dès les années 1920, l’idéologie de la performance et des primes à l’activité, mobilisée plus tard par la Banque mondiale et d’autres organisations dans les années 2000, est déjà bien en place. Des primes sont octroyées aux mamans et aux matrones (accoucheuses traditionnelles) pour soutenir la politique coloniale de natalité.
Quand le personnel médical colonial pratique aussi dans le privé
Dans la quatrième partie, j’analyse la pratique privée de la médecine alors que les salaires et les primes de « dépaysement » des médecins militaires et civil·es, venu·es de France, sont payé·es par l’administration coloniale jusqu’à l’indépendance du Sénégal en 1960. Ces primes servent souvent d’incitatifs à s’expatrier, comme c’est encore le cas aujourd’hui pour les acteurs de l’aide publique au développement.
À l’époque, face aux contraintes budgétaires, ces médecins ne sont pas en nombre suffisant. Pourtant, ces personnes ont une pratique privée au sein et en dehors des formations sanitaires publiques. L’administration coloniale va tardivement tenter de les réguler. De plus, le personnel de santé africain fait face à de multiples défis pour obtenir ce même droit. Dans les années 1950, des syndicats se plaignent alors que les mouvements sociaux augmentent.
Le personnel médical payé par l’administration coloniale obtient des ristournes (autour de 25 %) sur la vente de leurs actes médicaux aux particuliers, pratiqués en plus de leurs activités cliniques de routine (la personne malade est par exemple facturée 100 francs. Le médecin reçoit alors 25 francs de ristourne sur ce montant, le reste étant gardé par l’administration).
Ces ristournes, dont le fonctionnement perdure aujourd’hui, seront formalisées dans les années 1980, avec la généralisation du principe du recouvrement des coûts encouragé par l’OMS et l’Unicef à laquelle la France a contribué.
Actuellement, les soignants du secteur public sénégalais peuvent recevoir une ristourne de 20 % à 30 % des recettes nettes. À l’époque coloniale, l’administration publique tire aussi profit de cette pratique privée des médecins coloniaux puisqu’elle reçoit une partie des sommes payées par les patient·es. Cependant, les médecins du secteur privé (qui paient une patente) se plaignent de la concurrence déloyale des médecins (militaires et civils) payés par l’administration coloniale.
L’origine du mouvement mutualiste
La cinquième partie de mon ouvrage est consacrée au mouvement mutualiste. Durant la période coloniale, le mouvement mutualiste français (très développé en « Métropole ») s’est mobilisé pour développer les mutuelles de santé en Afrique du Nord. Bien que de nombreuses conférences aient été organisées autour de la mutualité dans les colonies, presque rien n’a été réalisé à destination des populations de l’Afrique de l’Ouest.
Cependant, les premières tentatives de mutuelles au Sénégal remontent aux années 1910. Conçues comme des instruments de la politique coloniale, ces mutuelles ne rencontrent pourtant pas de succès. Leur nombre demeure très restreint (à l’image des mutuelles communautaires relancées à partir des années 1990) et elles cherchent, avant tout, à fournir des services aux coloniaux.
À lire aussi : Sénégal : un modèle d’assurance santé résilient en temps de Covid-19
Une financiarisation de la santé à l’échelle globale
Les approches que j’ai mises au jour pour le Sénégal se retrouvent aussi ailleurs en AOF et dans les territoires de l’Empire français. La présence de la financiarisation de la santé est donc globale, y compris à cette époque. Les archives confirment qu’elle s’est développée dans de nombreux pays de la planète au cours de la période coloniale. Elle a poursuivi son emprise sur nos systèmes de santé jusqu’à maintenant, tant au Sénégal qu’en France.
Ainsi, cet ouvrage centré sur la financiarisation de la santé à l’époque coloniale au Sénégal s’inscrit en complémentarité des analyses contemporaines de sa présence et de sa permanence à l’échelle mondiale. Un détour archivistique vers d’autres territoires ayant dû subir la colonisation française, et d’autres, confirme la situation sénégalaise et donc, la diffusion des idées et des pratiques qu’il faudra évidemment préciser dans des recherches futures.
Valery Ridde a reçu des financements de l'ANR, la FRM, IRSC, INSERM, ECHO, OMS.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
