28.01.2026 à 14:43
Des fossiles datés de 773 000 ans éclairent l’histoire de nos origines
Jean-Jacques Hublin, Paléoanthropologue, Collège de France; Académie des sciences
Texte intégral (1022 mots)
Le site de la grotte aux Hominidés à Casablanca, sur la côte atlantique du Maroc, offre l’un des registres de restes humains les plus importants d’Afrique du Nord. Il est connu depuis 1969 et étudié par des missions scientifiques impliquant le Maroc et la France. Ce site éclaire une période cruciale de l’évolution humaine : celle de la divergence entre les lignées africaines qui donneront nos ancêtres directs, les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Asie.
Une étude très récente publiée dans Nature décrit des fossiles d’hominines datés de 773 000 ans. Le groupe des hominines rassemble à toutes les espèces qui ont précédé la nôtre depuis la divergence de la lignée des chimpanzés. Ces fossiles (des vertèbres, des dents et des fragments de mâchoires) ont été découverts dans une carrière qui a fait l’objet de fouilles pendant de nombreuses années. Les découvertes les plus importantes et les plus spectaculaires ont eu lieu en 2008-2009. La raison pour laquelle ce matériel n’avait pas été révélé plus tôt à la communauté scientifique et au public est que nous n’avions pas de datation précise.
Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?
Grâce à l’étude du paléomagnétisme, nous avons finalement pu établir une datation très précise. Cette technique a été mise en œuvre par Serena Perini et Giovanni Muttoni de l’Université de Milan (Italie). Ces chercheurs s’intéressent à l’évolution du champ magnétique terrestre. Le pôle Nord magnétique se déplace au cours du temps, mais il y a aussi de très grandes variations : des inversions. À certaines époques, le champ devient instable et finit par se fixer dans une position inverse de la précédente. Ce phénomène laisse des traces dans les dépôts géologiques sur toute la planète.
Certaines roches contiennent des particules sensibles au champ magnétique, comme des oxydes de fer, qui se comportent comme les aiguilles d’une boussole. Au moment où ces particules se déposent ou se fixent (dans des laves ou des sédiments), elles « fossilisent » l’orientation du champ magnétique de l’époque. Nous connaissons précisément la chronologie de ces inversions passées du champ magnétique terrestre et, dans cette carrière marocaine, nous avons identifié une grande inversion datée de 773 000 ans (l’inversion Brunhes-Matuyama). Les fossiles se trouvent précisément (et par chance) dans cette couche.
En quoi cette recherche est-elle importante ?
En Afrique, nous avons pas mal de fossiles humains, mais il y avait une sorte de trou dans la documentation entre un million d’années et 600 000 ans avant le présent. C’était d’autant plus embêtant que c’est la période pendant laquelle les chercheurs en paléogénétique placent la divergence entre les lignées africaines (qui vont donner nos ancêtres directs), les ancêtres des Néandertaliens en Europe et les formes asiatiques apparentées (les Dénisoviens).
Ce nouveau matériel remplit donc un vide et documente une période de l’évolution humaine assez mal connue. Ils nous permettent d’enraciner très loin dans le temps les ancêtres de notre espèce – les prédécesseurs d’Homo sapiens – qui ont vécu dans la région de Casablanca.
Le manque d’informations pour la période précédant Homo sapiens (entre 300 000 ans et un million d’années) a poussé quelques chercheurs à spéculer sur une origine eurasienne de notre espèce, avant un retour en Afrique. Je pense qu’il n’y a pas vraiment d’argument scientifique pour cela. Dans les débuts de la paléoanthropologie, les Européens avaient du mal à imaginer que l’origine de l’humanité actuelle ne se place pas en Europe.
Plus tard, au cours du XXᵉ siècle, le modèle prépondérant a été celui d’une origine locale des différentes populations actuelles (les Asiatiques en Chine, les Aborigènes australiens en Indonésie et les Européens avec Néandertal). Ce modèle a été depuis largement abandonné face notamment aux preuves génétiques pointant vers une origine africaine de tous les hommes actuels.
Quelles sont les suites de ces recherches ?
Notre découverte ne clôt peut-être pas définitivement le débat, mais elle montre que, dans ce qui était un vide documentaire, nous avons des fossiles en Afrique qui représentent un ancêtre très plausible pour les Sapiens. On n’a donc pas besoin de les faire venir d’ailleurs.
Nous avons en projet de réaliser le séquençage des protéines fossiles peut-être préservées dans ces ossements. Si ces analyses sont couronnées de succès, elles apporteront des éléments supplémentaires à la compréhension de leur position dans l’arbre des origines humaines.
Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches, commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.
Jean-Jacques Hublin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.01.2026 à 11:56
Du chatbot du pape au canard de Vaucanson, les croyances derrière l’intelligence artificielle ne datent pas d’hier
Michael Falk, Senior Lecturer in Digital Studies, The University of Melbourne
Texte intégral (3678 mots)

Des mythes antiques à la tête parlante du pape, de Prométhée aux algorithmes modernes, l’intelligence artificielle (IA) puise dans notre fascination intemporelle pour la création et le pouvoir de la connaissance.
Il semble que l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) ait donné naissance à une véritable bulle spéculative. Des bulles, il y en a déjà eu beaucoup, de la tulipomanie du XVIIe siècle à celle des subprimes du XXIe siècle. Pour de nombreux commentateurs, le précédent le plus pertinent aujourd’hui reste la bulle Internet des années 1990. À l’époque, une nouvelle technologie – le World Wide Web – avait déclenché une vague d’« exubérance irrationnelle ». Les investisseurs déversaient des milliards dans n’importe quelle entreprise dont le nom contenait « .com ».
Trois décennies plus tard, une autre technologie émergente déclenche une nouvelle vague d’enthousiasme. Les investisseurs injectent à présent des milliards dans toute entreprise affichant « IA » dans son nom. Mais il existe une différence cruciale entre ces deux bulles, qui n’est pas toujours reconnue. Le Web existait. Il était bien réel. L’intelligence artificielle générale, elle, n’existe pas, et personne ne sait si elle existera un jour.
En février, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, écrivait sur son blog que les systèmes les plus récents commencent tout juste à « pointer vers » l’IA dans son acception « générale ». OpenAI peut commercialiser ses produits comme des « IA », mais ils se réduisent à des machines statistiques qui brassent des données, et non des « intelligences » au sens où on l’entend pour un être humain.
Pourquoi, dès lors, les investisseurs sont-ils si prompts à financer ceux qui vendent des modèles d’IA ? L’une des raisons tient peut-être au fait que l’IA est un mythe technologique. Je ne veux pas dire par là qu’il s’agit d’un mensonge, mais que l’IA convoque un récit puissant et fondateur de la culture occidentale, celui des capacités humaines de création. Peut-être les investisseurs sont-ils prêts à croire que l’IA est pour demain, parce qu’elle puise dans des mythes profondément ancrés dans leur imaginaire ?
Le mythe de Prométhée
Le mythe le plus pertinent pour penser l’IA est celui de Prométhée, issu de la Grèce antique. Il en existe de nombreuses versions, mais les plus célèbres se trouvent dans les poèmes d’Hésiode, la Théogonie et les Travaux et les Jours, ainsi que dans la pièce Prométhée enchaîné, traditionnellement attribuée à Eschyle.
Prométhée était un Titan, un dieu du panthéon grec antique. C’était aussi un criminel, coupable d’avoir dérobé le feu à Héphaïstos, le dieu forgeron. Dissimulé dans une tige de fenouil, le feu fut apporté sur Terre par Prométhée, qui l’offrit aux humains. Pour le punir, il fut enchaîné à une montagne, où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie.
Le don de Prométhée n’était pas seulement celui du feu ; c’était celui de l’intelligence. Dans Prométhée enchaîné, il affirme qu’avant son don, les humains voyaient sans voir et entendaient sans entendre. Après celui-ci, ils purent écrire, bâtir des maisons, lire les étoiles, pratiquer les mathématiques, domestiquer les animaux, construire des navires, inventer des remèdes, interpréter les rêves et offrir aux dieux des sacrifices appropriés.
Le mythe de Prométhée est un récit de création d’un genre particulier. Dans la Bible hébraïque, Dieu ne confère pas à Adam le pouvoir de créer la vie. Prométhée, en revanche, transmet aux humains une part du pouvoir créateur des dieux.
Hésiode souligne cet aspect du mythe dans la Théogonie. Dans ce poème, Zeus ne punit pas seulement Prométhée pour le vol du feu ; il châtie aussi l’humanité. Il ordonne à Héphaïstos d’allumer sa forge et de façonner la première femme, Pandore, qui déchaîne le mal sur le monde. Or le feu qu’Héphaïstos utilise pour créer Pandore est le même que celui que Prométhée a offert aux humains.

Les Grecs ont avancé l’idée que les humains sont eux-mêmes une forme d’intelligence artificielle. Prométhée et Héphaïstos recourent à la technique pour fabriquer les hommes et les femmes. Comme le montre l’historienne Adrienne Mayor dans son ouvrage Gods and Robots, les Anciens représentaient souvent Prométhée comme un artisan, utilisant des outils ordinaires pour créer des êtres humains dans un atelier tout aussi banal.
Si Prométhée nous a donné le feu des dieux, il semble logique que nous puissions utiliser ce feu pour fabriquer nos propres êtres intelligents. De tels récits abondent dans la littérature grecque antique, de l’inventeur Dédale, qui créa des statues capables de prendre vie, à la magicienne Médée, qui savait rendre la jeunesse et la vigueur grâce à ses drogues ingénieuses. Les inventeurs grecs ont également conçu des calculateurs mécaniques pour l’astronomie ainsi que des automates remarquables, mues par la gravité, l’eau et l’air.
Le pape et le chatbot
Deux mille sept cents ans se sont écoulés depuis qu’Hésiode a consigné pour la première fois le mythe de Prométhée. Au fil des siècles, ce récit a été repris sans relâche, en particulier depuis la publication, en 1818, de Frankenstein ; ou le Prométhée moderne de Mary Shelley.
Mais le mythe n’est pas toujours raconté comme une fiction. Voici deux exemples historiques où le mythe de Prométhée semble s’être incarné dans la réalité.
Gerbert d’Aurillac fut le Prométhée du Xe siècle. Né au début des années 940 de notre ère, il étudia à l’abbaye d’Aurillac avant de devenir moine à son tour. Il entreprit alors de maîtriser toutes les branches du savoir connues de son temps. En 999, il fut élu pape. Il mourut en 1003 sous son nom pontifical de Sylvestre II.
Des rumeurs sur Gerbert se répandirent rapidement à travers l’Europe. Moins d’un siècle après sa mort, sa vie était déjà devenue légendaire. L’une des légendes les plus célèbres, et la plus pertinente à l’ère actuelle de l’engouement pour l’IA, est celle de la « tête parlante » de Gerbert. Cette légende fut racontée dans les années 1120 par l’historien anglais Guillaume de Malmesbury dans son ouvrage reconnu et soigneusement documenté, la Gesta Regum Anglorum (Les actions des rois d’Angleterre).
Gerbert possédait des connaissances approfondies en astronomie, une science de la prévision. Les astronomes pouvaient utiliser l’astrolabe pour déterminer la position des étoiles et prévoir des événements cosmiques, comme les éclipses. Selon Guillaume, Gerbert aurait mis son savoir en astronomie au service de la création d’une tête parlante. Après avoir observé les mouvements des étoiles et des planètes, il aurait façonné une tête en bronze capable de répondre à des questions par « oui » ou par « non ».
Gerbert posa d’abord la question : « Deviendrai-je pape ? »
« Oui », répondit la tête.
Puis il demanda : « Mourrai-je avant d’avoir célébré la messe à Jérusalem ? »
« Non », répondit la tête.
Dans les deux cas, la tête avait raison, mais pas comme Gerbert l’avait prévu. Il devint bien pape et évita judicieusement de partir en pèlerinage à Jérusalem. Un jour cependant, il célébra la messe à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. Malheureusement pour lui, la basilique était alors simplement appelée « Jérusalem ».
Gerbert tomba malade et mourut. Sur son lit de mort, il demanda à ses serviteurs de découper son corps et de disperser les morceaux, afin de rejoindre son véritable maître, Satan. De cette manière, il fut, à l’instar de Prométhée, puni pour avoir volé le feu.

C’est une histoire fascinante. On ne sait pas si Guillaume de Malmesbury y croyait vraiment. Mais il s’est bel et bien efforcé de persuader ses lecteurs que cela était plausible. Pourquoi ce grand historien, attaché à la vérité, aurait-il inséré une légende fantaisiste sur un pape français dans son histoire de l’Angleterre ? Bonne question !
Est-ce si extravagant de croire qu’un astronome accompli puisse construire une machine de prédiction à usage général ? À l’époque, l’astronomie était la science de la prédiction la plus puissante. Guillaume, sobre et érudit, était au moins disposé à envisager que des avancées brillantes en astronomie pourraient permettre à un pape de créer un chatbot intelligent.
Aujourd’hui, cette même possibilité est attribuée aux algorithmes d’apprentissage automatique, capables de prédire sur quelle publicité vous cliquerez, quel film vous regarderez ou quel mot vous taperez ensuite. Il est compréhensible que nous tombions sous le même sortilège.
L’anatomiste et l’automate
Le Prométhée du XVIIIe siècle fut Jacques de Vaucanson, du moins si l’on en croit Voltaire :
Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,
Semblait, de la nature imitant les ressorts
Prendre le feu des cieux pour animer les corps.
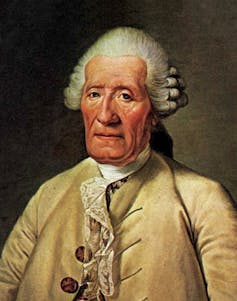
Vaucanson était un grand mécanicien, célèbre pour ses automates, des dispositifs à horlogerie reproduisant de manière réaliste l’anatomie humaine ou animale. Les philosophes de l’époque considéraient le corps comme une machine – alors pourquoi un mécanicien n’aurait-il pu en construire une ?
Parfois, les automates de Vaucanson avaient aussi une valeur scientifique. Il construisit par exemple un « Flûteur automate » doté de lèvres, de poumons et de doigts, capable de jouer de la flûte traversière de façon très proche de celle d’un humain. L’historienne Jessica Riskin explique dans son ouvrage The Restless Clock que Vaucanson dut faire d’importantes découvertes en acoustique pour que son flûtiste joue juste.
Parfois, ses automates étaient moins scientifiques. Son « Canard digérateur » connut un immense succès, mais se révéla frauduleux. Il semblait manger et digérer de la nourriture, mais ses excréments étaient en réalité des granulés préfabriqués dissimulés dans le mécanisme.
Vaucanson consacra des décennies à ce qu’il appelait une « anatomie en mouvement ». En 1741, il présenta à l’Académie de Lyon un projet visant à construire une « imitation de toutes les opérations animales ». Vingt ans plus tard, il s’y remit. Il obtint le soutien du roi Louis XV pour réaliser une simulation du système circulatoire et affirma pouvoir construire un corps artificiel complet et vivant.

Il n’existe aucune preuve que Vaucanson ait jamais achevé un corps entier. Finalement, il ne put tenir la promesse que soulevait sa réputation. Mais beaucoup de ses contemporains croyaient qu’il en était capable. Ils voulaient croire en ses mécanismes magiques. Ils souhaitaient qu’il s’empare du feu de la vie.
Si Vaucanson pouvait fabriquer un nouveau corps humain, ne pourrait-il pas aussi en réparer un existant ? C’est la promesse de certaines entreprises d’IA aujourd’hui. Selon Dario Amodei, PDG d’Anthropic, l’IA permettra bientôt aux gens « de vivre aussi longtemps qu’ils le souhaitent ». L’immortalité semble un investissement séduisant.
Sylvestre II et Vaucanson furent de grands maîtres de la technologie, mais aucun des deux ne fut un Prométhée. Ils ne volèrent nul feu aux dieux. Les aspirants Prométhée de la Silicon Valley réussiront-ils là où leurs prédécesseurs ont échoué ? Si seulement nous avions la tête parlante de Sylvestre II, nous pourrions le lui demander.
Michael Falk a reçu des financements de l'Australian Research Council.
27.01.2026 à 16:26
Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?
Catherine Guaspare, Sociologue, Ingénieure d'études, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Michel Dubois, Sociologue, Directeur de recherche CNRS, Sorbonne Université
Texte intégral (2385 mots)
Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. Nous vous proposons de découvrir les conclusions de l’ouvrage L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques, de Catherine Guaspare et Michel Dubois aux éditions PUF, en 2025.
L’intégrité scientifique est une priorité institutionnelle qui fait consensus. Par-delà la détection et le traitement des méconduites scientifiques, la plupart des organismes d’enseignement supérieur et de recherche partagent aujourd’hui un même objectif de promouvoir une culture des bonnes pratiques de recherche.
Il est tentant d’inscrire cette culture dans une perspective historique : la priorité accordée aujourd’hui à l’intégrité n’étant qu’un moment dans une histoire plus longue, celle des régulations qui s’exercent sur les conduites scientifiques. Montgomery et Oliver ont par exemple proposé de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de ces régulations : la période antérieure aux années 1970 caractérisée par l’autorégulation de la communauté scientifique, la période des années 1970-1990 caractérisée par l’importance accordée à la détection et la prévention des fraudes scientifiques et, depuis les années 1990 et la création de l’Office of Research Integrity, première agence fédérale américaine chargée de l’enquête et de la prévention des manquements à l’intégrité dans la recherche biomédicale financée sur fonds publics, la période de l’intégrité scientifique et de la promotion des bonnes pratiques.
Cette mise en récit historique de l’intégrité peut sans doute avoir une valeur heuristique, mais comme tous les grands récits, celui-ci se heurte aux faits. Elle laisse croire que la communauté scientifique, jusque dans les années 1970, aurait été capable de définir et de faire appliquer par elle-même les normes et les valeurs de la recherche. Pourtant, la régulation qui s’exerce par exemple sur la recherche biomédicale est très largement antérieure aux années 1970, puisqu’elle prend forme dès l’après-Seconde Guerre mondiale avec le Code de Nuremberg (1947), se renforce avec la Déclaration d’Helsinki (1964) et s’institutionnalise progressivement à travers les comités d’éthique et les dispositifs juridiques de protection des personnes.
Elle laisse ensuite penser que la détection des fraudes scientifiques comme la promotion des bonnes pratiques seraient autant de reculs pour l’autonomie de la communauté scientifique. Mais, à y regarder de plus près, les transformations institutionnelles – l’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015, la création de l’Office français de l’intégrité scientifique en 2017, l’entrée de l’intégrité dans la loi en 2020 –, sont le plus souvent portées par des représentants de la communauté scientifique. Et ce qui peut paraître, de loin, une injonction du politique faite au scientifique relève fréquemment de l’auto-saisine, directe ou indirecte, de la communauté scientifique. L’entrée en politique de l’intégrité scientifique démontre la capacité d’une partie limitée de la communauté scientifique à saisir des fenêtres d’opportunité politique. À l’évidence, pour la France, la période 2015-2017 a été l’une de ces fenêtres, où, à la faveur d’une affaire retentissante de méconduite scientifique au CNRS en 2015, du rapport porté par Pierre Corvol en 2016, de la lettre circulaire de Thierry Mandon en 2017, ces questions passent d’un débat professionnel à un objet de politique publique structuré.
Enfin, ce récit historique de l’intégrité semble suggérer qu’à la culture institutionnelle de détection des fraudes scientifiques, caractéristique des années 1970-1990, viendrait désormais se substituer une culture, plus positive, des bonnes pratiques et de la recherche responsable. Certes, l’innovation et la recherche responsables sont autant de mots-clés désormais incontournables pour les grandes institutions scientifiques, mais la question de la détection des méconduites demeure plus que jamais d’actualité, et ce d’autant qu’il s’est opéré ces dernières années un déplacement de la détection des fraudes scientifiques vers celle des pratiques discutables. La question de la qualification des méconduites scientifiques comme celle de leur mesure n’ont jamais été autant d’actualité.
Si le sociologue ne peut que gagner à ne pas s’improviser historien des sciences, il ne peut toutefois rester aveugle face aux grandes transformations des sciences et des techniques. En particulier, la communauté scientifique du XXIᵉ siècle est clairement différente de celle du siècle dernier. Dans son rapport 2021, l’Unesco rappelait qu’entre 2014 et 2018 le nombre de chercheurs a augmenté trois fois plus vite que la population mondiale, avec un total de plus de huit millions de chercheurs en équivalent temps plein à travers le monde.
Cette densification de la communauté scientifique n’est pas sans enjeu pour l’intégrité scientifique. Avec une communauté de plus en plus vaste, il faut non seulement être en mesure de parler d’une même voix, normaliser les guides et les chartes, mais s’assurer que cette voix soit entendue par tous. Même si l’institutionnalisation de l’intégrité est allée de pair avec une forme d’internationalisation, tous les pays ne sont pas en mesure de créer les structures et les rôles que nous avons eu l’occasion de décrire.
Par ailleurs, la croissance de la communauté scientifique s’accompagne mécaniquement d’une augmentation du volume des publications scientifiques qui met à mal les mécanismes traditionnels de contrôle. D’où d’ailleurs le développement d’alternatives au mécanisme de contrôle par les pairs. On a beaucoup parlé de la vague de publications liées à la crise de la Covid-19, mais la vague souterraine, peut-être moins perceptible pour le grand public, est plus structurelle : toujours selon les données de l’Unesco, entre 2015 et 2019, la production mondiale de publications scientifiques a augmenté de 21 %. Qui aujourd’hui est capable de garantir la fiabilité d’un tel volume de publications ?
Qui dit enfin accroissement du volume de la communauté scientifique, dit potentiellement densification des réseaux de collaborations internationales, à l’intérieur desquels les chercheurs comme les équipes de recherche sont autant d’associés rivaux. La multiplication des collaborations internationales suppose de pouvoir mutualiser les efforts et de s’assurer de la qualité de la contribution de chacun comme de sa reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de souligner l’importance de considérer les sentiments de justice et d’injustice éprouvés par les scientifiques dans la survenue des méconduites scientifiques : une contribution ignorée, un compétiteur qui se voit récompensé tout en s’écartant des bonnes pratiques, des institutions scientifiques qui interdisent d’un côté ce qu’elles récompensent de l’autre, etc., autant de situations qui nourrissent ces sentiments.
Par ailleurs, la multiplication des collaborations, dans un contexte où les ressources (financements, postes, distinctions, etc.) sont par principe contraintes, implique également des logiques de mise en concurrence qui peuvent être vécues comme autant d’incitations à prendre des raccourcis.
Outre la transformation démographique de la communauté scientifique, le sociologue des sciences ne peut ignorer l’évolution des modalités d’exercice du travail scientifique à l’ère numérique. La « datafication » de la science, à l’œuvre depuis la fin du XXᵉ siècle, correspond tout autant à l’augmentation du volume des données numériques de la recherche qu’à l’importance prise par les infrastructures technologiques indispensables pour leur traitement, leur stockage et leur diffusion. L’accessibilité et la diffusion rapide des données de la recherche, au nom de la science ouverte, ouvrent des perspectives inédites pour les collaborations scientifiques. Elles créent une redistribution des rôles et des expertises dans ces collaborations, avec un poids croissant accordé à l’ingénierie des données.
Mais, là encore, cette évolution technologique engendre des défis majeurs en termes d’intégrité scientifique. L’édition scientifique en ligne a vu naître un marché en ligne des revues prédatrices qui acceptent, moyennant paiement, des articles sans les évaluer réellement. Si les outils de l’intelligence artificielle s’ajoutent aux instruments traditionnels des équipes de recherche, des structures commerciales clandestines, les « paper mill » ou usines à papier, détournent ces outils numériques pour fabriquer et vendre des articles scientifiques frauduleux à des auteurs en quête de publications. Si l’immatérialité des données numériques permet une circulation accélérée des résultats de recherche, comme on a pu le voir durant la crise de la Covid-19, elle rend également possibles des manipulations de plus en plus sophistiquées. Ces transformations structurelles créent une demande inédite de vigilance à laquelle viennent répondre, chacun à leur manière, l’évaluation postpublication comme ceux que l’on appelle parfois les nouveaux détectives de la science et qui traquent en ligne les anomalies dans les articles publiés (images dupliquées, données incohérentes, plagiat) et ce faisant contribuent à la mise en lumière de fraudes ou de pratiques douteuses.
À lire aussi : Ces détectives qui traquent les fraudes scientifiques : conversation avec Guillaume Cabanac
Plus fondamentalement, cette montée en puissance des données numériques de la recherche engendre des tensions inédites entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. À l’occasion d’un entretien, un physicien, travaillant quotidiennement à partir des téraoctets de données générés par un accélérateur de particules, nous faisait remarquer, avec une pointe d’ironie, qu’il comprenait sans difficulté l’impératif institutionnel d’archiver, au nom de l’intégrité scientifique, l’intégralité de ses données sur des serveurs, mais que ce stockage systématique d’un volume toujours croissant de données entrait directement en contradiction avec l’éthique environnementale de la recherche prônée par ailleurs par son établissement. Intégrité scientifique ou éthique de la recherche ? Faut-il choisir ?
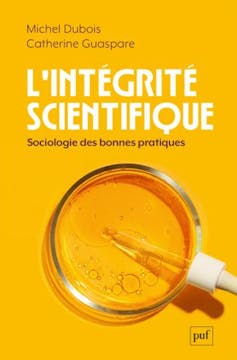
On touche du doigt ici la diversité des dilemmes auxquels sont quotidiennement confrontés les scientifiques dans l’exercice de leurs activités. La science à l’ère numérique évolue dans un équilibre délicat entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. Et l’un des enjeux actuels est sans doute de parvenir à maximiser les bénéfices des technologies numériques tout en minimisant leurs impacts négatifs. D’où la nécessité pour les institutions de recherche de promouvoir une culture de l’intégrité qui puisse dépasser la simple exigence de conformité aux bonnes pratiques, en intégrant les valeurs de responsabilité sociale auxquelles aspire, comme le montrent nos enquêtes, une part croissante de la communauté scientifique.
Le texte a été très légèrement remanié pour pouvoir être lu indépendamment du reste de l’ouvrage en accord avec les auteurs.
Catherine Guaspare et Michel Dubois sont les auteurs du livre L'intégrité scientifique dont cet article est tiré.
Michel Dubois a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique depuis septembre 2025.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
