ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture
29.10.2025 à 15:34
Redirection du commerce chinois vers l’Europe : petits colis, grand détour
Charlotte Emlinger, Économiste, CEPII
Kevin Lefebvre, Économiste, CEPII
Vincent Vicard, Économiste, adjoint au directeur, CEPII
Texte intégral (1389 mots)
À la suite des droits de douane mis en place par Donald Trump, on observe une réorientation significative du commerce chinois des États-Unis vers l’Union européenne à travers les… petits colis. Explication en chiffres et en graphiques.
La hausse spectaculaire des droits de douane imposée par les États-Unis aux importations en provenance de Chine (57,6 % fin août, après un pic à 135,3 % en avril d’après les calculs du Peterson Institute for International Economics) ferme largement le marché états-unien aux exportateurs chinois. La chute massive des exportations chinoises vers les États-Unis qui s’en est suivie, en recul de près de 25 % sur la période juin-août 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024, témoigne de l’ampleur du choc.
Le risque est que, confrontés à la fermeture de l’un de leurs deux principaux marchés, les exportateurs chinois cherchent à réorienter leurs exportations, laissant planer le doute d’une redirection massive vers l’Union européenne (UE). Dans cette perspective, la Commission européenne a mis en place une surveillance du détournement des flux commerciaux pour identifier les produits faisant l’objet d’une hausse rapide des quantités importées et d’une baisse de prix, toutes origines confondues.
Dynamiques saisonnières
Le premier graphique montre que, depuis février, la baisse des exportations chinoises s’est accompagnée d’une hausse de celles vers l’Union européenne. Une analyse des évolutions passées révèle toutefois que la hausse observée au deuxième trimestre 2025 correspond en partie à un rebond saisonnier observé à la même époque les années précédentes et lié au Nouvel An chinois, que cela soit pour l’Union européenne, les États-Unis, le Vietnam, le Japon ou la Corée du Sud. Il est essentiel d’interpréter les évolutions récentes au regard des dynamiques saisonnières des années antérieures.
Observer une hausse des importations ne suffit pas à conclure à une redirection du commerce chinois des États-Unis vers l’Union européenne (UE).
Pour qu’un tel phénomène soit avéré, il faut que les mêmes produits soient simultanément concernés par une hausse des volumes d’exportations de la Chine vers l’UE et une baisse vers les États-Unis. Par exemple, une hausse des exportations de véhicules électriques chinois vers l’UE ne peut pas être considérée comme une réorientation du commerce puisque ces produits n’étaient pas exportés auparavant vers les États-Unis.
De la même manière, les produits faisant l’objet d’exceptions dans les droits mis en place par Donald Trump, comme certains produits électroniques, certains combustibles minéraux ou certains produits chimiques, ne sont pas susceptibles d’être réorientés. Cela ne signifie pas qu’une augmentation des flux d’importations de ces produits ne soulève pas des enjeux de compétitivité et de concurrence pour les acteurs français ou européens. Mais ces enjeux sont d’une autre nature que ceux liés à une pure redirection du commerce chinois consécutive à la fermeture du marché des États-Unis.
Deux critères complémentaires
Pour identifier les produits pour lesquels la fermeture du marché états-unien a entraîné une redirection du commerce chinois vers l’Union européenne (UE), nous combinons deux critères :
Si, d’une année sur l’autre, le volume des exportations d’un produit vers l’UE augmente plus vite que celui des trois quarts des autres produits chinois exportés vers l’UE en 2024.
Si, d’une année sur l’autre, le volume des exportations d’un produit vers les États-Unis diminue plus vite que celui des trois quarts des autres produits chinois exportés vers les États-Unis en 2024.
Seuls les produits pour lesquels les exportations chinoises vers les États-Unis étaient suffisamment importantes avant la fermeture du marché états-unien sont retenus. Soit les 2 499 produits pour lesquels la part des États-Unis dans les exportations chinoises dépassait 5 % en 2024. Pour 402 de ces produits, le volume des exportations chinoises a enregistré une forte baisse entre juin-août 2024 et juin-août 2025.
Près de 176 produits concernés
En combinant les deux critères, 176 produits sont concernés en juin-août 2025 (graphique 2), soit 44 % des produits dont les ventes ont nettement chuté sur le marché états-unien. Parmi eux, 105 concernent des produits pour lesquels l’Union européenne a un avantage comparatif révélé, c’est-à-dire pour lesquels la hausse des importations se fait sur une spécialisation européenne.
Moins de la moitié des 176 produits connaît simultanément une forte baisse de leur prix, suggérant qu’une partie de la redirection du commerce chinois entraîne une concurrence par les prix sur le marché européen.
En valeur, les 176 produits identifiés représentent 7,2 % des exportations chinoises vers l’Union européenne sur la dernière période disponible, et la tendance est clairement à la hausse (graphique 3). Cette progression s’explique pour beaucoup par la hausse des flux de petits colis redirigés vers l’UE depuis qu’en avril 2025, les États-Unis ont supprimé l’exemption de droits de douane sur les colis en provenance de Chine.
Secteurs des machines, chimie et métaux
Les produits sujets à redirection vers le marché européen sont très inégalement répartis entre secteurs (graphique 4). En nombre, on les retrouve concentrés dans les secteurs des machines et appareils (42 produits), de la chimie (31) et des métaux (22). En valeur cependant, les secteurs les plus concernés sont de très loin les petits colis (qui représentent 5,4 % du commerce bilatéral en juin-août 2025) et, dans une moindre mesure, les équipements de transport, les huiles et machines et appareils.
En comparaison, le Japon subit davantage la réorientation du commerce chinois puisque 298 produits sont identifiés en juin-août 2025 (graphique 5). Ces produits représentent une part beaucoup plus importante des exportations chinoises vers le Japon (16,2 % en juin-août 2025). Des dynamiques similaires sont observées en Corée du Sud (196 produits, représentant 2,7 % de son commerce bilatéral avec la Chine) et le Vietnam (230 produits, 6,5 % de son commerce bilatéral avec la Chine).
Fin du régime douanier simplifié
Consciente de la menace qu’ils représentent, la Commission européenne prévoit, dans le cadre de la prochaine réforme du Code des douanes, de mettre fin au régime douanier simplifié dont ces petits colis bénéficient actuellement. Cette réforme ne devrait pas entrer en vigueur avant 2027. D’ici là, certains États membres tentent d’aller plus vite.
En France, le gouvernement a récemment proposé, dans le cadre de son projet de loi de finance, d’instaurer une taxe forfaitaire par colis. Mais, sans coordination européenne, la mesure risque d’être contournée : les colis pourraient simplement transiter par un pays de l’UE à la taxation plus clémente.
Au-delà des petits colis, un certain nombre d’autres produits sont également soumis à des hausses rapides des quantités importées, susceptibles de fragiliser les producteurs européens, mais ils représentent une part limitée des importations européennes en provenance de Chine. Des tendances qui devront être confirmées dans les prochains mois par un suivi régulier.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
29.10.2025 à 14:00
Le crime organisé est la première entreprise du Brésil et la menace la plus grave qui pèse sur le pays
Robert Muggah, Richard von Weizsäcker Fellow na Bosch Academy e Co-fundador, Instituto Igarapé
Texte intégral (1692 mots)
Le raid policier, mené le 28 octobre 2025, contre des narcotrafiquants dans les favelas de Rio de Janeiro est le plus meurtrier qu’ait connu la ville. Mais face à l’empire que le crime organisé a constitué au Brésil, les interventions spectaculaires ne suffisent plus : l’État doit inventer une réponse nationale.
Le 28 octobre, à Rio de Janeiro, des véhicules blindés de la police ont pénétré dans les complexes d’Alemão et de Penha pour interpeller des chefs de gangs. Des fusillades ont éclaté, des routes ont été bloquées, des bus ont été détournés, des écoles et des campus ont été fermés, et des drones ont largué des explosifs sur les forces de l’ordre. Le soir venu, l’État confirmait que « l’opération Contenção » s’était soldée par 124 morts, dont quatre policiers. Ce fut la confrontation la plus sanglante jamais enregistrée dans l’histoire de la ville.
L’économie criminelle du Brésil est sortie des ruelles pour investir désormais les salles de réunion, figurer dans les bilans financiers et s’infiltrer dans des chaînes d’approvisionnement essentielles. Au cours de la dernière décennie, le crime organisé brésilien s’est étendu à l’ensemble du pays et même à d’autres continents. Les plus grandes organisations de trafic de drogue, comme le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV), se trouvent au cœur de véritables réseaux franchisés. Les « milices » de Rio – groupes paramilitaires principalement composés de policiers et de pompiers ayant quitté leurs anciennes fonctions ou, pour certains, les exerçant toujours – monétisent le contrôle qu’elles exercent sur le territoire en se faisant payer pour des « services » de protection, de transport, de construction et autres services essentiels.
À mesure que ces groupes se sont professionnalisés, ils ont diversifié leurs activités, qui vont aujourd’hui du trafic de cocaïne à la contrebande d’or, aux paiements numériques et aux services publics. Lorsque les groupes armés du Brésil se disputent les marchés illicites, la violence peut atteindre des niveaux comparables à ceux de zones de guerre.
Rien n’illustre mieux le nouveau modèle économique que le commerce illégal de carburants. Comme je l’ai écrit dans The Conversation fin août, les autorités ont effectué environ 350 perquisitions dans huit États dans le cadre de l’opération Carbone Caché, qui visait à faire la lumière sur le blanchiment présumé de sommes colossales à travers des importations de dérivés du pétrole et un réseau de plus d’un millier de stations-service. Entre 2020 et 2024, environ 52 milliards de réaux (8,3 milliards d’euros) de flux suspects ont transité par des fintechs, dont l’une fonctionnait en tant que banque parallèle. Des fonds fermés auraient investi dans des usines d’éthanol, des flottes de camions et un terminal portuaire, donnant aux profits illicites un vernis de respectabilité.
Sur les marchés financiers, les investisseurs sont à présent conscients des dangers. Ces derniers mois, les fonds d’investissement ont enfin commencé à considérer l’infiltration criminelle comme un risque matériel, et les analystes cherchent plus qu’auparavant à déterminer quelles chaînes logistiques, quelles institutions de paiement et quels fournisseurs régionaux pourraient être exposés.
Gouvernance criminelle
Les équipes de sécurité des entreprises cartographient l’extorsion et le contrôle des milices avec la même attention que celle qu’elles accordent aux menaces cyber.
La réaction du marché aux opérations menées en août par la police dans le cadre de l’opération « Carbone Caché » a rappelé que le crime organisé ne génère pas seulement de la violence : il fausse la concurrence, pénalise les entreprises respectueuses des règles et impose une taxe cachée aux consommateurs. Il n’est donc pas surprenant qu’en septembre, le ministre des finances Fernando Haddad ait annoncé la création d’une nouvelle unité policière dédiée à la lutte contre les crimes financiers.
La « gouvernance criminelle » s’est propagée des prisons aux centres financiers. Dans leurs fiefs de Rio, les gangs et les milices opèrent comme des bandits traditionnels, contrôlant le territoire et les chaînes d’approvisionnement logistique. Pendant ce temps, des franchises du PCC et du CV sont apparues à l’intérieur des terres et en Amazonie, cherchant à engranger des profits plus élevés grâce à la contrebande d’or et de bois, ainsi qu’au transport fluvial illégal de marchandises.
Ces factions opèrent désormais au-delà des frontières, du pays en lien avec des organisations criminelles de Colombie, du Pérou et du Venezuela.
Les outils de contrôle n’ont pas suivi l’évolution du crime
Le bilan humain reste accablant, même si les chiffres nationaux agrégés se sont améliorés. En 2024, le Brésil a enregistré 44 127 morts violentes intentionnelles, son niveau le plus bas depuis 2012, mais cela représente encore plus de 120 homicides par jour. La géographie de l’intimidation s’est étendue : une enquête commandée par le Forum brésilien de la sécurité publique a révélé que 19 % des Brésiliens – soit environ 28,5 millions de personnes – vivent aujourd’hui dans des quartiers où la présence de gangs ou de milices est manifeste, soit une hausse de cinq points en un an.
Les outils de contrôle de l’État n’ont pas suivi l’évolution du modèle économique du crime organisé. Les incursions spectaculaires et les occupations temporaires font les gros titres et entraînent de nombreuses morts, mais perturbent peu le marché. Les polices des États, depuis longtemps considérées comme les plus létales du monde, démantèlent rarement les groupes criminels.
Les politiques étatiques et municipales sont elles aussi devenues de plus en plus vulnérables : le financement des campagnes, les contrats de travaux publics et les licences sont désormais des canaux investis par le pouvoir criminel. L’opération fédérale d’août a constitué une rare exception et a apporté la preuve de l’efficacité d’une répression visant l’argent du crime, et non seulement les porte-flingues.
Si les législateurs brésiliens sont sérieux, ils doivent traiter le crime organisé comme une défaillance du marché national et réagir à l’échelle nationale. Cela commence par placer le gouvernement fédéral à la tête de forces spéciales interinstitutionnelles permanentes réunissant police fédérale, procureur général, administration fiscale, cellules de renseignement financier, régulateurs du carburant et du marché, ainsi que Banque centrale.
Il faut davantage de condamnations
Ces équipes devront disposer d’un mandat clair pour agir au-delà des frontières des États et accomplir quatre tâches simples : suivre en temps réel les paiements à risque ; publier une liste fiable des propriétaires réels des entreprises qui contrôlent le carburant, les ports et d’autres actifs stratégiques ; connecter les données fiscales, douanières, de concurrence et de marchés afin qu’un signal d’alerte dans un domaine déclenche des vérifications dans les autres ; et se tourner vers des tribunaux au fonctionnement accéléré pour rapidement geler et saisir l’argent sale.
Les incitations doivent être modifiées afin que la police et les procureurs soient récompensés pour les condamnations et les saisies d’actifs, et non pour le nombre de morts. Et là où des groupes criminels ont pris le contrôle de services essentiels, comme les transports ou les services publics, ceux-ci doivent être placés sous contrôle fédéral temporaire et faire l’objet d’appels d’offres transparents et étroitement surveillés afin d’être, au final, remis à des opérateurs légaux.
Le Brésil a déjà prouvé qu’il pouvait mener de grandes opérations aux effets dévastateurs contre le crime. Le véritable défi est désormais de faire en sorte que le travail ordinaire de la loi – enquêtes, constitution de dossiers solides… – soit plus décisif que les interventions spectaculaires. Faute de quoi, il ne faudra pas longtemps pour qu’une grande ville brésilienne ne soit complètement paralysée.
Robert Muggah est affilié à l’Institut Igarapé et à SecDev.
28.10.2025 à 15:31
Marwan Barghouti, l’homme de l’espoir pour une Palestine démocratique
Vincent Lemire, Professeur en histoire contemporaine, Université Gustave Eiffel
Anna C. Zielinska, MCF en philosophie morale, philosophie politique et philosophie du droit, membre des Archives Henri-Poincaré, Université de Lorraine
Texte intégral (3792 mots)
Emprisonné depuis vingt-trois ans en Israël pour des crimes qu’il a toujours niés, Marwan Barghouti, aujourd’hui âgé de 66 ans, est selon toutes les enquêtes d’opinion le responsable politique le plus populaire au sein de la population palestinienne. S’il était libéré et participait à la prochaine élection présidentielle promise par Mahmoud Abbas avant fin 2026, ce cadre du Fatah pourrait jouer un rôle fondamental dans l’établissement d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.
Déterminé à obtenir l’indépendance de la Palestine dans les frontières de 1967, le dirigeant palestinien est tout autant hostile aux attentats visant les civils israéliens. Dans le monde entier, mais aussi en Israël même, des voix influentes demandent sa libération, à laquelle le gouvernement Nétanyahou continue, pour l’heure, de s’opposer.
Marwan Barghouti est né en 1959 à Kobar, non loin de Ramallah. Il a été, à partir de 1994, secrétaire général du Fatah en Cisjordanie et, à partir de 1996, membre du Conseil législatif palestinien, le Parlement de l’Autorité palestinienne créé à la suite des accords d’Oslo. Figure clé de la deuxième Intifada (2000-2005), entré dans la clandestinité en 2001, il est emprisonné en Israël depuis 2002. Le dirigeant palestinien a toujours nié avoir commandité les crimes pour lesquels il a été condamné à perpétuité.
L’homme est parfois qualifié de « Mandela palestinien ». Cette analogie est contestée par certains : alors que Barghouti a participé à des actions militaires, Nelson Mandela aurait prôné la lutte non violente au sein du Congrès national africain (ANC). C’est faux. Mandela a bel et bien fondé, puis dirigé, à partir de mai 1961, l’organisation Umkhonto we Sizwe (Fer de lance de la nation), la branche militaire de l’ANC.
Depuis son emprisonnement il y a vingt-trois ans, la libération de Barghouti n’a longtemps été exigée, au niveau international, que par des partis politiques de gauche (le Parti communiste français, notamment), mais cette revendication est aujourd’hui devenue largement transpartisane. En janvier 2024, Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet (le service de renseignement intérieur israélien), affirme que la remise en liberté de Barghouti est indispensable pour créer une alternative politique en Palestine, et donc un processus de paix effectif. Début octobre 2025, Ronald Lauder, figure clé de la communauté juive américaine, président du Congrès juif mondial depuis 2007, a proposé de se rendre en personne à Charm-el-Cheikh, en Égypte, (où se tenaient les négociations entre Israéliens et Palestiniens) pour inclure la libération de Barghouti dans l’accord final de cessez-le-feu, proposition rejetée par Benyamin Nétanyahou.
Hadja Lahbib, actuelle commissaire européenne à l’aide humanitaire et à la gestion de crises, ancienne ministre belge des affaires étrangères de 2022 à 2024, issue du centre-droit, a déclaré récemment qu’elle voyait en Barghouti « le Nelson Mandela palestinien » qui pourrait « gagner la confiance de son peuple tout en le conduisant vers la paix ».
Enfin, le 23 octobre 2025, Donald Trump, interrogé sur Barghouti dans une interview à Time, a répondu :
« C’est la question du jour. Je vais donc prendre une décision. »
Le même journal a également rapporté que l’épouse de Marwan, l’avocate Fadwa Barghouti, s’est adressée directement au président américain pour lui demander de contribuer à la libération de son mari.
Si, pour l’heure, Benyamin Nétanyahou refuse d’envisager une telle possibilité, cette libération semble moins improbable que par le passé. Mais que veut réellement Marwan Barghouti, que pèse-t-il sur la scène politique palestinienne, et qu’est-ce que son éventuelle libération pourrait changer ?
Les engagements politiques de Barghouti
Diplômé d’un master en relations internationales à l’Université palestinienne de Birzeit (Cisjordanie), avec un mémoire de recherche consacré à la politique du général de Gaulle au Moyen-Orient, Barghouti a été plusieurs fois arrêté pour ses activités à la tête d’organisations étudiantes. Lors de la première Intifada, il est exilé en Jordanie (1987-1993). Son retour en Palestine est rendu possible grâce aux négociations d’Oslo et il devient secrétaire général du Fatah en Cisjordanie en 1994, fervent soutien du processus de paix, tout en s’opposant au maintien de la colonisation.
Pendant la seconde Intifada (2000-2005), il joue un rôle politique de premier plan, en tant que dirigeant des Tanzim, les « organisations populaires » du Fatah, dont certains éléments s’engagent dans la lutte armée. L’action armée des Tanzim se caractérise alors par le refus des attentats suicides et des attaques contre les civils, avec des actions concentrées contre l’occupation israélienne à Gaza et en Cisjordanie. En août 2001, quelques mois avant son arrestation, sa voiture est visée par deux missiles antichars et son garde du corps est tué. Lors de son procès en 2004, Barghouti a rappelé que son rôle au sein du Fatah était avant tout politique et il a toujours nié avoir commandité les meurtres dont il était accusé.
Plusieurs sources témoignent du projet politique du leader palestinien. En 1994, dans un entretien avec Graham Usher, Barghouti se présente comme un pont entre deux cultures politiques palestiniennes : l’une forgée en dehors de Palestine, l’autre sous l’occupation israélienne. Il voit les accords d’Oslo comme la fin du rêve d’un « Grand Israël », puisque le gouvernement israélien a reconnu les Palestiniens en tant que peuple et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme son représentant. À ses yeux, l’indépendance est l’objectif prioritaire de la lutte, car elle est la condition indispensable à une évolution démocratique en Palestine. Il défend le pluralisme et craint qu’une victoire du Hamas aux élections législatives de 1996 (et auxquelles le mouvement islamiste ne se présentera finalement pas) ne provoque la mise en place de la loi islamique.
Il plaide pour la création d’institutions véritablement démocratiques afin de préserver le pluralisme, et rappelle que le futur gouvernement palestinien devra respecter les oppositions. Enfin, il voit l’OLP comme une étape transitoire dans le processus de mise en place de l’Autorité palestinienne puis de l’État palestinien. Il compare ce rôle à celui de l’Organisation sioniste mondiale, qu’il décrit comme « une institution internationale qui facilite et soutient le droit au retour ». Son État palestinien idéal est, explique-t-il :
« un État démocratique, fondé sur les droits humains et le respect de la pluralité des confessions et des opinions. Tout ce qui nous a été historiquement refusé dans notre lutte pour une patrie. Pour les Palestiniens, rien de moins ne sera acceptable. »

Dans une autre interview réalisée en 2001, au début de la seconde Intifada, Barghouti déclare notamment que « l’objectif de l’Intifada est de mettre fin à l’occupation israélienne », ce qui signifie concrètement l’arrêt de l’occupation « de l’ensemble des Territoires occupés » et l’établissement « d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 ». Au même moment, quelques mois après le déclenchement de la seconde Intifada et par l’intermédiaire d’un haut responsable du Shin Bet, il propose une trêve crédible au premier ministre israélien Ariel Sharon, qui la refuse. Le fait que Barghouti soit en prison depuis 2002 ne l’a pas empêché de participer aux élections parlementaires en Palestine de janvier 2006, les dernières à ce jour, en étant très largement réélu.
Quelques mois avant son arrestation en 2002, Barghouti publie dans le Washington Post une tribune intitulée « Vous voulez la sécurité ? Mettez fin à l’occupation », dans laquelle il dénonce les arguments prétendument sécuritaires d’Ariel Sharon :
« Le seul moyen pour les Israéliens de vivre en sécurité est de mettre fin à l’occupation israélienne du territoire palestinien, qui dure depuis trente-cinq ans. Les Israéliens doivent abandonner le mythe selon lequel il serait possible d’avoir la paix et l’occupation en même temps, avec une possible coexistence pacifique entre le maître et l’esclave. L’absence de sécurité israélienne est née de l’absence de liberté palestinienne. Israël ne connaîtra la sécurité qu’après la fin de l’occupation, pas avant. »
Ces mots n’ont rien perdu de leur évidence frontale et de leur force. À côté de la tragédie à Gaza, l’occupation de la Cisjordanie provoque aujourd’hui des dégâts incalculables chez les Palestiniens bien sûr, mais également au sein de la société israélienne, peu à peu gangrenée par la brutalité systématique et meurtrière de ses colons et de ses soldats.

Comme nous l’a rapporté le philosophe Sari Nusseibeh, l’engagement de Barghouti pour un État palestinien libre et démocratique était déjà visible dans les années 1980, quand il faisait partie des rares activistes palestiniens à discuter ouvertement avec les députés travaillistes en Israël. Sa position est restée inchangée depuis. Dans le texte du Washington Post déjà cité, Barghouti explicite sa ligne stratégique :
« Moi-même et le mouvement Fatah auquel j’appartiens nous opposons fermement aux attaques contre des civils en Israël, notre futur voisin […]. Je ne cherche pas à détruire Israël, mais seulement à mettre fin à son occupation de mon pays. »
Dans une lettre rédigée en 2016, il insiste également sur les réformes profondes qu’il faudra initier en Palestine pour renouveler et consolider le contrat démocratique entre les dirigeants et les citoyens :
« Nous ne pouvons dissocier la libération de la terre et celle du peuple. Nous avons besoin d’une révolution dans nos systèmes éducatif, intellectuel, culturel et juridique. »
Ce que sa libération pourrait apporter
Barghouti purge actuellement cinq peines d’emprisonnement à perpétuité. Son procès n’a pas répondu aux standards internationaux : Barghouti et ses éminents avocats – Jawad Boulus, Gisèle Halimi et Daniel Voguet, entre autres – ont plaidé que, selon le droit international, le tribunal du district de Tel-Aviv n’était pas compétent pour juger les faits dont il était accusé. Pour cette raison, Barghouti a refusé de répondre en détail aux accusations portées contre lui (le meurtre du prêtre Georgios Tsibouktzakis et de quatre autres civils), se cantonnant à répéter sa condamnation des attentats terroristes visant des civils.
Sa popularité auprès des Palestiniens est impressionnante. Selon un sondage réalisé en mai 2025 par le Centre palestinien pour la recherche politique, 39 % des électeurs en Palestine (Cisjordanie et Gaza) considèrent Barghouti comme le plus apte à succéder à Mahmoud Abbas, ce qui le place en première position, loin devant Khaled Mechaal, chef politique du Hamas exilé au Qatar, deuxième avec 12 %.
Un autre sondage réalisé juste avant le 7 octobre, en septembre 2023, à l’occasion du 30e anniversaire des accords d’Oslo, montrait déjà qu’en cas d’élection présidentielle 34 % des sondés auraient voté pour Marwan Barghouti au premier tour, et 17 % pour le leader du Hamas Ismaïl Haniyeh. Au second tour, Barghouti l’aurait facilement emporté par 60 % des voix contre Haniyeh, alors qu’Haniyeh l’aurait emporté par 58 % contre Mahmoud Abbas.
Non seulement Barghouti est la personnalité préférée des Palestiniens, le rempart contre le Hamas, mais il redonne confiance dans le processus politique lui-même. Selon ce même sondage, la participation aux élections sera 20 % plus élevée si Barghouti est candidat.
La libération de Marwan Barghouti ne suffira pas pour mettre fin au conflit, qui dure depuis plus d’un siècle. C’est un être humain qui peut commettre des erreurs et qui proposera peut-être certaines solutions qui s’avèreront décevantes. Mais, compte tenu de ce qu’il représente aujourd’hui pour les Palestiniens, sa libération apparaît comme un préalable indispensable à tout processus politique.
Depuis les années 1990, il a fait de la lutte contre la corruption et contre les inégalités femmes-hommes le cœur de son engagement. Leader incontesté du Mouvement des prisonniers, qui regroupe des militants de toutes les factions palestiniennes, il œuvre inlassablement pour une réconciliation nationale. En juin 2006, il initie l’Appel des prisonniers, signé par des militants de toutes obédiences, Hamas et Jihad islamique compris, qui déclare qu’un État palestinien devra être créé « dans les frontières de juin 1967 », ce qui revient à accepter l’existence d’Israël à l’extérieur de ces mêmes frontières.
L’annulation par Mahmoud Abbas des élections législatives de mai 2021, qui devaient marquer la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, a été accueillie avec défiance par l’opinion publique palestinienne, qui ne s’identifie plus à ce dirigeant démonétisé, inefficace et dépassé, tant sur le plan politique qu’économique. Le peuple palestinien, à ce moment dramatique de son histoire, doit de toute urgence pouvoir débattre librement de son avenir, avec de nouveaux horizons constructifs.
Le déclenchement du processus démocratique ne se fera pas sans Barghouti
Aujourd’hui, outre la confiance dont il jouit dans le milieu politique et intellectuel international et auprès du public israélien, Marwan Barghouti est soutenu par une grande partie de la population palestinienne. Si un État viable et démocratique peut advenir en Palestine, ce sera avec lui.
Il y a urgence, car la mise en place d’une gouvernance palestinienne à Gaza, pour avoir une chance de réussir, devra être soutenue par la population, au moment où le gouvernement d’extrême droite en Israël cherche au contraire à favoriser les clans mafieux de Gaza, dans le seul but de concurrencer le Hamas ; au moment également où Itamar Ben-Gvir, ministre israélien d’extrême droite en charge des prisons, vient menacer physiquement Barghouti dans sa cellule et couvre les mauvais traitements dont il est régulièrement victime.
Pour qu’un gouvernement palestinien soit soutenu non seulement en Cisjordanie, mais aussi à Gaza, il faut que les structures de l’Autorité palestinienne soient profondément refondées. Pour cela, des élections sont indispensables. Elles ont failli avoir lieu en mai 2021, mais, nous l’avons évoqué, elles ont été reportées sine die à la suite de la décision israélienne d’interdire les bureaux de vote à Jérusalem-Est, privant de participation les 400 000 habitants palestiniens de Jérusalem. Aujourd’hui, grâce aux smartphones et aux nouvelles technologies d’identification numérique, le vote électronique permettra aisément de surmonter cet obstacle.
Marwan Barghouti est aujourd’hui le favori incontesté des futures élections palestiniennes. Si elles étaient organisées sans lui, elles perdraient de ce fait toute crédibilité. Il pourrait bien sûr se présenter depuis sa prison, comme en 2021. Mais recréer cette situation de soumission et d’hostilité ne permettrait pas une véritable campagne électorale participative et citoyenne. Les Palestiniens continueraient d’avoir l’impression que leurs ambitions sont humiliées. Les Israéliens continueraient de ne voir en Barghouti qu’un terroriste emprisonné et ne pourraient imaginer l’émergence d’un État palestinien comme un avenir acceptable, voire désirable.
Un homme et un symbole
La présentation de Barghouti comme un homme providentiel susceptible de sauver non seulement la Palestine, mais aussi Israël, provoque parfois des réactions ironiques, y compris à l’égard des auteurs de ce texte. Cette ironie est déplacée.
Dans des situations politiques dégradées, toute collectivité a besoin de symboles unificateurs. C’était le cas en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, aux États-Unis avec Martin Luther King, mais également en Pologne et en Tchécoslovaquie : Lech Wałęsa et Václav Havel n’ont pas offert de solutions toutes faites, mais leur libération puis leur arrivée au pouvoir ont fait partie d’un processus d’émancipation et de prise de conscience politique pour leurs peuples respectifs.
L’incarnation d’une lutte, ce n’est pas le culte de la personnalité. Certains leaders charismatiques émergent dans des situations où tous les autres facteurs de stabilité se sont effondrés. De ce fait, ils constituent une cristallisation des aspirations politiques, et cela aussi devrait être pris au sérieux, dans le moment de bascule historique que nous traversons.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
27.10.2025 à 15:57
Vers un « goulag numérique » : comment la Russie développe le contrôle et la surveillance de ses citoyens
Iurii Trusov, chercheur en philosophie, docteur en sciences politiques, Université Bordeaux Montaigne
Texte intégral (2208 mots)
Interdiction de nombreuses applications de communication, obligations multiples imposées aux entreprises digitales et aux citoyens au nom de la transparence et de la lutte contre l’« extrémisme », caméras de surveillance omniprésentes dans les grandes villes, systèmes de reconnaissance faciale de plus en plus efficaces… Le contexte actuel est propice au développement, en Russie, d’un système intégré permettant au pouvoir de surveiller ses citoyens toujours plus étroitement.
Depuis le 1er septembre 2025, à Moscou (capitale de la Fédération de Russie), les travailleurs migrants originaires de pays exemptés de visas ont l’obligation d’installer sur leur smartphone une application qui transmettra en temps réel leurs données de géolocalisation aux services du ministère de l’intérieur. En cas de désactivation de la géolocalisation ou de suppression de l’application, les migrants seront inscrits sur un registre de « personnes sous contrôle » ; leurs transactions financières et leurs cartes SIM seront bloquées ; et ils pourront être expulsés. Cette expérimentation se poursuivra jusqu’en 2029, après quoi cette pratique pourrait être étendue à d’autres régions de Russie.
Cette loi, qui s’inscrit dans une série de mesures visant à renforcer de manière accélérée le contrôle numérique en Russie, depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, constitue une mise à l’épreuve de la possibilité d’une surveillance totale de l’ensemble des citoyens du pays.
Le souvenir, encore vivace, des tendances totalitaires à l’œuvre en Union soviétique (URSS) – suppression des libertés, surveillance de la population, mise en place du rideau de fer et censure totale –, symbolisées par le système du goulag (les camps de travail où étaient envoyés, entre autres, les prisonniers politiques pour délit d’opinion) a donné naissance à la formule de « goulag numérique », qui désigne le renforcement sans cesse plus palpable du contrôle technologique dans la Russie contemporaine.
Éléments de contrôle et de surveillance des citoyens, introduits en 2022
Jusqu’en 2022, la surveillance et la censure concernaient principalement la sphère politique, notamment la lutte contre l’opposition. Depuis, face à un mécontentement croissant, l’État a jugé nécessaire d’étendre son contrôle à tous les domaines de la vie publique.
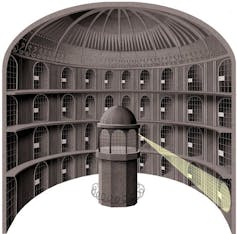
La Russie met progressivement en place ce que l’on pourrait appeler un « panoptique numérique ». Initialement conçu par Jeremy Bentham (1748-1832), le panoptique était un projet de prison circulaire dotée d’une tour de surveillance centrale. À l’intérieur du panoptique, le gardien voit tous les prisonniers, mais ces derniers ne savent pas s’ils sont observés. De là naît un sentiment d’être surveillé à tout moment. Ce sentiment est de plus en plus partagé par les habitants de la Russie contemporaine, car le développement des technologies permet aux services de sécurité et à l’État d’accéder à un volume croissant de données personnelles et de constamment contrôler les citoyens à sa discrétion.
Après l’invasion totale de l’Ukraine lancée en février 2022, les autorités adoptent en urgence de nouvelles lois criminalisant la diffusion d’informations divergeant de la position officielle du Kremlin. Ces normes – pénalisation de « diffusion de fausses nouvelles » et de la « discréditation » des forces armées russes, durcissement des textes ciblant les « agents de l’étranger » – instaurent une censure stricte et, de fait, criminalisent toute opinion ou information différente de celles provenant des sources officielles de l’État.
Dans le même temps, le régime continue de développer des solutions numériques. Depuis décembre 2022, toutes les entreprises qui collectent les données biométriques des citoyens sont tenues de les transférer au Système biométrique unifié de l’État (EBS). La loi n’interdit pas aux forces de l’ordre de consulter ces données. Ainsi se crée une base technologique permettant une utilisation généralisée des systèmes de reconnaissance faciale, déjà activement employés pour identifier puis arrêter les participants à des actions de protestation et les « ennemis de l’État ».
Entre 2025 et 2026, le ministère du développement numérique de la Fédération de Russie prévoit de dépenser 2 milliards de roubles (plus de 20 millions d’euros) pour la création d’une plateforme unifiée dotée d’une IA destinée à traiter les vidéos des caméras de surveillance dans toute la Russie. Rien qu’à Moscou, plus de 200 000 caméras sont déjà installées et utilisées par la police pour le suivi et l’analyse des comportements.
Un autre système électronique, le registre des personnes soumises aux obligations militaires, vise à répondre au chaos causé par la mobilisation de 2022 et à la fuite à l’étranger de centaines de milliers d’hommes et de leurs familles.
Ce système agrège les données personnelles provenant d’autres bases de données gouvernementales et est enrichi par les informations fournies par les employeurs et par les banques. C’est par son intermédiaire que sont envoyées les convocations électroniques, considérées comme ayant été automatiquement remises à leurs destinataires quelques jours après leur apparition dans cette base. Dès lors, jusqu’à ce qu’elle se présente au commissariat militaire (nom donné aux centres chargés de gérer la mobilisation militaire de la population), la personne se voit automatiquement interdire de quitter le pays et subit d’autres restrictions, notamment l'interdiction de conduire un véhicule.
Internet souverain ou rideau de fer numérique ?
L’écrivaine et philosophe américaine Shoshana Zuboff a forgé la notion de « capitalisme de surveillance », un système où les grandes corporations possèdent nos données et essaient de prédire et de contrôler notre comportement. Elle se demande si les sociétés informatiques qui détiennent un grand volume de données personnelles, comme Google, Meta, Amazon et d’autres, pourraient avoir plus de pouvoir que les États.
En Russie, la réponse se trouve déjà sous nos yeux : toutes les grandes sociétés informatiques russes possédant les données personnelles de leurs utilisateurs sont soit soumises au Kremlin soit bloquées.
Après le début de la guerre, le géant informatique Yandex (l’équivalent russe de Google) a été contraint d’effectuer un filtrage actif des informations dans son moteur de recherche et ses actualités. Il signale désormais certaines sources comme étant non fiables et diffusant de fausses informations, tout en promouvant celles qui sont loyales à la position officielle.
Le géant étranger Meta, déclaré organisation extrémiste en mars 2022, est bloqué sur le territoire russe, ainsi que ses services Facebook et Instagram. Ont également été bloqués X (anciennement Twitter) et de nombreux médias indépendants. YouTube a été ralenti et, de fait, bloqué.
En août 2025, Roskomnadzor (l’agence russe qui s’occupe de la censure sur Internet et du blocage des ressources d’information jugées indésirables) a bloqué la possibilité de passer des appels audio et vidéo sur Telegram et sur WhatsApp. Même si la raison officiellement invoquée pour cela est la protection contre les escroqueries téléphoniques, en réalité, ce processus va de pair avec le lancement de la messagerie d’État, MAX, à laquelle les forces de l’ordre ont un accès total.
La messagerie sera intégrée au système numérique de services publics. Le simple fait d’utiliser un service VPN pour contourner le blocage est considéré comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un « crime », tel que la recherche de « contenus extrémistes » (notion dont la définition, volontairement floue, permet de déclencher des poursuites sur des fondements ténus).
D’ici à novembre 2025, un programme d’intelligence artificielle (IA) pour la censure des livres sera lancé en Russie. Au départ, le programme ne recherchera que la propagande liée à la drogue dans les ouvrages. Comme c’est souvent le cas, en cas de succès, l’État pourrait facilement étendre la censure à la critique du pouvoir ou de l’armée, ou encore à la recherche de documents à thématique LGBTQIA+, sachant que le « mouvement LGBTQIA+ » a été classé comme extrémiste.
À lire aussi : Russie : l’homophobie d’État, élément central de la « guerre des valeurs » contre l’Occident
Vers un totalitarisme numérique ?
Ainsi, en moins de trois ans, la Russie a construit un système cohérent et interconnecté, où les interdictions du législateur relatives à l’information sont renforcées par des technologies de surveillance totale, et le contrôle numérique des citoyens assure l’application des lois répressives.
Ces lois et ces solutions technologiques s’accumulent en un effet boule de neige, entraînant une accoutumance progressive de la population. Sous prétexte de protéger les citoyens face à diverses menaces – contexte de guerre et de sanctions, attaques terroristes, escroqueries –, l’État met tout en œuvre pour renforcer le pouvoir total de Vladimir Poutine.
Au XXe siècle, le philosophe Isaiah Berlin (1909-1997) promouvait une alternative pluraliste et libérale au totalitarisme, impliquant l’existence d’une sphère de la vie humaine libre de toute ingérence étatique, de surveillance et de contrôle, ce qu’il appelait la « sphère de la liberté négative » (négative au sens de « privée d’entraves »). Aujourd’hui, nous assistons à un resserrement drastique de cette sphère en Russie et au développement progressif du « totalitarisme numérique », c’est-à-dire d’un pouvoir totalitaire armé non seulement de lois répressives, mais aussi de nouvelles technologies : caméras, bases de données électroniques et IA de plus en plus sophistiquée.
Iurii Trusov ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.10.2025 à 15:53
L’industrie automobile européenne face à la guerre en Ukraine
Prieto Marc, Professeur-HDR, directeur de l'Institut ESSCA "Transports & Mobilités Durables", ESSCA School of Management
Texte intégral (1601 mots)

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a conduit le secteur automobile à revoir ses chaînes de valeur en gérant de nouveaux risques. Les constructeurs européens de véhicules cherchent à ajuster leur organisation toyotiste, dite « au plus juste », en acceptant de recréer des stocks, d’intégrer verticalement certains partenaires stratégiques et de repenser la localisation des productions.
Au-delà du drame humain, le conflit en Ukraine a obligé les industriels européens de l’automobile à ajuster leurs chaînes de valeurs et à repenser la localisation de leurs activités. Dans un article publié en 2022 dans la Revue d’économie financière, nous analysions les déflagrations et recompositions économiques de ce conflit à travers la situation délicate de l’industrie automobile européenne à l’aube de la guerre.
Déjà soumis à la pénurie des semi-conducteurs et la pandémie de Covid-19, les constructeurs et les équipementiers automobiles ont dû engager, en à peine quelques mois, des reconfigurations de leurs chaînes de valeurs. Les modèles de production ont alors été revus, en particulier par ceux inspirés du « juste à temps ». Au-delà de l’abandon du marché russe ceux d’entre eux qui s’y étaient engagés tels que Renault-Nissan, Volkswagen, ou Michelin, les orientations stratégiques ont été profondément remises en question.
Avec quelles réussites ?
Chaînes de valeur déjà en tension avant le conflit
Le 24 février 2022, le conflit en Ukraine éclate tandis que le secteur automobile européen peine à digérer les deux crises du Covid-19 et de la pénurie des semi-conducteurs. Le conflit précipite le secteur dans une rupture de chaînes de valeurs du fait de l’effondrement du marché russe couplé à l’atonie des marchés européens.
Au cours des premiers mois de la guerre, le marché russe s’est effondré de 85 %. Le marché ukrainien, certes plus petit, mais stratégiquement important pour certains fournisseurs, a vu ses immatriculations chuter de plus de 90 %. La rupture des chaînes d’approvisionnement a conduit à l’arrêt de plusieurs usines d’assemblage comme en Allemagne pour Volkswagen à Zwickau et à Dresde en mars 2022. La vulnérabilité du modèle de production lean est apparue au grand jour. Conçu pour réduire les stocks et les coûts, le modèle semble peu adapté à un monde devenu bien plus fragmenté, exposé à des événements géopolitiques extrêmes.
La transition vers une mobilité décarbonée oblige les acteurs à se tourner vers le tout électrique nécessitant métaux et terres rares. Cette transition complique la tâche des industries européennes, puisque la Russie est un acteur majeur dans l’exportation de métaux essentiels à la fabrication de moteurs, de catalyseurs et de batteries, comme l’aluminium, le nickel ou encore le palladium. Le prix de ces matériaux a ainsi bondi entre 2020 et 2022 ce qui a contribué à l’inflation des prix des véhicules.
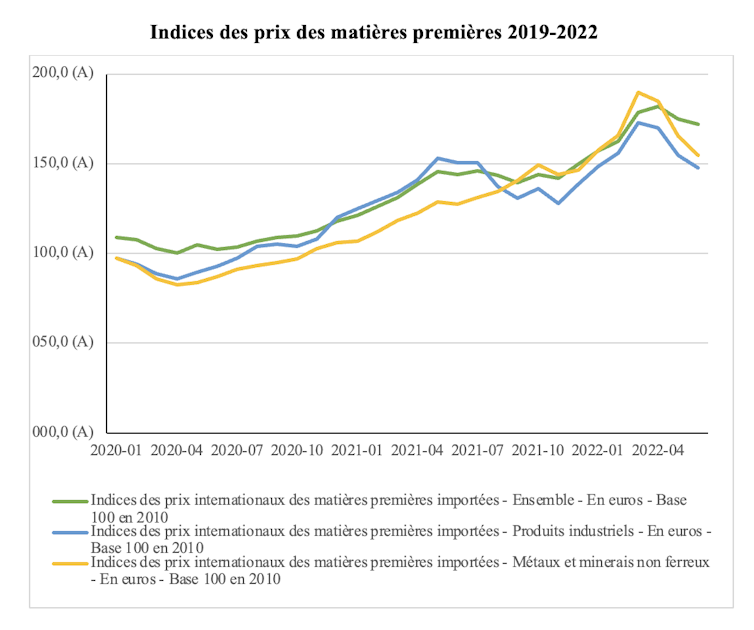
Régionalisation accrue de la production automobile
Le retrait du marché russe par les marques européennes a laissé la place aux acteurs chinois qui ont vu leurs parts de marché progresser depuis 2022. Grâce aux « nouvelles routes de la soie », qui renforcent les liens logistiques entre Moscou et Pékin, des constructeurs comme Geely ou Haval ont été parmi les premiers à se positionner pour approvisionner le marché russe.
Au-delà des risques de sanctions pour Pékin, cette stratégie illustre comment la géopolitique redessine les équilibres industriels à l’échelle mondiale.
La guerre en Ukraine a amené les constructeurs à modifier leurs priorités, puisque la logique de gestion des risques est alors devenue primordiale devant l’efficacité économique. La révision des chaînes de valeur a amené les constructeurs à diversifier leurs fournisseurs et internaliser davantage d’étapes de production. Il s’agit du rachat ou de la prise de participation dans les entreprises qui fabriquent certains composants devenus stratégiques – on parle alors d’intégration verticale puisque les constructeurs absorbent des entreprises qui interviennent en amont du processus de production des véhicules. Ces derniers ont également dû accepter les coûts liés au maintien de stocks stratégiques. La proximité géographique et la fiabilité des partenaires sont apparues tout aussi importantes que le prix.
Pour limiter les risques, l’industrie automobile européenne cherche dès lors à sécuriser l’accès aux matières premières critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de régions politiquement instables. La régionalisation accrue de la production s’impose.
Relance des volumes en Europe à travers davantage de petits véhicules abordables
La sécurisation des approvisionnements s’avère particulièrement ardue dans la transition énergétique qui s’annonce.
L’électrification de la filière automobile crée de nouvelles fragilités. Pourquoi ? Parce qu’elle requiert une quantité accrue de semi-conducteurs et de minéraux rares, comme le lithium et le cobalt. Les tensions géopolitiques autour de Taïwan, premier fabricant mondial de puces électroniques, ou dans la région du Sahel, stratégique pour l’approvisionnement en uranium et autres ressources, pourraient provoquer de nouvelles crises d’approvisionnement.
Cette contrainte oblige l’Europe à trouver des voies possibles pour une sécurité économique permettant à toute la filière automobile de continuer de restructurer ses activités sans compromettre sa compétitivité.
Jusqu’à récemment, le secteur semblait relever ce défi en misant sur une stratégie industrielle axée sur la réduction des volumes de production, tout en élargissant les gammes de modèles et en augmentant les prix, notamment grâce aux SUV électrifiés (hybrides rechargeables et véhicules électriques à batterie) et à la montée en gamme (ou « premiumisation » des ventes). L’atonie des ventes observée depuis 2024 remet en cause cette stratégie.
La relance des ventes pourrait venir d’une offre de véhicules électriques plus petits et abordables, afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone du parc automobile européen d’ici 2050. Fabriqués sur le territoire européen, ces véhicules devront aussi répondre à des exigences légitimes de contenu local. Ce retour à des petits modèles compacts, qui sont dans l’ADN des marques européennes, apparaît comme une condition indispensable pour préserver l’indépendance industrielle du continent et maintenir les emplois dans le secteur.
Prieto Marc ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.10.2025 à 20:55
Comment Telegram est devenue le champ de bataille des conflits modernes
Marie Guermeur, Sorbonne Université
Texte intégral (3104 mots)
Née comme une messagerie destinée à protéger au mieux la vie privée de ses utilisateurs, Telegram est devenue un théâtre d’affrontement permanent. Sur l’application, de multiples canaux diffusent l’horreur brute, la criminalité organisée prospère, les services secrets recrutent et, surtout, la propagande bat son plein. Décryptage du fonctionnement de cet outil qui s’est transformé en véritable arme de guerre numérique.
Longtemps perçue comme une alternative sécurisée aux réseaux sociaux de la galaxie Meta notamment par une frange d’internautes soucieux de la protection de leur vie privée et par les défenseurs des libertés numériques, séduits par son image « anti-système » et sa promesse d’un espace affranchi de la surveillance commerciale, Telegram, fondée en 2013 par les frères Durov, s’est imposée comme l’une des plateformes les plus influentes de la planète.
Pavel Durov, en est à sa seconde aventure numérique. Avant Telegram, il avait lancé VKontakte (VK), souvent qualifié de « Facebook russe ». Dès sa création en 2006, VK s’était distinguée comme un rare bastion de liberté sur le Web russe, jusqu’à ce que Durov refuse de livrer aux services secrets de son pays (le FSB) les données des blogueurs et de fermer les pages de l’opposition. Ce refus lui coûta progressivement le contrôle de l’entreprise, reprise ensuite par des proches du pouvoir. Aujourd’hui, Telegram, forte de près de 950 millions d’utilisateurs dans le monde, séduit par son chiffrement, sa promesse de confidentialité et la possibilité de créer des « canaux » rassemblant des centaines de milliers de personnes.
Mais derrière l’image de havre numérique pour défenseurs de la vie privée, Telegram est devenue un outil central pour des usages beaucoup plus sombres : trafic, voyeurisme et surtout… guerres de propagande.
Arrestation et mise en examen de Pavel Durov
Le 24 août 2024, le cofondateur de Telegram Pavel Durov, franco-russe, est arrêté et mis en examen en France. La justice lui reproche de ne pas avoir empêché la prolifération sur son réseau d’activités illégales : trafic de stupéfiants, pédocriminalité, escroqueries.
Mis en examen, Durov s’est défendu en soulignant le caractère inédit d’une telle procédure : « Arrêter le PDG d’une plateforme parce que certains utilisateurs commettent des crimes, c’était absurde », déclare-t-il alors. Depuis cette date, Telegram collabore davantage avec les autorités, selon plusieurs sources judiciaires. Mais la question reste entière : comment contrôler un espace aussi vaste et opaque ?
En Chine, une enquête de CNN a récemment révélé l’existence d’un gigantesque réseau de voyeurisme pornographique hébergé sur Telegram. Plus de 100 000 membres y échangeaient, à l’insu de leurs victimes, des milliards de photos et vidéos intimes et récits d’agression. L’affaire a choqué l’opinion publique et souligné l’extrême difficulté à contenir les dérives de l’application.
Car Telegram est un écosystème : tout y circule, de la contrebande de drogues aux fichiers frauduleux, en passant par des contenus extrêmes de propagande. Si le darknet exigeait autrefois des compétences techniques pour accéder à ces contenus, l’application rend aujourd’hui de tels échanges disponibles en quelques clics.
Du chiffrement à la cruauté
C’est sans doute sur le terrain de la guerre que Telegram s’impose le plus brutalement. Lors des attaques terroristes du Hamas contre Israël en octobre 2023, l’application est devenue un champ de bataille parallèle. Les groupes armés ont immédiatement compris le potentiel de l’outil : diffuser sans filtre des vidéos de violences, de tortures, de profanations de cadavres, accompagnées de messages galvanisant.
Le même jour, nous avons décidé d’infiltrer le canal du Hamas depuis la France. La facilité avec laquelle nous avons pu accéder à des contenus insoutenables a été glaçante : viols, exécutions, actes nécrophiles, corps – souvent d’enfants – mutilés et exhibés comme trophées de victoire. Chaque jour, des dizaines de vidéos de propagande inondaient les canaux, repoussant sans cesse les limites de l’indicible.
Le lendemain, les canaux liés à l’armée israélienne, Tsahal, adoptaient la même logique : images de massacres et de représailles, accompagnées de messages de haine et d’encouragement à la vengeance. La guerre des armes trouvait son double, instantané et cru, sur Telegram.
Les horreurs observées sont telles que nous avons choisi de ne pas toutes les relater ici. Mais il est essentiel que le lecteur comprenne l’ampleur de cette banalisation de la violence : sur cette plateforme, la cruauté devient quotidienne, accessible à tous et, souvent, reproduite à l’infini.
« Ce canal enfreint la législation locale »
En France, il a fallu attendre le 17 octobre 2023 pour qu’un blocage partiel du compte du Hamas soit mis en place, peu après la diffusion d’une vidéo montrant un otage. Dès lors, une tentative de connexion au canal faisait apparaître : « Ce canal enfreint la législation locale. » Trop tard pour éviter la propagation de scènes inimaginables, parfois accessibles à des mineurs, et pour certaines reprises sur des réseaux comme X. Car l’utilisation de VPN permet encore de contourner ces restrictions, laissant circuler sans entrave les pires images de guerre.
Cette banalisation de la violence interroge. En rendant la propagande accessible au grand public, Telegram transforme le spectateur en témoin, parfois complice, d’atrocités qui étaient jadis reléguées aux marges cachées d’Internet, à ce que l’on appelait le « darknet ». Les groupes armés, eux, ont compris l’impact psychologique de cette exposition massive. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire ; elle s’écrit et se diffuse en direct, dans la poche de chacun.
Telegram, par sa souplesse et par son opacité, est devenue l’arme invisible des conflits contemporains.
De l’outil de contestation à l’arme de propagande
Bien avant d’être l’outil favori des groupes armés au Moyen-Orient, Telegram avait déjà marqué l’histoire des contestations. Du Printemps arabe aux manifestations iraniennes « Femme, vie, liberté » de 2022 après la mort de Mahsa Amini, l’application s’est imposée comme un refuge numérique pour les dissidents, pour les journalistes citoyens et pour les organisateurs de mobilisations. Son atout majeur : un chiffrement et une architecture décentralisée qui échappent aux régulations traditionnelles.
De 2015 à 2019, Telegram se dressait comme un outil central de mobilisation citoyenne en Iran. Néanmoins, en 2018, les autorités iraniennes ont procédé à l’interdiction de la plateforme, sous prétexte de préserver la sécurité nationale, anéantissant l’un des derniers canaux d’expression et de coordination accessibles à la société civile.
En Biélorussie, puis ailleurs en Europe de l’Est, les manifestants se sont organisés sur l’application, tandis que les États tentaient de reprendre la main sur ce canal incontrôlable. L’histoire de Telegram dans les révoltes est celle d’un couteau à double tranchant : un outil de contre-pouvoir, mais aussi une scène où s’exerce la lutte pour le contrôle de l’information.
Lorsque Israël a coupé l’accès à Internet dans la bande de Gaza, le 27 octobre 2023, Telegram est restée la seule fenêtre sur le monde. Les journalistes palestiniens, comme Motaz Azaiza, y ont diffusé en direct des images de frappes, de victimes et de quartiers dévastés, vues par des millions de personnes en quelques minutes. L’application suppléait ainsi les médias traditionnels, empêtrés dans la vérification des faits et les contraintes d’accès.
Sur ce même réseau circulaient aussi les vidéos officielles des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, glorifiant leurs combattants et diffusant des images insoutenables. De leur côté, les chaînes proches de l’armée israélienne diffusaient leurs propres contenus militaires, souvent teintés de propagande. Telegram s’est transformé en un champ de bataille à part entière, où journalisme citoyen, propagande terroriste, communication officielle et rumeurs incontrôlées cohabitaient sur le même écran.
Une plateforme qui refuse de trancher
Contrairement à X (ex-Twitter) ou à Facebook, Telegram se distingue par l’absence de modération coercitive. Son cofondateur Pavel Durov revendique une conception radicale de la liberté d’expression, n’hésitant pas à héberger des groupes proscrits ailleurs. Cette latitude a bénéficié à des organisations, telles que Hayat Tahrir Al-Cham, ex-filiale d’Al-Qaida en Syrie, qui exerce désormais un contrôle politique et administratif étendu sur plusieurs régions du pays, où elle s’impose comme l’autorité de facto, tout en continuant à y diffuser sans entrave communiqués, vidéos et matériaux idéologiques.
Dans des zones auxquelles aucun journaliste étranger n’a accès et où les reporters locaux risquent leur vie, ces chaînes deviennent la seule source d’information disponible. Mais ce sont les groupes armés eux-mêmes qui décident de ce qui est montré, et de ce qui est passé sous silence.
L’exemple de la Syrie est frappant. En 2022, lors des pénuries de gaz, les chaînes prorégime imputaient la crise aux sanctions occidentales. En parallèle, celles de l’opposition diffusaient des vidéos de files interminables dans les stations-service, accusant l’Iran de sabotage. Aucune des deux versions n’a pu être vérifiée par des médias indépendants, mais toutes deux ont circulé massivement et nourri la colère populaire.
L’étude, publiée en 2024 par Hans W. A. Hanley et Zakir Durumeric lors de l’International Conference on Web and Social Media (ICWSM), intitulée Partial Mobilization : Tracking Multilingual Information Flows amongst Russian Media Outlets and Telegram montre l’usage systématique de Telegram par les médias russes pour orienter et modeler l’opinion publique autour de la guerre en Ukraine. Les auteurs développent une approche originale et extensible, capable de suivre les flux narratifs à travers différentes langues et plateformes, appliquée à 215 000 articles et 2,48 millions de messages Telegram. Les chercheurs soulignent une intensification marquée de l’usage de Telegram par les médias russes, qui y puisent régulièrement des thèmes qu’ils réinjectent ensuite dans leurs publications traditionnelles.
Leur méthodologie permet également d’identifier de manière automatisée des chaînes Telegram véhiculant des contenus pro-russes ou anti-ukrainiens, souvent en résonance avec les narrations des médias d’État. Telegram se révèle ainsi un vecteur stratégique clé, central dans la diffusion et la coordination de ces narratives (récits) à grande échelle.
Telegram, média ou machine d’influence ?
À cette dimension géopolitique s’ajoute une logique économique. Dans plusieurs pays en crise, comme le Liban, des équipes rédactionnelles de médias exclusivement installés sur Telegram se sont constituées. Certaines chaînes vendent des abonnements premium, d’autres acceptent des dons en cryptomonnaies, et beaucoup diffusent des contenus sponsorisés par des partis politiques. Sans transparence ni vérification, la frontière entre information et propagande devient poreuse.
Le danger n’est pas seulement la désinformation. C’est qu’à défaut d’alternatives, Telegram devienne la seule source d’information dans des environnements fragiles. Là où les civils n’ont pas de médias indépendants, et tandis que les milices et les États disposent de puissants relais, l’équilibre est faussé dès le départ.
Depuis le début de l’invasion russe, en février 2022, la direction générale du renseignement de l’Ukraine (DGRR, souvent désignée par son acronyme anglais HUR) a adopté une posture inédite : utiliser Telegram comme un relais officiel. Selon une étude publiée en août 2025 par le chercheur Peter Schrijver dans la revue scientifique The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, il s’agit d’un tournant majeur. Pour la première fois, un service de renseignement d’État conçoit sa communication non plus comme une sensibilisation ponctuelle, mais comme un processus continu d’engagement public.
Un instrument de renseignement public
Ce choix illustre ce que les spécialistes appellent la « communication participative du renseignement ». Sur Telegram, la DGRR ne se contente pas de diffuser des informations : elle coordonne le récit national tout en impliquant directement la population dans la défense du pays. Trois axes structurent cette stratégie. D’abord, l’institution met en avant ses opérations réussies, honore ses agents tombés et valorise ses valeurs de service et de sacrifice. La stratégie consiste à projeter l’image d’un renseignement compétent, héroïque et digne de confiance. Les chercheurs parlent d’un véritable « lobby du renseignement », une diplomatie de l’image destinée à rallier les civils autour d’un appareil habituellement secret.
Ensuite, la DGRR diffuse des documents ciblés visant l’adversaire : conversations interceptées, preuves de crimes de guerre, affaires de corruption, et parfois des données personnelles de militaires russes. Ces publications ont une double fonction : tactique, en fragilisant le moral et la crédibilité des troupes ennemies ; symbolique, en renforçant la légitimité morale de l’Ukraine sur la scène internationale.
Enfin, l’agence implique directement les citoyens. Les canaux Telegram incitent à signaler les mouvements ennemis, proposent un « Main Intelligence Bot » pour centraliser les informations et diffusent des conseils pratiques, notamment de cybersécurité pour les habitants des zones occupées. Dans ce modèle, le citoyen cesse d’être simple spectateur : il devient un acteur distribué de la défense nationale.
Telegram, né comme un refuge pour les défenseurs de la vie privée, est aujourd’hui devenu une scène mondiale où se mêlent contestation, propagande et espionnage. Mais derrière l’écran, c’est une autre guerre qui se joue : celle des récits, des images, sans filtre et sans règles. En rendant l’horreur accessible en un clic, l’application brouille les frontières entre information et manipulation. Dans les conflits du début de notre siècle, ce ne sont plus seulement les bombes qui frappent les populations… ce sont aussi les notifications.
À la suite de la publication de cet article, la communication de Telegram nous a demandé de publier ces éléments :
« Des millions de contenus préjudiciables sont supprimés chaque jour dans le cadre de la modération routinière de Telegram. De plus, Telegram n’est pas une plateforme efficace pour la diffusion de fausses informations, car elle n’utilise pas d’algorithmes favorisant la propagation de contenus sensationnalistes, contrairement à d’autres réseaux.
Telegram a toujours traité toutes les demandes judiciaires contraignantes émanant de l’Union européenne. La seule chose qui a changé depuis la mise en examen de M. Durov est que davantage d’autorités ont commencé à utiliser les canaux légaux appropriés au Digital Services Act. Sans le préciser, l’article donne à tort l’impression que Telegram est à l’origine de cette coopération accrue, alors qu’il s’agit en réalité d’une évolution des pratiques policières.
Loin d’être difficile à contenir, le canal MaskPark [cité dans l’enquête de CNN mentionnée dans l’article] a été fermé en mars 2025 pour violation des conditions d’utilisation de Telegram, dès qu’il a été découvert.
Contrairement aux réseaux traditionnels qui peuvent exposer les utilisateurs à des contenus liés à la guerre via des algorithmes, Telegram n’utilise aucun algorithme pour promouvoir des contenus sensationnalistes. Les utilisateurs n’y accèdent que s’ils les recherchent explicitement.
La modération de Telegram respecte ou dépasse les standards de l’industrie. Dans l’Union européenne, Telegram se conforme pleinement au Digital Services Act.
Telegram est largement utilisé par les membres de l’opposition russe anti-guerre et constitue la dernière source d’information indépendante et non censurée accessible aux citoyens russes, y compris via le canal du président Zelensky. Telegram est une entreprise politiquement neutre qui offre une plateforme à l’expression pacifique de toutes les parties. »
Marie Guermeur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
25.10.2025 à 10:15
Vente par la Russie d’hydrocarbures à la Chine en yuan : fin du dollar, opportunité pour l’euro ?
Suwan Long, Assistant Professor, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management
Texte intégral (1869 mots)

Le yuan (monnaie chinoise, officiellement appelée renminbi) s’impose dans le commerce du pétrole et du gaz entre la Russie et la Chine. Cette évolution présente des risques pour l’Union européenne, mais aussi une opportunité pour l’euro dans le contexte énergétique.
Lors du 25ᵉ Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu à Tianjin, en septembre 2025, les dirigeants chinois et russes ont ouvertement défendu un commerce de l’énergie en dehors du dollar états-unien. Cette poussée vers la dédollarisation, illustrée par l’augmentation des ventes de pétrole et de gaz de la Russie à la Chine en yuan (monnaie chinoise, officiellement renminbi), marque un bouleversement dans le commerce de l’énergie.
Pour l’Union européenne, et plus précisément pour les entreprises de la zone euro, où les importations de pétrole sont encore très largement facturées en dollars, cette évolution agit comme une arme à double tranchant.
Le yuan, central dans les accords énergétiques Russie–Chine
En quelques années, le yuan s’est affirmé comme monnaie de réglage importante dans les échanges énergétiques russo-chinois. En 2022, les entreprises Gazprom et China National Petroleum Corporation (CNPC) commencent à réduire leurs paiements en dollar pour certains contrats, en favorisant l’usage du rouble et du yuan. En 2023, le commerce bilatéral a atteint un record de 240 milliards de dollars (+ 26 %), avec la moitié du pétrole russe exporté vers la Chine.
En 2024, le commerce bilatéral Chine-Russie atteint 244,81 milliards de dollars états-uniens, en hausse de 1,9 % par rapport à 2023, selon les douanes chinoises. Ce chiffre s’explique par la montée des échanges sur la paire CNY/RUB, c’est-à-dire le taux de change entre le yuan chinois et le rouble russe. Autrement dit, de plus en plus d’entreprises russes achètent ou vendent directement des yuans contre des roubles, alors qu’auparavant, elles passaient presque toujours par le USD/RUB, le taux entre dollar des États-Unis et rouble.
Ce glissement reflète un transfert progressif du commerce de l’énergie russe, autrefois dominé par le dollar, vers la monnaie chinoise.
Ce basculement s’est confirmé à Tianjin, où Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi ont soutenu l’usage accru des monnaies nationales. Le président de la République populaire de Chine a même proposé la création d’une banque de développement destinée à contourner le dollar et à limiter l’impact des sanctions.
Plus de 80 % du pétrole de l’UE facturé en dollar
L’OCS réunit dix membres : la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Bélarus. Ils représentent près de la moitié de la population mondiale et un quart du PIB. Le commerce de la Chine avec ses partenaires a atteint 3,65 trillions de yuans (500 milliards de dollars états-uniens) en 2024.
Le commerce de la Chine avec ses partenaires est de plus en plus souvent réglé en yuan, transformant progressivement la monnaie chinoise en instrument international de facturation et d’échange, au-delà de son usage domestique. Le dollar conserve toutefois son statut dominant, représentant encore 58 % des réserves mondiales en 2024.
L’Union européenne (UE) reste largement dépendante du dollar pour ses importations d’énergie. Entre 80 et 85 % du pétrole de l’Union européenne est facturé en dollar états-unien (USD), alors qu’une part infime provient des États-Unis. Ce choix s’explique par le rôle du dollar comme monnaie commune de transaction sur les marchés mondiaux. Il sert d’intermédiaire entre producteurs et acheteurs, quelle que soit leur nationalité. L’UE se rend de facto vulnérable aux variations du dollar et aux décisions de la Réserve fédérale des États-Unis.
Nouvelle complexité pour les entreprises européennes
Si le commerce mondial du pétrole et du gaz cessait d’être dominé par le dollar pour se répartir entre plusieurs monnaies comme le yuan ou la roupie, les entreprises européennes, surtout celles de la zone euro, devraient s’adapter à un environnement financier plus complexe.
Aujourd’hui, la plupart d’entre elles achètent leur énergie en dollars. Elles peuvent se protéger contre les variations du taux de change grâce à des « marchés de couverture » très développés. Ces marchés permettent de conclure des contrats financiers à l’avance pour bloquer un taux et éviter des pertes si la valeur du dollar change.
Avec le yuan, la situation serait plus difficile. Les outils financiers permettant de se couvrir sont encore limités, car la Chine contrôle les mouvements de capitaux et restreint la circulation de sa monnaie à l’étranger. Autrement dit, le yuan ne circule pas librement dans le monde. Cela réduit la liquidité, c’est-à-dire la capacité d’une entreprise à acheter ou vendre rapidement des yuans quand elle en a besoin. Moins la monnaie circule, moins il y a d’échanges possibles, et plus les transactions deviennent lentes et coûteuses. Pour les entreprises, cela signifie des paiements plus complexes et des coûts financiers plus élevés.
Des signes concrets montrent que ce scénario commence à se concrétiser. En mars 2023, la China National Offshore Oil Corporation et TotalEnergies ont conclu la première transaction de gaz naturel liquéfié (GNL) libellée en yuan via une bourse de Shanghai. Quelques mois après, l’entreprise pétrolière publique de la République populaire de Chine a réalisé une autre transaction en yuan avec Engie. Ces accords illustrent la montée en puissance du yuan dans les échanges énergétiques et annoncent un nouvel équilibre où les entreprises européennes devront composer avec une plus grande diversité de devises.
Rôle accru de l’euro dans la facturation énergétique
L’évolution du commerce mondial de l’énergie ouvre une opportunité stratégique pour l’Union européenne : renforcer le rôle de l’euro dans la tarification du pétrole et du gaz, et réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar – ou, demain, du yuan.
L’euro est déjà la deuxième monnaie mondiale, représentant 20 % des réserves. Elle sert de référence pour plus de la moitié des exportations européennes. Dans le commerce de l’énergie, son rôle demeure limité. Dès 2018, la Commission européenne avait d’ailleurs recommandé d’accroître son usage dans la tarification énergétique, afin de consolider la souveraineté économique du continent.
Les progrès les plus visibles concernent le gaz. Selon la Banque centrale européenne, la réduction des approvisionnements russes a poussé l’Union européenne à s’intégrer davantage aux marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL). Les prix européens sont désormais étroitement liés aux marchés asiatiques, ce qui rend l’UE plus sensible aux variations de la demande mondiale. Cette interdépendance renforce l’intérêt de développer des contrats de gaz libellés en euros.
La même logique pourrait s’appliquer au pétrole. l’Union européenne importe plus de 300 milliards d’euros d’énergie chaque année. Elle dispose d’un poids suffisant pour négocier avec ses partenaires commerciaux, notamment les producteurs du Golfe cherchant à diversifier leurs devises.
Vers une monnaie énergétique européenne ?
Faire de l’euro une monnaie de référence dans les échanges énergétiques ne se décrète pas, mais cela pourrait devenir un levier essentiel de la politique monétaire et énergétique européenne.
L’euro dispose d’atouts : il est relativement stable, pleinement convertible, et soutenu par la Banque centrale européenne. Si des cargaisons de pétrole ou de gaz étaient facturées en euros, cela pourrait réduire la dépendance au dollar, simplifier la couverture monétaire pour les entreprises européennes et renforcer l’indépendance financière de l’Union.
Ce virage monétaire implique des défis concrets. Le marché de l’énergie en euros reste peu développé, et certains pays ou entreprises pourraient craindre des sanctions états-uniennes s’ils s’éloignent du dollar. Surmonter ces freins nécessite de renforcer les marchés de capitaux européens, de créer des produits de couverture expressément en euros pour l’énergie, et d’assurer une politique économique stable à l’échelle de la zone euro.
Cette démarche ne vise pas à remplacer le yuan, mais à établir une alternative équilibrée, où l’euro pèse dans la facturation, dans les réserves stratégiques et dans le paysage monétaire mondial.
Suwan Long ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.10.2025 à 16:18
La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis
Bernard Guilhon, Professeur de sciences économiques, SKEMA Business School
Texte intégral (1386 mots)
Les récentes politiques douanières des États-Unis signalent un changement de paradigme. Washington adopte un protectionnisme assumé, centré sur la relocalisation de la production et sur la promotion du « Made in America ». Ce tournant redéfinit les règles du jeu et contribue à une reconfiguration en profondeur de la mondialisation et des flux commerciaux internationaux.
Une lecture rapide de la mondialisation permet de retracer les étapes essentielles qui ont abouti à la situation actuelle et de mettre en lumière l’effacement de l’idéologie libérale au profit de l’interventionnisme stratégique aux États-Unis.
La période 1990-2019 représente une phase d’hypermondialisation caractérisée par la diffusion d’une idéologie néolibérale centrée sur les entreprises et les marchés, et sur l’adoption de politiques commerciales se conformant aux règles globales des flux commerciaux et d’investissements édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le système d’échanges international, construit autour de chaînes de valeur mondialisées, traduit l’influence unilatérale des États-Unis, unique hyperpuissance dans les années 1990, 2000 et 2010. Le résultat est un jeu à somme positive qui conduit à une convergence des taux de croissance entre le Nord et le Sud, entre 2003 et 2019.
Les inégalités s’accroissent à la fin de la période et la démondialisation, certes relative, s’amplifie. Pour deux raisons.
D’une part, en raison de la crise financière, les pays pauvres très endettés ne peuvent exploiter leurs avantages comparatifs au sein de chaînes de valeur raccourcies et régionalisées. C’est le cas du Bangladesh et du Cambodge dans le textile-habillement et dans l’ameublement. Les pays bénéficiaires sont la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie.
D’autre part, les considérations géopolitiques l’emportent sur les motifs strictement économiques, ce qui accroît fortement la contrainte de risque dans les choix des localisations et conduit à une fragmentation progressive de l’espace mondial (certains segments de chaînes de valeur dans l’aéronautique et les technologies numériques installées en Chine ont été transférés au Vietnam).
Du libre-échange à la quête de puissance
Pour les États-Unis, le risque global de décrochage économique et technologique par rapport à la Chine accentue le poids de l’impératif de sécurité : il s’agit de sécuriser certains approvisionnements (terres rares ou batteries) et de développer les technologies critiques couvrant des besoins économiques et de sécurité nationale. Il apparaît que les interactions internationales ont accru le déficit commercial et l’endettement financier.
Les rapports de force s’introduisent en deux temps. Les États-Unis réagissent d’abord lorsqu’ils admettent que les gains de puissance politique, économique et technologique de la Chine diminuent la puissance relative des États-Unis, et reconnaissent que la puissance mondiale est un jeu à somme nulle.
Le nouveau paradigme repose sur l’idée que les politiques industrielles ne s’opposent pas aux marchés, mais permettent de renforcer des positions d’ancrage significatives sur des marchés ayant une importance économique et géopolitique stratégique. Dès lors, des formes de protectionnisme se développent. D’où les deux lois votées en 2022, sous Joe Biden : le CHIPS and Science Act (semiconducteurs) et l’Inflation Reduction Act (transition énergétique).
À l’opposé, Donald Trump considère que la décarbonation de l’industrie ne permet pas la réindustrialisation des États-Unis. C’est pourquoi il a mis fin le 7 juillet au plan de subventions et d’exonérations fiscales en faveur de la transition énergétique.
Les rapports de puissance s’expriment par les droits de douane censés réaliser des objectifs économiques et de sécurité nationale. L’idée est que plus les droits de douane sont élevés, plus les entreprises étrangères sont incitées à investir aux États-Unis pour ne pas avoir à les payer.
Or, les entreprises étrangères peuvent être désincitées par le coût de la main-d’œuvre aux États-Unis (seize fois plus élevé qu’au Vietnam et onze fois plus important qu’au Mexique), mais plus encore par la difficulté de s’approvisionner en biens intermédiaires stratégiques, ce que les accords de libre-échange facilitaient.
Les nouveaux droits de douane sont la base d’une politique « réciproque » visant à équilibrer le commerce entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux, notamment les pays en développement.
Dans les faits, la recherche de l’équité via « la politique réciproque » dans les relations commerciales aboutit à de fortes asymétries. Par exemple, en ce qui concerne le Vietnam, les exportateurs américains vendront à droit zéro sur le marché vietnamien tandis que les exportateurs vietnamiens acquitteront une taxe de 20 %.
Dans ce contexte, la mondialisation transactionnelle articulée autour de négociations et de sanctions, comme dans le cas de l’Inde, s’accompagne de mesures protectionnistes dont les plus notables sont le contrôle des importations menaçant la sécurité nationale, les restrictions sur les investissements entrants et sortants et la prise de participation de 10 % de l’État américain au capital d’Intel, ce qui interroge sur l’éclosion d’un capitalisme d’État.
La fin de l’orthodoxie libérale
En janvier 2025, le Bureau of Industry and Security (agence du département du commerce, ndlr) a imposé des restrictions formelles à l’exportation de nouveaux équipements de calcul avancé (la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est dorénavant contrainte d’obtenir une licence pour tout envoi de produits), ce à quoi s’ajoute le contrôle de volumes importants de données nécessaires à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle (IA).
L’objectif est d’instrumentaliser les interconnexions économiques (flux de produits, de connaissances brevetées, de données, transferts financiers) à des fins de blocage et de coercition. L’orthodoxie libérale est congédiée au profit de l’avantage stratégique dans le but d’atteindre un leadership incontestable sur la scène mondiale.
À supposer que l’UE reste une zone de libre-échange capable d’irradier et de construire avec d’autres pays des règles et de l’équité, la mondialisation s’organiserait autour de deux découpages superposés : celui du libre-échange concernant les produits de faible et moyenne gamme et celui des biens stratégiques dont le périmètre est réduit, selon la formule « Small yard, high fence », en raison des barrières à l’entrée infranchissables, à la fois, géopolitiques et industrielles.
Bernard Guilhon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
23.10.2025 à 16:17
Devenue une religion mondiale, l’Église mormone va devoir s’adapter
Brittany Romanello, Assistant Professor of Sociology, University of Arkansas
Texte intégral (3102 mots)
Le 14 octobre 2025, Dallin H. Oaks a pris la tête de l’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours », aussi connue sous le nom d’Église mormone, un mouvement mondial en pleine expansion qui revendique plus de 17 millions de membres en 2024. L’anthropologue Brittany Romanello a étudié plusieurs communautés de femmes mormones à travers les États-Unis et revient sur leurs caractéristiques ainsi que sur les enjeux qui attendent la nouvelle direction de l’Église.
L’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours » (Église SDJ) a connu ces dernières semaines un moment de deuil et de transition. Le 28 septembre 2025, une fusillade et un incendie criminels ont fait quatre morts et huit blessés lors d’un rassemblement dans une église mormone du Michigan. La veille, le président de l’Église Russell M. Nelson était mort à l’âge de 101 ans. Dallin H. Oaks, le plus ancien des hauts dirigeants de l’Église, a été nommé comme nouveau président le 14 octobre.
Le nouveau président des Saints des Derniers Jours hérite de la direction d’une institution religieuse à la fois profondément américaine et de plus en plus globale. La diversité de ce mouvement entre en tension avec la manière dont il est traditionnellement représenté dans les médias, de la téléréalité la Vie secrète des épouses mormones à la comédie musicale de Broadway le Livre de mormons.
En tant qu’anthropologue culturel et ethnographe, je mène des recherches sur les communautés des saints des derniers jours à travers les États-Unis, en particulier sur les immigrantes latino-américaines et les jeunes adultes. Lorsque je présente mes recherches, je remarque que beaucoup de gens associent encore étroitement l’Église à l’Utah, où se trouve son siège social.

L’Église a joué un rôle central dans l’histoire et la culture de l’Utah. Aujourd’hui, cependant, seuls 42 % de ses habitants en sont membres. Le stéréotype selon lequel les saints des derniers jours sont principalement des Américains blancs et conservateurs est l’une des nombreuses idées fausses tenaces concernant les communautés et les croyances mormones.
Beaucoup de gens sont surpris d’apprendre qu’il existe des congrégations dynamiques loin du « corridor mormon » de l’Ouest américain. On trouve des saints des derniers jours fervents partout, du Ghana et des Émirats arabes unis à la Russie, en passant par la Chine continentale.
Croissance globale
Joseph Smith a fondé l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans le nord de l’État de New York en 1830 et a immédiatement envoyé des missionnaires prêcher le long de la frontière. Les premiers missionnaires outre-mer se sont rendus en Angleterre en 1837.
Peu après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants religieux ont revu leur approche missionnaire afin d’augmenter le nombre de missions internationales. Cette stratégie a conduit à une croissance à travers le monde, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique.
Aujourd’hui, l’Église compte plus de 17,5 millions de membres, selon ses registres. La majorité d’entre eux vivent en dehors des États-Unis, répartis dans plus de 160 pays.
L’Église et les chercheurs suivent cette croissance mondiale, notamment grâce à la construction de nouveaux temples. Ces bâtiments, qui ne sont pas utilisés pour le culte hebdomadaire mais pour des cérémonies spéciales telles que les mariages, étaient autrefois presque exclusivement situés aux États-Unis. Aujourd’hui, ils existent dans des dizaines de pays, de l’Argentine aux Tonga.
Au cours de sa présidence, qui a débuté en 2018, Nelson a annoncé la construction de 200 nouveaux temples, soit plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Les temples sont une représentation physique et symbolique de l’engagement de l’Église à être une religion mondiale, même si des tensions culturelles persistent.

Parmi les membres américains, la démographie évolue également. 72 % des membres américains sont blancs, contre 85 % en 2007, selon le Pew Research Center. Un nombre croissant de Latinos-Américains – 12 % des membres américains – ont joué un rôle important dans le maintien des congrégations à travers le pays.
Il existe des congrégations dans tous les États américains, y compris dans la petite communauté de Grand Blanc, dans le Michigan, lieu de la tragique fusillade. Le suspect Thomas Jacob Sanford, qui a été abattu par la police, s’était récemment lancé dans une tirade contre les saints des derniers jours lors d’une conversation avec un candidat politique local. Dans les jours qui ont suivi, un membre américain de l’église a récolté des centaines de milliers de dollars pour la famille de l’assaillant.
Douleurs en hausse
Malgré la diversité de l’Église, ses fondements institutionnels restent solidement ancrés aux États-Unis. Les instances dirigeantes sont encore composées presque exclusivement d’hommes blancs, dont la plupart sont nés aux États-Unis.
À mesure que l’Église continue de croître, des questions se posent quant à l’adéquation des normes d’une Église basée dans l’Utah avec les réalités des membres à Manille, Mexico, Bangalore ou Berlin. Quelle place reste-t-il, même dans les congrégations américaines, pour les expressions culturelles locales de la foi ?**
Les mormons latino-américains et les membres d’Amérique latine, par exemple, ont dû faire face à une opposition à l’égard de traditions culturelles considérées comme « non mormones », telles que la construction d’autels et les offrandes lors du Dia de los Muertos. En 2021, l’Église SDJ a lancé une campagne en espagnol utilisant des images du Jour des morts afin de susciter l’intérêt des Latino-Américains. De nombreux membres se sont réjouis de cette représentation. Pourtant, certaines femmes avec lesquelles j’ai discuté ont déclaré que l’accent mis sur la blancheur et le nationalisme américain, ainsi que la rhétorique anti-immigrés qu’elles avaient entendue de la part d’autres membres, les dissuadait de célébrer pleinement leur culture.
Même les détails esthétiques, comme les styles musicaux, reflètent souvent un modèle typiquement américain. Le recueil de cantiques standardisé, par exemple, contient des chants patriotiques comme « America the Beautiful ». Cette importance accordée à la culture américaine peut sembler particulièrement déplacée dans les pays où le taux d’adhésion est élevé et qui ont connu des conflits avec l’armée américaine ou politique.
Les attentes en matière d’habillement et d’apparence physique ont également soulevé des questions sur la représentation, l’appartenance et l’autorité. Ce n’est qu’en 2024, par exemple, que l’Église a proposé à ses membres vivant dans des régions humides des versions sans manches des vêtements sacrés que les mormons portent sous leurs vêtements pour rappeler leur foi.
Historiquement, l’Église considérait les tatouages comme tabous – une violation du caractère sacré du corps. De nombreuses régions du monde ont des traditions sacrées de tatouage vieilles de plusieurs milliers d’années, notamment l’Océanie, qui compte un taux élevé d’adhérents à l’Église.
Changement à venir ?
Parmi les nombreux défis qui l’attendent, le prochain président de l’Église SDJ devra trouver comment diriger une Église mondiale depuis son siège américain, une Église qui continue d’être mal comprise et victime de stéréotypes, parfois au point d’en arriver à des actes de violence.

Le nombre de mormons continue d’augmenter dans de nombreuses régions du monde, mais cette croissance s’accompagne d’un besoin accru de prise en compte des différentes sensibilités culturelles. L’Église, qui a toujours été très uniforme dans ses efforts de standardisation de l’histoire, de l’art et des enseignements des mormons, a de plus en plus de mal à maintenir cette uniformité lorsque les congrégations s’étendent sur des dizaines de pays, de langues, de coutumes et d’histoires.
Organiser l’Église SDJ comme une entreprise, avec un processus décisionnel descendant, peut également rendre difficile le traitement des histoires raciales douloureuses et des besoins des groupes marginalisés, tels que les membres LGBTQ+.
La transition au niveau de la direction offre une occasion non seulement à l’Église, mais aussi au grand public, de mieux comprendre les multiples facettes ainsi que la dimension mondiale de la vie des « saints des derniers jours » aujourd’hui.
Brittany Romanello ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
22.10.2025 à 17:54
L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?
Kambiz Zare, Professor of International Business and Geostrategy, Kedge Business School
Texte intégral (1861 mots)
La réussite économique de l’Union européenne a longtemps été le moteur de son influence mondiale. Aujourd’hui, les limites de sa compétitivité apparaissent et, avec elles, la fragilité de son modèle face aux nouvelles rivalités de puissance.
Non seulement en théorie, mais aussi en pratique, le commerce mondial demeure un moteur essentiel de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Aucun pays n’a jamais atteint une prospérité durable sans ouverture au commerce et à l’investissement. Après l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) de 1947, les échanges commerciaux mondiaux ont été multipliés par 43 fois depuis 1950, et leur valeur a été multipliée par 382 depuis cette date.
Aujourd’hui, parmi les grands blocs, l’Union européenne occupe une place centrale. Elle pèse 14 % du commerce international et constitue la troisième puissance économique mondiale. Les États-Unis dominent l’accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) tandis que les pays asiatiques renforcent leurs liens à travers le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’UE demeure donc un pilier de stabilité, d’influence réglementaire et de croissance durable dans un monde commercial de plus en plus multipolaire. Cependant, cette position dominante dissimule des fragilités structurelles de plus en plus préoccupantes.
Quand l’Est avance, l’Ouest s’essouffle
Entre 2011 et 2024, le PIB de l’UE est passé d’environ 13 000 à près de 18 000 milliards d’euros. Après une forte contraction en 2020, liée à la pandémie de Covid-19, l’économie européenne a rapidement rebondi, retrouvant et dépassant son niveau d’avant-crise dès 2021. Toutefois, la croissance ralentit depuis, en particulier en Europe occidentale, tandis que les modestes progrès de l’UE proviennent surtout du rattrapage effectué par les pays d’Europe de l’Est.
En 2026, la croissance moyenne du PIB dans l’UE devrait atteindre 1,5 %, mais les pays d’Europe de l’Est affichent des performances nettement supérieures. La Lituanie (3,1 %), la Pologne (3,0 %), la Croatie (2,9 %), la Hongrie (2,5 %), la Slovénie (2,4 %) et la Roumanie (2,2 %) figurent parmi les plus dynamiques, soutenant la croissance globale de l’UE. À l’inverse, les grandes économies d’Europe occidentale comme la France (1,3 %), l’Allemagne (1,1 %), la Belgique (0,9 %) et l’Italie (0,9 %) restent en bas du classement, confirmant le contraste persistant entre l’Est en expansion et l’Ouest en stagnation.
La croissance demeure globalement faible, reflétant des défis structurels tels que la faiblesse de la productivité, le retard en matière d’innovation et la perte de compétitivité face aux autres grandes économies mondiales. L’Europe peine toujours à faire émerger des géants technologiques à l’échelle mondiale.
Les études montrent que l’innovation et, plus particulièrement aujourd’hui, l’intelligence artificielle stimule significativement la croissance du PIB en améliorant la productivité et en favorisant la création de nouveaux secteurs économiques.
En 2024, le classement mondial de l’innovation montre une nette avance des pays non membres de l’UE. La Suisse (67,5), les États-Unis (62,4) et Singapour (61,2) dominent le classement en termes d’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index, établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), devant le Royaume-Uni (61,0) et la Corée du Sud (60,9). Côté européen, la Suède (64,5) reste la première de l’Union, suivie par la Finlande (59,4), les Pays-Bas (58,8) et l’Allemagne (58,1), qui conservent de bonnes performances en matière de recherche et d’innovation. Toutefois, aucun pays de l’UE ne figure parmi les tout premiers mondiaux, ce qui vient confirrmer le retard de l’Europe dans la transformation technologique face aux leaders mondiaux de l’innovation.
L’innovation constitue le fondement de la croissance du PIB à long terme, mais seulement si les économies parviennent à transformer le savoir en valeur commercialisable. Les pays qui associent des systèmes de recherche performants à des environnements économiques agiles (comme la Suisse ou les États-Unis) obtiennent à la fois de hauts niveaux d’innovation et une croissance du PIB soutenue – tandis que ceux qui innovent sans réussir à industrialiser ou commercialiser à grande échelle ces innovations risquent la stagnation malgré leur excellence scientifique.
Un budget européen largement insuffisant face aux besoins d’investissement
Certains pays membres de l’UE ont enfreint le Pacte de stabilité et de croissance, affichant des déficits et des dettes publiques élevés, ce qui fragilise la capacité de l’Europe à financer ses nouvelles priorités. La Grèce (158,2 % du PIB), l’Italie (136,3 %) et la France (113,8 %) présentent les niveaux d’endettement les plus élevés, tandis que l’Allemagne (62,4 %), la Pologne (53,5 %) et les Pays-Bas (42,2 %) restent plus modérés, confirmant ainsi un net clivage nord-sud en matière de discipline budgétaire.
Le budget européen, limité malgré l’élargissement de ses compétences et de ses membres, freine toute action véritablement efficace. Les gouvernements nationaux demeurant les principaux contributeurs, la solidarité européenne et les investissements à long terme dans des domaines stratégiques tels que la recherche, l’énergie et la défense s’en trouvent restreints.
À titre d’illustration, le programme NextGenerationEU (2020–2027) consacre la majeure partie de ses financements au Mécanisme pour la reprise et la résilience, avec 385,8 milliards d’euros de prêts et 338 milliards d’euros de subventions, ce qui en a fait le principal levier de l’Union pour soutenir la reprise post-pandémique et les réformes structurelles. Les autres programmes reçoivent des montants bien moindres : React-EU (50,6 milliards d’euros) soutient la reprise régionale, le Fonds pour une transition juste (10,9 milliards d’euros) accompagne la sortie des énergies fossiles, tandis que le Fonds de développement rural (8,1 milliards d’euros), InvestEU (6,1 milliards d’euros) et Horizon Europe (5,4 milliards d’euros) favorisent l’innovation, l’investissement et la durabilité. Enfin, RescEU (2 milliards d’euros) renforce la capacité européenne de réponse aux crises.
On le voit : bien que la priorité de l’UE demeure la relance économique, les moyens réellement consacrés à l’innovation et à la transformation structurelle restent limités. Certes, des programmes tels qu’Horizon Europe, InvestEU ou certains volets du mécanisme pour la reprise et la résilience soutiennent la recherche, la digitalisation et les technologies vertes – des leviers essentiels de compétitivité –, mais les montants alloués demeurent très en deçà des besoins.
Cette faiblesse budgétaire se confirme avec la proposition de la Commission européenne d’augmenter le budget de l’UE pour 2028-2034 de 1,1 % à seulement 1,26 % du revenu national brut, une progression jugée insuffisante au regard du déficit d’investissement estimé entre 4 et 5 % du PIB par le rapport Draghi (2024). L’augmentation proposée, de 0,15 %, apparaît d’autant plus dérisoire que la majorité des fonds sera absorbée par le remboursement de la dette post-pandémie, laissant peu de marge pour renforcer les capacités d’innovation et de compétitivité de l’Europe.
Les déséquilibres économiques et démographiques de l’UE
Les vulnérabilités économiques de l’UE découlent de l’élargissement des inégalités, du ralentissement de la convergence entre États membres et de déséquilibres structurels persistants. Les transformations technologiques rapides et l’automatisation accentuent l’incertitude autour de la productivité et de l’emploi, tandis que le vieillissement démographique met sous pression les systèmes de retraite et les finances publiques.
La dépendance de l’UE à l’égard des technologies, des infrastructures de paiement et des sources d’énergie étrangères accroît sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs et fragilise sa souveraineté économique. Ces facteurs combinés révèlent une architecture économique assez friable, nécessitant une intégration plus poussée, des investissements stratégiques et des réformes structurelles pour garantir une croissance durable et une stabilité à long terme.
De l’économie à la géopolitique : l’Europe à la croisée des puissances
Aujourd’hui, la véritable source du pouvoir n’est plus seulement militaire ou politique, mais avant tout économique. La capacité d’un acteur international à influencer le système mondial dépend de sa force de production, de son innovation et de sa capacité à créer de la richesse durable.
Dans ce contexte, si l’UE, en tant que bloc, n’est pas en mesure de renforcer sa base industrielle, d’investir dans la recherche et de stimuler la croissance, elle risque de perdre progressivement son poids géopolitique. La puissance économique conditionne désormais la souveraineté stratégique : sans une économie compétitive, il devient difficile de peser dans les négociations internationales, de financer la défense commune, la transition verte ou encore la transformation numérique.
Consolider la puissance économique du continent – par des politiques d’investissement coordonnées, une union des marchés de capitaux et une stratégie industrielle ambitieuse – est donc essentiel pour préserver sa stabilité, sa souveraineté et son rôle dans l’équilibre géopolitique mondial. Si ces vulnérabilités persistent, l’Europe pourrait devenir un espace soumis à l’influence extérieure plutôt qu’un acteur exerçant sa propre influence…
Kambiz Zare ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
22.10.2025 à 11:50
La diplomatie d’affaires, d’hier à aujourd’hui
Frédéric Martineau, Doctorant en Diplomatie des affaires, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
Texte intégral (2428 mots)

L’entreprise est une diplomate comme les autres, ou presque. Depuis l’âge du bronze, les échanges commerciaux ont été intrinsèquement liés aux relations interétatiques, les marchands pouvant parfois réussir là où les dirigeants politiques échouaient. Pour autant, le commerce n’est pas automatiquement synonyme de paix, bien des conflits ayant été déclenchés par des différends de nature économique…
Les sociétés civiles attendent aujourd’hui un engagement croissant des entreprises, perçues comme des acteurs capables de suppléer la puissance publique dans les transformations sociales, économiques et environnementales. En France, le baromètre Edelman 2025 révèle ainsi un degré de confiance plus élevé envers les entreprises qu’envers le gouvernement. Face à la baisse de l’efficacité de la diplomatie institutionnelle – un phénomène qui s’explique par des moyens réduits, des réseaux d’influence affaiblis, des intérêts divergents et des expertises dispersées –, les entreprises ont progressivement développé leurs propres solutions de gestion des risques géopolitiques et géoéconomiques. Car les marchés ne fonctionnent pas en autarcie, mais dans un contexte social, politique et culturel spécifique.
D’un domaine réservé à la puissance publique, la diplomatie est devenue un terrain stratégique pour le secteur privé. Ce dernier s’est engouffré dans l’espace libéré par la perte plus ou moins volontaire de souveraineté traditionnelle. Cette évolution a conduit à l’émergence du concept de diplomatie des affaires ou d’entreprise : une réponse adaptative des multinationales face à un avenir incertain, un environnement volatil, des risques protéiformes.
Cette diplomatie alternative utilise les moyens et les outils traditionnels pour maintenir des relations positives durables avec toutes les parties prenantes – internes et externes, commerciales et non commerciales. L’entreprise assure ainsi la préservation de sa légitimité et du droit d’opérer dans les pays hôtes, garantissant son développement économique et son rayonnement international. Cependant, les intérêts de la puissance publique restent dominants, et peuvent aller à l’encontre du désir de l’entreprise de maintenir des relations positives avec l’ensemble de ses parties prenantes. L’embargo européen sur une liste de produits et de services russes en est un exemple récent. Les sanctions unilatérales américaines prises contre l’Iran visent aussi les entreprises de son écosytème pétrolier ; certaines sont de nationalité chinoise !
L’implication du secteur privé dans les questions diplomatiques n’est pas nouvelle. Ses contours se dessinent dès que le commerce accompagne l’essor des territoires de l’âge du bronze, autour de 3000 av. J.-C., quand une relative autonomie des institutions marchandes fonctionnait déjà en Mésopotamie et en Égypte.
Le rôle fondateur des échanges commerciaux à l’âge du bronze
Bien que notre connaissance de l’organisation des échanges anciens demeure imparfaite en raison d’une mémoire imprégnée de mythologie et de transmission orale, les marchands, les voyageurs et autres agents mercantiles jouèrent un rôle majeur dans l’évolution des sociétés, dépassant la qualité de plénipotentiaire des royaumes, des empires ou des cités-États.
Le début du commerce international coïncide avec la circulation du cuivre, de l’étain, des textiles en laine et du sel, matières d’importance égale au pétrole et au gaz actuels.
L’épave d’un navire marchand découverte dans le site archéologique sous-marin d’Uluburun (sud de la Turquie) regorgeait de matières premières venues du monde connu : ambre scandinave, épée italienne, sceptre de la mer Noire, étain d’Ibérie ou d’Ouzbékistan. Cette cargaison révèle l’existence, dès la fin de l’âge du bronze, d’un vaste réseau commercial s’étendant de l’Asie centrale à l’Europe. Il était géré par de petites communautés locales indépendantes, pas uniquement soumises au pouvoir politique.

Des documents de Méditerranée orientale décrivent le négoce comme le fait d’entreprises privées et d’intermédiaires autonomes, de riches marchands dont Sinaranu, connu sous le nom de « tamkaru », constitue un exemple historique marquant. Il était une figure notable d’Ougarit, une ancienne cité-État située dans l’actuelle Syrie à la fin de l’âge du bronze. Le terme « tamkaru » désignait un marchand professionnel impliqué dans le commerce à longue distance.
Ces échanges permirent l’ouverture de nouvelles routes et la construction d’infrastructures (ponts, ports, caravansérails) procurant des revenus aux royaumes traversés. Les archives assyriennes de Kanesh inventorient les coûts engagés pour soutenir ce commerce transitaire. De surcroît, les échanges tissèrent des liens économiques, diplomatiques et sociaux entre territoires éloignés : traités, contrats et alliances sécurisaient un environnement favorable au négoce. Dans l’une des lettres d’Amarna, tablettes en argile d’ordre diplomatique, Burna-Buriyash II, le roi de Babylone, se plaint ainsi à Akhénaton que ses marchands ont été assassinés à Canaan par des sujets du pharaon. Il demande que les coupables soient punis.
Infatigables voyageurs, ces marchands jouaient déjà le rôle de diplomates, d’émissaires ou d’agents de renseignements, comme l’attestent la correspondance royale d’Alasiya ou les mémoires de César.
Impact socioculturel et premières multinationales
Au-delà des richesses matérielles, le commerce international modifia profondément les sociétés. Les marchands favorisèrent les transferts de technologies et de savoir-faire, renforçant la puissance des États qui les soutenaient. Leurs voyages répandaient coutumes et modes de vie qui influençaient l’organisation sociale des pays traversés.
Irad Malkin souligne le rôle des commerçants dans la diffusion du grec archaïque en Méditerranée. Ils participèrent au partage de récits, de la langue et d’une culture matérielle sans coordination gouvernementale. D’autres exemples confortent son travail : la diffusion du bouddhisme le long de la route de la soie, ou les valeurs véhiculées par les marchands hanséatiques plus tard en Europe.
Mais le développement des échanges produisit aussi des effets négatifs : concurrence accrue, jalousies, ambitions géostratégiques menant parfois à la guerre.
Parmi tous les dommages involontaires provoqués par le commerce international, la propagation des maladies a certainement été le plus terrible. La peste noire, causée par la bactérie Yersinia Pestis, aurait été transmise à Constantinople et en Europe depuis la Chine ou l’Inde peu après l’an 500 de notre ère.
Indépendants ou sous influence, les marchands ont dû s’adapter à un environnement social, politique et économique en constante évolution. Pour survivre, ils déployèrent des savoir-faire qui dépassaient la capacité à négocier le meilleur prix ou à maximiser les profits.
Au Moyen Âge, ceux qui voyageaient le long de la route de la soie faisaient montre de diplomatie pour obtenir leur passage en toute sécurité entre les multiples puissances régionales.
Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales fondée en 1602 par la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas illustre l’institutionnalisation précoce de pratiques diplomatiques d’affaires pour atténuer les risques et les incertitudes tout en obtenant des positions avantageuses. Ces émanations de la volonté publique influençaient la promulgation de loi et la création d’organisations commerciales, et finançaient des guerres, en servant l’expansionnisme colonial.
Le développement des premières entreprises transnationales ne peut être évoqué en passant sous silence le commerce triangulaire, un système d’échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Les navires européens embarquaient des marchandises vers l’Afrique où elles étaient échangées contre des captifs africains. Ces derniers étaient ensuite déportés de force vers les plantations des Amériques, où ils produisaient des biens coloniaux (sucre, coton, café, cacao, tabac), exportés vers l’Europe. Ce commerce a été particulièrement actif aux XVIIIe et XIXe siècles, même si l’esclavage existait depuis l’Antiquité. Les sociétés grecques et romaines, les civilisations arabes et asiatiques pratiquaient le commerce et la possession d’esclaves bien avant la traite atlantique.
Progressivement, davantage d’entreprises multinationales contribuèrent à façonner la politique étrangère, même sans autorité officielle déléguée. Bien que le terme « diplomatie » n’apparaisse qu’après la paix de Westphalie signée en 1648, les pratiques en cernaient déjà les contours. Codifié lors du Congrès de Vienne en 1815, il se rapportait principalement aux relations interétatiques et aux mécanismes visant à régler les différends et les conflits. De multiples conventions jusqu’en 1961 continueront de faire évoluer le cadre de l’activité diplomatique.
Ce n’est qu’en 1979 que les universitaires, et notamment Elmer Plischke, commencèrent à considérer que la diplomatie pouvait également s’appliquer aux particuliers et aux entreprises, même si la littérature commerciale aux États-Unis l’évoquait depuis 1950.
Vers une diplomatie d’entreprise moderne
Aujourd’hui, face à la fragmentation géopolitique et aux défis globaux (climat, santé, technologie), les entreprises négocient directement avec les États, participent aux forums internationaux, influencent les normes sectorielles. Cette évolution prolonge une tradition millénaire où commerce et diplomatie se mêlent pour construire les relations internationales.
La diplomatie d’affaires contemporaine hérite ainsi d’une longue histoire : celle de marchands qui, bien avant les diplomates modernes traditionnels, tissaient déjà les liens entre les peuples. Ces derniers n’hésitent plus à rejoindre le monde l’entreprise : Facebook a recruté en 2018 Nick Clegg, ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni ; Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, a rejoint le conseil d’administration d’Apple ; le Danemark a nommé un ambassadeur voué à l’industrie technologique. Début 2025, Huawei publiait une annonce de recrutement sur le réseau LinkedIn pour un poste de diplomate d’affaires !
Frédéric Martineau est Président de l'amicale des missions polaires et australes (AMAEPF).
22.10.2025 à 11:50
La contribution de Henri de Saint-Simon à l’indépendance des États-Unis et à la libération de la France de ses « blocages »
Patrick Gilormini, Economie & Management, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Texte intégral (2384 mots)

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), pionnier du libéralisme et de la pensée industrielle, a marqué l’histoire des idées en France en posant les bases de la doctrine positiviste et en fondant l’école du saint-simonisme. Il prit les armes lors de la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) au sein de l’alliance franco-américaine et contribua à la victoire contre les Britanniques lors de la bataille de Yorktown. Ce texte revient sur ses expéditions en Amérique et leur influence sur la conception de son projet politique à son retour en France en 1783.
En 2026, les États-Unis commémoreront le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance. Un recueil des récits témoignant des jalons de cette histoire est déjà en cours.
La société de Cincinnati de France, fondée en 1784, perpétue à ce jour le souvenir des circonstances qui ont abouti à l’indépendance des États-Unis et de la fraternité d’armes qui unit officiers américains et français au cours des combats qu’ils menèrent ensemble. Gageons qu’elle pourra participer à cette commémoration alors que cette année 2025 marque le 200e anniversaire de la mort de Henri Saint-Simon.
En effet, le socialiste utopiste Henri Saint-Simon prit part sur mer, sous le commandement de l’amiral de Grasse, au succès décisif du corps de 1 000 hommes envoyé par le comte de Rochambeau (1725-1807) à Washington pour appuyer La Fayette et les troupes américaines envoyées en Virginie. Arrivés dans la baie de Chesapeake le 31 août 1781, les Français établissaient le blocus des rivières York et James, débarquaient puis appareillaient pour engager la bataille le 5 septembre et chasser les Anglais.
En pleine guerre des tarifs douaniers avec les États-Unis de Donald Trump, alors que des doutes persistent sur la solidité de l’alliance transatlantique, et en pleine crise budgétaire dans une France qui doute des vertus de la démocratie, il nous semble éclairant de rappeler dans quelle perspective le jeune Henri Saint-Simon apporta sa contribution à l’indépendance américaine et à l’économie politique française.
Saint-Simon s’écriant « Rochambeau me voilà ! »
Né en 1760, Henri Saint-Simon était un jeune homme au moment où éclata la révolution américaine en 1775 qui fut un conflit armé qui dura huit longues années.
Elle constitua également une guerre civile entre sujets britanniques et américains, ainsi qu’une rébellion contre les autorités coloniales, et une insurrection contre le roi d’Angleterre (George III) et le régime monarchique. Elle fut la première guerre de « libération nationale » de l’histoire moderne. Pour Saint-Simon, le monde marche vers un idéal d’égalité et de liberté, emporté par le plus généreux des rêves : le règne de la raison gouvernant un monde selon la justice.
S’il a le goût d’observer et la passion de savoir, Henri Saint-Simon aime plus encore agir. Saint-Simon avait commencé sa vie professionnelle comme officier dans l’armée. En 1777, son père lui a obtenu une sous-lieutenance au régiment de Touraine ; il devint deux ans plus tard capitaine dans le corps de cavalerie de ce régiment. Trois ans après la proclamation de l’indépendance des treize colonies insurgées (Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie), il part pour l’Amérique en 1779 pour servir sous les ordres de M. de Bouillé, gouverneur des îles du Vent, et sous ceux de Washington : « Je suis parti de France pour l’Amérique, à dix-huit ans ; j’ai combattu pendant cinq ans pour la liberté des Américains, et je suis revenu dans ma patrie dès l’instant que leur indépendance a été reconnue par l’Angleterre », écrira-t-il.

La bataille de Yorktown, qui se déroule du 28 septembre au 19 octobre 1781, marque un tournant et signe la défaite de la Grande-Bretagne. Elle opposa les insurgés américains et leurs alliés français commandés par le comte de Rochambeau aux Britanniques commandés par Lord Cornwallis. Saint-Simon écrira un état détaillé décrivant « les troupes anglaises faites prisonnières à York en Virginie, le 19 octobre 1781 » dont le total s’élevait selon lui à 4550 prisonniers.
Après cette bataille, le régiment de Saint-Simon retournera à Fort Royal en Martinique (aujourd’hui Fort-de-France) avant de poursuivre sa navigation à Saint-Christophe puis à Basse-Terre en Guadeloupe et aux Saintes. Saint-Simon rentre en France en 1783 après le traité de Versailles du 3 septembre qui consacra l’indépendance des États-Unis. Quatre années leur seront encore nécessaires pour élaborer une Constitution et créer une véritable fédération. La France prend ainsi sa revanche sur l’Angleterre qui vingt ans plus tôt lui avait enlevé le Canada.
Avant de regagner la France, Henri Saint-Simon s’est rendu au Mexique pour présenter au vice-roi, administrateur colonial de la Nouvelle-Espagne, un projet de canal entre l’Atlantique et le Pacifique qui fut « froidement accueilli ». Ce projet préfigura l’implication de ses disciples dans la création de réseaux facilitant les flux de marchandises, de personnes, de capitaux et de connaissances tels que le canal de Suez. Saint-Simon quittera officiellement l’armée en mars 1790.
Les enseignements que Saint-Simon retint de son aventure américaine
Saint-Simon reviendra en France avec un dégoût pour le métier des armes qui le gagna pleinement quand il vit approcher la paix. Sa vocation est faite : il s’agit d’étudier la marche de l’esprit humain, pour travailler ensuite au perfectionnement de la civilisation. C’est ainsi que son projet scientifique contribuera à la création de la sociologie positiviste d’Auguste Comte, qui fut son secrétaire.
« En combattant pour l’indépendance de l’Amérique (il y a plus de quarante ans), j’ai conçu le projet de faire sentir aux Européens qu’ils mettaient la charrue avant les bœufs en faisant gouverner les producteurs par les consommateurs. Depuis ma vie entière est consacrée à ce projet… », se remémorera-t-il dans les années 1820.
Il s’inscrit ainsi au côté de son contemporain et maître Jean Baptiste Say dans une politique de l’offre qui pose le principe selon lequel « l’offre crée sa propre demande ». On retrouvera ces orientations dans les années 1980 avec le thatchérisme et les reaganomics, et aujourd’hui en France dans la politique économique des gouvernements successifs du président Emmanuel Macron : réductions fiscales considérables accordées aux grandes entreprises, lancement d’un programme de réindustrialisation notamment dans l’armement financé par l’endettement, déréglementation de l’activité économique…
Pour Henri Saint-Simon, la Révolution américaine signifia le commencement d’une nouvelle ère politique qui causera de grands changements dans l’ordre social en Europe. Il remarque avant tout que l’Amérique est un pays de tolérance puisqu’aucune religion n’y était dominante ni protégée d’une manière particulière ; qu’il n’y existe aucun corps privilégié, point de noblesse, nul reste de féodalité et que la nation n’est pas divisée en castes ; qu’aucune famille n’est en possession depuis plusieurs générations des principaux emplois publics et qu’aucun citoyen ne peut avoir de droit exclusif à gouverner l’État ; que le caractère dominant de la nation américaine est pacifique, industrieux et économe.
Cela permet à la jeune nation américaine d’établir un régime plus libéral et plus démocratique que celui des peuples européens encore marqués par l’esprit militaire. Pour Saint-Simon, le peuple français de 1789 était loin d’être capable de fonder un pareil ordre social :
« Le plus grand homme d’État, en Europe, celui du moins qui passe pour le plus habile, qu’on estime, qu’on avance, qu’on élève le plus c’est toujours celui qui trouve un moyen d’augmenter les revenus de l’impôt sans trop faire crier les imposés. Je sentis qu’en Amérique, le plus grand homme d’État serait celui qui trouverait le moyen de diminuer le plus possible les charges du peuple sans faire souffrir le service public. Le peuple ou les gouvernés de l’Ancien Monde se sont soumis à l’opinion qu’il fallait, pour le bien général, que les fonctionnaires fussent chèrement payés, de gros salaires étant supposés nécessaires pour la représentation. Je sentis que les Américains penseraient tout autrement, et que les fonctionnaires publics auraient d’autant plus de part à leur estime qu’ils étaleraient moins de luxe, qu’ils seraient d’un abord plus facile et plus simple dans leurs mœurs. »
À partir de cette expérience se dessinent déjà les principaux traits de ce que sera la doctrine de Saint-Simon et de ses héritiers jusqu’au Second Empire : le respect à la production et aux producteurs est infiniment plus fécond que le respect à la propriété et aux propriétaires ; le gouvernement nuit toujours à l’industrie quand il se mêle de ses affaires et qu’il nuit même dans le cas où il fait des efforts pour l’encourager ; les producteurs de choses utiles sont les seuls qui doivent concourir à sa marche et qu’étant les seuls qui paient réellement l’impôt ils sont les seuls qui aient de droit de voter ; les guerres, quel qu’en soit l’objet, nuisent à toute l’espèce humaine et nuisent même aux peuples qui restent vainqueurs ; le désir d’exercer un monopole est un désir mal conçu dans la mesure où ce monopole ne peut être acquis et maintenu que par la force ; l’instruction doit fortifier dans les esprits les idées qui tendent à augmenter la production et à respecter la production d’autrui ; et que toute l’espèce humaine ayant des buts communs, chaque homme doit se considérer dans les rapports sociaux comme engagé dans une compagnie de travailleurs.
C’est donc dans son expérience américaine qu’il conçoit son projet politique centré sur l’industrie. « La politique est pour me résumer en deux mots, la science de la production, c’est-à-dire la science qui a pour objet l’ordre des choses le plus favorable à tous les genres de production… Elle devient une science positive. »
Ce projet politique saint-simonien est favorable au libre-échange, comme en témoigna la signature d’un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni en 1860. Un aspect du libéralisme que les « MAGAnomics » ont oublié…
Patrick Gilormini est membre de la CFDT.
22.10.2025 à 11:50
Le couple Toumanov : une page de la guerre froide qui a des échos aujourd’hui
Cécile Vaissié, Professeure des universités en études russes et soviétiques, Université de Rennes 2, chercheuse au CERCLE (Université de Lorraine), Université Rennes 2
Texte intégral (3637 mots)

Durant la guerre froide, de nombreux Soviétiques captaient en cachette Radio Liberty, une station financée par les États-Unis et dont le QG se trouvait à Munich (alors en République fédérale d’Allemagne). Ils y écoutaient des dissidents originaires d’URSS qui leur faisaient connaître des informations inaccessibles dans leurs médias nationaux du fait de la censure. L’un de ces journalistes était Oleg Toumanov. Son épouse, Eta, enseignait le russe à des militaires américains. Mais Oleg – de même, très probablement, qu’Eta – travaillait en réalité pour le KGB…
Les histoires d’espions ont pour intérêt majeur non tant d’établir des faits – tout le monde y ment, ou à peu près – que de susciter des questions, celles-ci aidant à décrypter d’autres cas, plus contemporains.
Très révélateurs, les parcours d’Oleg Toumanov et de son épouse ont été rappelés lors d’une exposition intitulée « Des Voix de Munich dans la Guerre froide », organisée au musée municipal de Munich du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023 et consacrée aux radios occidentales Radio Free Europe (RFE)/Radio Liberty (RL).
Oleg Toumanov (1944-1997) travaillait pour Radio Liberté (RL), mais aussi pour le KGB. Quant à son épouse… la question reste complexe.
Radio Liberté, l’une des radios occidentales émettant vers l’URSS
La guerre froide avait à peine commencé quand les États-Unis ont créé deux radios basées à Munich : Radio Free Europe (RFE), qui, dès 1950, émettait vers les pays d’Europe centrale contrôlés par l’URSS ; et Radio Liberty qui visait l’URSS et qui, lancée le 1er mars 1953 sous le nom de Radio Liberation from Bolshevism, est devenue, en 1956, Radio Liberation, puis, en 1959, Radio Liberté (RL). Ses programmes, comme ceux de RFE, étaient diffusés dans les langues des auditeurs potentiels.
Aujourd’hui, nous parlerions de « guerre des narratifs » : il s’agissait de faire parvenir aux sociétés dites « de l’Est » des informations sur l’Occident, mais aussi sur leurs propres pays, par exemple en lisant à l’antenne des textes de dissidents, et d’accompagner le tout d’éléments des cultures occidentales et dissidentes.
Les États-Unis considéraient pouvoir ainsi fragiliser l’URSS, et celle-ci a d’ailleurs brouillé RL dès ses débuts. Pour Mark Pomar, qui y a été employé, RL et RFE étaient l’expression d’émigrés souhaitant représenter leur pays tel qu’il serait sans les communistes, alors que Voice of America, apparue en février 1947, était, elle, conçue comme la voix officielle des États-Unis ; Radio Liberté était donc, aux yeux de Pomar, « une radio entièrement russe qui se trouvait être à Munich », mais dont les financements venaient de la CIA jusqu’en 1971, puis du budget américain.
Oleg Toumanov, une belle carrière chez Radio Liberté
Oleg Toumanov qui, en 1993, publiera des « souvenirs » en anglais sous le titre Confessions d’un agent du KGB, a travaillé à Radio Liberté pendant vingt ans.
Né à Moscou en 1944, il rejoint en 1963 la flotte soviétique. En novembre 1965, il quitte son bateau à la nage près des côtes libyennes ; une fois à terre, il déclare vouloir être transféré chez les Occidentaux. Le 5 décembre 1965, un avion américain le conduit en RFA, dans un centre américain pour réfugiés : il y est interrogé, y compris avec l’aide d’un détecteur de mensonges. Le 14 avril 1966, il obtient l’autorisation de résider en permanence en Allemagne. Peu après, et non sans avoir subi de nouveaux tests, il est recruté par Radio Liberté.
Sa carrière y est spectaculaire : engagé au département « nouvelles » du service russe, Toumanov intervient assez vite à l’antenne et signe, dès 1967, un contrat à vie avec RL. Quelques années plus tard, il est nommé rédacteur en chef du service russe : le plus haut poste que puisse décrocher un non-Américain.

Mais Toumanov disparaît le 26 février 1986. Il réapparaît à Moscou le 28 avril, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère soviétique des Affaires étrangères, et dénonce les liens de RL avec la CIA. Par la suite, il expliquera avoir risqué d’être démasqué, suite à la défection de deux officiers du KGB. Avec l’aval de celui-ci, il a donc rejoint Berlin-Est et y a été débriefé, avant de prendre l’avion pour Moscou. Gorbatchev, au pouvoir en URSS depuis un an, vient de lancer la perestroïka.
Un parcours en questions
Ce parcours suscite bien des questions. L’une porte sur le moment où Toumanov a été recruté par les services soviétiques : sa « fuite d’URSS » était-elle une opération programmée par ceux-ci, comme Toumanov l’affirmera dans ses mémoires ? Ou, comme le croiront certains de ses collègues de RL, le jeune homme a-t-il été recruté alors qu’il se trouvait déjà en Occident ?
En outre, de quelles missions était-il chargé ? Il devait, écrira-t-il, infiltrer les cercles d’émigrés, et aurait transmis à ses officiers traitants – qu’il rencontrait à Berlin-Est, Vienne et Helsinki, mais jamais en RFA – des informations sur les employés de Radio Liberté. Il se chuchote aussi que, grâce à des documents transmis par Toumanov, l’URSS aurait découvert qu’une taupe travaillait pour les Américains dans les plus hauts cercles du PCUS.
L’ancien marin aurait également joué un rôle clé dans une opération conçue pour désinformer l’Occident. En revanche, Toumanov n’était sans doute pas chargé d’infléchir la rhétorique de Radio Liberté : passer pour un adversaire féroce du pouvoir soviétique était l’une des conditions de son poste…
S’agissait-il d’un cas isolé ? Non. Des documents désormais accessibles montrent que RL était « l’une des principales cibles » des services secrets de l’Est. La « guerre des narratifs » était au cœur, aussi, de la guerre froide.
L’épouse de Toumanov, Eta-Svetlana Katz-Toumanov
Toumanov a épousé, en 1978, Eta Katz (ou Drits), qu’il avait rencontrée quinze jours plus tôt à Londres.

Dans une interview d’avril 2023, elle dira être née en 1959 à Riga et venir d’une « famille juive dissidente » qui souhaitait émigrer, ce qui était alors « presque impossible ». Mais, en 1970, une dizaine de personnes, juives pour la plupart et regroupées autour d’Edouard Kouznetsov, tentent de détourner un avion pour partir en Israël. Leur tentative ratée et leur procès suscitent une importante mobilisation internationale : le combat des Juifs pour quitter l’URSS devient mondialement connu. Dans ce contexte, les Katz peuvent émigrer en juin 1971, et Eta elle-même parlera de « miracle ». À Londres, à seize ans, elle commence à travailler comme secrétaire pour le service russe de la BBC.
Trois ans plus tard, elle rencontre Toumanov et le suit à Munich. Il lui aurait révélé, une ou deux semaines plus tard, qu’il travaillait pour le KGB. La jeune femme aurait été horrifiée, mais les deux postes qu’elle a par la suite occupés font douter de l’authenticité de ce « choc ». D’abord, elle enseigne le russe dans un institut de l’Armée américaine, et ses étudiants sont des officiers américains qui se préparent à des missions en URSS. Puis, en 1982, suite à une proposition d’un cadre de Radio Liberté, elle devient l’assistante du directeur de cet institut et travaille dans la base américaine.
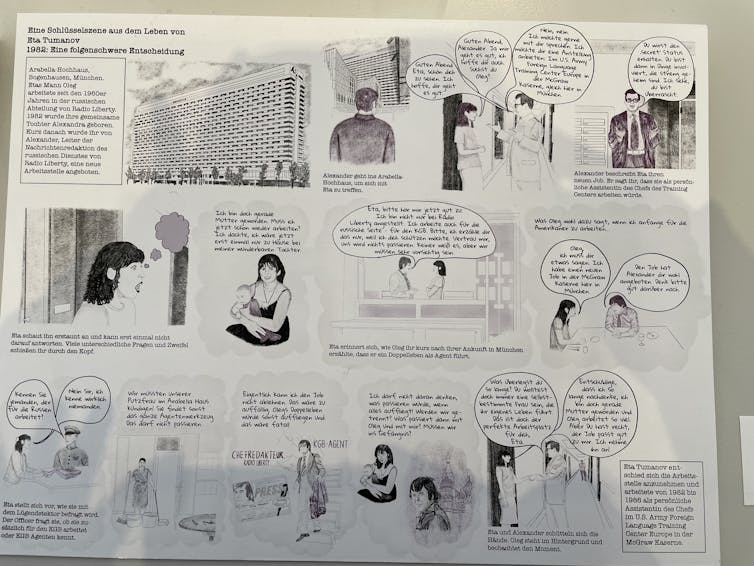
Cette planche montre le moment où Alexander, le chef d’Oleg à Radio Liberté, propose à Eta de travailler comme assistante du directeur de l’institut de langues, avec un accès à des informations secrètes. Eta y est présentée comme une jeune mère qui hésite à accepter un tel poste.
Pour les rédacteurs de l’exposition de Munich, « les employeurs américains de son mari escomptaient qu’Eta Toumanov travaillerait pour eux », ce qui n’est pas impossible.

Les questions que pose ce mariage
De nouvelles questions se posent donc. Est-il imaginable qu’Eta Toumanov ait occupé ses deux postes en Bavière sans collaborer avec les services secrets soviétiques, ainsi que le prétend son mari dans ses « souvenirs » ? Non. D’ailleurs, elle-même reconnaît aujourd’hui cette collaboration, même si elle déclare y avoir été « forcée » par son mariage.
Quelles informations a-t-elle alors transmises ? D’après ce qu’elle a confié à un journal israélien, il s’agissait de renseignements sur les emplacements, les mouvements et les armements des troupes américaines, et de nombreux détails personnels sur ses étudiants américains. A-t-elle aussi cherché à recruter certains d’entre eux ? À les influencer ? Et si Eta avait travaillé pour le KGB, ou pour d’autres services, avant même sa rencontre avec Toumanov ? Elle le nie.
Comme d’autres cas l’indiquent, l’Union soviétique a infiltré ses collaborateurs dans toutes les vagues d’émigration et a recruté des agents dans chacune de ces vagues. Et le parcours d’Eta, comme celui de son mari, semble ridiculiser le travail des services secrets occidentaux – en l’occurrence, américains et allemands – chargés de repérer, parmi les émigrés, ceux liés au KGB. Arrêtée en 1987 par la police allemande, Eta Toumanov est emprisonnée – six mois, selon elle ; plus de neuf, à en croire son mari. Accusée d’avoir travaillé pour le GRU, les services secrets militaires soviétiques, elle n’est condamnée qu’à cinq ans de probation.
Svetlana Toumanov à Moscou
En 1993, Eta Toumanov quitte Munich pour Moscou, prend la citoyenneté russe et adopte le prénom de Svetlana. En 2025, elle vit toujours dans la capitale russe où Poutine, soi-disant croisé en RDA, lui aurait fait attribuer un appartement. Sur sa page Facebook, elle se présente comme « retraitée des services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie » et proclame, le 16 septembre 2023, sa « fierté » d’être l’une des cinq personnes dont les parcours sont mis en valeur dans l’exposition de Munich.
Elle poste de nombreuses photos, prises lors de mondanités ou de cérémonies, souvent en compagnie de descendants de « légendaires agents secrets » soviétiques, hauts gradés, voire tueurs, du NKVD, comme ici lors d’un hommage sur les tombes de ces agents secrets, hommage auquel participent, entre autres, la petite-fille de Pavel Soudoplatov, ainsi que le fils et la fille de Naum Eitingon avec leurs enfants et petits-enfants ; ou lors d’une soirée avec l’un des membres de la famille de Félix Dzerjinski, le créateur de la Tchéka. Mais le 22 décembre 2024, elle rend aussi hommage à Edouard Kouznetsov, qui vient de mourir.
Radio Liberté aujourd’hui
Après le coup raté d’août 1991, Eltsine a autorisé RFE/RL à ouvrir un bureau à Moscou. Quatre ans plus tard, ces radios ont quitté Munich pour Prague. La guerre froide était, soi-disant, terminée.
Toumanov est mort en octobre 1997 à Moscou et y a été enterré avec les honneurs militaires.
Radio Liberté a été parmi les premiers médias à être déclarés « agents de l’étranger » par les autorités russes en décembre 2017 et ses correspondants ont quitté la Russie en mars 2022, deux semaines après l’attaque russe de l’Ukraine.
Le 14 mars 2025, Donald Trump a appelé à réduire au maximum légal les financements de l’US Agency for Global Media (USAGM) et des radios à l’étranger. RFE et RL continuent néanmoins d’émettre et de publier, tout en combattant cette décision en justice.
Cécile Vaissié ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.10.2025 à 15:08
Un an après les excuses de Biden, les droits des peuples autochtones aux États-Unis à nouveau fragilisés sous Trump
Sonia Félix-Naix, Professeure agrégée d'anglais Membre du CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), Université d’Angers
Texte intégral (2630 mots)
En octobre 2024, Joe Biden, alors encore président, présentait des excuses historiques aux peuples autochtones des États-Unis, dans la lignée des démarches entreprises par le Canada et par l’Australie en 2008. Un an plus tard, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a marqué un net revirement. Depuis janvier 2025, la nouvelle administration s’emploie à démanteler les avancées obtenues sous Biden et à imposer son propre récit national. Alors que les excuses de 2024 semblaient ouvrir la voie à un dialogue durable, la dynamique actuelle met un frein au processus de réparation historique et alimente les inquiétudes au sein des communautés autochtones.
–
Les excuses officielles présentées, le 25 octobre 2024, aux populations autochtones d’Amérique du Nord par le président Joe Biden, au-delà du baroud d’honneur de fin de mandat, ont inscrit les États-Unis dans un mouvement global de réparation des injustices historiques héritées de la colonisation, entamé dans d’anciennes colonies britanniques comme l’Australie et le Canada dès les années 1970.
Après l’Australie et le Canada en 2008, les États-Unis ont à leur tour reconnu le placement forcé de milliers d’enfants autochtones dans des pensionnats d’État pendant des dizaines d’années, et ainsi commencé à faire une place aux populations amérindiennes dans le récit national.
La reconnaissance des « générations volées » en Australie
En Australie, les Aborigènes sont, depuis l’indépendance du pays en 1901 et la construction d’une nation australienne blanche (politique « White Australia » de restriction de l’immigration non européenne), les grands oubliés de l’histoire du pays.
L’anthropologue australien W. E. H. Stanner aborde la problématique de l’exclusion des peuples autochtones de l’histoire du pays lors d’une conférence en 1968 consacrée au « grand silence australien » concernant l’histoire des Aborigènes en Australie depuis la colonisation britannique, à ce « culte de l’oubli » pratiqué à l’échelle nationale. Dès lors, le débat s’invite tant chez les historiens australiens que dans l’opinion publique, interrogeant la place des peuples autochtones dans le récit national.
L’année 1992 marque un tournant dans l’attitude observée par le gouvernement australien face aux peuples aborigènes : le premier ministre Paul Keating reconnaît la responsabilité des Australiens non aborigènes dans les crimes commis contre les populations autochtones depuis le début de la colonisation du pays lors du désormais célèbre discours de Redfern.

Quelques années plus tard, en 1995, le procureur général d’Australie demande l’ouverture d’une enquête nationale sur le placement forcé de milliers d’enfants aborigènes dans des internats religieux gérés par des missionnaires (les « mission schools ») entre les années 1910 et 1970.
Les résultats de l’enquête, publiés en 1997 dans le rapport « Bringing them home », font l’effet d’une bombe dans l’opinion publique australienne, jusqu’alors largement ignorante des souffrances infligées aux familles aborigènes. Les Australiens prennent la mesure de ce que leurs gouvernements successifs ont fait subir aux familles aborigènes : enlèvements d’enfants, adoptions forcées, mauvais traitements, crimes. Jusque dans les années 1970, des milliers d’enfants furent ainsi placés dans les écoles des missionnaires : on les appelle les « générations volées » (« stolen generations »).
Si ces générations volées laissent à partir de la fin du XXe siècle une trace indélébile dans l’histoire du pays qui ne peut désormais plus être ignorée, il faudra cependant attendre 2008 pour que des excuses officielles soient enfin présentées aux Aborigènes par le premier ministre Kevin Rudd.
Les excuses officielles du gouvernement canadien aux Premières Nations
2008 est également l’année des excuses officielles du gouvernement canadien aux populations autochtones du Canada (les Premières Nations, Métis et Inuits) par la voix du premier ministre Stephen Harper.
Ces excuses font suite à la plus grande procédure de recours collectif (« class action ») engagée dans l’histoire du Canada, qui aboutit à l’Indian Residential Schools Settlement Agreement, en 2006, puis à la création d’une commission de réconciliation (Truth and Reconciliation Commission), en 2015. Au Canada, on estime à 150 000 le nombre d’enfants placés dans les pensionnats d’État (« residential schools ») en un peu plus d’un siècle.
De nouvelles excuses officielles sont présentées quelques années plus tard, en 2021, par le premier ministre Justin Trudeau, à l’attention des survivants des pensionnats de la province du Newfoundland et du Labrador, province exclue du discours de Harper en 2008, et de leurs familles.
Le discours de Trudeau intervient alors que le pays est secoué par des révélations macabres liées au traitement inhumain des enfants des Premières Nations dans les pensionnats d’État : au printemps 2021, les restes de 215 enfants sont identifiés sur le site d’une ancienne école de Colombie-Britannique.
À lire aussi : La découverte d’un charnier d’enfants autochtones rappelle au Canada un sombre passé
D’autres étapes ont jalonné la prise de conscience de l’administration canadienne sur le sort des enfants des Premières Nations, leur octroyant au XXIe siècle une place et une visibilité dans la vie politique et dans le paysage médiatique du pays. Ainsi, les conclusions d’une grande enquête nationale sur les nombreuses disparitions de jeunes filles amérindiennes, publiées en 2019, dressent une liste de recommandations intimant le gouvernement à intégrer les cultures et langues autochtones dans la culture nationale, à mettre en place des actions de réparations et à éduquer le public et les médias.
À lire aussi : L’action collective réglée, il ne faut pas oublier les histoires des survivants des pensionnats autochtones
Au Canada, comme en Australie, la parole se libère et les histoires se racontent. Afin de s’assurer que l’histoire des Premières Nations ne retombe pas dans l’oubli, des ressources pédagogiques nationales ont été créées à destination des enseignants canadiens pour leur permettre d’intégrer cette part de l’histoire du pays dans leur enseignement.
Le processus de réparation des injustices historiques aux États-Unis
Après la colonisation des territoires nord-américains par les Européens, entamée au début du XVIIe siècle, et surtout de l’expansion des États-Unis entre 1803 et 1890 (la « conquête de l’Ouest »), on estime à environ 240 000 la population survivante d’Amérindiens (Native Americans) à la fin du XIXe siècle.
Décimés par les maladies européennes, les déplacements forcés, les massacres et les guerres, les Amérindiens sont relocalisés de force dans des réserves, sur des territoires souvent stériles et inhospitaliers, forcés à la sédentarisation, et leurs enfants envoyés dans des écoles gérées d’abord par les communautés religieuses et les paroisses, puis par l’État fédéral états-unien.
Entre les années 1870 et 1970, des dizaines de milliers d’enfants autochtones furent placés dans des pensionnats gérés par l’État fédéral (boarding schools). Comme en Australie et au Canada, les enfants y étaient la plupart du temps placés de force et sans le consentement de leurs parents. L’objectif affiché était de « civiliser » les enfants autochtones afin de permettre leur assimilation dans la société blanche américaine.
Il faudra attendre 1978 et l’Indian Child Welfare Act pour que les Amérindiens puissent retrouver leur droit fondamental à décider de l’éducation de leurs enfants. Comme l’a répété le président Biden dans son discours du 25 octobre 2024, cette histoire-là n’est pas enseignée dans les écoles.
Aux États-Unis, le processus de réparation des injustices historiques concernait jusqu’alors les Noirs américains, descendants des millions d’esclaves importés d’Afrique du XVIIe au XIXe siècle, et non les Amérindiens. Il était grand temps de briser le silence assourdissant qui a entouré l’histoire des populations autochtones nord-américaines pendant plus de deux siècles, comme l’a reconnu le président Biden : « Cela aurait dû être fait depuis longtemps. »
À travers le pays apparaissent ainsi les témoignages tant attendus d’un processus de reconnaissance de la face sombre de l’histoire de la conquête de l’Ouest, d’une volonté de réparation, d’une volonté aussi d’en finir avec le mythe du bon cow-boy et du mauvais Indien, créé au XIXe siècle et encore très vivace pendant la majeure partie du XXe siècle. En témoignent l’exposition sur le massacre de Sand Creek (ré)ouverte fin 2022 au musée de l’histoire du Colorado de Denver, ou la mise à jour, la même année, de la section consacrée aux peuples et cultures indigènes du musée d’histoire naturelle de Houston, effectuée en partenariat avec des conseillers issus de tribus amérindiennes.

Un an après : l’histoire états-unienne selon Trump
Les excuses officielles présentées par Joe Biden posèrent la première pierre d’un processus de reconnaissance des souffrances et injustices imposées aux Amérindiens et de leur place dans l’histoire des États-Unis, participant ainsi à une réécriture globale de l’histoire de la colonisation, une histoire alimentée à la fois par de nouvelles considérations pré- et post-coloniales, une histoire différente de celle, hégémonique, jusqu’alors écrite par les colons européens et leurs descendants.
Mais un an plus tard, l’écriture de l’histoire des États-Unis a pris une nouvelle direction avec l’administration Trump. En effet, dans un décret signé le 27 mars 2025 et intitulé « Restoring Truth and sanity to American history » (« Restauration de la vérité et du bon sens dans l’histoire américaine »), le président Trump accuse l’administration Biden d’avoir promu « l’idéologie corrosive » d’un « mouvement révisionniste » qui chercherait à construire une histoire « raciste, sexiste et oppressive » de la nation.
En quelques mois, les pages sombres de l’histoire états-unienne doivent disparaître des sites Internet fédéraux, des monuments et parc nationaux, des grands musées. L’Amérique blanche chrétienne reprend le contrôle sur un récit national qu’elle veut façonner à l’image de ses mythes et en accord avec sa propre version de l’histoire.
Sonia Félix-Naix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
20.10.2025 à 15:19
Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?
Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège
Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège
Texte intégral (2698 mots)

Une étude quantitative de 2025 réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population résidente en Algérie confirme que les campagnes d’information sur les risques de la migration irrégulière promues par l’Union européenne et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) n’ont qu’un impact très faible sur la propension à émigrer en dehors des voies légales.
Au printemps dernier, le fonds « Asile, migration et intégration » (Amif), créé par l’Union européenne (UE), lançait un appel à proposition afin de prévenir la migration irrégulière par des campagnes d’information sur les risques liés à ce type de migration.
L’objectif de cet appel doté d’un budget de 10 millions d’euros :
« Dissuader et prévenir la migration irrégulière en fournissant des informations fiables sur les dangers de la migration irrégulière, sur les voies légales d’accès à l’Europe et sur les possibilités économiques alternatives dans les pays d’origine. »
Malgré le fait que les chercheurs s’interrogent depuis longtemps sur l’efficacité de ce type de campagne, l’UE, ses États membres mais aussi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dépensent, chaque année, des budgets conséquents dans des campagnes de ce genre.
Des campagnes nombreuses et à l’efficacité douteuse
Les campagnes d’information ciblant les pays d’origine et de transit des migrants, notamment par le biais d’annonces à la radio et à la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, sont un outil de dissuasion de la migration très fréquemment utilisé par les gouvernements.
Une caractéristique récurrente de ces campagnes est qu’elles mettent en avant les dangers et risques liés à la migration et évoquent rarement les bénéfices que celle-ci peut procurer ni n’informent sur les modalités légales par lesquelles il est possible de rejoindre l’Europe. Dans ces campagnes, l’usage de dispositifs audiovisuels induisant la peur est également fréquent.
Entre 2015 et 2019, au moins 130 campagnes ont été mises en œuvre, dont 104 soutenues par des gouvernements de l’UE. À titre d’exemple, l’OIM et le ministère italien de l’intérieur ont conduit, entre 2016 et 2023, la campagne « Aware Migrants », qui ciblait 11 pays africains d’émigration et de transit. Cette campagne aurait touché, selon ses organisateurs, plus d’un demi-million d’individus. Plus récemment, en 2025, la Belgique a conduit des campagnes visant les demandeurs d’asile camerounais et guinéens transitant par la Bulgarie et la Grèce afin de leur faire savoir que les centres d’accueil du pays sont complets.

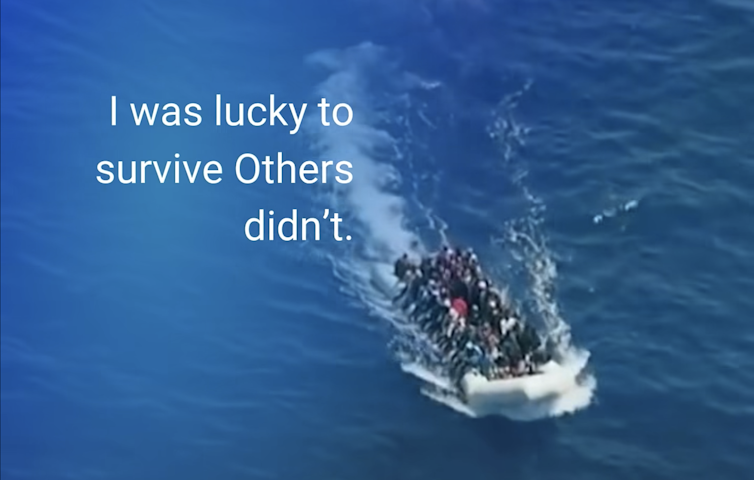
Les chercheurs qui ont analysé ce type de campagnes identifient trois limites récurrentes inhérentes à cet instrument des politiques migratoires européennes.
D’abord, la recherche qualitative existante (une sur le Cameroun, l’autre sur le Ghana) démontre que, contrairement aux hypothèses des financeurs des campagnes, la plupart des candidats potentiels à la migration dans les pays à revenus faible ou intermédiaire sont plutôt bien informés sur les risques liés à la migration irrégulière. Il n’empêche qu’en dépit de leur connaissance des risques encourus, y compris celui de perdre la vie, ils sont nombreux à estimer que, vu l’absence de voies légales pour quitter le pays où ils vivent, l’immigration irrégulière est leur seule possibilité.
À lire aussi : « Barcelone ou la mort » : au Sénégal, des femmes et des hommes en quête d’avenir
Ensuite, des travaux antérieurs ont déjà montré que les candidats à la migration accordent peu de crédit à la qualité de l’information diffusée dans des campagnes financées par des institutions explicitement motivées par le désir de réduire les flux migratoires. Ces campagnes peinent par conséquent à contrer les récits positifs diffusés par d’autres sources – tels les messages véhiculés par les passeurs et par les migrants de même origine déjà établis en Europe – et sont pour cette raison fréquemment présentées par la recherche comme vouées à l’échec.
Enfin, la communauté scientifique dans le champ des études migratoires souligne l’absence d’évaluation systématique de l’impact de ces campagnes et indique que, lorsque des évaluations sont conduites, celles-ci présentent des problèmes de fiabilité. Certains spécialistes s’interrogent également sur le caractère éthique de ces campagnes, qui visent à légitimer des politiques migratoires restrictives, et dont la capacité réelle à réduire la migration irrégulière paraît douteuse.
Une première évaluation à grande échelle auprès de la population algérienne
En réponse à ces critiques, notre étude a mis sur pied une expérimentation intégrée à une enquête administrée en ligne auprès d’un panel de 1 206 personnes représentatif de la population résidente en Algérie afin de tester l’impact de certaines informations sur la décision de migrer de façon irrégulière vers l’Europe.
La population sans papiers algérienne est en effet l’une des plus importantes en Europe : selon Eurostat, parmi les 918 925 personnes en séjour irrégulier en Europe en 2024, près de 60 000 sont des citoyens algériens. Elle constitue aussi le premier groupe national en nombre d’ordre de quitter le territoire, émis dans l’UE (plus de 38 000 citoyens algériens concernés en 2024).
Dans cette expérimentation, nous avons testé six messages.
Les deux premiers portent sur les risques liés à la migration : une vignette concerne les dangers de la migration irrégulière et comprend les risques de décès en mer, d’arrestation et d’expulsion du continent européen. La deuxième traite des murs et des grillages érigés en de nombreux points du territoire de l’UE dans le but de contenir l’immigration irrégulière. Chacun de ces messages a été testé dans une version « texte seul » et dans une version où le même texte est accompagné d’une photo d’illustration renforçant le caractère inquiétant du message écrit.
Les deux autres messages, testés uniquement en version « texte seul », concernaient l’accès aux droits des personnes migrantes dans le pays d’immigration, fréquemment présentés dans le débat politique comme des éléments susceptibles d’encourager la migration irrégulière vers l’Europe. À cet effet, une vignette fournissait des informations concernant la possibilité pour les sans-papiers de régulariser leur statut sous certaines conditions dans différents États membres de l’UE. L’autre concernait la possibilité pour les migrants algériens d’accéder à certaines prestations sociales en Europe grâce à l’existence d’accords bilatéraux de sécurité sociale.
Chacun de ces messages a été testé auprès d’une partie de l’échantillon. Les participants exposés à l’un de ces messages tout comme le groupe de contrôle (n’ayant pas reçu de message) ont ensuite répondu à trois questions sur leur désir et intention d’émigrer vers l’Europe, y compris de façon irrégulière.
Au terme de notre analyse, et dans la continuité des travaux principalement qualitatifs réalisés jusqu’ici sur la question, notre étude confirme l’absence d’impact des campagnes d’information. Plus précisément, fournir des informations sur les risques et les bénéfices liés à la migration n’a pas d’impact significatif sur la propension à migrer de façon irrégulière des individus résidant dans les pays à niveau de revenus faible et intermédiaire.
Impact insignifiant, débat indispensable
Puisqu’il se confirme que ce type d’information n’a pas d’impact sur la décision de migrer de façon irrégulière, il convient à nouveau d’interroger l’objectif des campagnes d’information menées dans les pays d’origine.
Si leur rôle est uniquement de rassurer les opinions publiques européennes quant à la capacité des États à limiter la migration irrégulière, s’agit-il d’un usage légitime des ressources publiques ? Si, comme cela est fréquemment invoqué, l’objectif est réellement d’informer les candidats à la migration quant à la réalité de l’expérience migratoire, alors l’usage d’informations délibérément incomplètes et inquiétantes sur la migration vers l’Europe pose bien entendu de sérieuses questions éthiques.
Autrement dit, le débat sur les campagnes d’information doit s’inscrire dans un débat plus large sur l’évolution des politiques migratoires en Europe. Comme le réclament la communauté scientifique et la société civile organisée, une politique migratoire qui entend permettre uniquement la migration régulière ne peut privilégier à ce point les réponses répressives et dissuasives sans risquer de continuer à produire des politiques migratoires inefficaces et dangereuses.
Si ces campagnes d’informations doivent être poursuivies, il importe qu’elles prennent désormais en compte deux éléments cruciaux jusqu’ici trop souvent passés sous silence. Il s’agit, d’une part, de reconnaître, outre la nécessité de créer de nouvelles voies d’accès légales et sûres vers l’Europe, qu’il existe des modalités légales limitées de migration, dont ces campagnes ne font pas mention. Informer adéquatement sur ces voies légales est un corollaire indispensable au droit de tout individu à quitter son pays, tel que garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme. D’autre part, dans un souci d’offrir une vision réaliste de l’expérience migratoire en Europe, il importe également que ces campagnes reconnaissent que, lorsque les politiques d’inclusion adéquates sont mises en œuvre, l’aspiration des candidats à la migration à une vie meilleure en Europe peut être rencontrée.
Sans prendre ces éléments en considération, ces campagnes sont condamnées à reproduire une vision partielle de l’expérience migratoire en Europe à laquelle les candidats à la migration ne continueront à accorder que peu de crédit.
Jean-Michel Lafleur a reçu des financements du FRS-FNRS pour conduire cette recherche.
Abdeslam Marfouk ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
20.10.2025 à 15:19
Nouveau partenariat Arabie saoudite-Pakistan : quelles conséquences internationales ?
Kevan Gafaïti, Enseignant à Sciences Po Paris en Middle East Studies, Président-fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, doctorant en science politique - relations internationales au Centre Thucydide, Sciences Po
Texte intégral (2155 mots)
Dans un contexte où la protection militaire fournie par les États-Unis peut paraître douteuse, l’Arabie saoudite s’est rapprochée du Pakistan, en signant avec ce grand pays d’Asie doté de l’arme nucléaire un accord de défense aux multiples implications.
En cas d’attaque contre l’Arabie saoudite, le Pakistan utilisera son arme nucléaire pour la défendre, en vertu de leur nouveau pacte de défense mutuelle. C’est en tout cas ce que bon nombre d’observateurs ont conclu de l’annonce, le 17 septembre 2025, de la signature d’un accord stratégique de haut niveau entre Riyad et Islamabad.
Du fait de ses possibles implications nucléaires, l’accord semble porteur de conséquences régionales et internationales majeures. En réalité, une analyse précise révèle que l’Arabie saoudite ne bénéficiera pas nécessairement du parapluie nucléaire pakistanais et que cet accord stratégique n’est pas aussi disruptif qu’annoncé.
Quel lien avec la frappe israélienne sur Doha ?
L’annonce intervient peu de temps après l’attaque illicite israélienne sur Doha, officiellement pour assassiner des cadres du Hamas, alors que le Qatar bénéficie d’un accord de défense avec les États-Unis, dont il héberge la plus grande base militaire au Moyen-Orient.
Il serait erroné de croire que l’accord saoudo-pakistanais a été initié par l’agression israélienne contre le Qatar, laissée impunie par les États-Unis, pourtant juridiquement engagés à protéger l’émirat : un pacte de défense mutuelle s’initie, se prépare et se matérialise en plusieurs années, et certainement pas en quelques jours.
En revanche, l’attaque israélienne et l’impunité qui s’en est suivie ont assurément accéléré le calendrier de l’annonce dudit accord stratégique, l’Arabie saoudite cherchant certainement à souligner une vérité politique ancienne mais peu connue : Riyad et Islamabad entretiennent une relation stratégique fournie, le Pakistan entraînant depuis plusieurs années déjà l’armée saoudienne, et recevant de la monarchie wahhabite différents soutiens financiers.
Il existe évidemment une proximité religieuse entre les deux États musulmans sunnites. À titre anecdotique, il peut être rappelé ici que les talibans afghans, d’obédience deobandi, école religieuse pakistanaise, avaient vu leur premier émirat reconnu internationalement par de très rares États, dont l’Arabie saoudite.
Cette annonce entre l’Arabie saoudite et le Pakistan vient ainsi mettre en lumière plusieurs dynamiques politiques pré-existantes, mais s’accélérant ostensiblement : la maîtrise de la technologie nucléaire civile et militaire fait l’objet d’une rude compétition au Moyen-Orient, région au sein de laquelle les blocs se reconfigurent.
Un accord nucléaire défensif, vraiment ?
La conclusion de l’accord de défense mutuel entre l’Arabie saoudite et le Pakistan est évidemment un événement majeur en soi pour la sécurité internationale, étant donné que le Pakistan possède l’arme nucléaire.
La doctrine nucléaire pakistanaise est de premier emploi, c’est-à-dire que, contrairement à la plupart des autres États nucléarisés, Islamabad se réserve le droit d’utiliser l’arme nucléaire en premier, et pas nécessairement en représailles face à une première attaque nucléaire. Il faut y ajouter que la formulation retenue à propos dudit accord rappelle clairement celle de l’article 5 du traité de Washington établissant l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), c’est-à-dire une clause d’assistance mutuelle et de défense collective. En d’autres termes, si le territoire saoudien est attaqué, même par des moyens conventionnels, le Pakistan peut en théorie employer l’arme nucléaire contre l’agresseur. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Ali Shihabi, présenté comme un analyste proche de la cour royale saoudienne.
Cependant, seul fait foi le verbe des autorités officielles des deux États, dont le communiqué officiel conjoint ne fait absolument pas mention de l’arme nucléaire pakistanaise. Plus largement, le contenu précis de l’accord n’a pas été révélé publiquement, ce qui tend à remettre en cause les analyses trop rapides selon lesquelles la bombe pakistanaise pourrait être utilisée au bénéfice de l’Arabie saoudite.
Le ministre pakistanais de la défense Khawaja Muhammad Asif, a toutefois affirmé que le programme nucléaire de son pays serait « mis à la disposition de l’Arabie saoudite en cas de besoin ». Nous sommes dans le flou sur ce que recouvre vraiment cette coopération nucléaire : sera-t-elle civile ou militaire ? Le volet précis est volontairement non précisé.
À ce stade, il apparaît donc que cet accord marque effectivement une nouvelle étape nucléaire pour l’Arabie saoudite, engagée dans cette voie depuis longtemps ; mais ce pacte de défense mutuelle n’est ni du même calibre que l’Otan ni une garantie militaire nucléaire pour Riyad.
Un approfondissement certain de la relation stratégique Riyad-Islamabad
Si, pour le moment, rien n’indique concrètement que la bombe nucléaire pakistanaise pourrait être utilisée en dehors de la seule défense du territoire national, il n’en reste pas moins que cet accord constitue une avancée majeure dans la relation bilatérale. L’Arabie saoudite marque clairement son souhait de diversifier ses partenariats stratégiques et de ne pas se reposer sur le seul partenaire américain.
Riyad, sans nécessairement s’éloigner de Washington, cherche à se rapprocher d’autres acteurs, asiatiques notamment. L’année 2025 a démontré que les États-Unis de Donald Trump alignaient leur politique moyen-orientale sur celle d’Israël : le président états-unien affirme régulièrement qu’en cas d’échec de la stabilisation à Gaza, le premier ministre israélien aura son plein soutien pour « finir le travail » ; Washington a attaqué l’Iran dans la foulée de l’agression illicite israélienne du vendredi 13 juin 2025 contre l’Iran, mais, nous l’avons dit, n’a pas réagi lorsque Tel-Aviv a aussi attaqué le Qatar, pourtant allié des États-Unis, Trump se contentant, trois semaines plus tard, de contraindre Nétanyahou à téléphoner en sa présence à l’émir du Qatar pour lui présenter ses excuses.
L’Arabie saoudite prend acte du fait que la Maison Blanche donne la priorité à un partenaire au détriment des autres. Elle se rappelle aussi que, lors de sa campagne électorale victorieuse de 2020, Joe Biden avait promis de faire du prince héritier Mohammed Ben Salmane un « paria » à la suite de l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Kashoggi, même s’il avait par la suite changé de position et s’était rendu à Riyad en 2022.
Pour autant, il ne faudrait pas voir une rupture complète dans la relation Washington-Riyad. Celle-ci s’inscrit toujours dans le strategic partnership unissant les deux États depuis le pacte de Quincy de 1945, basé sur une équation simple mais fondamentale : l’Arabie saoudite fournit du pétrole et achète massivement les équipements militaires américains (récemment encore, un contrat d’armement pour 142 milliards de dollars a été signé) ; en contrepartie, les États-Unis protègent l’Arabie saoudite et la monarchie wahhabite à sa tête.
Le Pakistan, quant à lui, renforce son statut de puissance militaire asiatique, mais aussi musulmane, tout en étant tracté vers le jeu moyen-oriental. L’accord peut aussi avoir pour effet de provoquer une embellie économique pakistanaise par des investissements saoudiens, la monarchie wahhabite étant accoutumée à l’équation « sécurité et armes contre financements et contrats ». Cette annonce de pacte de défense mutuelle permet également au Pakistan de réapparaître fort et protecteur par rapport à d’autres acteurs, quand sa propre situation sécuritaire est déjà particulièrement tendue.
Sur son flanc est, des combats sporadiques avaient éclaté en avril-mai 2025 avec le frère ennemi indien dans la région contestée du Jammu-et-Cachemire, faisant craindre le risque d’une guerre ouverte entre puissances nucléaires.
À lire aussi : Inde-Pakistan : vers une nouvelle guerre de grande ampleur ?
À l’ouest, le Pakistan voit dorénavant son filleul taliban le combattre ouvertement, Kaboul et Islamabad se renvoyant la responsabilité des récents meurtriers affrontements transfrontaliers.
Et sur son flanc sud-ouest, le Pakistan sait que la région du Sistan-Baloutchistan, à cheval sur le sol iranien, est hautement inflammable d’un point de vue stratégique, Islamabad entretenant une relation ambivalente avec Téhéran.
L’instauration d’un nouvel ordre sécuritaire régional ?
L’annonce du nouveau partenariat stratégique entre l’Arabie saoudite et le Pakistan est indubitablement un événement majeur dans les dynamiques sécuritaires régionales et internationales, notamment pour les raisons susmentionnées. Nonobstant, cet accord confirme des dynamiques pré-existantes plus qu’il n’en crée et resserre des liens entre des acteurs qui collaboraient déjà dans les secteurs militaire et technologique. Il conforte un lien étroit entre puissances usuellement considérées comme « périphériques » et « intermédiaires », qui cherchent toutes deux à s’éloigner de l’hyperpuissance américaine, mais aussi de ses concurrents globaux (Chine et Russie).
Au-delà de cet accord bilatéral, il faudra suivre de près les perceptions et réactions de deux voisins : l’Iran pour l’Arabie saoudite, l’Inde pour le Pakistan. Téhéran et Riyad sont des rivaux pour l’hégémonie régionale et l’Iran ne saurait voir d’un bon œil un accord stratégique – surtout avec un versant nucléaire – entre deux États l’entourant, même si le président Pezeshkian a salué le pacte, le présentant comme le début de la mise en place d’« un système de sécurité régional ». L’Arabie saoudite doit également ménager son partenaire indien, qui goûte peu ce nouveau rapprochement de Riyad avec Islamabad.
Une puissance internationale peut clairement se réjouir d’un tel accord saoudo-pakistanais : la Chine. Pékin est le premier client du pétrole saoudien et le port pakistanais de Gwadar, dont il a acquis la propriété et où il prévoit d’installer des infrastructures militaires, est le premier point de sa stratégie dite du « collier de perles » qui vise à sécuriser ses approvisionnements énergétiques en provenance du golfe Persique. On l’aura compris : les États-Unis voient se bâtir de nouvelles reconfigurations ouest et sud-asiatiques sans eux, et confortant le rival chinois.
Kevan Gafaïti ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.10.2025 à 16:56
Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels
Pierre-Charles Pradier, Maître de conférences en Sciences économiques, LabEx RéFi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (1847 mots)

Pour blanchir l’argent tiré de la vente de cocaïne, les trafiquants ont longtemps convoyé leurs recettes en utilisant des billets de 500 euros confiés à des « mules ». La surveillance accrue et la raréfaction des grosses coupures ont conduit les réseaux de blanchiment à payer les trafiquants de drogue en cryptomonnaies et à expédier les espèces sur des routes plus tranquilles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).
Le marché de la cocaïne a explosé entre 2014 et 2023. La production en Colombie a été multipliée par plus de sept pour atteindre, selon l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), près de 2 700 tonnes.
En coulisse, les trafiquants de drogue trouvent des moyens tout aussi illicites pour payer leurs fournisseurs, leurs petites mains ou pour dépenser le fruit de leur commerce criminel. La solution utilisée : le blanchiment d’argent. On estime que 25 % des montants collectés doivent être blanchis.
Trois phases sont généralement nécessaires dans le blanchiment : le placement dans le système financier, l’empilement (ou layering) avec le but de perdre la trace de l’origine des fonds et, enfin, l’intégration, où l’argent apparaît désormais légitime. Cette typologie ne permet pas de comprendre que le blanchiment est parfois partiel, c’est-à-dire qu’on s’arrête à la première étape. Considérons un exemple.
Prenons l’argent tiré de la cocaïne en provenance du principal exportateur de la coca : la Colombie. Une partie est intégralement blanchie sur place, en réinjectant l’argent liquide dans des commerces légitimes – restaurants, salons de coiffure, etc. –, tandis qu’une autre partie sert à payer la marchandise. Pour ce faire, il a longtemps suffi de fournir des espèces – en billets de banque –, dont le blanchiment s’achevait en Colombie.
Contrebande d’espèces
En Europe, elles sont changées en billets de 500 euros par des complices travaillant dans des banques puis confiées à des mules d’argent. Ces dernières prennent l’avion avec des sommes de 200 000 à 500 000 euros. Cette contrebande d’espèces en vrac (bulk cash smuggling) est le maillon de la chaîne du trafic de drogue ayant bénéficié à l’apparition des cryptomonnaies dans le trafic de drogue.
Pour bien comprendre l’emploi des cryptomonnaies dans le blanchiment de l’argent de la drogue, il faut expliciter les modalités de la contrebande d’espèces en vrac. Un article de Peter Reute et Melvin Soudijn (le premier est criminologue et le second officier de renseignement dans la police néerlandaise) a permis de mesurer précisément les coûts de cette opération. Ils ont accédé aux documents comptables des trafiquants dans six affaires jugées pour des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2008. Ils totalisent 800 millions d’euros transportés entre les Pays-Bas et la Colombie.
Les coûts représentaient environ 3 % pour le changement des petites coupures en billets de 500 euros, autant pour rémunérer la mule, un peu moins pour son voyage. La surveillance importante de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol obligeait à prendre l’avion ailleurs en Europe. Si on tient compte des frais annexes, le seul transport de fonds à destination de la Colombie coûtait entre 10 % et 15 %, voire jusqu’à 17 % des montants déplacés.
Concrètement :
La cocaïne part de Colombie.
Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.
L’argent collecté de cette vente est changé en billets de 500 euros, moyennant 3 % de frais.
Les billets de 500 euros sont confiés à des mules, moyennant 3 % de frais.
Les mules voyagent vers la Colombie, moyennant 3 % de frais.
L’argent liquide arrive en Colombie pour payer la drogue, puis est blanchi sur place, avec encore des frais.
Pour les auteurs, la réglementation anti-blanchiment réussit à augmenter significativement les coûts de la contrebande, notamment le transport, mais pas le prix de vente, puisque le marché de la cocaïne augmente chaque année en France. En France, les prévalences de consommation ont été multipliées par neuf depuis 2000. Pour pallier ces réglementations, les trafiquants misent sur le billet de 500 euros.
Fin des billets de 500 euros
Rebondissement le 4 mai 2016 : la Banque centrale européenne (BCE) décide de cesser l’émission des billets de 500 euros. Le nombre de ces billets en circulation passe de 614 millions, fin 2015, à un peu moins de 220 millions au milieu de l’année 2025).
« Il a été décidé de mettre fin de façon permanente à la production du billet de 500 euros et de le retirer de la série “Europe”, tenant compte des préoccupations selon lesquelles cette coupure pourrait faciliter les activités illicites », souligne la Banque centrale européenne.
Cette même année, un nouvel actif financier entre en trombe : le bitcoin.
Apparition des cryptomonnaies
À partir de 2016, face à la raréfaction des billets de 500 euros, le bitcoin va contribuer à reconfigurer les routes du trafic d’espèces.
Au lieu d’une filière intégrée où les espèces reviennent à la source de la drogue pour payer les livraisons, on assiste à une spécialisation. D’un côté, les trafiquants de drogue échangent leurs espèces contre des cryptomonnaies qu’ils utilisent pour payer leur approvisionnement en Colombie. De l’autre, une filière de blanchiment récupère les billets et les fait voyager sur des routes plus faciles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).
Comment sait-on cela ? Par exemple, grâce à l’opération Destabilize de la National Crime Agency britannique. Le dossier de presse décrit un réseau international de blanchiment, contrôlé par des Russes. Ils utilisaient une plateforme d’échange n’exerçant pas son obligation de vigilance, Garantex, pour les opérations en cryptomonnaies, et Dubaï pour les opérations en espèces.
Le réseau de blanchiment récoltait les espèces des trafiquants de drogue et les payait en cryptojetons (notamment en USDT-Tether), moyennant 3 % de frais seulement. Par comparaison avec les 10 % à 15 % que coûtait le transport en Colombie avant la mise en extinction des billets de 500 euros, c’est une économie de 70 % à 80 %.
Cadre de déclaration des cryptoactifs
Les cryptomonnaies – d’abord le bitcoin et, désormais, les stablecoins comme l’USDT-Tether – ont permis aux trafiquants de drogue d’économiser leur marge sur l’envoi d’espèces en choisissant les routes les plus sûres. Il est trop tôt pour savoir si l’augmentation considérable du trafic de drogue transatlantique, attestée par une enquête récente du Financial Times, est liée à cette innovation technique.
Concrètement, la nouvelle méthode suit cette nouvelle route entre les trafiquants de drogue et les réseaux de blanchiment :
La cocaïne part de Colombie.
Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.
L’argent collecté de cette vente est changé contre des cryptomonnaies USDT- Tether, moyennant 3 % de frais.
Les cryptomonnaies USDT-Tether sont envoyées en Colombie pour payer la drogue.
Pour le réseau de blanchiment, les espèces sont confiées à des mules, qui voyagent à Dubaï, moyennant 1 % de frais.
À Dubaï, les espèces sont blanchies, moyennant 1 % de frais.
Législation contre le blanchiment par cryptoactif
On peut penser que l’application des règles antiblanchiment aux prestataires de services liés aux cryptoactifs, dans les pays signataires du Crypto-Asset Reporting Framework_, va compliquer le jeu des organisations criminelles… qui sauront pourtant trouver les moindres failles et les exploiter.
L’invention des cryptomonnaies a fait perdre des années dans la lutte contre la criminalité organisée, mais la « coalition des volontaires », comme la Suisse, les Bahamas, Malte ou la France s’organise enfin.
En France, la lutte contre le blanchiment d’argent est renforcée par une loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic », promulguée en juin 2025. Un parquet national spécialisé est créé. Des mesures sont mises en place, de la fermeture administrative des commerces de façade (par les préfets plutôt que les maires trop exposés), le gel des avoirs des narcotrafiquants ou contre le mix de cryptoactifs.
Mais les trafiquants s’adaptent pour éviter d’être pris, c’est ce que nous verrons dans un second article.
A travaillé pour la Direction de la Surveillance du Territoire dans les années 1990.
18.10.2025 à 09:49
De Tianjin à New York : comment la Chine cherche à reconfigurer la gouvernance mondiale
Quentin Couvreur, Doctorant en science politique, Sciences Po
Texte intégral (2102 mots)
En septembre 2025, la Chine a organisé une grand-messe de l’Organisation de coopération de Shanghai et un immense défilé à l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l’occasion pour elle d’afficher sa volonté de réformer la gouvernance mondiale et de se poser en leader du « Sud global ». Dans le même temps, comme l’a démontré la dernière Assemblée générale de l’ONU, la République populaire cherche à s’imposer toujours davantage au sein des Nations unies, tout en rapprochant les institutions onusiennes des plateformes multilatérales qu’elle contrôle.
Dans un contexte marqué par l’unilatéralisme croissant des États-Unis de Donald Trump et par les incertitudes qui pèsent sur le système onusien, la Chine cherche à apparaître comme un pilier de la gouvernance mondiale tout en appelant à la réforme de celle-ci.
Au mois de septembre 2025, le double anniversaire de la victoire des Alliés (reddition de l’Allemagne en mai et du Japon en septembre 1945) et de la fondation de l’Organisation des Nations unies en octobre 1945 a offert à Pékin une séquence idéale pour promouvoir un système multilatéral plus étroitement aligné sur ses intérêts.
Le sommet de l’OCS et l’annonce de l’Initiative pour la gouvernance mondiale
La séquence s’est ouverte le 1er septembre à Tianjin, où la Chine organisait le 25e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Fondée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre pays centrasiatiques, l’OCS était à l’origine une organisation régionale essentiellement vouée aux questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Elle s’est ensuite progressivement étendue, intégrant l’Inde et le Pakistan (2017) puis l’Iran (2023) comme nouveaux membres.
Aujourd’hui, l’organisation eurasiatique – la plus « grande organisation régionale du monde », comme aime à le rappeler Pékin – s’est muée en une plateforme stratégique au sein de laquelle la Chine promeut ses normes et son discours sur la nécessaire réforme de l’ordre international, tout en affichant son leadership au sein du « Sud global ».
À Tianjin, le président chinois Xi Jinping avait ainsi rassemblé une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi.
En présence du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le président chinois a saisi l’occasion de ce sommet pour annoncer une Initiative pour la gouvernance mondiale (GGI, de l’anglais Global Governance Initiative), visant à « construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable ». Déclinant cinq concepts clés, il a notamment souligné l’importance du respect de la souveraineté et du droit international, tout en appelant à renforcer le multilatéralisme face aux grands défis mondiaux.
Formulée en termes délibérément vagues et exempte de propositions concrètes, la GGI n’en esquisse pas moins la vision chinoise d’une gouvernance mondiale reconfigurée, dans l’objectif de pallier trois « défaillances » des organisations existantes : la sous-représentation des pays du Sud dans les enceintes internationales, l’érosion de l’autorité des Nations unies (incarnée par l’impuissance du Conseil de sécurité face à la situation à Gaza) et leur manque d’efficacité (démontré par le retard dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable).
Cette vision se caractérise par la centralité qu’elle accorde aux questions de développement économique, par son refus des alliances militaires au profit d’une sécurité commune, et par sa conception pluraliste de la « coexistence harmonieuse » entre civilisations, qui ne laisse aucune place à l’universalité des droits humains.
Ces thématiques avaient déjà été mises en avant par les trois initiatives globales lancées par Xi Jinping entre 2021 et 2023, portant respectivement sur le développement, sur la sécurité et sur la civilisation.
Une constellation d’organisations et de forums multilatéraux
Cette vision se manifeste également dans le choix du sommet de l’OCS pour annoncer la GGI. L’OCS incarne en effet la volonté de Pékin de reconfigurer la coopération multilatérale autour d’une constellation d’organisations, de forums et de mécanismes peu contraignants, dont le principal point commun est de promouvoir un monde multipolaire, tout en accordant une place prépondérante, voire centrale, à la Chine. S’appuyant sur son « cercle d’amis » parmi les pays en développement, Pékin entend bâtir des contrepoids aux institutions dominées par les pays occidentaux, comme le G7.
Cette constellation comprend en premier lieu l’OCS et les Brics+, dont l’élargissement récent était une priorité pour la Chine. Dans le domaine financier, elle inclut également la Nouvelle Banque de développement des Brics (NBD), mais aussi la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), établie en 2016. Surtout, elle s’étend via la multiplication des forums « multi-bilatéraux » sino-centrés, comme le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) ou le Sommet Chine-Asie centrale, dont la première édition a été organisée en 2023.
Si ces plateformes participent d’abord d’un « effet d’affichage », l’évolution de l’OCS traduit la volonté chinoise d’en faire un vecteur d’approfondissement des coopérations.
Invoquant la nécessité de mettre en œuvre des « actions concrètes », le président chinois a ainsi plaidé pour la création d’une banque de développement de l’OCS. Il a aussi annoncé la mise en œuvre d’une centaine de projets de développement en faveur des États membres, financés par un don de deux milliards de yuans (240 millions d’euros), de même qu’un renforcement de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’intelligence artificielle.
Quel rôle pour l’ONU dans la diplomatie multilatérale chinoise ?
À la lumière de ces évolutions, la place accordée aux Nations unies dans la vision chinoise du multilatéralisme interroge. En effet, en 2015, pour le 70e anniversaire de l’ONU et pour son premier discours en tant que président de la Chine à la tribune de l’Assemblée générale, Xi Jinping avait mis en scène l’engagement multilatéral de son pays, présenté comme prêt à assumer davantage de responsabilités et à renforcer sa contribution à une organisation considérée comme « la plus universelle, la plus représentative et dotée de la plus haute autorité ».
Au cours des années suivantes, la Chine s’est affirmée comme une actrice majeure du système onusien, devenant sa quatrième contributrice financière et prenant la direction de plusieurs agences. Ambitionnant de transformer l’organisation depuis l’intérieur, elle s’est investie dans les Nations unies pour renforcer ses liens avec les pays en développement, diluer les normes libérales et redéfinir la conception des droits humains, tout en promouvant ses propres initiatives, en particulier les Nouvelles Routes de la soie.
À lire aussi : Organisations internationales : le spectre d’une hégémonie chinoise se concrétise
Dix ans plus tard, pour le 80e anniversaire de l’ONU, Xi Jinping n’a pas fait le déplacement à New York, préférant y dépêcher son premier ministre, Li Qiang. Cette absence n’est pas anodine, puisque c’est la première fois depuis 1985 qu’un président chinois ne se rend pas à un anniversaire décennal de l’organisation. De même, le choix de dévoiler la GGI au sommet de l’OCS plutôt qu’à la tribune de l’Assemblée générale peut être interprété comme une volonté de la Chine de privilégier et de renforcer des plateformes où elle peut plus aisément manœuvrer.
Néanmoins, l’ONU demeure une source essentielle de légitimité pour Pékin, qui continue de proclamer son soutien à l’organisation, en contrepoint du désengagement des États-Unis. Pékin renforce sa présence au sein des institutions onusiennes et a accru ses contributions financières volontaires en 2024, celles-ci atteignant leur plus haut niveau depuis 2016. Pour autant, ces contributions restent modestes au regard des besoins, et la Chine contribue elle-même à la grave crise de liquidités que traverse l’ONU, en s’acquittant de plus en plus tardivement de ses contributions obligatoires.
Revendiquer l’héritage de 1945
Au total, ces dynamiques ambivalentes ne suggèrent ni un désintérêt complet de Pékin pour le système onusien, ni une montée en puissance qui verrait la Chine entièrement supplanter les États-Unis en son sein, ni encore l’édification d’un ambitieux système alternatif. En réalité, elles reflètent plutôt la volonté chinoise d’arrimer plus étroitement le système onusien aux formats multilatéraux privilégiés par Pékin. En témoigne l’adoption par l’Assemblée générale, le 5 septembre 2025, d’une résolution sur la coopération entre l’ONU et l’OCS, malgré l’opposition ou l’abstention des pays occidentaux.
Cet arrimage vise in fine à faire apparaître la vision illibérale de la Chine comme conforme aux principes de la Charte des Nations unies. C’est en effet l’héritage de 1945 que la Chine revendique, comme l’illustre le télescopage temporel entre le sommet de l’OCS et le grand défilé militaire organisé à Pékin pour les commémorations du 80e anniversaire de la victoire dans la « Guerre mondiale antifasciste ». Pour le Parti communiste chinois, il s’agit de se poser en garant légitime des principes fondateurs de la gouvernance mondiale et de l’ordre international, réinterprétés à l’aune de ses préférences idéologiques. En cela, comme l’a reconnu Li Qiang dans son discours, l’ONU demeure pour l’heure « irremplaçable ».
Quentin Couvreur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.10.2025 à 11:40
L’Europe face à la « mise à l’épreuve permanente » imposée par la Russie
Christo Atanasov Kostov, International Relations, Cold War, nationalism, Russian propaganda, IE University
Texte intégral (1797 mots)
Derrière les manœuvres hybrides de la Russie – militaires, cyber et politiques – se dessine un objectif constant : épuiser l’Occident, diviser l’Europe et redessiner l’ordre sécuritaire issu de la guerre froide.
Les images sont tristement familières : les chars russes entrant en Géorgie en 2008, l’annexion de la Crimée en 2014 puis l’invasion de l’Ukraine en 2022, les avions militaires russes violant l’espace aérien européen et désormais de mystérieux drones provoquant la fermeture d’aéroports à travers le continent.
Ces épisodes s’inscrivent dans une stratégie unique, cohérente et en constante évolution : user de la force militaire là où c’est nécessaire, mener une guerre « hybride » ou « de zone grise » là où c’est possible, et exercer une pression politique partout ailleurs. Depuis des décennies, Moscou déploie ces tactiques avec un objectif précis : redessiner la carte sécuritaire de l’Europe sans déclencher une guerre directe avec l’OTAN.
Cet objectif n’a rien d’improvisé ni d’ambigu. Il repose sur un principe révisionniste : renverser l’élargissement de l’OTAN vers l’Est survenu après la guerre froide et rétablir une sphère d’influence russe en Europe.
C’est cette logique qui a guidé les actions du Kremlin à la veille de l’invasion de l’Ukraine. En décembre 2021, Moscou exigeait que l’OTAN proclame officiellement que l’Ukraine et la Géorgie ne pourront jamais adhérer à l’Alliance, et que les troupes de l’OTAN se retirent sur leurs positions de mai 1997, c’est-à-dire avant l’entrée des anciens États socialistes d’Europe de l’Est.
Ce n’était pas une manœuvre diplomatique préalable à l’invasion de février 2022, mais bien un objectif en soi. Aux yeux du Kremlin, l’élargissement de l’OTAN représente à la fois une humiliation et une menace existentielle qu’il faut enrayer à tout prix.
À lire aussi : « Nous avons été humiliés » : le discours du Kremlin sur les années 1990 et la crise russo-ukrainienne
Un arsenal de moyens de pression
Les actions russes peuvent tour à tour être perçues comme relevant du chantage, de la démonstration de force ou de la tentative de pression diplomatique. En réalité, elles relèvent de tout cela à la fois. Moscou brouille délibérément la frontière entre diplomatie, action militaire et propagande intérieure. Son « arsenal » de pressions s’organise en plusieurs volets :
La « stratégie du bord de l’abîme » pour forcer le dialogue : Les montées en puissance militaires – des concentrations de troupes à l’invasion de l’Ukraine – créent des crises qui obligent l’Occident à réagir. La Russie fabrique des situations d’urgence pour gagner du poids dans la négociation, comme elle l’a fait pendant la guerre froide, puis en Géorgie (2008) et en Ukraine (depuis 2014).
Les tests en « zone grise » : Les incursions de drones et d’avions russes dans l’espace aérien de l’Allemagne, de l’Estonie, du Danemark ou de la Norvège servent à jauger la capacité de détection et de réaction de l’OTAN. Elles permettent aussi de collecter des données sur la couverture radar, sans franchir le seuil d’un affrontement ouvert.
La pression hybride sur les « petits » membres de l’OTAN : Les cyberattaques et les perturbations énergétiques qui touchent divers États de l’OTAN visent à tester la solidarité de l’Alliance. Moscou cible les pays les plus vulnérables pour semer la discorde et la méfiance au sein de l’organisation.
Le théâtre intérieur : Sur la scène nationale, l’affrontement avec l’Occident sert de mise en scène politique. Comme l’a récemment déclaré Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, « l’Europe a peur de sa propre guerre ». Les atermoiements des Européens permettent de convaincre toujours davantage les Russes que l’Occident est indécis et faible, tandis que la Russie, elle, est forte et déterminée.
Cette stratégie n’a rien de nouveau : elle prolonge des méthodes éprouvées depuis l’effondrement de l’URSS. De la Transnistrie à l’Abkhazie, en passant par l’Ossétie du Sud et le Donbass, Moscou entretient des conflits « gelés » qui bloquent durablement l’intégration euro-atlantique de ces régions.
À lire aussi : Trente ans après l’effondrement de l’URSS, ces États fantômes qui hantent l’espace post-soviétique
Une « épreuve permanente »
Aujourd’hui, le Kremlin privilégie les moyens hybrides – drones, cyberattaques, désinformation, chantage énergétique – plutôt que la guerre ouverte. Ces provocations ne sont pas aléatoires : elles forment une campagne méthodique de tests.
Chaque incursion, chaque attaque sert à évaluer la réponse à ces questions : L’Europe sait-elle détecter ? Réagir de manière coordonnée ? Agir rapidement et efficacement ?
Comme l’ont reconnu des responsables belges après une récente série de survols de drones, le continent doit « agir plus vite » pour bâtir sa défense aérienne. Chaque aveu de ce type renforce la conviction du Kremlin : l’Europe est lente, divisée, vulnérable.
Ces épisodes sont ensuite recyclés en séquences de propagande à la télévision d’État, où les commentateurs moquent la « faiblesse » européenne et présentent la confusion du continent comme la preuve du bien-fondé de la ligne dure de Moscou. Cette crise fabriquée est, à son tour, la dernière application d’une stratégie longuement rodée. Vis-à-vis de l’Occident, l’objectif n’est pas la conquête, mais l’épuisement : une « mise à l’épreuve permanente » destinée à user ses ressources et sa cohésion par une pression continue, diffuse et de faible intensité.
Et maintenant ?
Les provocations croissantes de la Russie envers l’OTAN et l’Europe ne peuvent pas durer indéfiniment sans conséquences. Trois scénarios principaux se dessinent :
Une nouvelle confrontation durable : C’est l’issue la plus probable. L’OTAN ne peut satisfaire les exigences fondamentales du Kremlin sans renier ses principes fondateurs. Le conflit prendrait alors la forme d’un face-à-face prolongé : renforcement du flanc oriental de l’Alliance, explosion des budgets de défense et érection d’un nouveau rideau de fer.
La « finlandisation » de l’Ukraine : Un scénario possible, mais instable, verrait l’Ukraine contrainte à adopter un statut de neutralité – renonçant à rejoindre l’OTAN en échange de garanties de sécurité, à l’image de la Finlande pendant la guerre froide. Du point de vue occidental, cela reviendrait à récompenser l’agression de Moscou et à consacrer son droit de veto sur la souveraineté de ses voisins.
L’escalade par erreur de calcul : Dans un climat de tension permanente, un incident mineur – un drone abattu, une cyberattaque mal maîtrisée – pourrait rapidement dégénérer. Une guerre délibérée entre la Russie et l’OTAN reste improbable, mais elle n’est plus inimaginable.
L’impératif européen : la résilience
La stratégie du Kremlin repose sur la fragmentation. La réponse de l’Europe doit être la cohésion. Cela implique de renforcer plusieurs capacités clés :
Une défense aérienne et antimissile intégrée : construire un véritable bouclier continental, sans failles exploitables par les drones ou les systèmes hypersoniques.
Une défense hybride collective : Considérer les cyberattaques ou les incursions de drones comme des menaces visant l’ensemble de l’Alliance. Un mécanisme de réponse unique et prédéfini priverait Moscou de la possibilité d’isoler un membre.
Une autonomie technologique et politique : investir dans les industries européennes de défense, l’indépendance énergétique renouvelable et la solidité des chaînes d’approvisionnement. La sécurité commence désormais par la souveraineté, surtout face à l’incertitude du soutien américain.
Une dissuasion diplomatique : associer une capacité militaire crédible à un dialogue pragmatique, en maintenant ouverts les canaux de communication pour éviter toute escalade.
La stratégie russe n’est pas une réaction conjoncturelle : elle est structurelle.
Le Kremlin cherche à contraindre l’Occident à accepter un nouvel ordre sécuritaire en combinant coercition, tests et pression continue. Les moyens varient – chars, drones, guerre hybride d’usure – mais le but reste le même : affaiblir l’unité européenne et restaurer la sphère d’influence perdue en 1991.
Le défi de l’Europe est tout aussi clair : résister à la fatigue des crises répétées et prouver que la résilience, plutôt que la peur, définira l’avenir du continent. Les provocations de Moscou se poursuivront tant qu’elles ne lui coûteront pas trop cher. Seule une Europe unie et préparée pourra inverser ce calcul.
Christo Atanasov Kostov ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.10.2025 à 16:35
Maria Corina Machado, Nobel de la paix : et si Trump avait finalement gagné ?
Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine, Université de Rouen Normandie
Texte intégral (2333 mots)
Maria Corina Machado est certes une personnalité courageuse et déterminée, qui combat depuis des années le régime autoritaire en place dans son pays, le Venezuela. Mais certaines de ses prises de position semblent peu compatibles avec l’obtention d’un prix Nobel de la paix. La récompense qui lui a été attribuée, le 10 octobre 2025, pourrait apaiser Donald Trump, qui soutient depuis longtemps son action et qui se trouve engagé dans un bras de fer de plus en plus tendu avec le pouvoir vénézuélien dirigé par Nicolás Maduro.
La campagne de Donald Trump pour l’obtention du prix Nobel de la paix a été aussi inédite que pressante. La désignation de Maria Corina Machado a beaucoup surpris.
Certes, elle vient couronner une lutte infatigable contre le gouvernement autoritaire de Nicolás Maduro ; mais le profil de la lauréate est davantage celui d’une militante opposée à la dictature de son pays que d’une pacifiste. Cela reflète la tendance du Comité Nobel norvégien à davantage récompenser, ces dernières années, des promoteurs de la démocratie dans des régimes opposés aux intérêts géopolitiques occidentaux que des personnalités ayant « ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » comme le souhaitait Alfred Nobel dans son testament.
Ainsi, Maria Corina Machado s’inscrit dans la lignée du journaliste russe Dmitri Mouratov, lauréat en 2021, du militant des droits humains biélorusse Ales Bialiatski et de l’ONG russe Mémorial, célébrés en 2022, ou encore de Narges Mohammadi, militante des droits humains iranienne récompensée en 2023.
Qui est Maria Corina Machado ?
Le rapport à la paix de Maria Corina Machado mérite d’être questionné. En effet, outre son soutien à la tentative de coup d’État d’avril 2002 contre Hugo Chavez, alors président démocratiquement élu (soutien partagé par de larges secteurs de l’opposition vénézuélienne), Machado, âgée aujourd’hui de 58 ans, incarne les fractions les plus radicales des détracteurs d’Hugo Chavez puis de son successeur (depuis 2013) Nicolás Maduro et les plus subordonnées aux stratégies les plus brutales des États-Unis contre le gouvernement vénézuélien.
Ainsi, elle a été reçue par George W. Bush dans le bureau Ovale, le 31 mai 2005, en pleine guerre en Irak. En 2019, au moment de l’auto-proclamation de Juan Guaido comme chef de l’État vénézuélien alternatif, qui sera reconnu par une soixantaine de pays, elle en appelait à une intervention militaire étrangère contre le Venezuela parce que « les démocraties occidentales doivent comprendre qu’un régime criminel ne sera chassé du pouvoir que par la menace crédible, imminente et grave d’un recours à la force ».
Plus récemment encore, début octobre, à l’antenne de Fox News, elle remerciait Donald Trump pour les assassinats ciblés qu’il commet dans la mer des Caraïbes et pour ses menaces militaires contre son propre pays.
Si d’autres lauréats, aux positionnements idéologiques variés, tels Henry Kissinger, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres ou Juan Manuel Santos, avaient pu commettre ou appeler à commettre des actes violents avant leur désignation, ils avaient rompu avec cette orientation au moment de leur prix ou participé au règlement d’un conflit, aussi provisoirement que ce soit. Ce n’est pas le cas de Maria Corina Machado.
Grâce à ce positionnement intransigeant à l’encontre d’un gouvernement jugé responsable du tournant autoritaire et de l’effondrement économique du pays depuis 2013, elle bénéficie d’une aura importante dans la population vénézuélienne. Le Venezuela a vu son PIB baisser de 74 % entre 2014 et 2020, pour moitié du fait de la mauvaise gestion économique d’Hugo Chavez puis de Nicolás Maduro (en particulier une politique monétaire particulièrement négligente) et pour autre moitié à cause des mesures coercitives unilatérales édictées par Donald Trump durant son premier mandat et soutenues par Maria Corina Machado.
Dans ce marasme, Nicolás Maduro se maintient au pouvoir en dépit d’un soutien électoral minoritaire, à travers l’utilisation des institutions électorales, judiciaires et militaires, ce qui lui a permis de déposséder l’Assemblée nationale, où l’opposition était alors majoritaire, de ses prérogatives en 2015 ; de réprimer, au prix de plus d’une centaine de morts, une vague de manifestations en 2017 ; de réaliser une fraude massive pour inverser les résultats du scrutin présidentiel en 2024…
La popularité de Maria Corina Machado est aujourd’hui puissante : elle a remporté les primaires de l’opposition vénézuélienne en octobre 2023 avec 92,3 % des suffrages exprimés (après le retrait de plusieurs candidats qui n’avaient aucune chance). Après avoir été frappée d’inéligibilité par les institutions pro-Maduro, elle a parcouru le pays en faveur d’un illustre inconnu devenu candidat de l’opposition, Edmundo González Urrutia, suscitant un réel enthousiasme à travers le pays, avec une promesse qui a eu un fort impact : la réunification des familles dans un pays meurtri par l’exode de plus de huit millions de ses compatriotes, soit plus d’un quart de la population nationale.
Nicolás Maduro, en menant à l’échec tous les processus de négociations avec une opposition plus modérée, en limitant drastiquement le droit à la candidature des différentes personnalités, a paradoxalement propulsé son antithèse : libérale économiquement (quoique Maduro mène désormais une politique de dollarisation rampante de son économie) et alignée géopolitiquement sur les États-Unis.
Quelles conséquences pour le Venezuela ?
Les conséquences de ce prix Nobel seront sans doute limitées au Venezuela. Maria Corina Machado a déjà reçu, en octobre 2024, le prix des droits de l’homme Václav-Havel de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et, en décembre 2024, le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit du Parlement européen, à l’initiative des groupes parlementaires de droite et d’extrême droite.
Cela n’a pas changé les conditions de clandestinité dans lesquelles elle vit ni empêché sa brève arrestation en janvier 2025 à l’issue d’une apparition dans une manifestation lors de l’investiture de Nicolás Maduro pour ce nouveau mandat frauduleux.
L’octroi du prix Nobel augmente le coût de sa répression, mais ne change pas la configuration politique vénézuélienne. Dans les conditions de répression que connaît le Venezuela, le Nobel se « célèbre en silence » parmi les nombreux mécontents du gouvernement Maduro.
Parmi les conséquences concrètes de ce prix, on note la fermeture de l’ambassade du Venezuela à Oslo dans le cadre d’une « restructuration intégrale » de ses représentations à l’étranger, alors que la Norvège est médiateur des négocations entre le gouvernement Maduro et l’opposition depuis 2019.
La victoire d’une alliée de Donald Trump
L’octroi de ce prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado est aussi une manière de récompenser Donald Trump sans le dire. Dans le contexte actuel, récompenser une institution défendant le droit international, telles la Cour pénale internationale (CPI) ou la Cour internationale de justice (CIJ), aurait été perçu comme un signal d’irrévérence à l’égard du président états-unien. En revanche, choisir une opposante vénézuélienne qui soutient sa politique dans les Caraïbes est une légitimation de son action.
Depuis août 2025, Donald Trump a déployé la quatrième flotte des États-Unis (l’US Navy) dans la mer des Caraïbes sous le prétexte de lutte contre le narcotrafic. À la date du 16 octobre 2025, cinq navires ont été détruits par les troupes états-uniennes au large des côtes vénézuéliennes, coûtant la vie à 27 personnes au total.
L’administration Trump avait jusqu’alors privilégié une approche de négociations promue par son conseiller pour les missions spéciales Richard Grenell, sur une base d’échange contractuelle « maintien des licences pétrolières » contre « acceptation des déportations de retour de Vénézuéliens ». La licence de la firme multinationale Chevron a été suspendue en mai pour être rétablie sous d’autres modalités en juillet. Le jour même de l’obtention du prix Nobel par Maria Corina Machado, Shell a obtenu de l’administration de Washington l’autorisation d’extraire du gaz dans la zone Dragon à l’intérieur des eaux vénézuéliennes. Cependant, quelques jours auparavant, Donald Trump avait demandé à Richard Grenell de cesser ses communications avec Nicolás Maduro.
Le locataire de la Maison Blanche semble opter pour une stratégie de changement de régime, portée de longue date par le secrétaire d’État Marco Rubio. Pour autant, une guerre ouverte entre les États-Unis et le Venezuela ne semble pas pour l’heure d’actualité. La dernière intervention directe de Washington en Amérique latine date de 1989, au Panama, déjà au nom de la répression de la complicité des autorités du pays avec le narcotrafic – complicité en l’occurrence avérée.
Toutefois, le Panama représentait en termes militaires une cible mineure par rapport à ce que constitue l’État vénézuélien aujourd’hui, même après une décennie de crise économique. Une campagne militaire, telle que l’opération Midnight Hammer à l’encontre de l’Iran en juin 2025, ne saurait être exclue, d’autant que l’administration Trump vient d’autoriser des actions secrètes de la CIA au Venezuela. Même un journal historique de l’opposition libérale, El Nacional, redoute une telle intervention, considérant qu’il s’agirait d’un cataclysme.
En récompensant Maria Corina Machado, au moment où les menaces états-uniennes contre le Venezuela sont maximales, le Comité Nobel légitime la politique de changement de régime de Donald Trump. Si Maria Corina Machado a dédié son prix au président états-unien, c’est que cette récompense est aussi un peu la sienne.
Thomas Posado ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.10.2025 à 15:49
Au Japon aussi, la neutralité des médias est au cœur des débats
César Castellvi, Sociologue, maître de conférences en études japonaises, Université Paris Cité
Texte intégral (3001 mots)
Croyant que son micro était éteint, un caméraman d’une grande agence de presse a laissé entendre qu’il ferait son possible pour nuire à la nouvelle cheffe du principal parti du Japon, et donc probable future première ministre. Le scandale qui s’est ensuivi a remis au premier plan une question qui existe aussi dans bien d’autres pays, à commencer par la France : celle de la neutralité des médias.
Samedi 4 octobre 2025, le monde apprenait la victoire de Sanae Takaichi à l’élection interne de la direction du Parti libéral-démocrate (PLD) japonais. Cette victoire met la principale intéressée en position de devenir la première femme premier ministre de l’histoire du Japon, nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté internationale.
Dans le tumulte des conférences de presse données par la possible future cheffe du gouvernement, un scandale a éclaté le 7 octobre dernier.
Lors d’une réunion de discussion sur le futur de la coalition entre le PLD et son allié traditionnel, la formation d’obédience bouddhiste Komeitō, les propos d’un caméraman de l’agence de presse Jiji présent sur place et disant à un de ses interlocuteurs, alors qu’il ignorait que son micro était ouvert, « je vais faire baisser sa cote de popularité » et « je ne publierai que des photos qui la feront baisser », ont été diffusés en direct sur la page YouTube de la chaîne Nippon TV, la principale chaîne commerciale du pays.
Malgré le caractère informel de la conversation d’origine, il n’en fallait pas plus pour que la tempête se lève et que soit lancée une chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux pour identifier la personne à l’origine de ces commentaires. Le quotidien Asahi Shimbun relevait ainsi que la vidéo avait été vue plus de 37 millions de fois en quelques heures et suscité de très nombreux commentaires indignés.
Dès le 8 octobre, plusieurs responsables de l’agence de presse ont pris la parole à travers des communiqués afin de s’excuser publiquement et d’annoncer que le caméraman avait reçu un blâme pour son manque de professionnalisme. L’un des principaux responsables de la rédaction déplorait également le fait que ces commentaires « avaient semé le doute sur l’impartialité et la neutralité du travail journalistique ».
Si Sanae Takaichi elle-même n’a pas encore réagi, la porte-parole et responsable de la communication du PLD, Suzuki Takako, a publié le même jour un message sur le réseau social X dans lequel elle déclarait que « même si cela devait être une plaisanterie, au regard du principe de neutralité et d’impartialité politique qui s’impose à la presse, ces propos sont profondément regrettables ».
La question de la neutralité et de l’impartialité de la presse a régulièrement été mise en avant depuis le début de ce scandale. Mais qu’impliquent exactement ces notions dans le contexte japonais ?
La « neutralité politique » des médias japonais
Au moment de leur naissance, dans les années 1870, les premiers quotidiens japonais (dont un nombre important sont toujours en activité) se sont créés sur la base de rattachements partisans et militants. Il s’agissait de journaux d’opinion défendant les positions politiques des différentes factions, réformatrices ou conservatrices, qui débattaient alors de la direction à prendre pour moderniser le pays.

Cette affiliation partisane assumée va rapidement s’effacer au fur et à mesure de l’industrialisation de la presse. Les « petits journaux » qui, comme en France, fondaient leur modèle économique sur les faits divers, les divertissements et les annonces commerciales vont d’abord prendre le pas sur les journaux d’opinion, au point de les faire disparaître.
Surtout, le contexte politique des premières décennies du XXe siècle, d’abord à la suite d’autres affaires, puis de la période nationaliste des années 1930, va pousser la plupart des rédactions à réfuter les affiliations partisanes et à proclamer leur neutralité à l’égard des partis politiques, à travers l’expression « neutralité et impartialité politiques » (fuhen futō), revenue au premier plan ces derniers jours à la suite du scandale mentionné provoqué par les propos du caméraman de Jiji. Cette formule est présente dans les chartes déontologiques de nombreux médias contemporains.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces d’occupation américaines vont réinscrire ce principe dans leur politique de censure et d’encadrement des principaux journaux, accusés d’avoir contribué à la montée du nationalisme d’avant-guerre (sans que cela débouche sur le démantèlement des principaux quotidiens), en tentant de faire la promotion des valeurs journalistiques en vigueur de l’autre côté du Pacifique.
Quelques mois après que le Japon a recouvré son autonomie politique, la loi sur la radiodiffusion (Hōsō hō) de 1950 va elle aussi imposer ce principe de « neutralité et d’impartialité politiques » à l’ensemble des chaînes de télévision, publiques et privées, qui vont progressivement être créées durant les années qui vont suivre.
La neutralité politique au cœur de l’information
Durant la formidable expansion de la presse écrite japonaise entre les années 1960 et 1990, l’absence de position partisane dans la presse a été au cœur du mode de fonctionnement des journaux, dans un contexte de domination sans partage du Parti libéral-démocrate. Cela ne signifiait pas que les journaux ne disposaient pas de lignes éditoriales propres. Mais le soutien clair ou direct à une faction politique a très largement été proscrit, alors que l’opposition politique a perdu l’accès au pouvoir pendant plusieurs décennies.

La logique d’expansion des journaux s’est surtout faite sur des campagnes d’abonnement très incitatives, la promotion des événements sportifs ou encore une place très importante donnée à la couverture des faits divers. La couverture du monde politique, elle, s’est concentrée sur le suivi des stratégies internes des partis, bien plus que sur le journalisme d’investigation. Mais plus encore que la presse, c’est la télévision qui a été marquée par le principe de neutralité.
En effet, ce principe constitue une obligation légale à laquelle sont astreintes toutes les chaînes, sous peine de se voir retirer leur licence d’émission. Ainsi, les apparitions de personnalités politiques lors d’émissions télévisées ou la gestion des spots de campagne lors d’élections locales ou nationales sont, en principe, strictement encadrées.
Toutefois, le diable se cache dans les détails. Alors qu’en France ou aux États-Unis le contrôle du respect de ces règles est normalement assuré par des agences officiellement indépendantes des gouvernements (l’Arcom dans le cas français et la Federal Communications Commission aux États-Unis), au Japon l’attribution des licences comme le contrôle des contenus sont des tâches dont la charge revient au ministère des Affaires intérieures et des Communications.
Cela met ainsi tout l’audiovisuel sous le contrôle des différents gouvernements au pouvoir. Et comme nous allons le voir, un certain nombre d’affaires récentes ont montré que le pouvoir politique n’hésitait pas à rappeler sa position de force aux médias audiovisuels ne respectant pas sa conception de la « neutralité politique ».
L’injonction à la neutralité comme moyen de pression
La décennie 2010, au cours de laquelle Shinzo Abe a dirigé le Japon, a été marquée par une période de forte pression à l’encontre des médias nippons. La chute du Japon dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières en est un des indices les plus frappants, le pays étant passé de la 11ᵉ à la 66ᵉ place en quelques années. En 2017, le rapporteur des Nations unies pour la liberté d’information et d’expression s’était d’ailleurs alarmé de la situation à l’époque, dans un rapport très largement commenté.
Revenons un moment à Sanae Takaichi. Les observateurs internationaux l’ont généralement découverte dans les années 2010, lorsqu’elle était ministre des affaires intérieures et des communications dans plusieurs des gouvernements d’Abe. Réputée proche de l’ancien premier ministre, elle a occupé cette position entre 2014 et 2017, puis entre 2019 et 2020.
Elle s’est alors fait remarquer en mentionnant lors d’une session parlementaire à la Diète, en 2016, que le gouvernement se gardait le droit de couper l’accès aux ondes des chaînes de télévision qui ne respectaient pas sa vision de « la neutralité et de l’impartialité politique ». À l’époque, cette menace s’adressait notamment aux chaînes commerciales TV Asahi et TBS, dont certains propos et émissions étaient, aux yeux d’Abe et de ses proches, trop critiques à l’encontre du gouvernement.

L’argument de Takaichi, déjà à l’époque, était celui de l’obligation de respecter le principe de « neutralité et d’impartialité » des contenus, sans que personne ne soit véritablement capable d’en définir les critères. Cela fait pourtant longtemps que le flou entoure ces principes. Malgré le tollé qu’avaient alors suscité les menaces de la ministre, les chaînes de télévision avaient fini par plier, en remplaçant certains journalistes jugés trop critiques et en modifiant leurs programmes.
Les conséquences du scandale dans un contexte de défiance à l’encontre des médias
Les propos diffusés par mégarde il y a quelques jours constituent sans conteste une faute professionnelle malheureuse de la part du caméraman qui ne pensait pas être en ligne au moment de la tenue de ses propos. Pour le moment, c’est dans l’anonymat de l’espace public numérique que la plupart des critiques se font entendre. Mais dans un contexte de défiance grandissante à l’encontre des médias d’information, la moindre erreur peut être utilisée par le monde politique pour justifier, au minimum, des prises d’initiative, au pire, des actions concrètes.
Parmi les premiers exemples, le politicien Shinji Ishimaru, connu pour son score remarqué aux élections municipales de Tokyo en juillet 2024 et ses positions critiques à l’encontre des journalistes, en a appelé aux principaux médias pour « laver leur honte en prenant leurs responsabilités ». Dans le contexte français, on a vu comment l’enregistrement des journalistes de Radio France avait ensuite été réutilisé contre le média public, en jouant sur l’argument du biais journalistique. Alors que personne ne sait encore quelle sera la politique menée par la probable future première ministre à l’égard des médias, il ne serait guère surprenant que le rapport de force qui s’était instauré entre Shinzo Abe et les médias libéraux refasse surface.
César Castellvi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.10.2025 à 14:32
« Project 2025 » : le manuel secret de Trump prend vie
Elizabeth Sheppard Sellam, Responsable du programme « Politiques et relations internationales » à la faculté de langues étrangères, Université de Tours
Texte intégral (2464 mots)
Recours aux forces fédérales sur le territoire des États-Unis, désignation de l’opposition politique comme « ennemi intérieur », démantèlement de nombreuses agences, remise en cause de nombreux droits sociétaux… Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, l’administration Trump met en œuvre un programme d’une grande dureté, qui correspond largement aux préconisations du « Project 2025 », document publié en 2023 par le groupe de réflexion de droite ultraconservatrice l’Heritage Foundation.
Fin septembre, l’Illinois a porté plainte contre l’administration Trump, qu’il accuse d’avoir ordonné un « déploiement illégal et anticonstitutionnel » de troupes fédérales sur son territoire. Le gouverneur démocrate J. B. Pritzker a qualifié le déploiement dans son État de la garde nationale, annoncé par l’administration Trump, d’« instrument politique ». Le bras de fer juridique bat son plein.
La controverse survient quelques jours seulement après un discours prononcé par Donald Trump à Quantico (Virginie) devant un immense parterre de hauts gradés de l’armée. Le président y a déclaré, à propos de plusieurs grandes cités dont les maires sont issus du Parti démocrate, citant San Francisco, Chicago, New York ou encore Los Angeles :
« Nous devrions utiliser certaines de ces villes dangereuses comme terrains d’entraînement pour notre armée. »
Et d’ajouter :
« Nous subissons une invasion de l’intérieur. Ce n’est pas différent d’un ennemi étranger, mais c’est à bien des égards plus difficile, car ils ne portent pas d’uniformes. »
Or, le recours à l’armée pour des missions de maintien de l’ordre est en principe très encadré par la loi aux États-Unis. Depuis le Posse Comitatus Act de 1878, l’usage des forces fédérales à des fins civiles est strictement limité, sauf exceptions prévues par la loi (notamment l’Insurrection Act). C’est précisément ce verrou que l’administration Trump cherche aujourd’hui à contourner.
À lire aussi : Trump face à la Californie : affrontement à haute tension
Ces initiatives n’ont rien d’improvisé : elles reprennent les orientations du « Project 2025 », le manuel de gouvernement conçu par le think tank Heritage Foundation, qui préconise un renforcement de l’autorité présidentielle et une redéfinition des menaces intérieures.
Le Project 2025, de manifeste à manuel de gouvernement
Lorsque l’Heritage Foundation – traditionnellement considérée comme un groupe de réflexion conservateur mais qui, ces dernières années, a pris un tournant de plus en plus radical – a présenté, en 2023, son Project 2025, le document a suscité un mélange de curiosité et d’inquiétude. Il consiste en près de 900 pages de recommandations visant à renforcer le pouvoir présidentiel et à réduire l’autonomie des contre-pouvoirs institutionnels – notamment le Congrès, la « bureaucratie » fédérale et certaines instances judiciaires.
La plupart des observateurs l’avaient lu comme une déclaration d’intentions, une sorte de catalogue des rêves de l’aile la plus extrême des conservateurs. Peu imaginaient qu’il puisse devenir un véritable plan d’action gouvernementale.
En France comme en Europe, le Project 2025 reste presque inconnu. Le débat public retient davantage les outrances de Donald Trump que les textes programmatiques qui structurent son action. Or, depuis le début du second mandat de ce dernier, ce document s’impose en coulisses comme une feuille de route opérationnelle. Il ne s’agit plus d’un manifeste théorique, mais d’un manuel de gouvernement, conçu par l’un des think tanks les plus influents de Washington, déjà célèbre pour avoir fourni à Ronald Reagan une grande partie de son programme économique et sécuritaire, dans les années 1980.
Du texte à la pratique : des décisions qui ne doivent rien au hasard
Le bras de fer entre Donald Trump et plusieurs gouverneurs démocrates, de la Californie à l’Illinois, a déjà montré que la Maison Blanche est prête à employer la force fédérale à l’intérieur du pays. Mais ce n’est qu’un aspect d’un mouvement plus vaste.
Ainsi, l’administration a récemment qualifié Tren de Aragua, une organisation criminelle vénézuélienne, de « combattants illégaux ». En invoquant le Alien Enemies Act de 1798, rarement mobilisé, Donald Trump a transformé une organisation criminelle transnationale en adversaire militaire à traiter non plus comme un réseau mafieux, mais comme une force armée hostile. Ce glissement conceptuel, déjà prévu par le Project 2025, brouille volontairement la frontière entre sécurité intérieure et guerre extérieure.
Cette orientation trouve également son incarnation dans une figure clé du trumpisme : Stephen Miller. Chef de cabinet adjoint chargé de la politique à la Maison Blanche, celui-ci pilote les orientations actuelles en matière d’immigration. Dans ses discours, il n’hésite pas à qualifier le Parti démocrate d’« organisation extrémiste », désignant ainsi l’opposition politique comme une « menace intérieure ». Cette rhétorique illustre les principes du Project 2025 : un exécutif tout-puissant et une présidence qui assimile ses opposants à des ennemis.
Au-delà des axes déjà évoqués, l’administration Trump a engagé une multitude d’autres efforts inspirés du Project 2025, trop nombreux pour qu’il soit possible ici d’en rendre compte de manière exhaustive. Citons-en toutefois certains, qui illustrent la diversité des chantiers ouverts.
Dans le domaine éducatif, l’Executive Order 14191 a redéfini l’usage de plusieurs programmes fédéraux afin d’orienter une partie des financements vers l’école privée, confessionnelle ou « à charte ». En parallèle, l’Executive Order 14190 a imposé un réexamen des contenus jugés « radicaux » ou « idéologiques ». Ces mesures s’inscrivent dans une perspective plus large explicitement évoquée dans Project 2025 : la réduction drastique du rôle fédéral en matière d’éducation, jusqu’à l’élimination pure et simple, à terme, du Department of Education.
Dans le champ des politiques de santé reproductive, l’Executive Order 14182 est venu renforcer l’application de l’amendement Hyde, en interdisant explicitement toute utilisation de fonds fédéraux pour financer l’avortement, tandis que la réintroduction de la Mexico City Policy a coupé le financement d’organisations non gouvernementales étrangères facilitant ou promouvant l’avortement.
L’administration a également ordonné à la Food and Drug Administration (FDA, l’administration chargée de la surveillance des produits alimentaires et des médicaments) de réévaluer l’encadrement de la pilule abortive et a révoqué les lignes directrices de l’Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) qui protégeaient l’accès à l’avortement d’urgence dans les hôpitaux.
Par ailleurs, plusieurs décrets présidentiels – tels que l’Executive Order 14168 proclamant le « retour à la vérité biologique » dans l’administration fédérale, ou l’Executive Order 14187 qui interdit le financement fédéral des transitions de genre pour les mineurs – témoignent d’une volonté de redéfinir en profondeur les normes juridiques et administratives autour du genre et de la sexualité.
Enfin, au plan institutionnel, la Maison Blanche a imposé des gels budgétaires et des réductions de programmes qui s’inscrivent dans une stratégie de recentralisation du pouvoir exécutif et de mise au pas de la bureaucratie fédérale.
Des relais stratégiques et une duplicité assumée
Derrière Donald Trump, plusieurs figures issues des cercles conservateurs les plus structurés œuvrent à traduire Project 2025 en pratique. Le plus emblématique est Russ Vought, directeur de l’Office of Management and Budget lors du premier mandat de Donald Trump, poste qu’il a retrouvé lors du second mandat, et l’un des principaux architectes du document.
Lors de son audition de confirmation, plusieurs sénateurs l’ont présenté comme le stratège du projet et l’ont pressé de dire s’il comptait appliquer ce programme au gouvernement fédéral. Vought a soigneusement évité de s’y engager, affirmant qu’il suivrait la loi et les priorités présidentielles. Pourtant, ses initiatives depuis son retour à la Maison Blanche – notamment en matière de réorganisation administrative – reprennent directement les recommandations du manuel.

Un scénario similaire s’est joué avec d’autres nominations. Paul Atkins, nommé à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC, l’organisme fédéral de réglementation et de contrôle des marchés financiers), a été interrogé en mars 2025 sur sa participation au chapitre du projet appelant à la suppression d’une agence de supervision comptable créée après le scandale Enron (la Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Devant les sénateurs, Atkins a botté en touche, affirmant qu’il respecterait la décision du Congrès. Mais une fois en poste, il a engagé une révision conforme aux orientations du texte.
Cette duplicité illustre une méthode désormais systématique : nier tout lien pour franchir l’étape de la confirmation puis, une fois aux affaires, appliquer les prescriptions idéologiques préparées en amont.
Un modèle pour les populistes européens ?
Le Project 2025 n’est plus un manifeste idéologique mais une feuille de route appliquée par l’équipe au pouvoir. Porté par l’Heritage Foundation et incarné par Vought et Miller, il structure désormais la pratique présidentielle : renforcement sans précédent de l’exécutif, militarisation de la sécurité intérieure, délégitimation de l’opposition. Cette orientation réduit l’emprise des contre-pouvoirs et accélère le basculement autoritaire des États-Unis.
Ce qui se joue à Washington dépasse les frontières états-uniennes. Car ce modèle assumant la confrontation avec ses opposants constitue un précédent séduisant pour les populistes européens. Ceux-ci disposent désormais d’une vitrine : la démonstration qu’une démocratie peut être reconfigurée par un projet idéologique préparé de longue date, puis appliqué une fois au pouvoir. La question demeure : combien de temps les contre-pouvoirs, aux États-Unis comme en Europe, pourront-ils résister à cette tentation autoritaire ?
Elizabeth Sheppard Sellam ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.10.2025 à 15:42
Les mécanismes de la corruption illustrés par le cas de Malte
Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia
Texte intégral (1512 mots)
En 2017, Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise d’investigation qui enquêtait sur la corruption à l’œuvre jusqu’aux plus hautes sphères de l’État, trouvait la mort dans l’explosion de sa voiture. Depuis, certains exécutants ont été condamnés à de lourdes peines de prison ; mais les réels commanditaires n’ont toujours pas été identifiés. Comment expliquer un tel niveau de corruption au sein de l’Union européenne ?
L’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, survenu le 16 octobre 2017, et dont deux exécutants viennent récemment d’être condamnés à la prison à perpétuité, après trois autres condamnations en 2022 et en 2021, a mis en lumière un problème structurel : la persistance de la corruption à Malte.
En 2024, l’ONG Transparency International a classé Malte parmi les quatre pays les plus corrompus de l’Union européenne (UE).
Au-delà de son horreur, le meurtre d’une journaliste d’investigation soulève une question essentielle pour les démocraties contemporaines : comment un État membre de l’UE peut-il être gangrené par des pratiques aussi systématiques de corruption ?
Plusieurs facteurs permettent d’éclairer cette situation.
Une gouvernance institutionnelle fragile
Tout d’abord, Malte, bien qu’étant une démocratie, souffre d’un manque de séparation claire entre les pouvoirs. Le pays, devenu indépendant du Royaume-Uni en 1964, est depuis 1974 une république parlementaire où le président élu par le Parlement, exerce le pouvoir exécutif et nomme le premier ministre et le gouvernement.
Le système judiciaire a été particulièrement critiqué pour son manque d’indépendance. Par exemple, de nombreux juges maltais sont promus du fait de leur appartenance politique.
Lorsque les institutions censées garantir la transparence et la justice sont elles-mêmes vulnérables aux influences politiques, la corruption peut s’installer durablement.
Une économie ouverte aux flux opaques
D’autre part, le modèle économique maltais repose en partie sur des secteurs à haut risque de fraudes. Le secteur des services financiers offshore contribue deux fois plus à la valeur ajoutée brute à Malte que dans le reste de l’Europe, sachant que le nombre d’employés de ce secteur a augmenté de 22 % depuis 2020 ; les jeux en ligne, avec des soupçons d’infiltration par la mafia italienne ; ou encore la vente de passeports via le programme des « passeports en or » (« golden passports ») qui permet d’acquérir la citoyenneté contre investissement. Des oligarques russes ont ainsi acheté la nationalité maltaise en séjournant très brièvement sur l’île.
Ces activités attirent des capitaux étrangers, mais aussi des acteurs peu scrupuleux. L’opacité qui entoure ces flux financiers rend difficile la traçabilité et favorise les abus.
Une culture politique permissive
Par ailleurs, la tolérance sociale vis-à-vis de certaines pratiques douteuses contribue à leur banalisation. Le clientélisme, les conflits d’intérêts et le manque de sanctions effectives contre les responsables politiques alimentent un climat d’impunité.
Le cas de Daphne Caruana Galizia illustre cette dynamique. Malgré les révélations qu’elle avait publiées (par exemple, ses enquêtes sur le volet maltais de l’affaire des Panama Papers), les politiciens maltais avaient pris peu de mesures concrètes, jusqu’à ce que, après son assassinat, la pression de la société civile provoque la chute du gouvernement Muscat.

Des mécanismes de contrôle affaiblis
Même si la presse et la société civile jouent un rôle crucial dans la lutte contre la corruption, à Malte, les journalistes sont exposés à des pressions importantes, et les lanceurs d’alerte ne bénéficient pas toujours de protections suffisantes.
L'exemple le plus flagrant est évidemment l’assassinat de Daphne Caruana Galizia partiellement impuni, notamment l’absence de condamnation de l’entrepreneur douteux Yorgen Fenech, soupçonné d’être le commanditaire du crime.
L’absence de contre-pouvoirs robustes limite la capacité de dénonciation et de réforme. L’UE a d’ailleurs fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement maltais pour que des transformations soient opérées.
Des procédures complexes et opaques
Enfin, la corruption prospère dans les zones grises de l’administration. L’accès limité à l’information publique, les procédures complexes et l'inertie institutionnelle créent un environnement propice aux pratiques illicites. Cette opacité peut être systémique ou délibérée, comme l’ont montré certaines recherches internationales.
Le cas maltais n’est pas isolé, mais il est emblématique. Il rappelle que la corruption ne résulte pas seulement d’actes individuels, mais d’un écosystème institutionnel, économique et culturel. Pour y remédier, il ne suffit pas de condamner les coupables : il faut renforcer les institutions, garantir l’indépendance de la justice, protéger les journalistes et les lanceurs d’alerte, et promouvoir une culture politique fondée sur la transparence et la responsabilité.
Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr
