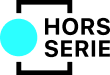09.03.2026 à 16:06
Le refuznik Itamar Greenberg arrêté et brutalisé par la police israélienne pour avoir dénoncé la guerre en Iran
Vivian PETIT
Texte intégral (1057 mots)
J’ai dénoncé la guerre contre l’Iran – La police israélienne m’a battu, arrêté et imposé une fouille à nu.
Mardi soir, je suis allé manifester pour dénoncer l’attaque menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran. Deux heures plus tard, j’étais humilié et fouillé à nu au sein d’un commissariat.
À notre arrivée sur la place Habima de Tel Aviv, des dizaines d’agents de police nous attendaient, prêts à nous disperser pour empêcher la manifestation. Nous étions vingt à refuser le silence imposé face à l’assaut meurtrier déclenché samedi dernier par Israël aux côtés des États-Unis. Nous sommes restés sur la place et avons sorti les écriteaux que nous avions préparés. Quelques secondes plus tard, nous étions violemment attaqués par la police, qui arrachait nos pancartes et nous frappait. J’ai personnellement reçu des coups de pied avant d‘être mis au sol et interpellé.
Jeudi matin, le tribunal auprès duquel j’avais fait appel m’a donné raison. Les cinq jours d’assignation à résidence auxquels j’avais été condamné ont été annulés et le caractère illégal de la fouille a été reconnu. J’ai également déposé plainte auprès du ministère de la Justice, chargé d’enquêter sur les fautes commises par des agents de police ainsi qu’auprès du procureur général par l’intermédiaire de l’Association pour les droits civils en Israël. Je ne me fais cependant aucune illusion quant au fait que cela puisse faire évoluer l’attitude de la police vis-à-vis des manifestants.
Les attaques contre la liberté d’expression ne se limitent pas aux heures passées au commissariat. Je suis étudiant en droit à l’université de Tel Aviv et élu au conseil étudiant. Je suis fier de pouvoir dire que le corps enseignant m’a soutenu dès le début, condamnant publiquement l’attitude de la police et prenant de mes nouvelles. Pour autant, une déclaration dénonçant le soutien exprimé à mon endroit a été publiée par le conseil étudiant, qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de m’exclure de l’instance en raison de mes engagements politiques. En tant que militant et étudiant en droit, je suis inquiet que l’avenir du système judiciaire israélien se trouve entre les mains de personnes qui soutiennent des fouilles à nu illégales dès lors qu’elles sont imposées à leurs adversaires politiques.
Mon propre cas n’est pourtant pas le sujet principal. Le sujet, ce sont ces plus de mille civils iraniens tués dans les bombardements depuis samedi, les 170 élèves et enseignants morts suite au bombardement d’une école dans la ville de Minab comme toutes les autres personnes qui paient au prix fort cette folie impérialiste. Le régime iranien est évidemment un régime oppressif, théocratique et fasciste : il emprisonne et assassine des dizaines de milliers d’opposants politiques, opprime brutalement les femmes et les personnes LGBT. Aussi, la majorité des citoyens iraniens vivent dans une pauvreté abjecte. Pour autant, si l’agression en cours est menée au nom de la « libération du peuple iranien », nous savons que l’invasion de l’Iran par une superpuissance étrangère n’aidera personne.
Un regard sur l’histoire nous apprend que les interventions extérieures n’ont jamais aidé les Iraniens. Les intérêts économiques liés au pétrole ont poussé les puissances occidentales à soutenir le Shah, incarnation d’un régime fantoche au service des États-Unis qui réprimait férocement son opposition. Sous son règne, l’économie iranienne était entièrement soumise aux intérêts des actionnaires des compagnies pétrolières britanniques et américaines.
C’est en partie à cause de cela que s’est développée la Révolution islamique et qu’a pu être instauré le régime des ayatollahs, système politique lui aussi oppressif. Que ce soit en Afghanistan, en Irak ou plus récemment au Venezuela, les interventions menées par les États-Unis n’ont jamais eu pour objectif d’améliorer le sort des populations. Dans ces pays, les conditions de vie sont aujourd’hui pires qu’avant l’intervention américaine.
Quiconque conçoit la guerre en cours comme un mal nécessaire pour faire avancer une cause juste doit comprendre que cette guerre ne libérera pas le peuple iranien de l’oppression qu’il subit et qu’elle ne lui apportera ni la liberté ni le respect des droits humains. Si la guerre profite à certains, ce sera uniquement à Trump, Netanyahou ainsi qu’à une poignée de milliardaires qui pourront faire croître leurs profits.
L’invocation par Israël du cassus belli qu’incarnerait la « menace iranienne » sonne tout aussi creux. Les déclarations de Netanyahou décrivant l’Iran comme porteur d’une menace « imminente » n’ont pas varié en trente ans. Les armes nucléaires, même lorsqu’elles sont accessibles, servent essentiellement d’instrument de menace et d’outil politique. Jusqu’à présent, la plus grande démocratie au monde fut la seule puissance suffisamment folle pour l’utiliser.
Depuis sa fondation, l’État d’Israël n’a cessé de jouer la carte de la victimisation, y compris lorsqu’il est comme aujourd’hui à l’origine d’une escalade militaire. Nous devons donc nous tenir à distance des récits fallacieux selon lesquels la sécurité pourrait être assurée par les raids aériens, les bombardements et le déclenchement de nouvelles guerres. Comme nous l’avons déjà observé à Gaza, cette politique ne peut déboucher que sur la destruction, la dévastation et l’acceptation du génocide
Tribune initialement parue en hébreu puis en anglais dans Haaretz.
Itamar GREENBERG
05.03.2026 à 16:19
Annuler LFI : le dangereux fantasme du PS
Pascal LEVOYER
Texte intégral (2191 mots)
Dans son vote du 3 mars, le PS appelle ses militants à se démarquer de LFI ; il exhorte ses élus locaux à se désolidariser, et dénonce publiquement les listes communes dans plus de soixante villes où PS et LFI se présentent ensemble. À quelques jours du premier tour des élections municipales.
Il faut mesurer la brutalité de ce geste. Non pas sa violence verbale, presque banale, mais sa violence politique et symbolique. Ce que le Parti socialiste accomplit ici dépasse le calcul électoral. Il s’agit d’une tentative d’annulation.
La politique de l’annulation
Il y a une distinction que l’on néglige trop souvent. Vouloir battre un adversaire, c’est éventuellement vouloir le supprimer, le défaire au point qu’il n’existe plus. L’annuler, c’est autre chose et c’est bien plus radical : c’est vouloir qu’il n’ait jamais existé, remonter en amont du présent pour atteindre le passé lui-même. Faire en sorte que des millions de voix n’aient jamais été exprimées, que la rupture politique ouverte au moins depuis 2017 soit réécrite comme une parenthèse illégitime, un accident qu’il faudrait effacer du récit.
La tentative est vouée à l’échec. On ne peut pas effacer rétroactivement les millions d’électeurs qu’une force politique a mobilisés ni les dynamiques qu’elle a engendrées. Pourtant cette volonté existe, s’organise, se déploie. Et c’est précisément ce que fait le PS en procédant à une diabolisation systématique de Mélenchon, à une destruction symbolique de sa légitimité.
C’est cette impossibilité structurelle qui rend cette volonté particulièrement effrayante et dangereuse. À ne cesser de vouloir ce qu’on ne peut faire advenir, on se livre à une pulsion qui se nourrit de son propre échec et qui se répète. Ce n’est plus une stratégie qui avance vers un but, c’est une compulsion qui tourne sur elle-même. Un acharnement. L’acharnement du PS contre Mélenchon.
Externaliser l’échec
Depuis près de dix ans, le PS ne cesse ainsi de désigner Mélenchon et LFI comme la cause de ses propres défaites, comme si l’effondrement de 2017 n’avait pas d’abord été le produit du quinquennat Hollande, de la rupture assumée avec les classes populaires, de l’abandon de toute conflictualité sociale. Plutôt que de tirer ce bilan, le PS a préféré déplacer la faute, externaliser l’échec, transformer sa défaite politique en faute morale de l’autre.
2017 aurait dû pourtant imposer un bilan radical, douloureux, public. Pourquoi cette déroute ? Que signifie ce transfert massif de voix vers une force politique qui, précisément, rompt avec le social-libéralisme ? Ce bilan n’a jamais eu lieu. Au mieux il est resté en suspens ou partiel ; en réalité, simplement esquivé. La séquence 2017-2026 est restée non-élaborée dans la mémoire du PS, telle une blessure ouverte qu’on ne regarde pas mais qui continue de s’infecter.
C’est pourquoi la résolution du 3 mars, conséquence directe de cette défaillance, n’est qu’un fantasme de restauration. Celui d’un retour à l’état antérieur à 2017, à un champ de gauche où le PS redeviendrait spontanément le centre de gravité et retrouverait l’hégémonie perdue. Elle exprime la nécessité d’annuler LFI — non pas la battre, mais bien l’annuler.
Toute tentative d’effacement laisse cependant des traces. Effacer une trace, c’est produire la trace de l’effacement. L’acte d’effacement est lui-même une trace, plus persistante encore que ce qu’elle prétendait faire disparaître, parce qu’elle porte en elle le témoignage de la violence de l’opération. Si bien que plus l’on cherche à nier une réalité politique, plus elle revient hanter ceux qui prétendent l’avoir liquidée. À force de refuser de reconnaître ce que représente LFI — une colère sociale, une demande de rupture, un électorat populaire durablement détaché du social-libéralisme — le PS transforme cette réalité en symptôme obsédant. Mélenchon devient l’ennemi intérieur permanent, celui qu’il faut dénoncer sans cesse parce qu’il empêche le récit de se refermer.
Antisémitisme « d’atmosphère » : l’arme de la disqualification
C’est ici que l’accusation d’antisémitisme joue un rôle central. Elle ne fonctionne pas comme un argument, mais comme un couperet qui dispense de toute démonstration et interdit la discussion. Elle disqualifie par avance quiconque refuse de s’aligner.
La mécanique est connue et elle est rejouée jusqu’au ridicule. Une polémique mineure sur une prononciation devient une preuve irréfutable d’antisémitisme. Quiconque demande des preuves supplémentaires est suspect. Quiconque contextualise est complice. Quiconque rappelle que Mélenchon a combattu toute sa vie les formes réelles d’antisémitisme, ou que LFI a fait bien davantage que le PS pour mobiliser les quartiers populaires contre le racisme et les discriminations, est accusé de relativisation. Le terme « antisémite » est instrumentalisé pour clore le débat avant qu’il ait pu s’ouvrir.
La méthode mérite d’être examinée de près. L’accusation ne fonctionne pas sur le mode de la preuve, de l’examen d’un acte, d’une déclaration, d’un texte qui établirait sans ambiguïté l’intention antisémite. Elle fonctionne sur le mode du relent : quelque chose qui se dégage, qui imprègne, qui se répand par contagion. On ne dit pas « Mélenchon a tenu des propos antisémites en prononçant ce mot », on dit qu’il « sent » l’antisémitisme, que ses propos en ont les « relents », que son rapport au monde en est traversé. C’est une accusation d’essence, non d’acte, et c’est précisément pourquoi elle est irréfutable. On peut contester un fait ; on ne peut pas se défendre d’une atmosphère. Mieux : quiconque tente de se défendre confirme par là même qu’il y a quelque chose à défendre. Le piège est parfait.
Cette instrumentalisation est politiquement irresponsable. Elle affaiblit la lutte réelle contre l’antisémitisme — qui existe, qui tue, et dont l’extrême droite est historiquement et massivement porteuse — en la transformant en arme de disqualification interne. En reprenant les mêmes procédés que ses adversaires, le PS ne protège personne ; il banalise seulement ce qu’il prétend combattre.
Et Mélenchon l’a écrit, le soir même du 3 mars : « Insupportable désolidarisation du combat antifasciste qui reprend les attaques de l’extrême droite. » Ce n’est pas une posture défensive. C’est un constat structurel. Quand le discours socialiste se nourrit des mêmes signifiants que le discours fasciste — quand les deux s’accordent, au moins fonctionnellement, sur la désignation d’un ennemi intérieur à exclure du champ du légitime — il y a collusion, même involontaire. Le résultat est connu. Le PS offre mécaniquement des victoires à la droite et au Rassemblement national. Ce n’est pas une opinion, c’est une règle arithmétique élémentaire.
Les irresponsables
Dresser un bilan est un acte exigeant ; son refus obstiné est une pathologie politique. Il faut être en mesure d’accepter une perte pour reconnaître que ce qu’on croyait être le socialisme ne l’est plus, que la respectabilité n’a pas protégé de la défaite, que la gestion sans conflictualité a détruit la confiance populaire. Il est sans doute plus confortable de se convaincre que c’est Mélenchon qui a « divisé » la gauche, comme si la gauche n’était pas déjà divisée par les choix du gouvernement Hollande, avant même que LFI n’existe, pour s’offrir ainsi le fantasme d’un retour à l’état d’avant l’échec.

L’histoire offre pourtant des avertissements sévères. Johann Chapoutot, dans Les Irresponsables, a montré comment des élites ont ouvert la voie au pire non par simple aveuglement, mais en choisissant délibérément la défense de leurs intérêts — leur position dans le champ social, leur accès aux institutions, leur reproduction comme couche dirigeante — plutôt que l’analyse lucide de ce qui se passait. La comparaison n’est pas morale, elle est structurelle. Le PS neutralise sa gauche non seulement pour survivre électoralement, mais parce que LFI incarne une ligne de rupture incompatible avec ce qu’il est devenu sociologiquement, à savoir un parti de notables, de hauts fonctionnaires et d’élus professionnels dont les intérêts de position contredisent toute conflictualité sociale réelle. Quand la social-démocratie préfère neutraliser sa gauche plutôt que d’affronter la droite radicale, elle prépare toujours sa propre impuissance et, avec elle, celle de tous.
Il faut nommer aussi la violence particulière qu’il y a à prétendre enjamber une séquence historique pour reprendre là où on en était. C’est une violence d’abord contre ceux qui ont vécu cette séquence. Dire : « Reprenons comme avant », c’est nier que quelque chose leur est arrivé, qu’ils ont été transformés, que leurs expériences — défaites, désillusions, ruptures, mais aussi mobilisations, espoirs, nouvelles formes d’engagement — ont une réalité. C’est leur demander de se comporter comme si leur propre histoire n’avait pas eu lieu. Une injonction à l’amnésie qui est aussi une injonction à trahir ce qu’ils ont traversé.
Nier le réel
C’est une violence ensuite contre le réel lui-même. L’électeur de 2017 puis de 2022 qui a voté Mélenchon ne peut pas être rejoué comme s’il était encore l’électeur de 2012 qui avait voté Hollande. La séquence a eu lieu. Elle a produit des effets. Les nier ne les efface pas.
C’est une violence enfin contre la possibilité même d’apprendre. Toute séquence, même catastrophique, est une expérience collective qui peut devenir ressource si elle est élaborée. Elle contient des diagnostics, des enseignements, des transformations nécessaires. La refuser, c’est se condamner à rejouer les mêmes erreurs avec la même bonne conscience intacte. Et c’est exactement ce que fait le PS depuis neuf ans.
Mais on aura compris que ce qui importe, en définitive, ce n’est pas le sort du PS en tant qu’organisation. C’est ce qu’il fait au corps social, à l’espace politique, à la possibilité même d’une alternative de gauche au moment où une extrême droite déjà gouvernante étend son emprise sur le pays. Les dégâts se mesurent à l’affaiblissement durable d’une capacité collective à penser et à agir. Des millions d’électeurs ont trouvé dans LFI une représentation qu’ils n’avaient plus ailleurs. Annuler cette représentation, c’est leur dire que leur choix était une erreur ou une faute, les renvoyer à une inexistence politique. C’est décider par avance que certaines formes de radicalité, certains électorats, certains modes d’existence politique sont irrecevables.
La résolution du 3 mars restera comme un document. Pas parce qu’elle marquera un tournant ; elle n’aura été qu’un épisode de plus dans une longue série. Mais parce qu’elle concentre, avec une économie de moyens presque didactique, toutes les pathologies d’un parti qui ne sait plus ce qu’il veut être, sinon ce qu’il était avant que la réalité lui impose un bilan qu’il refuse encore de regarder en face.
Pour prolonger
28.02.2026 à 15:45
U.S.A-Israël face à l’Iran : la conjonction des millénarismes
Joël SCHNAPP
Texte intégral (2444 mots)
Quelques minutes après le début des bombardements en Iran, Donald Trump s’en est pris violemment au régime des Gardiens de la Révolution : « ce régime terroriste ne pourra jamais posséder une arme nucléaire »1. En juin dernier, les attaques américaine et israélienne sur l’Iran avaient déjà la même justification officielle : le pays aurait été à quelques mois à peine de mener à bien son programme nucléaire. Il fallait à tout prix l’en empêcher car, selon les diplomates occidentaux, une telle réussite aurait mis en danger toute la région. C’était d’autant plus important, insistait-on, que le régime iranien est une théocratie sanguinaire qui ne recule devant rien : aucune provocation, aucune menace, aucune répression. Si les mollahs mettaient la main sur une bombe nucléaire, c’en était fait de la sécurité américaine et la fin du monde était proche. C’est donc plus ou moins le même argument qui est développé aujourd’hui. Le président prend soin d’y ajouter la volonté de mette à bas le régime, qui « a récemment tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens dans les rues alors qu’ils protestaient »2.
Le moment choisi laisse un peu dubitatif quant à cette motivation, qui n’occupe d’ailleurs qu’une part congrue dans le discours du président américain. La féroce répression des mollahs contre leurs opposants ces derniers mois n’avait visiblement pas suscité un grand émoi à Washington et il faudra sans doute chercher ailleurs les raisons de cette opération. C’est peut-être pour nous, spectateurs impuissants d’un drame sur lequel nous n’avons pas de prise, le moment de nous interroger : l’idée selon laquelle il faudrait empêcher une théocratie de s’emparer d’un arsenal nucléaire va-t-elle vraiment de soi ? Dans plusieurs pays dotés de l’arme atomique, les religieux ont le vent en poupe et le fait est que, bien souvent, les fondamentalistes sont déjà au pouvoir.
Les Etats-Unis en voie de transformation ?
Aux Etats-Unis, le président Trump a fait une campagne axée sur la potentielle fin du monde, si les démocrates gagnaient, et le retour de l’âge d’or s’il était élu : il s’agissait avant tout de rallier l’électorat évangélique blanc. Mission accomplie, puisque les évangéliques blancs ont voté à près de 80% pour le républicain. Parmi les multiples gages donnés en guise de récompense, le moindre n’est sans doute pas le Bureau de la foi, qui est devenu, au fil du temps, une véritable police religieuse, dont les représentants sont présents à tous les étages de l’administration fédérale.
Tous les membres du gouvernement ne sont évidemment pas des fondamentalistes chrétiens, mais certains sont très en vue. On pense évidemment à la pasteure évangélique charismatique Paula White Cain qui dirige le White House Faith Office. On se réfère aussi au pasteur Doug Wilson, qui, s’il n’a de fonction officielle, a cependant prêché, il y a peu, à la Maison Blanche sur invitation de Pete Hegseth, le Secrétaire à la Défense : Wilson est connu pour être un partisan d’un changement radical de la Constitution des Etats-Unis ; à sa place, il faut instaurer une « théocratie chrétienne »…
Israël et le fondamentalisme militant
En Israël, les courants messianiques sont en pleine effervescence. Dès les origines, un courant orthodoxe, minoritaire à l’époque, incarnait le sionisme religieux, le Mizrahi. Toutefois, depuis la création d’Israël, jamais les partis religieux n’ont eu autant d’influence et de pouvoir qu’aujourd’hui. Arrivé 3e aux élections de 2022, avec 10,8% des voix, le parti sioniste religieux est au cœur du dispositif gouvernemental de Benjamin Netanyahou. Son leader, Bezalel Smotrich, est à la fois ministre des Finances et ministre délégué à la Défense. Il est à la manœuvre actuellement pour la destruction de Gaza, dont il se félicite. Pour lui, affamer la population de Gaza pourrait « être justifié et moral ». Il œuvre également à l’annexion de la Cisjordanie, parle de restaurer le système juridique de la Torah et propose de gouverner le pays comme au temps du roi David.
Il faut aussi mentionner son collègue issu du même parti, Itamar Ben Gvir, suprémaciste juif et ministre de la Sécurité israélienne, qui s’inscrit dans une perspective ouvertement messianique. Tous deux entrainent dans leur sillage bon nombre de militants tout aussi fondamentalistes qu’eux, comme ceux du mouvement Temple Mount Faithful, qui promeuvent la reconstruction du Temple : une mesure éminemment dangereuse, puisque, si elle permet de hâter le retour du Messie, elle pourrait entrainer la destruction de lieux saints de l’Islam, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher.
Une orthodoxie de combat en Russie
En Russie enfin, la situation n’est guère différente. Vladimir Poutine aime à se présenter comme un parfait chrétien orthodoxe et depuis le début de la guerre en Ukraine, ses discours sont empreints de messianisme. Son vice-président Dmitri Medvedev a menacé à plusieurs reprises les états occidentaux d’apocalypse nucléaire. L’influence du patriarche Cyrille est à son zénith et ses propos sont teintés d’un millénarisme et d’un messianisme évidents : Moscou n’est-elle pas la Troisième Rome ? L’empire russe n’a-t-il pas vocation à préserver la vraie foi orthodoxe contre les attaques constantes d’un Occident dépravé, qu’il associe souvent à l’Antichrist ?
Il est rejoint en cela par le métropolite de Crimée, Tikhon, lui qu’on appelle le « confesseur de Poutine ». Ce religieux est aussi connu pour avoir favorisé l’implantation, dans une vingtaine de villes russes, de parcs d’attraction ayant pour thème « La Russie, mon histoire », parcs qui vantent les mérites de l’impérialisme russe et de la grande église orthodoxe3. On pourrait également mentionner le magnat Konstantin Malofeev, qui relaie sur sa télé en ligne les propositions les plus réactionnaires de l’Eglise orthodoxe4.
Les armées, cibles de l’entrisme religieux
On peut tenter de se rassurer en se disant que si les fanatiques religieux sont déjà au pouvoir, rien ne dit qu’ils useront du feu nucléaire pour faire valoir leurs idéaux millénaristes. Les structures étatiques, la pression populaire, la raison peut-être, devraient entraver les tentations atomiques des faucons fondamentalistes. Voire. Mais il y a plus inquiétant. Dans ces trois pays, on assiste à des phénomènes d’entrisme dans l’armée : aux Etats-Unis, l’armée s’est toujours montrée ouverte aux différents cultes, mais elle a aussi été marquée par une prédominance chrétienne. C’est de plus en plus net ces dernières années et Pete Hegseth explique à qui veut l’entendre que l’armée doit devenir une arme chrétienne, un outil au service de la croisade5.
En Israël, les militants d’Hardal, un mouvement qui associe nationalisme et fondamentalisme religieux, se font recruter en masse par Tsahal6. En Russie, enfin, armée et clergé sont de plus en plus intimement liés depuis les années 2010, et les popes imposent des formations religieuses aux soldats. Pire, le clergé orthodoxe prétend avoir un contrôle spécifique sur l’arme nucléaire : en effet, à leurs yeux, le choix de Sarov pour la création du plus important complexe militaire nucléaire russe est un signe divin, puisqu’on se trouve à proximité du très saint monastère de Diveevo. Ainsi, dans ces trois pays, les fondamentalistes ne se contentent pas d’être au pouvoir ; tous veulent également contrôler la puissance militaire7.
Une menace nucléaire intensifiée
Il ne faut donc pas minimiser le danger que l’accès à la puissance nucléaire de l’Iran représente, et les risques immenses de déstabilisation que cela engendrerait. La prolifération nucléaire n’est jamais une bonne nouvelle et un succès de ce genre permettrait au régime de regagner en prestige. Cette hypothèse est encore plus d’actualité aujourd’hui, car il est possible que les bombardements israélo-américains fassent quelque peu oublier la répression et que l’agression étrangère soude la population autour de la défense de la mère-patrie. Il ne faut pas perdre de vue dans cette perspective que messianisme et millénarisme sont également des éléments incontournables du chiisme iranien.
Mais au vu des bouleversements en cours à la tête des gouvernements américain, israélien et russe, l’argument selon lequel il faudrait empêcher une théocratie d’avoir la bombe a sérieusement du plomb dans l’aile, et on ne peut qu’être inquiet à la pensée que l’avenir de l’humanité se trouve aux mains des millénaristes de toutes les religions révélées. Dans le vacarme du monde actuel, quand les bombes explosent à Téhéran, à Tabriz et à Ispahan, quand les missiles s’abattent aveuglément un peu partout, quand tous craignent un embrasement généralisé du Moyen-Orient, on distingue de plus en plus nettement un cliquetis familier : c’est celui de l’Horloge de l’Apocalypse. Il ne reste plus que quelques secondes avant minuit.
- https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/28/nous-veillerons-a-ce-que-l-iran-n-obtienne-pas-d-arme-nucleaire-le-discours-de-donald-trump-apres-le-lancement-de-frappes-americaines_6668676_3210.html
 ︎
︎ - Idem.
 ︎
︎ - https://legrandcontinent.eu/fr/2024/06/01/le-prophete-du-tsar-un-orthodoxe-au-service-de-poutine/
 ︎
︎ - https://www.illiberalism.org/is-there-a-russian-version-of-us-christian-nationalism/
 ︎
︎ - https://www.nytimes.com/2024/12/05/us/hegseth-church-crusades.html
 ︎
︎ - https://www.lemonde.fr/international/article/2026/02/17/en-israel-la-transformation-de-l-armee-sous-l-influence-du-courant-messianique_6667038_3210.html
 ︎
︎ - https://www.illiberalism.org/is-there-a-russian-version-of-us-christian-nationalism/
 ︎
︎
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Ctrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique ‧ Asie ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- Infomigrants
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J
- I.C.I.J
- OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie