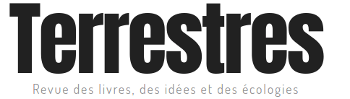Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique
09.10.2025 à 11:27
« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel
Jean-Baptiste Fressoz
Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3968 mots)
Temps de lecture : 9 minutes
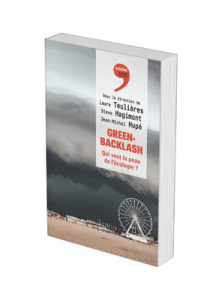
Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.
Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »
Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».
Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
La résignation climatique sous couvert de « transition »
À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.
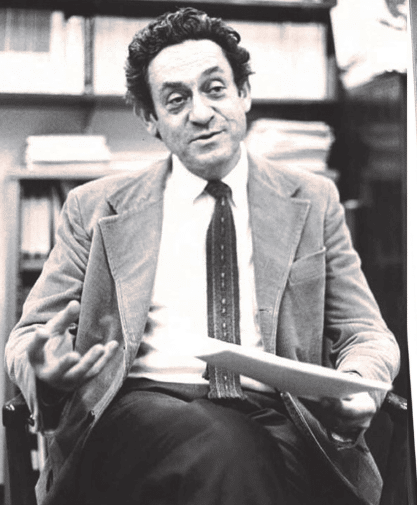
Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.
En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.
➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)
À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.
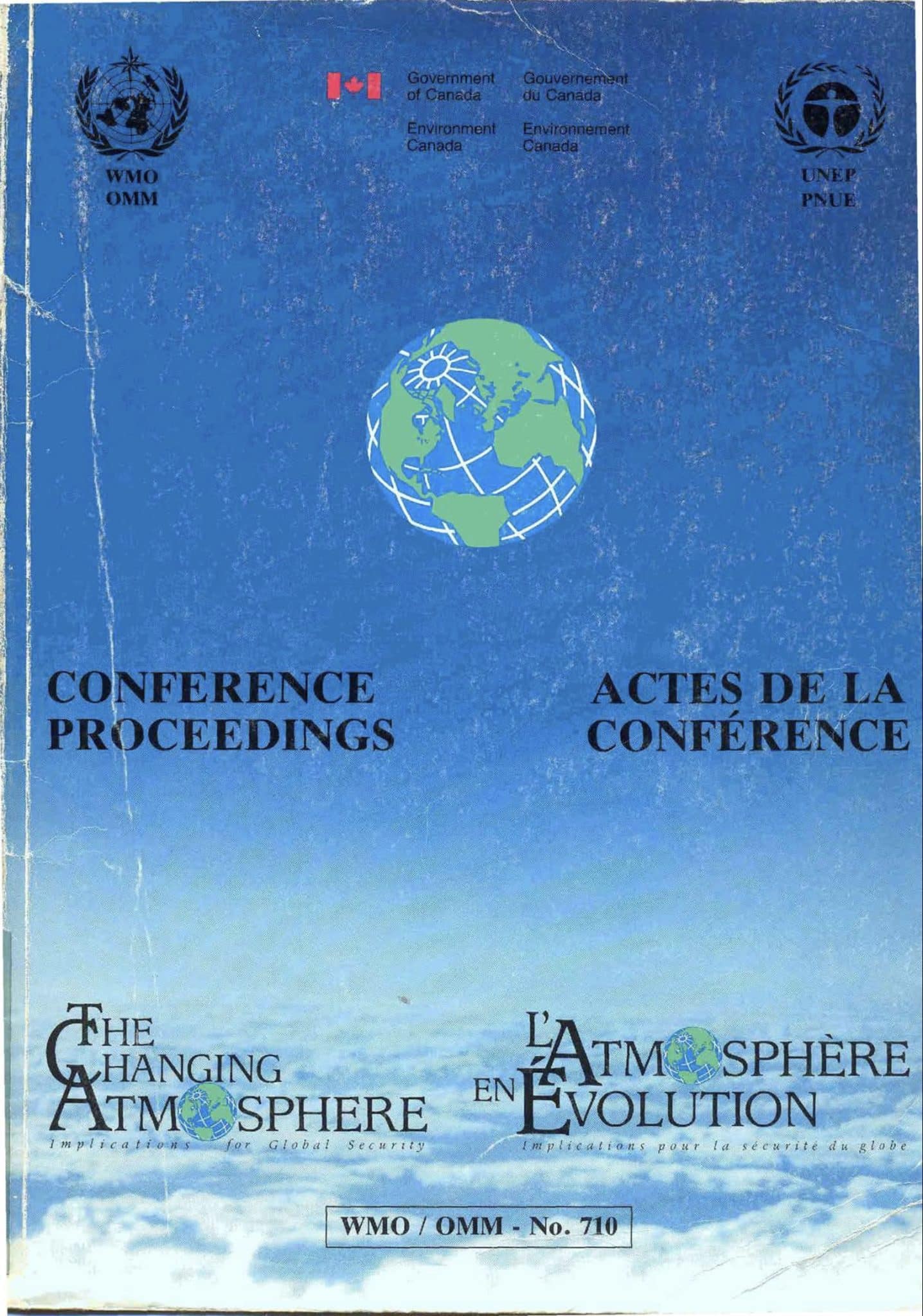
Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.
Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?
Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.
➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)
Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.
En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »
L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.
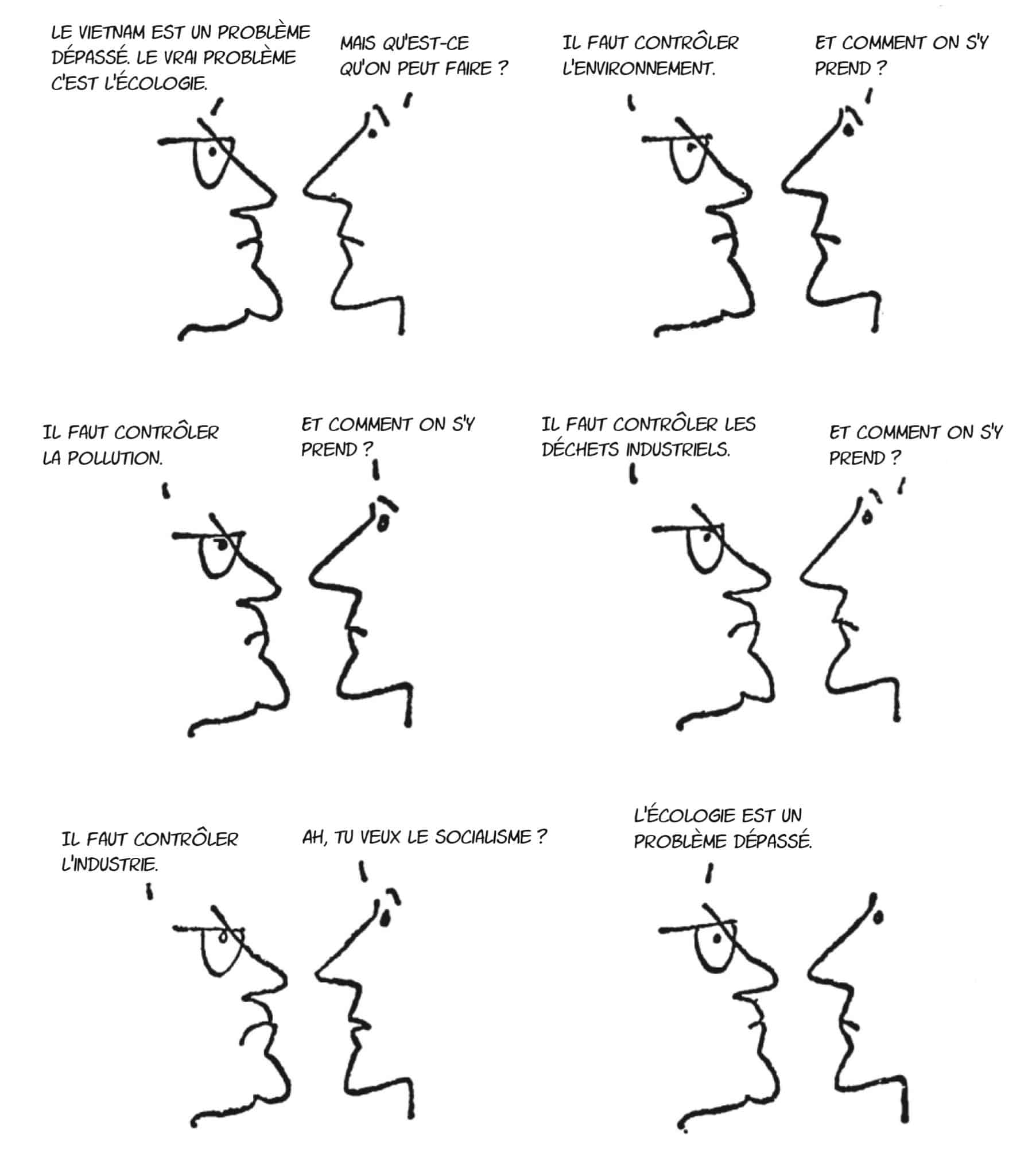
Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)
➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.
24.09.2025 à 19:14
Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire
La rédaction de Terrestres
Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4152 mots)
Temps de lecture : 11 minutes
Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.
Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.
Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.
Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.
Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.
On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.
Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.
« Revers des sources :
pays d’amont,
pays sans biens,
hôte pelé,
je roule ma chance
vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes
Virginie Maris
► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould
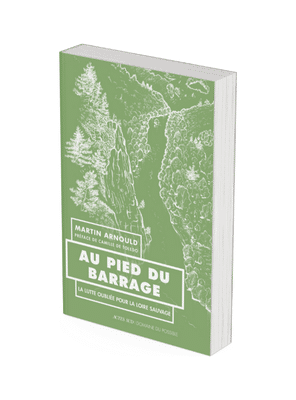
Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.
En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.
Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.
Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.
Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.
Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.
Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !
Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.
Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.
Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?
Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.
Aurélien Gabriel Cohen
► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025
Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs
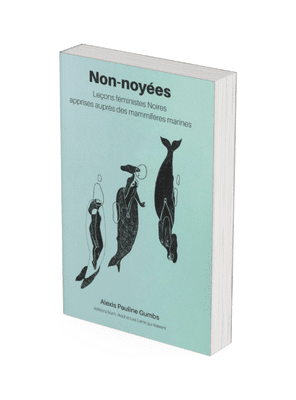
Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.
Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.
Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).
Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !
Léna Silberzahn
► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,
Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024
Roman · Le Déluge · Stephen Markley
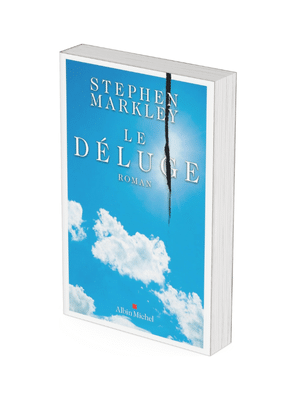
Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.
Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.
Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.
Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.
La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.
À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.
Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.
Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.
Sophie Gosselin
► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci
!
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
12.09.2025 à 15:30
Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure
Roméo Bondon
Dès 1860, alors que le carbone n’a pas encore envahi l’atmosphère et que le plastique n’existe pas, le géographe et militant anarchiste Élisée Reclus décrit les humains comme des agents géologiques qui modifient le climat. Tout au long de son œuvre monumentale, il parvient à rendre le monde plus familier tout en déployant l’idée d’une condition terrestre.
L’article Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4179 mots)
Temps de lecture : 7 minutes
Ce texte est un extrait du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre », de Roméo Bondon, qui vient de paraître dans la collection « Précurseurs de la décroissance » des éditions du Passager clandestin.
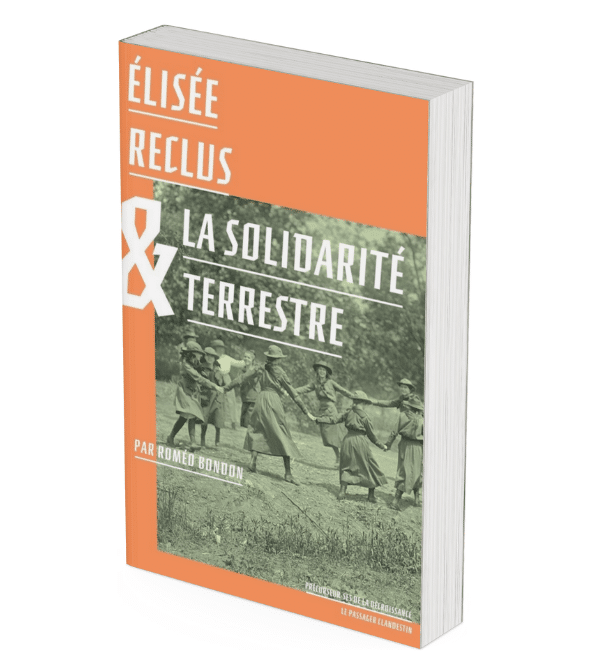
Interagir avec la Terre
Au moment de saluer son ami et camarade, mort quelques jours plus tôt, Pierre Kropotkine a ces mots pénétrants : c’était « l’un de ceux qui avaient le mieux senti et vécu la liaison qui rattache l’homme à la Terre entière, ainsi qu’au coin du globe où il lutte et jouit de la vie1 ». Tout est dit. Des premiers articles publiés dans la Revue des Deux Mondes jusqu’à L’Homme et la Terre, en passant par La Terre et les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle, Élisée Reclus n’aura de cesse de répéter, préciser, démontrer que les actions humaines sur la planète ne sont pas sans effets et, dès lors, qu’elles impliquent des responsabilités2.
Dans un article publié en 1864 à propos de Man and Nature, un ouvrage du diplomate américain et tenant de la préservation de la nature George Perkins Marsh3, Reclus note que les humains, « devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, […] ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes4 ». Inaugurant une conception dialectique du progrès n’allant jamais sans sa part de « régrès » qu’il conservera jusque dans ses derniers textes5, il détaille à partir de plusieurs exemples la diversité des modalités que recoupe l’action humaine sur la nature. « D’un côté elle détruit, de l’autre elle détériore » suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir6 ». Et d’ajouter que, devenue « conscience de la terre », l’humanité se civilise à mesure qu’elle comprend que « son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même7 ».
Difficile de ne pas penser à la notion désormais bien connue d’anthropocène pour décrire cette ère dans laquelle nous serions désormais entrés :
Sans qu’il soit nécessaire d’admettre un changement d’axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l’époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi, dans ses climats, toute une série de changements successifs, et déjà l’histoire nous prouve que, dans ces modifications si importantes du régime de notre globe, les travaux de l’humanité entrent pour une très large part8.
Évidemment, il ne s’agit pas pour Reclus de trouver le « clou d’or » datant précisément le début de cette nouvelle période géologique. Le carbone contenu dans l’atmosphère commence tout juste à augmenter sous les coups d’une industrialisation féroce, tandis que le plastique, qui est la marque de notre temps, n’est pas encore connu. Néanmoins, sa conscience des effets planétaires produits par des modifications localisées qui s’ajoutent les unes aux autres a de quoi nous interpeller.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus » de Roméo Bondon, septembre 2023.
Miroir de cette conception originale, Reclus n’hésite pas à conférer aux éléments ou à des milieux naturels une personnalité, voire une capacité d’action. Ainsi, sous sa plume, les montagnes sont « des êtres doués de vie9 » qui se révèlent composés d’« individus géographiques modifiant de mille manières les climats et tous les phénomènes vitaux des régions environnantes par le seul fait de leur position au milieu des plaines10 ». Dès lors, c’est bel et bien « l’action combinée de la Nature et de l’Homme lui-même, réagissant sur la Terre qui l’a formé11 », qu’il s’agit de décrire sur toutes les parties du monde et dans le moindre des phénomènes observés.

Rendre le monde plus familier
Les deux Histoires, d’un ruisseau et d’une montagne, publiées respectivement en 1869 et en 1880, sont peut-être ses textes qui illustrent le mieux cette démarche. Ils font ainsi écho à sa conviction selon laquelle « la science doit être une chose vivante12 ». Les deux récits paraissent aux éditions Hetzel, qui publient également Jules Verne, dans une collection intitulée « Bibliothèque d’éducation et de récréation », ce qui donne une bonne indication de la teneur des ouvrages : deux promenades informées, l’une au sein d’un bassin hydrographique, de la source à l’océan, l’autre dans un massif montagneux, auprès des animaux et des humains qui le peuplent. Au moment où il commence à travailler sur ce second opus, Élisée confie son intention à son éditeur, mais aussi ses doutes : « Mon livre est à la fois science et poésie, mais il vaudrait mieux qu’il fût l’un ou l’autre ; je crains bien que le genre lui-même ne soit faux13. » C’est pourtant bien ce mélange qui a assuré aux deux Histoires une postérité que n’ont pas démentie les plus récentes rééditions, ce à quoi il faut ajouter un engagement de l’auteur dans son texte, n’hésitant pas à mobiliser son expérience, à convoquer les sens des lecteurs et des lectrices, à conclure, comme toujours, sur un horizon émancipateur, celui d’une fraternité universelle14.
Aussi, quelle que soit l’échelle à laquelle il se situe et qu’importe le pas de temps considéré, Élisée Reclus tente de saisir les phénomènes terrestres avec une certaine familiarité. En cela, les évolutions de l’époque en matière de transport l’y ont sans doute aidé. Comme il l’écrit en ouverture d’un article publié en 1866,
[Il] se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat9.
Le monde, nous dit Reclus, subit une forme d’amoindrissement à mesure que les voies de communication se multiplient. Son usage n’en est devenu que plus accessible et son usure, diraient aujourd’hui certains critiques du tourisme, que plus rapide15.
Dans le dernier tome de la Nouvelle géographie universelle, Élisée adopte un regard rétrospectif sur les évolutions dont il a été le contemporain durant les vingt années qu’ont nécessitées la fabrication et la publication exhaustive de son grand-œuvre : « Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. […] Chaque année, se raccourcit la durée du tour du monde, devenu maintenant pour quelques blasés une fantaisie banale16. »

Sa longue et continue pratique de la Terre l’a évidemment rendu sensible aux façons de la représenter17. Il fait un usage abondant de la cartographie et a pu s’appuyer pour cela sur les compétences de l’anarchiste suisse Charles Perron18. Ensemble, ils développent des cartes non seulement de localisation, mais également économiques, statistiques et géopolitiques, ce qui constitue une véritable nouveauté pour l’époque.
Mais ça n’est pas tout. La tentative la plus originale, sans doute, pour « dépouiller l’État du monopole de la production des images du monde19 » a été le projet de construction de globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900, qui s’est tenue à Paris. Son but, alors : « Faire entrer la géographie dans la cité20. » Il partage des préoccupations pédagogiques avec l’ensemble du milieu anarchiste, ainsi qu’avec l’urbaniste écossais Patrick Geddes, qui travaille avec le neveu d’Élisée, Paul Reclus, ce « constructeur de globes, de reliefs et de dispositifs de représentation du monde les plus divers21 », à produire une représentation à échelle réduite de la surface terrestre de l’Écosse.
La planète, cette « grande patrie », est donc pour Élisée un lieu familier, aussi bien parce qu’il en connaît de nombreuses régions que parce qu’il tente, à défaut, par l’imagination et la connaissance, de se situer parmi les sociétés qu’il évoque, pleinement imprégné par les paysages qu’il décrit, en se plaçant « du point de vue de la solidarité humaine22 ».
Enfin, la description de la Terre, cet « ensemble merveilleux de rythme et de beauté23 », ne serait pas complète sans accorder une place de choix aux autres animaux – en un mot, à tout ce qui vit. Cette inclusion, assez banale pour les végétaux à une époque où la géographie botanique prend son essor, l’est beaucoup moins pour la faune, sauvage et domestique, qui est abordée dans chaque tome de la Nouvelle géographie universelle et devient un thème et une préoccupation à part dans les derniers textes d’Élisée Reclus. La mention de tel ou tel animal se double à la fin de sa vie d’une valorisation de la coopération interspécifique, notamment dans « La grande famille24 », ou de prises de position éthiques, comme dans « À propos du végétarisme25 ».
À écouter, un épisode des Sons Terrestres : « Histoire d’un ruisseau, d’Élisée Reclus », des extraits lus par la compagnie Le rouge et le vert, 2021.
Image d’ouverture : Photographie Jean Reutlinger, vers 1907-1914, Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Pierre Kropotkine, « Élisée Reclus », Les Temps nouveaux, 15 juillet 1905.
- C’est ce dont témoigne, entre autres textes, ceux réunis dans Libre nature (op. cit.), une anthologie à laquelle le livre « Élisée Reclus et la solidarité terrestre » doit beaucoup.
- Philippe Pelletier, « Élisée Reclus et George Perkins Marsh, convergence et rupture », Annales de géographie, vol. 732, no 2, 2020, p. 104-127.
- « De l’action humaine sur la géographie physique », Revue des Deux Mondes, vol. 54, 1864, repris dans Libre nature, op. cit., p. 49. Voir, dans la partie « Textes choisis », l’extrait 3 de « La libre nature ».
- Voir, dans la partie « Textes choisis », les extraits de « Cause animale et progrès social ».
- « De l’action humaine sur la géographie physique », art. cit., p. 50.
- Ibid.
- La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, t. II, Hachette, 1868-1869, p. 502.
- Du sentiment de la nature…, op. cit.
- La Terre, t. I, op. cit., p. 157.
- « Préface », dans L’Homme et la Terre, t. I, Librairie universelle, 1905-1908, p. II.
- « Lettre à M. de Gerandol », 11 janvier 1877, dans Correspondance, t. II, op. cit., p. 182.
- « Lettre à P.-J. Hetzel », 26 juin 1872, citée dans Federico Ferretti, Élisée Reclus. Pour une géographie nouvelle, éditions du CTHS, 2014, p. 90.
- Benoît Bodlet, Les histoires d’Élisée Reclus. Divulgation scientifique et émancipation, Presses universitaires de Lyon, 2024.
- Rodolphe Christin, L’usure du monde. Critique de la déraison touristique, L’échappée, 2014.
- « Dernier mot », dans Nouvelle géographie universelle. Tome XIX. L’Amérique du Sud : l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, repris dans Libre nature, Héros-Limite, 2022, p. 137.
- Écrits cartographiques, Héros-Limite, 2016.
- Federico Ferretti, « Charles Perron et la juste représentation du monde », visionscarto.net, 5 février 2010.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », Annales de géographie, vol. 706, no 6, 2015, p. 687.
- Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique d’Élisée Reclus », L’Espace géographique, vol. 32, no 2, 2003, p. 156-170.
- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté », art. cit., p. 686.
- « Dernier mot », op. cit., p. 137.
- Ibid., p. 139.
- Voir l’extrait 2 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
- Voir l’extrait 1 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».
L’article Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.
05.09.2025 à 10:38
La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique
Hamza Hamouchene
Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (11213 mots)
Temps de lecture : 26 minutes
Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.
À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.
Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.
Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Orientalisme environnemental
Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.
L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.
La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.
Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.
L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.
La crise climatique en Palestine
Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.
La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.
La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.
Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.
La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.
Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.
Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables
Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.
Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.
Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.

En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.
Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.
L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.
Croisade contre la nature et écocide à Gaza
Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.
En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.
Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.
À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.
C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.
La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.
Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.
L’écocide perpétré par Israël à Gaza s’étend jusqu’à la mer et au-delà, la côte méditerranéenne étant désormais saturée d’eaux usées et de déchets. Après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en carburant de Gaza après le 7 octobre, les coupures d’électricité ont empêché le pompage des eaux usées vers les stations d’épuration, et 100 000 mètres cubes par jour d’eaux usées ont été déversés dans la Méditerranée. Outre la destruction des infrastructures sanitaires, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé, et les restrictions sévères imposées à l’entrée de fournitures médicales sur le territoire, cette situation a créé les conditions « parfaites » propices à l’apparition de maladies infectieuses, telles que le choléra, et à la résurgence de maladies autrefois éradiquées par la vaccination, comme la polio29.
La longue liste des destructions décrites dans les paragraphes précédents ont conduit de nombreux expert·es et observateur·trices à affirmer que les attaques répétées d’Israël contre les écosystèmes à Gaza ont rendu le territoire invivable.
« Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir. »
Gustavo Petro, président de la Colombie
La Palestine contre l’impérialisme américain et le capitalisme fossile mondial
Lors de la COP 28, sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï en décembre 2023, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que « Le génocide et les actes barbares perpétrés contre le peuple palestinien sont ce qui attend ceux qui fuient les Suds à cause de la crise climatique… Ce dont nous sommes témoins à Gaza est une répétition du spectacle de l’avenir.30 » Comme le dit si bien le président colombien, le génocide à Gaza est un avertissement de ce qui nous attend si nous ne nous organisons pas et ne résistons pas. L’empire et ses classes dirigeantes sont prêts à sacrifier des millions de personnes noires, basanées et blanches de la classe ouvrière pour garantir l’accumulation du capital et perpétuer leur domination. Cela se reflète clairement dans le refus de ces élites, lors de la COP 29 à Bakou, de s’engager en faveur de l’action climatique tout en continuant à financer le génocide à Gaza, de même que dans l’apartheid autour de l’accès aux vaccins lors de la pandémie de COVID-19.
Cela révèle également comment la guerre et les complexes militaro-industriels alimentent la crise climatique. En effet, l’armée américaine est l’institution qui émet le plus de CO2 au monde31. Pour ce qui est de la guerre génocidaire à Gaza, les émissions générées par l’État d’Israël ont dépassé, en deux mois seulement, les émissions annuelles de carbone d’une vingtaine des pays les plus vulnérables au changement climatique, et sont causées en grande partie par les vols cargo de l’armée américaine et la fabrication d’armes32. Les États-Unis ne se contentent pas de faciliter un génocide, ils contribuent également activement à l’écocide commis en Palestine.

Mais le lien entre la première puissance mondiale et ce qui se passe en Palestine est encore plus profond. La lutte pour la libération des Palestinien·nes est indissociable de la résistance contre le capitalisme fossile et l’impérialisme américain. La Palestine est située au cœur du Moyen-Orient, une région qui occupe une place centrale dans l’économie capitaliste mondiale, non seulement en raison des flux commerciaux et financiers qu’elle concentre, mais aussi car celle-ci constitue le noyau du système mondial des combustibles fossiles, assurant environ 35 % de la production de pétrole à l’échelle mondiale33. En parallèle, Israël cherche à devenir une plaque tournante régionale de la production d’énergie, notamment grâce aux gisements de gaz comme les champs de Tamar et Leviathan en Méditerranée, pour lesquels le pays a accordé de nouvelles licences d’exploration gazière, quelques semaines seulement après le début de sa guerre génocidaire à Gaza.
L’hégémonie américaine au Moyen-Orient, et ses effets sur le système du capitalisme fossile mondial, repose sur deux piliers : l’État d’Israël et les monarchies du Golfe. Le premier, décrit par l’ancien secrétaire d’État américain Alexander Haig comme « le plus grand porte-avions américain au monde, impossible à couler », représente le point d’ancrage de l’empire américain dans la région en participant au contrôle des ressources en combustibles fossiles, ce qui ouvre la voie à l’innovation en matière de technologies de surveillance et d’armement. Son intégration dans l’économie de la région s’opère par le biais de secteurs tels que l’agro-industrie, les énergies et la désalinisation. Pour renforcer leur domination, les États-Unis et leurs alliés s’emploient activement à normaliser la position d’Israël dans la région. Ce processus a débuté avec les accords de Camp David de 1978 et le traité de paix signé entre Israël et la Jordanie en 1994, suivis par les accords d’Abraham conclus en 2020 avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Avant le 7 octobre, la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite était imminente, dans le cadre d’un accord conçu sous l’égide des États-Unis qui aurait anéanti la cause palestinienne. Les actions de la résistance palestinienne ont perturbé ces plans.
La libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale.
Tout cela démontre que la libération du peuple palestinien ne relève pas simplement d’une question de morale ou de droits humains ; il s’agit aussi d’une confrontation directe avec l’impérialisme américain et le système du capitalisme fossile. C’est pourquoi la libération de la Palestine doit être un enjeu central des luttes en faveur de l’environnement et de la justice climatique à l’échelle mondiale. Cela implique de s’opposer à la normalisation d’Israël et de soutenir le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), notamment dans le domaine des technologies vertes et des énergies renouvelables. Il ne peut y avoir de justice climatique sans démanteler la colonie sioniste d’Israël et renverser les régimes réactionnaires des pays du Golfe. La Palestine est en première ligne sur le front international contre le colonialisme, l’impérialisme, le capitalisme fossile et la suprématie blanche. C’est pourquoi les mouvements pour la justice climatique et les organisations antiracistes et anti-impérialistes doivent soutenir la lutte de libération, et défendre le droit des Palestinien·nes à résister par tous les moyens nécessaires.
Résistance et éco-soumoud
Face au cataclysme qu’elle subit, la population palestinienne continue de résister et de nous inspirer jour après jour par son soumoud (détermination, fermeté). Ce terme a de multiples significations. La chercheuse et militante palestinienne Manal Shqair le définit comme un ensemble de pratiques quotidiennes de résistance et d’adaptation aux difficultés de la vie quotidienne sous la domination coloniale imposée par Israël34. Le terme fait également référence à la persistance du peuple palestinien à demeurer sur ses terres, et à préserver son identité et sa culture face à la dépossession et aux discours qui présentent les colons juif·ves comme la seule population légitime de la région34.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Démembrer et pulvériser les corps : sur la guerre d’anéantissement à Gaza » de Suzanne Beth, janvier 2025.
En introduisant le concept d’éco-soumoud, qui renvoie aux actes quotidiens de ténacité des Palestinien·nes qui emploient des moyens écologiques ancrés dans la terre afin de maintenir un lien profond avec celle-ci, les travaux de Manal Shqair nous permettent d’approfondir notre compréhension de la persévérance du peuple palestinien. Cette notion englobe les savoirs autochtones, les valeurs culturelles et les pratiques quotidiennes que les Palestinien·nes mettent en œuvre pour résister à la rupture violente de leur lien avec la terre. L’éco-soumoud repose sur l’idée que les seules réponses viables aux crises écologique et climatique sont celles qui soutiennent la quête de justice, de souveraineté et d’autodétermination du peuple palestinien, en mettant fin au régime israélien d’occupation et d’apartheid qui, en tant que colonie de peuplement, doit être démantelé. La pratique de l’éco-soumoud est ancrée dans la foi qu’il est possible de vaincre le colonialisme israélien, et véhicule l’aspiration inébranlable des populations colonisées à être elles-mêmes maîtresses de leur destin.
La résistance héroïque dont font preuve les Palestinien·nes, qui s’exprime à travers la notion d’éco-soumoud et par un profond attachement à la terre, est une source d’inspiration pour les mouvements progressistes du monde entier, en lutte pour un monde plus juste face à des désastres qui s’accumulent. Pour conclure ce chapitre, on peut citer l’écomarxiste Andreas Malm, qui établit un parallèle poignant entre la résistance du peuple palestinien et la lutte contre le réchauffement climatique :
« Qu’est-ce que le front climatique peut apprendre de la résistance palestinienne ? Que même lorsque la catastrophe est intégrale, implacable et ininterrompue, nous continuons à résister. Même lorsqu’il est trop tard, lorsque tout a été perdu, lorsque les terres ont été saccagées, nous sortons des décombres et nous nous battons. Nous ne cédons pas, nous ne nous rendons pas, nous n’abandonnons pas, car les Palestinien·nes ne meurent pas. Les Palestinien·nes ne seront jamais vaincu·es. Une armée puissante est perdante si elle ne gagne pas, mais une armée de résistance faible est gagnante tant qu’elle ne perd pas. J’espère que la guerre en cours à Gaza se terminera avec une résistance intacte, ce qui serait une victoire. La pérennité de la résistance palestinienne serait en soi une victoire, car nous continuerons à nous battre, quels que soient les désastres que vous déversez sur nous. C’est une source d’inspiration pour le front de lutte contre le changement climatique. En cela, les Palestinien·nes ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Ils et elles se battent pour l’humanité toute entière, pour l’idée d’une humanité qui résiste aux catastrophes, quelle qu’en soient les formes, et qui continue à se battre malgré la supériorité écrasante de ses adversaires. Je pense qu’il y a toutes sortes de raisons d’être solidaire de la résistance palestinienne, pour son propre bien, mais aussi pour le nôtre.35 »
La tâche qui nous attend est très difficile mais, pour répondre à l’appel formulé par Frantz Fanon, nous devons, dans une relative obscurité, découvrir notre mission, la remplir et ne pas la trahir36.
Illustration principale : ©Fourate Chahal El Rekaby.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Davis, D.K. « Imperialism, orientalism, and the environment in the Middle East : history, policy, power and practice », dans Davis et Edmund Burke (eds.), Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa, Athènes (Ohio), Ohio University Press, 2011.
- Galai, Y. « Narratives of redemption : “The international meaning of afforestation in the Israeli Negev” », International Political Sociology 11, n° 3 : 273-291, 2017.
- Sasa, G. « Oppressive pines : Uprooting Israeli green colonialism and implanting Palestinian A’wna », Politics, 43(2), 219-235, 2022.
- « Rehabilitation of the Hula Valley », Water for Israel, KKL-JNF.
- Zeitoun, M. et Dajani, M. « Israel is hoarding the Jordan River – it’s time to share it », The Conversation, 19 décembre 2019.
- Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (2025), « Weaponizing Water For Israel’s Genocide, Apartheid and Ethnic Cleansing ».
- Amnesty International, « L’occupation de l’eau », 2017.
- Molavi, S. C. Environmental Warfare in Gaza : Colonial Violence and New Landscapes of Resistance, Londres, Pluto, 2024.
- Whyte, K. « Settler Colonialism, Ecology, and Environmental Injustice », Environment and Society, 9, 1 (septembre) : 135, 2018.
- Molavi, op. cit.
- Tippmann, R. et Baroni, L. « ClimaSouth Technical Paper N.2. The Economics of Climate Change in Palestine », 2017.
- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Programme d’assistance au peuple palestinien, Stratégie d’adaptation au changement climatique et programme d’action pour l’Autorité palestinienne, 2010.
- Agha, Z. « Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine », Al-Shabaka, 26 mars 2019.
- Dajani, M. « Challenging Israel’s Climate Apartheid in Palestine », Al-Shabaka, 30 janvier 2022.
- B’Tselem, « Parched : Israel’s policy of water deprivation in the West Bank », mai 2023.
- Voir la page des Nations Unies relative à l’accès à l’eau.
- The Applied Research Institute – Jérusalem (ARIJ), « Water resource allocations in the Occupied Palestinian Territory : Responding to Israeli claims », juin 2012.
- Lazarou, E. « L’eau et le conflit israélo-palestinien », Service de recherche parlementaire européen, 2016. https://www.europarl.europa.eu/
- Kubovich, Y. « Polluted Water Leading Cause of Child Mortality in Gaza, Study Finds », Haaretz, 16 octobre 2018.
- « Moins de 7 % des niveaux d’eau d’avant-guerre sont disponibles à Rafah et dans le nord de Gaza, aggravant une catastrophe sanitaire », Oxfam France, février 2025.
- Cette partie s’inspire dans une large mesure des travaux de Manal Shqair. Pour aller plus loin, voir Shqair, M. « L’éco-normalisation israélo-arabe : Écoblanchiment des colonies de peuplement en Palestine et dans le Jawlan », Transnational Institute, 2023.
- Forensic Architecture, « Herbicidal warfare in Gaza », 19 juillet 2019.
- Gisha, « Closing In : Life and Death in Gaza’s Access Restricted Areas », 2019.
- Al Mezan Center for Human Rights, « Effects of Aerial Spraying on farmlands in the Gaza Strip », 2018 (document pdf).
- Forensic Architecture, « A Cartography of Genocide : Israel’s Conduct in Gaza since October 2023 », 25 octobre 2024.
- Ahmed, K., Gayle, D. et Mousa, A. « « Ecocide in Gaza » : does scale of environmental destruction amount to a war crime ? », The Guardian, 29 mars 2024.
- Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), « Environmental legacy of Explosive weapons in Populated Areas », 5 novembre 2021.
- Al Jazeera, « Clearing Gaza rubble could take 15 years, UN agency says », 15 juillet 2024.
- Ahmed, op. Cit
- Gouvernement de Colombie, « President Petro : The unleashing of genocide and barbarism on the Palestinian people is what awaits the exodus of the peoples of the South unleashed by the climate crisis », 1er décembre 2023.
- Mallinder, L. « “Elephant in the room” : The US military’s devastating carbon footprint », Al Jazeera, 12 décembre 2023.
- Neimark, B., Bigger, P., Otu-Larbi, F., et Larbi, R., « A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict », 5 janvier 2024.
- BP, BP Statistical Review of World Energy 2022, 71st Edition, 2022 (document pdf).
- Shqair, op. cit. ; Johansson, A. et Vinthagen, S. Conceptualizing Everyday Resistance : A Transdisciplinary Approach, New York, Routledge, 2020 : 149-152.
- Extrait d’une conférence donnée par Andreas Malm à l’Université de Stockholm le 7 décembre 2023, intitulée « On Palestinian and Other Resistance In Times of Catastrophe ».
- Fanon, F. Les damnés de la terre, Éditions Maspero, Paris, 1961.
L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.
19.07.2025 à 11:27
Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique
Un groupe d'amis du Delta
De l'assèchement à la submersion, il n'y a souvent qu'une brève parenthèse. Dans ce texte mosaïque, un collectif de chercheurs et d'écrivains italiens enquête sur la manière dont le changement climatique et la montée du niveau de la mer bouleverse un territoire, le Delta du Pô, dont l'histoire récente est intimement liée à la gestion industrielle de ses eaux.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10280 mots)
Temps de lecture : 23 minutes
Ce texte a été distribué pour la première fois, sous la forme d’une brochure le 31 octobre 2024, à la Factory Grisù de Ferrare, lors de la première présentation du roman Gli uomini pesce par Wu Ming 1 (Einaudi, 2024). La diffusion du document s’est poursuivie en novembre, à l’occasion d’autres événements dans la Basso Ferrarese1, dans la Polésine et au nord de Bologne. Il a été publié pour la première fois en ligne sur le site Giap et nous espérons qu’il voyagera, qu’il provoquera des discussions et qu’il sollicitera des commentaires dans d’autres territoires.
Il a été écrit par un groupe informel et pluridisciplinaire et il est le premier fruit de deux années de discussions, de lectures partagées et surtout d’errances dans les territoires décrits ici.
Bonne lecture, bonnes déambulations.
Ce texte a été écrit par Sandro Abruzzese (enseignant et écrivain) ; Marco Belli (enseignant, écrivain et photographe, directeur artistique de l’Elba Book Festival) ; Davide Carnevale (enseignant-chercheur en anthropologie visuelle, Université de Ferrare) ; Cassandra Fontana (chercheuse en études urbaines, Université de Florence) ; Sergio Fortini (architecte-urbaniste, cofondateur de Metropoli di Paesaggio) ; Marco Manfredi (comédien, vagabond, spécialiste des relations entre cinéma, récits et territoire) ; Michele Nani (historien, chercheur au CNR — Ferrare) ; Giuseppe Scandurra (anthropologue, Université de Ferrare) et Wu Ming 1 (écrivain et essayiste, originaire du Basso Ferrarese).
La présente traduction de l’italien a été réalisée par Michele Nani et Niccolò Mignemi.

Carte du delta du Pô, réalisée par les auteur·es. Pour visualiser la situation de l’Italie nord-orientale en 2100 avec la mer Adriatique plus élevée d’un mètre par rapport au niveau actuel, voir le projet interactif élaboré par l’artiste Alex Tingle depuis 2006.
On raconte qu’au siècle dernier, dans les mines de charbon de diverses régions du monde, face au danger du grisou et en l’absence de systèmes de ventilation, les mineurs emportaient avec eux un canari en cage. Beaucoup plus petit et donc plus sensible au gaz, le canari commençait à agoniser bien avant que les mineurs ne ressentent les effets de ce qu’ils inhalaient. Lorsque l’oiseau commençait à suffoquer, c’était le signe qu’il fallait évacuer la mine.
D’où la métaphore bien connue du « canari dans la mine », également utilisée par le météorologue Luca Mercalli lors d’une conférence donnée il y a quelques années dans un centre du Basso Ferrarese2. Le Delta est le canari, c’est-à-dire la zone la plus exposée, celle qu’il faut regarder pour mieux comprendre les effets du changement climatique.
Dans le Delta
1. Par Delta du Pô, on entend ici…
Par Delta du Pô, nous entendons le delta historique, ou Delta grande, c’est-à-dire l’espace géographique façonné au fil des siècles par les crues et les débordements du fleuve et par le déplacement progressif de son bras principal vers le nord.
Le Delta grande est un ensemble de lits où le fleuve coule encore, d’autres — souvent invisibles à l’œil nu — qu’il a abandonnés et d’autres encore qui sont devenus artificiels, c’est-à-dire transformés en canaux, comme ce fut le cas pour la branche du Pô de Volano.
Le Delta grande n’a pas de frontières nettes, mais il comprend certainement la partie orientale de la zone de la Polésine de Rovigo, la partie orientale de la province de Ferrare et une partie du territoire de Ravenne. Le long de la côte, il s’étend de la limite nord de la municipalité de Rosolina — le dernier tronçon du fleuve Adige — à la limite sud de la municipalité de Cervia. Près d’un million de personnes vivent dans cette zone, en ne comptant que les résidents.
Le Delta est une région géo-historique, géo-économique et géo-culturelle aux caractéristiques propres. Il se distingue par la présence de zones humides résiduelles — qui ont échappé aux travaux d’assèchement et drainage — ainsi que par des risques hydrauliques propres et par sa morphologie de plaine ininterrompue, différente du reste de l’Italie, pays composé en grande partie de montagnes et de collines3.
2. Des impasses communes
Les territoires du Delta ont des histoires et des problèmes similaires. Ils ont également en commun d’avoir emprunté des voies sans issue, d’avoir misé sur des modèles de développement local qu’il convient aujourd’hui de repenser : le tourisme balnéaire de masse, une certaine agriculture intensive, un certain développement industriel. Certains modèles se sont avérés depuis longtemps des échecs, et les territoires les ont payés par l’émigration et le dépeuplement ; d’autres ont généré des retombées économiques pendant quelques décennies, mais se révèlent aujourd’hui insoutenables, voire catastrophiques.
C’est le cas de la basse vallée du Pô qui, à partir du XIXe siècle, est passée de zone humide à une vaste étendue de terres cultivables. Un processus qui ne peut jamais être considéré comme achevé, mais reste ouvert et toujours réversible, ce qui rend la zone du Delta particulièrement fragile à divers égards, aussi bien environnementaux que sociaux.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
3. Dans la terre de la bonifica
Nous avons grandi, nous nous sommes installés ou nous travaillons aujourd’hui sur des terres transformées par la bonifica4. Nous avons vécu ou nous sommes passés tous les jours devant les stations de drainage et les autres technologies de gestion des eaux, mais pendant longtemps nous n’y avons pas prêté attention, pendant longtemps nous avons tenu pour acquise cette utilisation des terres, ce complexe « territoire-machine », pour citer la géographe Federica Letizia Cavallo5.
Cette terre, la partie émergée, le paysage de la basse plaine, était pour nous une évidence alors que nous vivions dans une parenthèse entre des terres qui ont été submergées et qui, mutatis mutandis, le seront à nouveau.

4. Les parenthèses s’ouvrent et se referment
En rapportant chaque durée à celle de notre vie, nous percevons comme anciens des phénomènes qui, en fait, ne se sont manifestés que récemment, peut-être peu avant notre naissance. Pour les mêmes raisons, nous tenons ces phénomènes comme acquis et percevons les processus dont ils dépendent comme achevés, définitifs, alors qu’ils sont toujours en cours et plus ouverts que jamais.
Depuis le siècle dernier, l’idée d’une temporalité unique et linéaire a été remise en cause dans tous les domaines de la connaissance. Elle ne survit que dans l’idée de développement qui anime les politiques économiques. Mais les temporalités sont multiples, les parenthèses s’ouvrent et se referment, elles se situent à l’intérieur ou à côté d’autres parenthèses. L’histoire du monde est une coprésence de temporalités.
5. On ne comprend pas vraiment la bonifica si…
On ne comprend pas vraiment la bonifica, dans ses différentes phases, et l’héritage qu’elle nous a laissé, si nous ne tenons pas compte de ses contradictions internes, de la façon dont elle s’est imposée, des résistances qu’elle a dû abattre et de celles qui l’ont arrêtée au fur et à mesure que la situation et les sensibilités évoluaient.
Dans les discours actuels sur la bonifica, une erreur de raisonnement connue sous le nom de biais des survivants opère : pour évaluer une situation, on ne considère que les éléments résultants d’un processus de sélection ; cependant, ces éléments ne véhiculent pas nécessairement plus d’informations par rapport à ceux qui n’ont pas survécu. Ce qui a été occulté, et qui est resté longtemps en dehors de la représentation dominante, il est aussi bien un objet de recherche historique et un vecteur de savoir. Une fois sorties de l’oubli, ces histoires nous parlent, enrichissent notre connaissance et notre capacité de transformer le réel.
Au XIXe siècle, le Delta et, plus en général, la partie nord-orientale de l’Italie connurent une résistance populaire à la bonifica qui effaçait brutalement les biens communaux, les droits collectifs et les économies locales, en faisant éclater les communautés. Grâce à l’historien Piero Brunello, nous connaissons désormais les luttes contre la bonifica – menées entre 1853 et 1861 – dans les valli6 de Cona et de Cavarzere, deux communes aujourd’hui situées dans la ville métropolitaine de Venise7. Nous pouvons également citer l’opposition d’une partie de la population de Massa Fiscaglia, dans le territoire du Basso Ferrarese, à la bonifica de la valle Volta, une lutte menée par tous les moyens et qui a duré de 1874 à 18808.
D’autres batailles, conduites cette fois-ci par des associations de protection de l’environnement et du territoire comme Italia Nostra, furent menées exactement cent ans plus tard, au milieu des années 1970, dans le Delta de Ferrare, lorsqu’il apparut distinctement que l’Ente Delta Padano9 était en mode pilote automatique, avec l’intention d’assécher toutes les zones humides encore existantes, en premier lieu les valli de Comacchio, au nom de modèles de développement qui commençaient à montrer des signes d’essoufflement. Le changement de perception et la prise de conscience fut un facteur déterminant, au point que la dernière vague prévue de bonifica n’eut finalement pas lieu10.
6. Des connaissances « augmentées »
Cette connaissance « augmentée » s’enrichit de ce qui n’était pas connu à l’époque et qui est aujourd’hui un fait acquis : les zones humides font partie des écosystèmes qui stockent le mieux le dioxyde de carbone : un marais en séquestre cinq fois plus qu’une forêt. Les zones humides ne couvrent que 1% de la surface de la planète, mais elles captent cinq-cents fois plus de CO2 que les océans11.
Rétrospectivement, l’assèchement des marais et des valli dolci et salse12 a contribué à accélérer le réchauffement climatique. Cette prise de conscience, parmi tant d’autres aujourd’hui indispensables, suggère la nécessité d’étudier les expériences de restauration des zones humides dans le territoire du Delta du Pô comme ailleurs dans le monde, afin de façonner les pratiques d’intervention futures.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Inondations et barrages dans la Vallée de la Vesdre : l’aménagement du territoire en question » de Marie Pirard, juin 2023.
7. Une autre parenthèse : vivre sur le littoral
La « littoralisation » de la population, un phénomène qui s’est surtout produit au XXe siècle, est également une parenthèse. Aujourd’hui, nous constatons que le niveau de la mer monte, et sa montée est un problème car le phénomène touche aussi les agglomérations, parfois densément peuplées. Il fut un temps où, à l’exception de quelques villes portuaires, les côtes étaient vierges de toute présence humaine : à l’époque, nous n’aurions pas remarqué la montée, alors qu’aujourd’hui cette parenthèse des côtes peuplées risque de prendre fin de manière catastrophique.

8. Poubellocène
Nous devons à l’historien de l’environnement Marco Armiero le concept de poubellocène13, pour signifier non seulement l’ère de l’immense accumulation d’ordures, mais aussi l’ère centrée sur les déchets, comprise comme des relations d’exclusion, au sein desquelles certaines communautés et localités sont désignées comme susceptibles d’être sacrifiées. Sur ces communautés sont déversés, souvent littéralement, les « coûts externes » du développement, c’est-à-dire la pollution, les résidus toxiques, les marchandises qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et deviennent des déchets.
Par sa nature et sa situation, le Delta est aujourd’hui l’avant-dernier réceptacle — le dernier étant la mer Adriatique — des coûts externes du développement dans la plaine du Pô. Il l’est matériellement, parce que le Pô et d’autres cours d’eau rejoignent la mer remplis de pollutions industrielles et agro-industrielles, et culturellement, parce qu’il est l’expression d’une Italie mineure et subalterne.
Dans l’histoire de l’Italie, les pouvoirs publics ont essayé de faire de la plaine du Pô la zone industrielle par excellence. Pour atteindre ces résultats, des millions de personnes ont été poussées à émigrer, d’abord des zones internes du Nord lui-même, puis du Mezzogiorno, exacerbant les déséquilibres déjà existants entre le Nord et le Sud de l’Italie, enfin depuis l’Europe de l’Est et le Sud du monde.
Aujourd’hui, le territoire paie pour ces choix et doit faire face à des politiques économiques qui l’ont dévasté et à des concentrations méphitiques de particules. La plaine du Pô est de loin la zone la plus polluée d’Europe occidentale et l’une des plus polluées de tout le continent14. C’est la zone qui compte le plus grand nombre de décès prématurés causés par des concentrations excessives d’ozone, de NO2 (dioxyde d’azote) et de PM2,5 (particules)15. C’est de loin la zone la plus bétonnée du pays16.

Le Basso Ferrarese
9. Une focalisation territoriale précise
Une focalisation territoriale précise est nécessaire pour penser et agir dans un lieu donné. En même temps, cet effort centripète n’a de sens que s’il a aussi des effets centrifuges. Il s’agit de commencer par le Basso Ferrarese et, en même temps, élargir le champ d’action à l’ensemble du Delta du Pô et au-delà.
Le Basso Ferrarese va du chef-lieu de la province à la mer et se situe entre deux fleuves : le Pô au nord et le Reno au sud. Le Pô et le Reno sont des frontières ouvertes : revenons à la conception des fleuves tels qu’ils étaient autrefois : des lieux de passage et d’échange.
10. Le territoire avec les sols les moins artificialisés
La grande anomalie du Basso Ferrarese, une anomalie qui peut aujourd’hui être tournée à son avantage, est que pour diverses raisons — non pas du fait des vertus de ses administrateurs, mais de dynamiques historiques complexes — il est resté le territoire avec les sols les moins artificialisés de toute la plaine du Pô, exception faite bien sûr de la blessure des Lidi, ce littoral marqué par la présence d’établissements balnéaires, où la spéculation immobilière a commencé dans les années 1960 et s’est accélérée à partir des années 1980.
11. « Rien à voir » ?
Celui du Basso Ferrarese est un paysage en large partie « aménagé », construit par la bonifica. À un premier regard, il peut paraître parfaitement plat et vide, dépourvu de tout signe particulier, de ce que le géographe Eugenio Turri appelait des « iconèmes17 ».
« Il n’y a rien à voir », tel est le cliché que nous entendons renverser grâce à nos pérégrinations car c’est au fil des regards que ce territoire surprend, se révélant plein de détails, marqué par des lignes, subtilement entaillé par des dénivelés (berges, bassins de valli asséchées, anciens lits de fleuves), des réalités cachées et des « zones d’incertitude ». Et les iconèmes sont nombreux, à partir des artefacts de la bonifica jusqu’aux maisons abandonnées dont la province est aujourd’hui remplie.
En outre, les espaces naturels et protégés couvrent 13 % du territoire de la province. Ils sont pour la plupart des zones humides qui ont survécu à la fièvre du drainage.
Mais il ne faut pas oublier non plus certains interstices le long du grand fleuve, des interzones sans juridiction où l’on ne sait pas ce qui se trame, des lieux où des communautés inattendues s’arrêtent et s’installent.
12. Dépaysements
L’émigration, la raréfaction sociale qui en résulte et la perte de sens de l’habiter ont créé une sens de dépaysement. En un mot, celles et ceux qui vivent dans ces landes ne connaissent plus le territoire. Il est nécessaire de le re-connaître car, même sans en être pleinement conscient, on se sent dépossédé.
Pour réfléchir à l’organisation politique et sensible autour des fleuves, vous pouvez lire aussi dans Terrestres le texte collectif « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.
Territoires en marge, territoires inexprimés
13. Sans voix
Le Delta du Pô est un territoire marginal, un territoire inexprimé. Les territoires en marge sont des espaces subalternes — économiquement, socialement, culturellement — au monde urbain et aux imaginaires métropolitains, à une seule et unique idée de la modernité. Subalternes, donc incapables — reprenons ici une catégorie du sociologue Franco Cassano — d’être des sujets de pensée. Ces territoires ont du mal à trouver leur propre voix malgré leurs spécificités et leurs particularités, au point que leur avenir reste inexprimé.
Dans ces régions, les dysfonctionnements de la modernité ne trouvent pas leur explication dans des raisons structurelles, mais plutôt dans des stéréotypes et des préjugés. Il en résulte des complexes d’infériorité et des pulsions à l’émulation : des villes et de la civilisation technologique, on emprunte l’amour du pouvoir et de tous les signes de « réussite ». Des zones de prospérité économique, on tire des modèles prétendument « exportables » : l’histoire des Lidi Ferraresi, reproduction maladroite et tardive d’un modèle de tourisme à fort impact environnemental, en est un exemple18.
Faute de pouvoir répondre à l’imaginaire médiatique, à une représentation unidimensionnelle du monde et aux attentes des jeunes générations, les territoires en marge sont frappés par le dépeuplement, l’abandon, les dépressions, l’anomie. Ils subissent des processus et des projets d’en haut et troquent la chimère de l’emploi contre la pollution, contre les grands chantiers, éventuellement contre le fait de devenir un dépôt pour les déchets dangereux. En Italie, les territoires marginaux se trouvent dans les Apennins, dans les Alpes, sur les îles, le long des frontières, dans les basses terres déprimées.
14. L’attente perpétuelle de pseudo-solutions
Dans la crise climatique, les territoires en marge se trouvent ébranlés et abasourdis. Ils subissent les conséquences immédiates de cette crise, alors que leur situation de départ est déjà défavorisée. Ils sont victimes de modèles hétéronymes. Influencés par de lourdes interdépendances, ils ne peuvent pas s’exprimer en tant que sujets capables d’une pensée autonome. Ils n’ont droit qu’à attendre des solutions venues de l’extérieur, toujours pensées comme des techno-raccommodages.

Ce qui arrive
15. Le retour de la mer
Toute la côte occidentale de la Haute Adriatique et les plaines de son arrière-pays sont des territoires en équilibre face à l’aggravation de la crise climatique. Un nombre croissant d’études confirment qu’au cours du XXIe siècle, l’élévation du niveau de la mer Adriatique (eustatisme) — combinée à l’affaissement de la surface terrestre et à d’autres phénomènes en cours — dévastera toute la région, des Marches jusqu’au golfe de Trieste.
16. Les barrages et le vénitiano-centrisme
Pendant des décennies, le discours public national s’est concentré sur Venise, un lieu emblématique en matière de montée des eaux.
Certains espèrent qu’avec les barrages mobiles du MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), le problème sera en grande partie résolu. Mais les prémisses même de cette approche sont biaisées par ce qu’Evgeny Morozov appelle le « solutionnisme technologique », avec la suppression des symptômes sans diagnostiquer le mal, c’est-à-dire l’illusion que les effets peuvent être atténués sans intervenir sur les causes19.
En outre, le débat sur le MOSE a toujours été « Venise-centré », comme si la lagune de Venise ne faisait pas partie d’un système beaucoup plus vaste de zones humides et de territoires en équilibre entre la terre et l’eau. Au contraire, si Venise a une valeur, c’est en tant que synecdoque, en tant que partie d’un tout. Au nord et au sud de la ville, sur plus de trois cents kilomètres de littoral, le territoire risque de subir le même sort. La différence est qu’il court ce risque dans le silence et l’inconscience générale. Et à quoi va servir le MOSE si l’eau entre et se répand tout autour ?
17. Au-delà du chiffre rond
Les estimations vont de +80 à +140 centimètres de montée de la mer Adriatique d’ici 210020. Des cartes topographiques ad hoc montrent la situation hypothétique cette année-là : le littoral actuel a disparu, l’eau a pénétré dans l’arrière-pays, elle a même gagné — dans certaines régions, comme les provinces de Ferrare et de Rovigo (la Polésine) — des dizaines de kilomètres21.
Le chiffre rond de 2100 contribue à produire un instantané, au sens multiple du terme : une secousse soudaine, un pas en avant rapide dans la perception du problème et un instantané d’un moment dans le temps qui permet une vue d’ensemble ; dans le même temps, il détourne l’attention du fait que ces processus sont déjà en cours et se poursuivront même après cette date.
18. Les conséquences
Abandon des agglomérations côtières et de l’arrière-pays proche. Migrations climatiques vers d’autres régions d’Italie ou vers l’étranger. Perte de milliers d’hectares de terres agricoles. Perte de nappes d’eau potable. Destruction des écosystèmes d’eau douce et des zones naturelles et protégées, telles que les deux parcs régionaux du Delta du Pô, la lagune de Venise, les lagunes de Marano et de Grado, etc. Un changement climatique radical.
19. Il ne s’agit pas seulement d’eau
Il est important de garder à l’esprit qu’on ne parle pas d’« eau », mais de boues toxiques et contaminées. Le littoral de l’Adriatique-nord est densément urbanisé et industrialisé. Avec la montée des eaux, la mer pénètrerait dans des zones bâties, elle ferait donc voler en éclats les égouts, elle entraînerait des déchets, des produits chimiques, des carburants, des plastiques de toute sorte, des carcasses d’animaux, comme elle l’a déjà fait en 2023 et en 2024. Ce que l’on a vu à Conselice, bourg de la Romagne submergé pendant des semaines par la boue chargée de toutes sortes de poisons et de cocktails bactériologiques, sera amplifié de plusieurs ordres de grandeur.
La crue la plus impétueuse d’un cours d’eau des Apennins n’est rien comparée à la masse d’eau d’une mer : non seulement la pollution de l’Adriatique augmenterait de façon exponentielle, mais elle créerait des « grands Conselice », de vastes zones « amphibies » emprisonnées dans la boue, dont les miasmes se propageraient sur plusieurs kilomètres alentour.
20. En attendant…
C’est le scénario envisagé en l’absence totale d’action. En attendant, la montée des eaux est déjà en cours et considérée, dans une large mesure, comme inéluctable. Elle est déjà en train de se produire.

Ce qui se passe déjà
21. Les avant-gardes de l’avancée de la mer
Biseau salé, orages de plus en plus intenses et tempêtes de mer sont les signes avant-coureurs de la mer qui avance, et les manifestations de la crise climatique elle-même.
I. Biseau salé : en période de sécheresse, les rivières s’affaiblissent, la mer remonte les cours d’eau et les remplit de sel, avec de graves répercussions sur les écosystèmes, l’agriculture et les nappes d’eau potable.
II. Tempêtes, souvent de type downburst, fréquemment confondues avec les tornades. Leur intensité et leur fréquence accrues sont un symptôme du nouveau climat. L’Adriatique devient plus chaude : au cours de l’été 2024, elle a atteint plusieurs fois 30°C. Cela augmente l’évaporation et l’humidité dans l’atmosphère. Lorsque des courants plus froids arrivent, leur impact sur l’air chaud et humide libère de grandes quantités d’énergie et provoque de violentes précipitations. C’est ce que les médias italiens appellent les bombe d’acqua (bombes d’eau).
III. Affaissement et érosion des côtes : alors que le sol continue de s’affaisser en raison d’une combinaison de causes naturelles et anthropiques, l’artificialisation des sols et l’impact du tourisme intensif érodent le littoral, qui est de plus en plus vulnérable aux tempêtes de mer et à d’autres événements « extrêmes », qui en réalité sont désormais récurrents et font partie d’une nouvelle « normalité ».
22. Les « infos » sont un problème
Les médias « décomposent » la crise climatique en unités isolées, en épisodes distincts appelés « nouvelles » mais bénéficiant d’une attention et d’un accent inégal. Par exemple, la sécheresse et les bombe d’acqua sont des moments d’un même phénomène, appelé whiplash effect ou effet coup de fouet, mais la première attire moins l’attention que les secondes.
La sécheresse menace notre avenir de manière différée, des reportages lui sont consacrés avec des images de rivières asséchées, mais elle ne crève pas l’écran, surtout en ville, loin des lieux de production de la nourriture et des écosystèmes en souffrance. Tant que l’eau sort du robinet à la maison, le problème n’est pas suffisamment perçu.
Les tempêtes et les inondations, en revanche, nous touchent immédiatement et directement. Leurs effets sont visibles et tangibles, de sorte que leur couverture médiatique met en avant la dimension choquante, émotionnelle, sensationnaliste et généralement déconnectée de la sécheresse. Cette séparation nous empêche de saisir le lien intime entre les deux phénomènes et la totalité du processus.

23. Il ne faut pas défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui
Il n’est pas possible de faire face à ce qui se profile en prolongeant les mêmes logiques du présent. Ces logiques ont engendré la catastrophe, en s’appuyant sur des expédients éphémères et des escamotages technologiques. La crise climatique n’est pas un problème d’inadéquation technologique momentanée : c’est une crise sociale, le résultat d’un modèle socio-économique erroné, l’accumulation des contradictions dans le mode de production actuel.
La logique du raccommodage, du solutionnisme technologique pour défendre l’existant est totalement inadaptée.
La réponse la plus simple et la plus rapide à ce qui se profile sera d’installer des barrages et des vannes mobiles dans le style du MOSE, d’augmenter et de rendre plus puissantes les stations de pompage etc.
Tout cela vise à défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui. Mais « tel qu’il est aujourd’hui » est justement une partie du problème. Ce que nous dit la crise climatique, c’est que le territoire doit être radicalement repensé et transformé.
Une « fédération » de territoires inexprimés serait le sujet le plus qualifié pour une telle refonte, capable de dessiner une ligne d’horizon plausible pour intervenir.
24. L’inconscience
Dans les territoires qui subiront l’avancée de l’Adriatique d’ici 2100, la prise de conscience de la situation va de minime à inexistante. L’inadéquation des connaissances et de la perception face à la catastrophe climatique n’est certainement pas un problème uniquement local : il est planétaire. Mais dans les zones qui nous occupent, il présente des caractéristiques particulières.
25. Quatre mises au point
Nous sommes en train de raisonner et de formuler des hypothèses sur les modes d’intervention, en alternant quatre échelles différentes.
Territoires en marge → Zone nord-adriatique → Delta du Pô → Basso Ferrarese
Le Delta comme lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique (Notes)
26. Quand le Delta était une cause à défendre
Au début des années 1950, une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes de Ferrare et d’ailleurs décida de s’occuper du Delta et d’en faire un enjeu majeur dans le débat national. Ces personnalités firent du Delta leur « question méridionale22 ». En voyageant vers l’est, ils découvrirent leur « Sud », un territoire marginal situé à quelques dizaines de kilomètres de leur ville.
De cette mobilisation culturelle et politique, il demeure d’actualité l’intention de transformer la perception d’un territoire « en marge » en un lieu central d’analyse, de changement et de revanche sociale.
27. Soixante-dix ans plus tard
Soixante-dix ans plus tard, il est à nouveau nécessaire de remettre le delta du Pô au cœur des débats. Les conditions ont changé radicalement et nous en sommes conscients : dans les années 1950, derrière les intellectuels du Delta, il y avaient des partis de gauche, des forces syndicales et d’autres sujets collectifs proches du mouvement ouvrier et de la grande force représentée par la masse des braccianti. Derrière nous, à l’heure actuelle, il n’y a rien de comparable. Mais cela ne peut pas être un alibi.
28. Miser sur les spécificités du territoire : réinonder, naturaliser
Aujourd’hui, contrairement à hier, il ne s’agit certainement pas d’invoquer la bonifica. Au contraire, il faut aller à l’encontre de ce modèle : le territoire bénéficierait grandement — en termes de biodiversité, de capture de CO2, d’inauguration de différents modèles socio-environnementaux — d’un réalignement progressif et d’une renaturalisation contrôlée au moins dans les zones asséchées au cours de la seconde moitié du XXe siècle, comme les valli du Mezzano. Bien entendu, ces terres devraient d’abord devenir propriété publique ; ensuite, leur transformation devrait s’inspirer de la deuxième acception du verbe bonificare : « ramener un territoire fortement pollué à des conditions d’équilibre naturel » (Dictionnaire De Mauro de la langue italienne).
29. Décimenter, restaurer
Il est tout aussi urgent de décimenter le littoral afin d’éviter le scénario décrit au point 19. Dans les zones libérées du béton, les écosystèmes antérieurs devraient être restaurés autant que possible, ce qui signifie libérer les rares dunes qui subsistent de la pression de l’urbanisation et les reconstituer là où elles ont été rasées. C’est l’une des meilleures défenses contre la montée de la mer Adriatique.
Certains demandent : « Qu’en sera-t-il de l’économie des Lidi ? ». On peut leur répondre que les emplois dans le secteur du tourisme intensif — souvent précaires, surexploités, sous-payés, au noir — seront remplacés par de nouveaux emplois moins frustrants, ceux générés par un grand projet de réhabilitation et de réaménagement écologique du territoire, suivis d’un travail permanent d’entretien des écosystèmes : des activités en accord avec les caractéristiques spécifiques de ces lieux.
30. Ce ne sont que quelques exemples
Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont on peut tirer parti des spécificités du territoire, de sa conformation et de son histoire, voire de sa fragilité, pour en faire un formidable lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique, même en termes d’aménagement du territoire.
31. Pas besoin d’escamotages
Cela n’a rien à voir avec le solutionnisme technologique. Ce que nous préfigurons, ce ne sont pas des « coup de génie », mais des solutions ouvertes, lentes, non orientées vers le profit. Surtout, elles partent de l’identification des causes sociales et politiques de la crise et se détournent des modèles suivis jusqu’à présent.

32. Rapports de force
C’est une question de rapports de force. C’est précisément parce qu’ils se heurtent à l’existant que ces scénarios peuvent paraître inacceptables à la grande majorité des administrateurs et, surtout, aux dirigeants de nombreuses associations professionnelles. Il faut cependant rappeler que toutes les réformes sociales, même les plus banales aujourd’hui (école de masse ? retraites ? suffrage universel ?), sont nées de propositions à première vue subversives et utopiques.
33. Prolonger
Ces propositions, calibrées sur la partie émilienne-romagnole du Delta, peuvent être étendues, en les remodelant, à l’ensemble du Delta et à toute la zone nord-adriatique.
Cette façon de formuler les problèmes et de préfigurer des solutions peut être utile à celles et ceux qui agissent dans d’autres territoires en marge et non exprimés, en Italie et ailleurs dans le monde.
34. Faire pleuvoir à l’envers
Par une lutte consciente, les territoires en marge peuvent nous rendre une partie de ce que nous avons perdu : environnement, écologie des relations, durabilité des modes de vie. Dans un monde où tout nous tombe dessus d’en haut, agir dans les territoires en marge signifie la possibilité, pour citer le regretté écrivain, journaliste et activiste Luca Rastello, de faire pleuvoir à l’envers23. Ainsi, par exemple, le monde conçu comme une maison commune conduit à s’opposer à l’exclusion, la connaissance comme forme de participation à l’imposition technocratique, le soin de l’humain et de son environnement à la négligence néolibérale.
35. Un long voyage
Ce document se voudrait le premier étape d’un long parcours, à la fois multidisciplinaire et interstitiel, lancé pour générer des doutes avant même d’apporter des réponses, conscients qu’il n’est pas facile, d’un point de vue émotionnel, d’accepter l’urgence d’un changement aussi délicat qu’inéluctable.
Les modes de vie, les dynamiques de travail et les relations sociales sont destinés à se transformer : les communautés — à commencer par les plus marginales en apparence, qui sont en réalité des avant-postes conflictuels décisifs — doivent alors revendiquent leur centralité dans le processus pour gouverner et orienter l’inévitable changement de paradigme. Elles doivent endosser une responsabilité sociale et culturelle, fondement d’une société qui veut se penser comme « civile ».

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Partie orientale de la province de Ferrare, située dans le territoire du Delta du Pô.
- Mercalli a donné une conférence dans le cadre de la 71e édition de la Fiera di Migliarino, en septembre 2018. On trouve également une référence au « canari d’alarme » dans Canzone della nocività de Paolo Ciarchi et Dario Fo, pour le spectacle Ordine ! Per DIo,ooo.ooo.ooo (1972).
- Les données de l’institut national de la statistique (ISTAT) sur les zones altimétriques, provenant des bureaux provinciaux de l’Agenzia del territorio (sur la base des plans cadastraux), indiquent que les collines et les montagnes occupent respectivement 42% et 35% du territoire, pour un total de 77% (ISTAT, Annuario statistico italiano, 2023, « Territorio », chapitre 1, p. 8).
- Le terme italien bonifica désigne ici l’assèchement des terres marécageuses (bonifica delle paludi), mais il signifie plus largement l’amélioration, la mise en valeur des sols pour les activités humaines (NDLR).
- Federica Letizia Cavallo, Terre, acque, macchine. Geografie della bonifica in Italia tra Ottocento Novecento, Diabasis, 2011.
- Dans le contexte de la plaine orientale du Pô, le terme italien valle (ou valli, au pluriel) ne désigne pas une vallée de montagne mais plutôt une « dépression marécageuse située près du delta d’un fleuve ou d’une lagune » (Grande dizionario della lingua italiana, v. 21, p. 640).
- Piero Brunello, Ribelli, questuanti e banditi: Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866, Cierre edizioni, 2011 [1e éd. 1981].
- Alessandro Roveri, Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel Ferrarese, 1870-1920, La Nuova Italia, 1972.
- Organisme créé sous le contrôle du ministère de l’Agriculture et des Forêts pour mettre en œuvre, dans le territoire du delta du Pô, la loi de 1950 qu’en Italie on appelle traditionnellement de « réforme agraire ».
- Aucune publication monographique sur cet épisode n’existe encore. Voir Giorgio Bassani, « Il litorale emiliano-romagnolo : Problemi e prospettive », Bollettino di Italia Nostra, XII, 75-76, septembre-octobre 1970, Associazione Italia Nostra, Rome, p. 27-29. Republié dans Giorgio Bassani, Italia da salvare. Gli anni della Presidenza di Italia nostra (1965-1980), Feltrinelli, 2018; Piero Dagradi et Bruno Menegatti, Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell’Emilia Romagna, Pàtron, 1979.
- Données issues de : R. J. M. Temmink, L. P. M. Lamers, C. Angelini, T. J. Bouma, C. Fritz, J. Van De Koppel, R. Lexmond, M. Rietkerk, B. R. Silliman, H. Joosten et T. Van Der Heide, « Recovering wetland biogeomorphic feedbacks to restore the world’s biotic carbon hotspots », Science, 376(6593), eabn1479, 2022.
- Les valli se distinguaient par la qualité de leurs eaux : dans les dolci (douces), on cultivait le roseau ; dans les salse (salées, plutôt saumâtres et légèrement salées), on pratiquait la pisciculture.
- Marco Armiero, Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets, Lux Éditeur, 2024 (traduit depuis l’édition anglaise de 2021).
- Matthew Taylor et Pamela Duncan, « Revealed : almost everyone in Europe is breathing toxic air », The Guardian, 20 septembre 2023. « Eastern Europe is significantly worse than western Europe, apart from Italy, where more than a third of those living in the Po valley and surrounding areas in the north of the country breath air that is four times the WHO figure for the most dangerous airborne particulates ».
- Selon le rapport 2023 de l’Agence européenne pour l’environnement, environ 46 800 décès causés par les particules PM2,5 ont été enregistrés en Italie en 2021, dont 14 000 dans la seule plaine du Pô (89 pour cent mille habitants).
- La plaine du Pô s’étend précisément à l’intérieur des frontières administratives des quatre régions italiennes — la Lombardie, la Vénétie, le Piémont et l’Émilie-Romagne — les plus bétonnées d’après les rapports annuels de l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sur l’artificialisation des sols.
- Eugenio Turri, Semiologia del paesaggio italiano (1e éd), Marsilio, 2014. Voir aussi son article dans l’ouvrage collectif Mimmo Jodice et Eugenio Turri (dir.), Gli iconemi. Storia e memoria del paesaggio, Electa, 2001.
- Carlo Cencini, « Il litorale ferrarese : dai Lidi al Parco del Delta », in Forme del territorio e modelli culturali in Emilia-Romagna : per una nuova geografia regionale, Lo Scarabeo, 1994.
- Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, FYP Éditions, Limoges, 2014.
- F. Antonioli et al., « Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains : Flooding risk scenarios for 2100 », Quaternary Science Reviews, 158, 2017, p. 29-43.
- Il convient de rappeler que 44 % de la province de Ferrare se trouve en dessous du niveau de la mer.
- Voir la notice Wikipédia pour une présentation générale de la place de la question méridionale dans l’histoire italienne.
- Luca Rastello, Piove all’insù, Bollati Boringheri, 2017.
L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.
16.07.2025 à 16:41
La montée du fascisme de la fin des temps
Naomi Klein · Astra Taylor
L'idéologie dominante de l'extrême droite est devenue un survivalisme monstrueux, destructeur et suprématiste, expliquent Naomi Klein et Astra Taylor dans un article récent devenu incontournable, dont Terrestres publie la traduction en français. Elles appellent à construire un mouvement suffisamment fort pour l'arrêter.
L’article La montée du fascisme de la fin des temps est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (10347 mots)
Temps de lecture : 26 minutes
Traduction réalisée par Nicolas Haeringer de « The rise of end times fascism », un article de Naomi Klein et Astra Taylor paru dans The Guardian le 13 avril 2025.
La mouvance des cités-États privées n’en croit pas ses yeux1. Pendant des années, elle a défendu l’idée radicale que les ultra-riches, rétifs à l’impôt, devraient créer leurs propres fiefs high-techs – qu’il s’agisse de pays entièrement nouveaux sur des îles artificielles dans les eaux internationales (des « implantation maritimes ») ou de « villes libres » dédiées aux affaires, telles que Próspera, une communauté fermée adossée à un spa de l’ouest sauvage sur une île du Honduras2.
Pour autant, en dépit du soutien de figures majeures du capital-risque telles que Peter Thiel et Marc Andreessen, leurs rêves libertariens radicaux ne cessaient de s’enliser : il semble que la plupart des riches qui ont un peu d’estime d’eux-mêmes ne souhaitent en réalité pas vivre sur des plateformes pétrolières flottantes, même s’ils y paieraient moins d’impôts. Quand bien même Próspera serait un lieu de villégiature agréable, propice à des « améliorations » physiques3, son statut extra-national est actuellement contesté devant les tribunaux.
Ce réseau autrefois marginal se retrouve aujourd’hui brusquement à frapper à des portes grandes ouvertes, au cœur même du pouvoir mondial.
Le premier signe que la chance tournait remonte à 2023, quand Donald Trump, alors en pleine campagne, sortait de son chapeau l’idée d’organiser une compétition, qui déboucherait sur la création de dix « villes libres » sur des terres fédérales. À l’époque, ce ballon d’essai est passé inaperçu, noyé dans le déluge quotidien de déclarations outrancières. Mais depuis que le nouveau gouvernement a pris ses fonctions, ceux qui aspirent à créer de toutes pièces de nouveaux pays mènent une campagne de lobbying intense, déterminés à ce que l’engagement de Trump devienne réalité.
« À Washington, l’ambiance est vraiment électrique », s’est récemment enthousiasmé Trey Goff, le secrétaire général de Próspera, après s’être rendu au Capitole. La législation ouvrant la voie à de nombreuses cités-États privées devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, affirmait-il alors.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Inspirés par leur lecture tronquée du philosophe politique Albert Hirschman, des personnalités comme Goff, Thiel et l’investisseur et essayiste Balaji Srinivasan promeuvent ce qu’ils appellent « l’exit » – soit le principe selon lequel ceux qui peuvent se le permettre auraient le droit de se soustraire aux obligations de la citoyenneté, en particulier aux impôts et aux réglementations contraignantes. En remodelant et renouvelant les vieilles ambitions et les anciens privilèges des empires, ils rêvent de briser les gouvernements et de diviser le monde en havres hyper-capitalistes. Ceux-ci seraient dépourvus de démocratie, sous le contrôle exclusif des ultra-riches, protégés par des mercenaires privés, servis par des robots intelligents et financés par les cryptomonnaies.
On pourrait penser qu’il y une contradiction à ce que Trump, élu sur son programme-étendard « l’Amérique d’abord », accorde du crédit à cette vision de territoires souverains dirigés par des milliardaires rois divins. De fait, on a beaucoup parlé des luttes de pouvoir que mènent Steve Bannon, porte-parole du courant MAGA [Make America Great Again, ndt], fier populiste patriote, contre les milliardaires ralliés à Trump qu’il traite de « technoféodalistes » qui « n’ont rien à foutre de l’être humain » – et encore moins de l’État-nation. De fait, les conflits au sein de la coalition bancale et bizarroïde montée par Trump sont à l’évidence légion, et ont récemment culminé à propos des droits de douane4. Pourtant, les visions sous-jacentes ne sont pas forcément aussi incompatibles qu’elles n’en ont l’air.
Pour le dire crûment, les personnes les plus puissantes au monde se préparent pour la fin du monde, une fin dont elles accélèrent frénétiquement l’arrivée.
Le contingent des « aspirants créateurs de pays » envisage très clairement un avenir défini par les chocs, les pénuries et l’effondrement. Leurs domaines privés, ultra-modernes, ne sont rien d’autre que des capsules de sauvetage fortifiées, conçues pour qu’une petite élite puisse profiter de tout le luxe imaginable, et bénéficie de chaque opportunité d’optimisation humaine susceptible de leur offrir, ainsi qu’à leurs enfants, un avantage décisif dans un avenir de plus en plus barbare. Pour le dire crûment, les personnes les plus puissantes au monde se préparent pour la fin du monde, une fin dont elles accélèrent frénétiquement l’arrivée.
En soi, ce n’est guère différent de la vision, plus orientée vers les masses, de « nations forteresses », qui définit la droite dure partout dans le monde, de l’Italie à Israël en passant par l’Australie et les États-Unis. À l’ère des périls permanents, les mouvements ouvertement suprémacistes de ces pays veulent transformer ces États relativement prospères en bunkers armés. Des bunkers dont ils sont déterminés à brutalement expulser et emprisonner les êtres humains indésirables (même si cela passe par un confinement à durée indéterminée dans des colonies pénitentiaires extra-nationales, à l’instar de l’île de Manus5 ou de Guantánamo). Leurs promoteurs sont également sans pitié dans leur volonté de s’accaparer violemment les terres et les ressources (eau, énergie, minerais critiques) qu’ils estiment indispensables pour absorber les chocs à venir.

Au moment où les élites de la Silicon Valley, autrefois laïques, découvrent Jésus, il est remarquable que ces deux visions – l’État-privé à pass-priorité et la nation-bunker à marché de masse – partagent tant avec l’interprétation fondamentaliste Chrétienne de l’Enlèvement biblique, soit le moment où les fidèles sont censés être élevés au paradis, vers une cité dorée, tandis que les damnés seront abandonnés ici-bas, pour endurer la bataille apocalyptique finale.
Si nous voulons être à la hauteur de ce moment critique de l’histoire, nous devons admettre que nous ne faisons pas face à des adversaires similaires à ceux que nous connaissons. Nous faisons face au fascisme de la fin des temps.
Revenant sur son enfance sous Mussolini, le romancier et philosophe Umberto Eco notait dans un article célèbre que le fascisme souffre généralement d’un « complexe d’Armageddon » : une obsession à anéantir ses ennemis lors d’une grande bataille finale. Mais le fascisme européen des années 1930 et 1940 avait aussi un horizon : la vision d’un âge d’or à venir, après le bain de sang. Un âge qui, pour ses partisans, serait pacifique, champêtre et pur. Ce n’est plus le cas.
Si nous voulons être à la hauteur de ce moment critique de l’histoire, nous devons admettre que nous ne faisons pas face à des adversaires similaires à ceux que nous connaissons. Nous faisons face au fascisme de la fin des temps.
Conscients que notre époque est marquée par des risques existentiels réels – de la catastrophe climatique à la guerre nucléaire, en passant par l’explosion des inégalités et l’IA déréglementée – mais impliqués financièrement et idéologiquement dans l’aggravation de ces menaces, les mouvements d’extrême droite contemporains n’ont aucune vision crédible d’un avenir prometteur. L’électeur moyen ne se voit offrir que les réminiscences d’un passé révolu, aux côtés du plaisir sadique de la domination sur un ensemble toujours plus vaste de semblables déshumanisés.

C’est simple : sans votre soutien, Terrestres ne pourrait pas exister et vous ne pourriez pas lire cet article. Si vous le pouvez, par un don mensuel ou ponctuel, même pour quelques euros, vous nous permettez de poursuivre notre travail en toute indépendance. Merci
!
Ainsi de l’administration Trump, qui se voue à diffuser son flux ininterrompu de propagande (réelle ou générée par IA), dans le seul but de diffuser ces contenus obscènes. Les images de migrants pieds et poings liés embarqués dans des avions pour être expulsés, avec en fond sonore les bruits de chaînes et de menottes qui s’entrechoquent sont présentées par le compte X officiel de la Maison Blanche comme de l’« ASMR », soit un son conçu pour calmer le système nerveux. Ce même compte rapportait la détention de Mahmoud Khalil, un résident permanent américain impliqué dans le campement pro-palestinien de l’Université Columbia, avec ce commentaire extatique : « SHALOM, MAHMOUD ». Ou encore les nombreuses séances photos sadiques-chics de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, qui pose tour à tour sur un cheval à la frontière américano-mexicaine, devant une cellule de prison bondée au Salvador ou brandissant une mitraillette lors de l’arrestation d’immigrants en Arizona.
De Naomi Klein, vous pouvez lire aussi dans Terrestres l’article « La stratégie du choc du capitalisme numérique », paru en mai 2020.
Dans une époque où les catastrophes se multiplient, l’idéologie dominante de l’extrême droite a pris la forme d’un survivalisme monstrueux et suprémaciste.
Certes, ce constat est terrifiant par sa dureté. Mais il permet de dégager de puissantes perspectives pour la résistance. Parier à ce point-là contre l’avenir – tout miser sur le bunker – implique ni plus ni moins que de trahir nos devoirs envers les autres, envers les enfants que nous aimons, envers toute autre forme de vie avec laquelle nous avons la planète en partage. Ce système de croyance est intrinsèquement génocidaire, et il trahit les beautés et merveilles de ce monde. Nous sommes convaincues que plus les gens comprendront à quel point la droite a succombé à ce complexe d’Armageddon, plus ils et elles prendront conscience que tout est désormais remis en cause, et plus ils et elles seront prêt·es à résister.
Nos adversaires savent parfaitement que nous entrons dans une ère d’urgence, mais ils y répondent en optant pour des illusions aussi mortelles qu’égocentriques. Séduits par l’illusoire sécurité d’un apartheid bunkérisé, ils choisissent de laisser la Terre brûler. Notre tâche est donc de construire un mouvement aussi large que profond, aussi spirituel que politique, qui soit suffisamment puissant pour stopper ces traîtres irrationnels. Un mouvement enchâssé dans une indéfectible solidarité les unes envers les autres, au-delà de nos nombreuses différences et divergences, et envers cette planète aussi miraculeuse que singulière.
Nos adversaires savent parfaitement que nous entrons dans une ère d’urgence, mais ils choisissent de laisser la Terre brûler.
Il y a peu, seuls les fondamentalistes religieux saluaient avec enthousiasme les signes avant-coureurs de l’apocalypse, qui annonçaient l’Enlèvement tant attendu. Trump a désormais confié des rôles décisifs à des personnes qui adhèrent à cette orthodoxie, en particulier à plusieurs Chrétiens sionistes qui considèrent le recours à la violence annihilatrice par Israël pour étendre son emprise territoriale non pas comme une atrocité illégale, mais comme une preuve bienvenue que la Terre Sainte se rapproche des conditions propices au retour du Messie et à l’accession des fidèles au royaume céleste.
Mike Huckabee, le nouvel ambassadeur de Trump en Israël, est étroitement lié au sionisme chrétien, tout comme Pete Hegseth, son ministre de la Défense. Noem et Russell Vought, les architectes du Projet 20256 qui dirigent désormais l’organisme chargé de gérer les ministères et de préparer le budget, sont tous deux de fervents défenseurs du nationalisme chrétien. Même Peter Thiel, homosexuel et connu pour être un bon vivant, a récemment été entendu en train de spéculer sur l’arrivée de l’Antéchrist (spoiler : il pense qu’il s’agit de Greta Thunberg, nous y reviendrons plus bas).

Pas besoin de prendre la Bible à la lettre, ni même d’être croyant, pour être un fasciste de la fin des temps. De nombreuses personnes non-croyantes ont désormais adopté la vision d’un avenir qui se déroule de manière à peu près identique : un monde qui s’effondre sous son propre poids, où une poignée d’élus survit puis prospère dans diverses arches, bunkers et « communautés libres » fermées. Dans leur article de 2019 intitulé « Left Behind : Future Fetishists, Prepping and the Abandonment of Earth », les spécialistes des sciences de la communication Sarah T. Roberts et Mél Hogan décrivaient l’attirance pour un Enlèvement séculier : « Dans l’imaginaire accélérationniste, l’avenir ne se définit pas par la réduction des risques, les limites ou la réparation ; il s’agit au contraire d’une politique qui nous mène tout droit vers un affrontement final ».
De nombreuses personnes non-croyantes ont adopté la vision d’un monde qui s’effondre, où une poignée d’élus survit puis prospère dans diverses arches, bunkers et « communautés libres » fermées.
Elon Musk, dont la fortune s’est considérablement accrue aux côtés de Thiel à PayPal, incarne cet ethos de l’implosion. Nous avons affaire à quelqu’un qui, lorsqu’il regarde les merveilles du ciel étoilé, n’y décèle que des opportunités de remplir ce monde inconnu avec ses propres poubelles spatiales. Bien qu’il ait redoré sa réputation en alertant sur les dangers de la crise climatique et de l’intelligence artificielle, lui et ses sbires du soi-disant « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE), passent dorénavant leur temps à aggraver ces mêmes risques (et de nombreux autres) en sapant toutes les réglementations environnementales et en taillant dans l’ensemble des agences de régulation dans le but apparent de remplacer les fonctionnaires fédéraux par des chatbots.
Qui a besoin d’un État-nation opérationnel quand l’espace – apparemment l’obsession première d’Elon Musk – nous appelle ? Mars est devenu son arche laïque, qu’il estime être essentielle pour la survie de la civilisation humaine, par exemple grâce au transfert de la conscience vers une intelligence artificielle globale. Kim Stanley Robinson, l’auteur de la série de science-fiction La Trilogie de Mars, qui aurait pour partie inspiré Musk, ne mâche pas ses mots quant aux dangers des fantasmes du milliardaire sur la colonisation de Mars. Il s’agit, dit-il, « tout simplement d’un danger moral qui crée l’illusion que nous pouvons détruire la Terre mais nous en sortir quand-même. C’est totalement faux. »
À l’instar des croyants millénaristes qui espèrent échapper au monde physique, l’ambition de Musk de faire advenir une humanité « multiplanétaire » n’est possible qu’en raison de son incapacité à apprécier la splendeur multispécifique de notre unique maison. À l’évidence indifférent aux extraordinaires richesses qui l’entourent, ainsi qu’à la préservation d’une Terre bouillonnante de diversité, il utilise son immense fortune pour construire un futur dans lequel une poignée d’humains et de robots survivraient péniblement sur deux planètes arides – la Terre radicalement appauvrie et Mars terraformée. De fait, dans un étrange détournement du message de l’Ancien Testament, Musk et ses copains milliardaires de la tech, dotés de pouvoirs quasi divins, ne se contentent pas de construire les arches. Ils font à l’évidence de leur mieux pour provoquer le déluge. Les leaders de la droite contemporaine et leurs riches alliés ne se contentent pas de tirer profit des catastrophes, dans la lignée de la stratégie du choc et du capitalisme du désastre. Ils les provoquent et les planifient d’un même mouvement.
Les leaders de la droite contemporaine et leurs riches alliés ne se contentent pas de tirer profit des catastrophes, dans la lignée de la stratégie du choc et du capitalisme du désastre. Ils les provoquent et les planifient d’un même mouvement.
Qu’en est-il néanmoins de la base électorale du mouvement trumpiste MAGA ? Ils et elles ne sont pas tous·tes suffisamment croyant·es pour être honnêtement convaincu·es par l’idée de l’Enlèvement, et n’ont pour l’essentiel évidemment pas les moyens de s’offrir une place dans l’une des « villes libres », encore moins dans une fusée. Pas d’inquiétude ! Le fascisme de la fin des temps offre la promesse de nombreuses arches et de nombreux bunkers plus accessibles, largement à portée des petits soldats.
Écoutez le podcast quotidien de Steve Bannon – qui se présente comme le média privilégié du MAGA – et vous serez gavé·e d’un unique message : le monde devient un enfer, les infidèles détruisent les barricades et l’affrontement final approche. Soyez prêts. Le message prepper/survivaliste devient particulièrement explicite lorsque Bannon se met à faire la pub des produits de ses partenaires. Achetez du Birch Gold, dit Bannon à son auditoire, car l’économie américaine, surendettée, va s’effondrer et que vous ne pouvez pas faire confiance aux banques. Faites le plein de plats préparés chez My Patriot Supply (« Mon Épicerie Patriote »). Ne manquez plus votre cible en vous entraînant à tirer chez vous, grâce à ce système de guidage laser. En cas de catastrophe, rappelle-t-il, la dernière chose que vous voulez est de dépendre du gouvernement – sous-entendu : surtout maintenant que les « DOGE boys » le démantèlent pour le vendre à la découpe.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enracinement identitaire ou attachements terrestres ? » de Clara Damiron, novembre 2022.
Bien sûr, Bannon ne se contente pas d’inciter son public à construire ses propres bunkers. Il défend en même temps une vision des États-Unis comme un bunker à part entière, dans lequel les agents de l’ICE [Immigration and Customs Enforcement] rôdent en ville, dans les entreprises et sur les campus, faisant disparaître toute personne considérée comme ennemie de la politique et des intérêts états-uniens. La nation bunkerisée constitue le cœur du programme MAGA et du fascisme de la fin des temps. Dans cette logique, la première chose à faire est de renforcer les frontières nationales et d’éliminer tous les ennemis, étrangers comme nationaux. Ce sale travail est désormais bien engagé, le gouvernement Trump ayant, avec l’aval de la Cour suprême, invoqué l’Alien Enemies Act pour expulser des centaines de migrants vénézuéliens vers Cecot, la tristement célèbre méga-prison située au Salvador. L’établissement, dans lequel les prisonniers sont rasés de près et où s’entassent jusqu’à 100 personnes dans une cellule remplie d’austères lits de camp, opère en vertu d’un « état d’exception » destructeur des libertés fondamentales, promulgué pour la première fois il y a plus de trois ans par Nayib Bukele, le premier ministre chrétien sioniste fan de cryptomonnaies.
La nation bunkerisée constitue le cœur du programme MAGA et du fascisme de la fin des temps.
Bukele a proposé d’appliquer le même système de tarification à l’acte aux citoyens états-uniens que le gouvernement aimerait plonger dans un trou noir judiciaire. Interrogé à ce propos, Trump a récemment répondu : « J’adore ça ». Rien d’étonnant à cela : [la prison de haute sécurité] Cecot7 est le revers maléfique, mais évident, du fantasme de la « ville de la liberté » – un lieu où tout est à vendre et où aucune procédure régulière n’a droit de cité. Nous devrions nous préparer à un surcroît de sadisme de ce genre. Dans une déclaration terrifiante de franchise, le directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, a déclaré lors de la Border Security Expo 2025 qu’il aimerait voir advenir une approche plus « marchande » de ces expulsions : « Comme Amazon Prime, mais avec des êtres humains ».
La surveillance policière des frontières de la nation bunkerisée est la fonction première du fascisme de la fin des temps. Mais la seconde n’est pas moins importante : le gouvernement états-unien doit s’accaparer toutes les ressources dont ses citoyens ainsi protégés pourraient avoir besoin pour faire face aux épreuves à venir. Il peut s’agir du canal de Panama. Ou les routes maritimes du Groenland, dont la banquise fond à toute vitesse. Ou les minerais essentiels de l’Ukraine. Ou l’eau douce du Canada. Nous ne devrions pas tant l’envisager comme une forme éculée d’impérialisme, que comme une méga-anticipation de type survivaliste (super-sized prepping) à l’échelle d’un État-nation. Oubliées les vieilles lubies coloniales consistant à apporter la démocratie ou la parole de Dieu – quand Trump observe le monde avec convoitise, il entend accumuler des réserves en vue de l’effondrement de la civilisation.

L’état d’esprit bunkerisé explique aussi les incursions controversées de J.D. Vance dans la théologie catholique. Le vice-président, dont la carrière politique doit beaucoup à la générosité du survivaliste en chef Peter Thiel, a raconté sur Fox News que, selon le concept chrétien médiéval de l’ordo amoris (qui se traduit à la fois par « ordre de l’amour » et « ordre de la charité »), l’amour n’est pas dû à ceux qui survivent à l’extérieur du bunker : « On aime sa famille, puis on aime son voisin, puis on aime sa communauté, puis les concitoyens de son propre pays. Et après cela, on peut se concentrer et donner la priorité au reste du monde. » (Ou pas, comme tend à le montrer la politique étrangère du gouvernement Trump.) Pour le dire autrement : en dehors du bunker, nous ne devons rien à qui que ce soit.
Bien que ce courant s’appuie sur des courants anciens de l’aile droite – justifier l’exclusion par la haine n’est pas vraiment nouveau sous le soleil ethno-nationaliste – nous n’avons encore jamais fait face à une tendance apocalyptique au plus haut d’un gouvernement. Les grands discours sur la « fin de l’histoire » de l’après guerre froide sont rapidement remplacés par la certitude que nous faisons vraiment face à la fin des temps. Même si le DOGE se drape d’un argument d’efficacité économique, et même si les sbires d’Elon Musk rappellent les jeunes « Chicago boys » formés aux États-Unis qui ont conçu la stratégie du choc pour la dictature d’Augusto Pinochet, il ne s’agit plus de la vieille alliance entre néolibéralisme et néoconservatisme. Il s’agit d’un nouveau fourre-tout millénariste vénérant l’argent, qui affirme qu’il faut détruire la bureaucratie et remplacer les humains par des robots afin de réduire « le gaspillage, la fraude et les abus » – et aussi parce que la fonction publique est le dernier refuge des démons qui résistent à Trump. C’est là que les « tech bros » fusionnent avec les « TheoBros », un véritable groupe de suprémacistes chrétiens hyper-patriarcaux ayant des liens avec Pete Hegseth et d’autres membres du gouvernement Trump.
Quand Trump observe le monde avec convoitise, il entend accumuler des réserves en vue de l’effondrement de la civilisation.
Comme toujours avec le fascisme, le fantasme apocalyptique contemporain transcende les clivages de classe, et unit les milliardaires à la base MAGA. Grâce à des décennies de tensions économiques croissantes renforcées par les discours bien orchestrés opposant les travailleurs entre eux, nombreux sont ceux qui ressentent, à juste titre, qu’ils n’ont plus les moyens de se protéger contre la désintégration qui les entoure – peu importe le nombre de repas préparés qu’ils stockent. Mais on leur offre des compensations affectives : ils peuvent ainsi se réjouir de la fin des politiques dites DEI (diversité, équité et inclusion) en soutien à l’égalité des chances, s’enflammer pour les expulsions de masse, saluer le refus de soins d’affirmation de genre, conspuer les enseignant·es et les soignant·es qui prétendent en savoir plus qu’eux ou applaudir la déréglementation économique et écologique comme une manière de prendre une revanche sur les gauchistes [the libs, littéralement « les libéraux »]. Le fascisme de la fin du monde est un fatalisme sinistrement festif — le dernier refuge de ceux qui préfèrent célébrer la destruction plutôt qu’imaginer un monde sans suprématie.
C’est aussi une spirale infernale qui s’auto-entretient : les attaques féroces de Trump contre chacune des structures censées protéger le public – des maladies, des aliments néfastes ou des catastrophes – ou même simplement l’alerter lorsqu’un danger approche, ne font que renforcer la légitimité du survivalisme, aussi bien chez les élites que parmi les classes populaires, tout en ouvrant de multiples nouvelles opportunités de privatisation et de profits pour les oligarques qui alimentent et propagent le démantèlement de l’État social et régulateur.
Au début du premier mandat de Trump, The New Yorker enquêtait sur un phénomène qu’il qualifiait de « survivalisme apocalyptique pour ultra-riches ». Il était déjà clair à l’époque que, dans la Silicon Valley et à Wall Street, les survivalistes les plus sérieux parmi l’élite se préparaient aux bouleversements climatiques et à l’effondrement social en achetant de l’espace dans des bunkers souterrains sur mesure, ou en construisant des résidences de secours en altitude, dans des lieux comme Hawaï (où Mark Zuckerberg présente son abri souterrain de 1500 m2 comme un simple « petit refuge ») ou en Nouvelle-Zélande (où Peter Thiel a acquis près de 200 hectares, mais a vu son projet de complexe survivaliste de luxe rejeté en 2022 par les autorités locales, car trop disgracieux).
Ce millénarisme s’entremêle à un ensemble d’obsessions intellectuelles propres à la Silicon Valley, nourries par une vision eschatologique selon laquelle notre planète fonce droit vers un cataclysme, et qu’il serait donc temps de faire des choix difficiles quant aux parties de l’humanité qui pourront être sauvées. Le transhumanisme est l’une de ces idéologies, qui englobe aussi bien de petites « améliorations » humain-machine que la quête du transfert de l’intelligence humaine dans une intelligence artificielle générale chimérique. On y trouve aussi l’« altruisme efficace » et le « long-termisme », deux courants qui ignorent les politiques de redistribution pour venir en aide aux plus démunis ici et maintenant pour leur substituer une approche coûts-bénéfices visant à faire le « bien » à très long terme.
Le fascisme de la fin du monde est un fatalisme sinistrement festif – le dernier refuge de ceux qui préfèrent célébrer la destruction plutôt qu’imaginer un monde sans suprématie.
Bien qu’elles semblent de prime abord anodines, ces idées sont irrémédiablement imprégnées d’inquiétants biais raciaux, validistes et sexistes quant aux parties de l’humanité qui mériteraient d’être améliorées et sauvées, et celles qui pourraient au contraire être sacrifiées au nom d’un prétendu bien commun. Elles ont également en commun un désintérêt marqué pour la nécessité urgente de s’attaquer aux causes profondes de l’effondrement – un objectif pourtant responsable et rationnel, que nombre de personnalités influentes rejettent désormais ouvertement. À la place de l’« altruisme efficace », Marc Andreessen, un habitué de Mar-a-Lago, et d’autres, prônent désormais « l’accélérationnisme efficace » soit « la propulsion délibérée du développement technologique » sans aucun garde-fou.
En attendant, des philosophies encore plus sombres trouvent un écho grandissant. Parmi celles-ci, les élucubrations néoréactionnaires et monarchistes du programmeur Curtis Yarvin (une autre référence intellectuelle majeure pour Peter Thiel), l’obsession du mouvement pro-nataliste pour l’augmentation drastique du nombre de bébés « occidentaux » (une des marottes d’Elon Musk), ou encore la vision du « gourou de l’exit » Balaji Srinivasan : un San Francisco techno-sioniste, où les entreprises et la police s’allieraient pour épurer politiquement la ville de ses libéraux et faire place à un État d’apartheid en réseau.
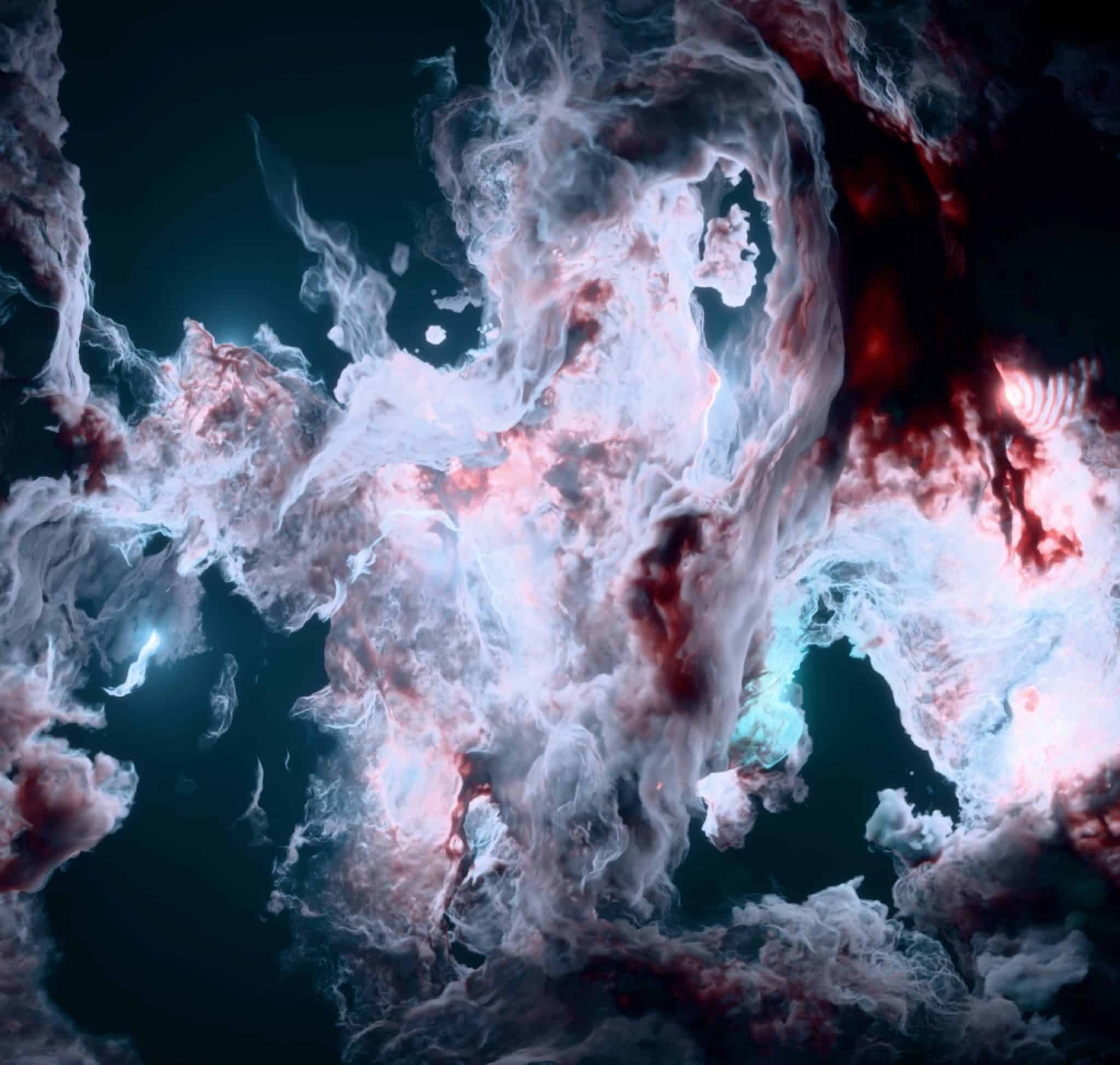
Comme l’ont écrit les spécialistes de l’Intelligence Artificielle Timnit Gebru et Émile P. Torres, bien que les méthodes soient nouvelles, ce « paquet » de lubies idéologiques « descend directement de la première vague de l’eugénisme », qui voyait déjà une élite restreinte décider de quelles parties de l’humanité méritaient d’être préservées, et lesquelles devaient être éliminées, écartées ou abandonnées. Jusqu’à récemment, peu de gens y prêtaient attention. À l’image de Próspera – où l’on peut déjà expérimenter des fusions humain-machine, comme implanter la clé de sa Tesla dans sa main – ces courants de pensée semblaient n’être que les lubies marginales de quelques dilettantes fortunés de la baie de San Francisco prompts à brûler leur argent et leur sagesse. Ce n’est plus le cas.
Ces lubies idéologiques « descendent directement de la première vague de l’eugénisme », qui voyait déjà une élite restreinte décider de quelles parties de l’humanité méritaient d’être préservées, et lesquelles devaient être éliminées, écartées ou abandonnées.
Trois changements matériels sont venus renforcer l’attraction apocalyptique du fascisme de fin des temps. Le premier est la crise climatique. Si certaines personnalités en vue persistent à nier ou minimiser la menace, les élites mondiales, dont les propriétés en bord de mer et les centres de données sont directement menacés par la montée des eaux et la hausse des températures, connaissent parfaitement les risques en cascade d’un monde en surchauffe. Le second est le Covid19. Les modèles épidémiologiques prédisaient depuis longtemps la possibilité d’un choc sanitaire planétaire dévastateur dans notre monde en réseau. Son avènement a été interprété par de nombreux puissants comme un signal : nous sommes officiellement entrés dans « l’Ère des Conséquences », pour reprendre la terminologie des analystes militaires états-uniens. Le temps des prédictions est derrière nous : l’effondrement est en cours. Le troisième changement est le développement fulgurant de l’intelligence artificielle. L’IA a longtemps été associée à des cauchemars de science-fiction et de machines qui se retournent contre leurs créateurs avec une efficacité brutale — des peurs qu’expriment, non sans ironie, ceux-là mêmes qui conçoivent ces outils. Ces crises existentielles se superposent aux tensions croissantes entre puissances nucléaires.
Rien de cela ne peut être relégué au rang d’un délire paranoïaque. Nous sommes nombreux·ses à ressentir au plus profond de nous l’imminence de l’effondrement avec une telle acuité que nous faisons face en nous plongeant dans des histoires de bunkers post-apocalyptiques, via des séries telles que Silo sur Apple TV ou Paradise sur Hulu. Comme le rappelle l’analyste et éditorialiste britannique Richard Seymour dans son dernier ouvrage, Disaster Nationalism : « L’apocalypse n’a rien d’une simple fantaisie. Après tout, nous vivons déjà dedans, entre les virus meurtriers et l’érosion des sols, la crise économique et le chaos géopolitique. »
Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Économie numérique : la mue du capitalisme contemporain » d’Hélène Torjman, mai 2021.
Le projet économique de Trump 2.0 est un monstre à la Frankenstein, assemblé à partir des industries qui alimentent toutes ces menaces : les combustibles fossiles, l’armement, les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle insatiables en ressources énergétiques. L’ensemble des acteurs de ces secteurs savent pertinemment qu’il est impossible de construire le monde-miroir artificiel promis par l’IA sans sacrifier le monde réel : ces technologies consomment bien trop d’énergie, trop de minéraux critiques et trop d’eau pour pouvoir coexister avec la planète dans un équilibre un tant soit peu viable. En avril dernier, l’ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, a reconnu devant le Congrès que les besoins énergétiques « considérables » de l’IA devraient tripler dans les prochaines années et qu’ils seraient majoritairement comblés par les énergies fossiles, le nucléaire ne pouvant être déployé assez rapidement. Ce niveau de consommation, qui revient à incinérer la planète, serait à ses yeux indispensable pour permettre l’émergence d’une intelligence « supérieure » à l’humanité — une divinité numérique surgissant des cendres d’un monde abandonné.
Le projet économique de Trump 2.0 est un monstre à la Frankenstein, assemblé à partir des industries qui alimentent toutes ces menaces : les combustibles fossiles, l’armement, les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle insatiables en ressources énergétiques.
Et ils sont inquiets — mais pas des menaces qu’ils déchaînent. Ce qui empêche les dirigeants de ces industries imbriquées les unes aux autres de dormir, c’est la possibilité d’un sursaut civilisationnel, c’est-à-dire la possibilité que les efforts coordonnés des gouvernements parviennent enfin à freiner leurs activités prédatrices avant qu’il ne soit trop tard. Car pour eux, l’apocalypse ce n’est pas l’effondrement : c’est la régulation.
Le fait que leurs profits reposent sur la destruction de la planète permet de comprendre pourquoi les discours bienveillants sont en reflux dans les sphères du pouvoir, au profit d’un mépris de plus en plus assumé pour l’idée même que nous sommes liés par des liens réciproques pour la simple raison que nous partageons une humanité commune. La Silicon Valley en a fini avec l’altruisme, qu’il soit « efficace » ou non. Mark Zuckerberg rêve d’une culture qui valorise « l’agressivité ». Alex Karp, un associé de Peter Thiel à la tête de la société de surveillance Palantir Technologies, fustige l’« auto-flagellation perdante » de ceux et celles qui remettent en question la supériorité américaine ou les mérites des armes autonomes (et donc les juteux contrats militaires qui ont fait sa fortune). Elon Musk explique à Joe Rogan que l’empathie est « la faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale » ; et, après avoir échoué à acheter une élection pour la Cour suprême du Wisconsin, râle au motif qu’« il devient de plus en plus évident que l’humanité n’est qu’un support biologique (biological bootloader) pour la super-intelligence numérique. » Autrement dit, nous, humains, ne sommes rien de plus que du grain à moudre pour Grok, son IA. (Il nous avait prévenus : il est « dark Maga ». Et il est loin d’être le seul.)

Dans une Espagne asséchée, accablée par le stress climatique, un des collectifs appelant à un moratoire sur les nouveaux data-centrer de données est baptisé Tu Nube Seca Mi Río – en français : « ton nuage assèche mon fleuve ». Ce constat ne vaut pas que pour l’Espagne.
Un choix indicible et sinistre est en train d’être fait sous nos yeux et sans notre consentement : les machines plutôt que les humains, l’inanimé plutôt que le vivant, le profit avant tout le reste. Les mégalomanes de la tech ont discrètement renié leurs engagements vers la neutralité carbone à une vitesse effarante, pour se ranger derrière Trump, prêts à sacrifier les ressources et la créativité réelles et précieuses de ce monde sur l’autel d’un royaume virtuel et vorace. C’est le dernier grand pillage — et ils se préparent à affronter les tempêtes qu’ils convoquent eux-mêmes. Et ils tenteront de calomnier et de détruire quiconque se mettra en travers de leur route.
Le fait que leurs profits reposent sur la destruction de la planète permet de comprendre pourquoi les discours bienveillants sont en reflux dans les sphères du pouvoir.
La récente tournée européenne de J.D. Vance en est un bon exemple : le vice-président a tancé les dirigeants mondiaux pour leur prétendue « inquiétude excessive » face aux dangers de l’IA destructrice d’emplois, tout en demandant que les discours néonazis et fascistes ne soient plus censurés sur Internet. Il a tenté une remarque censément drôle – mais qui a laissé le public de marbre : « la démocratie américaine a survécu à dix ans de remontrances de Greta Thunberg, vous pouvez donc bien supporter Elon Musk quelques mois. »
Son propos rappelle ceux de son mécène tout aussi dénué d’humour, Peter Thiel. Dans des entretiens récents portant sur les fondements théologiques de son idéologie d’extrême droite, le milliardaire chrétien a comparé à plusieurs reprises la jeune et infatigable militante climatique à l’Antéchrist — qui, selon lui, était présenté par la prophétie comme portant un message trompeur de « paix et de sécurité ». « Si Greta réussit à convaincre tout le monde sur Terre de faire du vélo, c’est peut-être une solution au changement climatique, mais cela revient à passer de la peste au choléra8 », a-t-il déclaré avec gravité.
Pourquoi Greta ? Pourquoi maintenant ? La peur apocalyptique de la régulation, qui viendrait affecter leurs super-profits, l’explique en partie. Pour Thiel, les politiques climatiques fondées sur la science, telles que Greta Thunberg et d’autres les réclament, ne pourraient être appliquées que par un « État totalitaire » — ce qui serait, à ses yeux, une menace bien plus grave que l’effondrement climatique (plus problématique encore, les impôts liés à de telles politiques seraient « très élevés »). Mais il y a peut-être autre chose qui les effraie chez Greta Thunberg : son engagement inébranlable envers cette planète, et envers toutes les formes de vie qui l’habitent — à l’opposé des simulations numériques générées par l’IA, des hiérarchies entre les vies dignes ou non de survivre, ou encore des fantasmes d’évasion extra-planétaire que nous vendent les fascistes de la fin des temps.
Un choix indicible et sinistre est en train d’être fait sous nos yeux et sans notre consentement : les machines plutôt que les humains, l’inanimé plutôt que le vivant, le profit avant tout le reste.
Elle est déterminée à rester, tandis que les fascistes de la fin du monde l’ont déjà quittée, au moins dans leur tête — reclus dans des abris opulents, transcendés dans l’éther numérique, ou en route pour Mars.
Peu de temps après la réélection de Trump, l’une d’entre nous a eu l’opportunité d’interviewer Anohni, l’une des rares artistes qui cherche à déployer une pratique artistique autour de cette pulsion de mort qui caractérise notre époque. Interrogée sur ce qui, selon elle, relie la volonté des puissants de laisser la planète brûler à leur obsession de contrôler le corps des femmes et des personnes trans comme elle, elle a fait référence à son éducation catholique irlandaise : « C’est un mythe très ancien que nous sommes en train de jouer et d’incarner. C’est l’accomplissement de leur Enlèvement. C’est leur fuite hors du cycle voluptueux de la création. C’est leur fuite loin de la Mère. »
Comment sortir de cette fièvre apocalyptique ? Commençons par nous entraider mutuellement pour affronter la profonde perversité que porte l’extrême droite dans chacun de nos pays. Pour avancer efficacement, nous devons comprendre une chose essentielle : nous faisons face à une idéologie qui a abandonné l’idéal et les promesses de la démocratie libérale ainsi que la possibilité même de rendre ce monde vivable – une idéologie qui a abandonné la beauté du monde, ses peuples, nos enfants, les autres espèces. Les forces que nous affrontons ont fait la paix avec les destructions de masse : elles trahissent ce monde et toutes les vies humaines et non humaines qu’il abrite.

Nous devons également opposer à leurs récits apocalyptiques une histoire bien plus forte sur la nécessité de survivre aux temps difficiles qui nous attendent, sans laisser personne de côté. Un récit capable de priver le fascisme de la fin des temps de son pouvoir horrible, et de mobiliser un mouvement prêt à tout risquer pour notre survie collective. Un récit non pas de fin, mais de renouveau ; non pas de séparation ni de suprématie, mais d’interdépendance et d’appartenance ; non pas de fuite, mais d’enracinement et de fidélité à cette réalité terrestre troublée dans laquelle nous sommes pris et liés les un·es aux autres.
Ce sentiment assez simple n’a en soi rien de nouveau. Il est au cœur des cosmologies autochtones et constitue l’essence même de l’animisme. Si l’on remonte suffisamment loin dans le temps, chaque culture et chaque foi possède sa propre tradition de respect envers le caractère sacré de l’ici, sans quête illusoire d’une terre promise toujours lointaine et inaccessible. En Europe de l’Est, avant les anéantissements fascistes et staliniens, le Bund, mouvement socialiste juif, s’organisait autour du concept yiddish de Doikayt [« hereness », que l’on peut traduire en français par « diasporisme » ou encore « la pertinence d’être là où l’on est »]. L’artiste et autrice Molly Crabapple, qui lui consacre un livre à paraître, définit le Doikayt comme le droit de « lutter pour la liberté et la sécurité là où l’on vit, envers et contre tous ceux qui souhaitent notre disparition » — plutôt que d’être forcé à chercher refuge en Palestine ou aux États-Unis.
Nous devons opposer à leurs récits apocalyptiques un récit capable de priver le fascisme de la fin des temps de son pouvoir horrible, et de mobiliser un mouvement prêt à tout risquer pour notre survie collective. Un récit non pas de fin, mais de renouveau.
Peut-être est-il temps de réinventer une version universelle et moderne de cette idée : un engagement envers le droit à l’« ici » de cette planète malade, envers ces corps vulnérables, envers le droit de vivre dignement où que nous soyons, même lorsque les secousses inévitables nous obligent à bouger. Cette idée peut être fluide, affranchie du nationalisme, enracinée dans la solidarité, respectueuse des droits autochtones et libérée des frontières.
Ce futur impliquerait sa propre apocalypse, sa propre fin du monde et sa propre révélation — bien différente, toutefois. Car, comme l’a fait remarquer la chercheuse spécialiste de la police Robyn Maynard : « Pour rendre possible la survie planétaire sur Terre, certaines versions de ce monde doivent disparaître. »
Nous sommes arrivés à un moment clef : la question n’est plus de savoir si l’apocalypse aura lieu, mais quelle forme elle prendra. Les sœurs activistes Adrienne Maree et Autumn Brown l’expliquent dans un récent épisode de leur podcast au nom prophétique : « How to Survive the End of the World » (« Comment survivre à la fin du monde »). Alors que le fascisme de la fin des temps mène une guerre totale sur tous les fronts, de nouvelles alliances sont indispensables. Plutôt que de nous demander : « Partageons-nous tous et toutes la même vision du monde ? », Adrienne nous invite à poser une autre question : « Ton cœur bat-il, et as-tu l’intention de vivre ? Alors viens, et nous réglerons le reste ensemble, de l’autre côté. »
Pour avoir la moindre chance de tenir tête aux fascistes de l’apocalypse — avec leurs cercles concentriques étouffants d’« amour ordonné » — nous devrons construire un mouvement indiscipliné animé par un amour fervent pour la Terre : fidèle à cette planète, à ses peuples, à ses créatures, et à la possibilité d’un avenir vivable pour toutes et tous. Fidèle à l’ici. Ou, pour reprendre les mots d’Anohni, cette fois en parlant de la déesse en laquelle elle place désormais sa foi : « T’es-tu demandé un instant si ce n’était pas là sa meilleure idée ? »
Image d’accueil : Marek Pavlík sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Cités-États privées traduit « corporate city states » dans la version originale. Les autrices parlent ensuite de « freedom cities », traduit ici par « villes libres ». Toutes les notes sont du traducteur.
- Próspera est une enclave libertarienne privée, située au nord du Honduras sur l’île de Roatan.
- « Body upgrade » en anglais, qui emprunte au champ lexical des logiciels (« mise à jour corporelle »).
- Pour rappel, l’article original a été publié le 13 avril 2025.
- Île de Papouasie Nouvelle-Guinée sur laquelle l’Australie avait installé un camp de réfugiés.
- Il s’agit du programme préparé par la Heritage Foundation pour préparer l’élection de Donald Trump et s’assurer que son second mandat permettre de durablement transformer l’administration et la société étatsuniennes.
- Pour Centro de Confinamiento del Terrorismo, « centre de confinement du terrorisme ».
- L’expression originale est « out of the frying pan into the fire », soit passer d’une situation horrible à une situation pire encore.
L’article La montée du fascisme de la fin des temps est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr