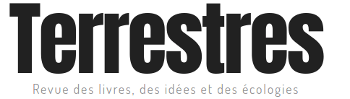Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique
04.12.2024 à 10:31
Sortir des labos sans lâcher la recherche
Des scientifiques en rébellion
Avec blouses blanches, banderoles et micros, les Scientifiques en rébellion s’enchaînent à des ponts et repeignent des banques afin d’interpeller la société sur les énergies fossiles ou la biodiversité. À l’occasion de la publication de « Sortir des labos pour défendre le vivant », Terrestres s’entretient avec trois membres du collectif sur la posture des scientifiques et le sens de la recherche.
L’article Sortir des labos sans lâcher la recherche est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7168 mots)
Temps de lecture : 19 minutes
En février 2020, à la veille du confinement, un appel de 1000 scientifiques était publié dans le journal Le Monde : « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ». Quelques mois plus tard, en Angleterre, des scientifiques lançaient de la peinture verte sur la Royal Society de Londres pour dénoncer l’inaction climatique. Scientist rebellion était né : le collectif de scientifiques cousin d’Extinction rebellion s’est notamment fait connaître au moment de la COP 26 à Glasgow en 2021 par ses actions de désobéissance civile non-violente et d’occupation de l’espace public en blouses blanches.
Scientifique en rébellion, crée en France en 2022, procède à la fois de l’Appel des 1000 scientifiques et du collectif anglophone. Depuis, ses membres ont écrit des tribunes, témoigné lors de procès de militant·es pour le climat, organisé des campagnes et des occupations (au Museum d’histoire naturelle à Paris ou dans un salon d’exposition BMW à Munich, actions qui ont elles-mêmes donné lieu à des procès). Parallèlement à ces interventions publiques, le collectif œuvre à une réorientation de la recherche et de l’enseignement pour faire face à la catastrophe climatique et sociale.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
À l’occasion de la publication récente de Sortir des labos pour défendre le vivant (Éditions du Seuil, collection « Libelle »), Terrestres s’entretient avec trois membres du collectif. Quelle est la spécificité de la posture des scientifiques, symbolisée par la blouse blanche, dans la société ? Comment interpeller des collègues dont l’activité dépend de ce qu’on dénonce ? Faut-il poursuivre la recherche scientifique ?
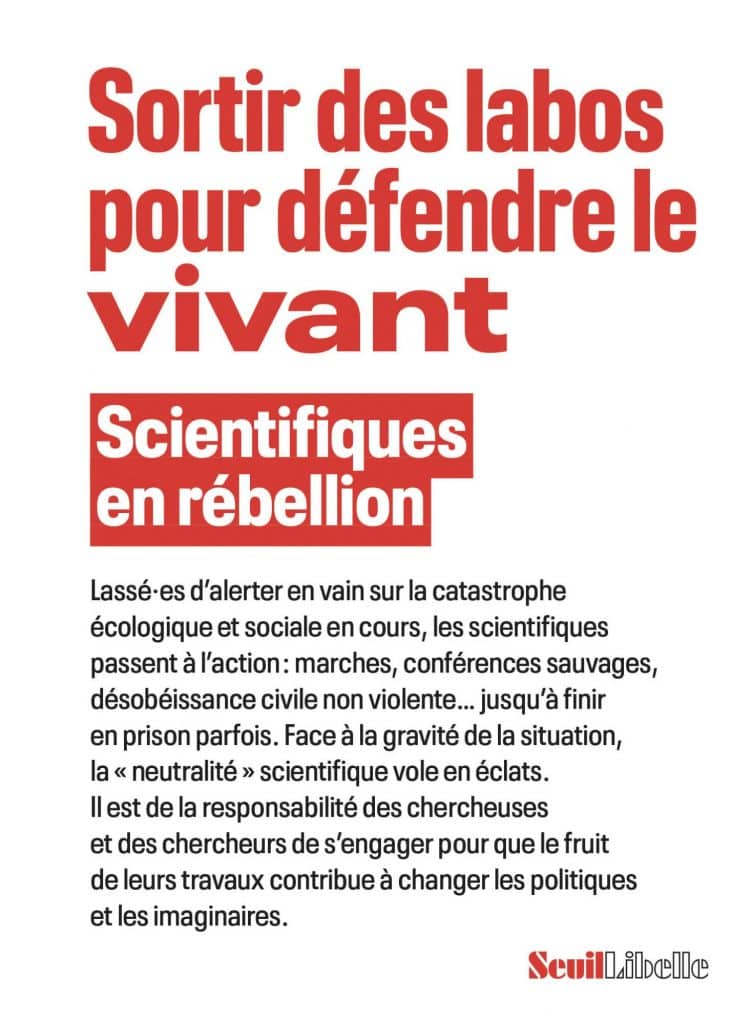
Terrestres – Pour qui ce livre a-t-il été écrit ? Pour vos collègues, pour la société civile ?
Andrée – Ce livre s’adresse à un public sympathisant. Son objectif est de mettre par écrit une réponse simple aux questions que l’on nous pose sur les lieux d’action, mais il vise un public plus large, en espérant qu’un dialogue puisse s’établir sous une forme ou une autre.
Les positions et les opinons de nos collègues ne sont pas homogènes : elles sont diverses, à l’image de notre société. Certains sont engagés sous d’autres formes que Scientifiques en rébellion mais il y a aussi des chercheur·es qui adhèrent au technosolutionnisme ou dont les modèles de réussite sont l’enrichissement et l’accès aux instances de pouvoir. On ne veut pas avoir une posture d’accusation caricaturale, de type : « regardez-nous comme on est beaux, et vous êtes du mauvais côté ». Face aux enjeux, il y a un travail de conscience à faire : est-ce que les scientifiques sont des intellectuel·les (au sens historique du terme) ou des acteurs impuissants de la société de consommation ? Est-ce qu’on peut définir des valeurs communes au-delà du fait de respecter la méthodologie scientifique, comme le « peer review », qui garantit l’exactitude et le bien-fondé de la connaissance produite ?
Vous écrivez : « Le manque de réponse de nos dirigeant·es laisse penser que notre mouvement devra amplifier son engagement à court et moyen terme ». En quoi consisterait cette amplification ? Par ailleurs, j’ai entendu l’une d’entre vous faire le constat d’une « vocation à la marginalité » pour le collectif Scientifiques en rébellion : dans quel sens ? N’est-ce pas contradictoire ?
Cédric – Cette marginalité va avec l’un des modes d’action du collectif qui est de pratiquer la désobéissance civile pour aboutir à des arrestations et des procès : c’est la médiatisation de ces procès qui permet d’argumenter et de mettre en avant nos thématiques. Ce qui va forcément avec une forme de radicalité, puisque cela comporte certains risques que tout le monde n’est pas prêt à prendre.
Julien – La marginalité renvoie à une question qui se pose autant dans le monde académique que dans la société : est-ce qu’on transforme les choses par la marge, en créant un système parallèle qui va peu à peu infuser dans le système actuel ? Ou est-ce qu’on s’attaque à la mégamachine, comme le disent Fabian Scheidler et Aurélien Berlan, en essayant de la déboulonner ? Dans le monde académique, ça pose la question des recettes qu’on peut partager avec nos collègues, afin de transformer notre activité de recherche, voire de bifurquer. Dans la société, ça soulève autre chose : se positionner en tant que scientifique peut être vu comme une manière de rester dans notre tour d’ivoire. Il est essentiel de tisser des liens entre scientifiques et société civile, notamment avec les mouvements sociaux (Soulèvements de la Terre, mouvement syndical, etc.).
J’ai toujours été étonné de la réaction d’informaticiens ou de matheux qui s’impliquaient dans les mouvements écolo, par la force de ce message radical qui leur arrive comme une explosion.
Julien
Andrée – Nous sommes très attachés à l’intelligence collective et au fonctionnement horizontal, contre l’idée de lignes directrices décidées à un moment donné et derrière lesquelles tout le monde devrait se ranger. On ne peut pas prévoir à l’avance comment va évoluer le mouvement, et tant mieux. C’est également une façon de retrouver de la puissance face au contrôle politique. C’est ce que je vois dans un mouvement comme les Soulèvements de la Terre : cela leur permet de se protéger d’une forme de surveillance et de rassurer leurs membres sur le fait que leur énergie ne va pas être récupérée.
Lire aussi sur Terrestres : Lesley Hughes, « Quand la catastrophe planétaire est notre boulot quotidien », octobre 2018.
Celleux qui ont lancé Scientifiques en rébellion ont donné une impulsion colossale, dans l’espoir que cette impulsion amène à des bascules – pardonnez-moi cette image un peu mécanique. Puis le collectif a grossi, on a réfléchi, il y a eu des retours d’expérience et on a envie d’évoluer.
Il est important pour nous d’avoir un positionnement radical – les sciences politiques montrent que cela fait bouger la société – mais ce n’est pas pour autant qu’on donne des leçons, ou qu’on dit ce que les gens doivent penser. Que ce soit dans les lieux professionnels ou ailleurs, nous acceptons que certaines choses prennent du temps pour être entendues. Les actions de désobéissance civile sont pensées pour heurter : on balance un message qui bouleverse pour alerter sur une menace plus grande encore. Mais cela ne marche pas sans l’échelle locale et individuelle, où la communication bienveillante est essentielle. Cette bienveillance doit aller dans les deux sens : nous sommes attentif·ves aux collègues du collectif qui racontent qu’iels se sont retrouvés isolé.e.s, ou que le dialogue s’est rompu.

Les membres de Scientifiques en rébellion sont majoritairement issu·es des sciences dites exactes ou naturelles, les sciences du vivant ou les sciences du climat étant évidemment particulièrement représentées, mais aussi informatique, mathématique… seule une minorité est issue des sciences humaines et sociales. Comment expliquer ce déséquilibre ?
Andrée – Je partage l’idée que nous vivons des mécanismes de domination qui reposent toujours sur la censure et le refoulement de nos émotions (colère, indignation, sentiment d’injustice…). C’est ce qu’on demande surtout aux petits garçons et c’est ainsi que se perpétue le patriarcat. On est également focalisé sur l’intelligence rationnelle. Les sciences basées sur les chiffres font autorité. Est-ce parce que les sciences humaines savent cela, et s’y soumettent, qu’elles montrent une sorte de distance et se laissent moins affecter, bouleverser ? Il me semble que du côté des sciences dures, il y a peut-être une forme de naïveté sur les mécanismes politiques et socio-économiques, mais moins de conditionnement à ne pas se laisser affecter pas la réalité. Dans nos lieux de travail, l’émotion n’est pas accueillie, au nom d’une soi-disant « neutralité ». Entrer en rébellion et sortir des labos devient alors vital.
Julien – Pour ma part, j’ai toujours été étonné de la réaction d’informaticiens ou de matheux qui s’impliquaient dans les mouvements, disons, écolo – on peut remonter à Grotendick dans les années 70 – par la force de ce message radical qui leur arrive comme une espèce d’explosion. C’est très étonnant au regard de la discipline d’où viennent ces collègues-là. Et je crois qu’effectivement il y a une espèce de naïveté, on se prend les émotions très spontanément et ça nous transforme.
Lire aussi sur Terrestres : Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, « Total face au réchauffement climatique (1968-2021) », octobre 2021.
La recherche actuelle est structurellement construite pour favoriser les idées innovantes et « disruptives », généralement intensives en technologies et en capitaux. Mais il existe d’autres approches, qui tentent de faire différemment. Comment les faire exister ? Faut-il réorienter la recherche ? Ou arrêter d’en faire ? On pense aux conférences de Grothendieck, mais aussi à l’océanographe Véronique Carignan, qui a annoncé en 2023 qu’elle quittait un poste de professeur à l’université du Rhode Island, quand, explique-t-elle, « j’ai compris que les sciences universitaires étaient non seulement inefficaces face aux changements climatiques, mais aussi qu’elles pouvaient contribuer à retarder l’action climatique ».
Julien – On peut commencer par donner un élément très factuel, qui a été présenté lors du récent Congrès des Labos 1.5 (collectif de scientifiques travaillant en vue de réduire l’empreinte carbone de la recherche) : c’est un poster qui porte sur les liens entre les industries fossiles et les financements publics. Il s’agit notamment de regarder comment sont financés les projets de recherche, dans le cadre d’un travail de cartographie des liens public-privé sur le financement d’extraction fossile, ou du greenwashing d’acteurs comme Total. Nous scientifiques, on documente des liens d’intérêt pour dénoncer des situations qui ne sont plus tenables, comme de financer des industries qui continuent de polluer alors que cet argent pourrait servir largement à d’autres chose. Quand on est informaticien, on a de quoi faire pour traiter toutes ces données !
On peut aller vers de la décroissance ou de la sobriété, mais cela ne veut pas dire qu’on va revenir à un âge d’or sans technique et sans recherche, qui du reste n’a jamais existé.
Cédric
Quitter la recherche, ça peut être parce qu’on ne supporte plus l’endroit où l’on est et qu’on cherche à aller mieux, personnellement ou en rapport avec ses valeurs, mais ça veut dire aussi qu’on quitte un milieu de travail où vont rester des gens qui continueront à faire des choses dans la direction qui ne nous semble pas souhaitable.
Il est précieux de garder un pied dans les laboratoires : qu’il s’agisse de Scientifiques en rébellion ou du réseau des Atécopol (Atelier d’écologie politique), ça permet d’injecter de la réflexivité dans ce qu’on fait. Pour ma part, je ne me suis pas redirigé complètement, je continue à avoir mon activité historique, mais je la regarde avec de nouveaux yeux.

Cédric – On peut saluer le départ de Véronique Carignan, c’est effectivement très courageux de quitter un poste confortable, surtout quand ça fonctionne, c’est-à-dire surtout quand les médias en parlent. Mais il y a plusieurs manières de résister : résister, ça peut vouloir dire faire des actions de désobéissance civile, ça peut vouloir dire démissionner de son poste, ça peut vouloir dire aussi résister dans une certaine mesure en détournant. L’informatique, par exemple, est un domaine où on attend de nous beaucoup de choses très opérationnelles et très liées à l’industrie. Les gens qui sont dans ces domaines-là et qui utilisent les fonds qu’ils reçoivent pour aller informer de ce qui se passe au niveau climatique ou autre, ou pour soutenir les sciences humaines et sociales, c’est aussi une autre manière de résister.
Ensuite, la question de faire de la recherche ou pas, est quelque chose qui se pose en effet depuis longtemps, mais il faut faire attention à mon avis à ne pas rêver à un retour à un âge d’or. Il faut se méfier de l’abandon de la recherche ou de l’idée de progrès car l’inverse du progrès serait une sorte de retour en arrière – y compris à gauche, y compris chez nous – qui dirait : il faut revenir avant le moment où on s’est mis à dépenser trop d’énergie. Mais nous sommes dans une autre époque et nous ne pouvons pas revenir en arrière : on peut aller vers de la décroissance ou de la sobriété, mais cela ne veut pas dire qu’on va revenir à un âge d’or sans technique et sans recherche, qui du reste n’a jamais existé.
Véronique Carignan a quitté son poste après l’étude qui avait été menée sur les financements de la recherche, et qui montrait que les montants alloués aux sciences humaines et sociales sont dérisoires en comparaison du reste. Or, c’est cela qui est intéressant : la recherche est nécessaire pour faire ce constat. Il faut bien garder à l’esprit que si on n’a pas de recherches scientifiques, on ne peut pas informer du réchauffement climatique, ou en tout cas on n’a pas d’élément concret et tangible pour l’informer, mais on n’a pas non plus de moyen d’informer des mécanismes de l’extrême droite. Je pense par exemple à David Chavalarias du Politoscope.org, qui a notamment montré comment la Russie est intervenue dans la vie politique française.
Mais ça ne suffit pas – informer ne suffit pas. C’est une condition nécessaire, mais non suffisante. C’est pour ça que Scientifiques en rébellion existe.
Lire aussi sur Terrestres : Sophie Gerber et Stéphanie Mariette, « Les marqueurs du vivant : génétique et big data », octobre 2023.
Au-delà de ces exemples – importants – en faveur de la poursuite de la pratique scientifique et de l’ancrage dans les institutions, que répondre aux appels à réorienter son travail ou à abandonner la recherche ?
Andrée – Allons droit au but : quel est le sens fondamental de la recherche ? L’esprit chercheur scientifique est propre à l’humain et a toujours existé, la question est celle des moyens que la société investit dans cette activité : à quels besoins, et aux besoins de qui, cette activité va s’attacher. Dans l’exposition sur Leonard de Vinci au château d’Amboise, on peut voir une sorte de lettre de motivation où il explique à un mécène (le duc de Milan je crois) toute sa capacité d’ingénieur à construire des engins de guerre hyper innovants, parce qu’il sait faire des ponts qu’on démonte et qu’on remonte pour passer des rivières quand on veut envahir son voisin, etc. La position de celui qui a besoin d’être financé pour se livrer à sa curiosité et à sa passion – parce que pour moi, c’est ça un chercheur –, cette position a toujours été compliquée.
Pour ma part, c’est un porte-à-faux depuis toujours, avant la conscience de la crise écologique : j’ai été formée pour faire de la recherche car je suis capable d’apprendre, curieuse et rigoureuse. Depuis le début de ma carrière, je souhaite un job où je me sens aussi utile à la société. Aujourd’hui, je ne crois absolument pas dans le technosolutionnisme et la politique de fuite en avant (notamment sur le sujet de l’énergie), à l’opposé d’un virage vers la sobriété solidaire, qui me convient beaucoup plus. Au-delà de cette question, une société qui décide qu’elle n’a plus besoin de la recherche, qu’elle n’a plus besoin de se livrer à l’activité de curiosité et de développement de connaissances, ou dont les professeurs se contenteraient d’enseigner les livres du passé, aura perdu tout sens à mes yeux.

Cédric – Effectivement, une société où il n’y aurait plus de recherche serait une société où les problèmes ne sont pas résolus. Les décisions qu’on prend, les messages et revendications qu’on porte sont toujours appuyées sur du scientifique. On va vers une autre science, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de science, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de technologie. C’est une question qu’on trouve en écologie politique depuis très longtemps, dans le convivialisme d’Ivan Ilitch par exemple, où Ilitch est très clair sur le fait que dans sa vision des choses, il ne s’agit pas d’abandonner les connaissances ou d’abandonner la science ou la technique, ou la technologie – c’est aussi le cas pour Janet Biehl.
L’idée est d’avoir un autre rapport à cette technique ou à cette technologie, et notamment de trancher entre ce qu’on peut s’approprier c’est-à-dire ce qu’on utilise comme outil, ce qui peut nous aliéner. Là-dessus, on a des exemples assez frappants dans les travaux d’Antonio Casilli sur la manière dont toute une partie de la population du globe est aliénée par l’intelligence artificielle, avec des gens rémunérés à la tâche pour cliquer sur ce qui est un camion, pas un camion, un passage piéton, etc. Et ça peut être une bonne démarcation entre ce qui reste un outil et donc une extension de la manière dont on fonctionne et dont on travaille, et ce qui n’est plus un outil et qui vient nous aliéner.
On ne peut pas conserver autant de monde derrière les ordinateurs pour faire du marketing, de l’e-réputation ou écrire des petites lignes dans les contrats d’assurance.
Andrée
Julien – Et pour ce qui est des technologies, contester le fait que la solution à la crise environnementale passera forcément par des solutions technologiques ne veut pas dire que la solution sera forcément antitechnologique. C’est important de dire que même si on a une grande circonspection sur la technologie, on ne la bannit pas complètement.
Andrée – J’aime bien l’idée de s’intéresser à la façon dont Cuba a réussi à survivre à la chute de l’URSS, comme dans le reportage « Comment Cuba a survécu sans pétrole en 1990 ». J’ai retenu que le pays a été confronté grosso modo à ce que nous devrions aujourd’hui nous imposer : une réduction de 80% de la drogue pétrole en quelques années, et une production agricole qui doit se passer des engrais industriels, des gros tracteurs et faire revivre les sols. Cette part de l’histoire, qui n’offre pas un modèle politique pour autant, peut aider à ouvrir les yeux sur le virage à faire. Rappelons que cela n’a pas été sans heurts sociaux et que cela n’a pas été tout le temps heureux. Mais apparemment, il n’y a pas eu autant de morts à déplorer que ce que l’on imagine.
Tout le monde a perdu 3 à 5 kg du fait de la nécessité de faire de la bicyclette, de faire beaucoup plus de travail manuel, et de ne presque plus manger de viande – des constats qui correspondent à certaines recommandations actuelles ! J’en avais discuté avec un collègue médecin membre de Scientifiques en rébellion : on pourrait se pencher sur cette expérience là pour anticiper des questions de santé publique.
Il est dit que la population qui a le plus souffert sont les femmes enceintes et les nourrissons, par manque de fer. C’est à prendre en compte dans un programme de santé publique qui anticipe la crise économique qu’on voit venir. Se préparer à la sobriété – ce à quoi nous aspirons, mais dont on ne maîtrise pas encore les trajectoires possibles. Que nous dit la trajectoire de Cuba pour les scientifiques ? Qu’il a fallu laisser un moment les bouquins et désartificialiser les sols, les trottoirs, les toits, et se mettre à planter pour avoir de quoi manger.
Assez rapidement, les universités se sont décentralisées et se sont mises aux côtés des agriculteurs et des maraîchers pour trouver des solutions, pour régénérer la terre par exemple et pour trouver des réponses aux problématiques : en somme, la recherche a été réorientée. Personnellement, cela me fascine, il y a un travail intellectuel conséquent car, rien ne peut être imité. Nous n’avons ni le sol, ni le climat, ni l’histoire de Cuba.
Mais soyons conscients que dans une économie sobre et décarbonée, il faut retourner aux fondamentaux, on ne peut pas conserver autant de monde derrière les ordinateurs pour faire du marketing, de l’e-réputation ou écrire des normes et des petites lignes dans les contrats d’assurance.

Votre stratégie politique consiste à vous mobiliser pour faire davantage connaître les résultats scientifiques afin d’interpeller les politiques et « d’obliger nos dirigeants à les regarder en face et à agir en conséquence ». On peut pourtant douter que les dirigeants travaillent réellement au bien commun, pas plus qu’ils ne constituent une supposée une « élite éclairée ». Par exemple, les séminaires de la climatologue Valérie Masson-Delmotte devant le gouvernement en 2022 n’ont été suivis d’aucun effet. Ne s’agirait-il pas plutôt de créer un rapport de force ?
Andrée – Un réel rapport de force est difficile à concilier avec de la désobéissance civile non-violente. On peut aussi choisir d’autres modes d’engagement et d’autres contextes. Scientifiques en rébellion ne se positionne pas sur le plan du rapport de force politique. Si on envisage tous les rapports de force possibles, personnellement, quand j’étais petite, mes parents voulaient que j’apprenne à me défendre. Mon grand-père et ma grand-mère étaient des Résistants. Dans mes racines, la violence n’est donc pas exclue, elle est contrôlée en fonction de la menace. N’a-t-on pas droit à la légitime défense ? Mais le collectif de Scientifiques en rébellion n’est absolument pas le lieu où ces choses-là s’envisagent.
Du point de vue de la prise de conscience de nos dirigeants et de leur sens des responsabilités, je m’interroge toujours. Par exemple, l’intervention de Valérie Masson Delmotte devant le gouvernement n’est pas inutile puisqu’elle permet de montrer qu’elle n’a pas été entendue – et c’est une prise de conscience importante pour tous ceux qui donnent du crédit à la science.
Julien – Lorsqu’on parle d’élites comme les gouvernants par opposition aux gouvernés, je pense qu’il est important de dire qu’en tant que scientifique, nous avons un statut ambigu : il ne faut pas se leurrer, on est beaucoup à venir de classes bourgeoises, donc du point de vue des classes populaires, on est sans doute assigné à une position d’élite. Pour autant, il y a une confiance dans la parole des scientifiques, il existe de nombreuses études qui montrent que leur parole est écoutée, relativement respectée. Mais il y a une chose claire dans Scientifiques en rébellion, c’est qu’on ne veut pas incarner l’idée d’un scientifique qui serait l’avant garde, qui prescrirait ce qu’il faut faire pour que le peuple suive.
Par exemple, je connais un ancien directeur de labo qui pense que le problème de la politique est qu’il n’y a pas assez d’experts ou de scientifiques hommes ou femmes politiques. Je ne suis pas d’accord avec lui. C’est peut-être vrai, mais moi je verrais d’un mauvais œil que les scientifiques cherchent à être au pouvoir.
Ça me paraît même assez dangereux. On ne doit pas aller vers ça, mais au contraire tisser des liens avec la société.
On ne veut pas diluer notre engagement, mais il est intéressant de rejoindre un mouvement plus large et de diluer notre posture de scientifique avec son marqueur de blouse blanche.
Julien
Il y a un bouquin de Sandra Laugier et Albert Ogien qui est sorti il y a peu sur la désobéissance climatique. En le lisant, une idée m’a frappé, un constat que je n’avais jamais vraiment réalisé avant : dans l’histoire des droits civiques, de la désobéissance civile pendant l’apartheid par exemple, il s’agissait de lutter contre des lois injustes, racistes, etc. Les mouvements agissaient contre ces lois en les bravant. Mais dans le cas du climat, il n’y a pas de lois auxquelles s’opposer. Il y a des modes de vie qui sont clairement insoutenables, mais ce n’est pas une loi qu’on cherche à abolir. C’est pour cela qu’on cherche à entrer autrement dans la sphère judiciaire, en utilisant les actions de désobéissance civile non violente dont on cherche à montrer qu’elles sont légitimes en invoquant l’état de nécessité, en l’occurrence l’état d’urgence climatique, afin de permettre la création de jurisprudences. L’occupation du Museum de Paris en avril 2022 (par des membres de Scientifiques en rébellion) a récemment donné lieu à des relaxes.
Or, ces procès ne laissent pas les gens insensibles : quand des scientifiques se retrouvent en prison ou en procès, cela touche beaucoup de monde. La désobéissance civile, à savoir aller physiquement quelque part et s’engager pour une cause juste et pas pour des intérêts financiers, restent largement d’actualité. Il nous faut trouver des stratégies pour insister dans cette voie là tout en tenant compte de la répression croissante.

Pour en revenir au livre Sortir des labos pour défendre le vivant, il est publié dans un contexte singulier : au lendemain de l’élection de Trump, le jour où Elon Musk est nommé à la tête d’un futur ministère de l’efficacité gouvernementale, à la veille de la Cop 27 qui a lieu à Bakou et dont on craint le naufrage. Dans un moment aussi hostile, comment porter ce livre ? Plus largement, comment interprétez-vous ce moment au sein du collectif ?
Julien – Lors des législatives, Scientifiques en rébellion s’est engagé spécifiquement en son nom. Autant on ne veut pas diluer notre engagement, autant c’est intéressant de rejoindre un mouvement plus large et de diluer notre posture de scientifique, avec ce marqueur de blouse blanche. Contre l’extrême droite, il est important de se grouper et d’être fort.
Andrée – J’ai écouté la retransmission d’une commission sénatoriale où il était expliqué qu’avec les données de Twitter, on peut voir comment les messages ont été relayés géographiquement, selon les groupes de pensée, de croyance, et comment les réseaux sociaux sont utilisés comme outils d’analyse et de manipulation des opinions. Je ne m’attendais pas à ce que ça soit aussi puissant et avéré. Lors d’une table ronde à l’académie du Climat, j’ai entendu un spécialiste des « bots » qui créent des faux comptes et manipulent les opinions. Il était très découragé face à la puissance que cela donne à certains intérêts politiques ou économiques et a conseillé aux activistes de renoncer à mettre leur énergie dans les réseaux sociaux car, selon lui, la situation est trop inégale et seuls les pouvoirs publics auraient les moyens de limiter cette influence toxique.
Je suis davantage en faveur de mettre mon énergie dans d’autres canaux de communication, d’où le besoin d’aller vers l’interpersonnel. Je crois qu’il faut se voir, créer des liens, court-circuiter la dictature de l’image, de la com, pour arriver à comprendre, avec les sciences humaines, comment changer le monde, avant que les conditions d’habitabilité de la Terre ne soient irrémédiablement rompues.
Un spécialiste des bots générant des faux comptes sur les réseaux sociaux a conseillé aux activistes de renoncer à mettre leur énergie là-dedans : la situation est trop inégale.
Andrée
Julien – Par rapport à la communication sur les réseaux sociaux, il est en effet peut être déjà trop tard pour trouver des messages qui pourraient contrebalancer les messages très forts de l’extrême droite – David Chavalarias a montré que le match est presque déjà plié : l’extrême-droite est ultraforte, donc à quoi bon ajouter de la communication contre ça, sachant que ça ne sera pas entendu ?
Mais il y a peut-être l’option de revenir à la racine de ce qu’est un réseau numérique actuellement : ce sont des câbles, ce sont des endroits où l’information est diffusée. Je ne sais pas ce que les Soulèvements de la Terre ont proposé dans la campagne anti-Bolloré, mais on peut très bien imaginer de poser la question du sabotage concernant des médias de désinformation qui relaient des messages de haine. C’est peut-être la réponse la plus simple, en fin de compte : on s’attaque à l’infrastructure pour empêcher la diffusion de contenus toxiques – qui est d’ailleurs illégal la plupart du temps, mais que la loi n’a pas forcément le temps ou l’énergie de contrôler. C’est pourquoi il me semble que, sur ce thème, on peut porter des messages très radicaux.
Sinon, le risque est que les scientifiques ne fassent que documenter le désastre, comme ce qui se passe pour le GIEC… Au-delà de la recherche, il y a peut-être des actions plus fortes à mener pour empêcher l’ascension de pouvoirs autoritaires et anti-écologiques.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Sortir des labos sans lâcher la recherche est apparu en premier sur Terrestres.
17.07.2024 à 20:44
Le Ministère du futur
Kim Stanley Robinson
Alors que la France semble plongée dans la tourmente politique, l'Inde vit une canicule mortelle. Que se passerait-il si, au gré d'une puissante et longue canicule, les conditions climatiques devenaient littéralement suffocantes ? C'est sur ce scénario effroyable que s'ouvre le roman d'anticipation climatique de Kim Stanley Robinson. Extrait.
L’article Le Ministère du futur est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7111 mots)
Temps de lecture : 20 minutes
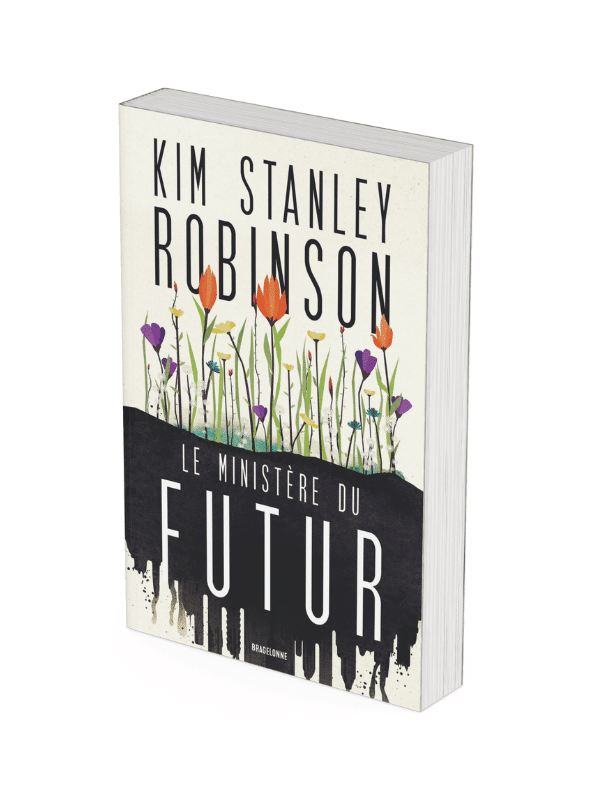
Cet extrait est tiré du roman Le Ministère du futur de Kim Stanley Robinson, traduit par Claude Mamier et publié chez Bragelonne en 2023.
Il faisait de plus en plus chaud.
Frank May quitta son petit matelas et s’avança jusqu’à la fenêtre. Murs et tuiles ocre, couleur de l’argile locale. Immeubles carrés, comme celui où il se trouvait, toits-terrasses occupés par des résidents qui y dormaient la nuit pour échapper à la chaleur des appartements. À présent, certains d’entre eux regardaient vers l’est par-dessus les garde-corps. Ciel du même ocre que les immeubles, teinté de blanc là où le soleil ne tarderait pas à apparaître. Frank prit une longue inspiration. Qui lui rappela aussitôt l’atmosphère des saunas alors que c’était le moment le plus frais de la journée. Il n’avait pas passé plus de cinq minutes de sa vie dans un sauna, faute d’apprécier la sensation. L’eau chaude, d’accord ; l’air chaud et humide, non. Pourquoi s’infliger une telle impression d’étouffement ?
Ici, impossible d’y échapper. Frank n’aurait pas accepté le poste s’il avait su. Cette ville était jumelée à la sienne, mais ce n’était pas la seule, de même qu’il existait d’autres structures humanitaires. Il aurait pu travailler en Alaska. Sans que sa propre sueur lui pique les yeux. Il était déjà trempé, son short aussi, le matelas aussi, là où il avait essayé de dormir. Il crevait de soif mais la bouteille près du lit était vide. Toute la ville résonnait du bruit des climatiseurs, qui bourdonnaient comme des moustiques géants.
Une ville ordinaire de l’Uttar Pradesh à 6 heures du matin. Il consulta son téléphone : 38 °C. Humidité aux alentours de trente-cinq pour cent. C’était cette conjonction le vrai problème.
Puis le soleil surgit sur l’horizon. Avec l’éclat d’une bombe atomique, ce qu’il était par définition. Le contre-jour assombrit champs et bâtiments dans cette direction, tandis que la tache lumineuse s’élargissait, devenait un croissant aveuglant. La chaleur qui en émanait gifla Frank. Les radiations solaires lui brûlaient la peau. Ses yeux baignés de larmes ne voyaient plus grand-chose. Tout était ocre ou beige ou d’un blanc insoutenable. Une ville ordinaire de l’Uttar Pradesh à 6 heures du matin. Il consulta son téléphone : 38 °C. Ce qui faisait en Fahrenheit – il pianota – 103°. Humidité aux alentours de trente-cinq pour cent. C’était cette conjonction le vrai problème. Quelques années auparavant, il se serait agi de l’une des plus hautes températures humides jamais enregistrées. Non pas d’un simple mercredi matin.
Des gémissements affligés montèrent du toit d’en face. Cris d’horreur poussés par deux jeunes femmes penchées sur le garde-corps, vers la rue. Quelqu’un sur ce toit ne se réveillait pas. Frank s’empressa d’appeler la police. Pas de réponse. Dur de savoir si la communication passait. Des sirènes retentirent, distantes, comme noyées. Avec l’aube, les gens trouvaient des dormeurs en détresse et ceux qui ne se réveilleraient jamais de cette longue nuit torride. Alors ils cherchaient de l’aide. Les sirènes indiquaient que certains appels avaient abouti. Frank vérifia de nouveau son téléphone. Chargé, connecté. Mais aucune réponse du poste de police qu’il avait déjà contacté plusieurs fois depuis son arrivée quatre mois plus tôt. Encore deux mois à tirer. Cinquante-huit jours, beaucoup trop. Le 12 juillet et toujours pas de mousson en vue. Il fallait se concentrer sur chaque journée, une à une. Avant de retourner à Jacksonville en Floride, ridiculement fraîche par comparaison. Frank aurait bien des histoires à raconter. Mais ces pauvres gens sur le toit d’en face…
Le bruit des climatiseurs cessa d’un coup. Provoquant d’autres cris d’horreur. Plus de connexion sur le téléphone. Plus d’électricité. Baisse de tension ou coupure totale ? Les sirènes beuglaient comme tous les dieux et déesses du panthéon hindou.
Les générateurs prirent le relais, engins braillards à deux temps. Carburant illégal – essence, gazole ou kérosène – gardé en réserve pour ce genre d’occasion, passant outre la loi qui imposait le gaz naturel liquéfié. L’air, déjà pollué, ne tarderait pas à s’emplir de vapeurs d’échappement. Autant se mettre le pot d’un vieux bus sous le nez.

Frank toussa rien que d’y penser. Il voulut s’abreuver mais la bouteille était toujours vide. Il l’emporta en bas, la remplit d’eau filtrée au bidon placé dans le réfrigérateur de la réserve. L’eau était encore fraîche malgré la coupure de courant et le resterait un moment dans la bouteille isotherme. Il y ajouta un comprimé d’iode pour faire bonne mesure puis vissa fort le bouchon. Le poids de l’eau le rassura.
La réserve de la fondation abritait en outre deux générateurs et assez d’essence pour tenir deux ou trois jours. Rassurant, là aussi.
Les collègues de Frank débarquèrent à la porte. Hans, Azalee, Heather, tous agités, les yeux rougis.
— Il faut partir, lui dirent-ils.
— Comment ça ? rétorqua Frank, troublé.
— On doit aller chercher de l’aide. L’électricité est coupée dans tout le district, on doit prévenir Lucknow. Ramener des médecins.
— Quels médecins ?
— Essayons quand même !
— Je reste, assena Frank sous les regards ahuris. Allez-y et laissez-moi le téléphone satellite. Je dirai que vous êtes en route.
Ils hochèrent la tête, mal à l’aise, puis se hâtèrent de partir.
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Frank enfila une chemise blanche qui se trempa aussitôt de sueur. Il sortit dans la rue. Les générateurs grondaient, sans doute pour alimenter les climatiseurs tout en crachant leurs gaz d’échappement dans l’air surchauffé. Il retint une nouvelle quinte de toux. Il faisait trop chaud pour tousser, sinon la bouffée d’air suivante semblait jaillie d’un four, ce qui faisait tousser encore plus. Entre l’absorption d’air chaud et l’effort de tousser, le corps ne cessait de monter en température. Des gens s’approchèrent, lui demandèrent de l’aide. Il leur répondit que les secours seraient bientôt là. Vers 14 heures. Là, ils pourraient venir à la clinique. Pour l’instant, vieillards et enfants devaient se mettre à l’abri dans des pièces climatisées. Dans les écoles, la maison du gouvernement. Il suffisait de suivre le bruit des générateurs.
À chaque entrée d’immeuble, des personnes en larmes attendant une ambulance ou un corbillard. Comme pour la toux, il faisait trop chaud pour gémir avec force. Le seul fait de parler devenait dangereux. Que dire, de toute façon ? Il faisait même trop chaud pour penser. Mais les gens venaient voir Frank malgré tout. « S’il vous plaît monsieur… » « À l’aide monsieur… »
Il leur enjoignait de venir à la clinique à 14 heures. Mais d’abord aller à l’école, à l’intérieur, un endroit climatisé. Pour les vieux et pour les gosses.
— Ça n’existe pas ! lançaient-ils.
L’idée lui vint d’un coup :
— Allez au lac ! Mettez-vous dans l’eau ! (Ils n’avaient pas l’air de comprendre.) Comme pendant Kumbh Mela, quand on se baigne dans le Gange. L’eau vous aidera à avoir moins chaud.
Un homme secoua la tête.
— Le lac est en plein soleil. C’est comme une baignoire. Pire que l’air.
Sortir au soleil revenait à être poussé devant un grand feu. Ne restait alors qu’à tituber vers la prochaine zone d’ombre.
Perplexe, inquiet, peinant lui-même à respirer, Frank se dirigea vers le lac. Les habitants se massaient hors des immeubles, dans les entrées. Certains le regardaient passer, d’autres non, perdus dans leurs sombres pensées. Leurs yeux écarquillés par la peur, rougis par la chaleur, la poussière, les gaz d’échappement. Les surfaces métalliques exposées au soleil ne pouvaient déjà plus être touchées ; des ondes de chaleur en émanaient comme d’un barbecue. Frank n’avait aucune force dans les muscles et seule une étincelle de terreur lovée dans sa colonne vertébrale lui permettait de tenir debout. Il voulait se dépêcher mais n’y parvenait pas. Il marchait le plus possible à l’ombre : en général, si tôt le matin, un côté de la rue était protégé. Sortir au soleil revenait à être poussé devant un grand feu. Ne restait alors qu’à tituber vers la prochaine zone d’ombre.
Une fois au lac, Frank constata sans surprise que de nombreuses personnes y étaient déjà plongées jusqu’au cou. Visages bruns grillés par la chaleur. La surface du lac scintillait. Il traversa la promenade bétonnée, puis s’accroupit et enfonça un bras dans l’eau. Aussi chaud qu’une baignoire, en effet, ou pas loin. Il tenta de déterminer si l’eau était plus ou moins chaude que son propre corps. Difficile à dire dans une telle étuve. Il finit par conclure que la surface du lac était à peu près à la température de son sang. Donc bien plus fraîche que l’air ambiant. Mais si elle s’avérait un tantinet plus chaude que son corps… eh bien, ça restait plus frais que l’air. Bizarrement, c’était dur à déterminer. Il jeta un coup d’œil aux baigneurs. Seule une petite zone du lac demeurait en sursis, à l’ombre matinale des arbres et des bâtiments. Ensuite, toute la surface serait exposée au soleil jusqu’à ce que les premières ombres apparaissent de l’autre côté, tard dans l’après-midi. Une perspective affolante même si tout le monde avait un parapluie. Se posait la question de combien de personnes pouvaient s’entasser dans le lac. Pas assez. La population locale tournait autour des deux cent mille. Une ville entourée de champs et de petites collines, ainsi que par d’autres villes situées à quelques kilomètres, dans toutes les directions, selon une disposition très ancienne.

Frank rebroussa chemin jusqu’à son immeuble. Traversa la clinique du rez-de-chaussée, gagna en haletant sa chambre au premier étage. Mieux valait s’allonger et patienter. Il tapa la combinaison du coffre-fort, en sortit le téléphone satellite. Batterie pleine.
Il appela le quartier général à Delhi.
— On a besoin d’aide, lança-t-il à la femme qui répondit. On n’a plus d’électricité.
— Nous non plus, lui annonça Preeti. Comme partout.
— Comment ça, partout ?
— La majeure partie de Delhi, l’Uttar Pradesh, le Jharkhand, le Bengale. Certains États de l’Ouest aussi : Gujarat, Rajasthan…
— Qu’est-ce qu’on peut faire ?
— Attendre les secours.
— Qui viennent d’où ?
— J’en sais rien.
— Que dit la météo ?
— La canicule va encore durer un moment. Après, l’air chaud montera pour laisser entrer de l’air marin plus frais.
— Quand ?
— Aucune idée. La zone de haute pression est bien installée. Coincée contre l’Himalaya.
— Il vaut mieux se mettre dans l’eau que rester dehors ?
— Bien sûr. Si l’eau est moins chaude que le corps.
Frank raccrocha et remit le téléphone dans le coffre-fort. Il consulta le détecteur de particules au mur : 1 300 ppm. Pour les particules fines de diamètre inférieur à vingt-cinq nanomètres. Il ressortit dans la rue, à l’ombre des immeubles ; plus personne ne se risquait au soleil. L’air était d’un gris de fumée. Trop chaud pour avoir une odeur, donnant juste la sensation de respirer des flammes.
Brancher la rallonge, redescendre dans le bureau, brancher le climatiseur, l’allumer. Bourdonnement de l’engin. Un vague souffle d’air. Bon Dieu, ça ne marchait pas.
Retour dans le bâtiment. Frank récupéra la clé de la réserve dans le coffre-fort, en sortit un générateur et un bidon d’essence. Au moment de remplir le réservoir du générateur, il s’aperçut que celui-ci était déjà plein. Une fois le bidon rangé, il emporta le générateur près de la fenêtre où se trouvait le climatiseur. Lequel, avec son petit câble, était branché à une prise juste en dessous. Impossible de faire fonctionner le générateur dans une pièce, à cause des gaz d’échappement. Impossible aussi de le mettre dans la rue, sous la fenêtre, car des gens désespérés s’empresseraient de le voler. Donc… Frank retourna à la réserve et y dénicha une rallonge. Monta ensuite sur le toit-terrasse entouré de garde-corps et situé quatre étages au-dessus de la rue. Mais la rallonge s’arrêtait un étage trop bas. Frank redescendit, délogea le climatiseur de la fenêtre du deuxième étage et entreprit de le hisser à son tour. Il crut un instant s’évanouir dans l’escalier, puis la sueur lui piqua les yeux, lui offrant un regain d’énergie. Il installa l’engin dans le bureau du quatrième, sur le rebord de la fenêtre, baissant la vitre jusqu’au-dessus de l’appareil et tirant sur les panneaux latéraux en plastique afin d’obturer les parties encore ouvertes sur l’extérieur. Sur le toit, il démarra le générateur. L’écouta crachoter son rythme à deux temps. Après le gros jet de fumée initial, le gaz d’échappement demeurerait invisible. Mais le bruit s’entendrait de loin. Frank en percevait de semblables autour de lui. Brancher la rallonge, redescendre dans le bureau, brancher le climatiseur, l’allumer. Bourdonnement de l’engin. Un vague souffle d’air. Bon Dieu, ça ne marchait pas. Si, ça marchait. La température baissa rapidement de cinq ou dix degrés Celsius. Ce qui en laissait bien trente à encaisser. Mais c’était tenable à l’ombre, même avec l’humidité. À condition de ne pas bouger. Et l’air frais descendrait par l’escalier, refroidissant tout l’immeuble.
Au deuxième étage, Frank tenta de refermer la fenêtre qui avait accueilli le climatiseur. Coincée. Il tapa dessus avec ses poings pour la faire descendre, à deux doigts de briser le verre. Elle céda enfin dans une ultime secousse. Puis Frank sortit du bâtiment en fermant bien la porte à clé. Direction l’école. Une petite échoppe sur le chemin vendait en-cas et boissons aux élèves et à leurs parents. L’école était fermée, le magasin aussi, mais des gens étaient là malgré tout. Frank en reconnut certains.
— La clinique a l’air conditionné. Venez avec moi.
Un groupe le suivit en silence. Sept ou huit familles, dont les propriétaires de l’échoppe. Ils essayaient tous de rester dans le peu d’ombre disponible. Les maris précédaient les épouses, lesquelles tentaient de faire avancer les enfants en file indienne pour les garder à l’ombre. Ça parlait awadhi ou peut-être bhojpuri. Frank ne connaissait que quelques mots d’hindi ; ces gens le savaient et utiliseraient cette langue s’ils voulaient s’adresser à lui, ou bien trouveraient un locuteur de l’anglais. Il ne s’était jamais habitué à aider une population avec laquelle il ne pouvait pas converser. Honteux, il surmonta sa gêne et leur demanda en mauvais hindi comment ils allaient, où étaient leurs familles, s’ils avaient quelque part où aller. Enfin il crut le leur demander. Il n’obtint en réponse que des regards curieux.
Frank ouvrit la clinique et laissa entrer les gens. Sans plus d’indications, ils s’engagèrent dans l’escalier, gagnèrent la pièce climatisée où ils s’assirent par terre. L’endroit ne tarda pas à se remplir. Frank se posta devant la porte de la clinique, accueillant les passants intéressés. L’immeuble se retrouva vite plein comme un œuf. Frank rentra et ferma la porte à clé.
Les gens étouffaient malgré la relative fraîcheur des pièces. Frank consulta le tableau de bord de l’ordinateur : 38 °C au rez-de-chaussée. Peut-être un peu moins dans la pièce du climatiseur. Soixante pour cent d’humidité. C’était bizarre, inhabituel, d’avoir à la fois de fortes températures et une forte humidité ; durant la saison sèche de la plaine indo-gangétique, de janvier à mars, il faisait plus frais et moins humide, puis la température montait mais pas l’humidité, jusqu’à ce que le déluge de la mousson fasse de nouveau baisser le thermomètre, avec des nuages omniprésents qui protégeaient du soleil. Mais cette canicule-ci était différente. Grosses chaleurs, pas de nuages, beaucoup d’humidité. Un mélange très dangereux.

La clinique disposait de deux salles de bains. Dont les toilettes cessèrent vite de fonctionner. Sans doute les égouts menaient-ils à un centre de traitement des eaux usées marchant bien sûr à l’électricité mais sans générateurs pour prendre le relais. Difficile à croire, néanmoins il fallait faire avec. Frank laissa sortir les gens qui avaient des besoins pressants afin qu’ils se soulagent quelque part aux alentours, comme dans ces villages perchés du Népal qui n’avaient jamais vu de toilettes. Frank avait été choqué de découvrir cette réalité. Depuis, il ne préjugeait plus de rien.
Lorsque quelqu’un se mettait à pleurer, d’autres se rassemblaient pour le réconforter. Des vieillards en détresse. Ou de jeunes enfants. Quelques accidents sur les besoins pressants. Frank installa des seaux dans les toilettes, qu’il sortait une fois pleins afin de les déverser dans le caniveau. Un vieil homme succomba ; Frank aida quelques adultes à monter le corps sur le toit, où ils l’enveloppèrent d’une bande de tissu fin, peut-être un sari. Le pire se produisit quelques heures plus tard lorsqu’il fallut faire de même pour un gamin. Tout le monde sanglota tandis que le petit cadavre était évacué vers le toit-terrasse. Frank s’aperçut que le générateur allait bientôt manquer de carburant ; il prit un bidon dans la réserve et remplit le réservoir.
Sa bouteille d’eau était vide. Les robinets ne coulaient plus. Le réfrigérateur contenait deux gros bidons d’eau, dont il omit de révéler la présence aux occupants de la clinique. Il remplit la bouteille à l’un d’eux, dans le noir ; l’eau était encore vaguement fraîche. Puis il se remit au travail.
Quatre autres personnes moururent cette nuit-là. Au matin, le soleil se leva une fois de plus, cet horrible four, brûlant la terrasse et sa sinistre cargaison de corps emmaillotés. En ville, chaque toit-terrasse et, en se penchant sur les murets, chaque trottoir semblait s’être changé en morgue. La ville entière n’était plus qu’une morgue écrasée par une chaleur encore plus atroce que la veille. Le thermomètre indiquait à présent 42 °C et soixante pour cent d’humidité. Frank contempla son écran d’un air morne. Il avait dormi environ trois heures, par intermittence. Le générateur poursuivait sa percussion irrégulière ; le mauvais climatiseur continuait à vibrer. À l’extérieur retentissait le bruit d’autres générateurs et d’autres climatiseurs. Qui ne résoudraient rien.
Frank descendit, ouvrit le coffre-fort et rappela Preeti sur le téléphone satellite. Après vingt, peut-être quarante sonneries, elle décrocha enfin.
— Écoute, on a besoin d’aide, lui dit-il. On est tous en train de crever.
— Qu’est-ce que tu crois ? lâcha-t-elle, furieuse. Que vous êtes les seuls ?
— Non, mais on a besoin d’aide.
— Comme tout le monde !
Frank tenta d’analyser cette phrase. C’était dur de réfléchir. Preeti vivait à Delhi.
— Comment ça va de ton côté ?
Pas de réponse. Preeti avait raccroché.
Les yeux de Frank le piquaient de nouveau. Il les essuya, remonta s’occuper des seaux dans les toilettes. Ils se remplissaient moins vite désormais ; les gens s’étaient vidés. Sans eau, ils allaient tous devoir quitter cet endroit à brève échéance.
Lorsqu’il ouvrit la porte pour rentrer dans la clinique avec les seaux vides, un coup dans le dos le propulsa à l’intérieur. Trois jeunes hommes l’immobilisèrent au sol, l’un d’eux muni d’un pistolet anguleux aussi gros que sa tête. Le regard de Frank plongea dans la gueule du canon, seule partie ronde de cette étrange arme noire. Le monde se résuma soudain à ce petit cercle. Frank sentit son corps se tendre. Le sang battait dans ses veines tandis que la sueur inondait ses paumes et son visage.
— Ne bougez pas, ordonna l’un des autres types. Sinon vous êtes mort.
Les cris provenant des étages supérieurs permettaient de suivre la progression des intrus. Les sons étouffés du générateur et du climatiseur cessèrent brusquement. Le brouhaha de la ville pénétra par la porte restée ouverte. Des passants observaient la scène, curieux, puis s’éclipsaient. Guère nombreux de toute façon. Frank s’efforça de respirer aussi doucement que possible. Son œil droit le piquait violemment, mais il se contenta de le fermer et de détourner l’autre du pistolet. Le devoir lui commandait de résister, sauf qu’il voulait vivre. Il avait l’impression de se contempler depuis l’escalier, loin de son corps, loin de tout sentiment ou sensation, à l’exception de la douleur dans son œil.
Ces gens s’inquiétaient pour lui, craignaient une blessure. Leur sollicitude le bouleversa. Les larmes atténuèrent l’irritation de ses yeux.
Les jeunes voleurs redescendirent d’un pas lourd, portant générateur et climatiseur. Ils disparurent aussitôt dans la rue. Les hommes qui maintenaient Frank à terre le relâchèrent.
— On en a plus besoin que vous, expliqua l’un d’eux.
Celui qui tenait le pistolet se renfrogna à ces mots. Il pointa l’arme vers Frank une dernière fois.
— C’est votre faute, ce qui nous arrive.
Puis ils partirent à leur tour en claquant la porte derrière eux.
Frank se releva, se frotta les bras là où ses agresseurs l’avaient empoigné. Son cœur battait la chamade. Son estomac se soulevait. Une poignée d’occupants de l’immeuble descendirent lui demander comment il allait. Ces gens s’inquiétaient pour lui, craignaient une blessure. Leur sollicitude le bouleversa. Écrasé par une émotion soudaine, il s’assit sur la première marche de l’escalier et se cacha le visage dans les mains. Les larmes atténuèrent l’irritation de ses yeux.
Au bout d’un moment, il parvint à se lever.
— Il faut aller au lac, leur dit-il. Il fera plus frais. Dans l’eau et sur la rive.
Plusieurs femmes froncèrent les sourcils.
— Peut-être, mais il y a trop de soleil, protesta l’une d’elles. Attendons la nuit.
— C’est vrai, admit Frank en hochant la tête.
Il retourna à la petite échoppe en compagnie du propriétaire. Il se sentait à la fois faible et nerveux. L’impression d’être dans un sauna s’abattit de nouveau sur lui. Malgré cela, il réussit à faire six voyages avec des sacs de boissons et de nourriture. En dépit de son épuisement, il se comptait encore parmi les plus costauds du groupe. Même si certains autres semblaient capables de poursuivre cette tâche toute la journée. Personne ne parlait durant les trajets. Personne ne croisait son regard.
— On reviendra plus tard, finit par dire le propriétaire.
La journée s’écoula avec lenteur. Les cris de désespoir se changèrent peu à peu en gémissements. Les gens avaient trop chaud, trop soif pour s’agiter, même quand leurs enfants mouraient. Des yeux rouges au fond de visages bruns regardaient Frank tituber tandis qu’il aidait à monter de nouveaux cadavres sur le toit, où ils rôtissaient au soleil. Les corps risquaient de pourrir mais pouvaient aussi se dessécher à force de cuire. Aucune odeur ne se propageait sous une telle chaleur à part celle de l’air brûlant lui-même. Ou peut-être que si : des relents soudains de viande avariée. Plus personne ne s’attardait sur le toit-terrasse. Frank y dénombra quatorze cadavres enveloppés, adultes et enfants. Il aperçut au loin des gens engagés dans le même ouvrage, pressés, graves, les yeux baissés. Il était le seul à prendre le temps d’observer les alentours.
À l’intérieur, nourriture et boissons étaient déjà épuisées. Frank compta les occupants de l’immeuble, au prix d’un gros effort. Environ cinquante-deux personnes. Il s’assit dans l’escalier un long moment, puis se rendit à la réserve et étudia ce qu’elle contenait. Il remplit sa bouteille, but avec avidité, la remplit de nouveau ; l’eau n’était plus fraîche mais pas encore chaude. Le bidon d’essence permettrait de brûler les corps s’il fallait en arriver là. Quant au second générateur, il n’avait plus rien d’utile à faire fonctionner. Le téléphone satellite était chargé mais qui contacter ? Frank songea un instant à appeler sa mère. « Salut Maman, je suis en train de crever. » Non, mauvaise idée.

Le jour s’étira, seconde par seconde, jusqu’à sa dernière heure. Frank s’adressa alors au propriétaire de l’échoppe et à ses amis, qui marmonnèrent leur accord : le moment était venu d’aller au lac. Ils secouèrent les autres, leur expliquèrent le plan, aidèrent ceux qui peinaient à se lever et à descendre l’escalier. Certains n’y parvinrent pas, ce qui posa un sacré dilemme. Quelques vieillards affirmèrent vouloir se reposer encore un peu, aller au lac plus tard ; ils dirent au revoir à ceux qui partaient, comme si tout était normal, mais leurs yeux les trahissaient. Beaucoup de gens pleuraient en quittant la clinique.
Ils progressèrent ensemble dans les ombres de la fin d’après-midi. Il faisait plus chaud que jamais. Personne dans la rue ni sur les trottoirs. Aucun cri en provenance des immeubles. Quelques bruits de générateurs, de climatiseurs, étouffés par l’air torride.
Une fois au lac, ils découvrirent une scène de désolation. D’innombrables têtes en parsemaient la surface, près des rives mais aussi là où l’eau était plus profonde, corps appuyés sur un quelconque radeau improvisé. Sauf qu’il y avait des morts parmi les baigneurs. Des miasmes s’élevaient du lac, une odeur de viande pourrie perceptible même par des narines brûlées de chaleur.
Le groupe convint qu’il serait mieux, dans un premier temps, de s’asseoir au bord de l’eau et d’y plonger les jambes. Il restait un peu de place disponible là où la promenade s’achevait ; ils s’y rendirent d’un pas lourd et s’assirent en rang d’oignons. Sous leurs fesses, le béton recrachait la chaleur absorbée durant la journée. Ils suaient tous, sauf ceux qui n’y parvenaient plus, la peau d’une rougeur incandescente au sein des ombres. Tandis que le crépuscule s’installait, il fallut soutenir ces personnes, les aider à mourir. L’eau du lac était aussi chaude que celle d’une baignoire, à l’évidence plus chaude qu’un corps humain. De l’avis de Frank, plus chaude qu’à son premier passage dans la matinée. Logique, malheureusement. Il avait lu que si toute l’énergie du soleil frappait la Terre au lieu d’être repoussée en grande partie, la température monterait au point de faire bouillir mers et océans. Facile à imaginer : l’eau du lac ne semblait qu’à quelques degrés de l’ébullition.
Pourtant, lorsque la nuit remplaça le crépuscule, ils décidèrent tous d’entrer dans l’eau. La sensation était meilleure. Leur chair le réclamait. Ils s’assirent sur une langue de terre immergée, la tête hors de l’eau, tentant de supporter la chaleur.
À côté de Frank se trouvait un jeune homme qui avait joué le rôle de Karna dans une pièce lors de la mela locale. Frank sentit de nouveau l’émotion l’étreindre, comme lorsque ses compagnons s’étaient inquiétés de lui. Il se rappelait l’instant où Arjuna, ayant vaincu Karna en lui jetant un sort, s’apprêtait à le tuer ; le voisin de Frank s’était alors écrié d’une voix triomphante : « Ce n’est que le destin ! » avant de périr sous l’épée de son ennemi. À présent, le jeune homme buvait de petites gorgées d’eau du lac, les yeux écarquillés par la peur et le chagrin. Frank détourna le regard.
La chaleur lui monta peu à peu à la tête. Il s’imagina bondir hors du lac en quête de ce bain d’eau glacée qui devrait jouxter tous les saunas, sentir la morsure bénie du froid lui expulser l’air des poumons, comme il s’y était essayé une fois en Finlande. Les habitués conseillaient de maximiser l’écart de température, de voir ce que ça faisait d’encaisser un différentiel de 50 °C en une seconde.
Accepter l’eau chaude dans son estomac signifiait qu’il n’y avait plus de refuge nulle part, que le monde était à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, dans les deux cas bien plus chaud que la température normale d’un corps humain.
Mais de telles pensées rendaient la situation encore moins tenable. Frank goûta l’eau du lac, chaude, fétide, gavée de matières organiques d’origine inconnue. Il souffrait d’une soif inextinguible. Accepter l’eau chaude dans son estomac signifiait qu’il n’y avait plus de refuge nulle part, que le monde était à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, dans les deux cas bien plus chaud que la température normale d’un corps humain. Les baigneurs se faisaient pocher dans le lac. Frank but discrètement à sa bouteille ; l’eau était tiède, pas trop chaude, et pas sale. Son corps en avait tant besoin qu’il avala tout d’un coup.
Autour de lui, les gens mouraient de plus en plus vite. Toute forme de fraîcheur avait disparu. Les enfants étaient déjà morts, de même que les vieillards. Les autres marmonnaient ce qui aurait dû être des clameurs endeuillées ; ceux qui pouvaient encore bouger sortaient les cadavres de l’eau ou les poussaient vers le centre du lac, où ils flottaient tels des troncs d’arbre avant de couler.
Frank ferma les yeux et tenta de ne pas écouter les voix qui l’entouraient. Il posa sa nuque sur le rebord en béton, puis s’enfonça dans la boue jusqu’à s’y figer, ne laissant qu’une partie de sa tête exposée à l’air brûlant.
La nuit s’écoula peu à peu. Seules les étoiles les plus brillantes étaient visibles, lueurs floues en surplomb. Une nuit sans lune. Des satellites passaient parfois, d’est en ouest ou d’ouest en est, une fois même du nord au sud. Donc des gens observaient, sachant ce qui se produisait. Sachant mais n’intervenant pas. Ne pouvant pas. Ne voulant pas. Rien à faire, rien à dire. Pour Frank, cette nuit dura des années. Lorsque le ciel s’éclaircit, s’affichant d’abord gris, comme voilé de nuages, puis d’un bleu éclatant, Frank s’efforça de bouger. Le bout de ses doigts était fripé. Il avait été poché, oui, cuit et recuit à petit feu. Dur de soulever la tête ne serait-ce que d’un centimètre. Il risquait pourtant de se noyer. Cette idée le força à remuer. Il s’appuya sur les coudes, se redressa. Ses muscles semblaient n’être que des spaghettis trop cuits collés aux os, mais ses os s’occupaient de tout, de leur propre chef. Il parvint à s’asseoir. L’air demeurait plus chaud que l’eau. De l’autre côté du lac, il vit les premiers rayons de soleil frapper le sommet des arbres, qui parurent s’enflammer. Tournant très doucement la tête, Frank scruta le lac. Tout le monde était mort.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Le Ministère du futur est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Lava
- La revue des médias
- Le Grand Continent
- Le Diplo
- Le Nouvel Obs
- Lundi Matin
- Mouais
- Multitudes
- Politis
- Regards
- Smolny
- Socialter
- The Conversation
- UPMagazine
- Usbek & Rica
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- Contretemps
- A Contretemps
- Alter-éditions
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- Philo Mag
- Terrestres
- Vie des Idées
- ARTS
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
- Fiabilité 3/5
- Slate
- Ulyces
- Fiabilité 1/5
- Contre-Attaque
- Issues
- Korii
- Positivr