23.02.2026 à 17:15
Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
Maria Clotilde Camboni, Honorary Research Fellow, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford
Texte intégral (1973 mots)

On a coutume de dire « servi sur un plateau d’argent ». Mais c’est grâce au décor peint d’un plat en céramique qu’a été résolue une petite énigme historique, en découvrant que la « première dame de la Renaissance », Isabelle d’Este, était la propriétaire d’un manuscrit aujourd’hui conservé à Paris.
Cette céramique, de style majolique, comporte trois imprese, c’est-à-dire des emblèmes qui étaient utilisés à la Renaissance comme insignes personnels. On voit, sous un blason, une partition musicale ; sur une balustrade au premier plan, on peut lire la devise latine Nec spe nec metu (« Ni par l’espoir ni par la crainte ») et, répété deux fois, un nombre latin, XXVII (27).
J’avais déjà vu ce numéro quelques années auparavant, dans une décoration figurant sur la première page d’un manuscrit à la Bibliothèque nationale de France à Paris, non loin de l’endroit où le plat en majolique était exposé, prêté temporairement par le Victoria-and-Albert Museum à la Fondation Al Thani Collection. Le manuscrit était une copie partielle d’un manuscrit perdu, et j’essayais de déterminer d’où il provenait.
Les armoiries et les différentes « imprese » étaient toutes celles d’Isabelle d’Este (1474-1539), marquise de Mantoue, fille d’Hercule Ier d’Este duc de Ferrare et d’Éléonore d’Aragon, fille du roi de Naples Ferdinand Ier. La réponse m’est soudain apparue comme une évidence : le manuscrit parisien se trouvait à l’origine dans sa bibliothèque personnelle.

Bien qu’elle se soit mariée à seulement 16 ans, Isabelle était une femme extrêmement cultivée. Cela l’a probablement aidée à jouer son rôle dans la gouvernance de Mantoue, en particulier lorsque son mari Francesco Gonzaga (dit François II de Mantoue) partit combattre dans les guerres italiennes, puis fut fait prisonnier. Elle disposait également de ressources financières personnelles considérables et était libre de dépenser son argent comme elle le souhaitait, ce qui lui a permis de devenir la plus importante collectionneuse de la Renaissance italienne.
Mécène des arts, Isabelle a été représentée sur des médailles, des peintures et des dessins par plusieurs artistes, dont Léonard de Vinci. Pour abriter ses antiquités et ses œuvres d’art, elle a aménagé certaines pièces de ses appartements. L’une d’elles était connue sous le nom de studiolo, une pièce consacrée à la lecture et à l’écriture privées. De nombreux artistes de renom ont été chargés de réaliser des peintures pour le décorer, de même que son appartement à Mantoue, où elle s’est installée après la mort de son mari en 1519.
La vaste bibliothèque d’Isabelle y était également conservée. Un inventaire partiel dressé après sa mort révèle qu’elle ressemblait davantage aux bibliothèques des hommes de l’élite de la Renaissance qu’à celles des femmes nobles de son époque. Elle se composait principalement d’ouvrages contemporains et profanes, plutôt que de volumes hérités et de textes religieux, et contenait une proportion inhabituellement élevée de livres manuscrits.
Au cours de sa vie, Isabelle utilisa au moins huit imprese différentes. Il pouvait s’agir de marques de propriété, comme on le voit sur le manuscrit parisien et l’assiette du Victoria-and-Albert Museum, ainsi que sur les 23 autres pièces survivantes de son service de table. Cependant, elles étaient également destinées à transmettre des messages codés.
Une impresa de la Renaissance contenait une sorte de déclaration personnelle concernant la situation, la philosophie, les aspirations et les qualités personnelles de son titulaire. Contrairement aux armoiries, qui étaient héritées, elle n’exprimait rien en rapport avec la lignée familiale ou le statut social, pouvait être utilisée par toute personne qui décidait d’en concevoir une et pouvait être modifiée ou abandonnée à volonté.
Comme sa véritable signification nécessitait une interprétation, une impresa était souvent ambiguë. Les silences (pauses dans la musique) visibles sur la partition musicale représentés sur ce plat peuvent signifier le silence, une vertu associée aux femmes à l’époque. Par leur symétrie, ils peuvent aussi symboliser un principe d’équilibre, à l’instar de la devise latine. Quelle que soit sa signification, c’est celle qu’Isabelle a choisie pour orner les robes qu’elle portait lors d’occasions spéciales, notamment le mariage de son frère Alphonse avec Lucrezia Borgia en 1502.

La marquise n’appréciait pas les explications trop compliquées de ses imprese. En 1506, lorsque l’auteur Mario Equicola écrivit un livret sur sa devise latine, elle déclara dans une lettre à sa mécène, une femme de la noblesse, « nous ne l’avons pas créée avec autant de mystères qu’il lui en a attribués ».
La devise latine d’Isabelle fut, fait inhabituel, réutilisée par d’autres, notamment par l’un de ses fils et par un roi d’Espagne. Ce ne fut pas le cas de l’énigmatique nombre XXVII. Sa présence sur la première page du manuscrit parisien prouve donc qu’il appartenait à Isabelle.
Il existait déjà d’autres indices de cette appartenance. Le manuscrit parisien est une copie partielle de la Raccolta Aragonese, une anthologie de poèmes italiens anciens rares, offerte par l’homme d’État Lorenzo de Médicis à Federico d’Aragona, fils du roi de Naples, vers 1477. Dernier souverain de sa dynastie, Federico s’exila en France avec ses livres.
Après sa mort, la plupart de ses livres sont passés entre les mains de sa veuve, qui s’est installée à Ferrare sous la protection de la famille d’Isabelle. Ses lettres révèlent que, en janvier 1512, elle a réussi à emprunter la collection :
« Le livre des premiers poètes vernaculaires que Votre Majesté a eu la bonté de me prêter, je le conserverai avec tout le respect et la révérence qui lui sont dus, et il ne tombera entre les mains de personne d’autre. Dès que j’aurai fini de le lire, je le renverrai à Votre Majesté, que je remercie pour sa grande humanité à mon égard. »
Isabelle ne mentait pas. Elle voulait ce livre en raison de la rareté de son contenu, et elle aimait être la seule ou presque la seule propriétaire des textes. Nous pouvions déjà émettre l’hypothèse qu’elle en avait commandé une copie, et nous savons maintenant que c’est vrai. Grâce à son initiative, ces poèmes rares ont bénéficié d’une plus large diffusion, mais ni elle ni son correspondant n’auraient pu le prévoir.
Maria Clotilde Camboni ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
20.02.2026 à 17:53
Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres
Christian-Georges Schwentzel, Professeur d'histoire ancienne, Université de Lorraine
Texte intégral (4285 mots)
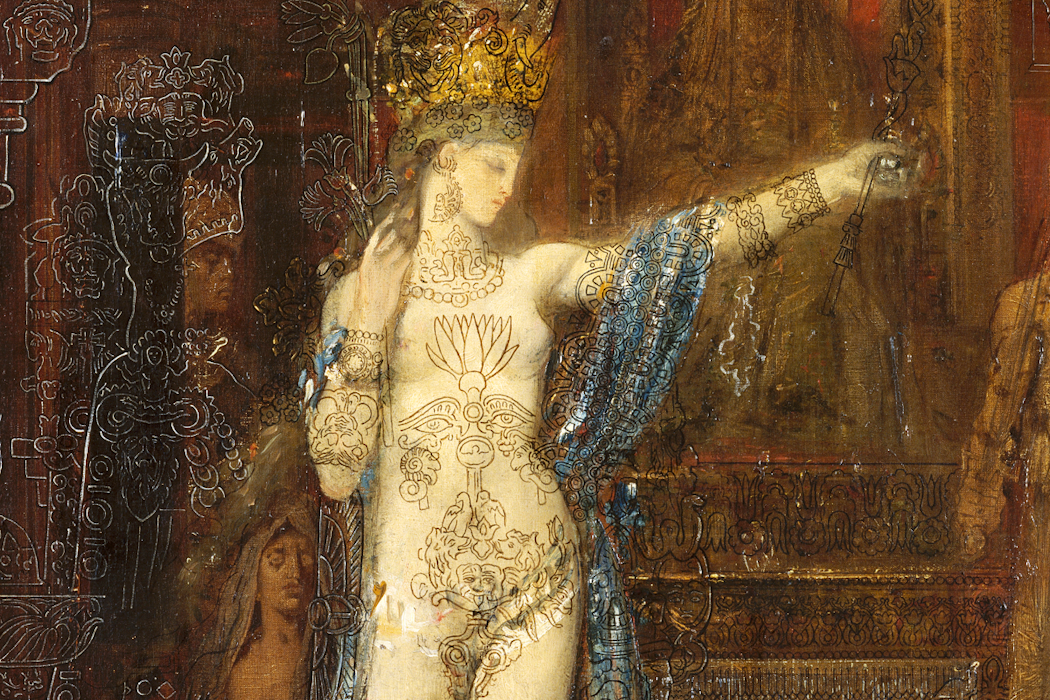
L’exposition « Salomé, Henner et Moreau face au mythe », au musée national Jean-Jacques-Henner, à Paris, qui se tient du 18 février au 22 juin 2026, présente au public une trentaine de peintures et de dessins figurant la danseuse biblique, incarnation de la séduction féminine.
De courts passages des Évangiles mettent en scène Salomé à l’occasion de la fête d’anniversaire de son grand-oncle, Hérode Antipas, gouverneur, ou tétrarque, de Galilée et de Pérée, au nord et à l’est de la Judée, pour le compte des Romains, vers 29 de notre ère.
La jeune fille « vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives » raconte l’Évangile selon Marc (Mc 6, 22). Pour qu’elle accepte de se donner en spectacle, Antipas avait promis une forte récompense à sa petite-nièce : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume », lui avait-il assuré.
Une promesse bien excessive. Salomé qui n’a rien d’une innocente jeune fille va en tirer profit. Une fois sa prestation accomplie, elle exige comme salaire « sur un plat, la tête de Jean le Baptiste ». Le prophète, précurseur du Christ pour les chrétiens, est alors décapité sur ordre d’Antipas pour satisfaire la demande de l’adolescente.
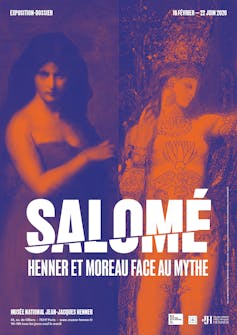
Le récit évangélique est très bref. Il n’en produit pas moins, dans l’esprit des lecteurs, de fortes images mentales, propices à la rêverie. On y trouve trois ingrédients étroitement liés : une jeune fille, une danse, un meurtre.
Ainsi, une princesse qu’on imagine particulièrement charmante, sans quoi son grand-oncle n’aurait pas insisté outre mesure pour la voir danser, est-elle capable, contre toute attente, de provoquer l’exécution d’un saint homme. Cette ambivalence constitue le moteur du fantasme « Salomé » qui associe le désir et la mort.

La bacchante impudique
Plus tard, Saint Augustin (354-430) a contribué à populariser la figure de Salomé, de manière paradoxale, puisque son but était de condamner la femme réputée impudique. En décrivant une danse érotique effrénée, il fixe définitivement ce qui jusque-là n’avait été que suggéré par les Évangiles : « Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs ; tantôt, en présence de ces hommes, elle fait parade de ses seins » (seizième sermon Pour la décollation de saint Jean-Baptiste).
À l’époque où écrit l’auteur, les cultes polythéistes sont encore présents dans l’Empire romain. Augustin se souvient sans doute des images de bacchantes, ces femmes de la mythologie grecque, adeptes de Bacchus ou Dionysos et dépeintes comme des danseuses déchaînées.
Sur un grand vase en bronze doré, découvert à Derveni, dans le nord de la Grèce, aujourd’hui au musée archéologique de Thessalonique, on peut voir une bacchante en délire, dont un sein dénudé bondit par-dessus sa tunique. Les courbes de son corps ne manquent pas d’exciter le satyre, être hybride mi-homme mi-bouc, dont le phallus se dresse à gauche de la danseuse.
Au XVe siècle, le peintre italien Benozzo Gozzoli s’inspire à son tour de ces antiques images, comme le montrent les mouvements du drapé de sa Salomé. Alléché, Hérode Antipas, pose sa main droite sur son cœur, siège du désir amoureux, tandis que, de l’autre, il serre fortement un couteau phallique pointé vers le haut.

La danseuse orientale
Au XIXe siècle, la figure de la bacchante antique fusionne avec celle de la danseuse du ventre, alors que le mouvement orientaliste triomphe en Occident dans l’art et la littérature. Gustave Flaubert dans « Hérodias », l’un de ses Trois Contes (1877), joue un rôle majeur dans ce processus d’identification. Pour décrire Salomé, il s’inspire des danseuses égyptiennes Kuchuk Hanem et Azizeh qu’il a rencontrées lors d’un voyage dans la vallée du Nil :
« Les paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins. »
La Salomé de Flaubert devient le prototype de la danseuse orientale qui va fasciner le public occidental pendant plusieurs décennies.
En 1891, Oscar Wilde, s’inspire de Flaubert dans sa pièce de théâtre Salomé, tout en inventant le thème de la danse des sept voiles, striptease oriental en plusieurs étapes, qui sera mis en musique par Richard Strauss, en 1905.
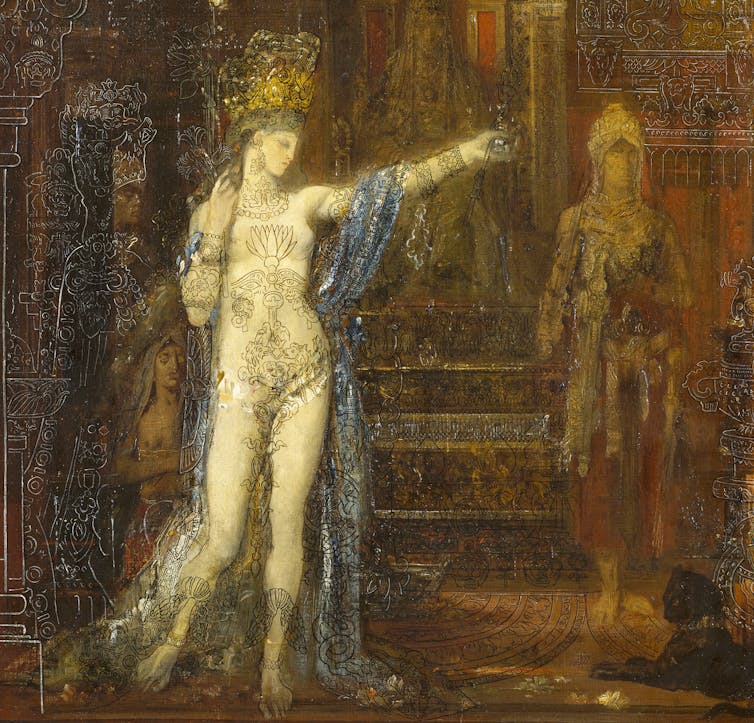
C’est dans ce contexte d’orientalisme occidental, associant érotisme et exotisme, que s’inscrit l’œuvre de Gustave Moreau (1826-1898). S’y ajoute la découverte archéologique de l’Égypte antique et notamment de fresques montrant des banquets, des musiciennes et des danseuses dénudées sur les parois d’antiques tombeaux.

Gustave Moreau réalise plusieurs peintures et dessins figurant Salomé, notamment une Salomé dansant, commencée en 1874 et retouchée jusque dans les années 1890, qui compte parmi des chefs d’œuvres de l’artiste. La princesse, déhanchée, se déshabille de son long drapé bleu ; elle lève le bras gauche, signe qu’elle va commencer sa danse.

Si son corps est inspiré des Vénus de la sculpture gréco-romaine, avec ses petits seins, ses larges hanches et la blancheur de sa nudité qui évoque le marbre, les motifs qui le couvrent, à la manière de tatouages, font directement référence à l’Égypte pharaonique.
On y trouve des cobras égyptiens, une fleur de lotus, des amulettes en forme d’œil Oudjat, associé au dieu Horus, ou encore un scarabée ailé, symbole de résurrection, et des têtes de bélier qui évoquent Amon.
À lire aussi : Les prêtresses de l’Égypte ancienne : entre érotisme et religion
La technique de surimpression elle-même a pu être suggérée au peintre par des momies de femmes égyptiennes aux corps tatoués, mises au jour depuis le XIXᵉ siècle dans la vallée du Nil.
Il en résulte une œuvre où, malgré l’effeuillage de la princesse, c’est en fin de compte l’énigme et le mystère qui prédominent.
Jeunesse, beauté et mystère
Dans les années 1890, Jean-Jacques Henner (1829-1905) s’empare à son tour de la séduisante princesse qu’il traite d’une manière très différente de Moreau. Les thèmes de l’Orient et de la danse s’estompent comme des accessoires secondaires aux yeux du peintre.


Henner se concentre sur l’essentiel selon lui : la jeunesse et la beauté charnelle émergeant d’une brume mystérieuse. Il peint une adolescente au regard trouble, longs cheveux et épaules dénudées, tenant contre elle le grand plateau de cuivre, discret élément oriental, sur lequel elle va recevoir la tête du saint décapité. La chair, pâle et brillante de la jeune fille, est mise en valeur par le contraste avec sa tunique de couleur unie, bleue (prototype vers 1892) ou rouge (variante de 1904), et le fond très sombre. La beauté de la chair paraît sortie d’un songe aux contours flous mais terriblement captivants.

Déhanchements et culture de masse
Dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, l’apogée du mythe « Salomé » n’en est pas moins limité à une élite cultivée, intellectuelle et bourgeoise, « fin de siècle ». Contrairement à Cléopâtre, autre figure fantasmée héritée de l’Antiquité, elle ne fera que des apparitions très brèves et peu marquantes dans la culture de masse au XXᵉ siècle. Salomé tombe progressivement dans l’oubli.
Le fantasme de l’effeuillage exotique est dissocié de son prototype biblique. La danseuse lascive va triompher auprès du grand public sous d’autres noms, comme Mata Hari, prétendue princesse javanaise adepte du dieu hindou Shiva qui fascine Paris et l’Europe occidentale à la veille de la Première Guerre mondiale. La cruauté de la femme fatale est gommée au profit de ses seuls appâts physiques et érotiques.

En 2006, dans la continuité de ces ondulations sensuelles remontant à l’Égypte pharaonique, Shakira et Beyoncé remportent un succès mondial avec leur clip intitulé Beautiful Liar, qui offre étonnant mélange de RnB et de danse arabe. Les déhanchements rythmés s’accompagnent désormais de paroles féministes : il n’est plus question de la décapitation d’un prophète, mais d’un pervers narcissique que les deux interprètes décident conjointement de bannir de leur existence. Une décision salutaire !
Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.02.2026 à 17:02
La mort de Dawson, ou le deuil de toute une génération
Vladimir Lifschutz, Maître de conférences, Université Paul Valéry – Montpellier III
Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Texte intégral (1957 mots)

Le 11 février 2026, James Van Der Beek mourait d’un cancer, à l’âge de 48 ans. Acteur central de la série Dawson (1998-2003), il fut le visage de Dawson Leery pendant les six saisons du show. « Teen drama » se situant dans la petite ville états-unienne fictionnelle de Capeside, tournée avec un petit budget lors de la première saison, et des acteurs majoritairement inconnus, la série est devenue un phénomène mondial à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La disparition de son interprète entraîne une multitude de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, car c’est un choc pour toute une génération : Dawson est mort.
Plan large d’un crépuscule sur un cours d’eau, apparition d’une maison typiquement américaine dans la nuit dont seule une fenêtre est éclairée, puis travelling vers la chambre et gros plan sur deux adolescents hypnotisés par une télévision cathodique. En trois images, Dawson’s Creek (titre français, Dawson, ndlr) entre dans les foyers américains en 1998 avec, déjà, un métadiscours sur « le pouvoir de la fiction ».
Aujourd’hui, avec la disparition de James Van Der Beek, la rivière de Capeside, la chambre tapissée des affiches de films de Steven Spielberg, le générique porté par la chanson de Paula Cole, tout reprend vie dans la mémoire d’une génération qui a grandi devant ces adolescents pas tout à fait comme les autres.
La puissance mémorielle de la série en fait une œuvre générationnelle. Car cette fiction a su, en son temps, faire la synthèse d’une époque, d’une jeunesse, de ses aspirations, de ses doutes et de ses espoirs. Jeunesse qui pouvait s’identifier à quatre personnages : Dawson, Joey, Jen et Pacey. Partant des archétypes popularisés par le cinéma dès les années 1950 avec la Fureur de vivre (1955), de Nicholas Ray, le créateur cinéphile Kevin Williamson réinvestit le genre pour le pétrir à sa manière autour des figures du geek intellectuel, du garçon manqué, de la blonde incendiaire et du sempiternel bad boy.
La vie est un film (ou une série)
Kevin Williamson est avant tout un auteur. Il est le scénariste à succès du premier volet de Scream en 1996, suivi de Souviens-toi… l’été dernier en 1997 – deux slashers (_sous-genre du film d’horreur, ndlr*) pour adolescents dans lesquels il joue allégrement de sa passion pour le cinéma à travers un métadiscours resté célèbre, incarné par le tueur au masque blanc inspiré du célèbre tableau le Cri, d’Edvard Munch.
Cinéphile averti, Williamson se lance en 1998 dans la production d’une série tournée dans le Massachusetts, influencée par sa propre adolescence : une fiction se déroulant dans une ville rurale américaine où des adolescents de 15 ans s’éveillent à leur désirs, à leurs pulsions et à leurs espoirs.
Dès le pilote, la série cite le cinéma, à la fois comme source narrative mais aussi comme métadiscours. L’arrivée de Jen en ersatz de Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (1959), de Billy Wilder, la femme fatale incarnée par l’enseignante Tamara Jacobs qui rejoue le Lauréat (1967), de Mick Nichols : l’adolescence est passée sur le fil d’une cinéphilie protéiforme qui en fait toute l’originalité. Comme le dit Dawson lui-même, il regarde des films pour trouver des réponses aux questions de la vie. La cinéphilie se fait apprentissage du réel.
La maturité par la fiction
Dawson n’est pas la seule série à avoir traité de l’adolescence par ses intrigues romantiques (triangle amoureux, séparation, retrouvailles…) ni la seule à avoir usé de musique lacrymale dès qu’une émotion affleure dans le récit. Cependant, elle est l’une des seules à avoir vu l’adolescence comme une période intelligible.
Kevin Williamson a mis en valeur l’intellect de ses héros et dialectisé son rapport à la fiction dans une mise en abîme permanente de la fiction elle-même. Les critiques ont parfois vilipendé la série pour ses dialogues jugés trop développés pour de « simples » adolescents – un élément singulier qui est l’une des clés probables de son succès. L’adolescence y est représentée comme un dialogue exigeant, décisif et profond avec soi-même et avec l’autre, dans cette période perçue comme le carrefour d’une vie adulte ancrée par les choix dictés à un âge où leurs conséquences restent insaisissables.
Dans Dawson, l’amour est semblable à une montagne qu’il faudrait gravir : il s’agit du lieu de l’ultime dévoilement de soi, l’espace le plus intime, là où l’âme peut se révéler. C’est une chose sérieuse traitée avec toute l’intensité propre à l’adolescence. On aime pour la première fois, on est trahi pour la première fois, on rompt pour la première fois. Les personnages intellectualisent leurs sentiments : ils parlent trop, parce qu’ils savent qu’après le verbe ne reste que l’action.
Dès le pilote, les rôles sont inversés, les parents de Dawson se sautent dessus dans le salon familial alors que Joey et lui parlent de leur basculement vers la sexualité. Inversion des mondes où les adolescents doivent être responsables parce que les adultes ne le sont pas. Le monde de l’adolescence n’est pas un espace d’insouciance : c’est un temps où se confrontent l’enfant d’hier et l’adulte de demain, une hydre à plusieurs têtes.
Une série à l’avant-garde
Dawson est l’une des premières fictions sérielles à avoir profité de l’émergence d’Internet comme outil de convergence et de promotion. Comme le note Henry Jenkins dans la Culture de la convergence (2013), la production lance dès 1998 Dawson’s Desktop, un site web donnant accès aux fichiers informatiques du personnage, permettant aux visiteurs de lire ses mails, son journal intime, ses notes de cours, ses brouillons de scénario, et même, pour les plus intrusifs, le contenu de sa corbeille. Les téléspectateurs américains pouvaient se rendre chaque semaine sur le site pour déceler des indices sur le prochain épisode. Avec cet outil transmédiatique qui use de la complicité téléspectorielle pour participer à la fiction, la série s’est construite dans une forme de mimétisme avec les nouveautés technologiques de l’époque (début des mails et des chats en ligne).
« To Love Is to Live »
La série étant inspirée de sa propre adolescence, le créateur a interrogé sa propre maturation au contact de la fiction. Grandir, c’est faire fiction, et c’est particulièrement net dans l’héritage final de la fiction à travers son Series Finale.
Dawson devient réalisateur de série et met en scène sa propre vie à travers un palimpseste de la première saison de la fiction. De son côté, Jen est rongée par un cancer qui ne laisse aucun espoir de rémission. Elle demande alors l’aide de Dawson pour enregistrer un message vidéo à destination de sa fille. Dans cette séquence, la série met en scène un double discours d’adieu qui s’adresse autant à l’enfant fictif de Jen qu’aux téléspectateurs. Ce discours en forme d’héritage symbolise la note d’intention d’une fiction qui a eu pour piliers l’imagination, l’amour et la foi. Sous le regard attristé de Dawson, Jen se livre à la caméra et révèle que la série elle-même est un héritage laissé à l’attention de celles et ceux qui l’ont regardée. Jen achève son message ainsi : « To Love Is to Live. » Un acte réflexif qui interroge la mortalité par la fiction renvoyant à notre propre condition selon Martin Julier-Costes.
Jen reprend les commandes de son récit par la fiction, elle se place au centre du cadre et raconte une vie d’épreuves. Dawson, lui, remet en scène son adolescence dans une série à l’intérieur de la série. Dans les deux situations, il est question de résilience par la fiction. La maturité devient un acte d’acceptation, l’ultime étape du deuil. La série vient clarifier un discours qui l’a toujours habité : la fiction est le seul moyen de grandir. Qu’importe qui vit, qui meurt, qui réalise ses rêves, à la fin reste la fiction.
À lire aussi : « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
La chambre de tous les possibles
Dawson a su accompagner une génération dans le début d’un nouveau siècle avec le réconfort de sa figure tutélaire : la fiction. Dans une période pré-11 septembre (les deux dernières saisons sont diffusées après l’attentat), la série a capté un temps évanescent, le crépuscule d’une jeunesse sans iPhone, sans réseaux sociaux, où l’écran n’est encore qu’une télévision cathodique dans une chambre, objet réconfortant depuis lequel on regarde de vieux films en rêvant d’en faire de nouveaux.
La chambre de Dawson est un témoin : celle d’un monde disparu que nous avons tant aimé parce que c’est un peu aussi notre chambre. Dans cet espace, chacun a dialogué avec sa Joey ou son Dawson, en vrai ou en fiction. Cette chambre n’existe plus. Mais il nous reste la fiction.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
18.02.2026 à 17:01
Les Anglo-Saxons, grands amateurs d’anniversaires littéraires
Amy Wilcockson, Research Fellow, English Literature, Queen Mary University of London
Texte intégral (2023 mots)
Pourquoi certains écrivains traversent-ils les siècles quand d’autres sombrent dans l’oubli ? Derrière les grandes célébrations littéraires se jouent des mécanismes complexes de reconnaissance, de transmission et d’appropriation collective.
L’an dernier marquait le 250e anniversaire de la naissance de la romancière anglaise Jane Austen. La rédaction britannique de The Conversation a célébré cet important jalon littéraire avec une série d’articles et un podcast spécial, « Jane Austen’s Paper Trail ». Cette année spéciale a donné lieu à de nombreux événements de grande visibilité à travers le Royaume-Uni, des bals Régence aux projections de films, en passant par des visites thématiques et des conférences littéraires.
Mais les anniversaires littéraires ne concernent pas uniquement des auteurs célèbres et unanimement célébrés, aussi importants soient-ils. De nombreuses dates passent inaperçues, alors même que nous traversons une période faste en matière de dates clés de l’histoire littéraire.
Un grand nombre de commémorations
Les années 2020 ont été marquées par une succession de grands anniversaires liés au romantisme, notamment les bicentenaires de la mort des poètes John Keats (2021), Percy Bysshe Shelley (2022) et Byron (2024). L’anniversaire de Jane Austen, l’an dernier, a été particulièrement marquant tant l’autrice a fait l’objet d’un engouement large et enthousiaste.
Mais c’était aussi l’année du centenaire de Gatsby le Magnifique, le grand classique de l’âge du jazz, de F. Scott Fitzgerald, ainsi que de Mrs Dalloway, œuvre phare du modernisme signée Virginia Woolf. Retour à Brideshead, d’Evelyn Waugh, la Ferme des animaux, de George Orwell, et À la poursuite de l’amour, de Nancy Mitford ont tous fêté leurs 80 ans, tandis que le classique de la littérature jeunesse le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique de C. S. Lewis célébrait son 75e anniversaire. (NDT : En France, on célébrait entre autres les cent ans des Faux-Monnayeurs, de Gide, ou le centenaire de la naissance de Roger Nimier*.)
2026 ne dérogera pas à la règle
L’année 2026 sera elle aussi riche en grands anniversaires, avec notamment le tricentenaire des Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, et les 200 ans du Dernier Homme, de Mary Shelley, un roman toujours d’actualité publié en 1826 et consacré à la quasi-extinction de l’humanité après une pandémie mondiale (NDT : En France, on célébrera notamment les 50 ans de la mort d’André Malraux ainsi que les 150 ans de celle de George Sand.)
C’est aussi en 1926 que Winnie l’ourson, créé par A. A. Milne, goûtait à son premier pot de miel. La même année intronisait Agatha Christie comme reine incontestée du roman policier, lorsque le Meurtre de Roger Ackroyd, immense succès populaire, s’emparait de l’imagination du public.
Cinquante ans plus tard, son dernier roman, la Dernière Énigme, était publié à titre posthume, après sa mort le 12 janvier 1976. Des rééditions spéciales des livres de Christie, de nouveaux enregistrements en audiolivre, des conférences, des colloques, des adaptations Netflix, et même une grande exposition à la British Library ont été organisés pour célébrer ce jalon majeur de l’histoire littéraire.
Le roman d’Anne Rice Entretien avec un vampire, qui a profondément renouvelé le genre en proposant une figure vampirique plus complexe et nuancée, célèbre lui aussi les 50 ans de sa publication.
D’où vient cette envie ?
Mais pourquoi célèbre-t-on les anniversaires littéraires ? Pourquoi musées, universitaires et grand public se mobilisent-ils pour commémorer nos auteurs préférés ? Et pourquoi certains écrivains bénéficient-ils d’une attention bien plus grande que d’autres ?
D’abord, les anniversaires littéraires sont importants parce qu’ils contribuent à créer un patrimoine commun et à nourrir un sentiment d’unité au sein des communautés et des cultures. Comme l’ont observé les spécialistes de Shakespeare Monika Smialkowska et Edmund G. C King à propos des nombreuses commémorations consacrées au Barde, « chaque événement est aussi l’occasion, pour la communauté qui le commémore, de se célébrer elle-même ».
En 2016, lorsque le Royaume-Uni et le reste du monde ont commémoré le 400ᵉ anniversaire de la mort de Shakespeare, concerts de gala, émissions de pièces de monnaie commémoratives et expositions n’ont été que la partie émergée de l’iceberg. Shakespeare incarne pour beaucoup le sommet de la culture britannique, et nombreux sont ceux qui estiment que ses œuvres restent essentielles parce qu’elles nous permettent d’interroger ce que nous sommes et la place que nous occupons dans le monde.
Les grands événements historiques, eux, ne semblent pas susciter l’imaginaire collectif de la même manière. Et bien sûr, des figures majeures comme Shakespeare ou Austen deviennent universelles. Elles ne sont pas seulement des symboles de la culture britannique : leur notoriété et leur incarnation d’un certain esprit « british » se sont mondialisées. Shakespeare a ainsi été reconnu comme faisant partie de traditions états-uniennes, européennes, africaines et plus largement mondiales. Autre preuve si nécessaire en Nouvelle-Zélande où la Société Jane-Austen d’Aotearoa a célébré l’an dernier son dixième anniversaire.
Marquer ces dates permet de tisser des liens non seulement avec l’époque ou l’univers façonné par un auteur, mais aussi avec d’autres passionnés, autour d’intérêts partagés pour des genres, des textes ou des écrivains. À travers ces commémorations, ce ne sont pas seulement les auteurs que nous célébrons, mais aussi nos réseaux et nos cultures, personnelles, nationales et mondiales.
Nostalgie et tourisme littéraire
Les anniversaires littéraires sont également la manifestation parfaite de la nostalgie, ce sentiment qui consiste à penser qu’un lieu, un événement ou une période du passé est préférable au présent. Les rituels que sont les célébrations d’anniversaire en sont l’incarnation concrète.
C’est ce qui explique que des passionnés se déguisent en tenues de l’époque ou en uniformes militaires, afin de se transporter dans un temps perçu comme moins complexe. De la même manière, lire les œuvres d’un auteur, visiter sa maison ou observer les plumes et les stylos avec lesquels il écrivait invite les visiteurs à faire un pas en arrière, à entrer dans le passé et dans l’univers de l’écrivain.
Il n’est donc pas étonnant que les musées littéraires organisent des événements d’ampleur pour marquer les grandes dates liées à des auteurs majeurs. Le tourisme littéraire est en plein essor et, comme le souligne Travel Weekly, le tourisme autour de Jane Austen est – sans surprise – particulièrement en vogue en ce moment.
Si les chiffres définitifs de fréquentation n’ont pas encore été publiés, un porte-parole de la « Jane Austen’s House » (un cottage dans le Hampshire où l’autrice a vécu et créé ses six romans les plus célèbres) a indiqué qu’ils s’attendaient à dépasser leur moyenne annuelle habituelle de 40 000 visiteurs en 2025.
Ces anniversaires constituent bien sûr un puissant moteur d’attractivité à l’échelle mondiale, au point que de vastes campagnes de marketing sont construites autour de dates symboliques. Ainsi, 2017 avait été désignée par VisitEngland comme l’Année des héros littéraires « Year of Literary Heroes », tandis qu’une campagne interactive baptisée Magical Britain, accompagnée d’une carte dédiée, était lancée pour célébrer les 20 ans de la parution du premier roman Harry Potter.
Les anniversaires de livres et d’auteurs populaires stimulent ainsi l’économie locale et nationale, les visiteurs affluant vers les lieux évoqués dans les œuvres, mais aussi vers les villes natales des écrivains, leurs maisons et leurs tombes.
Mais pourquoi certains auteurs marquent-ils davantage l’imaginaire collectif que d’autres ? L’autrice et universitaire H. J. Jackson explique, dans son ouvrage consacré aux réputations romantiques, que la reconnaissance commence généralement par une édition complète des œuvres d’un écrivain. L’intérêt se développe ensuite à travers des biographies, des traductions et des adaptations. Les textes entrent dans les programmes scolaires, des sociétés se constituent au nom de l’auteur, et ce n’est qu’à ce stade que les célébrations d’anniversaire viennent consacrer l’ampleur de ses accomplissements.
Selon Jackson, pour s’imposer durablement et accéder à une renommée mondiale, un auteur doit parvenir à séduire des publics variés. Au vu de leur rayonnement solide et transversal, il y a peu de doute que Keats, Austen, Orwell et Christie continueront d’être célébrés dans cent ans.
* NDT : Une première version de cet article indiquait par erreur qu'il s'agissait du centenaire de la mort de Roger Nimier.
Amy Wilcockson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.02.2026 à 17:10
Avoir un impact positif sur son lieu de vacances : quel avenir pour le tourisme « régénératif » ?
Élodie Manthé, Maître de Conférences en Sciences de gestion, Université Savoie Mont Blanc
Texte intégral (1821 mots)

Le rêve d’un tourisme 100 % durable se heurte à une réalité plus complexe. Selon le baromètre 2026 de Skift, société d’information sur les voyages et le tourisme basée à New York, l’industrie traverse une phase de désillusion : entre inflation, priorités politiques fluctuantes et réticence des consommateurs à payer plus, les belles promesses écologiques cèdent souvent la place à une gestion de crise pragmatique. Il existe pourtant des initiatives qui permettent de garder espoir.
Dans un article récent, je m’intéresse aux travaux de l’anthropologue Marcel Mauss dans son Essai sur le don de 1925, une œuvre majeure qui éclaire la dimension sociale et symbolique des échanges et qui nous permet d’ouvrir une troisième voie pour résoudre ce dilemme. Selon cette analyse, le tourisme moderne – qui traverse une phase de désillusion – doit dépasser les solutions purement transactionnelles pour s’ancrer dans une dynamique plus humaine et équilibrée. En s’appuyant sur deux exemples extrêmes d’échange étudiés par Mauss – le potlatch et le kula –, l’article propose un outil précieux pour décrypter les excès du tourisme contemporain.
Donner, recevoir et rendre
Le potlatch, pratiqué sur la côte nord-ouest de l’Amérique et décrit au XIXᵉ siècle, consiste à accumuler des biens pour les détruire ou les distribuer de manière ostentatoire, affichant ainsi pouvoir et prestige. C’est le miroir des dérives du tourisme actuel : une surconsommation d’expériences uniques, luxueuses et « instagrammables », où l’accumulation de souvenirs spectaculaires sert de marqueur social. À l’inverse, le kula, rituel d’échange symbolique entre les îles Trobriand, incarne un modèle régénératif. Les objets circulent selon des règles précises, créant des liens durables entre les communautés.
Pour Mauss, la relation de long terme entre communautés est maintenue grâce aux dons qui circulent entre elles au cours du temps, selon un principe immuable : il faut toujours donner, recevoir, et rendre. Ces rituels reposent sur l’idée que le don est un contrat moral qui engage celui qui reçoit à rendre, non par obligation, mais par reconnaissance.
Et si nous appliquions cette philosophie au voyage ? Pour un tourisme vraiment régénératif, il faudrait s’inspirer du kula : privilégier des échanges équilibrés, où les voyageurs ne se contentent pas de consommer, mais s’engagent à respecter les lieux, valoriser les cultures et contribuer au bien-être des territoires visités. Le voyage devient alors un rituel d’échange, bien au-delà d’une simple transaction. En assumant une « dette morale », c’est-à-dire ce que l’on doit à la communauté qui nous accueille, on pose les bases d’une relation authentique et durable.
En somme, l’éthique du voyage de demain se mesure moins à ce que l’on paie qu’à ce que l’on rend. Cette idée peut sembler décalée, voire utopique, dans une société occidentale où le tourisme se réduit souvent à une transaction : on paie, on consomme, on part. Pourtant, à travers le monde, des destinations réinventent l’art du voyage en exigeant des visiteurs qu’ils s’engagent dans une relation de respect et de réciprocité. Ces initiatives, loin d’être anecdotiques, dessinent les contours d’un tourisme plus conscient, où l’hospitalité n’est plus un dû, mais un échange.
Des serments pour voyager autrement
En 2017, l’archipel de Palau, en Micronésie, a lancé une initiative pionnière : le Palau Pledge. Chaque visiteur doit signer, à son arrivée, une déclaration solennelle s’engageant à respecter et préserver l’environnement et la culture locale.
Ce « passeport moral » va au-delà des mots : il s’accompagne d’actions concrètes, comme une vidéo de sensibilisation diffusée à bord des vols vers Palau. Les enfants locaux ont même participé à sa création, renforçant son ancrage communautaire. Résultat ? Palau protège aujourd’hui 80 % de ses eaux grâce à un sanctuaire marin, tout en intégrant la conservation dans son système éducatif.
Autre exemple, inspiré du terme maori tiaki (« protéger »), la charte Tiaki Promise qui invite les voyageurs visitant la Nouvelle-Zélande à adopter des comportements responsables : minimiser leur empreinte écologique, ne laisser aucune trace et aborder la culture locale avec respect. Le serment est clair :
« Je protégerai la terre, la mer et la nature, et je traiterai la culture locale avec un esprit et un cœur ouvert. »
Citons encore l’Aloha Pledge de Kauai, inspirée d’une philosophie hawaïenne millénaire : « He Aliʻi Ka ʻĀina ; He Kauwā ke Kanaka » (« La terre est chef, l’humain est son serviteur »). Les voyageurs s’engagent à respecter la culture, les écosystèmes et les ressources naturelles, en évitant par exemple les crèmes solaires toxiques pour les coraux ou en ne prélevant ni fleurs ni roches.
L’Islande et la Finlande ont également adopté des serments similaires. Le premier, accompagné de capsules vidéo éducatives, encourage les touristes à adopter des comportements écoresponsables pour préserver les paysages islandais. Le second, porté par Visit Finland, vise à faire du pays la première destination touristique durable au monde, en intégrant le respect de l’environnement et des communautés locales.
Un changement de paradigme : le voyage comme échange, non comme consommation
Ces initiatives partagent un point commun : elles replacent l’hospitalité au cœur du voyage. Qu’il s’agisse de garder « le cœur et l’esprit ouverts » en Nouvelle-Zélande, d’interagir « avec bienveillance » à Hawaï, ou de « rester responsable » en Finlande, chaque serment reflète les valeurs profondes de la société qui l’a créé.
Loin d’être de simples effets de mode, ces engagements marquent une volonté de transformer l’état d’esprit des voyageurs. Ils rappellent que voyager, c’est entrer dans un cercle de réciprocité : on reçoit l’hospitalité comme un cadeau, et on s’engage à le rendre, ne serait-ce qu’en respectant la terre et ceux qui nous accueillent. C’est finalement une réponse concrète à l’appel du géographe français Rémy Knafou de « réinventer (vraiment) le tourisme ».
De manière très opérationnelle, Copenhague, la « capitale du cool », a transformé l’engagement écologique et social en une expérience touristique désirable. Avec son programme CopenPay, la ville danoise propose aux voyageurs de prolonger leur séjour pour participer à des actions citoyennes, en échange de récompenses locales. L’idée ? Remplacer le tourisme de consommation par un tourisme de contribution, où chaque visiteur devient acteur de la ville.
Pour s’adapter à tous les profils, Copenhague a imaginé des activités courtes et accessibles, assorties de contreparties immédiates :
ramasser des déchets (trente à soixante minutes) avec l’ONG Drop in the Ocean pour obtenir un bon de réduction de 50 % dans des hôtels du centre-ville ;
jardiner en ville, les jeudis, dans une ferme urbaine, en échange d’un café et d’une discussion avec les bénévoles ;
aider à la production de fraises en introduisant des insectes auxiliaires (une heure) pour gagner un jus de fraises frais.
Contrairement à d’autres initiatives où la responsabilité sociale reste abstraite, CopenPay mise sur l’immersion et la rencontre. Les récompenses (visites guidées, réductions, accès à des lieux insolites) ne sont pas qu’un bonus : elles transforment les touristes en contributeurs, leur offrant une expérience authentique, proche de celle des locaux.
Cette approche répond à une quête croissante d’authenticité, sans tomber dans la théâtralisation. Les actions sont utiles, courtes et peu contraignantes, mais surtout, elles créent du lien social. Comme le soulignent les recherches récentes, c’est la dimension relationnelle qui rend ces expériences mémorables et souhaitables.
On peut toutefois se demander si le tourisme durable ne représente pas non pas une rupture mais une intégration progressive des principes du développement durable dans les activités touristiques existantes. Il semble que les destinations qui s’en emparent sont déjà matures et plutôt attirantes pour une clientèle privilégiée qui évite le tourisme de masse.
Bien sûr, chaque acteur du secteur – hébergeurs, voyagistes, guides, ou même collectivités – peut adopter les principes énoncés en adaptant ses pratiques et en enrichissant son offre avec des critères responsables. D’où l’importance que des acteurs touristiques gérant d’importants flux touristiques (paquebots, centres de vacances, tour opérateurs, etc.) s’en emparent, même à petite échelle, pour avoir un impact plus conséquent, au-delà d’un marché de niche de voyageurs en quête de bien faire.
Élodie Manthé ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 16:58
La fermentation, entre conservation des aliments et conservatisme en ligne
Clémentine Hugol-Gential, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Bourgogne Europe
Texte intégral (1536 mots)

Prendre le temps, cuisiner maison, fermenter ses aliments : ces pratiques séduisent aujourd’hui largement. Mais, sur les réseaux sociaux, la valorisation de la fermentation s’accompagne parfois d’une vision très normative du temps, qui peut servir de support discret à des formes contemporaines de conservatisme culturel, notamment autour de la famille et des rôles de genre.
Fermenter, c’est d’abord accepter le temps long. Laisser agir des micro-organismes invisibles, renoncer à l’immédiateté, attendre sans pouvoir totalement maîtriser le résultat. Cette temporalité singulière, au cœur des pratiques fermentaires, est loin d’être anodine. Dès le XIXe siècle, Jean Anthelme Brillat-Savarin soulignait que la gastronomie s’inscrit dans une articulation complexe entre nature, techniques culinaires et temps de la transformation. La fermentation, pratique ancestrale par excellence, matérialise cette alliance entre patience, savoir-faire, mais également transformation du vivant.
Esthétique de la lenteur
Aujourd’hui, le retour en grâce du levain, du kéfir, de la lactofermentation ou du kombucha s’inscrit dans un contexte marqué par une critique diffuse de l’accélération contemporaine. Comme l’analyse le sociologue Hartmut Rosa, la modernité se caractérise par une compression du temps, une injonction permanente à faire plus vite, plus souvent, plus efficacement, au détriment du sens.
Sur les réseaux sociaux, la fermentation est fréquemment associée à une esthétique de la lenteur : gestes répétitifs, routines domestiques, attention portée aux cycles naturels. Ces images mettent en scène un temps maîtrisé, ordonné et aussi souvent ritualisé. Le temps n’est plus seulement une contrainte biologique du processus fermentaire, il devient un marqueur moral et fait référence à un passé idéalisé. Dans ce cadre, l’appel à la tradition fonctionne dans les discours alimentaires comme un argument d’autorité. En valorisant le temps long, on naturalise certaines pratiques tout en disqualifiant implicitement d’autres rythmes de vie jugés trop rapides. Le temps devient alors un critère de distinction et la fermentation apparaît comme une réponse presque morale à l’urgence généralisée.
Temporalité domestique et assignation des rôles
L’anthropologue Claude Lévi-Strauss avait déjà mis en évidence le rôle fondamental du temps dans les classifications alimentaires, en situant la fermentation du côté du « pourri », c’est-à-dire d’un état intermédiaire et culturellement ambivalent. Aujourd’hui, cette ambivalence est largement esthétisée : le temps qui transforme devient un temps qui élève. Cette morale de la lenteur prend une dimension particulière dans les contenus liés aux esthétiques « tradwife ».
Sur Instagram ou TikTok, la fermentation est souvent intégrée à une mise en scène du quotidien domestique. Le foyer y apparaît comme un espace hors de l’urgence, protégé de la frénésie extérieure. Or, ce temps long est très fortement genré. La patience, l’attention aux détails, la disponibilité temporelle sont présentées comme des qualités féminines. La fermentation devient ainsi un support symbolique pour réaffirmer une division traditionnelle des rôles. Il revient alors aux femmes le temps du soin, de l’attente et de la transmission.
Les analyses de Marie-Claire Frédéric sur la fermentation comme réaction à une société perçue comme excessivement hygiéniste et industrialisée éclairent directement ces mises en scène contemporaines. La réhabilitation du microbien s’y accompagne d’une revalorisation du temps long. Mais sur les réseaux sociaux, cette réhabilitation ne se limite pas au vivant : elle s’étend à des formes d’organisation sociale idéalisées, associant lenteur, stabilité et ordre domestique. Les esthétiques tradwife trouvent alors une forte résonance. La fermentation devient un support symbolique pour réaffirmer un foyer préservé. Dans ce dernier, le temps est d’abord genré et la nostalgie, d’un passé supposé plus stable, se rejoue à travers des gestes culinaires présentés comme naturels et surtout féminins.
Le temps comme outil de politisation discrète
L’un des traits les plus saillants de ces discours réside dans leur caractère non conflictuel. Le temps long y est présenté comme une valeur universelle associée à des registres partagés tels que le soin, la santé, l’écologie ou bien encore le respect du vivant. Cette neutralité apparente leur confère une force particulière. Comme le montrent les travaux sur la circulation des croyances en ligne, ce sont souvent les récits les plus consensuels qui véhiculent les normes sociales les plus puissantes, précisément parce qu’ils échappent à la controverse. Dans le cas de la fermentation, le temps devient ainsi un cadre normatif qui hiérarchise les manières de vivre, de produire et de consommer. À travers des gestes domestiques ordinaires et des images de routines maîtrisées, se dessine une conception implicite et naturalisée de l’ordre social avec le temps pour vertu.
Cette politisation du temps est d’autant plus efficace qu’elle s’opère à bas bruit. La fermentation agit comme un support de politisation douce, au sens où elle permet de diffuser une vision du monde sans jamais la formuler explicitement comme telle. À travers des gestes domestiques, des images de bocaux alignés ou de pains longuement façonnés à la main, apparaît une conception implicite de l’ordre social. Le temps domestique, présenté comme maîtrisé et harmonieux, est ainsi valorisé au détriment d’autres formes de temporalités plus contraintes et fragmentées.
Lorsque le temps long est associé à une morale de l’autonomie et de la responsabilité individuelle, fermenter chez soi et « prendre le temps » deviennent des marqueurs de vertu personnelle voire de bonne citoyenneté alimentaire. Cette injonction repose pourtant sur une inégalité structurelle face au temps et aux ressources, que les discours tendent à invisibiliser. Présenté comme un idéal apolitique, le temps long fonctionne alors comme un outil de régulation sociale.
Fermenter : conservateur ou conservatisme ?
Il serait évidemment erroné d’assimiler la fermentation à une idéologie conservatrice. Les travaux de Sandor Ellix Katz rappellent au contraire la diversité historique, culturelle et politique des pratiques fermentaires, souvent liées à des formes d’émancipation et de transmission collective. La fermentation n’est ni univoque, ni intrinsèquement synonyme de repli genré sur le domestique.
L’analyse des discours numériques montre pourtant la puissance idéologique de certains récits qui accompagnent les pratiques fermentaires. Le temps, érigé en ressource symbolique centrale de la fermentation, devient alors un opérateur discursif puissant. Selon la manière dont il est mis en récit, il contribue à hiérarchiser les modes de vie et à naturaliser certaines conceptions de l’ordre social. Présentés comme apolitiques, ces récits diffusent des normes d’autant plus efficaces qu’elles restent rarement nommées et semblent naturalisées.
C’est dans ce cadre que se joue, en creux, la question de la place des femmes. Ainsi, sans jamais être formulés explicitement, certains discours sur la fermentation contribuent à réactiver des représentations traditionnelles du foyer et des rôles féminins, en les enveloppant d’un vocabulaire du soin et du bon sens. Comprendre ces dispositifs discursifs permet de saisir comment des pratiques alimentaires en apparence anodines deviennent des supports de recomposition contemporaine du conservatisme, non pas en conservant des aliments, mais en contribuant à conserver, à bas bruit, certaines représentations du monde social.
Clémentine Hugol-Gential ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.02.2026 à 11:02
L’importation des comics et la crise de la bande dessinée française dans l’entre-deux-guerres
Benjamin Caraco, Chercheur associé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Université de Caen Normandie
Texte intégral (1669 mots)
L’arrivée en France des productions états-uniennes dans l’entre-deux-guerres a profondément bouleversé le paysage éditorial de la bande dessinée à l’ancienne. De nouveaux personnages, Mickey en tête, mais aussi de nouveaux univers graphiques et de nouveaux modes de narration, vont donner un coup de vieux aux images d’Épinal.
Cet article est extrait de l’ouvrage Histoire de la bande dessinée en France publié dans la collection « Repères » aux éditions La Découverte.
Dans le sillage de la Grande Guerre, l’américanisation de la culture – d’abord symbolisée par le cinéma et la musique – touche la presse enfantine dans les années 1930. La période allant de 1934 à 1940 est désignée rétrospectivement comme un âge d’or par les bédéphiles des années 1960. En particulier, « trois éditeurs mythiques, Paul Winkler, Ettore Carozzo et Cino Del Duca », sont célébrés par ces amateurs ayant grandi avec leurs publications. Ces patrons de presse sont tous d’anciens combattants, des immigrants, de sensibilité de gauche, et des entrepreneurs investissant la bande dessinée alors que sa présence est encore mal assurée en France.
L’arrivée du Journal de Mickey
Paul Winkler (1898-1982), journaliste d’origine juive né à Budapest et installé à Paris depuis 1925, est un « pionnier de l’introduction massive en France des bandes dessinées américaines » associé à la création du Journal de Mickey. En 1928, il fonde l’agence de presse Opera Mundi Press Service spécialisée dans la traduction et la revente d’interviews de personnalités. Il scelle un accord peu de temps après avec le King Features Syndicate du magnat de la presse américain William Randolph Hearst. Ce syndicate (agence de presse) dispose d’un impressionnant portefeuille de bandes dessinées : Félix le Chat, Mandrake le Magicien, Mickey, etc., et de ressources financières considérables.
Toutefois, Winkler est freiné par l’espace restreint laissé à la bande dessinée dans la presse française lorsqu’il essaie de vendre ces séries, et par le poids du modèle des images d’Épinal qui l’oblige à des adaptations de mise en page. Il noue un accord avec Hachette, qui, en tant que partenaire, lui permet de lancer le Journal de Mickey le 19 octobre 1934 à grand renfort de publicité.
Près de 350 000 exemplaires par semaine
Winkler privilégie l’humour dans ses choix et vise d’abord un public d’enfants grâce aux personnages du catalogue Disney et au comic strip américain Pim Pam Poum. Progressivement, en concurrence avec d’autres titres, le journal s’ouvre de plus en plus aux bandes dessinées d’aventures. Peu onéreux grâce à la publicité, le périodique est un succès qui tire rapidement à 350 000 exemplaires par semaine.
En 1936, Winkler lance Robinson, magazine destiné à un public plus âgé avec l’« introduction de genres ignorés par la presse enfantine française : la science-fiction et le fantastique ». Trois bandes dessinées américaines sont représentatives de ce « choix éditorial original », qui s’écarte des séries du studio Disney et met en avant l’aventure : Guy l’Éclair, Mandrake et Luc Bradefer (traduction française de Brick Bradford).
Popeye incarne le versant humoristique de ce titre qui atteint les 200 000 exemplaires hebdomadaires. Hop-là est publié par Winkler en 1937 et propose plusieurs séries en couleur dont Mac Orian et Prince Vaillant. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la réussite de Winkler est « incontestable ». Il a su conquérir le jeune public français grâce à des « illustrés structurés autour de bandes dessinées américaines ». Son succès fait rapidement des émules.
À lire aussi : Du roman gravé au roman graphique, une généalogie réinvestie
La concurrence italienne
En 1935, le magazine Jumbo offre la réplique au Journal de Mickey. L’illustré est né en Italie. Son directeur, Ettore Carozzo, dirige la succursale parisienne de la Librairie moderne. Jumbo propose des séries italiennes et anglaises avec quelques bandes dessinées américaines. Le démarrage est modeste ; le titre se modernise en 1938 en donnant une plus grande place à la production américaine (Lone Ranger). Il comprend aussi des bandes dessinées yougoslaves, comme Simbad le Marin. Carozzo édite également Aventures (1936), qui propose davantage de bandes dessinées, en particulier policières, avec pour titre phare le Fantôme du Bengale. Superman fait ses débuts français dans ces pages.
Le parcours de Cino Del Duca (1899-1967) ne se résume pas à la seule bande dessinée. Del Duca commence sa carrière en Italie, avec son frère. Il arrive en France en 1932, menacé par le fascisme en raison de son engagement à gauche, mais aussi animé par l’idée d’étendre son entreprise de presse. Il commence par la publication de romans en feuilletons, imprimant ses fascicules en Italie. En 1934, il fonde les Éditions mondiales, qui publient d’abord des ouvrages à caractère politique. Un an plus tard, son magazine Hurrah ! paraît : « Les aventures de Brick Bradford figurent en première page. Cette saga de science-fiction sera immuable jusqu’à la fin du magazine. Explorateur, aviateur, justicier et agent secret, Brick voyage dans le temps comme dans l’espace pour défendre son idéal contre les tyrans. Noble chevalier, généreux, indomptable et fidèle, il se débat dans des aventures extraordinaires. »
Spécialisé dans l’aventure, le magazine propose des bandes dessinées américaines aussi bien qu’italiennes. L’éditeur accorde peu de soin à la mise en page, tout comme au respect du droit d’auteur. Lancé à partir de 1936, L’Aventureux est un titre assez instable qui change régulièrement de format. Il comprend beaucoup de bandes dessinées d’un grand éclectisme : « Tous les genres en vogue sont publiés comme la science-fiction, l’aventure policière, l’espionnage, la guerre, le western, l’aventure historique, la féerie et l’histoire exotique. Il ne manque, là encore, que l’humour. » Les deux titres sont des succès avec 276 000 exemplaires hebdomadaires pour Hurrah ! en 1939. En parallèle, plus de 100 000 exemplaires de collections de récits complets sont vendus chaque semaine.
Réprobations morales et conséquences financières
Outre les réprobations morales qu’elle déclenche, cette arrivée de la bande dessinée américaine a des répercussions sur le paysage : elle entraîne disparitions et adaptations. La Société parisienne d’édition, bousculée, s’ouvre finalement à la « culture de masse américaine tout en préservant une large part de son identité ». Son nouveau journal, Junior (1936), inclut des bandes dessinées américaines comme Tarzan, Terry et les pirates et Futuropolis de Pellos, chef-d’œuvre de la bande dessinée de science-fiction française. L’Épatant, le titre emblématique des Offenstadt, s’arrête en revanche en 1937. Cette fin s’explique aussi par les investissements de l’éditeur dans la publication d’albums.
À lire aussi : La bande dessinée, un modèle de gentrification culturelle ?
Quand Fayard et Albin Michel cessent leurs activités dans le domaine des illustrés, les Éditions du Petit Écho de la mode parviennent à moderniser leur titre Pierrot, qui devient un « bastion de la bande dessinée française des années 1930 » avec des auteurs comme Marijac, Geruy, Liquois, Pellos, Cuvillier ou Le Rallic. De leur côté, la Semaine de Suzette et le plus récent Benjamin font le choix d’un certain conservatisme et résistent à l’américanisation. Le confessionnel Cœurs vaillants réagit en commandant les Aventures de Jo, Zette et Jocko à Hergé. Son concurrent, Mon camarade, propose davantage de bandes dessinées réalisées par des auteurs français. Toutefois, celles-ci restent influencées par le récit en images et sont très verbeuses.
Malgré leurs efforts, parfois tardifs, d’adaptation, les éditeurs français historiques restent dominés par les nouveaux entrants en termes de tirage. En 1949, le modèle dérivé des images d’Épinal est tombé en désuétude sous l’effet de l’importation de la bande dessinée américaine : « non seulement elle apporte le son par les ballons et les onomatopées diverses mais également le mouvement par des cadrages et des découpages plus dynamiques et elle libère l’image de textes qui l’encombraient ».
Benjamin Caraco ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
15.02.2026 à 17:00
Peut-on faire du vin en combinaison de surf ?
Magalie Dubois, Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business
Nicolas Depetris Chauvin, Professeur d'économie, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Petri de Beer, Lecturer and Industry Consultant, Stellenbosch University
Texte intégral (2378 mots)
Pendant que la France défend ses traditions, l’Afrique du Sud réinvente tout : vignerons surfeurs, domaines ouverts aux familles, safaris dans les vignobles. Un autre monde viticole.
Tous les ans à Stilbaai, sur la côte sud du Cap (Afrique du Sud), une compétition de surf unique au monde, la Vintners Surf Classic, réunit les vignerons sud-africains. La condition pour participer ? Apporter cinq litres de son meilleur vin rouge. Les vins collectés sont ensuite assemblés pour créer « The Big Red », édition collector vendue aux enchères au profit de Surf4Life, association qui initie les jeunes défavorisés au surf. Cette compétition incarne bien l’esprit de la viticulture sud-africaine moderne : libre, engagée et inclusive.
Trois siècles d’évolution viticole
L’industrie viticole sud-africaine est plus ancienne qu’on ne pourrait le croire. L’histoire débute le 2 février 1659, lorsque Jan van Riebeeck note dans son journal : « Aujourd’hui, grâce à Dieu, du vin a été fait pour la première fois à partir de raisins du Cap. » Mais c’est véritablement l’arrivée des huguenots français à partir de 1685, fuyant la persécution après la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV, qui transforme la viticulture locale. Cette même année, Simon van der Stel, commandeur puis gouverneur du Cap pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), fonde Groot Constantia (Western Cape), aujourd’hui le plus ancien domaine encore en activité du pays.
Les vignerons expérimentés de la vallée de la Loire apportent avec eux les boutures de leurs vignes, notamment le Chenin blanc. Productif, polyvalent et résistant à la chaleur, ce cépage se révèle parfaitement adapté au climat sud-africain. Aujourd’hui la production sud-africaine de chenin blanc représente plus de 50 % de la production mondiale. En 2016, la viticultrice Rosa Kruger lance Old Vine Project, premier programme au monde à certifier l’âge des vignes avec leur date de plantation.
Cette initiative visant à identifier et préserver les vignobles de plus de trente-cinq ans a joué un rôle clef dans le changement de perception internationale du vin sud-africain, repositionnant le pays comme gardien d’un patrimoine viticole précieux. Ironie de l’histoire : certains clones de Chenin blanc, descendants des boutures apportées par les huguenots, sont aujourd’hui éteints en France. Ces clones sud-africains sont désormais préservés dans un jardin clonal français et étudiés comme solution d’adaptation au changement climatique.
De ces racines du XVIIᵉ siècle, l’Afrique du Sud s’est hissée au rang de 8ᵉ producteur mondial de vin. Mais contrairement à l’image romantique des petits domaines familiaux français, l’industrie sud-africaine est beaucoup moins atomisée : quatre acteurs principaux (dont KWV et Heineken Beverages) représentent 65 % de la production totale. Héritage d’une industrie historiquement axée sur le vrac, cette concentration a toutefois évolué depuis la fin du boycott au début des années 1990.
La reconnaissance internationale est aujourd’hui au rendez-vous. Plusieurs domaines sud-africains figurent désormais parmi les meilleurs au monde, acclamés par la critique internationale. Certains producteurs, comme Eben Sadie (The Sadie Family), ne parviennent plus à satisfaire la demande et fonctionnent désormais sur le système d’allocations utilisé en France dans les propriétés les plus recherchées.
La montée en puissance du pays sur la scène viticole mondiale culmine en octobre 2024 avec l’élection d’Yvette van der Merwe à la présidence de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Elle est la première femme africaine à diriger l’OIV depuis sa création il y a un siècle.
Toutefois, l’accès à la terre demeure un obstacle majeur pour de nombreux producteurs indépendants. Les lois locales limitant le morcellement des grandes exploitations, ces derniers doivent soit acheter des raisins, soit louer des parcelles sans la sécurité qu’offre la propriété foncière, ce qui limite leurs investissements à long terme.
Un autre monde viticole
Quand les vignerons français taillent leurs vignes dans le froid de janvier, leurs homologues sud-africains vendangent en plein été austral. L’orientation des vignobles s’inverse également : dans l’hémisphère Sud, ce sont les versants nord qui reçoivent le plus de rayonnement solaire. Résultat ? Les versants sud, recherchés en France pour leur ensoleillement privilégié, sont en Afrique du Sud mis à profit pour leur fraîcheur.
Autre différence de taille avec la France : Le Wine of Origin Scheme (système d’indication géographique sud-africain) certifie l’origine, le millésime et le cépage, mais n’impose pas les variétés cultivées ni leur mode de culture. Les vignerons peuvent donc planter les cépages de leur choix où bon leur semble et irriguer librement.
Ce qui constituerait une hérésie dans la plupart des appellations françaises est ici une nécessité face aux sécheresses récurrentes du Cap et aux températures qui peuvent atteindre 40 °C en plein été. Fort heureusement, les vignobles sud-africains comptent de nombreux microclimats, et les vignerons peuvent trouver de la fraîcheur en altitude ou à proximité des côtes. Le Cape Doctor, ce vent du sud-est, refroidi par le courant froid du Benguela est également un allié de taille pour modérer la chaleur intense des étés sud-africains.
Des raisins pour les babouins
Les vignerons français sont aux prises avec les sangliers, en Afrique du Sud ce sont les babouins qui viennent se servir dans les vignes. À Klein Constantia, en période de vendange les équipes affrontaient des dizaines de primates par jour. Et s’en protéger coûte cher : clôtures électriques, surveillance à plein temps, systèmes GPS. Mais malgré les investissements les babouins sont extrêmement habiles à développer des stratégies de contournement. En désespoir de cause quelques rangs ont finalement été plantés de l’autre côté des clôtures pour assouvir l’appétit des primates et éviter les dégâts.
Cette cohabitation forcée avec la faune sauvage reflète une réalité unique au monde : les vignerons sud-africains produisent leurs vins au cœur du fynbos, écosystème inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le royaume floral du Cap est le plus petit des six royaumes floraux au monde. Il ne faut donc pas s’étonner que l’offre des wine farms sud-africaines intègre non seulement des restaurants, hôtels boutique, spas, jardins botaniques et galeries d’art, mais aussi, plus surprenant pour nous, des safaris dans les vignobles pour observer babouins, antilopes, léopards et plantes endémiques. Mais l’intégration du vin dans le paysage touristique sud-africain va encore plus loin : le vin s’invite dans les lodges de safari des réserves animalières où les caves rivalisent avec celles des grands domaines. Les animaux attirent les touristes internationaux qui, une fois sur place, découvrent l’excellence des vins et des domaines sud-africains. Si l’on en croit le site « The World’s 50 best vineyards », deux des des dix plus beaux vignobles du monde (Klein Constantia and Creation) se trouvent en Afrique du Sud.
Construire un modèle inclusif
Contrairement à de nombreux domaines français qui ont dû s’adapter tardivement au tourisme, les producteurs sud-africains ont d’emblée conçu leurs domaines comme des destinations touristiques. Tous les week-ends, les wine farms des routes des vins sud-africaines se transforment en véritables espaces de vie où les familles entières viennent petit-déjeuner, déjeuner et passer l’après-midi, voire la soirée. Mais à la différence de la France, l’offre œnotouristique est également pensée pour les visiteurs ne consommant pas d’alcool. Nombreux sont les domaines qui proposent des aires de jeux pour les enfants, et il n’est pas rare d’y célébrer également leurs anniversaires. L’offre gastronomique se veut également inclusive. Pour déjeuner, les visiteurs de Benguela Cove ont par exemple le choix entre un restaurant gastronomique, un fast-food ou une sélection de pique-niques. La gastronomie sud-africaine s’est développée conjointement à l’œnotourisme et certains des meilleurs restaurants d’Afrique du Sud sont aujourd’hui hébergés par des domaines viticoles.
Cette adaptation aux besoins des consommateurs reflète la nécessité de multiplier les revenus dans un marché domestique encore limité. Les domaines sud-africains ont fait de l’œnotourisme un pilier de leur modèle économique. Celui-ci génère 16 % de leur chiffre d’affaires et plus de 40 000 emplois. Pour maximiser les ventes directes au domaine certains producteurs ont développé une collaboration inédite. Elle permet aux touristes européens de passer commande lors de leur visite dans plus de cinquante domaines du Cap, d’effectuer un paiement unique sur une plateforme en ligne à l’issue de leur séjour et de recevoir chez eux à leur retour les bouteilles expédiées depuis une plateforme logistique commune basée en Allemagne.
La filière se mobilise également afin de former la nouvelle génération et de combattre les inégalités héritées de l'apartheid. Nombreux sont les producteurs qui investissent dans l'éducation des enfants de leurs employés en accueillant des écoles sur les domaines. La formation et l’inclusion de professionnels du vin est une priorité pour la pérennité de la filière, les initiatives visant à offrir à des jeunes la possibilité d’étudier gratuitement ou de développer leurs talents de vignerons portent aujourd’hui leurs fruits et permettent de prédire à la filière vin sud-africaine un brillant avenir.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
13.02.2026 à 13:22
Avant d’être protégés, les hérissons ont été longtemps persécutés
Kate Davies, PhD candidate, Nottingham Trent University
Texte intégral (2051 mots)

Pendant des siècles, le hérisson a été tour à tour craint, persécuté, puis idéalisé. Des mythes médiévaux aux campagnes de protection actuelles, son histoire éclaire la manière dont nos récits façonnent notre rapport à la faune sauvage.
Les hérissons font partie de la culture humaine depuis des millénaires. Selon les sociétés, ils ont été tour à tour associés à la fertilité, à la protection et à la guérison, mais aussi à la peur, aux superstitions et à la méfiance.
Aujourd’hui, 17 espèces de hérissons sont présentes en Europe, en Afrique et en Asie. Beaucoup vivent à proximité immédiate des humains, une cohabitation étroite qui a contribué à façonner les récits que l’on raconte à leur sujet.
Bien avant l’apparition de l’écriture, des représentations évoquant le hérisson apparaissaient déjà dans des formes d’art symbolique liées à la fertilité et au renouveau, ce qui suggère que ces animaux comptaient pour les humains depuis bien plus longtemps que ne le révèlent les sources écrites.
Dans l’Égypte ancienne, ils étaient considérés comme des guides et des protecteurs, admirés pour leur capacité à survivre à l’hiver grâce à l’hibernation, un puissant symbole de renaissance. Toutefois, les Égyptiens les chassaient également et utilisaient leurs piquants dans des remèdes populaires, notamment ceux supposés soigner la calvitie.
Les hérissons ont aussi, au fil de l’histoire, endossé des rôles plus inquiétants. Dans certaines régions de Chine, les premiers récits évoquaient des esprits de hérissons capables de se transformer en êtres humains et d’apporter le malheur. Des traditions plus tardives en faisaient à l’opposé des protecteurs sacrés du foyer et des guérisseurs.

L’histoire sombre des hérissons
En Grande-Bretagne, les hérissons ont longtemps souffert d’une image largement négative, jusqu’à une période relativement récente. Au Moyen Âge, ils étaient étroitement associés à la sorcellerie. Une croyance très répandue voulait que les sorcières puissent se transformer en hérissons afin de perpétrer leurs méfaits. On pensait aussi qu’ils se glissaient la nuit dans les champs pour voler le lait directement au pis des vaches.
Selon une autre croyance ancienne, les hérissons transportaient des fruits volés sur leurs piquants. Les illustrations médiévales les représentaient souvent traversant des vergers, des pommes fichées sur le dos, une image qui perdure encore aujourd’hui dans les livres pour enfants et jusque dans les décorations de gâteaux d’anniversaire. Certains mythes anciens subsistent également : des personnes bien intentionnées continuent par exemple de leur proposer du lait, alors même que les hérissons sont intolérants au lactose.
Si certaines de ces histoires subsistent aujourd’hui comme de simples curiosités pittoresques, d’autres ont eu des conséquences bien plus graves. Les hérissons ont ainsi été officiellement classés parmi les « vermines » en vertu du Preservation of Grain Act (loi sur la protection des récoltes céréalières) de 1532, parmi une longue liste d’animaux.
Les paroisses étaient tenues de les tuer, une prime de trois pence étant versée pour chaque hérisson abattu, une somme importante pour l’époque. Les communautés qui n’atteignaient pas les quotas imposés pouvaient même être sanctionnées par des amendes. Les hérissons sont restés inscrits sur ces listes de nuisibles pendant des siècles.
On estime qu’entre 1660 et 1800, sur une période de 140 ans, près de 500 000 hérissons ont été éliminés de cette manière – un total proche de celui que compte aujourd’hui la population britannique actuelle de hérissons. Et les hérissons n’étaient pas les seuls : chats sauvages, loutres ou encore martres des pins (pour ne citer qu’eux) ont eux aussi été persécutés selon les mêmes logiques. Après de forts déclins, ces espèces figurent aujourd’hui parmi les plus strictement protégées par la loi au Royaume-Uni.
Persécution et protection
Bien que cette loi ait fini par être abrogée, la mise à mort des hérissons s’est poursuivie jusqu’au XIXe siècle et au début du XXe, en particulier sur les domaines de chasse. Les archives indiquent que des dizaines de milliers d’individus étaient tués chaque année durant cette période, avant que les chiffres ne commencent à reculer entre les années 1960 et le début des années 1980. Ce recul peut traduire une évolution des mentalités et l’adoption de lois de protection de la faune, mais il est aussi possible qu’il reflète une raréfaction des hérissons.

Aujourd’hui, au Royaume-Uni du moins, les hérissons bénéficient d’une image très différente. En 2016, ils ont été élus mammifère préféré des Britanniques, devançant largement le renard roux, arrivé en deuxième position. Cet attachement du public a nourri des campagnes de préservation dans les jardins, le développement de structures caritatives dédiées et l’essor d’un réseau croissant de centres de soins, qui prennent en charge des animaux malades ou blessés, souvent avec le soutien de particuliers qui aménagent activement leurs jardins en pensant aux hérissons.
Si les attitudes à l’égard des hérissons se sont nettement améliorées au cours des dernières décennies, cela n’a toutefois pas suffi à enrayer leur déclin. L’espèce a récemment été reclassée comme « quasi menacée » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Comprendre notre parcours culturel et l’évolution de notre regard sur les hérissons permet d’éclairer à la fois notre volonté de les protéger et certaines des erreurs que nous continuons à commettre.
Le parcours du hérisson, autrefois perçu comme un nuisible redouté et aujourd’hui érigé en icône des jardins, illustre la puissance des récits humains, capables à la fois de nuire à la faune sauvage et de susciter sa protection. Mais l’affection, à elle seule, ne suffit pas.
Les mythes qui ont jadis servi à justifier sa persécution subsistent encore sous des formes plus atténuées, influençant des comportements bien intentionnés mais parfois préjudiciables. Aujourd’hui, les hérissons ont besoin de protection. Des gestes simples – comme mettre à disposition une coupelle d’eau peu profonde, aménager des jardins favorables aux hérissons, prévoir des issues de secours dans les bassins ou limiter l’usage des pesticides – peuvent contribuer à préserver ce mammifère désormais très apprécié.
Kate Davies ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
12.02.2026 à 16:12
Barbie, figure d’émancipation féminine ?
Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
Texte intégral (1781 mots)

Longtemps critiquée pour enfermer les fillettes dans des carcans stéréotypés, Barbie s’affirme désormais comme un symbole de l’émancipation féminine. Effectivement, Mattel a entièrement révisé sa stratégie : diversité des origines, des hobbies et professions, représentation des handicaps… Mais Barbie est-elle pour autant devenue un levier d’émancipation ou présente-t-elle un féminisme compatible avec les ambitions commerciales ?
Créée en 1959, Barbie apparaît comme une innovation majeure dans l’univers du jouet. À une époque où les poupées proposées aux fillettes sont essentiellement des bébés à pouponner, Barbie incarne une femme adulte, indépendante, dotée d’une maison, d’une voiture et susceptible d’épouser une pluralité de métiers. Elle ouvre ainsi un espace de projection inédit, permettant aux enfants d’imaginer des trajectoires féminines affranchies du seul horizon domestique. Cette promesse d’autonomie s’accompagne toutefois de critiques. La silhouette de Barbie, aux proportions irréalistes, devient un symbole de la pression exercée sur les corps féminins. Comme l’indique Bazzano dans son ouvrage intitulé la Femme parfaite : histoire de Barbie :
« Si Barbie, au lieu de ses quelque trente centimètres, mesurait un mètre soixante-quinze, ses mensurations poitrine-taille-hanches seraient : 95-53-83. »
Selon l’auteure, il s’agit de proportions peu crédibles avec un buste trop court, une poitrine trop forte, sur une taille trop fine, avec des hanches trop étroites, sur des jambes trop longues se terminant par des pieds trop cambrés. De nombreuses recherches montrent que l’exposition répétée à cet idéal corporel contribue à l’intériorisation de normes de beauté susceptibles d’affecter l’image corporelle dès le plus jeune âge.
L’univers esthétique de la poupée, centré sur la mode, la consommation et une féminité très codifiée, renforce cette critique. Barbie représente une femme indépendante, certes, mais tenue de rester belle, mince et désirable.
Représenter pour rendre possible
Afin de répondre aux transformations sociétales et de mieux coller à la diversité du réel, Mattel a engagé une évolution progressive de la poupée. Comme le signifie Rogers dans son ouvrage intitulé Barbie Culture, bien que Barbie ait des amies racisées depuis les années 1960 et qu’elle ait elle-même été commercialisée en version afro-américaine, asiatique et hispanique, elle demeurait dans l’esprit collectif blonde, blanche et élancée.
L’introduction de la gamme Barbie Fashionistas en 2009 constitue une étape décisive. Mattel élargit la gamme des carnations, de types de cheveux et coiffures, tout en mettant l’accent sur une diversité des styles, hobbies et professions. Il faut attendre 2016 pour que la marque franchisse une étape supplémentaire en introduisant des morphologies alternatives en termes de taille et corpulence engageant ainsi une remise en question plus directe de l’idéal corporel historiquement associé à la poupée.
Barbie incarne également une diversité de carrières, avec un message clair : « You can be anything » (« Tu peux être qui tu veux »). Sur le plan symbolique, cette logique se fonde sur un principe qui postule que tout ce qui est visible devient susceptible d’être pensé. Les jouets jouent un rôle actif dans la socialisation genrée et la formation des aspirations. Évidemment, une poupée astronaute, paléontologue, médecin ou rock-star n’évoque pas les mêmes rêves qu’une poupée confinée au milieu domestique. Ici, l’émancipation se manifeste par le jeu, la redondance et la normalisation de figures féminines qui ont été longtemps mises en marge. Ainsi, Barbie permet aux enfants d’explorer une variété de scénarios professionnels. Pourtant, cette influence sur le réel reste complexe.
L’étude menée par Sherman et Zurbriggen a montré que les fillettes qui jouaient à Barbie, même dans sa version docteur avec blouse blanche, otoscope et stéthoscope, indiquaient qu’elles avaient moins d’options de carrière futures que les garçons. En revanche, celles qui jouaient avec Monsieur Patate signalaient une différence moins importante entre leurs propres carrières futures possibles et celles des garçons, suggérant que la sexualisation de la poupée pèse plus lourd que son uniforme.
Présentée comme célibataire, malgré l’omniprésence de Ken, son éternel prétendant relégué au second plan, Barbie met en scène une indépendance qui passe aussi par ce qu’elle possède. Les objets qui l’entourent participent à la construction d’une image de femme libre et ambitieuse. L’empowerment se transforme alors en promesse individualisée, esthétisée et compatible avec les logiques de consommation de masse, plutôt qu’en un processus collectif de transformation sociale. Par ailleurs, malgré les efforts de diversification, certaines normes persistent. Même lorsqu’elle est scientifique ou pilote d’avion, Barbie reste conforme aux standards de désirabilité dominants. Son évolution demeure ainsi régie par les normes du marché. Il s’agit in fine de provoquer l’acte d’achat.
La représentation du handicap : entre reconnaissance et simplification
Parmi les avancées les plus notables figure la récente représentation du handicap dans l’univers de Barbie. Mattel a en effet déployé des poupées en fauteuil roulant, dotées de prothèses de jambe, touchées par le vitiligo, l’alopécie, la cécité ou bien encore la trisomie 21. Élaborées en partenariat avec des personnes concernées ou spécialistes (professionnels de santé, associations…), ces poupées ont le plus souvent été saluées pour leur aptitude à représenter des vérités longtemps négligées dans le monde du jouet. Elles permettent aux enfants concernés de se reconnaître et aux autres d’intégrer la différence comme une composante ordinaire du monde social. Le jeu devient alors un espace de familiarisation et de déstigmatisation.
La commercialisation, en 2025, d’une Barbie atteinte de diabète de type 1, équipée d’un capteur de glucose et d’une pompe à insuline, marque une étape importante dans la politique inclusive de la marque. Ce lancement ouvre un nouveau chapitre en déplaçant la question de la représentation vers le terrain des handicaps dits « invisibles », longtemps absents de l’univers du jouet. Dans cette mouvance, une Barbie autiste est commercialisée depuis janvier 2026. Ici aussi, la représentation s’opère principalement par l’utilisation d’accessoires. La Barbie est en effet équipée d’un casque antibruit, d’un hand-spinner et d’une tablette de communication. Ces évolutions posent alors la question de la capacité du jouet à offrir un véritable espace d’identification, sans réduire le handicap à une série de signes ou d’objets immédiatement reconnaissables.
Barbie, miroir de nos contradictions
À mesure que l’inclusion devient un argument central du discours de marque, une tension se dessine entre reconnaissance symbolique et logique commerciale, au risque de relever d’une forme d’habillage éthique. Dans cette perspective, l’inclusion est envisagée comme une stratégie de marque, consolidant la crédibilité de Barbie sans remettre en question les hiérarchies esthétiques et commerciales qui structurent son succès.
Barbie cristallise certaines des contradictions contemporaines : la reconnaissance d’une diversité plus visible s’accompagne d’une vigilance face à une stratégie marketing bien maîtrisée. Cette ambivalence a été mise en évidence par le film Barbie (2023) qui oscille entre satire populaire et analyse métaféministe. Le film met en effet en exergue les paradoxes d’un féminisme soutenu par une icône commerciale.
En définitive, Barbie ne génère pas l’empowerment, elle le soutient, le reformule et parfois le simplifie. Elle exprime, dans le langage accessible du jouet, des problématiques complexes. La trajectoire de Barbie illustre que l’émancipation dépend des conditions socio-économiques et culturelles qui peuvent transformer ces représentations en expériences concrètes.
Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
11.02.2026 à 16:27
La cinéaste Chloé Zhao, portraitiste de l’intimité du deuil
Joanne Vrignaud, Doctorante en cinéma américain à UPN, Université Paris Nanterre
Texte intégral (2660 mots)

Le dernier film de Chloé Zhao, Hamnet, est déjà un succès critique et populaire. Quatre ans après le succès mitigé de son film de commande les Éternels, la réalisatrice oscarisée revient avec une adaptation de l’œuvre de la romancière et journaliste britannique Maggie O’Farrell. Un drame qui met en lumière un thème central dans son cinéma : l’intimité du deuil.
Chloé Zhao s’est fait connaître dès ses débuts dans l’industrie en se formant sous l’égide de réalisateurs et d’acteurs engagés, comme Spike Lee ou Forrest Whittaker. Alors que les médias s’emparent de la question de l’alcoolisme dans les réserves amérindiennes, la Sino-Américaine part en 2015 filmer les riders (ces hommes qui pratiquent le rodéo) des nations lakotas du Dakota du Sud et en tire son premier long-métrage, Les chansons que mes frères m’ont apprises.
On y suit deux jeunes membres du clan des Oglalas dont la mort brusque du père entraîne une réflexion sur leur présence dans la réserve de Pine Ridge. Leur gestion différente du deuil, l’un par les questionnements sur la masculinité, l’autre par l’apprentissage culturel, se rejoint dans leur relation commune à la nature et devient le fil conducteur de l’histoire et, incidemment, de toutes les autres que Zhao développera.
Une esthétique intime fondée sur le lien avec la nature
En effet, dans Les chansons…, Johnny (17 ans) et Jashaun Winters (10 ans) sont sans cesse ramenés aux conséquences de la perte de leur père (un rider alcoolique), des difficultés économiques à l’opportunité de se tourner vers de nouveaux mentors, tout aussi violents et traumatisés par la vie dans une réserve. Si elle ne quitte jamais le domaine du réalisme social, la caméra s’attache aux moments de vulnérabilité : un premier baiser, un lever de soleil, un combat de boxe. L’ancrage des protagonistes dans la réserve est un cheminement émotionnel fait de plans rapprochés nous invitant à nous projeter dans leur univers mental. Les scènes sont douces, le son feutré, les plans longs : les dialogues laconiques dans la nature forment déjà la patte caractéristique (fortement inspirée par le réalisateur Terrence Malick) de l’esthétique de la réalisatrice.
Le film fait parler de lui au festival du cinéma indépendant de Sundance (Wyoming), et lui permet de réaliser son second film en 2017, The Rider. À nouveau, Zhao dézoome lentement sur l’expression endeuillée du jeune rider Brady Blackburn, interdit de monter à cause d’une terrible chute de rodéo, pour l’inscrire dans son environnement. Loin de l’esthétique épique des westerns traditionnels où selon l’historien Armando José Pratts, les cowboys, ranchers et bandits s’approprient les terres d’abord par le regard, puis par la force, ce cowboy sioux ne domine pas le sublime paysage qui l’entoure, laissant ses fantasmes de masculinité de cowboy dans le sillage de sa dernière course sur le dos de Gus. C’est là la théorie de l’intime de Zhao : se concentrer sur les regards plutôt que sur l’objet de ceux-ci et inscrire les personnages dans des environnements qui reflètent l’abondance de leur paysage intérieur.
Pouvoir thérapeuthique des grands espaces
Nomadland (oscarisé en 2021) s’inscrit dans des thèmes similaires (perte, questionnement identitaire, critique du capitalisme). Après avoir perdu son mari et son travail, Fern devient nomade pour fuir son passé. L’intime, comme toujours chez Zhao, se crée dans les dialogues minimes, une bande-son légère et des moments d’humanité poétisée. Zhao filme encore l’Ouest américain et le pouvoir thérapeutique des grands espaces sur Fern, en contraste avec son dénuement isolant dans le monde du travail. Quittant les tensions raciales et idéologiques du western, elle utilise les codes du road movie pour dramatiser le paysage (grands panoramas, lumières rasantes) au travers du regard de Fern, qui se fait camérawoman, utilisant des cailloux percés pour observer la même réserve de Pine Ridge. C’est par cet apprentissage de la vision artistique que Fern parvient à recréer du lien dans un système capitaliste et individualiste qui déchire l’Amérique profonde et à se remettre de son deuil. L’étape finale de son développement est le regard caméra soulagé de Fern quand on lui indique la sortie d’un labyrinthe naturel : l’intime se noue aussi par la relation à la spectatrice.

Zhao pose ainsi les fondements de son esthétique intimiste, qui lui sera reprochée dans le cadre épique d’un film Marvel comme les Éternels (2021). Les plans rapprochés et les longues séquences à l’épaule où les personnages baignent dans des lumières rasantes (les fameuses golden hours) reflètent le cheminement émotionnel des personnages. Il s’agit de lenteur, de gros plans, voire de très gros plans, sur des personnages sensibles, marginalisés et souvent ignorés par les films hollywoodiens, dont la tradition cinématographique peine encore à séparer la figure de l’autochtone de l’Indien des westerns ou à centrer des personnages féminins marginalisés.
« Hamnet », un monde naturel où seul l’intime survit
Avec Hamnet (2026), la relecture du mythe shakespearien se fait à l’aune de la perte, annoncée dans une myriade de symboles : l’oiseau de proie, un gouffre mystérieux, l’inondation, les scènes d’accouchement anxiogènes. La forêt forme l’épicentre de la vie et de la mort dont émergent les femmes de la lignée d’Agnes : c’est là qu’elle accouche, qu’elle rencontre puis perd son oiseau. Surtout, les boutures de la clairière, symbole de vie et de renaissance, sont replantées dans le jardin de la maisonnette, reconstituées sur la scène du Théâtre du Globe et dans les tapisseries des coulisses de l’au-delà où attend Hamnet.

La dichotomie stéréotypée entre Agnes, femme de la forêt, et William, génie littéraire, s’inscrit dans le cinéma de Zhao : alors que William se construit par le verbe (contre son père, en jouant avec ses enfants, sur scène), Agnes, comme Jashaun et Fern, est caractérisée par la mise en scène de son regard sur le monde naturel. L’art et la nature s’emmêlent à l’image du couple, comme dans les costumes en treille et paille des enfants jouant Macbeth.
Le pathos du film ne fait pas non plus l’unanimité auprès de la critique. En effet, Zhao ne laisse aucune distance s’établir entre les personnages et les spectatrices et spectateurs : le film foisonne sensoriellement, souligne les textures, capture les micro-expressions, remplit l’espace sonore de bruits de fonds discrets qui rendent les rares silences insoutenables.

Alors que le film commence sur des plans pied ou panoramiques, la caméra de Zhao se rapproche progressivement des visages à mesure qu’approche la disparition de l’enfant, jusqu’à finir sur les gros plans à l’épaule qui caractérisent l’agonie du fils et le cri de sa mère.
La caméra, suivant les dynamiques de l’intime propre au cinéma de Zhao, semble également représenter une puissance de vie et de mort : un très gros plan vacillant sur l’œil de William symbolise ses tendances suicidaires sur le quai, un regard caméra terrifié de Hamnet brise le quatrième mur quand il prend la place de sa sœur dans le lit de mort. Le regard spectateur, si intime dans Nomadland, se fait celui de la Faucheuse : nous, public presque voyeur, annonçons la scène finale ou l’acteur fantomatique d’Hamlet transcende la frontière de la mort et des planches en prenant la main d’Agnes.
Comme Jashaun, Fern ou Brady, Agnes redécouvre ses émotions au travers de la confrontation avec l’art et le toucher. En serrant la chair du pouce, Agnes perçoit les paysages secrets de ceux qu’elle aime, et c’est par la perte de ce contact que le couple se déchire dans le deuil de leur enfant. C’est donc également par ce toucher qu’Agnes rend universel le deuil de ce fils-personnage conjuré par les mots de son mari : une fois que les parents s’accordent sur la forme du deuil et que la mère a pu recréer de l’intime individuel avec les fantômes sur scène, les autres spectateurs se joignent à l’expérience de cette perte.
Joanne Vrignaud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.02.2026 à 16:46
Le mystère de la « Dame à l’éventail », éclairé par une photo de Jeanne Duval
Maria C. Scott, Associate Professor of French Literature and Thought, University of Exeter
Texte intégral (1729 mots)
On sait très peu de choses au sujet de la comédienne haïtienne Jeanne Duval (1818-1868), compagne de Charles Baudelaire peinte par Manet, qui continue de fasciner les spécialistes de la littérature, de la peinture et du féminisme.
En mai 2025, je suis tombée sur une photographie extraordinaire sur le site Wikipedia anglais consacré à Jeanne Duval. Duval, originaire d’Haïti, était la maîtresse et muse de longue date, supposée n’avoir jamais été photographiée, du poète français Charles Baudelaire.
Le portrait, représentant une femme assise vêtue d’habits bourgeois raffinés, avait été publié sur Wikipédia par une étudiante de l’historienne de l’art Justine De Young. De Young évoque ce portrait comme un exemple d’auto-mise en scène dans son dernier ouvrage, The Art of Parisian Chic. Imprimée sur une petite carte (il s’agit d’un portrait-carte de visite, en vogue à l’époque) et datée du 18 août 1862, l’image a été découverte dans les archives françaises par une autre chercheuse, comme je l’ai mentionné dans un récent article publié par le Times Litterary Supplement, et documentée en ligne par elle en 2021.
Une photo redécouverte
Jeanne Duval fascine de nombreuses chercheuses et chercheurs experts du féminisme et du postcolonialisme, en partie parce que l’on sait très peu de choses précises à son sujet. Intriguée, je me suis rendue moi-même aux archives à l’été 2025, juste pour voir la photo. Là, j’ai remarqué une deuxième photo au format carte de visite à côté de la première. Elle portait le même nom, « Jeanne », la même date, et provenait du même studio de photographie, l’atelier Nadar. Les deux cartes avaient été inscrites au registre du dépôt légal sous la mention « idem ».
À lire aussi : Les femmes censurées des « Fleurs du mal »
Cette deuxième Jeanne se tient debout, dans une pose inhabituellement rigide pour une photographie de ce type. Elle porte une robe de soirée à épaules dénudées et ses cheveux tombent en cascade dans son dos, retenus sur le front par un simple bandeau.
Une inspiration pour Manet ?
Une version numérique haute résolution de cette image a révélé de fortes ressemblances avec le modèle de la première photographie, similitudes qui n’étaient pas immédiatement apparentes sur les petites cartes. Les deux photos révèlent une implantation capillaire similaire, une même imperfection sur le front et une bague au même doigt. Il était clair que si la première photographie représentait Duval, celle-ci aussi.
Cependant, le crucifix porté en pendentif sur une chaîne courte et les grandes boucles d’oreilles m’ont semblé particulièrement intéressants. Des bijoux très similaires sont en effet portés par le modèle dans le portrait d’Édouard Manet intitulé Dame à l’éventail (1862), également connu sous le nom de la Maîtresse de Baudelaire allongée. Ce dernier titre avait été inscrit au dos du tableau à un moment donné, soit pendant, soit avant l’inventaire posthume de l’atelier de l’artiste.
La pose maladroite et l’expression faciale impénétrable du modèle ont souvent été interprétées comme faisant référence aux difficultés et à la maladie que Duval endurait à l’époque. Elle se trouvait dans une situation financière désastreuse et souffrait d’une paralysie du côté droit depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 1859. Cependant, l’identification du modèle de Manet comme étant Duval est parfois contestée par les chercheurs, pour plusieurs raisons.
Le portrait sur carte de « Jeanne » debout, réalisé la même année que le portrait à l’huile et son étude à l’aquarelle, présente des traits, une expression et des ombres très similaires. Les historiens de l’art Griselda Pollock et Therese Dolan ont émis l’hypothèse que Manet s’était inspiré d’une photographie ou d’une carte de visite de Duval pour réaliser Dame à l’éventail. Les liens entre la photographie de Jeanne debout et les portraits à l’huile et à l’aquarelle de Manet semblent confirmer que Duval est le sujet des deux peintures (aquarelle et huile) et des deux photographies.
Pourquoi ces photographies ont-elles été prises ?
Duval posait-elle donc pour Manet dans ces photographies ? Il convient de noter que Manet, Félix Nadar (le propriétaire du studio de photographie) et Baudelaire étaient tous des amis proches, et que Duval s’était séparée du poète, apparemment de manière définitive, en 1861.
Duval a peut-être proposé de poser, ou a été invitée à poser pour les photographies de Nadar (et indirectement pour Manet, qui travaillait souvent à partir de photographies) en échange d’argent. Nous savons qu’elle avait approché au moins un autre ami de Baudelaire en 1862 pour essayer de lui vendre les biens du poète. Le fait qu’elle tienne une cravache sur la photographie avec le crucifix vient étayer l’hypothèse de la monétisation. Peut-être espérait-elle, ou espéraient-ils, que le portrait sur carte de la muse sadique/angélique du recueil de poèmes de Baudelaire les Fleurs du mal (1857) aurait une valeur marchande.

Il est également possible que Baudelaire ait commandé des portraits de son ancienne maîtresse à des fins personnelles. Malgré sa colère et son ressentiment envers Duval après leur séparation, ses lettres et ses croquis témoignent de sa loyauté et de son affection persistantes.
Ou peut-être Duval souhaitait-elle rétablir la vérité sur qui elle était. Peut-être voulait-elle que le monde sache qu’elle n’était en fait pas la muse diabolique et sexualisée au centre du volume de poésie scandaleux de Baudelaire, mais plutôt quelqu’un qui s’habillait avec des vêtements élégants et respectables (probablement empruntés) comme on le voit sur la première photographie.
Peut-être que le crucifix et la bague visible à l’annulaire des deux photos avaient également pour but de témoigner de ses valeurs morales. Cependant, certains détails de la deuxième image, notamment la cravache, les épaules nues et les grandes boucles d’oreilles, suggèrent que sa volonté n’était pas de se donner une image « respectable ».
Il est probable que les portraits-cartes de visite, s’ils représentent bien Jeanne Duval, aient été motivées par des raisons financières, qu’elles aient été son idée ou celle de Nadar, Manet ou Baudelaire. Il est également possible que la mise en scène de soi ait fait partie de son objectif, mais si tel est le cas, le message qu’elle voulait faire passer n’est pas clair.
Des chercheurs français ont récemment découvert que Duval était morte dans un hospice six ans seulement après la réalisation de ces portraits. Jusqu’alors, personne ne semblait savoir ce qu’elle était devenue. Ces photographies témoignent, du moins à mes yeux, de la résistance de Duval à se laisser cataloguer et de sa dignité tranquille.
Maria C. Scott publiera prochainement un article universitaire sur ce sujet dans la revue French Studies.
09.02.2026 à 23:08
En Mésopotamie, le rôle très important des personnes trans
Chaya Kasif, PhD Candidate; Assyriologist, Macquarie University
Texte intégral (2998 mots)

Loin d’être marginalisées, certaines personnes de genre atypique jouaient un rôle central dans le culte, la politique et l’armée en Mésopotamie, montrant une forme ancienne de reconnaissance sociale.
Aujourd’hui, les personnes trans font face à une politisation de leur vie et à la diabolisation par des politiciens, certains médias et une partie de la société. Mais dans quelques-unes des premières civilisations de l’histoire, ces personnes étaient reconnues et comprises de manière totalement différente.
Dès 4 500 ans avant notre ère, en Mésopotamie dans le Proche-Orient ancien par exemple, des rôles sociaux importants, avec des titres professionnels majeurs, étaient dévolus aux personnes de genre atypique. Notamment les serviteurs cultuels de la grande divinité Ištar, appelés assinnu, et les hauts courtisans royaux appelés ša rēši. Des preuves antiques montrent que ces personnes occupaient des positions de pouvoir en raison de leur ambiguïté de genre, et non malgré elle.
La Mésopotamie
La Mésopotamie est une région qui correspond aujourd’hui principalement à l’Irak et à des régions de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran. Faisant partie du Croissant fertile, le mot « Mésopotamie » vient du grec et signifie littéralement « terre entre deux fleuves », l’Euphrate et le Tigre.
Pendant des milliers d’années, plusieurs grands groupes culturels y ont vécu. Parmi eux, les Sumériens, puis plus tard les groupes sémitiques appelés Akkadiens, Assyriens et Babyloniens.
Les Sumériens ont inventé l’écriture en traçant des coins sur des tablettes d’argile. L’écriture, appelée cunéiforme, a été créée pour transcrire la langue sumérienne, mais les civilisations suivantes l’ont utilisée pour écrire leurs propres dialectes de l’akkadien, la plus ancienne langue sémitique.
Qui étaient les assinnu ?
Les assinnu étaient les serviteurs religieux de la grande déesse mésopotamienne de l’amour et de la guerre, Ištar.
Reine des cieux, Ištar a précédé Aphrodite et Vénus.

Connue des Sumériens sous le nom d’Inanna, cette déesse guerrière détenait le pouvoir politique ultime et conférait leur légitimité aux rois. Elle veillait également sur l’amour, la sexualité et la fertilité. Dans le mythe de son voyage aux Enfers, sa mort entraîne la fin de toute reproduction sur Terre. Pour les Mésopotamiens, Ištar était l’une des plus grandes divinités du panthéon. L’entretien de son culte officiel garantissait la survie de l’humanité.
Ses serviteurs, les assinnu, avaient la responsabilité de la satisfaire et de s’occuper d’elle par le biais de rituels religieux et de l’entretien de son temple. Le titre même d’assinnu est un mot akkadien lié à des termes signifiant « féminin », « homme-femme » ainsi que « héros » et « prêtresse ».

Leur fluidité de genre leur venait directement d’Ištar. Dans un hymne sumérien, la déesse est décrite comme ayant le pouvoir de :
transformer un homme en femme et une femme en homme,
changer l’un en l’autre,
habiller les femmes avec des vêtements d’hommes,
habiller les hommes avec des vêtements de femmes,
mettre des fuseaux dans les mains des hommes,
et donner des armes aux femmes.
Les assinnu ont d’abord été considérés par une partie des historiens comme un type de travailleur·se religieux·se sexuel·le. Une conception qui repose sur des hypothèses anciennes concernant les groupes transgenres et qui n’est pas fortement étayé par les preuves.
Le titre est aussi souvent traduit par « eunuque », bien qu’il n’existe aucune preuve claire qu’il se soit agi d’hommes castrés. Si le titre est principalement masculin, il existe des preuves d’assinnu féminines. En réalité, divers textes montrent une résistance à la binarité de genre.
Leur importance religieuse leur attribuait des pouvoirs magiques et de guérison. Une incantation dit :
Que ton assinnu se tienne à mes côtés et retire ma maladie. Qu’il fasse sortir par la fenêtre la maladie qui m’a saisi.
Un présage néo-assyrien indique également que des relations sexuelles avec un assinnu pouvaient procurer des avantages personnels :
Si un homme s’approche d’un « assinnu » pour avoir des relations sexuelles, les interdits à son égard seront assouplis.
En tant que dévots d’Ištar, ils exerçaient également une forte influence politique. Un almanach néo-babylonien indique :
le [roi] doit toucher la tête d’un « assinnu », il vaincra son ennemi
et son pays obéira à ses ordres.
Ayant vu leur genre transformé par Ištar elle-même, les assinnu pouvaient marcher entre le divin et le mortel tout en veillant au bien-être des dieux et de l’humanité.
Qui étaient les « ša rēši » ?
Généralement décrits comme des eunuques, les ša rēši étaient des serviteurs du roi. Les « eunuques » de cour ont été recensés dans de nombreuses cultures au fil de l’histoire. Cependant, le terme n’existait pas en Mésopotamie, et les ša rēši avaient leur propre titre distinct.
Le terme akkadien ša rēši signifie littéralement « un de la tête » et désigne les courtisans les plus proches du roi. Leurs fonctions au palais étaient variées, et ils pouvaient occuper plusieurs postes de haut rang simultanément.

Les preuves de leur ambiguïté de genre sont à la fois textuelles et visuelles. Plusieurs textes les décrivent comme infertiles, comme une incantation qui dit :
Comme un « ša rēši » qui n’engendre pas, que ton sperme se dessèche !
Les ša rēši sont toujours représentés imberbes, en contraste avec un autre type de courtisan appelé ša ziqnī (« celui qui a une barbe »), qui avait des descendants. Dans les cultures mésopotamiennes, la barbe symbolisait la virilité ; un homme imberbe allait donc directement à l’encontre de la norme. Pourtant, des bas-reliefs montrent que les ša rēši portaient les mêmes vêtements que les autres hommes royaux, leur permettant ainsi d’afficher leur autorité aux côtés des autres élites masculines.

L’une de leurs fonctions principales était de superviser les quartiers des femmes dans le palais – un lieu à accès très restreint – où le seul homme autorisé à entrer était le roi lui-même.
Étant si étroitement liés au roi, ils pouvaient non seulement occuper des fonctions martiales comme gardes et conducteurs de char, mais aussi commander leurs propres armées. Après leurs victoires, les ša rēši se voyaient attribuer des biens et la gouvernance de territoires nouvellement conquis, comme en témoigne l’inscription royale en pierre que l’un d’eux s’est fait ériger.
Grâce à leur fluidité de genre, les ša rēši pouvaient transcender non seulement les limites de l’espace genré, mais aussi celles séparant le souverain de ses sujets.
La fluidité de genre comme outil de pouvoir
Alors que les premiers historiens considéraient ces figures comme des « eunuques » ou des « travailleur·ses religieux·ses sexuel·les », les preuves montrent que c’est parce qu’ils vivaient en dehors de la binarité de genre que ces groupes pouvaient occuper des rôles puissants dans la société mésopotamienne.
Reconnaître aujourd’hui l’importance des personnes trans et de genre divers dans nos communautés, est, en quelque sorte, une continuité du respect accordé à ces figures anciennes.
Chaya Kasif ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 23:07
Au Moyen Âge, les femmes prenaient (aussi) la plume
Justine Audebrand, Chercheuse associée au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), post-doctorante à l'Institut Historique Allemand, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Texte intégral (2056 mots)

Au Moyen Âge, l’alphabétisation se décline en une palette de situations : savoir lire ne signifie pas qu’on est capable de composer un texte. Seule une petite élite maîtrise l’écriture. Mais dans cette élite, il y a des femmes. Qui étaient-elles ? Et dans quels types d’écrits se sont-elles illustrées ?
Le Moyen Âge apparaît souvent comme une période sombre pour les femmes : cloîtrées dans d’obscurs monastères ou soumises à leur mari, elles auraient été tenues écartées du pouvoir et de toute forme de culture écrite.
Ce cliché, comme beaucoup d’autres, sur les prétendus temps obscurs, apparaît à la Renaissance et se développe dans l’esprit des Lumières. Or, durant les six siècles qui suivent la fin de l’Empire romain, la condition féminine est très éloignée de cet imaginaire collectif. Dans les sphères du pouvoir ou du savoir, certaines femmes tiennent alors une place éminente, qui n’est pas tout à fait la même que ce que l’on verra entre les XIIᵉ et XVᵉ siècles.
Le Moyen Âge est une longue période et de nombreuses reconfigurations politiques, économiques ou religieuses changent et affectent la condition des femmes : celles de la fin de la période sont plus connues car nous possédons davantage de sources, mais celles du début ont parfois accès à des ressources économiques ou culturelles inattendues.
Les femmes ont aussi pris part à la culture de leur temps, c’est que montrent les recherches mises en avant dans la Vie des femmes au Moyen Âge. Une autre histoire VIᵉ-XIᵉ siècle (Perrin, 2026). À une époque où l’alphabétisation était faible, c’est parfois par les femmes que se transmettait la maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Apprendre à écrire
Pour écrire, il faut bien sûr avoir appris le geste technique qui consiste à tracer des lettres sur du parchemin. Aujourd’hui, lecture et écriture s’apprennent ensemble mais, au Moyen Âge, beaucoup de personnes savent lire sans pour autant être capables d’écrire, si ce n’est leur nom.
L’alphabétisation médiévale se pense d’ailleurs comme un spectre : il y a un monde de pratiques entre savoir lire et être capable de composer un texte complexe en latin. De ce fait, la maîtrise complète de l’écriture est réservée à une petite élite, laïque ou ecclésiastique, et de plus en plus à des professionnels de l’écrit comme les notaires qui gagnent en importance à partir du XIIᵉ siècle. Par ailleurs, les laïcs les plus susceptibles d’avoir appris à lire et à écrire disposent aussi de secrétaires : au début du Moyen Âge par exemple, les aristocrates n’écrivent pas eux-mêmes leurs lettres mais les dictent à des secrétaires, voire ne leur donnent que quelques indications.
Les femmes ne sont pas exclues de ces logiques, bien au contraire. Dans l’aristocratie laïque de la première moitié du Moyen Âge, il n’est pas rare qu’elles reçoivent une éducation poussée.
La raison en est simple : elles sont bien souvent elles-mêmes en charge de l’éducation de leurs enfants. La reine Mathilde, épouse du roi de Germanie Henri Ier (919-936), sait par exemple lire et écrire, ce qui n’est pas le cas de son royal époux et, dans la famille ottonienne (du nom de leur fils, le roi puis empereur Otton Ier), ce sont souvent les femmes qui sont les plus lettrées.
Copistes et autrices
Ce n’est pourtant pas chez les laïcs mais au sein des monastères féminins que l’on trouve le plus de femmes qui savent écrire. L’acte le plus courant est la copie de manuscrits : avant l’invention de l’imprimerie, c’est cet inlassable travail qui permet la diffusion des œuvres.
On estime qu’environ 1 % des manuscrits médiévaux ont été copiés par des femmes. Cela peut paraître infime, mais il faut avoir en tête que l’immense majorité des manuscrits ne sont pas signés par leurs copistes et qu’on ne peut donc en réalité que rarement connaître le genre du ou de la copiste. Le travail des moniales est en tout cas loin d’être déconsidéré : à la fin du VIIIᵉ siècle, les nonnes de Chelles sont les principales pourvoyeuses en copies d’Augustin d’Hippone, un des pères de l’Église les plus lus au Moyen Âge. Elles reçoivent notamment des commandes des évêques de Cologne et de Wurtzbourg.
Il est donc logique que ce soit aussi dans les monastères que l’on trouve le plus d’autrices, c’est-à-dire de femmes qui ne se contentent pas de copier des œuvres et en composent de nouvelles. Aucun genre littéraire ne leur est interdit : elles écrivent de l’hagiographie – la vie de saints, hommes et femmes –, des textes annalistiques, des traités, de la poésie et même du théâtre.
La dramaturge et poétesse Hrotsvita, qui vit au monastère de Gandersheim (en Saxe) autour de 960, est ainsi considérée comme la « première poétesse allemande » même si elle écrit, comme la plupart de ses contemporains, en latin.
Une écriture « féminine » ?

Ces textes de femmes ont été étudiés de diverses manières par les historiens, d’abord avec un brin de suspicion : quand les œuvres de Hrotsvita ont été redécouvertes au XIXᵉ siècle, d’éminents savants ont douté de leur attribution et ont cherché, en vain, à affirmer que la moniale n’avait jamais existé, ou jamais écrit…
Et ce n’est que dans les années 1980 que les spécialistes du Moyen Âge ont véritablement commencé à s’intéresser aux écrits des femmes médiévales d’avant Christine de Pizan. Ces travaux sont marqués par l’idée que l’écriture des hommes serait différente de celle des femmes. Il ne s’agit pas de l’écriture manuscrite, paléographique, puisque la différenciation genrée n’apparaît qu’au XVIIIᵉ siècle, mais du style.
Les femmes, même au Moyen Âge, parleraient plus facilement de leurs émotions et de leur famille. C’est sans doute vrai dans certains textes mais, en réalité, les textes écrits par des femmes montrent plus de similitudes que de différence avec ceux des hommes. Cela est dû, en partie, au poids des modèles anciens dans l’écriture médiévale : quand la moniale Baudonivie écrit la vie de la sainte reine Radegonde vers 600, elle a en tête le modèle par excellence qu’est la Vie de saint Martin, tout comme son contemporain Venance Fortunat qui consacre aussi un texte à la sainte.
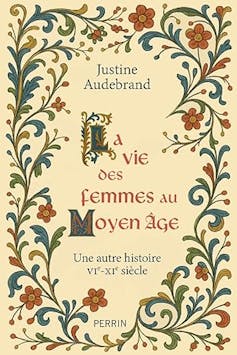
Pour autant, en particulier à partir des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, il semble que l’écriture des femmes soit de plus en plus contrainte et que cela les cantonne parfois à certains types d’écrits. La grande réforme de l’Église connue sous le nom de réforme grégorienne cherche à mieux encadrer les pratiques des fidèles et à redéfinir le lien des femmes au sacré. Le développement des universités – réservées aux clercs et donc aux hommes – exclut aussi les femmes de tout un pan du savoir.
C’est dans ce cadre que fleurissent les femmes mystiques, dont les écrits vantent une proximité particulière avec la divinité. Mais là encore, la réalité est complexe : les visions de ces femmes sont souvent mises par écrit par leur confesseur ou un homme qui peut retravailler la matière transmise par la mystique. Même Hildegarde de Bingen, grande savante et abbesse du XIIᵉ siècle, a recours à un secrétaire. Au Moyen Âge, l’idée d’un auteur ou d’une autrice unique fonctionne rarement, et l’écrit des femmes comme celui des hommes fait souvent appel à une multitude d’intervenants ou intervenantes.
Justine Audebrand ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.02.2026 à 15:59
La statue de la Liberté (1886-2026) : un anniversaire sous tension
Laurence Nardon, responsable du programme Amériques, IFRI (Institut français des relations internationales)
Texte intégral (1305 mots)

Cet article est publié en partenariat avec France Inter. Retrouvez Laurence Nardon, spécialiste de la politique américaine, dans le podcast « L’épopée de Lady Liberty », qui relate l’histoire épique de la statue de la Liberté, une idée française devenue le symbole de l’Amérique. Au fil des dix épisodes de ce poscast, Philippe Collin propose un long voyage dans le temps, un récit mouvementé à travers une amitié transatlantique autour de valeurs à défendre.
L’année 2026 marque les 140 ans de l’inauguration de la statue de la Liberté à New York, le 28 octobre 1886. Cette figure majestueuse, installée sur une île à l’embouchure de l’Hudson, est l’un des monuments préférés des New-Yorkais et des touristes, accueillant quatre millions de visiteurs par an. Au cours du temps, elle a su symboliser tour à tour la libération des esclaves et le triomphe de la république à l’issue de la guerre de Sécession (1861-1865), l’accueil des immigrants et le progrès social dans les années 1930, la lutte du « monde libre » et des démocraties libérales contre le totalitarisme pendant la guerre froide, ou encore la résilience de la ville après les attentats du 11-Septembre…
Cadeau de la France aux États-Unis, Lady Liberty incarne aussi le lien entre ces deux pays. Sa construction est imaginée en 1865 par un groupe d’amis français sous la houlette du professeur de droit Édouard de Laboulaye et du sculpteur Auguste Bartholdi, qui souhaitent célébrer la démocratie libérale américaine au lendemain de la guerre de Sécession. Leur projet exprime plus largement leur adhésion aux valeurs des Lumières et, implicitement, une critique du régime impérial de Napoléon III. Il mettra plus de vingt ans à se réaliser. Grâce à la vente de produits dérivés et aux dons du grand public des deux côtés de l’Atlantique, la statue elle-même est financée par la France, son socle par les Américains.
Une amitié franco-américaine compromise par le populisme trumpiste
La commémoration de son inauguration aurait pu donner lieu cette année à une célébration conjointe de l’amitié franco-américaine, d’autant plus qu’une autre date anniversaire se profile en 2026, celle de la Déclaration d’indépendance. Proclamée le 4 juillet 1776, cette dernière aura cette année 250 ans. On sait que la France a été le premier allié déclaré des rebelles nord-américains, dépêchant Lafayette, Rochambeau et l’amiral de Grasse à la tête de 10 000 hommes pour aider les révolutionnaires dans leur combat pour l’indépendance. On aurait donc pu imaginer dans les mois qui viennent des discours, des fleurs et des embrassades sincères devant la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus et devant celle de Bartholdi au cimetière du Montparnasse.
Hélas, les relations entre Paris et Washington se sont dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025. À vrai dire, l’hostilité de la Maison-Blanche ne concerne pas seulement la France, mais toute l’Europe. Les hausses de droits de douane, les désaccords sur le soutien à l’Ukraine et le projet d’achat du Groenland refusé par le Danemark ne sont que les manifestations concrètes d’une remise en cause beaucoup plus fondamentale : la contestation idéologique du modèle libéral hérité des Lumières par le camp populiste MAGA (Make America Great Again) autour du président Trump. À Munich en février 2025, le vice-président J. D. Vance a ainsi dénoncé le « déclin civilisationnel » du Vieux Continent via le « wokisme » et l’immigration, laissant stupéfait le parterre d’Européens auquel il s’adressait.
Affirmer l’espoir de jours meilleurs
Dans ce contexte, les Européens n’ont désormais plus d’autre choix que de se penser seuls. C’est un choc pour certains de nos voisins : ceux qui sont très proches culturellement des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ou ceux qui se perçoivent comme particulièrement vulnérables vis-à-vis de la Russie, tels que la Pologne ou les pays baltes. Ces derniers avaient compris les avancées russes, de l’annexion de la Crimée en 2014 à l’invasion de l’Ukraine en 2022, comme la preuve qu’il fallait absolument maintenir la protection américaine, impliquant un alignement politique et stratégique, l’achat d’armements américains, etc. Le fait que les États-Unis de Trump soient devenus une puissance menaçante pour le Vieux Continent conduit ces mêmes pays européens à modifier en profondeur leur approche sécuritaire.
Cette rupture est sans doute plus facile à penser pour la France, qui a été historiquement habituée aux frictions avec Washington – c’est pour garantir son indépendance qu’elle a, avant même le retour de de Gaulle au pouvoir en 1958, lancé son propre programme de bombe nucléaire. La situation actuelle entraîne en tout cas des propositions inédites. Ainsi, le premier ministre canadien a proposé, lors du sommet de Davos de janvier 2026, que les puissances moyennes s’unissent pour tenir tête aux grandes puissances inamicales ou devenues inamicales. Si l’on considère qu’une telle alliance existe déjà avec l’Union européenne, cette dernière doit désormais avancer résolument dans la voie de la puissance géopolitique.
Mais sans doute faut-il aussi garder à l’esprit que le populisme trumpiste ne sera qu’un moment, peut-être un cycle, de l’histoire des États-Unis. La société civile américaine a connu deux cent cinquante ans de pratique démocratique ininterrompue et compte dans ses rangs une majorité de personnes « décentes ». Ces dernières auront du mal à accepter un glissement durable vers l’illibéralisme et l’agressivité internationale. Tocqueville ajoute encore que les Américains sont finalement peu intéressés par les passions politiques, tendant à se retirer tôt ou tard dans leur sphère privée.
Dès lors, les symboles conservent toute leur importance. Célébrer cette année la statue de la Liberté et les valeurs qu’elle incarne, c’est aussi affirmer l’espoir de jours meilleurs pour les États-Unis comme pour leurs alliés.
Laurence Nardon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.02.2026 à 14:01
« Hamnet » ou le roman d’une femme puissante
Armelle Parey, Professeur de littératures de langue anglaise, Université de Caen Normandie
Texte intégral (1425 mots)

La sortie du film Hamnet de Chloé Zhao et son grand succès critique sont l’occasion de revenir au roman éponyme, publié par la romancière britannique Maggie O’Farrell en 2020, et à la façon dont ce récit met en lumière des personnages en marge de l’histoire littéraire, en particulier l’épouse de Shakespeare, Agnes (dite Anne) Hathaway.
Ce qui frappe probablement le plus sur l’affiche du film Hamnet, outre sa très belle photographie, est ce titre qui ne manque pas d’interpeller le passant ou la passante par sa quasi-homophonie avec Hamlet, l’un des plus célèbres titres et personnages de William Shakespeare. L’affiche, qui représente un couple, nous promet d’ailleurs « L’histoire méconnue qui a inspiré le plus grand chef-d’œuvre de Shakespeare ». En effet, Hamnet est le prénom du fils du dramaturge et le film comme le roman développent la thèse selon laquelle c’est à ce garçon décédé à l’âge de 11 ans pour des raisons inconnues que l’on devrait indirectement Hamlet et, probablement, la Nuit des rois.
Si le point d’orgue du roman est la mort d’Hamnet qui intervient à la moitié du volume et à ses effets sur sa famille, la véritable protagoniste est la mère de l’enfant et épouse de Shakespeare, généralement connue sous le nom d’Anne Hathaway. Dans le scénario du film co-écrit par O’Farrell, comme dans l’adaptation théâtrale proposée par Lolita Chakrabarti en 2023, le propos est quelque peu infléchi pour donner une part plus importante au personnage du dramaturge qui reste en retrait, jamais nommé, dans le roman. Dans Hamnet, Anne Hathaway est Agnes, son nom de naissance, O’Farrell signalant ainsi dès le début que son récit se détache des portraits négatifs et infondés dressés jusqu’au XXe siècle dans des biographies et des romans qui représentaient cette femme dont l’on ne sait pourtant presque rien en prédatrice âgée et ignare. Après une étude exhaustive de ce que l’on sait d’Anne, Katherine West Scheil, professeure de littérature anglaise, a montré la variété des récits faits sur la conjointe de Shakespeare au fil des siècles en fonction des évolutions culturelles, jusqu’à des romances récentes qui font d’elle une influence majeure dans la production shakespearienne.
Un récit alternatif et vraisemblable
Tout en restant dans les limites du vraisemblable, O’Farrell élabore dans Hamnet un récit alternatif plus juste envers cette femme, rappelant qu’elle était en fait un bon parti pour les Shakespeare endettés auprès de la famille Hathaway. O’Farrell cite parmi ses sources la féministe Germaine Greer qui revient sur les interprétations négatives des biographes qui attribuent par exemple les années passées par Shakespeare loin de sa famille au désir d’être éloigné de sa femme, négligeant le fait qu’il prend le soin de l’installer dans la plus grande maison des environs… Greer suggère que cette séparation peut très bien avoir été une décision conjointe puisque Anne n’a pas dénoncé son époux pour avoir déserté le domicile conjugal comme cela aurait été possible. O’Farrell va plus loin en montrant que c’est Agnes qui organise le départ de son mari pour Londres, lui permettant ainsi d’écrire, consciente qu’il étouffe à Stratford dans l’atelier d’un père violent, gantier de son état.
« Le romancier est l’interprète du mystère », dit l’historienne et essayiste Mona Ozouf. C’est en effet le propre du roman en général que de combler les blancs de l’histoire, d’imaginer ce que ce que l’on ne sait pas. O’Farrell utilise la liberté permise par la fiction pour questionner la mémoire officielle qui s’est cristallisée autour du personnage de la femme de Shakespeare et envisager des alternatives.
Lorsqu’elle apparaît de loin au jeune précepteur pour la première fois dans le roman, Agnes est prise pour un garçon, signe d’un caractère transgressif et en dehors des normes souligné tout au long du roman à tel point qu’on la dit folle ou fille d’une sorcière. L’Agnes imaginée par O’Farrell est bien une femme puissante. Certes illettrée, elle est dotée d’une connaissance du monde de la nature qui lui permet de fabriquer des remèdes pour soigner les autres doublé d’un don de prémonition. Inventive et pragmatique, elle sait qu’une grossesse est le moyen de forcer les 2 familles à accepter leur union.
Une évocation féministe du passé
Cette mise au premier plan d’un personnage très secondaire de l’histoire littéraire ne se fait pas aux dépens du poète et dramaturge. Désigné par ses différents rôles dans la vie ordinaire (précepteur de latin, père, mari, etc.) le personnage de Shakespeare est en marge du roman qui explore dans sa deuxième partie la douleur de la mère. Le roman (comme le film) culmine cependant avec la représentation finale d’Hamlet qui permet la réconciliation d’un couple séparé par la perte de leur enfant lorsque Agnes succombe à « l’alchimie » ou illusion théâtrale grâce à laquelle elle retrouve son fils sur scène. Hamnet contextualise l’écriture d’Hamlet et interprète la pièce comme un hommage certain, bien qu’indirect, au fils disparu ; le roman célèbre également le pouvoir de l’art à rendre compte de l’expérience humaine et à offrir du réconfort. Enfin, à travers la réaction finale d’Agnes à la représentation de la pièce, le lecteur est convaincu du talent artistique supérieur de Shakespeare et de son génie des mots.
Quand elle imagine ces histoires de vies ordinaires négligées ou déformées, O’Farrell sauve Hamnet de l’invisibilité et Anne Hathaway de son assujettissement à des rôles négatifs ou improbables. En outre, en se concentrant sur Agnes et les activités quotidiennes des femmes, O’Farrell souligne également l’absence de traces écrites de l’expérience domestique. Dans une certaine mesure, son évocation féministe du passé complète les archives historiques en réinsérant les activités domestiques d’Agnes et des autres personnages féminins dans le récit.
En comblant les lacunes de la mémoire et en soulignant l’impact d’une figure mineure comme Hamnet Shakespeare, en réparant les dommages indûment causés à la réputation d’Agnes Shakespeare, en donnant vie et voix aux invisibles ou personnages perçus comme mineurs, Hamnet s’inscrit dans la lignée du roman historique contemporain et du roman biographique qui réorientent la mémoire culturelle.
Armelle Parey ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.02.2026 à 16:31
Parlez-vous l’« algospeak » ? Les dessous d’une néologie particulière
Anne Gensane, Chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
Texte intégral (1657 mots)

Aujourd’hui, les contenus en ligne sont massivement surveillés par des algorithmes chargés de filtrer ce qui est jugé sensible ou contraire aux règles des plateformes (propos injurieux ou insultes). Pour continuer à s’exprimer malgré ces restrictions, les internautes ont développé ce que l’on appelle désormais l’« algospeak ». Mais exprimer quoi ? Comment ? Pourquoi ? Et à quel prix ?
Le mot « algospeak » est formé des termes anglais algo, troncation d’« algorithme », et speak, « parler ». À ce jour, il reste cependant un néologisme non référencé dans les dictionnaires généralistes les plus connus. Il désigne un ensemble de pratiques linguistiques consistant à modifier volontairement la forme ou le sens des mots afin d’évoquer des sujets considérés comme problématiques par les plateformes en échappant à la détection automatisée. Du point de vue de la néologie (analyse de la (re)création des mots), on parle de « néologismes de forme » (modifications graphiques, substitutions phonétiques…) et de « néosémies » (glissements ou détournements de sens).
L’objectif de l’algospeak est double. Il s’agit, d’une part, d’éviter des sanctions telles que la suppression du contenu ou même du compte ; d’autre part, de rester compréhensible par les autres utilisateurs. Il ne s’agit pas seulement d’inventer de nouveaux mots, mais de négocier en permanence avec des systèmes de contrôle automatisés.
Comment parler « algo » ?
Les travaux anglophones consacrés à l’algospeak sont relativement nombreux. Nous pouvons notamment trouver des recensements de termes observés. En revanche, les études francophones restent lapidaires ; c’est pourquoi la constitution de corpus spécifiques représente aujourd’hui un enjeu majeur pour la recherche en néologie (et en argotologie contemporaine). Nous recherchons activement des informateurs pour nous aider à finaliser une typologie.
Concrètement, comment contourne-t-on un filtre lexical en français ?
Un émoji (🍆) peut se substituer à un mot, une graphie peut être altérée en remplaçant des lettres par des chiffres (la « v10lence »), ou en lui incorporant des points entre chaque lettre (le s.u.i.c.i.d·e), des astérisques peuvent remplacer des lettres (le v***) voire peuvent être finalement supprimées : il est possible de nommer avec une seule lettre (le V). Des périphrases et des métaphores peuvent permettre, également, d’évoquer indirectement certaines réalités. Nous pourrions ajouter que dans les contenus audiovisuels, un bip sonore peut masquer un terme problématique (comme une image peut être brièvement floutée afin de préserver la visibilité d’une vidéo).
La compréhension de ces messages suppose une compétence interprétative particulière. Le destinataire doit être capable d’assembler différents indices et de reconnaître des conventions implicites. L’algospeak repose ainsi sur une forme de connivence linguistique, où la compréhension n’est jamais totalement garantie.
Argot et « algo »
À bien des égards, l’algospeak peut sembler familier : il n’est pas sans rappeler des formes connues de création ou d’innovation linguistique. Il fait par exemple penser aux formes scripturales du célèbre « langage SMS » d’antan…
Mais surtout, il présente des affinités avec les pratiques argotiques néologiques qui reposent elles aussi sur le détournement du sens et de la forme des mots afin de permettre une communication entre initiés. Dans ces deux cas, il s’agit d’une néologie fonctionnelle : le langage est transformé pour répondre à une contrainte précise.
Cependant, il nous faut nommer ici au moins deux différences majeures qui distinguent l’algospeak de l’argot « classique ». D’abord, l’argot est de tradition orale, au contraire de l’algospeak. Ensuite, la contrainte n’est plus principalement sociale, mais algorithmique. Là où l’argot visait souvent à se distinguer d’un groupe dominant ou à exclure en tout cas certains interlocuteurs humains, l’algospeak cherche avant tout à devenir invisible pour des systèmes d’intelligence artificielle.
Les locuteurs ne cherchent pas nécessairement à marquer une identité collective forte, mais à rendre leurs propos indétectables par des dispositifs dont les règles sont changeantes et rarement explicitées. Il s’agit de dire autrement ce qui ne peut plus être dit directement.
Un caractère éphémère ?
L’algospeak est, par définition, un langage éphémère. Dès qu’une expression est repérée par un filtre automatique, il perd sa valeur stratégique et doit être remplacé. On peut ainsi parler d’une véritable obsolescence programmée du langage, où l’éphémère constitue une propriété centrale. Ce n’est pas autant le cas pour les pratiques argotiques bien qu’elles soient tout à fait labiles : la vitesse du changement n’est pas tout à fait la même.
Pour autant, toutes les créations de l’algospeak ne disparaissent pas aussitôt. Certaines parviennent à se stabiliser et à dépasser leur fonction initiale de contournement. Elles peuvent être reprises dans d’autres contextes, parfois à l’oral, parfois dans des usages argotiques plus classiques. Le terme « tana » qui désigne, pour l’insulter, une jeune femme qui est jugée trop visible (vraisemblablement la forme tronquée du nom de la série Hannah Montana, diffusée entre 2006 et 2011, ou d'Ana Montana, mannequin reconnue dans les années 2010), par exemple, illustre cette circulation entre sphères numériques et pratiques langagières plus larges. Il devient aussi difficile de déterminer l’origine exacte d’un mot : est-il né pour déjouer un algorithme, ou appartenait-il déjà à des usages préexistants ?
Cette porosité montre que l’algospeak ne constitue pas un phénomène isolé. Il pourrait témoigner d’une évolution plus générale du lexique, marquée par l’effacement progressif des frontières entre langage numérique et parlers ordinaires.
Des enjeux éthiques
L’algospeak repose sur un savoir-faire collectif, construit et transmis au sein de communautés d’internautes. Il s’appuie sur l’expérience : on apprend, au moyen d’essais et d’erreurs, ce qui risque d’être modéré et comment reformuler ce qu’il vaut mieux éviter de dire explicitement. Ces pratiques mobilisent ainsi de nouvelles compétences liées à l’anticipation de la modération algorithmique.
Mais cette adaptation n’est pas sans conséquences. Modifier les mots pour éviter la censure peut en atténuer la force symbolique. Remplacer un terme explicite par un émoji ou une périphrase permet de rester visible, mais peut aussi rendre certaines réalités moins lisibles voire les banaliser. L’algospeak apparaît dès lors comme une solution ambivalente : il ouvre des espaces d’expression tout en transformant profondément la manière dont les choses sont nommées et perçues.
S’il s’agissait surtout, au départ, de modérer le contenu pour lutter contre une « désinformation » au sujet de la pandémie causée par le coronavirus, le problème est désormais déplacé.
L’algospeak met en lumière des enjeux centraux liés aux rapports entre langage, intelligence artificielle et… pouvoir. Il illustre la capacité d’adaptation des locuteurs face à des systèmes de contrôle invisibles et omniprésents, mais cette créativité linguistique n’est pas sans ambiguïté : si elle permet de préserver une libre expression dans un espace public, elle a le pouvoir de transformer la manière de nommer le réel qui dérange. Or, comme l’ont montré par exemple les (socio)linguistes, nommer le réel n’est jamais un acte neutre : c’est déjà exercer un pouvoir symbolique sur lui.
L’algospeak pose dès lors une question éthique centrale : comment continuer à s’exprimer librement, dans une volonté de prévention par exemple, dans un environnement de plus en plus surveillé, tout en restant compréhensible et sans perdre l’impact symbolique des mots ? À travers ces détours linguistiques se joue peut-être, discrètement mais à terme, une redéfinition assez profonde de notre manière de dire le monde.
Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 16:13
Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine
Elsa Valle, Doctorante, Institut catholique de Paris (ICP)
Texte intégral (2075 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.
« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »
Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.
L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.
Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.
Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.
L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.
Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international
La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.
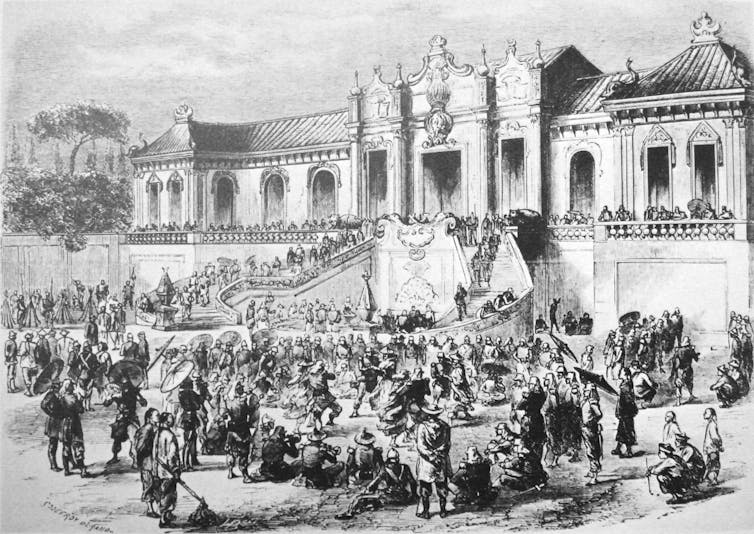
Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.
Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.
Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.
Un trafic illicite toujours actif
Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.
Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.
Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.
Les limites du droit international du patrimoine
La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.
La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.
La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.
Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois
Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.
Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.
Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.
Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.
Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
04.02.2026 à 16:09
Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy
Gaëlle Crenn, Maîtresse de conférences en Sc. de l'Info-Com, Centre de Recherche sur les Médiations (CREM), Université de Lorraine
Texte intégral (1832 mots)

À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, a été dévoilée, le 6 novembre 2025, face à la statue du sergent Blandan, la Table de désorientation, œuvre de Dorothée-Myriam Kellou, qui, selon l’inscription visible sur le socle, « interroge le passé colonial de l’Algérie et de la France, évoque ses blessures et appelle à la réparation ». Par les conditions de sa genèse, par les caractéristiques de son implantation, mais aussi par la singularité de sa grammaire stylistique, la Table de désorientation inaugure une politique mémorielle originale.
Ce monument est le résultat d’un processus de patrimonialisation « par le bas », produit d’initiatives convergentes de divers acteurs locaux : un projet pédagogique au lycée Jeanne-d’Arc, lancé par le professeur Étienne Augris, touché par le mouvement Black Lives Matter ; l’histoire personnelle de la famille Kellou, dont le père, le réalisateur Malek Kellou, a découvert la statue durant son enfance à Boufarik (près de Blida en Algérie), puis, devenu résidant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), l’y a redécouverte. Cette histoire trouve un écho dans la démarche des musées de la ville, qui souhaitent explorer les enjeux mémoriels liés à la colonisation.
À lire aussi : Ce que les statues coloniales dans l’espace public racontent de la France
En 2022, l’exposition « Sur les traces du sergent Blandan », inaugure le programme « Récits décoloniaux » au musée des Beaux-Arts de Nancy. Le projet se concrétise ultimement avec une commande publique d’œuvre à la fille du réalisateur, Dorothée-Myriam Kellou. L’œuvre mêle « Histoire » et « histoire », politique coloniale et récit familial intime. Elle naît de la transmission d’une histoire traumatique d’abord tue, puis déliée, après un temps d’anamnèse, dans un geste de transmission filiale.
Installée à quelques mètres de la statue, l’œuvre est un miroir circulaire, dressé à la verticale, qui porte en inscription un texte poétique de l’autrice, débutant par une interpellation du sergent : « Qui es-tu ? » Le texte, inscrit en français et en arabe – les deux écritures se déployant en miroir l’une de l’autre, vise à interpeller le spectateur qui découvre en passant son reflet dans la surface miroitante.
À lire aussi : Ce que les statues coloniales dans l’espace public racontent de la France
Un contre-monument dissonant
Le reflet perturbe la perception habituelle et permet de replacer le monument Blandan dans le périmètre de notre attention, invitant à la réflexion sur le sens que peut prendre aujourd’hui cet emblème de la statuaire figurative de l’époque coloniale.
Après son rapatriement forcé en 1963, suite à l’indépendance algérienne, et après un temps de purgatoire dans une caserne, la statue est réinstallée en 1990 sur le terre-plein d’un carrefour près de la caserne qui porte son nom. Elle est ensuite déplacée de quelques mètres et repositionnée, pour prendre place face aux nouveaux bâtiments d’ARTEM, un complexe universitaire novateur.
La présence imposante de la statue n’empêche cependant pas un relatif oubli de cette figure. C’est pourquoi,« devant la statue du sergent Blandan qui a perdu son sens historique pour la plupart des passants, mais qui exerce toujours son influx mémoriel, se dresse un appel en miroir » (texte du socle).
L’œuvre redonne visibilité au monument initial, mais en le recontextualisant, en ouvrant des « réinterprétations de l’histoire coloniale », en proposant des « contrepoints » au récit, plutôt que des répliques (discours de Dorothée-Myriam Kellou lors du dévoilement).
On peut soutenir que l’espace physique entre les monuments fait naître un nouvel espace discursif qui permet d’initier un dialogue sur les multiples significations de la statue. Ce dialogue se nourrit d’un jeu d’opposition : entre l’« Histoire » officielle et l’« histoire » familiale qu’elle vient percuter, entre les mémoires des exploits militaires et les mémoires des descendants de familles algériennes immigrées. Le contre-monument institue un espace de discussion sur le sens des héritages coloniaux ouverts à des interprétations divergentes, voire contradictoires.L’ espace inter-monumental produit de plus une mise en tension de la géographie mémorielle de la ville. Il résonne avec l’inauguration récente d’une esplanade du nom de François Borella, membre du PSU (Parti socialiste unifié), victime de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), geste qui veut affirmer l’attachement de la ville aux valeurs républicaines.
Avec ce contre-monument, « une trace ajoutée à une trace » (carton d’invitation), s’ouvre « un espace de relation et de réflexion critique sur les conséquences contemporaines de la colonisation » (ibid.).
Par ce geste, la Ville de Nancy déploie ce que l’on peut appeler une politique de la dissonance patrimoniale. Alors que le patrimoine est habituellement pensé comme le résultat d’un consensus sur les legs du passé que l’on souhaite conserver, le terme prend ici une signification plus complexe, qui incorpore les dissensions et les disputes qui le colorent.
En phase avec les nouvelles expressions citoyennes de revendication mémorielle, le rôle de la statuaire publique s’en trouve modifié : moins au service de l’imposition et de l’affirmation de valeurs que de leur mise en débat et de leur diffraction dans l’espace public.
Un anti-monument de réparation mémorielle
Au-delà de son rôle de contre-monument, on peut également considérer la Table comme un anti-monument, au sens que l’artiste Jochen Gerz, ainsi que ses commentateurs et commentatrices ont pu donner à ce terme.
Selon Gerz, un anti-monument est une proposition qui, par sa grammaire plastique et stylistique, remet en cause les fonctions habituellement remplies par les monuments – affirmer des valeurs, représenter (des héros, des victimes ou des allégories) –, au profit d’une ouverture à la réflexion et à la multiplication des significations possibles. La Table de désorientation possède cette forme d’humilité et d’ouverture aux interprétations favorisant une mise en suspens des valeurs. Comme le dit encore Mathieu Klein dans son discours, l’œuvre « ne nous impose rien, elle invite à penser ».
Le trait le plus marquant de la Table est la modestie de sa taille. Dressée et légèrement inclinée vers l’arrière, elle mesure 1,59 mètre – ce qui était très exactement la taille du sergent. Sa rondeur et sa petitesse sont en tant que telles une remise en question de la monumentalité de la statue voisine, qui culmine sur son énorme socle à presque 4 mètres de hauteur. À l’impression de lourdeur et d’opacité donnée par l’ensemble massif de pierre et de bronze, qui héroïse le combattant colonial, encapsule les valeurs guerrières et rappelle la politique de conquête impérialiste, s’oppose la clarté et la légèreté de la Table. Ses miroitements conduisent les passant·es à se questionner, sans préjuger de leurs interprétations : elle renvoie les sujets à leur propre réflexion (aux sens propre et figuré).
Alors que l’attitude du sergent, les mentions sur le socle, ses bas-reliefs de bronze et sa plaque commémorative concourent tous à affirmer la valorisation du guerrier héroïque mort pour la colonisation, la Table invite à mettre en question ces valeurs et à rouvrir un questionnement sur celles que nous (l’ensemble de la communauté) souhaitons voir célébrées aujourd’hui dans l’espace public. Ainsi, l’œuvre contribue à la mise en débat des héritages de la colonisation et à la réflexion sur la place des descendants et des minorités. À l’égard des anciennes voix silenciées, elle opère une forme de réparation mémorielle.
Quelle orientation des publics ?
Une difficulté cependant peut naître dans l’appropriation du nouveau monument par le public. En effet, le texte gravé sur le miroir, avec son lettrage subtil, s’avère très difficile à déchiffrer. Lors de la cérémonie de dévoilement, les premiers spectateurs et spectatrices ne ménagent pourtant pas leurs efforts, se rapprochant au maximum de la surface miroitante, reculant et variant les angles de vue. La mairie a prévu un programme de médiations pour accompagner la découverte de la nouvelle œuvre publique dans son contexte. Celles-ci s’avèreront sans doute utiles pour que le public ne souffre pas d’une « désorientation » excessive.
Peut-être même l’adjonction d’un panneau permanent sera-t-elle à envisager afin de lui livrer des appuis interprétatifs pour faire sens de l’œuvre et de l’espace intermonumental qu’elle génère. Cela serait sans doute profitable pour qu’il saisisse toute la richesse de ce nouveau monument, à la fois populaire par sa genèse, dissonant dans son principe, contre- et anti-monumental dans ses effets.
Gaëlle Crenn a été membre de la liste des Verts lors des élections municipales de Nancy en 2020.
03.02.2026 à 17:14
Addicts à nos écrans : et si tout avait commencé avec la télé en couleurs ?
Jean-Michel Bettembourg, Enseignant, Métiers du multimédia et de l'Internet, Université de Tours
Texte intégral (1882 mots)

Octobre 1967, le premier programme en couleurs est diffusé sur la deuxième chaîne de l’ORTF (aujourd’hui, France 2). Pourtant, la démocratisation de la télévision couleur a pris de nombreuses années, pour s’imposer à la fin des années 1980 dans quasiment tous les foyers de France, créant une forme de séduction qui se poursuit peut-être aujourd’hui à travers l’addiction aux écrans.
Le 1er octobre 1967, dans quelques salons français, le monde bascule avec l’avènement de la télévision en couleurs : une révolution médiatique, mais aussi politique, sociale et culturelle.
Cette première diffusion a lieu sur la deuxième chaîne de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Mais la télévision en couleurs, au début, n’est pas à la portée de tous. Pour la grande majorité des Français, elle reste un rêve inaccessible. Il y a, d’un côté, une ambition nationale immense pour promouvoir cette vitrine de la modernité et, de l’autre, une réalité sociale qui reste encore largement en noir et blanc.
La décision, très politique, vient d’en haut. La couleur n’était pas qu’une question d’esthétique, et le choix même de la technologie, le fameux procédé Sécam, est une affaire d’État. Plus qu’une décision purement technique, le choix d’un standard de télé est en réalité une affaire de souveraineté nationale.
Pour comprendre ce qui se joue, il faut se replacer dans le contexte de l’époque. Dans la période gaullienne, le maître mot, c’est l’indépendance nationale sur tous les fronts : militaire, diplomatique, mais aussi technologique.
Un standard très politique
Pour le général de Gaulle et son gouvernement, imposer un standard français, le Sécam, est un acte politique aussi fort que de développer le nucléaire civil ou plus tard de lancer le programme Concorde. La France fait alors face à deux géants : d’un côté le standard américain, le NTSC, qui existe déjà depuis 1953, et le PAL, développé par l’Allemagne de l’Ouest. Choisir le Sécam, c’est refuser de s’aligner, de devenir dépendant d’une technologie étrangère.
L’État investit. Des millions de francs de l’époque sont investis pour moderniser les infrastructures, pour former des milliers de techniciens et pour faire de la deuxième chaîne une vitrine de cette modernité à la française. Sécam signifie « Séquentiel couleur à mémoire », un système basé sur une sorte de minimémoire tampon avant l’heure, qui garantit une transmission sur de longues distances et des couleurs stables qui ne bavent pas.
Le pari est audacieux, car si la France opte ainsi pour un système plus robuste, cela l’isole en revanche du reste de l’Occident. Le prix à payer pour cette exception culturelle et technologique est double. Tout d’abord, le coût pour le consommateur : les circuits Sécam étaient beaucoup plus complexes et donc un poste TV français coûtait entre 20 et 30 % plus cher qu’un poste PAL, sans compter les problèmes d’incompatibilité à l’international. L’exportation des programmes français est acrobatique : il faut tout transcoder, ce qui est coûteux et entraîne une perte de qualité. Et ce coût, justement, nous amène directement à la réalité sociale de ce fameux 1er octobre 1967.
Fracture sociale
D’un côté, on avait cette vitrine nationale incroyable et, de l’autre, la réalité des salons français. Le moment clé, c’est l’allocution du ministre de l’information Georges Gorse qui, ce 1er octobre 1967, lance un sobre mais historique « Et voici la couleur… ». Mais c’est une image d’Épinal qui cache la fracture.
Le prix des télévisions nouvelle génération est exorbitant. Un poste couleur coûte au minimum 5 000 francs (soit l’équivalent de 7 544 euros, de nos jours). Pour donner un ordre de grandeur, le smic de l’époque est d’environ 400 francs par mois … 5 000 francs, c’est donc plus d’un an de smic, le prix d’une voiture !
La démocratisation a été extrêmement lente. En 1968, seuls 2 % des foyers environ étaient équipés, et pour atteindre environ 90 %, il faudra attendre jusqu’en… 1990 ! La télévision couleur est donc immédiatement devenue un marqueur social. Une grande partie de la population voyait cette promesse de modernité à l’écran, mais ne pouvait pas y toucher. La première chaîne, TF1, est restée en noir et blanc jusqu’en 1976.
Cette « double diffusion » a accentué la fracture sociale, mais en même temps, elle a aussi permis une transition en douceur. Le noir et blanc n’a pas disparu du jour au lendemain. Et une fois ce premier choc encaissé, la révolution s’est mise en marche.
La couleur a amplifié de manière exponentielle le rôle de la télé comme créatrice d’une culture populaire commune. Les émissions de variétés, les feuilletons, les jeux et surtout le sport, tout devenait infiniment plus spectaculaire. L’attrait visuel était décuplé. Lentement, la télévision est devenue le pivot qui structure les soirées familiales et synchronise les rythmes de vie. Et en coulisses, c’était une vraie révolution industrielle. L’audiovisuel s’est professionnalisé à une vitesse folle. Les budgets de production ont explosé.
Cela a créé des besoins énormes et fait émerger de tout nouveaux métiers, les étalonneurs, par exemple, ces experts qui ajustent la colorimétrie en postproduction. Et bien sûr, il a fallu former des légions de techniciens spécialisés sur la maintenance des caméras et des télés Sécam pour répondre à la demande. Dans ce contexte, l’ORTF et ses partenaires industriels, comme Thomson, ont développé des programmes ambitieux de formation des techniciens, impliquant écoles internes et stages croisés.
Le succès industriel est retentissant. L’impact économique a été à la hauteur de l’investissement politique initial. L’État misait sur la recherche et le développement. Thomson est devenu un leader européen de la production de tubes cathodiques couleur, générant des dizaines de milliers d’emplois directs dans ses usines. C’est une filière entière de la fabrication des composants à la maintenance chez le particulier qui est née.
Et puis il y a eu le succès à l’exportation du système. Malgré son incompatibilité, le Sécam a été vendu à une vingtaine de pays, notamment l’URSS.
La place des écrans dans nos vies
Mais en filigrane, on sentait déjà poindre des questions qui nous sont très familières aujourd’hui, sur la place des écrans dans nos vies. C’est peut-être l’héritage le plus durable de la télévision en couleurs. La puissance de séduction des images colorées a immédiatement renforcé les craintes sur la passivité du spectateur. On commence à parler de « consommation d’images », d’une « perte de distance critique ».
Le débat sur le temps d’écran n’est pas né avec les smartphones, mais bien à ce moment-là, quand l’image est devenue si attractive, si immersive, qu’elle pouvait littéralement « capturer » le spectateur. La télé couleur, avec ses rendez-vous, installait une logique de captation du temps.
Et avec l’arrivée des premières mesures d’audience précises à la fin des années 1960, certains observateurs parlaient déjà d’une forme d’addiction aux écrans. La couleur a ancré durablement la télévision au cœur des industries culturelles, avec le meilleur des créations audacieuses et le moins bon, des divertissements certes très populaires mais de plus en plus standardisés.
L’arrivée de la couleur, c’était la promesse de voir enfin le monde « en vrai » depuis son salon. Cette quête de réalisme spectaculaire, de plus vrai que nature, ne s’est jamais démentie depuis, de la HD à la 4K, 6K et au-delà. On peut alors se demander si cette promesse initiale vendue sur un écran de luxe ne contenait pas déjà en germe notre rapport actuel à nos écrans personnels ultraportables, où la frontière entre le réel et sa représentation est devenue une question centrale.
Jean-Michel Bettembourg ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.02.2026 à 16:21
Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
Isabelle Horvath, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université de Haute-Alsace (UHA)
Gaëlle Dechamp, Maître de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches, Sciences de Gestion et du Management, Grenoble INP - UGA
Texte intégral (2125 mots)

Mère de trois enfants, chanteuse lyrique et codirectrice d’une association dont la double activité porte sur la médiation culturelle et la création de spectacles lyriques, Caroline jongle avec ses différentes activités et identités au quotidien. Deux chercheuses en entrepreneuriat artistique et culturel ont conduit avec elle un travail pour comprendre quelles stratégies elle mettait en place, loin du modèle classique et malgré les obstacles rencontrés, dans un contexte de baisse des subventions culturelles en France.
L’entrepreneuriat artistique et culturel associe le monde de l’entreprise au monde de la culture. Dans la presse professionnelle, notamment celle du spectacle vivant, dans les associations ou encore dans les réunions stratégiques d’établissements culturels, on en parle de plus en plus pour trouver une solution aux difficultés de financement, de production et de diffusion des œuvres. L’entrepreneuriat artistique et culturel consiste à développer de manière structurée un projet dans le domaine des arts et de la culture en conciliant la dimension artistique avec la dimension économique.
Il génère à la fois des valeurs symboliques, telles que la création et la diffusion de formes esthétiques, et des valeurs économiques parce que l’art se produit, se vend, s’achète et, ainsi, qu’il est à l’origine d’emplois, de métiers avec un poids économique direct en France de 2 %. L’entrepreneuriat créatif et culturel suscite de plus en plus d’intérêt, car la baisse des subventions pour financer la culture n’est pas simplement une mauvaise passe, mais un sujet qui questionne sur les modèles économiques à inventer sans vendre son âme au diable. Il s’agit plutôt de considérer que tous les dispositifs de gestion et managériaux sont au service des arts et de la culture et non l’inverse.
Le casse-tête des femmes entrepreneures dans la culture
Cette donne est commune à tous les acteurs du secteur. Mais quand on est une femme, qui plus est une mère, autrement appelée « mampreneure », transformer la tension en dynamique devient un défi qui relève parfois du casse-tête. Selon l’Indice entrepreneurial français de 2023, 28 % des femmes sont inscrites dans une dynamique entrepreneuriale (projet de création, création ou reprise d’entreprise) contre 37 % des hommes. Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, 39,6 % des entreprises individuelles sont créées par des femmes et 60,4 % par des hommes. La motivation des femmes à devenir entrepreneures repose sur trois facteurs : la nécessité pour assurer les besoins primaires du foyer ; un choix de carrière pour davantage se réaliser ; la conciliation famille-travail.
Dans le cas des mampreneures, les trois facteurs se combinent, cependant rechercher une situation professionnelle pour répondre à un besoin de réalisation de soi est premier. Dans le secteur artistique et culturel, ces femmes sont 32 % à être intermittentes avec une organisation de travail discontinue. Les mampreneures font face à une précarité plus importante que tout autre intermittent. Elles sont appelées aussi « matermittentes » ; leur nombre n’est pas recensé. Le collectif du même nom s’engage pour une reconnaissance de ce statut particulier.
Au-delà des conditions matérielles, les particularités des mampreneures artistes concernent leur organisation en millefeuille avec une « interdépendance des temps » individuels, familiaux et professionnels. Comment réussir le triple défi d’être à la fois femme, artiste et entrepreneure ?
Pour le relever, il faut inventer ses propres outils. C’est ce que Caroline a fait. Nous l’avons rencontrée et nous avons cherché à comprendre comment s’est construit son parcours entrepreneurial.
Comment tout concilier ?
Caroline est à la fois docteure en sciences de gestion et du management, chanteuse lyrique et co-directrice de l’association Brins de Voix dont la double activité porte sur la médiation culturelle et la création de spectacles lyriques. Au moment de sa fondation, Caroline a un bébé d’un an, elle en aura deux autres par la suite. Elle est intermittente du spectacle, donc non salariée.
Notre mampreneure doit relever deux défis qui caractérisent l’entrepreneure artistique : concilier deux rôles qui peuvent paraître incompatibles, à savoir créer et entreprendre ; articuler une vie personnelle avec une vie professionnelle, marquée dans le spectacle vivant par un rythme atypique à cause des horaires décalés et des absences dues aux tournées. Caroline s’est alors retrouvée devant la nécessité d’innover, pour articuler son parcours, en matière d’outillage managérial, qui, sans donner une réponse unique, constitue une ouverture dont d’autres mampreneures artistes peuvent s’inspirer. Nous avons étudié ce processus entrepreneurial à partir d’une approche autoethnographique, c’est-à-dire de l’analyse de l’expérience mise en récit par l’auteur, et de l’éclairage par la théorie de l’effectuation.
Cette théorie est bien adaptée aux contextes d’incertitude car elle propose une alternative aux modèles rationnels de l’entrepreneuriat. Elle privilégie l’intuition à la logique causale, le processus de création de l’avenir à sa prédiction, les transformations successives à l’élaboration d’un modèle d’affaires. Ainsi repose-t-elle sur cinq principes : faire avec ses moyens (1) ; définir les pertes acceptables (2) ; privilégier les partenariats (3) ; être ouvert aux surprises (4) ; créer son propre univers (5).
Un parcours jonché de difficultés
Le parcours entrepreneurial de Caroline est jonché de difficultés qu’elle réussit à dépasser grâce à sa capacité à inventer des outils de gestion et des dispositifs organisationnels qui peuvent servir d’inspiration aux mampreneures artistes du spectacle vivant.
Le critère physique est souvent pris en compte lors des auditions ; la femme, plus que l’homme, doit ressembler à l’image du rôle à interpréter. Le cycle hormonal a un impact sur la qualité vocale ; la durée de carrière est plus courte que pour les hommes à cause des changements de tessiture. Les obstacles sont liés aussi à la garde des enfants, car les horaires et les déplacements sont mal adaptés à une vie de famille et encore moins à une situation d’urgences médicales ; il est impossible d’amener son enfant en coulisses sans nourrice et, enfin, un enfant non gardé est synonyme d’absence de la chanteuse et donc d’annulation de spectacle, ce qui n’est pas envisageable. La fatigue engendrée par l’absence de sommeil et les grossesses peuvent altérer les performances de l’artiste. Les interruptions de carrière pendant le congé maternité ont une incidence sur la poursuite des contrats ; les artistes susceptibles de devenir mères se voient parfois refuser des contrats, car elles représentent un risque d’absence pour les employeurs. En cela, le secteur des arts et de la culture ne diffère pas des résultats d’études sur le lien entre le risque de maternité et les opportunités d’embauche.
Devant ce carrefour de contraintes et pour tracer une trajectoire dynamique, Caroline a développé les dispositifs suivants que nous mettons en perspective avec les axes de la théorie de l’effectuation : elle a créé son entreprise (5) pour réussir à articuler sa vie personnelle avec sa vie professionnelle (2) avec les moyens dont elle dispose (1), notamment les connaissances qu’elle a de la gestion et du management des équipes et l’intégration de ses contraintes personnelles. Elle a rapidement créé un réseau (3) avec, à la clé, des rencontres inattendues (4).
Concrètement, elle a mis en place des réunions points d’étapes avec les membres du conseil d’administration de son association ; organisé un coaching personnalisé pour gérer son temps et ses priorités ; élaboré un outil d’acceptation de contrat avec des critères pour justifier un refus ou une acceptation et ainsi rationaliser sa charge de travail ; prévu des « doublures » dès le début de la création d’un spectacle pour anticiper les arrêts maladies, les congés maternité ou les absences non programmées. Une fois par semaine, elle échange avec son conjoint sur les contraintes organisationnelles et la répartition des charges afin de maintenir un équilibre de couple. Caroline a aussi développé un réseau d’entraide entre parents pour trouver des solutions de gardes partagées et réduire les coûts afférents.
Ces dispositifs de gestion ont permis à Caroline d’atteindre son triple objectif : chanter, gérer et éduquer, tout en développant son activité.
La capacité à entreprendre malgré les écueils
L’exemple de Caroline, en tant que femme, mère, entrepreneure et artiste, n’est pas un cas isolé. D’autres, comme la pianiste Pauline Chenais, témoignent de cette imbrication de vies, des écueils contre lesquels se fracasse l’unité de vie personnelle et de vie professionnelle, par exemple quand des organisateurs de spectacle sont peu conciliants devant l’artiste qui emmène son enfant dans les coulisses pour pouvoir l’allaiter avant de monter sur scène.
Caroline, artiste-entrepreneure, a créé des outils ou des dispositifs de gestion essentiels pour les prises de décision, qui guident et structurent une démarche entrepreneuriale que l’on peut qualifier d’augmentée. En effet, ils deviennent des instruments de réalisation de projets, des « médiateurs de sens » et comme l’expliquent les chercheurs Sarasvathy et Germain :
« Vous commencez avec le monde tel qu’il est, simplement la petite partie qui vous est accessible en particulier, et vous effectuez sur lui une série de transformations effectives qui aboutissent à la création de nouveaux mondes imaginés, inimaginés et même inimaginables. » (Traduit par les auteurs de l’article.)
Si, depuis 2017, le ministère de la culture œuvre pour lutter contre les discriminations liées au sexe et au genre, il n’existe pas d’études pour rendre compte du parcours entrepreneurial des mampreneures. Le cas de Caroline nous a permis de plonger dans un processus d’élaboration d’outillage qui, sans être un modèle et encore moins une recette, témoigne d’une capacité à entreprendre. Un exemple sans doute inspirant pour d’autres femmes artistes et entrepreneures.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
01.02.2026 à 07:58
Avec « KPop Demon Hunters », les Coréennes tiennent l’épée, le micro — et peut-être bientôt un Oscar
Hyounjeong Yoo, Instructor, School of Linguistics and Language Studies, Carleton University
Texte intégral (1840 mots)

Succès critique et populaire, « KPop Demon Hunters » s’inscrit dans l’essor mondial de la Hallyu, la « vague coréenne ». Le film met en lumière le rôle central des femmes et du folklore coréen dans une culture longtemps reléguée aux marges du récit occidental.
Quand j’étais enfant en Corée du Sud, le Nouvel An commençait souvent par une chanson bien connue : « Kkachi Kkachi Seollal ». Seollal désigne le Nouvel An lunaire, l’une des fêtes familiales les plus importantes en Corée, et kkachi signifie « pie », un oiseau associé à la chance et aux nouveaux départs heureux.
En chantant cette chanson, pensions-nous, nous invitions des visiteurs bienveillants à entrer dans la maison. Pour mes frères et sœurs et moi, ces visiteurs étaient le plus souvent nos grands-parents, et leur arrivée était synonyme de chaleur, de continuité et de sentiment d’appartenance à une même communauté.
Des décennies ont passé,je vis désormais au Canada, loin de mon pays d’origine, et ces visites sont devenues rares. Pourtant, j’ai l’impression que la pie est revenue, cette fois sur un écran vu partout dans le monde.
Le film d’animation de Netflix KPop Demon Hunters suit les aventures d’un groupe fictif de K-pop, Huntrix, dont les membres chassent des démons la nuit. Il vient d’obtenir une nomination aux Oscars, dans les catégories meilleur film d’animation et meilleure chanson originale, après avoir déjà remporté plusieurs Golden Globes.
Le film a été créé par la réalisatrice coréano-canadienne Maggie Kang. La production musicale est assurée par Teddy Park, et les voix sont celles d’acteurs et d’actrices américano-coréens, dont Arden Cho, Ji-young Yoo et Audrey Nuna.
Je m’intéresse à la façon dont KPop Demon Hunters ouvre une nouvelle phase de la Hallyu, la « vague coréenne », où le folklore et le travail musical des femmes se croisent pour bousculer la place longtemps marginale des récits asiatiques dans les médias occidentaux.
Le folklore comme autorité culturelle
L’un des aspects les plus marquants du film est l’usage assumé de symboles coréens. Les chasseuses de démons portent des gat — des chapeaux traditionnels en crin de cheval associés aux lettrés sous la dynastie Joseon — et combattent les esprits maléfiques aux côtés du tigre, longtemps considéré comme un esprit protecteur de la Corée. Ces éléments marquent une prise de position culturelle.
Historiquement, le cinéma et l’animation occidentaux ont souvent cantonné les personnages asiatiques à des stéréotypes ou les ont purement et simplement effacés par des pratiques de whitewashing.
À l’inverse, KPop Demon Hunters place le folklore coréen au cœur de son récit. Le gat évoque la dignité et la discipline ; le tigre incarne la protection et la résilience. Ensemble, ils viennent contester l’idée persistante selon laquelle les productions grand public portées par des personnages asiatiques seraient nécessairement de niche ou de moindre valeur.
En recourant à des références clairement coréennes — comme le style satirique de la peinture minhwa incarné par le tigre Derpy — le film s’ancre fermement dans un contexte coréen bien précis, qui n'a rien à voir avec une esthétique panasiatique vague.
Une lignée matrilinéaire de survie
L’un des moments forts du film se trouve dans la séquence d’ouverture. À travers une succession rapide de figures chamaniques, de flappers et d’artistes de l’ère disco, la séquence peut se lire comme un hommage matrilinéaire aux musiciennes coréennes, de génération en génération.
Comme le souligne l’autrice Iris (Yi Youn) Kim, en s’appuyant sur une conférence de la chercheuse en études asiatico-américaines Elaine Andres, cette lignée fait écho à l’histoire bien réelle des Kim Sisters, souvent présentées comme le premier groupe féminin coréen à connaître un succès international. Après la mort de leur père pendant la guerre de Corée, les sœurs furent formées par leur mère, la célèbre chanteuse Lee Nan-young — connue notamment pour la chanson anticoloniale « Tears of Mokpo » — et se produisirent sur les bases militaires américaines pour gagner leur vie.
Les Kim Sisters sont ensuite devenues des habituées de l’émission The Ed Sullivan Show, séduisant le public américain tout en composant avec des attentes racistes qui cantonnaient les femmes asiatiques à des figures jugées accessibles, inoffensives et exotiques.
Le travail symbolique de la représentation nationale
Le groupe fictif Huntrix s’inscrit dans cet héritage. À l’image des Kim Sisters, ses membres sont censées incarner la discipline, le professionnalisme et la Corée elle-même aux yeux du public.
Le film montre ainsi le groupe face à la discipline rigoureuse qui leur est imposée, contraintes de maintenir une image publique irréprochable tout en étouffant leurs vulnérabilités personnelles afin d’assumer leur double rôle d’idoles et de protectrices. À un niveau méta-narratif, Huntrix est également présenté comme un représentant de la Corée du Sud, à travers l’usage de symboles du folklore du pays comme le gat et le tigre.
En tant qu’« ambassadrices culturelles », à l’écran comme en dehors, les membres de Huntrix ne se contentent pas de divertir : elles assument aussi la charge symbolique de représenter une nation face à un public mondial.
En inscrivant cette filiation dans un film d’animation grand public, KPop Demon Hunters reconnaît que le succès mondial de la K-pop repose sur des décennies de travail, de sacrifices et de négociations menées par des femmes face aux structures de pouvoir occidentales.
Au-delà du soft power
Le succès du film s’inscrit dans la poursuite de l’expansion de la Hallyu dans les médias mondiaux. Le cinéma et les séries sud-coréens ont déjà transformé les perceptions à l’international, avec des œuvres majeures comme Parasite et des séries diffusées à l’échelle mondiale comme Squid Game. Netflix s’est en outre engagé publiquement à investir des centaines de millions de dollars dans les contenus coréens, signe que cette dynamique culturelle est structurelle plutôt que passagère.
KPop Demon Hunters montre comment la culture populaire coréenne circule désormais avec fluidité entre différents médias — musique, animation, cinéma et plateformes de streaming — tout en conservant une forte spécificité culturelle. L’accueil du film remet en cause l’idée tenace selon laquelle les récits ancrés dans des expériences asiatiques manqueraient de portée universelle.
La reconnaissance, à elle seule, ne suffit pas à effacer les inégalités, pas plus qu’elle ne démantèle les hiérarchies racialisées à l’œuvre dans les industries médiatiques mondiales. Mais une visibilité durable peut faire la différence. Des travaux montrent qu’une exposition répétée à des représentations multidimensionnelles et humanisées de groupes marginalisés contribue à réduire les biais raciaux, en normalisant la différence plutôt qu’en l’exotisant.
Tenir l’épée et le micro
Si le film s’inscrit dans des histoires culturelles marquées par la présence militaire américaine et la politique de la guerre froide, il reconfigure ces héritages à travers un récit diasporique qui place les voix et les points de vue coréens au centre.
La promesse de la pie est enfin tenue. Les personnages coréens ne sont plus de simples « invités » ni des figures secondaires dans l’histoire des autres. Ils sont désormais les protagonistes — tenant l’épée, le micro et, peut-être un jour, un Oscar.
Récemment, je me suis surprise à revoir KPop Demon Hunters en mangeant du gimbap et des nouilles instantanées, les mêmes plats réconfortants que partagent les personnages à l’écran. Le moment était simple, mais chargé de sens.
Il m’a rappelé une remarque faite un jour par l’un de mes étudiants : une exposition de cette ampleur permet à celles et ceux qui se sont longtemps sentis blessés par l’exclusion de se sentir enfin regardés.
Hyounjeong Yoo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
