02.02.2026 à 11:29
Comment les organisations à but non lucratif se transforment face à la baisse des subventions publiques
Angélique Chassy, Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie
Khaled Saadaoui, Professeur Associé en finance, EM Normandie
Laré Amandine, Professeure Associée en économie sociale et solidaire, EM Normandie
Texte intégral (1772 mots)

Plus de 186 000 emplois sont menacés dans les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), notamment les associations de loi 1901. Pour affronter ces défis, ces organisations à but non lucratif, ou à lucrativité limitée, doivent trouver de nouvelles sources de revenus. L’enjeu : redéfinir de nouveaux modèles économiques en diversifiant les sources de financement.
L’économie sociale et solidaire (ESS) occupe une place structurante dans le paysage économique français. Selon l’Observatoire national de l’ESS, elle représente 13,7 % des emplois privés et 10 % du produit intérieur brut (PIB) français en 2025.
Afin d’examiner les évolutions de leurs modèles économiques et les enjeux contemporains de performances sociale et territoriale, une journée dédiée à l’ESS a été organisée 26 novembre 2025 à l’EM Normandie.
Les échanges ont mis en évidence deux constats majeurs : le risque d’une dépendance accrue des structures lié au désengagement progressif de l’État, et la nécessité de développer des modèles d’affaires innovants pour assurer leur pérennité.
Deux questions centrales ont émergé : la recherche de viabilité économique risque-t-elle de masquer les atouts de long terme de l’ESS pour l’économie ? Comment penser le modèle économique d’acteurs engagés dans des activités non marchandes et socialement utiles dans un contexte de baisse des subventions ?
Plus de 186 000 emplois de l’ESS menacés
Depuis la loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, l’ESS est définie par des critères spécifiques : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une gestion fondée sur le réinvestissement des excédents et la constitution de réserves impartageables.
Le contexte économique actuel fragilise fortement le secteur. Plus de 186 000 emplois de l’ESS sont aujourd’hui menacés, sous l’effet combiné de la baisse des subventions publiques, de l’inflation durable et de tensions de trésorerie accrues. Parallèlement, les structures sont confrontées à une augmentation de la part des revenus d’activité, liée à la diversification de leurs sources de financement.
Diversification des sources de financement
Face à la baisse des subventions publiques, les associations renforcent la part de leurs revenus d’activité et cherchent à diversifier leurs sources de financement.
Cette évolution est clairement visible dans les données récentes : entre 2011 et 2020, les financements publics sont passés de 51 % à 48 % des ressources. Elles se basent sur un portage collectif du risque via des mécanismes coopératifs – fonds propres associatifs, financement participatif, adhésion des bénévoles, etc. – pour absorber les chocs économiques ce qui rompt avec l’autonomie économique des entreprises.
À lire aussi : Entre l’État et le monde associatif, une alliance brisée
Cette évolution des pratiques économiques des structures de l’ESS s’inscrit dans un environnement économique plus contraignant, sans pour autant remettre en cause les finalités sociales. En combinant diversification des ressources, recherche de viabilité et prise en compte explicite de leur impact social et territorial, ces organisations déplacent progressivement le débat de la seule maîtrise des coûts vers une interrogation plus large sur la valeur créée pour la société. La question n’est plus seulement « Combien cela coûte-t-il ? », mais bien « Quelle valeur cela crée-t-il ? ».
Redéfinir la performance
Dans ces conditions, repenser les modèles d’affaires de l’ESS devient un enjeu central, à la croisée de la viabilité économique, de l’ancrage territorial et de la finalité sociale. Car, loin d’être un modèle marginal, ce secteur offre un cadre d’analyse instructif pour comprendre comment performance économique et utilité sociale peuvent se renforcer plutôt que s’opposer.
L’ESS occupe un espace intermédiaire, là où ni le marché ni l’action publique ne suffisent à répondre durablement aux besoins sociaux. Les activités de l’ESS se caractérisent par une faible rentabilité directe, des publics souvent peu solvables et de fortes externalités positives – cohésion sociale, prévention sanitaire, insertion professionnelle – rarement prises en charge par les entreprises privées, faute de modèles économiques immédiatement viables.
Dans l’entreprise classique, la performance repose sur une logique individuelle de mesurabilité, d’efficience et de comparabilité, héritée de l’industrie. Les pratiques des organisations de l’ESS reposent sur un modèle protéiforme de performance, de plus en plus fondé sur l’associatif entrepreneurial. Par exemple, le modèle économique d’Emmaüs comporte un volet marchand – vente d’objets récupérés – qui permet de financer un volet social consistant en actions de solidarité et d’accompagnement.
Ce modèle performant constitue avant tout un mode d’entreprendre collectif, reposant sur l’implication et le financement des parties prenantes. Il conduit naturellement à des formes de gouvernance démocratique qui se traduisent notamment par le principe « Une personne, une voix », la représentation des usagers, salariés ou bénévoles dans les conseils d’administration, ainsi que par la limitation de la lucrativité individuelle et l’affectation prioritaire des excédents au projet collectif.
Cette logique a permis à l’ESS d’occuper une place structurante dans l’organisation des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en complément durable de l’action publique dans de nombreux territoires.
Innovations sociales
Les formes juridiques de l’ESS, comme le statut d’association de loi 1901 ou la société coopérative et participative (SCOP), encadrent statutairement la lucrativité, l’affectation des excédents et la gouvernance multipartite. Elles créent un cadre propice à l’expérimentation de modèles économiques orientés vers l’impact, plutôt que vers la maximisation du profit.
Parmi les initiatives récentes, plusieurs illustrent des innovations sociales combinant impact territorial et modèles économiques hybrides. Dans l’éducation populaire, Synergie Family a créé le tiers‑lieu l’Épopée, mutualisant espaces de coworking, formation et animation culturelle pour favoriser la mixité sociale, financé par des locations, des prestations payantes et des subventions. Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) innove à l’échelle territoriale en créant des emplois durables pour les personnes éloignées du marché du travail, financés par une reconversion des aides sociales non dépensées et des partenariats avec collectivités et entreprises, transformant les coûts sociaux en emplois utiles au territoire. Pour les aidants, l’application AMI accompagne les proches fragiles via un service numérique en abonnement et un partenariat avec des mutuelles alors que Les Bobos à la ferme proposent des séjours de répit et des activités adaptées, financés par tarification, aides publiques et mécénat.
Condition essentielle de la pérennité de l’ESS
Ces principes ne relèvent pas d’un cadre théorique abstrait : ils se traduisent concrètement dans les pratiques développées par de nombreuses structures de l’ESS.
Extalea développe des prestations administratives et des logiciels de paie générant des revenus, tout en favorisant l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap. L’association La Recyclette propose la location d’objets de seconde main et des ateliers manuels afin de financer ses actions de solidarité locale. La Fabrique à Yoops conçoit, quant à elle, des « tiny houses » modulables pour l’hébergement d’urgence, cherchant à renforcer la rentabilité de son modèle pour accroître son impact social.
Dans un contexte de raréfaction des financements publics, de crises économiques récurrentes et d’attentes sociétales accrues, la capacité à renouveler les modèles économiques apparaît désormais comme une condition essentielle de la pérennité et de l’impact des organisations de l’ESS. La question n’est peut-être plus seulement de savoir comment soutenir l’ESS, mais ce que l’économie dans son ensemble peut apprendre de ces formes d’innovation sociale.
Laré Amandine a reçu des financements de la Macif, Malakoff Humanis et la Fondation de l'EM Normandie pour l'organisation de la journée ESS du 26 Novembre
Angélique Chassy et Khaled Saadaoui ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
29.01.2026 à 09:57
« Rendre la liberté académique plus solide… » Stéphanie Balme est l’invitée de notre émission « La grande conversation »
Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Lire + (347 mots)

Elle a rédigé le rapport « Défendre et promouvoir la liberté académique », commandé par France Universités. Stéphanie Balme, directrice du Centre de recherches internationales de Sciences Po et experte de la diplomatie scientifique, était l'invitée vendredi 23 janvier de notre émission « La Grande Conversation », en partenariat avec CanalChat Grandialogue.
La liberté académique est aujourd’hui confrontée à des tensions inédites : pressions politiques, restrictions budgétaires, ingérences étrangères et remise en question des principes d’indépendance scientifique. Ces enjeux, qui touchent les chercheurs et les institutions en France comme à l’international, interrogent notre capacité à produire un savoir libre et critique.
Lors de cette émission, nous abordons avec Stéphanie Balme, rédactrice du rapport« Défendre et promouvoir la liberté académique », le rôle des institutions et des politiques publiques pour la protéger. Quelles mesures prendre pour assurer sa défense? Comment répondre aux critiques récurrentes d'une partie de l'opinion publique? Quelles leçons tirer de ce qui se passe sur les campus américains ? Une émission à retrouver sur notre chaîne YouTube.
28.01.2026 à 16:14
La démocratie est-elle seulement une question de vérité ?
Frank Chouraqui, Senior University Lecturer in Philosophy, Leiden University
Texte intégral (1439 mots)
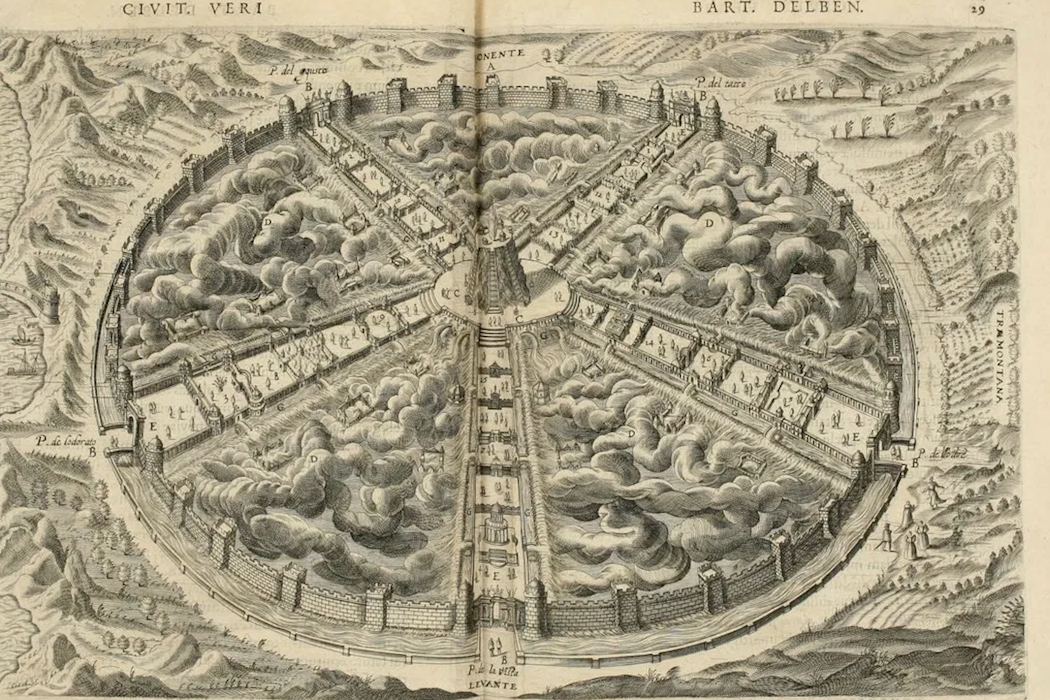
La crise de la démocratie est liée à une crise du rapport à la vérité mais aussi à une crise de sens, qu’il est important de distinguer de la première. La démocratie cherche à construire un monde porteur de sens, et pas seulement un univers de connaissances permettant la délibération. La rupture des liens sociaux, historiques ou culturels, qui donnent du sens à nos existences, est une aubaine pour les ennemis de la démocratie.
Nous sommes au cœur d’une crise de la vérité. La confiance dans les institutions publiques du savoir (les écoles, les médias traditionnels, les universités et les experts) n’a jamais été aussi faible, et des menteurs éhontés obtiennent des victoires politiques partout dans le monde. On pourrait penser que, collectivement, nous avons cessé de nous soucier de la vérité.
La fébrilité des démocrates face à cette crise repose en partie sur l’idée qu’il n’y a pas de démocratie sans vérité. Mais cette approche n’est pas sans conséquence. Surestimer la valeur de la vérité peut conduire à négliger d’autres exigences démocratiques, ce que ne manquent pas d’exploiter les ennemis de la démocratie. Les philosophes ont avancé plusieurs arguments en faveur d’un lien entre vérité et démocratie. Il semble que l’idée soit si répandue qu’on oublie de l’examiner : la démocratie représente tout ce que nous aimons, et la vérité en fait partie.
Mais il existe des manières plus sophistiquées d’exprimer cette conception. Le philosophe allemand Jürgen Habermas soutient qu’une démocratie en bonne santé possède une culture délibérative, et que la délibération exige des « prétentions à la validité ». Lorsque nous parlons de politique, nous devons nous donner la peine d’essayer de nous assurer que ce que nous disons est vrai.
Maria Ressa, journaliste philippine et lauréate du prix Nobel de la paix, soutient de manière similaire que la démocratie a besoin de la vérité parce que : « Sans faits, il ne peut y avoir de vérité. Sans vérité, il ne peut y avoir de confiance. Sans ces trois éléments, nous n’avons pas de réalité partagée, et la démocratie telle que nous la connaissons – ainsi que toute entreprise humaine porteuse de sens – disparaissent. »
Mais avons-nous vraiment besoin de la vérité pour partager la réalité ? En pratique, la plupart de nos expériences de réalités communes n’impliquent pas la vérité. Pensez aux mythes, au sentiment de voisinage, ou au sens de la communauté, peut-être même à la religion, et certainement à la réalité partagée ultime : la culture elle-même. On ne peut soutenir que nous partageons la culture de notre communauté parce qu’elle est vraie ou parce que nous la croyons vraie. Certains pourraient affirmer que la démocratie est liée à la vérité parce que la vérité serait en quelque sorte neutre : ceux qui cherchent à dire la vérité, contrairement aux menteurs ou aux populistes de l’ère de la post-vérité, doivent rendre des comptes. Ils sont soumis aux règles de la vérité. Concluons que le lien entre démocratie et vérité ne tient qu’à cela : la démocratie est sans doute plus liée à la responsabilité qu’elle ne l’est nécessairement à la vérité.
Une entreprise humaine porteuse de sens
Quoi qu’il en soit, le problème demeure : comme Ressa et Habermas le reconnaissent eux-mêmes, le but de la démocratie est de promouvoir des « entreprises humaines porteuses de sens ». La démocratie a pour vocation de construire un monde dans lequel les êtres humains peuvent vivre de manière pleinement humaine. Or, cela ne peut être assuré par la seule vérité. Une vie véritablement humaine exige non seulement la connaissance de faits concernant la réalité, mais aussi une compréhension subjective du monde et de la place que l’on y occupe. Nous oublions souvent que, bien qu’elles aillent fréquemment de pair, ces deux exigences peuvent aussi entrer en conflit. Cela tient au fait que la vérité relève des faits, tandis que le sens relève de la compréhension.
La compréhension, contrairement à la connaissance, relève de la manière dont nous regardons le monde, de nos habitudes de pensée et de nos constructions culturelles – principalement les identités, les valeurs et les institutions. Ces éléments remplissent leur fonction, qui est de nous faire sentir chez nous dans le monde, sans pour autant formuler la moindre prétention à la vérité. Selon la philosophe allemande Hannah Arendt, il s’agit là de la seule fonction de la politique, proprement entendue.
Trop souvent, l’esprit démocratique disqualifie ces éléments en les réduisant à des préjugés et à des superstitions. L’association populaire entre démocratie et vérité conduit à une dévalorisation du domaine du sens, qui demeure le but d’une politique humaniste. C’est ce qu’ont bien vu nombre de critiques de la modernité et du capitalisme quand ils critiquent la tendance des démocraties modernes à se soumettre a une « raison instrumentale » qui privilégie le prouvable sur le valable.
Les défenseurs de la vérité démocratique feraient bien de se souvenir que la démocratie cherche à construire un monde porteur de sens, et pas seulement un univers de connaissances arides et de recherche factuelle. L’actualité montre que négliger ce principe implique de lourdes conséquences politiques. L’insistance sur la vérité et la dévalorisation du sens ont conduit à la dépression moderne bien connue, souvent décrite comme un sentiment d’aliénation – une rupture des liens sociaux, historiques et traditionnels. Et cela a des répercussions politiques. Car le valable prendra sa revanche sur le prouvable, au risque de le sacrifier. C’est ce que l’on observe sous le néologisme de post-vérité ; un humanisme monstrueux et tordu mais qui trouve son succès dans le faiblesses de l’association entre démocratie et vérité. Car cette aliénation a également constitué un terrain fertile pour les populistes et les antidémocrates qui prétendent répondre à la crise du sens. Ce n’est pas un hasard si les thèmes récurrents du populisme contemporain sont ceux de l’appartenance, de la tradition, de l’identité, des origines et de la nostalgie.
Nous traversons une crise de la vérité, mais nous sommes aussi confrontés à une crise du sens. Lorsque nous accordons une importance excessive à la vérité au détriment du sens, nous nourrissons un sentiment d’aliénation et livrons les citoyens aux mains des ennemis de la démocratie. Nous ferions bien de construire nos démocraties en gardant à l’esprit que l’attachement à la vérité n’est qu’une condition parmi d’autres – et très partielle – d’une vie véritablement humaine.
Frank Chouraqui est membre (non actif) du parti politique néerlandais Groenlinks-PvdA (centre gauche).
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
