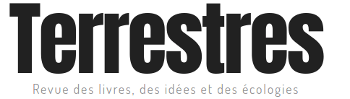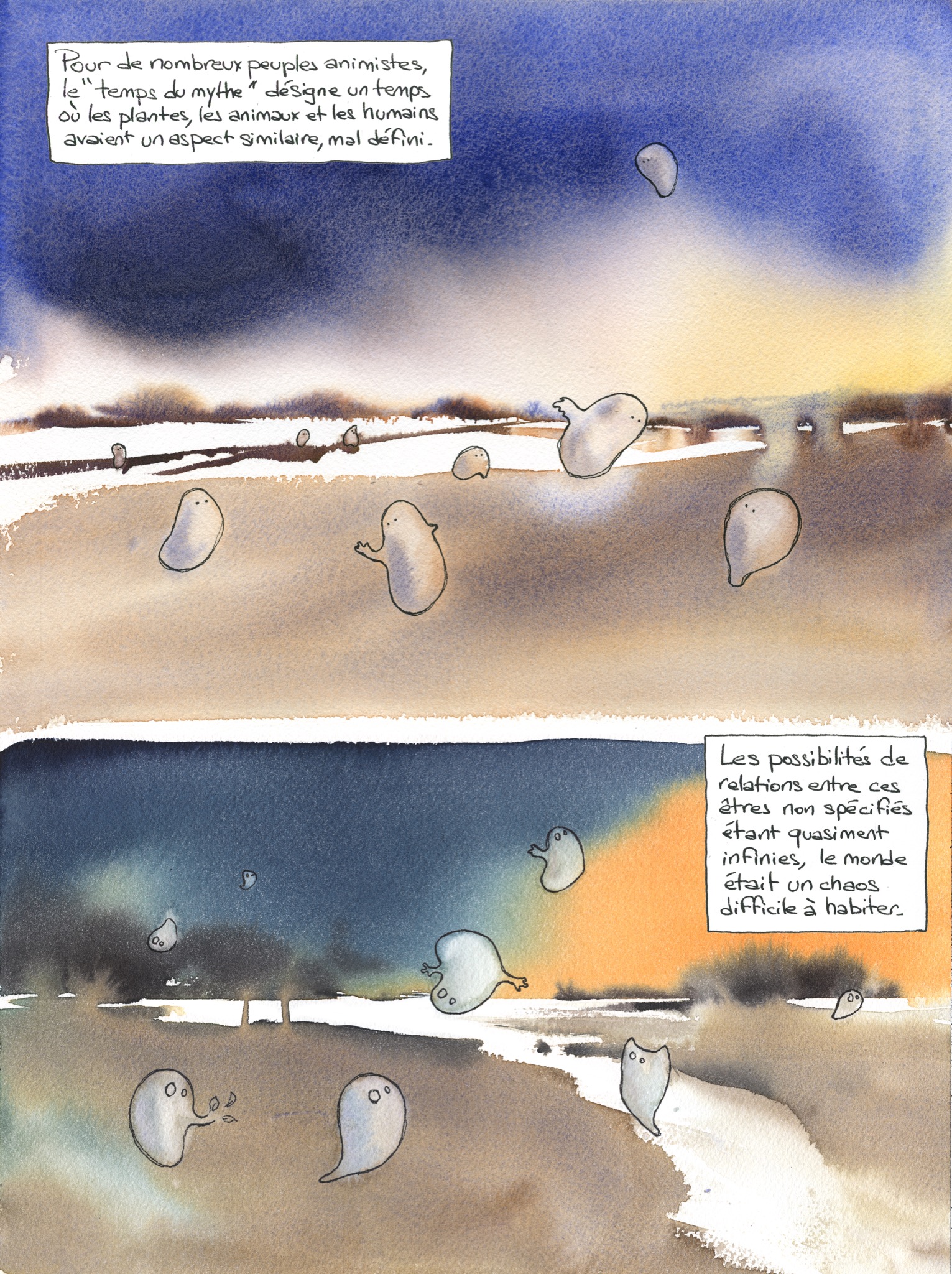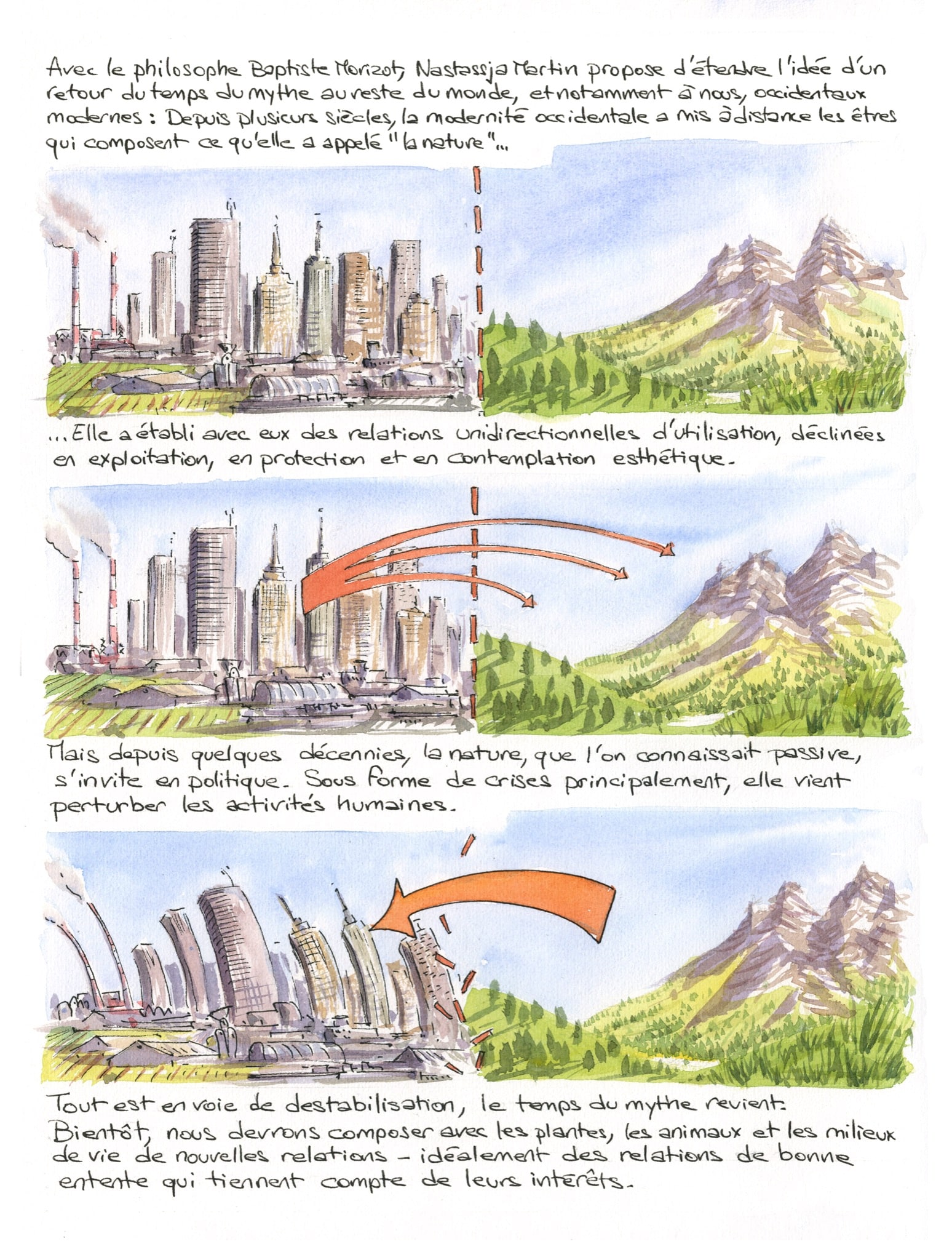28.12.2025 à 10:30
Le tournant féministe de la primatologie
Donna Haraway
1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (15453 mots)
Temps de lecture : 41 minutes

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).
Note de traduction, par Marin Schaffner
À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie
Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.
Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.
Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.
Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.
Préface de l’autrice à l’édition française (2025)
Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.
Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.
En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.
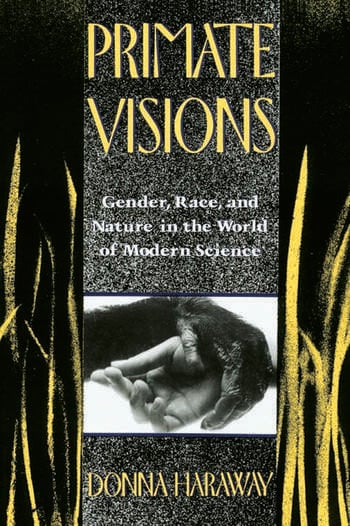
Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.
Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.
Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »
Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4
« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970
« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980
Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.
Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »
Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».
J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.
J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.
Donna Harraway
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Fait et fiction
La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.
La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.
La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.
La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
Donna Haraway
D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).
Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.
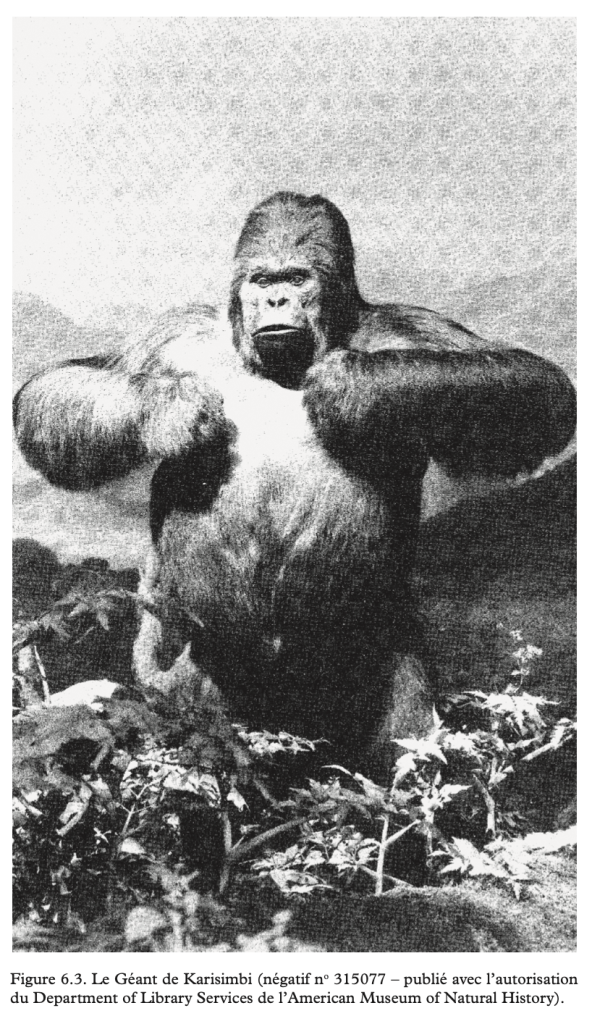
Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.
Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.
Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.
➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)
La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.
Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations
Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.
La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.
Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?
La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.
Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.
Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.
Donna Haraway
Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.
Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.
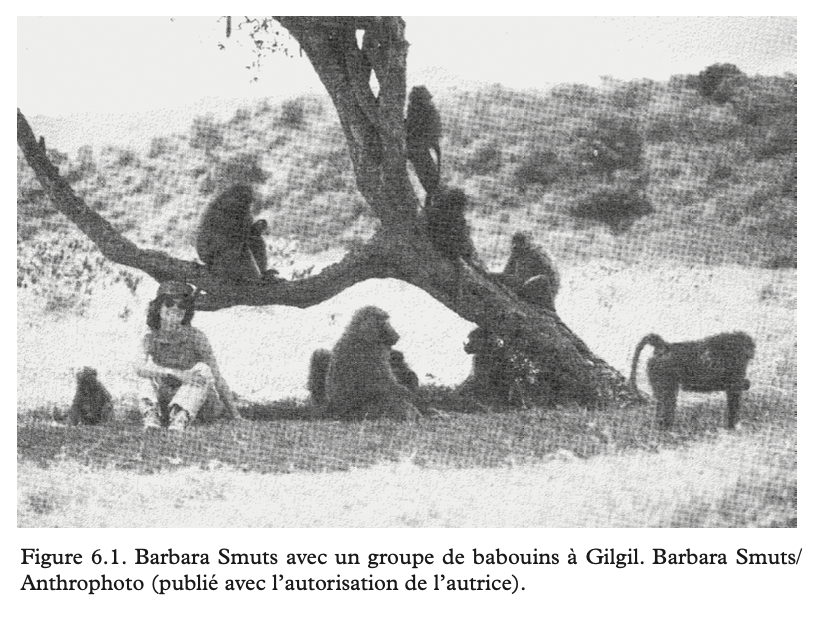
La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.
Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
Donna Haraway
Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.
La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.
Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.
➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)
La primatologie est une science (judéo-)chrétienne
Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.
Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.
Donna Haraway
La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.
Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.
Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.
La primatologie est un orientalisme simien
L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.
La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
Donna Haraway
Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.
L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.
La critique de Saïd envers l’orientalisme devrait nous alerter sur un autre point important : ni le sexe ni la nature ne sont la vérité sous-jacente du genre et de la culture ; pas plus que l’« Orient » n’est réellement l’origine et le miroir déformant de l’« Occident ». La nature et le sexe sont tout autant fabriqués que leur « autre », les pôles dominants. Mais leurs fonctions et leurs pouvoirs sont différents. La tâche de ce livre est de participer à montrer comment l’ensemble de l’édifice dualiste est construit, quels sont les enjeux liés à ses architectures, et comment cet édifice peut être redessiné. Il importe de savoir précisément comment le sexe et la nature deviennent des objets de connaissance naturels-techniques ; et il importe tout autant d’expliquer leurs doubles – le genre et la culture. Il n’est pas vrai qu’aucune histoire ne pourrait être racontée sans ces dualismes, ni qu’ils font partie de la structure de l’esprit ou du langage. D’ailleurs, il existe des histoires alternatives au sein de la primatologie. Mais ces binarités ont été à la fois particulièrement productives et particulièrement problématiques pour les constructions des corps femelles et des corps marqués par la race ; il est crucial de voir comment ces binarités peuvent être déconstruites et peut-être redéployées.
➤ Lire aussi | Aux sens large : comment l’éthologie agrandit le monde・Thibault De Meyer et Vinciane Despret (2025)
Pour celles et ceux qui gagnent leur vie en produisant les sciences naturelles et en les commentant, il semble pratiquement impossible de croire qu’il n’y a pas de réalité donnée en deçà des écritures de la science, qu’il n’y a pas de centre sacré intouchable permettant de fonder et d’autoriser un ordre de la connaissance innocent et progressiste. Peut-être que dans les « humanités », il n’y a pas d’échappatoire à la représentation, à la médiation, à la narration et à la saturation sociale. Mais les sciences naturelles l’emportent sur cet autre ordre défectueux que sont les « humanités » – comme le prouve leur pouvoir de convaincre et de réordonner le monde entier, et non pas juste une culture locale. Les sciences naturelles sont l’« autre » des sciences humaines, avec tous leurs tragiques orientalismes. Pour autant, un tel édifice ne résiste pas à l’examen.
Ce n’est pas seulement parce que les sciences naturelles sont présentées comme cet « autre » que les plaidoyers des scientifiques convainquent. Leurs assertions sont prévisibles et semblent plausibles à celles et ceux qui les formulent parce qu’elles sont intégrées dans les taxonomies du savoir occidental, et parce que les besoins sociaux et psychologiques des chercheu·ses sont satisfaits par les affirmations persistantes de la division entre sciences naturelles et humaines – par cette division du travail et de l’autorité au sein de la production des discours. Sauf que de telles observations quant aux assertions prévisibles et aux besoins sociaux ne réduisent pas les sciences naturelles à un « relativisme » cynique qui n’aurait aucune norme au-delà de son pouvoir arbitraire. Mon argumentation ne prétend pas non plus que le monde dont les gens s’efforcent de rendre compte n’existe pas, qu’il n’y a pas de référent dans le système de signes et de productions des savoirs, ni de progrès dans l’élaboration de meilleurs récits au sein de ces traditions de pratiques. Cela reviendrait précisément à réduire un champ complexe à l’un des pôles des dualismes ici analysés : le pôle désigné comme idéal par rapport à un matériau impossible, celui désigné comme apparence par rapport à un réel interdit.

Le cœur de mon argumentation est plutôt que les sciences naturelles, tout comme les sciences humaines, se trouvent inextricablement prises au sein des processus qui leur donnent naissance. Et donc, comme les sciences humaines, les sciences naturelles sont culturellement et historiquement spécifiques, modifiées, impliquées. Elles importent pour des personnes réelles. Il est alors logique de se demander quels sont les enjeux, les méthodes et les genres d’autorités impliqués dans les récits des sciences naturelles – et comment ils diffèrent, par exemple, de la religion ou de l’ethnographie. En retour, il n’est par contre pas logique de chercher une forme d’autorité qui échapperait au réseau de ces champs culturels si productifs, et qui, au commencement, rendent les récits possibles. L’œil détaché de la science objective est une fiction idéologique, et elle est puissante. Mais c’est une fiction qui cache – et qui est conçue pour cacher – combien les puissants discours des sciences naturelles opèrent sur le réel. Là encore, les limites sont ici productives, et non pas réductrices et invalidantes.
L’une des conséquences désagréables de mon argument est que les sciences naturelles sont légitimement sujettes à la critique, et ce au niveau des « valeurs », et pas seulement des « faits ». Elles sont sujettes à une évaluation culturelle et politique « de l’intérieur », et pas seulement « en extérieur ». Mais l’évaluation, elle aussi, est impliquée, liée, pleine d’enjeux et d’intérêts croisés, et fait partie du champ de pratiques qui créent du sens pour des personnes réelles en rendant compte de vies situées – et y compris de ces choses hautement structurées que l’on appelle « observations scientifiques ». Les évaluations et les critiques ne peuvent pas enjamber les normes fabriquées pour produire des récits crédibles au sein des sciences naturelles, car ni les critiques ni les objets dont elles parlent n’ont de place « en dehors » qui permettrait de légitimer une vue d’ensemble aussi arrogante. Insister sur le fait que la production du savoir scientifique est fondamentalement chargée de valeurs et d’histoires n’équivaut pas à se tenir nulle part en ne parlant de rien d’autre que de ses propres préjugés – c’est même plutôt le contraire. Seule la façade d’une objectivité désintéressée rend impossible une « objectivité concrète ».
La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture.
Donna Haraway
Une partie de la difficulté à approcher les constructions intégrées, intéressées et passionnées de la science d’une façon non réductrice nous vient d’une tradition analytique – que nous héritons notamment d’Aristote et de l’histoire transformative du « patriarcat capitaliste blanc » (comment bien nommer cette chose scandaleuse ?) – et qui fait de toute chose une ressource à s’approprier. En tant que « ressource », un objet de connaissance n’est finalement qu’une matière pour le pouvoir séminal, et donc pour l’acte du sachant. Ici, l’objet à la fois garantit et revigore le pouvoir du sachant ; mais tout statut d’agent doit être dénié à l’objet dans les productions de savoir. Le monde doit, en somme, être objectivé en chose, pas en agent ; il doit être de la matière pour la formation de soi du seul être social au sein des productions de savoir, le sachant humain. La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture. De la même manière, le sexe est seulement la matière de l’acte de genre ; la logique productionniste semble inéluctable au sein des traditions dualistes occidentales. Cette logique narrative analytique et historique explique ma nervosité à propos de la distinction sexe/genre lorsqu’elle est vue, au sein de l’histoire récente des théories féministes, comme un moyen d’aborder les reconstructions de ce qui peut compter comme étant « femelle » ou « nature » dans la primatologie – et de pourquoi ces reconstructions importent au-delà des frontières des études sur les primates. Il a semblé pratiquement impossible d’éviter le piège d’une logique de domination appropriationniste, enchâssée dans la binarité nature/culture et dans sa lignée générative, ce qui inclut la distinction sexe/genre.
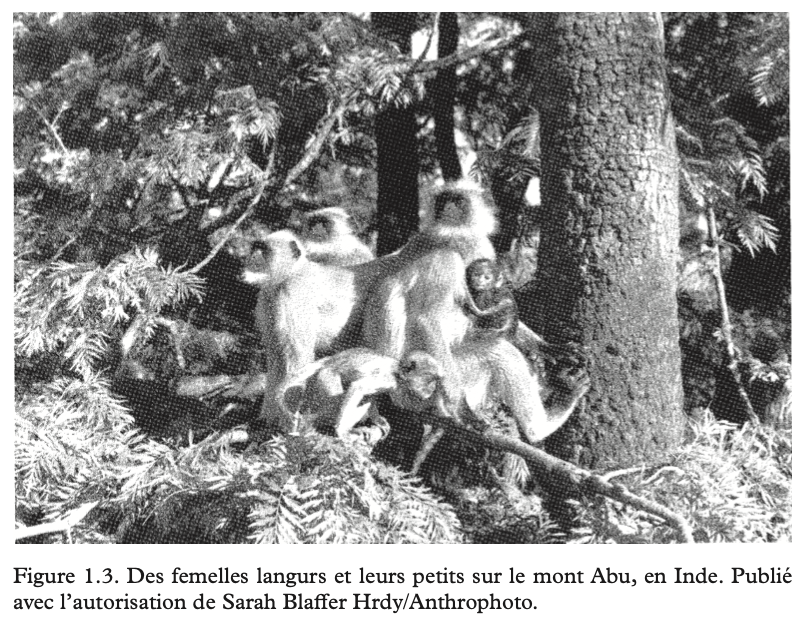
Lire dans les zones frontières
De nombreux sujets dans l’histoire de la biologie et de l’anthropologie pourraient venir nourrir les thèmes discutés dans cette introduction : alors pourquoi ce livre a-t-il choisi d’explorer les sciences des primates en particulier ? La raison principale est que les singes, et les êtres humains considérés comme leurs descendants taxonomiques, existent aux frontières d’une myriade de luttes pour déterminer ce qui comptera comme étant du savoir. Les primates ne se sont pas gentiment enfermés dans une discipline ou un champ spécialisé et sécurisé. Même en cette fin de 20e siècle, de nombreux types de personnes peuvent prétendre connaître les primates, suscitant la consternation et le grand dam de nombreux autres candidats à l’expertise officielle. La possibilité de déstabiliser les savoirs à propos des primates reste à la portée non seulement des praticien·nes de divers champs des sciences de la vie et des sciences humaines, mais aussi à la portée de personnes en marge de toute science – des écrivain·es scientifiques, des philosophes, des historien·nes, comme des visiteu·ses de zoos. De surcroît, raconter des récits à propos des animaux est une pratique si profondément populaire que le discours produit au sein des spécialités scientifiques est approprié par d’autres personnes, à leurs propres fins. La frontière entre discours technique et discours politique est aussi fragile que perméable. Même en cette fin de 20e siècle, le langage de la primatologie est mobilisé au sein de débats politiques controversés sur la nature humaine, son histoire et son avenir. Et cela reste vrai malgré la transformation des discours spécialisés de la primatologie en d’autres langages : mathématiques, théorie des systèmes, analyses ergonomiques, théorie des jeux, stratégies au sein de l’histoire de la vie, et biologie moléculaire.
En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF, j’invite les lecteurs et lectrices à redessiner les frontières entre nature et culture.
Donna Haraway
Parmi les conflits frontaliers intéressants à propos des primates – qui et que sont-ils (et qui et à quoi servent-ils) –, il y a ceux qui opposent : la psychiatrie et la zoologie ; la biologie et l’anthropologie ; la génétique et la psychologie comparée ; l’écologie et la recherche médicale ; l’agriculture et les industries touristiques dans le « tiers-monde » ; les chercheu·ses de terrain et les scientifiques de laboratoire ; les défenseu·ses de l’environnement et les multinationales de l’exploitation forestière ; les braconniers et les gardes-chasse ; les scientifiques et les administrateurs au sein des zoos ; les féministes et les antiféministes ; les spécialistes et les profanes ; l’anthropologie physique et la biologie éco-évolutionnaire ; les scientifiques confirmé·es et les récent·es titulaires de doctorat ; les étudiant·es en études de genre et les professeur·es en comportement animal ; des linguistes et des biologistes ; des responsables de fondation et des demandeu·ses de subvention ; des écrivain·es scientifiques et des chercheu·ses ; des historien·nes des sciences et des vrai·es scientifiques ; des marxistes et des libéraux ; des libéraux et des néo-conservateurs. Et toutes ces intersections apparaissent dans ce livre.
Comment différent·es lectrices et lecteurs pourraient-ils voyager avec plaisir dans ces zones frontières ? Chaque chapitre relève à la fois de l’histoire des sciences, des études culturelles, de l’exploration féministe et d’une intervention engagée pour la constitution d’amour et de connaissance au sein de la fabrique disciplinée de l’ordre des Primates. J’espère que les lecteurs et lectrices n’y seront pas un « public », dans le sens de la réception d’une histoire finie. Les conventions au sein du champ narratif qu’est la SF semblent exiger des lectrices et lecteurs qu’ils réécrivent radicalement les histoires par l’acte même de les lire. En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF – les narrations de la fiction spéculative comme des faits scientifiques –, j’invite les lecteurs et lectrices (historien·nes, critiques culturel·les, féministes, anthropologues, biologistes, antiracistes et amoureu·ses de la nature) à redessiner les frontières entre nature et culture. Je souhaite que les lecteurs et lectrices trouvent ici un « ailleurs » à partir duquel envisager un ordre de relations différent et moins hostile entre les gens, les animaux, les technologies et la terre. Tout comme les acteurs et actrices des histoires qui suivent, je souhaite également proposer de nouveaux termes qui nous aident à circuler entre ce que nous avons historiquement appris à connaître comme nature et culture.
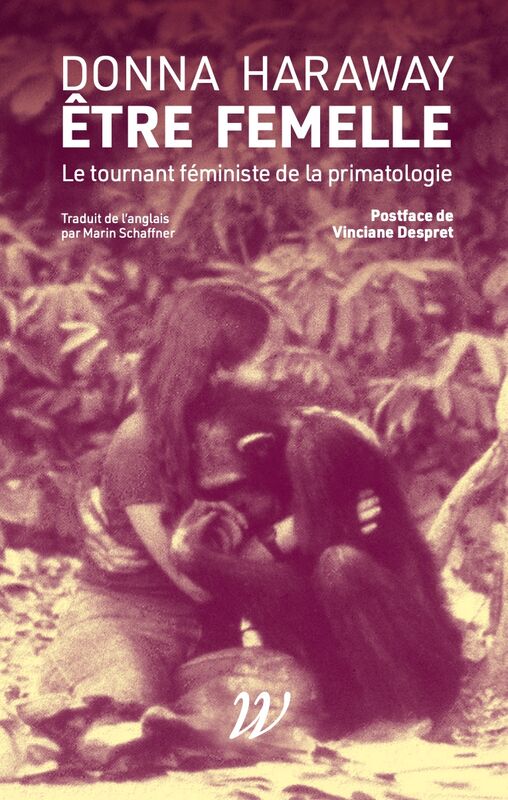
Image principale : « Les singes dans l’orangeraie », Henri Rousseau, 1910. Wikiart.
L’ensemble des images en noir et blanc de cet article sont tirées des divers chapitres du livre Être femelle – les autres sont libres de droits.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Le premier, Crystals, Fabrics and Fields (non traduit), paru en 1976, était la publication de sa thèse en biologie.
- Traduit en 2002 par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et Nathalie Magnan, dans Connexions : art, réseaux, média, anthologie établie par Nathalie Magnan et Annick Bureaud, Paris : éditions Ensba.
- Une nouvelle traduction de « Savoirs situés » est à paraître aux Éditions Wildproject en mars 2026 – accompagnée d’un entretien avec Jeanne Burgart Goutal.
- La nouvelle de science-fiction de John Varley, The Persistence of Vision, est en partie à l’origine de ce livre. Dans cette nouvelle, Varley décrit une communauté utopique conçue et construite par des personnes sourdes et aveugles. Il explore ensuite les technologies et autres moyens de communication de ces personnes, ainsi que leurs relations avec les enfants voyants et les visiteu·ses (Varley, 1978). L’interrogation sur les limites et la violence de la vision fait partie de la politique d’apprentissage de la révision.
- NdT : Tout au long de l’ouvrage, l’expression « politiques de reproduction » (reproductive politics) renverra au terme forgé par les féministes dans les années 1970 pour décrire les luttes de pouvoir contemporaines sur la contraception, l’avortement, l’adoption, la gestation pour autrui, et les questions qui leur sont corollaires.
- Foucault (1963) ; Albury (1977) ; Canguilhem (2013 [1966]) ; Figlio (1976).
- Voir aussi Latour (1983, 2005 [1987], 2012 [1984]) ; Bijker et al. (1987) ; Gallon et Latour (1981) ; Knorr-Cetina (1983) ; Knorr-Cetina et Mulkay (1983) ; Traweek (1988).
- Voir Hartsock (1983) ; Harding (1986) ; Rose (1983).
- Voir Young (1977, 1985a) ;Yoxen (1981, 1983) ; Figlio (1977).
- Voir Fee (1986) ; Gould (1981) ; Hammonds (1986) ; Hubbard, Henifin et Fried (1982) ; Gilman (1985) ; Lowe et Hubbard (1983) ; Keller (1985).
- Je dois cette analyse de Linné comme Œil/Je (Eye/I) de Dieu à Camille Limoges, de l’université de Québec à Montréal.
L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.
12.11.2025 à 00:35
Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe
Léo Coutellec
Pour le philosophe Léo Coutellec, l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture patriarcale, caractérisée par la domination masculine et la dépendance aux fossiles. À l’autre bout du spectre, on voit pourtant naître une paysannerie féministe et émancipatrice, qui conteste la subordination des paysannes et renouvelle les pratiques.
L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4816 mots)
Temps de lecture : 9 minutes
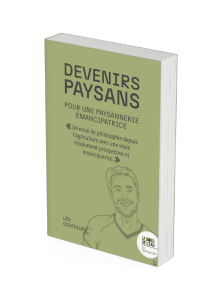
Extrait du livre de Léo Coutelec, Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice, paru en 2025 aux éditions Le Bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène », 192 pages.
« J’entends les silences et je pense aux arbres ; ils sont là, nus, ils ne plastronnent pas, ils ne sont pas glorieux, ils sont tenaces, accrochés dans la pente des hivers et du temps. Je ne sépare pas les arbres et les paysannes. » Marie-Hélène Lafon1
« Prendre la pétromasculinité au sérieux signifie prêter attention aux désirs contrariés des patriarcats privilégiés, à mesure que s’étiolent leurs fantasmes fossiles. » Cara New Daggett2
« Nous saluons toutes les femmes qui, à partir de différents territoires, soutiennent la vie, l’alimentation, les soins et les transformations sociales. (…) Nous, les femmes, continuons à marcher, à dénoncer la violence et les crimes environnementaux et sociaux, à lutter contre le pillage de nos richesses et le massacre des peuples. Nous continuons à tisser des réseaux et des alliances pour démasquer le patriarcat, le capitalisme et le néolibéralisme qui menacent la vie sur la planète. » La Via Campesina3
Mesurer la réussite d’une ferme à la taille de ses tracteurs, organiser un concours de labour ou une course de moiss’batt-cross, porter des habits de travail à l’effigie d’une marque de machines agricoles, manifester à coups de gros tracteurs pour faire démonstration de puissance mécanique, assumer sa dépendance aux combustibles fossiles par la consommation ostentatoire de carburants ou d’engrais chimiques, sont autant d’indices que l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture. Et que cette dernière est avant tout une « pétromasculinité4 », concept forgé par la politologue Cara New Dagett. La domination masculine et l’affirmation d’une virilité autoritaire trouvent dans la mécanisation démesurée de l’agriculture un point d’appui, avec une identification du travail « à l’expérience virile du contact avec la machine5 ». Le refus d’admettre l’évidence de la crise climatique par la continuation assumée d’une agriculture pétro-dépendante est l’une des manifestations de cette pétromasculinité. La responsabilité des hommes dans le désastre agricole en cours est évidente, et pas simplement parce qu’ils sont numériquement bien plus nombreux que les femmes, mais aussi et surtout parce qu’ils dominent la « profession » par l’adhésion sans réserve au mythe fossile qui assure leurs privilèges.
C’est une lecture que l’on peut faire des mouvements récents d’agriculteurs des syndicats de droite (FNSEA [Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles], JA [Jeunes Agriculteurs] et Coordination rurale), dont le centre revendicatif était le refus des normes environnementales, l’arme principale une ribambelle de gros tracteurs et les visages médiatiques essentiellement masculins. Ce qui était défendu au fond, au-delà des slogans creux de diversion distillés par les directions syndicales, c’était une forme de pétromasculinisme agricole que nous définissons comme la domination masculine dans l’agriculture s’affirmant par la défense du régime fossile. Selon cette approche, épuiser la terre, polluer les sols et les eaux, homogénéiser les paysages, détruire la biodiversité ne sont pas les objectifs principaux de l’agriculture productiviste, ce sont des conséquences d’une finalité bien plus insidieuse, celle qui consiste à maintenir et à défendre les privilèges d’une culture patriarcale basée sur l’autoritarisme fossile. Dagett définit le régime fossile comme la « logique de gouvernement qui dépend matériellement et psychologiquement de la consommation intensive de combustibles fossiles6 ». La deuxième dimension de cette dépendance, la dimension psychologique, bien que moins souvent mise en avant, est pour autant déterminante en cela qu’elle permet de justifier une posture d’autorité, là où « le pouvoir explosif de la combustion s’est trouvé grossièrement assimilé à la virilité7 ». Dans un contexte où la responsabilité de la combustion d’énergies fossiles dans la crise climatique est avérée, défendre le régime fossile et le faire de façon ostentatoire peut être considéré comme une forme de violence, que certains qualifient de « carbofasciste8 », dont le but est de réaffirmer et conserver le pouvoir masculin blanc. C’est pourquoi Daggett parle d’une « convergence catastrophique » entre masculinité, combustion fossile et autoritarisme.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Une paysannerie émancipatrice passe donc nécessairement par un refus de cette pétroculture patriarcale. En contrepoint, c’est un écoféminisme paysan que l’on voit naître et s’intensifier9. De nombreuses paysannes s’installent hors du cadre dominé par la démonstration d’une puissance mécaniste et viriliste, et dans une conscience du caractère systémique des dominations de la terre et du corps des femmes pour penser et vivre l’activité paysanne différemment, sans pour autant faire sécession. Prendre soin de la terre et des animaux autrement, revendiquer des pratiques de subsistance10 pour se défaire de la dépendance au système productif masculin, gagner en autonomie décisionnelle et pratique, refuser la division sexuelle du travail agricole11, adapter le travail pour qu’il ne soit plus aliénant, se former et se renforcer au sein de collectifs non mixtes12 sont autant de visées pour sortir des pétrocultures qui renforcent la domination masculine dans l’agriculture.
Dans une telle perspective, il ne s’agit pas « d’inclure les femmes dans l’agriculture » ou d’affirmer que « leur place est différente », ce serait encore accorder du crédit à la conception patriarcale de l’agriculture, car ces politiques « paternalistes d’empowerment des femmes », devenues à la mode, ne contribuent qu’à accélérer « la destruction des bases matérielles de leur pouvoir, les privent de la joie de l’autonomie13 ». Plutôt que l’instrument d’une soi-disant diversité au sein du corporatisme agricole, la perspective écoféministe dans l’agriculture s’invente en autonomie et dans la pluralité des expériences14, elle renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires, elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations. Et elle reste le rempart et l’alternative la plus solide au pétromasculinisme agricole en cela qu’elle ne cherche pas seulement à proposer des ajustements techniques ou des pratiques différentes, mais propose un renouvellement profond de la culture de l’agriculture par la construction de relations écologiques au vivant humain et autre qu’humain qui permettent de rompre simultanément avec la domination masculine, l’asservissement au régime fossile et à l’autoritarisme qui les accompagne. La façon dont les femmes paysannes ont investi de façon autonome La Via Campesina, le plus grand mouvement de paysannes et paysans au niveau mondial, et qui défend un « féminisme paysan et populaire », est illustratif de ce devenir écoféministe de la paysannerie.

S’ouvrir à ce devenir pourrait aussi être une forme de mise à distance de l’emprise d’un autre mouvement de fond qui structure, et parfois sclérose, les pensées et pratiques paysannes, le familialisme. Ce dernier fait de la famille l’unité élémentaire de la société politique et se comprend comme « un mode d’organisation de la cité qui articule la détention de l’autorité politique et la position dans la famille15 ». Dans l’agriculture, le familialisme se loge derrière l’idée que le modèle à défendre et à promouvoir est celui de l’exploitation agricole familiale, où le travail agricole s’organise en famille et où se confondent les sphères privées et professionnelles. Cette défense d’une agriculture familiale, souvent réduite à une agriculture de couple, est assez transversale au sein du syndicalisme agricole, de droite comme de gauche. La cohérence et l’intrication entre le travail domestique et les tâches agricoles sont ainsi régulièrement valorisées, tout comme le souhait d’une vie pleine qui puisse dépasser la séparation entre les dimensions familiales, professionnelles et sociales. L’influence historique de la JAC (Jeunesse agricole catholique), mouvement créé dans les années 1920, dans la formation des cadres des mouvements syndicaux en est sûrement un facteur déterminant bien que cette organisation ait aussi été un vecteur important de la prise en compte de la cause des femmes paysannes16.
La perspective écoféministe dans l’agriculture renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires. Elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations.
Malgré des avancées dans la reconnaissance de certains droits sociaux pour les paysannes, l’invisibilité du travail féminin, la non-déclaration de la conjointe au sein de la ferme, les différentes formes de violences subies17 ou encore la division sexuelle des tâches persistent. Et l’on observe que ces phénomènes ne sont pas l’apanage d’une vision traditionaliste de l’agriculture, ils traversent toutes les visions de l’agriculture, y compris chez les « néoruraux » ou au sein des mouvements d’agriculture biologique18. Le rôle subordonné des femmes dans l’agriculture, notamment en termes de reconnaissance de droits, a des racines profondes et s’apparente à la situation des femmes en général sous la IIIe République : « si elles ne sont pas admises dans la citoyenneté électorale, c’est parce qu’en tant que membres subordonnés de la famille, on les suppose présentes dans le vote émis par les hommes au nom de l’intérêt général19 ». C’est parce que la famille est considérée comme l’unité de base de l’organisation d’une activité agricole, au sein de la laquelle est supposée une unité d’intérêts et d’opinions, que « ses membres subordonnés sont privés du droit de vote. (…) lorsque le pater familias s’exprime à travers le vote, c’est toute la famille qui s’exprime derrière lui20 ». C’est pourquoi aussi, les femmes n’ont été reconnues comme agricultrices qu’en tant que membre d’une famille, fille, mère ou épouse ; et que les termes de « chef de famille » et de « chef d’exploitation » se sont souvent confondus. La défense d’une agriculture familiale est intenable si elle ne s’oblige pas à cet examen critique.
Il ne s’agit pas de dire qu’il faut abolir la famille ou qu’une paysannerie émancipatrice serait obligatoirement une paysannerie hors du cadre de la famille. Ce que l’écoféminisme paysan apporte c’est un questionnement sur les modalités de faire famille d’une part – notamment en libérant celle-ci de son emprise patriarcale et hétéronormée21 – et sur la place de celle-ci au sein de l’activité paysanne – par une mise à distance de sa centralité pour donner plus d’espaces d’autonomie aux femmes paysannes et ouvrir à des formes collectives plus diversifiées ; pour désimbriquer les enjeux de patrimoine, de famille et travail. C’est pourquoi l’expression « hors cadre familial » devrait avoir, selon moi, un sens bien plus générique, et porter non plus seulement sur l’absence d’une filiation agricole mais sur toutes les dimensions de la vie paysanne lorsque celle-ci n’est plus centrée sur une logique familiale de production22, autrement dit lorsque la paysannerie n’est plus soumise à l’emprise du familialisme.
➤ Lire aussi | Ils ont 20 ans pour sauver le capitalisme・Léo Coutellec (2019)
Image d’accueil : Jerry Kavan sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- LAFON Marie-Hélène, VETTORETTI Alexis, 2024, Paysannes, Ulmer, Paris.
- DAGGET Cara New, op. cit., p. 52.
- LA VIA CAMPESINA, 2025, Appel à l’action antifasciste.
- DAGGET Cara New, op. cit.
- JARRIGE François, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014, p. 154.
- DAGGET, op. cit., p. 26.
- Ibid, p. 29.
- Antoine DUBIAU définit le « carbofascisme » comme la convergence d’intérêts entre le capitalisme fossile, les grandes entreprises productrices d’hydrocarbures et les forces politiques d’extrême droite.
- Le concept d’écoféminisme paysan a notamment émergé à l’occasion des rencontres, en non-mixité choisie, des travailleuses de la terre qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2022 à Vezin-le-Coquet. Il sera aussi utilisé dans la déclaration des 84 paysannes de la Confédération paysanne réunies les 16 et 17 novembre 2023 à Montreuil : « Notre féminisme est écologique, paysan et populaire. Il se veut solidaire des personnes opprimées et exploitées et comprend profondément que l’exploitation des femmes et de leurs corps est intrinsèquement liée à l’exploitation industrielle de la nature et de ses ressources par le capitalisme et le patriarcat. L’écoféminisme paysan et populaire veut avant tout célébrer la vie, notre rapport sensible au monde et nous reconnaître comme vivantes parmi le Vivant, pour amener à une entière valorisation d’une agriculture paysanne, autonome, durable, nourricière, qui régénère les sols et mise sur les alliances et les coopérations interespèces » (consultable en ligne sur le site de la Confédération Paysanne).
- PRUVOST Geneviève, 2021, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, Paris.
- DEMATHIEU Agathe, 2022, « Comprendre la division sexuelle du travail agricole : comment les techniques contribuent à la perpétuer ? », AgriGenre. Source en ligne, consulté le 13 avril 2025 : <https://agrigenre. hypotheses.org/11345>.
- WEILER Nolwenn, 2024, « Agriculture et féminisme, une alliance heureuse », Basta.
- AZAM Geneviève, 2023, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », Revue Terrestres.
- À ce titre, je conseille vivement la lecture de l’enquête sociologique de Constance Rimlinger sur les expériences de vie en lien avec la terre de personnes féministes et non hétérosexuelles : RIMLINGER Constance, 2024, Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, PUF, Paris.
- VERJUS Anne, 2013, « Familialisme » in : ACHIN Catherine et BERENI Laure, Dictionnaire. Genre et science politique : Concepts, objets, problèmes, Presses de Sciences Po, Paris, p. 251-262.
- MARTIN Jean-Philippe, Histoire de la nouvelle gauche paysanne. Des contestations des années 1960 à la Confédération paysanne, 2005, La Découverte, collection « Cahiers libres », p. 37-38.
- SALMONA, Michèle, 2003, « Des paysannes en France : violences, ruses et résistances », Cahiers du Genre, 35 (2), p. 117-140.
- SAMAK Madline, 2017, « Le prix du “retour” chez les agriculteurs “néo-ruraux”. Travail en couple et travail invisible des femmes », Travail et emploi, 150.
- VERJUS Anne, op. cit.
- Ibid.
- CHOLLET Mona, 2021, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, La Découverte, Paris.
- Logique qui reste bien présente, y compris dans les mouvements d’agricultrices qui revendiquent une reconnaissance économique de leur travail. Voir : COMER Clémentine, 2022, « Luttes d’agricultrices ou d’épouses au travail ? Retour sur l’histoire d’un féminisme paradoxal (1970-2010) », Entreprises et histoire, 107(2), p. 110-123.
L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.
15.10.2025 à 16:09
« Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche
Mélanie Antin
Le 8 novembre 2024, Julia Chuñil est partie en forêt avec ses animaux. Elle n’est pas revenue. Depuis, les manifestations se multiplient dans tout le Chili, demandant justice et vérité pour cette cheffe de communauté et défenseuse territoriale mapuche, dans un contexte tendu d’extractivisme et de criminalité. Et puis, la terrible nouvelle est arrivée…
L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (7954 mots)
Temps de lecture : 16 minutes
Je remercie Javier Troncoso pour notre entretien téléphonique, et le collectif Ad Kimvn pour la mise en relation. En espérant que justice soit faite.
Cela fait bientôt un an que Julia Chuñil Catricura, 72 ans, femme mapuche et défenseuse territoriale a disparu dans la région de Los Ríos, au sud du Chili1. J’apprends sa disparition alors que je suis au Chili pour mon dernier terrain de recherche dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l’agir politique de femmes rurales et mapuche autour de la souveraineté alimentaire. Depuis cinq ans maintenant, je m’attache à documenter leurs stratégies de résistance pour la terre, dans un contexte de vulnérabilité socio-écologique intense.
Le 25 novembre 2024, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je rejoins un groupe de femmes mapuche à Temuco. Elles scandent « Ni una menos (Pas une de moins) ». Beaucoup se sont identifiées à Julia. Sur les pancartes qu’elles brandissent, on peut lire : « Donde está ? ¿ Chew muley Julia Chuñil ? (Où est Julia Chuñil ?) ». Dans les territoires mapuche, les violences de genre sont indissociables des violences liées à un modèle de prédation, compris comme « un processus d’accumulation par et dans la destruction »2. Les slogans font écho aux mobilisations contre les disparitions forcées sous la dictature.
Julia Chuñil était engagée dans l’amélioration des conditions d’existence de sa communauté, qu’elle présidait. Reconnue dans sa commune, elle œuvrait à la revitalisation de la culture mapuche, notamment à travers sa participation à des trafkintü, nom mapuche donné aux échanges non monétaires de semences, de plantes, d’artisanat et de savoirs. Elle participait aussi à l’organisation de cérémonies mapuche (bien qu’elle soit elle-même évangéliste). Comme beaucoup de femmes mapuche des régions rurales, elle vivait de son activité d’agriculture de subsistance et de la vente des produits de son potager et de ses animaux. Malgré les pressions qu’elle subissait de la part d’un entrepreneur de l’industrie forestière appelé Juan Carlos Morstadt Anwandter, Julia refusait de quitter ses terres. Peu de temps avant sa disparition, elle confiait à sa famille : « S’il m’arrive quelque chose, vous savez déjà qui c’est », en faisant allusion à J. C. Morstadt.
Depuis sa disparition le 8 novembre 2024, les manifestations pour exiger vérité et justice pour Julia Chuñil se multiplient dans les grandes villes chiliennes – Santiago, Concepción, Valparaiso, Temuco… – et même à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation est tout aussi vive. L’artiste Constanza Nahuelpan a même écrit une chanson pour la défenseuse territoriale : « ¿ Chëw Müley Julia Chuñil ?3 ».

Le 8 août 2025, près de 5000 personnes se sont retrouvées à l’Estadio nacional lors d’une journée de solidarité pour Julia Chuñil et sa famille.
Certaines voix dénoncent la violence structurelle perpétrée à l’encontre des femmes, particulièrement présente en Abya Yala4, une problématique analysée par de nombreuses chercheuses féministes telles que la chercheuse Rita Segato5. Les écologistes rappellent l’urgence de protéger les défenseur·ses autochtones et environnementaux, en exigeant l’application effective du traité environnemental dit « accord d’Escazú », ratifié par le Chili en 2022. ANAMURI, l’association nationale de femmes rurales et autochtones, dénonce également le racisme et le colonialisme qui nourrissent les logiques extractivistes menaçant la vie des communautés.
Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer.
La disparition de Julia Chuñil ravive le débat sur la répression des défenseur·ses de l’environnement, en particulier en contexte autochtone. Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer. Les luttes portées par les femmes autochtones, qu’elles soient autour de pratiques politiques « discrètes », ou luttes plus frontales, restent encore trop invisibilisées. L’image romantique de « gardiennes de la nature » ne rend pas justice à la complexité de leurs combats et de leurs stratégies multiples.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Un continuum de violences
Depuis la colonisation espagnole au XVIe siècle, les Mapuche subissent une dépossession de leurs territoires, inscrite dans une longue histoire de violences et de domination. Après l’indépendance chilienne en 1818, l’occupation militaire de l’Araucanie (1861-1883) réduit les terres communautaires entre 5 et 10% de leur superficie originelle et une grande partie est réattribuée à des colons, entraînant une grande fragmentation sociale et culturelle. Le colonialisme républicain marque avec force la persécution des Mapuche, à travers, entre autres, leur subordination à des « institutions et une territorialité exogènes »6.
Au XXe siècle, la réforme agraire puis la contre-réforme agraire sous la dictature de Pinochet redessinent les rapports à la terre, les terres collectives mapuche étant depuis lors soumises à la logique de la propriété privée. Le modèle néolibéral ancre une logique extractiviste et favorise l’expansion massive de monocultures de pins et d’eucalyptus, particulièrement dans les régions à forte population mapuche. Soutenue par des subventions publiques, cette filière concentre les richesses de quelques entreprises et provoque de lourdes conséquences environnementales, notamment pour la perpétuation des modes de vie mapuche. L’industrie forestière se déploie au prix d’inégalités criantes. Les emplois – à 95% masculins – sont précaires et ne génèrent pas le développement promis7.
Le « retour à la démocratie » dans les années 1990 ne modifie pas les structures héritées du régime dictatorial, mais ouvre un nouvel espace pour les revendications autochtones. En 1992, les mobilisations autour de la contre-commémoration de la « découverte des Amériques » constituent une fenêtre d’opportunité pour les organisations mapuche8.
En 1993, la Ley Indígena9 reconnaît pour la première fois la présence des peuples autochtones dans la constitution chilienne et crée la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI, « Corporation nationale pour le développement autochtone »), qui veille à l’application de divers programmes de santé, d’éducation et d’accès à la terre à travers un mécanisme d’achat de terres auprès de propriétaires privés. Cette reconnaissance reste toutefois obtenue au prix d’un compromis politique puisqu’elle canalise les « aspirations légitimes de justice » dans un cadre institutionnel10.

La politique indigéniste d’alors avait comme objectif clair d’encourager la valorisation de l’identité autochtone, mais aussi sa « modernisation »11. L’autochtonie devient une « valeur ajoutée » si elle répond aux besoins du marché, dans un contexte de grandes réformes néoliberales qui se poursuivent dans les décennies suivantes. Le « néolibéralisme multiculturel », à partir des années 2000, renforce ainsi la division entre le « bon indien » et le « mauvais indien »12. Les femmes autochtones incarnent « par nature » le « bon indien », considérées comme les « reproductrices biologiques, culturelles et symboliques » de leur culture13. Dans ce cadre, leurs savoirs, souvent au cœur de projets d’ethno-développement et d’empowerment, lorsqu’ils peuvent être capitalisés, tendent à renforcer leur assignation au care, sans pour autant interroger les structures de domination qui la sous-tendent. Pourtant, derrière cette image de « gardienne de la nature », perçue comme apolitique, elles mènent des luttes concrètes pour la terre, l’eau et la biodiversité, affirmant ainsi leur pouvoir d’agir politique.
À la fin des années 1990, les conflits territoriaux s’intensifient au Chili et les territoires mapuche sont particulièrement visés par la répression de l’État. Si les figures médiatisées de ces luttes sont essentiellement masculines, décrites par les médias et la sphère politique sur le registre du terrorisme et de la violence, les femmes mapuche y jouent un rôle central.
➤ Lire aussi | Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme・Héloïse Prévost (2023)
La « Commission pour la Paix et l’Entente »
La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre cette dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche. Trente-deux ans après la promulgation de la Ley Indígena, l’écart entre les revendications territoriales et les terres effectivement acquises reste conséquent et le mécanisme de redistribution perpétue la spéculation immobilière et les conflits entre communautés.
Dans ce cadre, la « Commission présidentielle pour la Paix et l’Entente » (Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento) a remis en 2025, après deux ans de travail, son rapport proposant un ensemble de recommandations autour de la justice, la réparation, la restitution des terres et du développement territorial14. Pour les Mapuche, ce processus suscitait des espoirs de changement, dans un pays où les avancées juridiques en matière de droits fonciers et politiques y restent limitées15.
La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre la dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche.
Bien que cet accord ait été qualifié d’historique en raison de la portée des recommandations et de la méthodologie de consultation employée, de nombreuses interrogations subsistent, notamment sur la création d’un nouvel organe dédié aux politiques autochtones, qui ne serait que « décoratif »16. Le texte émet également des recommandations concernant le « développement territorial et économique » des régions. Mais il reste globalement centré sur des logiques d’intégration au marché agroindustriel et d’« efficacité », dans la prolongation d’une vision paternaliste. Rien ne fait état de l’accès effectif à l’eau, de la préservation des ressources aquatiques dans des régions où le stress hydrique est croissant et les sécheresses récurrentes.
Depuis la remise du rapport, les critiques se sont intensifiées, notamment sur les irrégularités du nouveau processus de consultation autochtone, ouvert en août 2025. Les organisations mapuche ont généralement rejeté les recommandations.
Dans ce climat, la disparition forcée de Julia Chuñil prend aussi une autre portée, pointant du doigt les violences continues qui s’exercent sur les communautés mapuche, en particulier sur les femmes.

L’élimination de femmes mapuche dans des luttes territoriales
L’une des luttes territoriales les plus emblématiques est celle de Ralco (Alto Biobío), opposant des communautés Pewenche de la cordillère contre un projet hydroélectrique. Porté par l’entreprise Endesé et soutenu par l’État comme symbole de développement, le barrage hydroélectrique Ralco fait partie d’un projet d’aménagement sur le fleuve Bío Bío, qui a eu des impacts environnementaux et sociaux majeurs, illustrant la violence extractiviste.
Autorisé en 1997 par la CONADI, malgré des critiques sur sa légalité, il a forcé au déplacement de nombreuses familles pewenche, inondant leur invernada et réduisant leur capacité de subsistance17. En 2003, toutes les familles concernées avaient fini par accepter, sous pression, la permutation de terres proposée par l’entreprise Endesa, par le biais de la CONADI. Cimetières, sites cérémoniels et lieux sacrés ont été engloutis, bouleversant les pratiques religieuses et l’habiter. L’arrivée de travailleurs et de nouveaux propriétaires privés a introduit une logique axée sur la propriété privée, l’individualisme et l’exploitation intensive, contrastant avec le rapport à la terre des Pewenche18.
Au cœur de cette lutte de près de dix ans, le souvenir des sœurs Berta et Nicolasa Quintreman est encore vif. En 2013, Nicolasa Quintreman fut retrouvée morte, son corps flottant dans les eaux du lac artificiel du barrage de Ralco19. Elle avait déclaré qu’elle ne quitterait pas ses terres, même morte.
On peut aussi rappeler le cas de Macarena Valdés, qui luttait également contre un autre projet hydroélectrique à Panguipulli. Les circonstances de sa mort, laissant fortement présumer un féminicide maquillé en suicide, ne sont toujours pas élucidées.
Le concept de « continuum de la violence sexuelle » permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus et violences subis par les femmes, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme.
Aujourd’hui, d’autres défenseuses territoriales continuent leur lutte malgré les menaces. C’est le cas de la machi (chaman20) Millaray Huichalaf, engagée depuis quinze ans pour la défense du fleuve Pilmaikén (Los Ríos) contre l’entreprise norvégienne Startkraft et sa centrale hydroélectrique. En août 2025, l’entreprise a ouvert les vannes du barrage sans prévenir, alors que la machi et sa communauté étaient en pleine cérémonie sur le fleuve. La crue provoquée a emporté une jeune fille et un homme qui tentait de la sauver. Depuis, Millaray Huichalaf fait de nouveau face à des intimidations policières et à une criminalisation de sa lutte.
La lutte de Julia Chuñil pour la dignité mapuche prolonge ces résistances féminines face à la prédation de leur territoire.
➤ Lire aussi | Luttes féministes en Amérique latine : penser ensemble le patriarcat et le colonialisme・Lina Álvarez-Villarreal (2023)
Ces violences extrêmes sont à analyser à l’aune du « continuum de la violence sexuelle »21. Ce concept permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus, contraintes et violences subis par les femmes, exacerbés en contexte extractiviste, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme22. On y voit un lien avec le concept de terricide développé par Moira Millán (Puelmapu, Argentine), pour désigner un continuum de violences que subissent les Mapuche et peuples autochtones en général (écocide, génocide, épistémicide, féminicide), à travers une « matrice civilisatrice de la mort » qui affecte à la fois les terres et les corps subalternisés. Ce concept permet de mieux saisir le contexte de la disparition de Julia Chuñil.

¿ Donde està Julia Chuñil ?
Julia Chuñil se définissait comme « cheffe de famille et combattante ». Dans un documentaire, elle raconte son bonheur de prendre soin de ses animaux et de son potager, et de participer aux trafkintü (troc). Cette forme de solidarité, principalement organisée par les femmes permet de tisser des réseaux de solidarité et d’échange, et de « faire communauté » :
On partage avec les personnes, parfois d’autres communautés, on récupère nos graines, c’est important. Les graines qu’on récolte, on les échange contre des choses qu’on n’a pas. J’aime participer et ramener des boutures, des graines, de la farine, tout ce que je fais dans ma maison. Cette année on n’a pas pu l’organiser, à cause du problème qu’on a ici.23
Dirigeante mapuche, mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits enfants, Julia Chuñil présidait la communauté de Putreguel (Région de Los Ríos), composée de 17 familles. Depuis 2015, elle menait l’occupation et la protection d’un terrain de près de 900 hectares, dont une grande partie de forêt naturelle et cinq cours d’eau, espérant sa régularisation foncière par la CONADI (la Corporation nationale pour le développement autochtone). Elle y vivait de manière précaire, sans électricité, ni eau potable ni couverture téléphonique, et pratiquait une agriculture paysanne, de subsistance.
Le 8 novembre 2024, Julia est partie avec trois de ses chiens pour surveiller ses animaux dans les collines voisines. Seuls deux chiens sont revenus ; Julia et son jeune chien Cholito, qui ne la quittait jamais, ne furent jamais retrouvés. Aucune trace d’elle n’a été retrouvée et ses enfants, soutenus par la Fondation Escazú24, ont porté plainte pour enlèvement, évoquant la possibilité d’un féminicide politique.

Cette disparition est à replacer dans le cadre d’un long conflit foncier. Le terrain revendiqué par la communauté de Julia Chuñil faisait partie de la réforme agraire avant de passer entre les mains de propriétaires privés sous la dictature. Il comprend notamment un cimetière mapuche, où Julia souhaitait être enterrée. Après une première transaction irrégulière impliquant l’entrepreneur Juan Carlos Morstadt (descendant de colons allemands) et la banque Scotiabank, le terrain est abandonné par une première communauté à laquelle il avait été attribué. La communauté de Julia s’y est alors installé pour protéger le site, espérant que la CONADI leur transfèrerait les droits à la terre.
Lors d’un entretien, Javier Troncoso, fils de Julia Chuñil, raconte :
Ma mère n’a jamais eu de terre à elle, elle travaillait ici et là pour d’autres, elle travaillait de la vente de produits agricoles, et a réussi à s’en sortir seule. Et aujourd’hui elle se sentait épanouie parce qu’elle avait ce bout de terre, sa forêt et ses animaux. (Javier Troncoso, mai 2025)
La forêt naturelle pour les Mapuche va bien au-delà d’une ressource alimentaire ou de bois de chauffe, elle est un lieu de cueillette, notamment de plantes médicinales utilisées pour les soins quotidiens et lors de cérémonies religieuses. La forêt est profondément liée à l’habiter mapuche.
Avec l’annulation de la vente, les terres passèrent à nouveau entre les mains de J.C. Morstadt mais la CONADI n’informa pas la communauté de Julia : « On l’a su après sa disparition et Morstadt n’a jamais rendu l’argent », souligne Javier Troncoso. Depuis lors, Julia Chunil avait signalé à sa famille plusieurs menaces de l’entrepreneur, qui continuait d’abattre des arbres autochtones pour leur commercialisation. Javier ajoute : « ils ont essayé d’acheter ma mère, comme ils l’ont fait avec d’autres, et ma mère a aussi caché beaucoup de choses, elle ne voulait pas nous inquiéter ».

L’enquête a été marquée par une succession de quatre procureurs et a souffert d’un manque flagrant de continuité et de transparence. Les avocats de la famille dénoncent la fuite du dossier d’enquête vers les médias alors qu’il était confidentiel, l’absence de de moyens techniques (géoradar, drones), des perquisitions répétées, dont certaines violentes, visant la famille.
Une telle inversion du soupçon sur les victimes peut stupéfier : elle illustre pourtant la criminalisation systématique des luttes autochtones. Javier Troncoso raconte :
Ils n’enquêtent pas sur lui [Morstadt], nous sommes les principaux suspects de la disparition de ma mère maintenant. En plus de la présence quotidienne de la police, on a eu beaucoup de perquisitions, ici et chez ma sœur. Trois procureurs sont venus chez ma sœur. Ma sœur a subi chez elle une torture psychologique, on lui disait : « Allez, dis-nous où est ta mère. » C’est donc encore plus douloureux de voir toutes ces injustices que les policiers commettent à notre égard. Ils viennent encore de changer de procureur ce mois-ci. Et déjà dix jours de perquisitions domiciliaires. Il y a des enfants ici, il y a des personnes âgées, ils ont bafoué les droits des enfants. Ils ne respectent pas la loi parce que nous sommes Mapuches.
Le cas de Julia se situe dans un double contexte : celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique.
Le 7 août 2025, cinq organisations – dont le Mouvement pour l’eau et les territoires (MAT), l’Observatoire latino-américain des Conflits environnementaux (OLCA) et la Commission éthique contre la torture – ont présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU un rapport dénonçant la vulnérabilité structurelle des défenseurs et défenseuses de l’environnement au Chili, en particulier des femmes autochtones. Le cas de Julia est effectivement replacé dans un contexte plus large, d’une part celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et d’autre part celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique. En 2023, vingt défenseur·euses de l’environnement ont été menacé·es au Chili, dont 65% de femmes, selon la Fondation Escazú Ahora. Cette dernière dénonce le vide juridique et éducatif concernant la reconnaissance de la figure de défenseur·euse de l’environnement. Si le président Gabriel Boric a publiquement exprimé sa préoccupation pour la disparition de Julia Chuñil et promis de poursuivre les recherches, sa déclaration n’est encore suivie d’aucune avancée notable.
Le 1er octobre 2025, près d’un an après sa disparition, les avocats de la famille de Julia Chuñil dévoilent une information d’une rare violence.
Dans un enregistrement issu d’une conversation téléphonique, J. C. Morstadt confie à son père : « Julia Chuñil, ils l’ont brûlée ». L’enregistrement a été exposé auprès d’organismes de défense des droits humains. Cette révélation insoutenable doit accélérer le processus d’enquête afin que justice soit faite. Un reportage du 12 octobre 2025, sur Canal 13, une chaîne de télévision nationale, remet en question l’activisme de Julia Chuñil au sein du mouvement mapuche et écologiste. Les journalistes insistent une fois de plus sur culpabilité de ses enfants dans son assassinat, sans preuve concrète. Ce reportage nie une fois de plus la subjectivité politique de Julia Chuñil, et, par extension des femmes autochtones.
Les trajectoires comme celle de Julia Chuñil s’inscrivent dans une histoire plus large, où les femmes mapuche jouent un rôle décisif dans les luttes pour la défense des territoires. Au-delà d’actions ancrées dans une politique du quotidien, elles traversent aussi les sphères politiques : certaines prennent part à des organisations nationales voire internationales, construisent des alliances avec des organisations non mapuche, agissent depuis les instances institutionnelles, se mobilisent pour faire valoir leurs droits, en tant que femme, et en tant qu’autochtone.
Sans la mobilisation massive de collectifs mapuche et chiliens, Julia Chuñil, aurait subi l’invisibilisation de sa vie et de sa lutte, qu’il est important de comprendre dans sa globalité. Raconter l’histoire de Julia Chuñil, c’est refuser l’oubli et l’effacement.

Image d’accueil : Affiche du Réseau des femmes autochtones pour la défense de la mer (Red de mujeres originarias por la defensa del mar). Illustration de Carla Soto Ampuero @carlawillin

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Il est souvent utilisé le terme d’activiste environnementale pour définir Julia Chuñil. Je préfère le terme de défenseuse territoriale, qui, à mon sens, est beaucoup plus englobant et imbrique les multiples dimensions de sa lutte et de son rapport au territoire.
- Adèle Blazquez et Martin Lamotte, 2024, « Prédation : l’accumulation par et dans la destruction », L’Homme, pp. 251-252.
- Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=9sUI-Wqlyc8
- Abya Yala, terme issu des Gunas (peuple de l’actuel Panama) désigne le territoire américain avant la colonisation et est souvent traduit par « terre de pleine maturité ». Le terme s’est plus largement diffusé à partir de 1992 et des contre-célébrations du 500e anniversaire de la « découverte des Amériques ».
- Voir entre autres, son ouvrage La guerre aux femmes, trad. Irma Velez et Alicia Rinaldy, Paris, Payot, 2022.
- Nahuelpan Moreno, H. J., & Antimil Caniupan, J. (2019). « Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX ». HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 11(21), 211‑248 ; Le Bonniec, F. (2003). « État de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post-dictature : Portrait de la criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique ». Amnis, 3, 1‑19.
- Reyes, R., & Nelson, H. (2014). « A Tale of Two Forests : Why Forests and Forest Conflicts Are Both Growing in Chile ». The International Forestry Review, 16(4), 379‑388.
- Baeza, C. (2012). « Multiculturalisme et construction identitaire au Chili (1990-2011) » : Critique internationale, n° 54(1), 119‑143.
- Cette loi résulte d’un « pacte » en 1989 entre le candidat de la Concertation des Partis de la Démocratie, Patricio Aylwin et des organisations autochtones, principalement mapuche. Les représentations autochtones demandaient alors la reconnaissance constitutionnelle de la plurinationalité, finalement écartée du texte. Finalement, la loi de 1993 reconnaît d’abord l’existence de trois « ethnies », dont Mapuche, et sept « communautés autochtones ». Ce n’est qu’avec la ratification tardive de la Convention 169 de l’OIT en 2008, que les autochtones sont désignés comme « peuples ». Aujourd’hui le Chili en reconnaît 12, dont le dernier en 2019, le peuple afrodescendant chilien. La loi de 1993 marque aussi le début de l’auto-identification dans les recensements. Voir l’original ici (document pdf).
- https://fundacionaylwin.cl/el-acuerdo-de-nueva-imperial/
- Idem.
- Boccara, G., & Ayala, P. (2011). « Patrimonializar al indígena. Imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile ». Cahiers des Amériques latines, 2011/2(67), 207‑228.
- Yuval-Davis, N. (1996). « Género y nación : Articulaciones del origen, la cultura y la ciudadanía ». Arenal. Revista De Historia De Las Mujeres, 2(3), 163‑175.
- https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/
- Environ 12% de la population chilienne se considère autochtone, dont environ 80% mapuche.
- Salvador Millaleo, « Sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento », El País, 8 mai 2025.
- L’invernada désigne le site de vie et de culture coutumier des Pewenche, encore largement inscrits à ce moment-là dans l’agro-pastoralisme semi-nomade.
- Hakenholz, T. (2004). « Un peuple autochtone face à la « modernité » : La communauté Mapuche-Pewenche et le barrage Ralco (Alto Bío Bío, Chili) ». Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, 57(228), article 228.
- Si la thèse de l’accident semble être confirmée, les modifications environnementales et socio-culturelles provoquées par le barrage ont, d’une autre manière, participé à sa mort.
- Personne centrale du système spirituel et médicinal mapuche.
- Kelly, L.,Traduit de l’anglais par Tillous, M.(2019). « Le continuum de la violence sexuelle ». Cahiers du Genre, 66(1), 17-36.
- Hillenkamp, I., & Prévost, H. (2024). « Extractivisme et résistances paysannes dans l’agroécologie au Brésil : Une analyse de genre des conflictualités. ». Revue internationale des études du développement, 255, 41‑66.
- Trafkintü : intercambio de semillas y saberes, de Victor Gutiérrez Astete.
- https://www.escazuahorachile.cl/
L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.
24.09.2025 à 19:14
Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire
La rédaction de Terrestres
Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4216 mots)
Temps de lecture : 11 minutes
Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.
Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.
Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.
Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.
Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.
On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.
Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.
« Revers des sources :
pays d’amont,
pays sans biens,
hôte pelé,
je roule ma chance
vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes
Virginie Maris
► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould
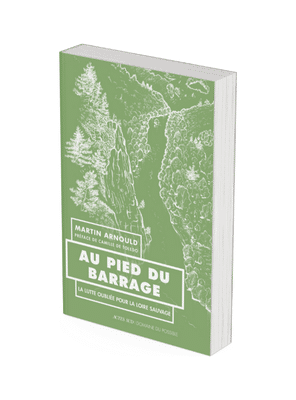
Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.
En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.
Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.
Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.
Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.
Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.
Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !
Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.
Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.
Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?
Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.
Aurélien Gabriel Cohen
► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025
Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs
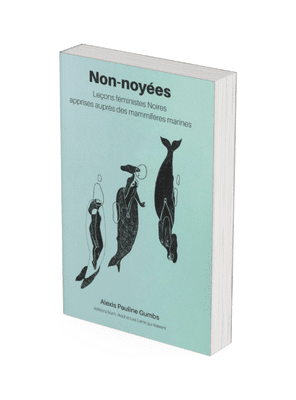
Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.
Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.
Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).
Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !
Léna Silberzahn
► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,
Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024
Roman · Le Déluge · Stephen Markley
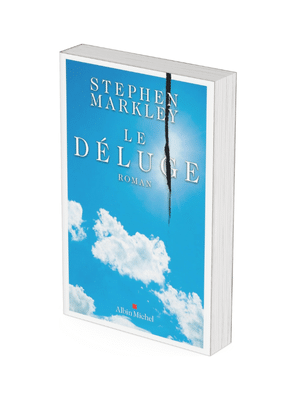
Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.
Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.
Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.
Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.
La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.
À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.
Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.
Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.
Sophie Gosselin
► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci
!
L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.
26.06.2025 à 11:00
L’amour au temps du mythe
Alessandro Pignocchi
Pour les peuples animistes, le temps du mythe est cet âge initial où les êtres adoptent des formes distinctes et négocient le genre de relation qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Et si c’était pareil pour le couple ? Et si ça valait aussi pour l’engagement envers des ami·es ou un territoire ? Un strip d’Alessandro Pignocchi aussi beau que surprenant.
L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3074 mots)
Temps de lecture : < 1 minute
Un nouveau strip d’Alessandro Pignocchi, à retrouver également sur son blog Puntish.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
À propos de nos amours Terrestres, lire aussi « Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter » de Cy Lecerf Maulpoix, janvier 2025.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.
27.05.2025 à 18:33
Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique
La rédaction de Terrestres
La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.
L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3846 mots)
Temps de lecture : 10 minutes
Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.
Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.
Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.
Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.
Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.
De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.
Geneviève Azam
► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.
Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.
Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.
Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.
Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.
« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »
Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :
Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.
Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.
Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.
Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…
C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.
Virginie Maris
► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017
Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée
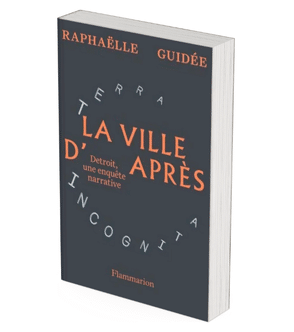
Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».
La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?
Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.
Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.
Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).
Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.
Quentin Hardy
► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024
BD · Environnement toxique · Kate Beaton
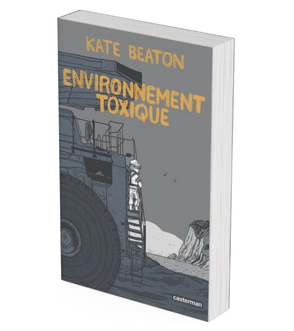
Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.
En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.
En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.
50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.
Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.
Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.
Emilie Letouzey
► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.
02.05.2025 à 12:41
Comment et quoi « réparer » après le colonialisme nucléaire ?
Léna Silberzahn
Les conséquences des expérimentations nucléaires en Mā’ohi Nui (Polynésie) sont irréversibles : les terres, la mer et les vies sont contaminées à perpétuité. Il faut pourtant les assumer. Mais comment réparer l’irréparable ? En commençant par se tourner vers les luttes antinucléaires, anticoloniales et féministes, suggère Léna Silberzahn dans cet essai sur l’héritage du nucléaire.
L’article Comment et quoi « réparer » après le colonialisme nucléaire ? est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (15014 mots)
Temps de lecture : 32 minutes
Août 2021. « La France coloniale doit réparation aux Polynésien·nes et aux Algérien·nes ». Accrochée au tracteur, la banderole flotte au vent, prête à partir en manifestation avec nous. Plusieurs centaines de personnes participent à ces journées d’actions et d’ateliers « contre le nucléaire et son monde » à la gare de Luméville, un des sites principaux de lutte contre le projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Plus tôt dans la semaine, des militant·es décoloniales ont réalisé une fresque murale des atolls polynésiens et du désert algérien sur la façade du bâtiment principal, et écrit : « décolonisons les luttes anti-nuk ». Grâce à leur présence, la jonction entre luttes contre la domination coloniale et contre la poubelle nucléaire prend corps, et les questions de race sont enfin mises en avant lors d’un évènement antinucléaire meusien1.
J’assiste à certains de ces échanges, je répète et reprends ces phrases. Joie – de prendre enfin à bras le corps ces questions. Gratitude – pour les personnes qui donnent de leur énergie à ce travail important. Pourtant, quelques semaines plus tard, une fois les barnums démontés et de retour au quotidien parisien, je n’arrive pas à me défaire de l’impression désagréable d’avoir gesticulé dans le vide. « Lutter contre un système énergétique et militaire qui repose sur le secret, l’extractivisme, la contamination des terres du Sud global, et l’exploitation des sous-traitant·es nécessite d’élaborer une perspective anticoloniale, féministe, anti-autoritaire et anticapitaliste ». C’est comme si nous avions dit les bons mots, rappelé les bons faits, mais sans être réellement traversé·es par leurs implications, ni parvenir à les traduire en stratégies politiques.

La décolonisation n’est pas une métaphore2, rappellent justement Eve Tuck et K. Wayne Yang, et tout le monde à ces journées aurait approuvé. Certes, nous étions une vaste majorité de blanc·hes, mais personne à ce rassemblement à l’est de l’hexagone français ne pensait que la décolonisation ne puisse être réduite à une question de bonne posture (même très militante). C’est pourtant exactement ce à quoi j’avais eu l’impression de participer, malgré moi, en me contentant de saupoudrer quelques mots-clés ici et là, en dénonçant scrupuleusement les violences impériales dans nos manifestes, et en écrivant des mots certes nécessaires mais largement incantatoires sur des pancartes. Impression désagréable de reproduire cette fameuse « sympathie-sans-lien » entre hexagone et colonies départementalisées ou régionalisées (les « Outre-mer »), décrite par Malcom Ferdinand dans sa critique des mouvements écologistes hexagonaux, « où les soucis des autres là-bas sont admis sans pour autant en reconnaître les liens matériels, économiques et politiques3 ».
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Que mettre concrètement derrière des mots aussi immenses que « décoloniser » et « réparer », au-delà des postures et des bonnes étiquettes ? Et quels ponts construire entre luttes contre la poubelle nucléaire hexagonales et luttes de survivant·es irradiées par les expérimentations impériales de la France ? Lorsqu’on prend la mesure de l’insuffisance des politiques de reconnaissance actuelles (1), et face à l’ampleur dévastatrice du péril nucléaire, il peut être difficile de savoir par où commencer (2). Cependant, des luttes contemporaines et passées esquissent les fondements essentiels de la réparation : restituer, au-delà des simples chiffres et des indemnités individuelles (3), restaurer les terres, au-delà des seules existences humaines (4), reprendre ses déchets (5), reconnaître l’intégralité des faits (6), faire circuler les récits des survivantes (7), et construire des solidarités transnationales au-delà de l’État (8).
L’échec de la politique publique de reconnaissance et de réparation des conséquences des essais nucléaires
« Si vous me plantez un couteau dans le dos de 20 cm et que vous le retirez de 15 cm, il n’y a pas de progrès. Si vous le retirez complètement, ce n’est pas un progrès. Le progrès, c’est de guérir la blessure que le coup a causée. »
Malcom X
Entre 1960 et 1996, l’État Français a fait exploser plus de 200 bombes nucléaires à des fins expérimentales dans ses colonies. Lorsque la campagne d’essais algérienne prend fin après à la guerre d’indépendance4, et tandis que les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni se sont engagés à arrêter les essais atmosphériques5, la France poursuit ses expérimentations en Ma’ohi Nui6, au-dessus des atolls de Moruroa et de Fangataufa, puis dans les sous-sols et sous les lagons des mêmes atolls.
Conséquences de ces 193 « essais » dans le Pacifique : des enfants mort-nés, des leucémies, lymphomes, cancers de la thyroïde, du poumon, du sein, et de l’estomac « inexpliqués », une nourriture impropre à la consommation sur des dizaines d’années7, et une partie de l’île de Moruroa qui menace de s’effondrer à cause de forages et de crevasses dans le basalte.

Aujourd’hui, la pression des associations et des lanceurs et lanceuses d’alerte fait craqueler cinquante ans de mensonges d’État au sujet de l’ampleur du dispositif d’expérimentation8. Grâce au bras de fer judiciaire mené par les associations comme Moruroa e tatou et celle des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN), des centaines de documents ont été déclassifiés ces vingt dernières années. Depuis la loi Morin de 2011, un Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) est censé indemniser les personnes ayant développé une des 23 maladies radio-induites reconnues.
En 2023, alors que 171 pays ont voté pour la résolution d’aide aux victimes intitulée « Le lourd héritage des armes nucléaires », seuls quatre l’ont rejetée : la Corée du Nord, la Russie, le Royaume-Uni et la France.
Tandis que son principal instigateur présente cette loi comme une « solution transparente, juste et rigoureuse pour que notre pays puisse tourner la page et être en paix avec lui-même9 », divers militant·es Maohi relèvent au contraire « l’échec de la politique publique de reconnaissance et de réparation des conséquences des essais nucléaires10 ». À titre comparatif, aux États-Unis, un tel dispositif existe depuis le Radiation Exposure Compensation Act de 1990 (RECA), qui reconnaît 29 maladies – même s’il demeure lui aussi largement insuffisant au regard des dommages subis11.
En 2023, alors que 171 pays ont voté pour la résolution d’aide aux victimes intitulée « Le lourd héritage des armes nucléaires », seuls quatre l’ont rejetée : la Corée du Nord, la Russie, le Royaume-Uni et la France. C’est d’ailleurs pour faire la lumière sur les réparations promises et le manque de volonté politique et scientifique qu’a été ouverte une commission d’enquête parlementaire (dont les auditions ont repris en janvier 2025). Force est de constater : les indemnités de la loi Morin ne sont pas à la hauteur des conséquences coloniales de l’atome en Ma’ohi nui. Mais quel dispositif le serait ?
« Réparer »
Dans le dictionnaire, le mot « réparation » renvoie au fait de « remettre en l’état initial, rétablir », « faire disparaître, corriger »12. Pris en ce sens, « réparer » les conséquences du nucléaire est évidemment impossible : le sol et les vies ont été contaminés pour des dizaines de milliers d’années – à des échelles si vastes et complexes que même les technologies les plus avancées ne peuvent les mesurer ou en prévoir les conséquences à long terme. Dans ces contextes, la notion même de « réparation » peut sonner comme une imposture solutionniste, à la manière du lexique désormais courant de l’« adaptation » et de la « résilience »13 qui exhortent les populations à vivre avec les catastrophes et leurs innombrables contaminations. Prétendre que la France puisse « réparer » quoi que ce soit après le colonialisme nucléaire, n’est-ce pas déjà contribuer à une forme de déni, motivé par la volonté de « tourner la page » et de « faire la paix avec nous-mêmes », pour reprendre les mots de Morin ?

De toute évidence, une discussion sérieuse sur la réparation commence par la reconnaissance de l’irréparable, c’est-à-dire l’impossibilité de « solutionner » ou de gérer le désastre nucléaire comme un simple paramètre de plus dans l’administration des choses. Parmi les principes fondamentaux de l’ONU concernant le droit à la réparation figure la garantie de non-répétition14 : réparer le passé, c’est déjà garantir que des faits similaires ne se produiront plus dans le futur. Considérant que l’industrie nucléaire, tant civile que militaire, repose sur une chaîne de production et de contaminations coloniales irréversibles, il est antithétique de proclamer une « paix » sans avoir préalablement procédé à une dénucléarisation et à une décolonisation totales des sociétés française et maohi. Ni déni, ni résignation : c’est dès lors le difficile pari affectif à relever quand on veut faire exister la possibilité d’une justice – forcément non idéale, lacunaire, et jamais achevée – après les violences.
« Réparer » les conséquences du nucléaire est évidemment impossible : le sol et les vies ont été contaminés pour des dizaines de milliers d’années.
Si en découvrant le corpus de la pensée écologique, l’écoféminisme a directement résonné en moi, c’est qu’il nourrit une attention particulière aux blessures, au passé et à l’inestimable, au-delà des illusions comptables de la compensation et du recouvrement. Les titres des recueils et articles écoféministes sont à cet égard sans appel : Healing the wounds15 (Guérir les blessures), Reweawing the world16 (Retisser la Terre)… à rebours des yeux rivés sur « la » catastrophe à venir et sa temporalité de l’urgence, les pensées de l’écologie issues des rangs féministes et décoloniaux ont ceci en commun de penser la question écologique d’emblée comme une question d’héritage et de guérison. Cela ne veut pas dire qu’elles sont obnubilées par le passé et une hypothétique restauration d’un état antérieur aux préjudices : elles participent plutôt d’une forme d’écologie post-apocalyptique17 en offrant un lieu à partir duquel nous pouvons nous regarder et agir sous un nouvel angle. Leurs présupposés : l’émancipation passe par une exhumation des expériences des violences et des moyens d’y résister. L’invisibilisation de ces violences et les fantasmes de table rase sont une impasse. La révolution est aussi une question de guérison, qui implique cet art complexe et paradoxal de faire exister les blessures tout en voulant faire disparaître leurs origines.
Nous ne sommes pas les premièr·es à nous interroger ainsi : les personnes et les luttes traversées par la question de comment réparer l’irréparable face à des injustices vécues et innommables, sont nombreuses. La confrontation au passé esclavagiste étatsunien, notamment, a posé de nombreux jalons concernant les pensées et pratiques de la restitution, de la mémoire, de la reconnaissance historique qu’exige la « réparation ». Que pouvons nous apprendre de luttes anticoloniales, qui, dans le Pacifique et ailleurs, mobilisent le terme de réparation pour avancer leur cause ?

Restituer (au-delà des procédures d’indemnisation individuelles)
La discussion autour des réparations a le mérite de mettre la restitution, et non la rétribution, au cœur des processus de justice. Mais le propre du fait nucléaire est de tuer, de contaminer, et de détruire irréversiblement – de rendre la restitution précisément impossible.
Dans un tel contexte, il est courant de conclure que la réparation implique d’établir des équivalences, notamment monétaires. La procédure d’indemnisation prévue par le CIVEN a le mérite d’exister, et remplit partiellement cette fonction. En ce qu’elle applique le « principe de présomption de causalité », elle représente certes une avancée majeure pour les associations de victimes : il « suffit » de remplir un certain nombre de conditions afin qu’un lien entre la maladie et les explosions soit admis, sans avoir à établir scientifiquement une causalité entre la pathologie et l’exposition aux radiations. On compte néanmoins 98% de refus dans la période 2011-2017, et seules 385 personnes ont été reconnues victimes (sur 1061 demandes reçues) après la réforme du comité sur la période 2018–2023. À titre indicatif, les modélisations récentes estiment qu’au moins 150 000 personnes seraient éligibles18… Quand on sait la difficulté de constituer un dossier (au vu des barrières linguistiques, géographiques ou encore administratives), et le découragement qui découle des nombreux refus dans les premières années, force est de constater qu’« inversion de la charge de la preuve » il n’y a pas vraiment eu.
On peut, tout d’abord, interroger le conditionnement de l’indemnisation au remplissage de longs dossiers. Tous·tes les Maohis, ne sont-ils et elles pas victimes – même celles et ceux qui ne sont pas directement touché·es par une maladie radio-induite – du fait de l’irradiation de leur environnement, des maladies de leurs proches, ou la crainte de tomber malade soi-même ? La justice française a déjà par le passé forcé des employeurs à verser des indemnités aux travailleurs de l’amiante pour compenser ce qu’elle qualifie de « préjudice d’anxiété »19. Dans la même veine, on pourrait argumenter que le fait de vivre toute sa vie avec la crainte de développer une maladie radio-induite constitue un préjudice en tant que tel. L’automaticité de l’indemnisation pour tous les habitant·es des archipels, défendue par plusieurs personnes de cette lutte, permettrait de reconnaître que tous ceux qui vivaient dans les îles au moment des essais sont victimes.
On pourrait argumenter que le fait de vivre toute sa vie avec la crainte de développer une maladie radio-induite constitue un préjudice en tant que tel.
Par ailleurs, à un niveau plus fondamental, le calcul pour « indemniser » un cancer n’est-il pas toujours périlleux ? Certains vont jusqu’à refuser de faire les démarches administratives, précisément car ils les perçoivent comme une manière de postuler une forme d’équivalence entre une maladie mortelle et une somme d’argent. À l’instar du projet de loi de 2021 porté par le député indépendantiste Moetai Brotherson Brotherson (devenu président de la Polynésie depuis), on pourrait envisager de passer du registre de « l’indemnisation » à celui de la complète prise en charge de la maladie (prise en charge qui comprend également les soins, accompagnements, et compensations d’éventuelles pertes de revenus)20. En l’état, certain·es malades ont certes obtenu une indemnisation du Civen, mais la prise en charge des frais médicaux engagés pour le traitement de maladies radio-induites reste à charge des Polynésiennes : soit à titre individuel pour les frais non remboursés, soit au travers de la caisse de prévoyance sociale (CPS). L’ex-président du Conseil d’Administration de la CPS Patrick Galenon estime ainsi qu’entre 1985 et 2023, les maladies radio-induites en Ma’ohi nui ont couté près de 900 millions d’euros, dont 89% ont été payés par le régime de santé ma’ohi. Il souhaite le remboursement de ces dépenses par l’État français.

Comme le rappelle le penseur Olúfẹ́mi O. Táíwò, la réparation ne saurait se réduire à un mécanisme matériel ou symbolique de réparation des torts passés : depuis des siècles, les diverses luttes le voient comme un acte de construction d’un monde plus juste (worldmaking). Développant cette vision « constructive » de la réparation, il rappelle que les revendications de réparation des mouvements noirs se concentrent moins sur des paiements individuels que sur l’obtention de fonds pour construire des institutions noires autonomes et améliorer leur vie communautaire21. Or, en faisant le « cadeau » du statut de territoire autonome à la Polynésie, l’État français s’est désengagé des frais de santé, tout en s’assurant de garder la mainmise sur les fonctions régaliennes comme la défense. La construction, à minima, d’un centre spécialisé dans le traitement des cancers, et plus largement, de centres de santé communautaires paraît dans ce contexte essentielle. On pourrait s’inspirer ici de la lutte contre les injustices historiques et les impacts durables de la traite transatlantique des esclaves : « la composante financière des réparations n’a de sens que si elle s’inscrit dans une visée holistique et renforce l’intégralité de notre processus d’autoréparation22 ».
Restaurer (au-delà de l’humain)
À l’instar de celui qui a abouti à bombarder le « désert » algérien, le processus du choix des atolls polynésiens doit beaucoup à l’image de ces vastes espaces comme espaces« vides ». L’image des atolls de Moruroa et la région de Reggane comme Terra Nullus est symptomatique d’une longue histoire raciste d’invisibilisation des formes de vie autochtones23. Elle reflète également une vision éminemment anthropocentrée : la rhétorique insistante concernant la « faible densité de population » trahit la conviction que les non-humains et l’environnement n’ont jamais été ne serait-ce que perçus comme étant dignes de considération. Les récits des conséquences des explosions sont pourtant accablants : poissons morts par milliers, diminution par deux de certaines populations d’oiseaux (allant jusqu’à la disparition pour certaines), coraux et habitats détruits, arbres vaporisés et sectionnés. À Moruroa, il est toujours interdit aux militaires de se baigner et de consommer du poisson24. La gestion de l’après ne fait que confirmer l’absence totale de considération pour l’environnement et la santé de celleux qui en dépendent : deux puits ont été creusés afin de stocker 570 tonnes de déchets radioactifs, des endroits qui « présentent une instabilité géomécanique avérée25 » selon la CRIAAD. Quant aux sols, une des techniques de « nettoyage » consiste à gratter au bulldozer les zones contaminées, pour regrouper les déblais et recouvrir le tout de béton. En complément de cette bétonisation partielle des atolls, 3 200 tonnes de déchets radioactifs, dont des fusées, avions, et autres engins lourds ont été immergées dans l’océan26.
L’image des atolls de Moruroa et la région de Reggane comme Terra Nullus est symptomatique d’une longue histoire raciste d’invisibilisation des formes de vie autochtones.
Contre la politique du ministère des Armées et du CEA qui n’effectuent ou ne prévoient aucun traitement d’ampleur des conséquences environnementales des expérimentations excepté la surveillance du site27, le Conseil économique, social, environnemental et culturel local préconise à minima une dépollution en profondeur, ainsi que « la mise en place d’une redevance (que l’on pourrait estimer à 150 Francs pacifique/m2/mois), au titre de la location des laboratoires vivants que sont Moruroa et Fangataufa, transformés en dépotoirs nucléaires28 ».
Les femmes autochtones du Canada désignent par « rematriement29 », la réhabilitation des relations des peuples autochtones avec leurs terres ancestrales. Contre la marchandisation et l’exploitation des territoires, la rematriation vise à honorer les connexions spirituelles et culturelles des populations à leurs terres et à réhabiliter les pratiques de soin propres aux systèmes matrilinéaires autochtones. Le contexte et les pratiques ne sont évidement pas comparables en Maohi Nui, mais le mouvement autour de la rematriation rappelle que le vol de terres ou d’objets ne peut être traité comme simple atteinte à une « propriété privée » qu’on peut se contenter de rapatrier ou de restituer. Réparer le vol d’une terre implique de restaurer les traditions, les tissus de relations interspécifiques, ainsi que les cultures qui étaient attachés à ces terres – des éléments pour l’instant absents des discussions.

Reprendre ses déchets
En contexte de réparation décoloniale, il est souvent question de restitution. Sachant que l’impérialisme écologique repose non pas seulement sur le pillage des ressources et savoirs, mais également sur l’utilisation de terres du Sud global comme décharges30, il pourrait être pertinent de se mettre en chantier sur des démarches de rapatriement vers le Nord global : libérer les terres Mao’hi n’impliquerait-il pas de reprendre certains des déchets les plus polluants pour les traiter dans l’Hexagone ?
Qui est ce « nous » implicitement désigné par les communs négatifs ?
Les recherches autours des « communs négatifs » soulignent la nécessité de prendre soin collectivement des nuisances et des déchets, à défaut de pouvoir en faire table rase. Il semble en effet essentiel de reconnaître les limites de la centralisation étatique pour « permettre à des collectifs de se réapproprier démocratiquement des sujets qui leur échappaient jusqu’à présent31 ». Néanmoins, qui est ce « nous » implicitement désigné par les communs négatifs ? La gestion démocratique de nuisances imposées de l’extérieur constitue-t-elle véritablement un horizon désirable ? Ne devrions-nous pas plutôt tenir les véritables responsables pour coupables et les contraindre à rendre des comptes et à traiter leurs nuisances ? « Vous, vous proposez quoi ?32 » est la première question systématiquement adressée par l’industrie nucléaire aux militant·es contre l’enfouissement des déchets, souvent formulée d’un ton supérieur et autosatisfait. Comme si la gestion de leurs déchets nous incombait. Comme si l’absence de solution viable pour les résidus des activités nucléaires justifiait leur maintien, alors qu’elle ne constitue en réalité qu’un argument supplémentaire en faveur du démantèlement de cette industrie. Les Maohis devraient évidement être décisionnaires en matière des déchets nucléaires. Mais ce n’est pas que « leur » problème. Cela devrait être aussi, voire surtout, celui des Français·es de l’Hexagone.
Reconnaître (sans preuves « irréprochables »)
« En Polynésie, certains disent qu’il faut tourner la page. Mais comment tourner une page si elle n’est pas écrite ? Comment la tourner avant de l’avoir lu ? »
Mereana Reid Arbelot, députée et membre du parti indépendantiste Polynésien
« Sans la Polynésie, la France ne se serait pas dotée de la force nucléaire et donc de la force de dissuasion (…). Cette contribution que vous avez apportée, je veux la reconnaître solennellement aujourd’hui devant vous ». Pour le gouvernement français, la « reconnaissance du fait nucléaire » a eu lieu avec la prise de parole de François Hollande en 2016, et cinq ans plus tard, avec celle d’Emmanuel Macron, lorsqu’il affirme que « la nation a une dette à l’égard de la Polynésie française » du « fait d’avoir abrité ces essais (…) dont on ne peut absolument pas dire qu’ils étaient propres ». De véritables excuses officielles se font encore attendre, et les mots sont encore en décalage avec les faits : contre l’imaginaire contractuel du sacrifice consenti invoqué à travers les concepts de « contribution » et de « dette », il convient de rappeler que les expérimentations nucléaires ne sont pas le fruit d’un commun accord, mais une démonstration des violences coloniales et racistes.
Par ailleurs, certaines associations revendiquent depuis de nombreuses années la reconnaissance de nombreuses victimes oubliées et indirectes des essais nucléaires, c’est-à-dire des ascendant·es, des conjoint·es, ou des descendant·es des malades. Elles soulignent d’abord le préjudice que constitue le fait de devoir prendre soin d’un proche très malade ou de l’accompagner jusqu’à la mort, et revendiquent l’indemnisation à la mesure des souffrances endurées par les patient·es et aidant·es (sur les victimes par ricochet, voir l’article de Naïké Desquesnes, « La bombe, ses femmes et ses enfants »). Elles soulignent également le cynisme inhérent au fait d’élargir les critères d’indemnisation lorsqu’il est question d’une génération qui disparaît lentement, tout en refusant de reconnaître les descendant·es, encore bien vivant·es, atteint·es de maladies transgénérationnelles.
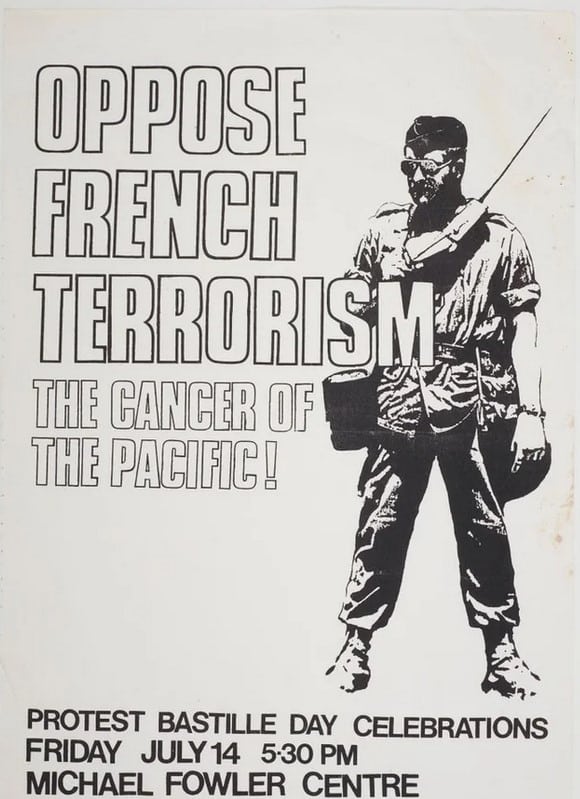
Sur ce sujet, l’action politique patine sur un océan de controverses opposant, d’un côté, les conclusions épidémiologiques de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)33, et de l’autre, des expertises de pédopsychiatres34 et des études indépendantes35 dénonçant une science asservie au lobby nucléaire et soulignant l’absence de véritables registres des malformations ou des accidents périnataux. Interrogé à ce sujet lors de la commission d’enquête de 2024, Florent de Vathaire, directeur de recherche à l’INSERM, affirme qu’« étudier les pathologies pour comprendre ces effets est totalement impossible. Il existe tellement d’autres facteurs en jeu que la puissance statistique reste insuffisante pour de telles études, sauf dans des populations très vastes et dans le cas d’expositions très importantes. » Au lieu de déduire qu’il faut donc avancer en s’appuyant sur d’autres choix méthodologiques et politiques, il conclut : « or, nous voulons des résultats irréprochables36 ».
Comme le savent les victimes des désastres difficilement quantifiables et mesurables du dit Anthropocène « l’irréprochabilité » des démonstrations scientifiques a souvent pour effet de préserver le statu quo, et le « fétichisme des mesures37 » peut rapidement devenir un moyen d’écarter la vérité telle que la formulent les non-expert·es. Les recherches en histoire des sciences qui étudient la production sociale de l’ignorance ont d’ailleurs parfaitement détaillé les mécanismes par lesquels le « doute » scientifique a été instrumentalisé pour faire obstacle à la vérité ou à l’action politique38. Les producteurs de pesticides n’ont-ils pas frénétiquement commandé des recherches sur les menaces alternatives qui planaient sur les abeilles pour détourner l’attention de la toxicité des néonicotinoïdes39 ?
Le propre des maladies « anthropocéniques » est de ne pas avoir de cause unique et facilement identifiable. Cela fait d’ailleurs longtemps que le contentieux des maladies professionnelles l’admet.
Le propre des maladies et contaminations « anthropocéniques » est de ne pas avoir de cause unique et facilement identifiable40, et cela fait d’ailleurs longtemps que le contentieux des maladies professionnelles l’admet : refusant de faire peser sur les épaules des victimes la charge de la preuve d’une causalité spécifique par un seul agent toxique, la lutte des syndicats contre les maladies professionnelles a systématiquement consisté à établir une « présomption d’origine ». Dans le cas de l’amiante par exemple, la justice distingue la causalité juridique de la causalité scientifique (entendue au sens strict)41.
Ces exemples sont autant d’éléments qui soulignent les limites d’une procédure de justice et de reconnaissance qui dépend exclusivement de mesures de laboratoire, soulevant des questions profondes sur les potentiels, les limites et la prétention des sciences à garder le monopole sur la production du savoir et à trancher des questions de réparation. Il se pourrait que rendre compte des conséquences coloniales de l’atome implique d’élargir les méthodes et le groupe de personnes considérés comme étant dignes de contribuer à la compréhension du réel.
Tandis que le système onusien vante depuis longtemps les mérites des savoirs autochtones et des « traditional ecological knowledges » (TEK), force est de constater que les populations concernées ne sont pas considérées comme étant détentrices de savoirs au sujet de leurs propres expériences. Comme le note Auguste Uebe-Carlson, président de l’Association 193, fondée en 2014 pour obtenir la vérité et des indemnisations au sujet des expérimentations nucléaires : alors même que les prêtres qui vivaient sur les îles Gambier avaient fait d’importantes observations concernant la natalité des enfants grâce à leurs registres de baptême, il a fallu « des écrits de chercheurs et de journalistes pour que le sujet cesse d’être qualifié de passionnel42 ».

La reconnaissance implique certainement de faire un travail de recherche et de mémoire. À cet égard, la construction d’un Institut du Cancer de Polynésie française en 2021, et le projet de construction d’un mémorial à long terme semblent être d’importantes avancées. Encore faut-il que ces différentes institutions ne deviennent pas « le lieu d’une seule parole43 » médicale et étatique, voire « un outil de propagande de l’État44 ». De manière similaire, il importe de continuer à lutter pour l’ouverture complète des archives, mais leur déclassification ne remédiera pas au problème d’une histoire racontée du point de vue des administrations, écrite « de l’encre du vainqueur », qui « nie l’histoire des vaincus (…) comme des crachats sur nos intelligences45 ».
« Reconnaître le fait nucléaire obligerait l’État à reconnaître le fait colonial »
Chantal Spitz
En effet, au-delà de l’accès aux documents labellisés secret défense par le gouvernement, l’injustice épistémique des cinquante dernières années consistant à systématiquement tourner en dérision les paroles maohi constitue un enjeu central de la réparation. Continuer le travail d’histoire orale et d’exhumation de témoignages des premier·es concerné·es déjà débuté par des personnes comme la militante lesbienne féministe et antinucléaire Zohl dé Ishtar46 ou encore Bruno Barillot, militant antimilitariste de l’Observatoire des Armements47, irait en ce sens.
« Un souvenir de quelqu’un qui a vécu les choses, c’est quand même mieux qu’un souvenir d’historien. Je le dis sans méchanceté, mais ça arrange bien l’État d’avoir de moins en moins de témoins vivants », nous glisse Mereana Reid Arbelot, députée et rapporteuse de la commission d’enquête parlementaire sur les essais nucléaires en Ma’ohi nui. Comme le note Chantal Spitz, « reconnaître le fait nucléaire obligerait l’État à reconnaître le fait colonial48 ». Elle souligne ici le paradoxe inhérent au fait de trop attendre de la part de dispositifs mis en place par un État ayant commis des atrocités coloniales en premier lieu… et la nécessité, qui en découle, de faire avancer la question des réparations en deçà et au-delà de l’État.
Raconter
« Il importe les pensées avec lesquelles nous pensons d’autres pensées.
Donna Haraway49
Il importe les histoires avec lesquelles nous racontons d’autres histoires.
Il importe quelles histoires font les mondes et quels mondes font des histoires. »
Même de l’autre côté de la barricade, quand on lutte contre le nucléaire, on se trouve souvent confronté·e au côté supposément anonyme, abstrait et insaisissable de cette menace. De manière symptomatique, Günther Anders, un des pionniers de l’écologie politique et de la lutte antinucléaire continentales, développe sa notion de supraliminarité – ce qui est trop grand pour être perceptible et imaginable – dans le contexte de son engagement contre la bombe atomique. Certains parlent même d’aphénoménalité des dangers modernes, et a fortiori du nucléaire : les pires menaces contemporaines, à savoir la radioactivité, la pollution atmosphérique, ou encore l’IA, sont imperceptibles pour beaucoup de gens.

Mais cette imperceptibilité du danger ne concerne pas tout le monde. Certes, les expérimentations nucléaires participent d’une violence lente, « une violence qui se produit progressivement et hors de vue, une violence de destruction retardée qui est dispersée dans le temps et dans l’espace, une violence qui n’est généralement pas du tout considérée comme de la violence50 ». Pourtant, les nuisances ne sont pas « inimaginables » ou invisibles, mais bien plutôt externalisées, et invisibilisées. Pour le dire plus simplement, les témoignages, les images et les récits sont là – nous ne leur accordons juste pas assez d’attention. Les appels anciens et récents autour du déploiement d’une « imagination » pour se figurer les catastrophes restent pertinents51 – mais peut-être faudrait-il avant tout commencer par écouter les survivant·es et exhumer les archives post-apocalyptiques déjà existantes.
L’entrée dans « l’Anthropocène » inverse la flèche temporelle de la modernité : les peuples opprimés sont les premiers à vivre l’avenir qui attend l’Europe continentale. Comme l’écrit la militante Hinewirangi Kohu, membre du Nuclear Free and Independent Pacific Movement, « Nous, les peuples autochtones de l’océan Pacifique, (…) nous sommes les premiers témoins de la destruction, car la plupart d’entre nous vivons sur la ligne de front du nucléaire – mais vous la verrez bientôt52 ». Les militantes et militants Maohi nui nous livrent des récits depuis des dizaines d’années. Souvent relégués au rang de « littérature » ou de poésie, leurs témoignages cassent les statuts, font compter d’autres mémoires, et offrent des descriptions précieuses du ravage environnemental et colonial.
Peut-être faudrait-il avant tout commencer par écouter les survivant·es et exhumer les archives post-apocalyptiques déjà existantes.
Dans un contexte où le militantisme de femmes antinucléaires a récemment fait l’objet d’une attention particulière en France53, nous gagnerions à nous intéresser à la riche littérature antinucléaire et anticoloniale du Pacifique, largement issue d’autrices comme Déwé Gorodé en Kanaky ou Grace Molisa au Vanouatu.
En Maohi Nui, les représentantes antinucléaires de l’Océanitude54 ne manquent pas. Pour ne citer que quelques exemples, l’île des rêves écrasés de Chantal Spitz55 retrace la généalogie d’une famille depuis la venue des premiers navigateurs français jusqu’à l’installation d’une base de missiles nucléaires dans l’île fictive de Ruahine. À l’instar de nombreuses œuvres de la littérature océanienne, le recueil de Rai Chaze, Vai : La rivière au ciel sans nuages56, narre plusieurs vécus de cancer. Plus récemment, Mutismes, publié en 2002 par Titaua Peu57 met en lumière les violences sociales et culturelles produites par la colonisation avant de terminer par un récit des révoltes de 1995 (voir l’encadré sur ce sujet dans l’entretien avec Hinamoeura Morgant-Cross).
Comme l’écrit Magali Bessone, « la réparation ne modifie pas le passé, mais elle peut modifier le récit que l’on fait sur le passé : réparer, c’est d’abord établir un récit historique sans failles ni silences où les crimes et les morts retrouvent leur place58 ». À partir de quelles voix et par quels moyens façonne-t-on une mémoire commune ? Comment construire un rapport de force à travers le foisonnement de contre-histoires ? À nous de les lire, de les faire circuler et de leur faire de la place dans nos généalogies politiques.
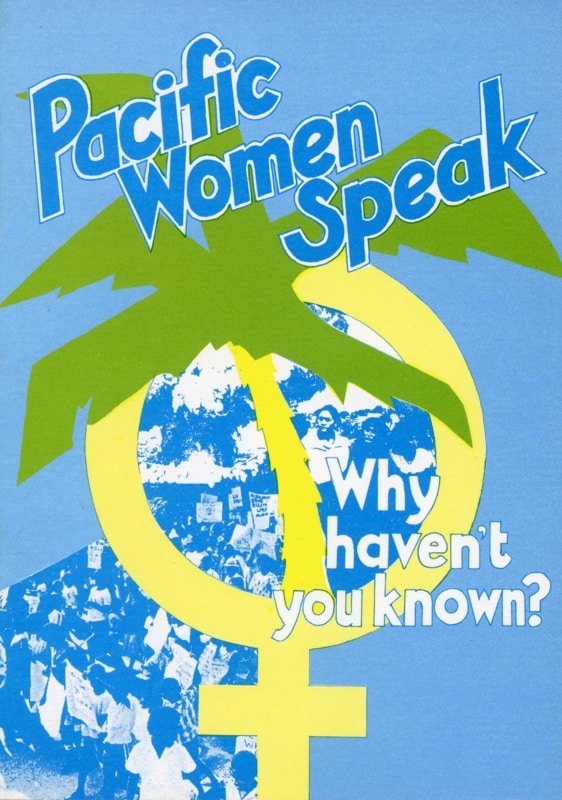
Se relier (au-delà de l’État)
Comment cet héritage nous oblige-il nous, en tant que militant·es antinucléaires de l’hexagone qui refusons la contamination de nos territoires par 17 km de galeries radioactives sous le sol meusien au 21ème siècle ? Cette question mériterait évidemment qu’on s’y penche plus longuement que ne le fait cet essai, et surtout, collectivement. Les archives de militant·es écologistes allié·es des luttes contre le colonialisme nucléaire fournissent néanmoins une première source d’inspiration.
Dans les années 1970 et 1980, les réseaux de solidarité transnationaux entre les nations du Pacifique sont foisonnants59. Bien avant la célèbre affaire du Rainbow Warrior en 1985, où les services secrets français coulèrent le navire de Greenpeace mobilisé pour protester contre les essais nucléaires de la France aux alentours de Moruroa, des équipes internationales organisent déjà des « croisières contestataires » pour sensibiliser et ralentir les expérimentations à partir de 1972. Revendiquant la souveraineté des peuples autochtones, et refusant la militarisation de leurs terres par des puissances nucléaires, diverses associations, partis politiques indépendantistes, syndicats et Églises océaniennes forment ainsi en 1975 le mouvement pour un Pacifique libre et dénucléarisé (Nuclear Free and Independent Pacific) à Fidji, alors indépendante depuis cinq ans.
Plusieurs comités locaux solidaires se forment en Europe, dont celui des femmes œuvrant à un Pacifique libre et dénucléarisé au Royaume Uni (WWNFIP : Women Working for a Nuclear Free and Independent Pacific). Le WWNFIP publie 43 numéros de 1985 à 1999 pour informer ses lectrices et lecteurs des événements dans la région du Pacifique. Les militantes organisent également plusieurs tournées de témoignages de femmes du Pacifique de 1985 à 1996, les invitant au camp de paix de Greenham Common, à une conférence féministe à Brighton, et dans divers groupes locaux anti-nucléaires à travers le pays. Elles publient les discours de ces tournées dans un recueil intitulé Pacific Women Speak – Why Haven’t you Known60, et le résultat de leur travail d’enquête dans le pacifique dans Daughters of the Pacific61. Si les initiatives françaises sont moins institutionnalisées, et prennent plus de temps à se former62, elles existent, et les instances gouvernementales de l’époque craignent d’ailleurs le rapprochement entre indépendantistes, écologistes et instances religieuses63. Parmi l’équipe internationale du navire contestataire Le Fri, on compte un pasteur français.

Par ailleurs, plusieurs députés et représentants des Églises manifestent en 1973 dans les rues de Papeete en tant que « Français contre la bombe ». La lutte du Larzac a été particulièrement active dans le tissage de liens, invitant des militants anticoloniaux sur leur occupation, organisant une visite de paysan·nes à Tahiti pour rencontrer des femmes de la coopérative de Hiti Tau et échanger autour de pratiques agricoles. Quatre militants originaires du Larzac sont d’ailleurs mis en examen pendant les révoltes de 1995 à Tahiti.
Que « la France doive réparation aux Polynésien·nes et aux Algérien·nes », cela semble une évidence. Mais qui, de « la France », doit œuvrer pour cette réparation ? Les ex-présidents, puisque ce sont eux qui ont délibérément choisi les atolls de Moruroa et Fangataufa pour leurs expérimentations funestes ? Toute la population de l’hexagone, qui profite aujourd’hui de la « sécurité » assurée par le statut de puissance nucléaire obtenu sur le dos des peuples colonisés ? Quelle responsabilité attribuer aux Français·es blanc·hes, descendant·es de cette histoire coloniale, sachant que les Maohis doivent vivre avec l’héritage du colonialisme nucléaire ?
Que « la France doive réparation aux Polynésien·nes et aux Algérien·nes », cela semble une évidence. Mais qui, de « la France », doit œuvrer pour cette réparation ?
Comme le souligne Taiwo, les descendant·es des colons doivent assumer leurs responsabilités dans la construction d’un système plus juste, non pas parce qu’ils sont individuellement « responsables » des injustices du passé, mais parce qu’ils bénéficient de privilèges en lien avec cette héritage historique. La responsabilité éthique et politique qu’il invoque n’est pas aussi nette et linéaire qu’une responsabilité au sens juridique du terme – dont la définition n’est d’ailleurs plus adaptée aux possibilités de destruction sur plusieurs générations.
Quiconque a déjà pris part à une lutte contre un grand Projet Inutile et Imposé sait toute l’importance de s’y prendre tôt. Si possible avant que les déclarations d’utilité publique ne soient proclamées et les expropriations ordonnées. Et au plus tard avant le début des travaux. « C’est plus dur de mobiliser après », comme on dit. Pourtant, la vie dans les ruines du capitalisme racial ne peut pas être (seulement) une affaire de débrouille affinitaire. La réparation est un pilier essentiel de la justice environnementale, et les luttes écologistes hexagonales ont encore beaucoup à apprendre lorsqu’il s’agit de mobiliser sur des lieux de défaite. Dans la continuité des éthiques du care féministes, du travail des comités « vérité et justice » ou des luttes syndicales pour les maladies professionnelles, il nous faut collectivement envisager des institutions de solidarité, des transferts de fonds et des pratiques de « rematriement » qui s’occupent des vivant·es, après que la violence se soit abattue sur eux, et à échelle transnationale.
L’illustration de couverture est une œuvre de l’artiste HTJ. Son compte Instagram : @htjdesigns

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Pour les discussions, conseils, et relectures, j’adresse mes sincères remerciements à C., M., Pia, Marie, Naïké, Renda Belmallem, Emilie, Geneviève, Quentin, François, et plus généralement, à tous les camarades contre le nucléaire et son monde.
- Eve Tuck, K. Wayne Yang, La décolonisation n’est pas une métaphore, Sète, Rot-Bo-Krik, 2022, trad. de Jean-Baptiste Naudy.
- Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale, Le Seuil, 2019, p. 24 ; également cité dans Émilie Hache, De la génération : Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, Les Empêcheurs de penser en rond, 2024, p. 224.
- Un article des accords d’indépendance de 1962 permettait à la France d’utiliser les sites du Sahara jusqu’en 1967, malgré la libération du pays.
- Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires du 5 août 1963, signé à Moscou.
- En cohérence avec les appellations et pratiques militant·es anticoloniales locales, ce texte utilise le terme Ma’ohi Nui pour désigner la Polynésie Française, et « Maohis » pour décrire les Polynésiens et Polynésiennes. Sur un tel choix, voir notamment Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies : Research and Indigenous Peoples, Zed Books, 2012.
- Sebastien Philippe, Tomas Statius, Toxique : enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, PUF, 2021.
- Bruno Barillot parle de négationisme nucléaire. Cf. Bruno Barrillot, « Human rights and the casualties of nuclear testing », Journal of Genocide Research, vol. 9, n°3, Routledge, 2007. Voir aussi Thomas Fraise, « Comment cacher un nuage ? L’organisation du secret des essais atmosphériques français (1957-1974) », Relations internationales, vol. 194, n°2, Presses Universitaires de France, 2023 ; Renaud Meltz, « Associer et dissimuler. Les essais nucléaires en Polynésie française, un “deuxième contact” entre secret et mensonge », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 70‑3, n°3, Belin, 2023.
- Déclaration de M. Hervé Morin. Journal officiel des débats à l’Assemblée nationale, 26 juin 2009, p.5661 cité dans : Yannick Barthe, Les retombées du passé : le paradoxe de la victime, Éditions du Seuil, 2017, p. 193.
- Moetai Brotherson, « Rapport sur la proposition de loi de M. Moetai Brotherson et plusieurs de ses collègues visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (3966), n°4237, déposé le mercredi 9 juin 2021 », 2021, p. 28.
- Kylie M. Allen, « Indigenous Nuclear Injuries and the Radiation Exposure Compensation Act (RECA) : Reframing Compensation toward Indigenous-Led Environmental Reparations », Arizona Journal of Environmental Law and Policy, vol. 10, n°2, 2019 ; Marie I. Boutté, « Compensating for Health : The Acts and Outcomes of Atomic Testing », Human Organization, vol. 61, n°1, 2005.
- Sur le site du Centre de ressources textuelles et lexicales, en ligne, consulté en octobre 2024.
- À ce sujet, voir Thierry Ribault, Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs, 1e édition, L’Échappée, 2021.
- Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, consulté le 21 mars 2025.
- Ynestra King, « Healing the wounds : feminism, ecology, and the nature / culture dualism », dans Alison M. Jaggar et Susan R. Bordo (éds.), Gender/body/knowledge: feminist reconstructions of being and knowing, New Brunswick, Rutgers University Press, 1989 ; Petra Kelly, Healing the wounds: the promise of ecofeminism, Philadelphia, New Society Publishers, 1989. Irene Diamond, « Artists as Healers : Envisionning Life-giving Culture », dans Gloria Orenstein (éd.), Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, 2nd edition, San Francisco, Sierra Club Books, 1990.
- Irene Diamond, Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, 2nd edition, San Francisco, Sierra Club Books, 1990.
- Carl Cassegård, Håkan Thörn, « Toward a postapocalyptic environmentalism ? Responses to loss and visions of the future in climate activism », Environment and Planning E : Nature and Space, vol. 1, n°4, 2018, p. 574.
- Sébastien Philippe, Sonya Schoenberger, Nabil Ahmed, « Radiation Exposures and Compensation of Victims of French Atmospheric Nuclear Tests in Polynesia », Science & Global Security, vol. 30, n°2, Routledge, 2022.
- Ce préjudice connait récemment un élargissement à d’autres substances. Le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt considérant que « tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique pourra demander réparation à son employeur, du fait des obligations de sécurité de ce dernier ».
- En outre, la proposition de loi introduit de nouveaux concepts, tel celui de la « prise en charge » et non plus uniquement de l’« indemnisation » du préjudice. « En l’état actuel du droit, la reconnaissance d’un lien entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants donne lieu au versement d’une indemnisation, dont le montant peut varier de quelques milliers à quelques centaines de milliers d’euros, sans que ne soit toujours prise en compte les soins du quotidien, directement ou indirectement liés au traitement de la maladie – c’est ainsi le cas, par exemple, des soins associés au traitement d’un cancer cutané. »
- Olúfẹmi O. Táíwò, Reconsidering Reparations, Oxford University Press, 2022.
- International Consultative Preparatory Forum (ICPF) for the Pacific Alliance Gathering of Colonised Peoples & Sovereign Peoples Union for Global Justice through Decolonisation and Reparations (document pdf).
- Un biais qu’on retrouve d’ailleurs chez certains pionniers de la protection de la nature, et notamment dans le mouvement de conservation de la wilderness étatsunienne. Voir par exemple William M. Denevan, « The Pristine Myth : The Landscape of the Americas in 1492 », Annals of the Association of American Geographers, vol. 82, n°3, Routledge, 1992.
- Bablet JP Gout B. Goutière G, Les atolls de Mururoa et de Fangataufa Polynésie française. Tome III – Le milieu vivant et son évolution, Commissariat à l’énergie atomique CEA DIRCEN, 1995.Cité dans Sebastien Philippe, Tomas Statius, Toxique : enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, op. cit.
- Rapport sur la proposition de loi de M. Moetai Brotherson et plusieurs de ses collègues visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (3966), n° 4237, déposé le mercredi 9 juin 2021.
- La Convention de Londres sur la prévention de la population des mers résultant de l’immersion des déchets était ratifiée par 37 pays, dont la France (qui s’est réservé le droit de ne pas appliquer les dispositions de cette convention « si celle-ci était interprétée comme faisant obstacle à des activités estimées nécessaires à la défense nationale ». « Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets » (document pdf), consulté le 30 octobre 2024.
- Moetai Brotherson, « Rapport sur la proposition de loi de M. Moetai Brotherson et plusieurs de ses collègues visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (3966), n° 4237, déposé le mercredi 9 juin 2021 », op. cit.
- CESEC, « Vœu relatif au fait nucléaire » (document pdf), 2020.
- Le terme a été introduit par l’auteure Stó:lō Lee Maracle Lee Maracle, I Am Woman : A Native Perspective on Sociology and Feminism, Raincoast Books, Press Gang Publishers, 2002. Il est mobilisé par de nombreuses luttes et autorise une diversité de définitions. Voir par exemple Cyndi Suarez Dempsey Donald Soctomah, Darren Ranco, Mali Obomsawin, Gabriela Alcalde, Kate, « Land Rematriation : A Conversation with Cyndi Suarez, Donald Soctomah, Darren Ranco, Mali Obomsawin, Gabriela Alcalde, and Kate Dempsey », Non Profit News | Nonprofit Quarterly, 2024, consulté le 23 mars 2025.
- Max Liboiron, Polluer, c’est coloniser, Éditions Amsterdam, 2024, trad. de Valentine Leÿs.
- « Entretien avec Alexandre Monnin enregistré à la Ferme de la Mhotte par Rieul Techer et Sylvia Fredriksson », 2017, consulté le 9 avril 2025.
- « « Mais vous, vous proposez quoi ? » Luttes contre le nucléaire et sa gestion des déchets », 2016, infokiosques.net, consulté le 9 avril 2025.
- « Essais nucléaires et santé – Conséquences en Polynésie française », Inserm, consulté le 15 octobre 2024.
- « Conséquences génétiques des essais nucléaires : l’étude accablante du docteur Christian Sueur en Polynésie », Observatoire des armements/CDRPC, consulté le 8 novembre 2024.
- « Les atteintes aux enfants », Observatoire des armements/CDRPC, consulté le 8 novembre 2024.
- « Compte rendu n°10. Audition de M. Florent de Vathaire. 29 mai 2024 », Assemblée Nationale.
- René Riesel, Jaime Semprun, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008.
- Naomi Oreskes, « The fact of uncertainty, the uncertainty of facts and the cultural resonance of doubt », Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 373, n°2055, Royal Society, 2015.
- Stéphane Foucart, La fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, Gallimard, coll. « Folio », 2014.
- Celia Izoard, « Cancer : l’art de ne pas regarder une épidémie », Terrestres, 2020.
- Marion Bary, « L’indemnisation des victimes de l’amiante en droit français », JURIS-Revista da Faculdade de Direito, vol. 19, 2013.
- « Compte rendu n°2. Audition du Père Auguste Uebe-Carlson, président de l’Association 193, et Mme Léna Normand, première vice‑présidente de l’association », Assemblée Nationale, 2024.
- « Compte rendu n°2. Audition du Père Auguste Uebe-Carlson, président de l’Association 193, et Mme Léna Normand, première vice‑présidente de l’association », op. cit.
- L’association 193 a d’ores et déjà annoncé son retrait du projet de mémorial, « qui finalement n’est autre qu’un outil de propagande de l’État ». Cité dans Caroline Perdrix, « L’association 193 se retire du projet de centre de mémoire des essais nucléaires – Radio1 Tahiti », 2019 (consulté le 9 avril 2025).
- Chantal Spitz, « Lettre ouverte de Polynésie », Multitudes, n°1, 2018, p. 18.
- Zohl Dé Ishtar, Daughters of the Pacific, Spinifex Press, 1994.
- Bruno Barillot, Victimes des essais nucléaires : histoire d’un combat, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, 2010.
- Chantal Spitz, « Lettre ouverte de Polynésie », Multitudes, op. cit.
- Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020, trad. de Vivien Garcia.
- Rob Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Harvard University Press, 2011, p. 2.
- Sur « l’impensabilité » du dérèglement climatique, et l’importance de l’imagination pour y faire face, voir par exemple Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement : d’autres récits à l’épreuve du changement climatique, Wildproject, 2021, trad. de Morgane Iserte et Nicolas Haeringer. Günther Anders, et dans sa lignée, Hans Jonas et Jean-Pierre Dupuy, creusent également cette hypothèse.
- Hinewirangi Kohu, « Foreword I », dans Zohl Dé Ishtar (éd.), Daughters of the Pacific, Spinifex Press, 1994, p. vii.
- Renée Conan, Anne Laurent, Femmes de plogoff, Éditions la Digitale, 2010 ; Starhawk, Rêver l’obscur : femmes, magie et politique, Cambourakis, 2015, trad. de Morbic ; Gwyn Kirk, Alice Cook, Des femmes contre des missiles : rêves, idées et actions à Greenham Common, Cambourakis, 2016, trad. de Cécile Potier ; Xavière Gauthier, Isabelle Cambourakis et Sophie Houdart, Retour à La Hague : Féminisme et nucléaire, Cambourakis, 2022.
- L’auteur Paul Tavo (originaire du Vanuatou) propose de désigner les pensées décoloniales du Pacifique par « océanitude », en réponse à la négritude. Pour une étude plus poussée de ce courant, voir Anaïs Maurer, « Océanitude », Francosphères, vol. 8, n°2, Liverpool University Press, 2019. Audrey Ogès, Violences coloniales et écriture de la transgression : Étude des oeuvres de Déwé Görödé et Chantal Spitz, Éditions L’Harmattan, 2016.
- Chantal Spitz, L’île des rêves écrasés, Au vent des îles, 2008.
- Rai Chaze, Vai : La rivière au ciel sans nuages, Creat Space, 2013.
- Titaua Peu, Mutismes, Au Vent des Iles, 2021.
- Magali Bessone, « Reconnaître, réparer, restituer », dans Racismes de France, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2020.
- Clémence Maillochon, Les réseaux de militants contre les essais nucléaires français (1959 – 1996), thèse de doctorat, Université de Mulhouse, 2023.
- Women Working for a Nuclear Free and Independent Pacific (ed.). Pacific Women Speak, Green Line, 1987.
- Ishtar, Zohl Dé. Daughters of the Pacific, Spinifex Press, 1994.
- Bruno Barrillot témoigne ainsi des premières réticences de Greenpeace France : « Il se trouvait que Greenpeace Nouvelle-Zélande avait publié une brochure avec des témoignages de Polynésiens en anglais. A Paris, même à Greenpeace, on disait “C’est encore un coup des anglophones qui attaquent la France”… En effet, les témoignages étaient effarants sur les maladies et sur le déroulement des essais à Moruroa. Donc, le directeur de Greenpeace France, avait demandé que le centre de recherche de Lyon puisse aller vérifier ces témoignages sur place. Comme j’étais le seul disponible à l’époque, on m’a envoyé à Tahiti. » Voir Jean-Marie Collin, « Bruno BARRILLOT, “Vérité et Justice” pour les victimes des essais nucléaires », 2018.
- Clémence Maillochon, Les réseaux de militants contre les essais nucléaires français (1959 – 1996), op. cit., p. 193.
L’article Comment et quoi « réparer » après le colonialisme nucléaire ? est apparu en premier sur Terrestres.
23.04.2025 à 12:41
La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse
Marion Sbriglio
Il y a nos mouvements et nos gestes. Et puis il y a les “mouvementements”, ainsi que la philosophe et artiste Emma Bigé appelle ces “mouvements internes qui ne se décrètent pas” tels que le maintien du corps ou la respiration. Comment sentir et penser ces mouvementements ? Pourraient-ils permettre de subvertir l’ordre existant ? Exploration de leurs multiples dimensions politiques.
L’article La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9329 mots)
Temps de lecture : 21 minutes
À propos de Mouvementements. Écopolitiques de la danse d’Emma Bigé, paru en 2023 aux éditions La Découverte dans la collection « Terrains philosophiques ».
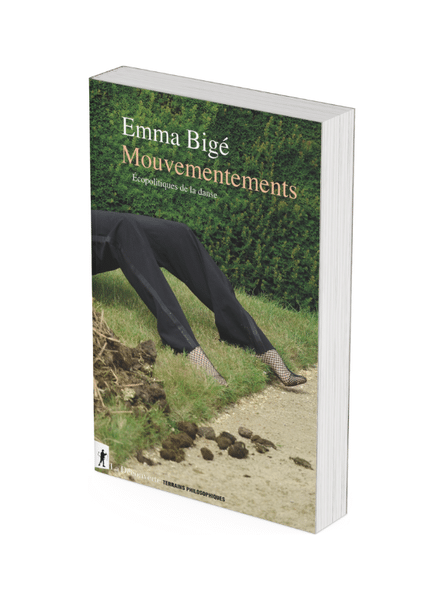
Emma Bigé, l’autrice de cet ouvrage conçu comme une « enquête », a écrit six ans plus tôt une thèse consacrée à la phénoménologie du mouvement depuis le contact improvisation1. Il s’agit d’une pratique somatique qui s’intéresse au corps vivant et vécu dans sa totalité et que l’on retrouve en filigrane dans l’ouvrage. Par ailleurs, Emma Bigé est commissaire d’exposition, anime des ateliers de contact improvisation, enseigne la philosophie, écrit et traduit des articles pour les revues Trou noir, lundi matin ou Multitude avec Yves Citton. Enfin, elle partage ses textes sur son site Internet2 avec un enthousiasme viral, consacrés aux théories pratiques TPG (transpédégouines), queer féministes, décoloniales, et plus récemment, crip3.
L’ouvrage, composé de cinq courts chapitres, est proliférant : d’exemples, de références, de thématiques, tissés autour du fil conducteur des « mouvementements » dont il crépite, résonne et fourmille. Le choix du terme de mouvementement a deux origines. D’une part, il renvoie à un travail précédent d’études en danse, proposé par Alice Godfroy4, chercheuse en danse et en littérature qui emprunte à un philosophe et phénoménologue, Jean Clam, le terme de mouvementements : ce sont les mouvements qui animent un être vivant et désirant. Le terme permet de « dire l’incessante mobilité intérieure » comme extérieure5. D’autre part, le terme permet à l’autrice de nommer cette dualité bougeant-e/bougé·e qu’elle tente de dépasser dans son enquête.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Ainsi, les « mouvementements » désignent tous ces « mouvements en soi qui ne sont pas de soi », qui constituent une occasion et une puissance de transformation, d’autant plus si l’on est capable de les constater et de se laisser affecter par eux. L’autrice prend l’exemple de l’écoute de la musique : « loin d’avoir à me mettre au pas de la musique, tout va se passer comme si, enveloppée par les sons, j’allais me laisser bouger par eux plutôt que de bouger « sur » eux » (p. 58). Il s’agit aussi des micro-mouvements qui nous agitent, nous déséquilibrent ou nous permettent de nous ajuster, sous l’effet de la gravité, lorsque nous sommes debout et immobiles. Bref, ce sont tous les mouvements internes qui ne se décrètent pas mais se constatent, s’activent en nous si on les laisse faire, sans résulter d’une décision motrice pour autant, et qui héritent de forces extérieures (telles que la gravité) ou intérieures (la respiration) et peuvent conduire au geste. En effet, « nous sommes mouvementées par des gestualités autres qu’humaines » (p. 32).
Les mouvementements sont tous les mouvements internes qui ne se décrètent pas mais se constatent, s’activent en nous si on les laisse faire, sans résulter d’une décision motrice (respiration, posture…).
Le paradoxe qui mène à l’ouvrage est le suivant : nous, habitant·es des sociétés occidentales, sommes aussi des créatures terrestres, mais nous détruisons notre sol et nous ne savons ni où ni comment « atterrir6 ». Cependant certaines d’entre nous, notamment danseuses et activistes, ont appris à survivre dans/avec la perspective de la chute, et des sols mouvants avec lesquels elle dialogue. Le pari de l’ouvrage est donc le suivant : comment sentir et penser ces mouvementements et comment agir voire subvertir l’ordre existant, grâce à eux ?
Je partirai des approches relationnelles qui étaient le propos l’ouvrage, celui-ci cherchant à frayer un chemin alternatif au dualisme pour problématiser notre appartenance terrestre. Ensuite, seront synthétisées quelques propositions de l’autrice quant aux manières de se sentir mouvementées, grâce aux danses et aux œuvres qui associent la critique sociopolitique à la critique esthétique. Enfin, je proposerai trois éléments critiques pour prolonger les discussions auxquelles cet ouvrage nous invite.

« Des mouvements qui ne sont pas de moi »
L’avant-propos présente synthétiquement et successivement le projet de l’autrice, à la fois son objet d’étude et sa stratégie. Il s’agit d’une « enquête » sur et avec les « mouvementements », c’est-à-dire « les mouvements qui ne sont pas de moi, des mouvements qui me précèdent et dont certains m’instituent », tels que la respiration, la circulation sanguine, le maintien de la posture érigée, etc. « Sans cesse je suis mouvementée, du dedans comme du dehors, par d’autres mouvements que les miens. » (p. 13). L’autrice allie plusieurs sources, des praticiennes et/ou penseuses en danse contemporaine et des philosophies activistes. « Quelles mobilisations pouvons-nous trouver dans les leçons-en-mouvement dont s’arment les danseuses ? » (p. 15). Cette alliance est profondément « écologique », au sens de la philosophe Isabelle Stengers : en effet, Emma Bigé se place du côté d’une écologie des solidarités, plutôt que de la prédation7. L’enquête repose sur l’étude d’une série de relations coopératives entre différentes communautés de pratiques auxquelles appartient l’autrice et à travers lesquelles elle se situe, notamment du côté des milieux activistes queer, de la danse et d’autres pratiques somatiques8.
« Quelles mobilisations pouvons-nous trouver dans les leçons-en-mouvement dont s’arment les danseuses ? »
Emma Bigé
D’autre part, l’approche qu’elle mobilise, relationnelle, s’inspire largement d’une relationnalité « écosomatique », envisagée par la chercheuse écologue et danseuse Joanne Clavel9. L’écosomatique consiste en une « philosophie du soma, qui en plongeant dans le corps-vivant-vécu, y découvre l’eco, la maison-Terre qui l’entoure et avec laquelle il vit » (p. 31). Plus précisément, « Mouvementements est une enquête sur ces danses « composthumanistes », c’est-à-dire sur la manière dont certaines pratiques chorégraphiques peuvent nous aider à aiguiser les sentis de nos solidarités avec d’autres entités, humaines et pas qu’humaines » (p. 14), en s’inspirant de la philosophe Donna Haraway10.
L’hypothèse de travail est la suivante : la danse contemporaine, lorsqu’elle s’articule aux philosophies activistes (notamment critiques : féministes, queer, décoloniales, antivalidistes, etc) et que l’on prend le temps de lui consacrer une enquête, d’en décrire les pratiques, est riche d’une intelligence et d’un enseignement qui peut contribuer aux activismes. Cette intelligence est sensible, c’est-à-dire qu’elle repose sur un apprentissage créatif de notre capacité à sentir, à porter notre attention sur ce à travers quoi nous vivons incarné·es, et même à reconnaître ce qu’il y a, dans notre aptitude attentionnelle, d’incarné et de vivant. L’avant-propos présente rapidement la manière dont chaque partie du livre s’organise et se déploie autour de ce fil conducteur.
La dimension politique de l’esthétique
L’introduction et le premier chapitre clarifient deux postulats principaux qui guident la réflexion de l’autrice. Le premier, général, concerne l’ontologie, c’est-à-dire les croyances relatives à la réalité concrète. L’autrice revendique une « ontologie relationnelle », où ce qui existe ne consiste pas d’abord en des entités à l’identité préconstituée qui peuvent interagir, mais en des relations multiples qui fondent des existences aux identités évolutives. Le second postulat, particulier, découle du premier : si le fait d’exister procède avant tout de relations, alors la définition traditionnelle du corps, notamment humain, comme entité première, évidente, ne tient plus. « L’anatomie moderne ne coupe pas que dans les chairs : elle coupe aussi et surtout entre le corps et l’environnement au sein duquel il se tient. » (p. 40).
Ce pari se nourrit notamment de la pensée de la philosophe du « danser » et danseuse Erin Manning, qui contourne l’essentialisation à laquelle mène le plus souvent le substantif du « corps » au profit d’une activation que permet l’anglais par le suffixe –ing. Erin Manning affirme un « refus du corps comme unité descriptive dernière des évènements dynamiques […], refus à la faveur duquel on trouve plutôt ce qu’elle appelle des « bodyings », « encorporations » ou « corps-en-train-de-se-faire » (p. 48). Le pari se fonde et se comprend également sur une proposition plus logique, celle de la « voie médiane » (p. 55-66), qui désigne dans certaines langues, la possibilité d’articuler les voix active et passive (par exemple en grec, haptomai signifie autant « toucher » qu’« être touché »).
Lire aussi sur Terrestres : Baro d’evel et Barbara Métais-Chastanier, « Les beaux gestes », juillet 2024.
L’autrice entremêle tout au long de l’ouvrage les références nourries par les approches relationnelles, qui excèdent largement la question ontologique. D’une part, les références théoriques issues des travaux en épistémologie – l’étude des conditions de validité des énoncés scientifiques – se nourrissent des approches critiques, qui s’intéressent aux rapports sociaux de domination, et des théories phénoménologiques, qui s’intéressent à la connaissance issue de l’expérience et de sa description de celle-ci. Certaines de ces références sont elles-mêmes à la croisée des épistémologies critiques et phénoménologiques. C’est le cas de la Queer Phenomenology (2006) de Sara Ahmed, qui est aussi décoloniale, ou encore de Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs (1952) pour qui la souffrance issue de l’oppression coloniale se traduit dans la posture corporelle, et aussi de celleux qui en héritent comme Fred Moten, qui s’intéresse en retour aux potentialités du soin et du soutien intra-communautaire, à travers une autre forme de contact11.
« L’anatomie moderne ne coupe pas que dans les chairs : elle coupe aussi et surtout entre le corps et l’environnement au sein duquel il se tient. »
Emma Bigé
D’autre part, du côté des pratiques chorégraphiques, on retrouve une tendance à articuler les préoccupations politiques et esthétiques. Les théories répondent aux pratiques en les formalisant, et réciproquement : les pratiques (esthétiques) permettent d’incarner concrètement ce que les théories formalisent. Ce faisant, l’ouvrage insiste sur une version particulière de la notion d’esthétique, qui renvoie moins au regard distancié du/de la spectatrice, qui apprécie sensiblement mais de l’extérieur ce qui lui est donné à voir, qu’à une version de l’esthétique qui insiste sur la manifestation voire la création de sentis « haptiques », liés au contact (tactile, mais également au mouvement, au soutien d’autrui). C’est là que se loge en partie la dimension politique de l’esthétique : notre capacité à sentir, à sentir nos relations à nous-mêmes, aux autres et à autrui dépendent directement de la définition du corps, et de ce à quoi les corps sont autorisés ou non par la société dans laquelle ils s’activent. Ces perspectives « écosomatiques », relationnelles et critiques se traduisent dans les pratiques somatiques et chorégraphiques, grâce à l’étude de divers « savoir-sentir » (chapitres 2 à 5), empruntée à Isabelle Launay : il s’agit « du mixte d’habitudes sensorielles et motrices qui se développent au travers d’une pratique et en particulier de la répétition de certains gestes ou de certaines attitudes » (p. 31).
Trois gestes intimes et politiques pour sentir autrement
Avec la gravité
Le premier chapitre de l’ouvrage dédié aux savoir-sentir concerne la chute, telle qu’elle est pratiquée en danse. L’autrice convoque les pensées et pratiques héritées du contact improvisation. Le transfert de poids peut en effet être considéré comme une forme de chute horizontale, en ce qu’il suppose le déséquilibre et permet d’apprendre à sentir le déplacement de ses propres appuis, à même le sol, et ceux de l’autre. Ce transfert peut s’expérimenter seul·e, à travers la méditation de la « petite danse » proposée par le gymnaste et danseur Steve Paxton, pour se rendre disponible et se préparer à la chute, tout en restant debout12. Il peut également s’exercer dans le cadre du duo de contact, qui met alors en exergue un agencement tout à fait singulier : il s’agit en fait davantage d’un « quartet », plus que d’un duo, dans la mesure où, selon Steve Paxton, on danse toujours en relation avec son propre sol (avec la gravité qui nous y relie), cette relation étant elle-même articulée à la danse du partenaire avec son propre sol à lui. Cela signifie que le duo de contact improvisation permet de se sentir concerné·e par la Terre, et par sa relation avec l’autre, autrement dit de faire place au senti gravitaire et à sa puissance.

Contre ou avec autrui
La question politique articulée aux pratiques somatiques, à tout mouvement en tant qu’il est vécu et senti, traverse l’ensemble de l’ouvrage, parfois explicitement, parfois davantage en filigrane.
D’une part, les pratiques écosomatiques, chorégraphiques, artistiques décrites sont appréhendées dans leur capacité à souligner et créer de nouvelles relations à son corps et celui d’autrui, plus généralement à la Terre, offrant ce faisant un horizon de résistance non frontale aux oppressions qui structurent le monde moderne occidental (violence et répression policière, racisme et néo-colonialisme, capitalisme racial et patriarcal, qui exploitent les corps des personnes les plus précaires, réduits à un outil de travail productif).
D’autre part, ce sont précisément les oppressions systémiques (race, genre, validisme, etc.) qui sont remises en question par certaines praticien·nes somatiques. Celleux-ci constatent que les oppressions se renouvellent au sein même des communautés de pratique somatiques et chorégraphiques, alors même que ces communautés se pensent non concernées voire émancipées de certaines formes d’oppression. Des propositions de certain·es praticien·nes cherchent précisément à mettre en exergue ces oppressions internes, et à les réduire. C’est le cas, par exemple, des danseurs noirs de contact improvisation Ishmael Houston-Jones et Fred Holland, qui soulignent les normes blanches du contact improvisation et ont proposé dans les années 1980 Le Manifeste du contact de travers, afin de « jouer le rôle de rabat-joie : ils vont pratiquer une « mauvaise sorte » de contact improvisation, « et le flux pourra bien aller se faire foutre » » (p. 105). Concrètement, dans les jams ou dans les ateliers de contact improvisation, les agressions racistes et sexistes13 ne sont pas rares, tout comme les agressions validistes. Il apparaît que le monde des pratiques somatiques et chorégraphiques est un microcosme qui n’échappe pas aux structures sociopolitiques plus générales, mais qui cherche des marges de manœuvre afin d’en réduire les effets délétères.

Avec soi-même : « ne-pas-faire »
Le senti de la relation à soi-même traverse les chapitres dédiés aux quatre exemples de « senti » développés par l’autrice : se sentir vulnérables et puissantes vis-à-vis de la Terre et de la gravité qui constitue notre première condition, à nous vivant·es humain·es, comme à tous·tes les autres vivant·es ; ou se sentir vulnérables, et puissant·es, en relation avec d’autres prenant soin de nous, avec tendresse. Cela dit, l’autrice insiste à juste titre sur la spécificité de la relation à soi-même, grâce à une exploration de plusieurs pratiques somatiques et chorégraphiques. C’est le cas de la « sieste PEP (Pour en profiter) » proposée par Catherine Contour (p. 184), qui invite chacun·e à s’octroyer, lorsque l’envie se manifeste, quelques minutes de relâchement, sans forcément sombrer dans le sommeil, mais en prêtant attention à ce que fait notre corps, notre « corps-en-train-de-se-faire », lorsque plus rien ne lui est demandé d’autre que de constater ce qui le mouvemente, immobile.
Selon Emma Bigé, alors que la notion de performance a souvent servi de métaphore en sciences sociales, c’est moins le cas pour la danse. Elle se propose d’y remédier au moyen de la notion de « mobilisation » qui permet de comprendre les mouvements sociaux en termes de contagion, de viralité. Emma Bigé cite également l’anthropologue brésilien André Lepecki (2013) qui envisage pour sa part la danse comme possibilité de « reconnaître dans toute situation son potentiel de mouvement » (p. 203) mais aussi ce qui, dans les politiques répressives policières, relève d’un contrôle des corps et des mouvements. En somme, les savoirs des danseuses et praticien·nes somatiques pourraient outiller l’étude des luttes sociales, précisément à partir de leur dimension somatique. L’implication de cette proposition est pragmatique : l’autrice se tourne alors vers l’essai poétique d’Alexis Pauline Gumbs (dans Underdrowned. Black Feminist Lessons from Marine Mammals, 2020, traduit en français aux éditions Burn~Août/Les liens qui libèrent en 2024), qui trace, elle, un chemin possible pour accueillir parmi les gestes des humain·es ce qui pourrait les relier à d’autres qu’elleux-mêmes telles que les « mammifères marines14 » (écouter, respirer profondément, etc.).

Une autre « politique du moindre geste »
La multiplicité des axes par lesquels l’autrice aborde la question politique est intéressante. Le premier axe est en quelque sorte pré-politique (chapitre 1 et 2) : il s’agit de proposer une approche permettant de rompre avec les ontologies/épistémologies humanistes de la « modernité/colonialité » (p. 17) occidentale, qui séparent radicalement corps et matière, esprit et corps, etc., et dont l’organisation capitaliste de l’économie conduit à une écologie de la prédation qui exploite les corps humains comme non humains et les sols qui les soutiennent. Selon l’autrice, la danse permet de faire l’expérience sensible d’une autre écologie, celle des relations (corps-matière, espèce humaine et non-humaine, etc.), et plus précisément des relations de coopération, de soutien mutuel.
Deuxièmement, l’autrice évoque un autre axe qui concerne l’existence des oppressions sociales (chapitre 3), considérées à la fois à l’échelle macro et micropolitique (échelle des communautés de pratiques somatiques). Le chapitre suivant (chapitre 4) explore les stratégies « obliques » permettant non pas de combattre de front des groupes ou des systèmes dans une logique oppositionnelle mais de trouver des chemins de traverse ou des interstices pour faire des pratiques somatiques une ressource de l’émancipation, notamment corporelle, psychique et sociale. Par exemple, Black Power Naps est une installation de 2018, d’artistes également activistes qui proposent à la spectatrice (notamment sexisée et racisée) de prendre soin d’elle en trouvant le repos dans la sieste, considérant celle-ci comme une revendication d’un droit au sommeil tout à fait politique. Le dernier chapitre renseigne moins clairement sur sa dimension politique, si ce n’est qu’il met en exergue l’engagement (somatique) que génère paradoxalement le « non-agir ».
La danse permet de faire l’expérience sensible d’une autre écologie, celle des relations (corps-matière, espèce humaine et non-humaine, etc.), et plus précisément des relations de coopération, de soutien mutuel.
Enfin, un dernier axe politique est esquissé dans la conclusion : il s’agit de considérer la participation « choréopolitique », des pratiques somatiques aux luttes et activismes qu’ils soient écologiques, et/ou antiracistes, queer, etc.
L’autrice rappelle à travers ces trois axes la pluralité des articulations entre sensibilité, pratique somatique et écopolitique. Elle s’intéresse, via la création artistique, chorégraphique et somatique à une autre forme de « politique du moindre geste »15.
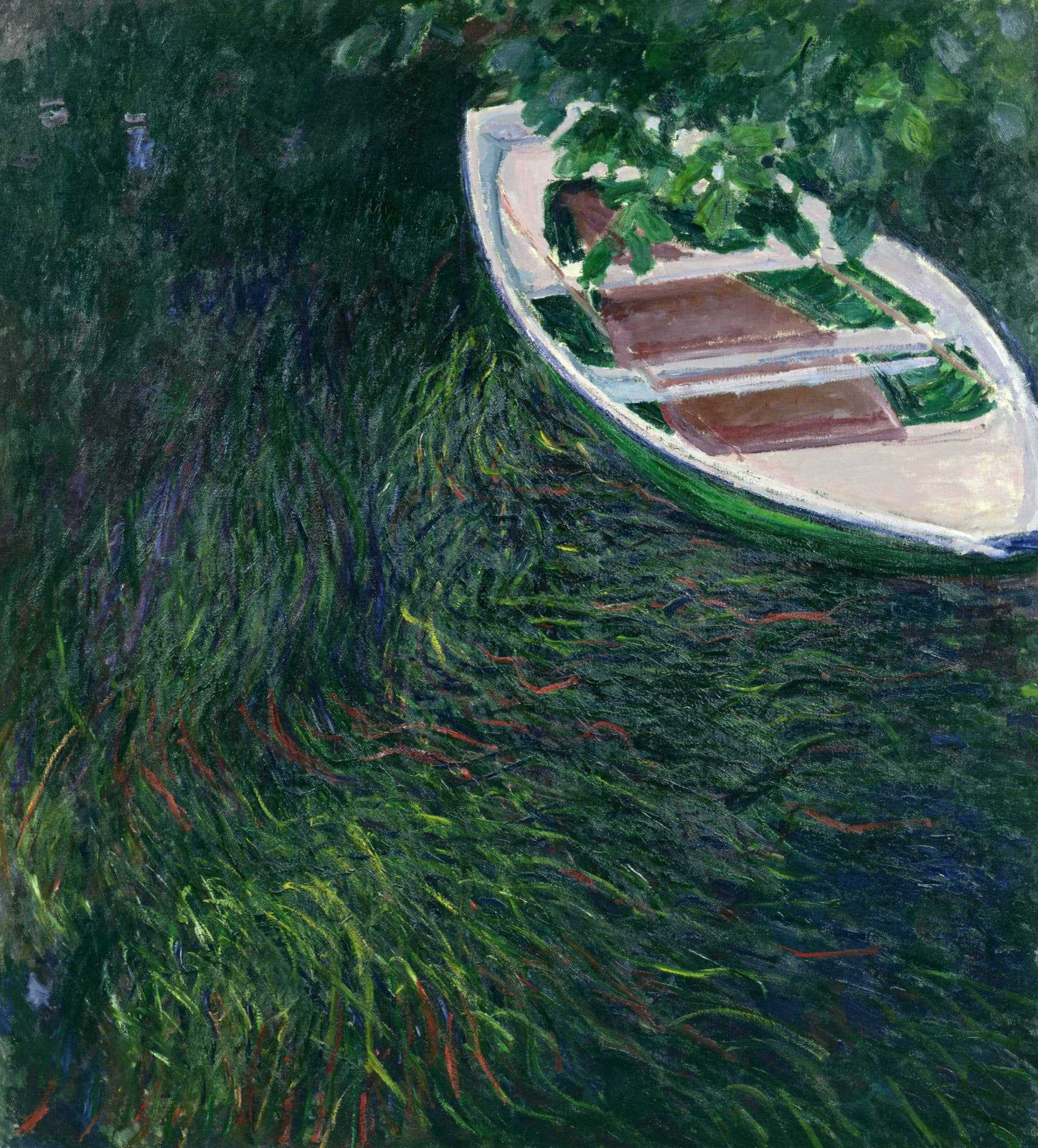
Toutefois, le traitement de ces questions politiques est inégal. D’une part, on peut s’étonner de l’absence de la question, à la fois transversale et spécifique, de la classe sociale : est-ce qu’aucune pratique « somactiviste » ne vient par exemples de milieux prolétaires ? Les pratiques somatiques ne sont ici jamais situées comme un privilège des groupes les plus aisés (ou des plus aisées parmi les plus précaires) : celleux qui ont le choix de pratiquer la danse comme un métier, celleux qui trouvent le temps et l’énergie pour cultiver leur plaisir esthétique, celleux qui ont les ressources nécessaires et suffisantes pour se rendre sensibles à de telles pratiques.
D’autre part, plus généralement, la matérialité économique des pratiques somatiques et chorégraphiques n’est jamais évoquée. Cela n’est certes pas le cœur de l’ouvrage, mais on peut s’interroger sur le fait qu’il n’en soit pas fait mention dans le corps du texte de l’ouvrage ou dans ses notes. Comment et à quelles conditions ces praticiennes (et/ou les spectatrices) sont-elles concrètement en mesure de s’organiser collectivement ?
Enfin, un dernier élément peut surprendre : le troisième axe politique évoqué, qui concerne l’articulation des luttes et des pratiques somatiques, n’est traité qu’en conclusion, en forme d’ouverture de l’ouvrage, et consacré principalement à l’étude des « mobilisations » sociales au prisme des savoirs de la danse. Un chapitre aurait pourtant pu être dédié à l’articulation des luttes et des pratiques somatiques, afin d’analyser leur potentiel heuristique. À tout le moins, un passage aurait pu expliquer le choix délibéré de ne pas creuser cette question, quand d’autres s’y attèlent : on peut penser à la récente parution de la revue Communications, « Danser en lutte », co-dirigé par Marie Glon et Bianca Maurmayr, où Emma Bigé a d’ailleurs écrit un article, ou encore au travail du groupe Soma & po16. Ce troisième axe est d’autant plus intéressant qu’il irrigue plus ou moins implicitement une part des débats dans le champ militant/activiste : quelle place faut-il laisser au corps, à la sensibilité, à l’écoute, au soin par et pour le groupe dans les luttes ? Les luttes oppositionnelles, frontales, peuvent-elles se soustraire à la prise en compte les besoins fondamentaux de celleux qui consacrent de leur temps à cette lutte17 ?
Lire aussi sur Terrestres : Ariel Salleh, « Pour une politique écoféministe », mai 2024.
Esthétique et ontologie relationnelle
La proposition esthétique qui sous-tend tout l’ouvrage est pertinente. Il s’agit en effet de se tourner du côté d’un certain nombre de pratiques artistiques, chorégraphiques, somatiques, qui n’ont pas pour enjeu premier leur mise en spectacle – quoi que cela puisse être un moyen pour faire connaître ces pratiques. Ce n’est pas ici le regard et l’imagination qui contribuent seulement au plaisir esthétique, reposant sur l’action d’autrui, ou sur un paysage, mais bien une invitation à se laisser mobiliser soi-même afin d’éprouver autrement le monde. C’est une sorte de petite révolution, au sens d’un tour sur soi-même : plutôt que de projeter au-devant et en-dehors de soi ses aptitudes sensorielles, il s’agit de les retourner vers soi-même afin de faire une expérience alternative du monde et d’autrui.
Emma Bigé décrit de nombreuses facettes de cette proposition qu’elle connaît fort bien, étant elle-même praticienne de la danse, des somatiques, et philosophe du mouvement vécu-senti. Le concept d’« hapticalité », qui désigne la double capacité à toucher/être touchée dans un contact peau à peau, mais aussi par le regard ou l’écoute, est repris et employé par l’autrice à travers une approche décoloniale (comme celle des textes de Suely Rolnik et Fred Moten).
Il s’agit de se tourner vers des pratiques artistiques, chorégraphiques ou somatiques qui n’ont pas pour enjeu premier leur mise en spectacle, pour se laisser mobiliser soi-même afin d’éprouver autrement le monde.
Toutefois, l’une des matrices de ce concept est aussi la psychanalyse transitionnelle qui s’intéresse à la construction du sujet en relation avec son environnement (Winnicott18 ou Didier Anzieu), et notamment à l’importance du care, du soutien de l’environnement (par exemple des parents) au sujet. Cette approche psychanalytique, que certains travaux d’études en danse mobilisent, n’est jamais mentionnée dans le livre. Cela se comprend dans la mesure où l’enquête cherche à articuler les références activistes, critiques et somatiques, mais cela interroge aussi, car la dimension esthétique et éthique de l’hapticalité est développée du côté de la psychanalyse, et pourrait tout à fait soutenir l’argumentaire de l’autrice.
La proposition d’ontologie relationnelle, notamment inspirée d’Erin Manning, opère avec une certaine efficacité. Non seulement cette proposition est conceptualisée depuis la danse et à propos de la danse, mais en outre les illustrations choisies par l’autrice permettent d’imaginer leurs traductions somatiques et chorégraphiques (par exemple avec l’invitation à la Petite danse). Le principe relationnel selon lequel la relation préexiste aux entités et surtout aux identités devient donc concret. Les mouvementements prennent corps dans l’écriture comme à la lecture.
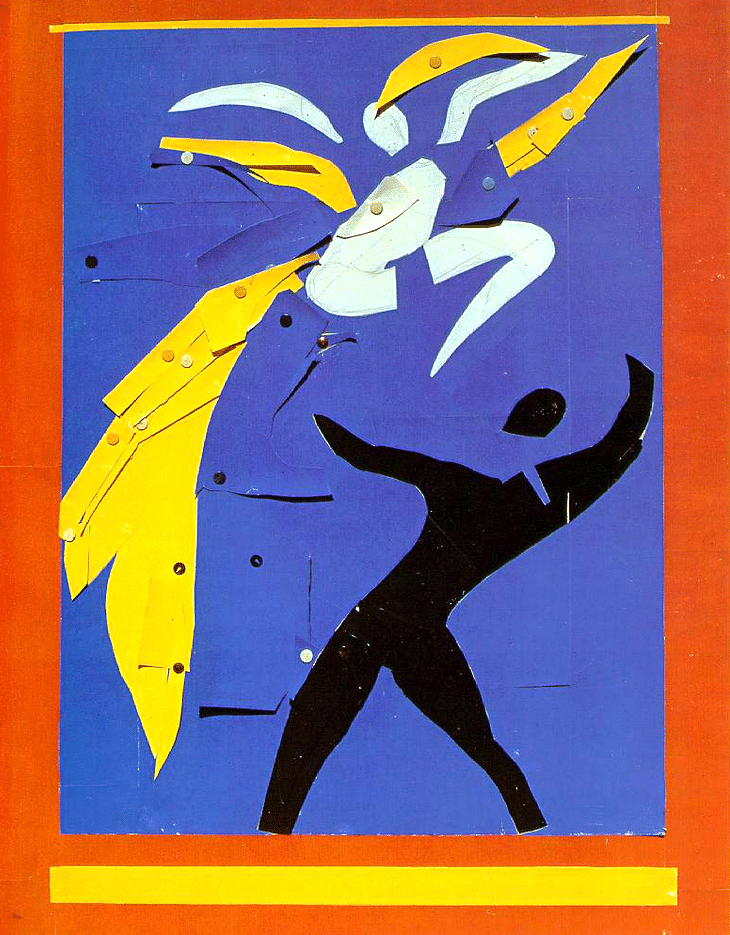
Cela dit, sur le plan conceptuel, la proposition ontologique n’est que partiellement développée et articulée à d’autres pensées relationnelles écologiques (qu’elles traitent d’art, de politique ou de sciences), pourtant nombreuses chez les philosophes actuel·les. Par exemple, en philosophie esthétique, Arnold Berleant propose à travers l’« esthétique environnementale » une approche singulière : défaisant l’articulation fréquente entre l’art et l’objet d’art, il s’intéresse à la relation sensible que tout sujet peut déployer avec son environnement. Du côté de la philosophie d’Isabelle Stengers, la relationnalité est particulièrement abordée dans l’un de ses derniers ouvrages consacrés à la métaphysique de Whitehead (Réactiver le sens commun). Elle y traite de l’usage possible de la voie médiane (moyenne) dans différentes formes d’associations et de la co-transformation des êtres concernés qui peut s’en suivre. Par exemple, dans le cadre d’une enquête en sciences sociales, quelles sont les alliances mises en place et comment fonctionnent-elles ? Comment est-ce que les groupes de pratiques artistiques s’organisent concrètement entre eux ? Autant de questions que l’on a envie de poser à Emma Bigé : comment a-t-elle concrètement mené son enquête, à travers quels modes de relations ? Et comment les danseuses et praticiennes somatiques à propos desquelles/depuis lesquelles elle mène sa réflexion s’organisent-elles matériellement, symboliquement, pour constituer cette forme de vie particulière qui articule l’art et l’activisme ?
On peut enfin penser au géographe et philosophe Augustin Berque qui depuis les années 1980 travaille sur une articulation non dualiste de la subjectivité et de l’objectivité, de la phénoménologie et de l’écologie. Il s‘intéresse notamment à la possibilité pour l’environnement d’être prédiqué (interprété) par le sujet percevant, et les sociétés dont il est issu, sans effacer sa base terrestre, dans une spirale dite « trajective ». Il fait pour cela une place de choix aux logiques non occidentales et aux ontologies associées.
La quasi absence de référence aux travaux de Berleant, Stengers et de Berque peut étonner, dans la mesure où ces auteur·ices évoquent à la fois des questions esthétiques, écologiques, et politiques.
Lire aussi sur Terrestres : Ana Minski, « La buveuse d’ombre », octobre 2019.
Une phénoménologie pratique
Les Mouvementements ne laissent pas indemnes, ils invitent à s’émouvoir autant qu’à explorer de nouveaux gestes. L’écriture généreuse permet de plonger, parfois presque en pratique, dans quelques expérimentations somatiques, comme lorsqu’Emma Bigé cite le texte de la « Petite Danse » ou encore la « pratique de deuil » proposée par la danseuse Olive Bieringa, « DECOMPOSITION A CIEL OUVERT19 […] ». L’écriture elle-même semble portée par la voie médiane, et rend la lectrice bougeuse/bougée. Les références nombreuses, issues de courants de pensées/pratiques fort différents, font l’objet d’un agencement original et donnent matière à repenser notre rapport au mouvement dans ses dimensions écopolitiques. En outre, bien que l’écriture soit fluide, et emprunte parfois le ton du récit, la méthode structure bel et bien toute l’enquête. Socialisée aux épistémologies phénoménologiques par ses études philosophiques, l’autrice s’emploie en effet clairement à une phénoménologie pratique. Elle cherche 1) à suspendre les préjugés habituels quant au mouvement, 2) en s’attachant à la description de pratiques de danses relativement marginales, et 3) en « pistant » ce qui favorise l’affleurement des « mouvementements » à travers chaque proposition somatique étudiée. Ces trois traits de la méthode font également écho à l’appel de Nathalie Depraz, pour une « pratique concrète de la phénoménologie20 ».
Toutefois, la méthode phénoménologique s’est depuis quelques années déployée hors de la philosophie : la psycho-phénoménologie en est un exemple. Développée par Pierre Vermersch et le GREX (Groupe de recherche en explicitation), cette dernière permet d’opérer un passage de la philosophie à l’enquête en sciences sociales, grâce à l’entretien d’explicitation. C’est un dispositif relationnel d’entretien qui permet de soutenir l’évocation puis la verbalisation descriptive du vécu. À quoi pourraient ressembler les descriptions singulières de mouvementements vécus ? On peut déjà goûter à quelques descriptions grâce à l’enquête initiée par les danseuses-chercheuses Catherine Kych et Matthieu Gaudeau21, qui s’intéressent tant aux mots choisis par les membres d’un duo quant à leur vécu de contact improvisation, qu’aux modalités attentionnelles, somatiques issues du contact improvisation qui pourraient faciliter en retour l’entretien d’explicitation. Une enquête par entretiens pourrait tout à fait être menée auprès des praticiennes somactivistes, ou des praticiennes somatiques engagées dans diverses luttes, pour pister autrement les effets de leurs « leçons-en-mouvements ».

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Le contact improvisation consiste en un jeu improvisé, souvent en duo, de transfert de poids opérant de manière continue et souvent jusqu’au déséquilibre à partir d’un point de contact mouvant. Voir R. Bigé, Le partage du mouvement. Une philosophie des gestes avec le Contact Improvisation, thèse en philosophie, Université Paris sciences et lettres, 2017.
- Voir https://cargocollective.com/sharingmovement (avec des articles pour une grande majorité d’entre eux accessibles directement depuis son site).
- « Le mouvement Crip part des acquis du modèle social, et se développe dans les années 2000 surtout aux États-Unis. C’est un mouvement qui critique le premier mouvement des personnes handicapées car il est jugé trop masculin, trop blanc, etc. C’est un mouvement qui cherche à croiser les oppressions, lancé par des femmes, des personnes racisées ou qui ont une sexualité jugée différente de la norme. » : Charlotte Puiseux, « Chacun-e est à la fois valide et handicapé-e à des degrés divers ». Entretien avec Charlotte Puiseux, Contretemps, revue de critique communiste, 2019.
- A. Godfroy, Prendre corps et langue : étude pour une dansité de l’écriture poétique, Paris, Ganse arts et lettres, 2015, cité par Emma Bigé.
- Cette recension a été rédigée en partie suite à la présentation de l’ouvrage par l’autrice au printemps 2024 à la librairie des Modernes à Grenoble. Certaines citations, si elles ne sont pas référencées, proviennent de cette présentation publique.
- B. Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017. Cité par Emma Bigé.
- I. Stengers, Apprendre à bien parler des sciences: la Vierge et le neutrino, Paris, La Découverte, 2023.
- Les pratiques somatiques renvoient au corps vivant et vécu, et désignent également un certain nombre de pratiques développées au cours du 20e siècle avec pour enjeu celui d’appréhender le corps et la santé depuis le ressenti, notamment celui du mouvement, afin de rendre à celleux qui souffrent une autonomie dans la guérison, mais également plus généralement afin d’apprendre à connaître son corps autrement.
- M. Bardet, J. Clavel et I. Ginot, Écosomatiques: penser l’écologie depuis le geste, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2019. Cité par Emma Bigé.
- D. J. Haraway, Vivre avec le trouble, traduction Vivien García, Vaulx-en-Velin, Les Éditions des mondes à faire, 2020. Cité par Emma Bigé.
- F. Moten, In the break: the aesthetics of the Black radical tradition, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003.
- « Tu nages dans la pesanteur depuis le jour où tu es née. Toutes les cellules de ton corps savent où se trouvent le bas. On l’oublie vite. Ta masse et la masse de la Terre s’attirent l’une l’autre. »
- À ce sujet, l’article « Ce qui nous rient de nous toucher » (2021) de Myriam Rabah-Konaté, co-écrit avec Emma Bigé, est tout à fait éclairant.
- L’accord au féminin est généralisé dans l’ouvrage, et explicité au début de ce dernier : toutes les formes d’écriture inclusives sont les bienvenues, tant qu’elles « font bégayer la langue » et la grammaire sexiste qui l’irrigue.
- La « politique du moindre geste » est une expression de la sociologue ethnographe Geneviève Pruvost qui s’intéresse à la dimension politique de la subsistance notamment agricole. (Voir par exemple G. Pruvost, « Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : la politisation du moindre geste », Sociologie du travail, vol. 57, no1, 2015, p. 81-103).
- Écosomatiques, op. cit.
- Voir par exemple l’émission du podcast Avis de tempête consacrée aux groupes affinitaires : « Audioblog – S3 – Épisode Hors série #5 – Former des groupes affinitaires pour les mobilisations à venir – Pour les bassines et au-delà… » (2024), ou bien la prise de position quant aux violences perpétrées lors de la répression à Sainte-Soline en 2023 : Collectif, « Sainte Soline : repenser nos stratégies de lutte depuis une logique d’autonomie et de soin », Terrestres (2023).
- Voir à ce sujet les travaux d’Anne Volvey (2013) en géographie de l’art, ainsi que ceux de C. Leroy et A. P. Preljocaj, Phénoménologie de la danse : de la chair à l’éthique, Paris, Hermann, 2021.
- « Dans les premières heures après ta mort, ton corps, vu du dehors, paraît inchangé. Mais à l’intérieur, tout change. Ton corps commence à refroidir immédiatement. Il n’y a plus de fluide en mouvement pour générer de la chaleur. C’est Algor Mortis. Ta température corporelle chute de deux degrés par heure jusqu’à prendre la même température que l’environnement. Ton corps est une démonstration de la seconde loi de la thermodynamique. Ton sang commence à coaguler. Suivant la loi de la gravité, il tombe en direction du sol, il se dépose dans les cellules qui sont à son contact. […] » (en italique dans le texte).
- N. Depraz, Comprendre la phénoménologie: une pratique concrète, Paris, Armand Colin, 2012.
- M. Gaudeau et C. Kych, « Aller-retours entre Entretien d’Explicitation et Contact Improvisation », Expliciter, no119, 2018.
L’article La puissance du moindre geste : écopolitiques de la danse est apparu en premier sur Terrestres.
28.02.2025 à 12:34
Les conseils des Terrestres #2
La rédaction de Terrestres
Nouvelle livraison des conseils de la rédaction ! Au menu : la SF lunaire de Catherine Dufour, une dystopie des années 20, le pianiste enneigé de Claudie Hunzinger — et l'amie Corinne Morel Darleux en invitée pour nous parler du nouveau roman de Jean Hegland, « Le temps d'après ».
L’article Les conseils des Terrestres #2 est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3201 mots)
Temps de lecture : 8 minutes
Roman · Les Champs de la Lune · Catherine Dufour

Au début des Champs de la Lune, le personnage principal, El-Jarline, cultive patiemment ses plantations sous leur dôme de duraglass, pour nourrir la cité soulunaire de Mut. Chaque jour, elle envoie de brefs rapports techniques sur la situation de la ferme. Cette routine va être perturbée par le téléchargement d’une bibliothèque afin d’améliorer la rédaction de ses rapports, puis par sa rencontre fugace avec Sileqi, une enfant humaine dont l’attention vibrante et délicate va donner corps à cette littérature terrestre qui, sans elle, serait certainement restée lettre morte.
Une androïde habitée par les fantômes de la littérature humaine dans des paysages lunaires hantés par le clair de la Terre, une Terre à jamais perdue, ravagée, inaccessible… Tout dans le dernier roman de Catherine Dufour s’inscrit dans cette délicate dialectique de l’humain et du non-humain, du lunaire et du terrestre, des surfaces où l’on meurt et des profondeurs où l’on survit. Ces tensions circulent aussi entre les êtres, robots et animaux humanisés par le langage, face à des humains qui ont perdu leur monde et avec lui une grande partie d’eux-mêmes, terrés dans des villes souterraines pour échapper aux radiations de la surface.
Cette présence-absence de la Terre fait une grande partie de la puissance poétique et politique du roman : tantôt « petite rognure d’ongle bleue sur l’horizon » lorsque l’on quitte la face cachée de la Lune, tantôt sphère obsédante qui empêche d’oublier tout ce qu’on a perdu. L’écriture de Catherine Dufour cisèle constamment, et non sans humour, ce dialogue de la perte et de l’oubli.
Ainsi de ces robots qui tentent d’imaginer à quoi pouvaient bien ressembler des milliers de pommes rouges, échappées de la cale d’un navire et flottant sur la Seine. Ou de ce vieux marin terrien, réfugié sur la Lune, trimbalant avec lui un respirateur bricolé pour lui donner à sentir des odeurs nostalgiques de pétrole et de « vieux ports goudronneux ». Ou encore de la froide analyse du Gardien des Glaces, aboutissant à l’idée que l’assassinat collectif de l’écosystème terrestre est « le résultat d’une volonté humaine pleine et entière, tendue comme un poignard et guidée par la haine ».
Ici, la Lune n’est jamais le recommencement de la Terre : « la Lune n’est pas une Alma mater » dit El-Jarline. Tous les soins qu’elle apporte à sa ferme-écosystème sont perpétuellement à la merci du vide — de la rupture de cette fissure qui, page après page, s’étend sur le dôme qui protège la ferme Lalande des radiations et de la mort.
Le roman de Dufour est l’inverse de ces space operas qui ne sont souvent que des extensions spatiales d’un impérialisme viriloïde, assuré de la destinée manifeste de l’espèce humaine. Non, s’il fallait trouver une analogie musicale pour qualifier Les Champs de la Lune, ce serait plutôt un space lamento, lent, drôle et poétique, qui jamais ne sous-estime la fragilité de la vie et l’importance des attachements simples contre les aveuglements de la puissance.
Alors que les délires martiens et les folies escapistes d’un Elon Musk vont continuer à avoir une tribune inédite, cette mise au travail de l’imaginaire spatial est politiquement salutaire. D’autant plus lorsqu’elle laisse malgré tout sa place à la rêverie sidérale. Comme dans la Trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, traversée d’une fascination géologique et philosophique pour les paysages martiens, l’écriture de Dufour est habitée par la topographie de la Lune, la beauté de ses cratères et de ses immensités couvertes de régolithe. Une beauté certes captivante, mais la beauté d’un désert — « nu et sans vie dans la splendeur du vide ».
Aurélien Gabriel Cohen
► Les Champs de la Lune de Catherine Dufour, Robert Laffont, « Ailleurs & demain », 2024
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Roman · Les Âmes de feu · Annie Francé-Harrar

Les Âmes de feu, c’est un ouvrage fantastique publié en 1920 par une jeune biologiste allemande, également éprise de poésie, et qui deviendra une grande spécialiste de la science des sols au cours du XXe siècle. Elle publiera après 1945 de nombreux travaux sur la formation de l’humus, le compostage et la préservation des sols, alors même que s’engage la modernisation agricole à l’origine de leurs dégradations.
Son livre est à la fois une utopie et une dystopie, un ouvrage d’anticipation et un jalon oublié, bien que remarquable, dans l’histoire longue de la science-fiction. Salué par la critique à sa sortie avant d’être oublié pour un siècle, il a été récemment redécouvert outre-Rhin. Sa traduction en français est une bonne nouvelle tant l’ouvrage mérite d’intégrer la bibliothèque des Terrestres. Sa lecture nous frappe aujourd’hui par sa force narrative, sa beauté, mais aussi sa lucidité sur la double crise sociopolitique et écologique qui menace un monde artificialisé et industrialisé à l’extrême.
L’ouvrage dépeint un avenir où les humains vivent dans de vastes cités climatisées, ingurgitent de la nourriture artificielle, se déplacent via des petits véhicules dits « autinos », travaillant seulement quelques heures par jour dans ce qui se présente comme le sommet de l’évolution. Les derniers terriens et agriculteurs — les « cabaniers » — sont contraints de rejoindre les villes et de quitter la « nature » pour se fondre dans la « culture ». Pourtant, ce monde de citadins est traversé de névroses : ses habitants, devenus incapables de se mouvoir autrement qu’avec leur prothèse mécanique, ambitionnent de supprimer tout ce qui les relie encore à la terre en se libérant de toute dépendance à l’égard des productions agricoles.
Grâce au pompage massif de l’azote et à celui d’autres matières premières, cette société hyper avancée prépare son propre effondrement sous l’impact conjugué des dérèglements climatiques, de l’assèchement des sols, et de la mort à petit feu de la faune et de la flore. Finalement, l’émergence d’une nouvelle forme biologique étonnante — ces fameuses « âmes de feu » qui donnent son titre au livre — va obliger l’humanité à réinventer une autre relation au monde.
Rédigé il y a plus de cent ans, au lendemain de la boucherie industrielle de 1914-1918, mais avant la grande accélération du milieu du XXe siècle, le livre d’Annie Francé-Harrar peut sembler parfois un peu désuet ou naïf. Mais ces impressions fugaces importent peu tant le livre est passionnant, presque incandescent, car cette même naïveté lui donne aussi sa force et sa complexité. Par son aspiration à la renaissance de l’amour et à la redécouverte des plaisirs simples de la vie, Les Âmes de feu apparait comme un livre certes catastrophiste, mais dans lequel demeure toujours ouverte la possibilité d’une vie au-delà de la barbarie industrialisée.
François Jarrige
► Les Âmes de feu d’Annie Francé-Harrar (traduit de l’allemand par Erwann Perchoc), Belfond, 2024
Roman · Il neige sur le pianiste · Claudie Hunzinger
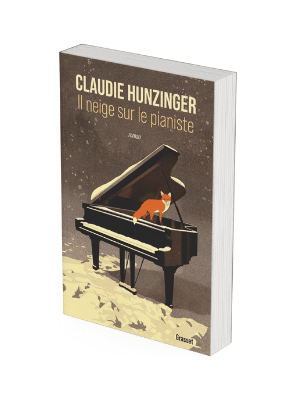
Il neige sur le pianiste est l’histoire d’une captivité. Pendant neuf jours et dix nuits, une vieille femme entichée d’un renard et la neige sa complice retiennent un pianiste virtuose dans une maison au fond des bois.
C’est une histoire de forêt. Comme une allégorie du monde, la forêt qui protège et qui subit. Au loin, les tronçonneuses accomplissent obstinément leur travail de destruction. Et les grumes sont autant de cadavres amputés, dépecés, des morts sans sépulture. Puis soudain, la neige tombe et cesse le fracas des machines. La forêt peut alors se faire entendre, ses chants, ses souffles, ses craquements remplissent à nouveau l’air de vie et de beauté. L’histoire peut commencer.
C’est une histoire de désirs. Des passions brutes, hilares, univoques, ne voulant rien d’autre que leur objet. Désirer le corps endormi du pianiste comme on désire cette aiguillette de poulet laissée pour nous au seuil d’une maison pleine d’offrandes. Insolents, plongés en eux-mêmes plutôt que tendus vers leur assouvissement, des désirs « à sens unique, heureusement. » (p. 125)
C’est une histoire de l’inséparation. Elle nous fait éprouver, en quelques pages, l’évidence de ce que des piles d’essais sur le tournant ontologique, les nouveaux matérialismes ou le panpsychisme radical tentent laborieusement de démontrer. Tout vit, vibre, bruisse, communique, agit. L’empreinte d’un flocon sur la vitre gelée, une fugue de Bach, le corps d’une fourmi ailée, la trace d’un lièvre ou la forme renversée d’une maison d’architecte sont autant de récits enchevêtrés.
C’est une histoire de musique. Elle s’entend plus qu’elle ne se lit. Une histoire qui fredonne, chuchote, crisse et soupire. Les mots se muent en sons et le texte devient partition pour un orchestre fait de tout bois : des voix, des êtres, des choses, le renard le vent la neige le piano l’enfance, la neige encore.
C’est une histoire d’ensauvagement. Où l’on ne sait plus qui est civilisé et qui ne l’est pas, où les doigts d’un musicien s’animent d’une vie autonome, où l’on adresse poliment ses vœux à la lune montante et dans laquelle on met, à l’attention d’un renard farouche, les petits plats dans les grands avant de se vautrer dans l’herbe grasse de la prairie.
C’est une histoire que j’ai envie de relire souvent et d’offrir à tous mes amis ; une histoire qui console et qui enchante, tissée de malice et de mauvais coups ; une folie douce qu’il ne faut pas contrarier. Je ne suis pas dupe. Je sais qu’une fois la neige fondue les tronçonneuses reprendront le massacre. Mais qu’il est bon de respirer la blancheur du silence, et de rire, et de s’émerveiller.
« Il fallait soigner. Encore une fois soigner. Ceux qui ne veulent pas tuer n’en ont pas fini de soigner le monde autour d’eux. C’est comme ça. Il faut nous y faire. » (p. 26)
Virginie Maris
► Il neige sur le pianiste de Claudie Hunzinger, Grasset, 2024
Roman · Le temps d’après · Jean Hegland

Le temps d’après est la suite du roman phare de Jean Hegland Dans la forêt, que je qualifiais en 2018 dans Terrestres de « récit initiatique d’un dessillement ».
Lors de sa sortie tardive en France, vingt ans après sa publication aux Etats-Unis, l’histoire des jeunes sœurs Nell et Eva, condamnés à survivre alors que plus rien – ni ondes, ni personnes, ni biens – ne parvenait du monde extérieur, avait fortement résonné. Les risques d’effondrement civilisationnels étaient sous les feux militants, on était en plein essor de la collapsologie et c’était une expérience saisissante d’évoluer à travers les regards, les doutes et les peurs de Nell et Eva, tant on partageait avec elles le sentiment terrible d’être soudain inadaptées à son milieu de vie, impréparées, incapables de reconnaître les plantes qui soignent et celles qui empoisonnent.
Depuis, si l’écoféminisme, l’agroécologie, la décroissance et la perspective de subsistance ont essaimé, si des chantiers de reprise de savoirs ont éclos en France, si on a vu se multiplier les actes de désarmement et de résistance, l’absurde, la cruauté et le chaos continuent d’étendre leur puissance. La forêt qu’habitait Jean Hegland en Californie a brûlé. Et la notion d’effondrement n’a hélas rien perdu de son acuité.
Le temps d’après se situe quinze ans après l’effondrement. Nell et Eva ont appris à vivre dans, de et avec la forêt. Leur fils Burl est désormais adolescent et c’est par sa voix que l’on va découvrir ce « new next now » — littéralement « nouveau futur maintenant », le titre original du roman. L’idiolecte singulier qu’utilise Burl est d’abord déroutant. C’est le langage d’un enfant né dans la forêt et nourri d’oralité. « Enloques », « seulé », « mots voisés » : sa syntaxe et ses mots sonnent néanmoins familiers et on s’y fond rapidement. J’en profite pour saluer la traduction de Josette Chicheportiche, qui a dû bien s’amuser.
Sur fond de sécheresse, Burl convoque ses souvenirs et nous décrit un quotidien où « inhalants » et « exhalants » co-existent harmonieusement, où l’on ne prélève que ce qui est nécessaire pour subsister et où l’on a appris à se passer du pétrole et de l’électricité. Du moins est-ce le cas de « noutrois », cette entité humaine formée de Burl, Nell et Eva qui a su s’adapter à la forêt, se construisant une « capane », se soignant à l’aide de pavots et lessivant les glands à grande eau avant de les réduire en farine. Car pour ce qui est du reste du monde, hélas, on ne peut en dire autant et le parfum d’enfance qui flotte sur le roman sera traversé d’éclairs de violence.
Le temps d’après est empreint de la candeur et du désir de Burl de rencontrer d’autres gens. De la réticence de ses mères à se frotter de nouveau à cette espèce malfaisante. On y voit sourdre un violent ressentiment à l’égard des générations qui n’ont rien fait pour empêcher le désastre ; et l’espoir, malgré tout, d’une nouvelle humanité.
(Et tout ça donne très envie de lire et relire Dans la forêt.)
Corinne Morel Darleux
► Le temps d’après de Jean Hegland, Gallmeister, 2025
L’article Les conseils des Terrestres #2 est apparu en premier sur Terrestres.
15.10.2024 à 12:22
Subvertir les normes depuis les marges féministes rurales
Fanny Hugues
Dans « Féministes des champs », Constance Rimlinger décrit des communautés écoféministes rurales inventant depuis les campagnes des formes de vie plus soucieuses des vivants humains et non-humains. Le retour à la terre peut-il être un moyen de s’extraire de la domination masculine et de l’exploitation capitaliste ? Possible… mais pas simple.
L’article Subvertir les normes depuis les marges féministes rurales est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9734 mots)
Temps de lecture : 22 minutes
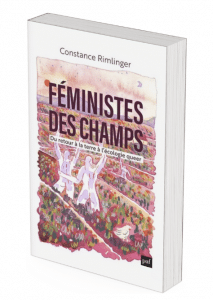
À propos de Féministes des champs. Du retour à la terre à l’écologie queer, de Constance Rimlinger, Presses universitaires de France, 2024.
Depuis les années 1970 dans plusieurs pays occidentaux, des femmes et des minorités de genre opèrent un « retour à la terre1 », qui s’inscrit plus largement dans les vagues d’installations en collectif rural observées par exemple en France après Mai 68. Ces personnes quittent leurs logements et leurs modes de vie urbains pour co-fonder ou rejoindre des lieux de vie à la campagne.
Dans son livre Féministes des champs, qui porte sur ces mobilités résidentielles politisées, la sociologue Constance Rimlinger explique qu’il s’agit de se réapproprier l’espace rural « en vue de valoriser un milieu vivant et d’opérer une (re)connexion à la terre, aussi bien d’ordre sensible et/ou spirituelle que matérielle2 ». Ces personnes présentent tout de même des spécificités : en quittant les villes, elles souhaitent autant « s’émanciper de l’hétéropatriarcat » qu’« élaborer un autre rapport à l’environnement3 » en se reconnectant à la « nature » et aux activités de subsistance.
Si les démarches de ces « féministes des champs » peuvent à première vue sembler homogènes, les motivations, modalités organisationnelles et positions respectives sont en réalité diverses au sein de la « nébuleuse écoféministe4 » identifiée par Constance Rimlinger dans son ouvrage.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Entre 2015 et 2021, Constance Rimlinger s’est attachée à explorer un « angle mort de la recherche sur le retour à la terre5 » qui a, jusque-là en France, laissé de côté les alternatives rurales portées par des personnes féministes et non hétérosexuelles. En effet, au croisement de la sociologie rurale, de la sociologie des mouvements sociaux et de la sociologie du genre et des sexualités, cette enquête ouvre les travaux français portant sur les alternatives rurales depuis les années 19806 à leurs marges lesbiennes et queers. L’originalité et la force de la démarche de Constance Rimlinger résident dans ses choix théoriques et méthodologiques.

Les sept terrains choisis par la sociologue se situent sur les trois continents qui ont accueilli un retour à la terre lesbien séparatiste depuis les années 1970 : les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France.
Les Women’s Land états-uniens voient le jour à cette époque dans un contexte de guerre froide, de peur d’une apocalypse nucléaire, de considérations écologiques émergentes et de remise en cause du capitalisme7. Des lesbiennes cherchent alors à opérer un retour à la terre (back-to-the-land-movement) de manière séparatiste, c’est-à-dire sans homme cisgenre8, en s’inspirant de la pensée féministe radicale et du lesbianisme politique alors en plein essor, selon lesquels le meilleur moyen de lutter contre le système patriarcal est de s’organiser entre femmes. Il ne s’agit pas uniquement de fuir le patriarcat, mais également de se réfugier dans un lieu protecteur – identifié comme rural, car en connexion avec la terre associée à la figure de la mère – et d’inventer une culture lesbienne9.
Ces initiatives s’étendent progressivement en Europe – particulièrement, pour la France, en Ariège et en Ardèche – et en Nouvelle-Zélande, au gré des voyages des un·e·s et des autres, et de la circulation de leurs idées à partir de créations artistiques et de publications littéraires. Or, après une période culminante au début des années 1990 au cours de laquelle Constance Rimlinger dénombre une centaine de lieux (dont 80 aux États-Unis), beaucoup de ces initiatives disparaissent. L’importance du travail de la chercheuse réside ainsi dans la redécouverte de ces initiatives tombées en désuétude, à travers l’identification de leurs points communs et de leurs singularités. Elle rappelle qu’ont existé et perdurent toujours des initiatives écoféministes en France, malgré une « réception manquée10 » dans les années 1970 par rapport aux pays anglo-saxons.
Constance Rimlinger dresse un panorama de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante.
Le terme d’« écoféminisme », qui connaît un regain d’intérêt en France depuis 201511, apparaît pour la première fois sous la plume de Françoise d’Eaubonne en 1972. Il désigne la « tentative de synthèse entre deux combats qu’on avait jusqu’alors envisagés comme séparés, celui du féminisme et celui de l’écologie », que celle-ci observe dans les pays des Suds (dénonciation du néo-colonialisme et de l’extractivisme, défense des pratiques de subsistance), comme du Nord (lutte anti-nucléaire dans laquelle elle s’engage)12.
Lire aussi sur Terrestres : Myriam Bahaffou, « Gouines des champs : expérimenter l’éco-féminisme par la non-mixité », octobre 2022.
Aujourd’hui, deux approches de l’écoféminisme existent en parallèle dans le monde académique : certains travaux de philosophie en proposent des approches théoriques et plutôt abstraites, quand d’autres, anthropologiques et sociologiques, s’appuient sur des enquêtes de terrain et des données empiriques.
Quoi qu’il en soit, l’écoféminisme académique tel qu’il se déploie dans les cercles intellectuels se distancie de l’écoféminisme tel qu’il s’éprouve et s’expérimente dans des groupes militants ou dans des manières concrètes de vivre. Face à ces tensions, Constance Rimlinger parvient à dresser un panorama très convainquant de l’écoféminisme contemporain dont la principale caractéristique est d’être en évolution constante. Sa démarche empirique est d’autant plus bienvenue qu’elle adhère au point de vue selon lequel les luttes écoféministes ne sont pas « hors sol », mais « s’inscrivent dans des territoires, dans un rapport matériel, affectif, parfois spirituel à la terre, à des terres13 ».
Les initiatives écoféministes recensées par Constance Rimlinger ne s’en tiennent pas à la non-mixité et à la construction d’une culture de femmes, comme dans le cas des terres de femmes séparatistes des années 1970, mais intègrent davantage les questions d’intersectionnalité et de genre, tout en prenant en compte les autres qu’humains. Elles se répartissent sur un continuum : la chercheuse propose d’étudier les différences et similarités entre trois configurations écoféministes.
Cette élaboration théorique se fonde sur une enquête multi-située et comparative, qui repose elle-même sur une diversité d’initiatives que Constance Rimlinger qualifie d’écoféministes, malgré le fait que leurs actrices ne s’en revendiquent pas forcément.
Cerner les contours de la nébuleuse écoféministe rurale
D’une terre de femmes aux États-Unis à un sanctuaire végan en Nouvelle-Zélande, en passant par une ferme en permaculture en Bretagne : si l’exploration des parcours et expériences de vie rurales à distance de l’hétéronormativité est vaste, ces initiatives ont des traits communs. Au quotidien, elles articulent « un projet féministe et un projet écologiste14 » et partagent une même visée politique : s’émanciper des normes dominantes en matière de genre et de sexualité, de travail, de consommation, et de rapport à la « nature » et aux autres qu’humains. Leurs habitant·e·s ont également un profil social homogène en étant originaires des classes moyennes-supérieures, blanc·he·s et diplômé·e·s du supérieur.
Dans les années 1970 apparaissent des terres de femmes, lieux de vie non-mixtes pour se reconstruire suite à la violence patriarcale et se connecter spirituellement à la terre.
Cependant, ces initiatives écoféministes présentent des différences. À ce titre, Constance Rimlinger identifie trois configurations, la première étant légèrement antérieure aux deux suivantes. Celles-ci sont traversées par des lignes de clivage, comme l’intégration ou l’exclusion des personnes trans, le rapport au véganisme, ainsi que leurs visions féministes de la « nature ». Si les deux premières configurations ont pour priorité d’offrir un accès à la terre à distance des hommes cisgenres hétérosexuels et de sensibiliser des personnes féministes, lesbiennes ou queers à l’écologie, la troisième est surtout fondée sur un projet de vie écologiste et décroissant.
La chercheuse nous met tout de même en garde : ces configurations visent moins à « réifier en des catégories statistiques des agencements ponctuels et mouvants15 », qu’à rendre compte de « la pluralité des manières d’être écoféministe et d’articuler au quotidien plusieurs engagements16 ».

La première configuration est définie comme « séparatiste différentialiste ». Dans les années 1970 aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, des lesbiennes décident de créer des terres de femmes. Ce sont des lieux de vie non mixtes marqués par l’amour libre, des célébrations et des pratiques artistiques, qui leur permettent de se reconstruire autour d’une culture sororale suite à la violence patriarcale causée à leur égard par des hommes de leur entourage, et de se connecter spirituellement à la terre.
Deux de ces terres de femmes sont concernées dans l’ouvrage : We’Moon Land dans l’Oregon et la communauté Earthspirit en Nouvelle-Zélande. Dans la première, on trouve par exemple Suzie, âgée d’une soixantaine d’années, qui y vit depuis 4 ans, ou encore Marie et Sky, deux jeunes trentenaires en couple. Dans la seconde, on rencontre Arafelle, née en 1944, ergothérapeute de profession. Elle décide de fonder une terre de femmes dans les années 1970 après avoir rencontré Nut, avec laquelle elle entame une relation amoureuse. Après plusieurs mois de recherche, elles acquièrent un terrain au cours d’une enchère publique, où se trouve une maison, entouré de forêts et traversé par un ruisseau. Les visiteuses – qui pour certaines s’installent rapidement – affluent après quelques annonces placées dans des revues lesbiennes et la visite d’Allemandes depuis lesquelles se déploie un bouche-à-oreille. Cependant, au cours des dernières années, le flot de visiteuses s’est considérablement réduit.
Ensuite, la sociologue définit la « configuration queer intersectionnelle ». De manière plus récente, en France et en Nouvelle-Zélande, des personnes queers s’installent à la campagne à proximité de grandes villes et organisent leurs modes de vie à partir d’une approche féministe intersectionnelle qui se nourrit d’une sensibilité anarchiste, anticapitaliste, antiraciste, antipsychiatrique et d’une critique du système policier.
Il ne s’agit pas ici d’adopter une stricte optique séparatiste, car les catégories de genre binaires sont questionnées, de même que les femmes et les hommes trans sont acceptés. C’est le cas de la Ferme des Paresseuses, en Saône-et-Loire, et du sanctuaire végane Black Sheep, en Nouvelle-Zélande, construit autour d’une association de protection des animaux. Sezig et Maya habitent la première. En 2012, la mère de Sezig ne veut plus vivre dans le vieux corps de ferme chargé de souvenirs de son compagnon décédé, et donne les clés à sa fille de 36 ans. Celle-ci débute une formation en maraîchage et décide d’en faire un lieu collectif, pour son réseau amical lyonnais, mais les visites sont ponctuelles.
Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural.
À la même période, Maya arrive dans le coin pour rejoindre l’éco-lieu de son frère en construction. Les deux lesbiennes finissent par se rencontrer, et la seconde emménage chez la première. Chacune possède son espace personnel : Maya dort dans la grange, et Sezig dans un mobile-home. Elles vendent quelques légumes et un peu de pain, mais elles subsistent surtout grâce au RSA de Sezik et au petit héritage que Maya a reçu suite au décès de sa mère.
Enfin, Constance Rimlinger construit la « configuration holistique intégrationniste ». En France, des lesbiennes et queers valorisent moins leur appartenance identitaire et féministe que la dimension écologiste de leur mode de vie, proche de la terre et déployé dans des collectifs mixtes, caractérisé par une alimentation saine cultivée chez soi, la médecine alternative et l’exploration de la parentalité positive.
C’est le cas de la Ferme des Roches, en Charente, qui met en œuvre plusieurs activités de permaculture, et des Jardins de Colette à la lisière de l’Indre et de la Creuse. Ces derniers sont tenus par Margaret, qui a quitté l’Angleterre il y a trente ans pour s’installer dans ce hameau. Durant ses études, elle réalise qu’elle ne veut pas d’un emploi salarié et qu’elle souhaite travailler au grand air. Son diplôme en poche, elle part voyager avec sa compagne de l’époque. Son père, ingénieur civil, accepte de lui prêter de l’argent et, célibataire, elle se lance seule dans la recherche d’une terre : elle se rend en Creuse, le foncier y étant peu cher et les terres supposément peu polluées. Elle s’installe et fonde les Jardins de Colette en 1990, en référence à l’écrivaine qu’elle estime. Elle tire ses revenus de l’accueil de stages artistiques et de bien-être, et de la vente de sirops, tisanes et autres produits qu’elle produit à partir de ses plantations en permaculture.
Par contraste, la ferme des Roches est un projet de couple : celui de Vanessa et Charlie, deux trentenaires ayant acheté une vielle ferme charentaise à rénover en 2015. Iels y développent maintenant des activités mêlant permaculture, thérapie et écoconstruction.
Vivre et vieillir en féministe rurale
Toutes les initiatives explorées se rejoignent sur le souhait de vivre en collectif féministe sans homme cisgenre en milieu rural. En effet, les lieux de vie créés constituent un « refuge » et un « espace de mise à l’abri » pour ces « personnes affectées par le système patriarcal, que ce soit en tant que femme ou en tant que personnes ayant une identité minoritaire17 ».
La « configuration différentialiste séparatiste » met particulièrement l’accent sur cette hospitalité à l’égard de celles qui sont menacées, psychologiquement et/ou physiquement, par les oppressions de genre et de sexualité. C’est par exemple le cas de plusieurs femmes des communautés We’Mon Land et Earthspirit, qui s’y sont réfugiées pour quitter des conjoints violents ou des pères incestueux.

Par ailleurs, ces écoféministes prennent la clé des champs en s’émancipant du couple hétérosexuel monogame et de la famille nucléaire, qui constituent les principales armes du patriarcat pour les féministes matérialistes18, et du capitalisme pour les féministes de la subsistance19. Il s’agit donc de repenser les liens amoureux, en laissant libre cours à des expériences polyamoureuses et en essayant de maintenir des relations saines, voire amicales, avec des anciennes amantes.
Les écoféministes des campagnes cherchent également à « échapper à la vision masculine » en s’offrant « un espace de vie et d’expérimentation préservé de regards qui jaugent, évaluent, sexualisent et, in fine, dépossèdent20 ». Pour cela, ces personnes renversent les normes de genre et la dichotomie entre le féminin et le masculin, par des transgressions vestimentaires et corporelles – ne pas s’épiler, ne pas porter de soutien-gorge tout en étant assignée au genre féminin –, et subvertissent la division sexuée du travail. Iels apprennent à manier des outils, en faisant les travaux par elleux-mêmes ou en organisant des chantiers collectifs sans homme cisgenre.
Faire ensemble permet d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante.
À la ferme des Paresseuses, Constance Rimlinger assiste à un chantier en non-mixité « meufs trans gouines » ayant pour ambition de pailler le potager et de préparer des semis. Joyce, l’un·e des participant·e·s, lui explique que le fait qu’il n’y ait pas d’hommes cisgenres qui, sinon, « essaient de porter toutes les choses lourdes ou de faire toutes les tâches physiques », lui offre « l’opportunité d’essayer ces choses et d’apprendre21 ».
Margaret, des Jardins de Colette, raconte également à la chercheuse la manière dont elle a enseigné à une visiteuse à se servir d’une tronçonneuse, alors que son conjoint n’adoptait aucune posture pédagogue, ce qui lui a permis de sortir momentanément du rôle et des activités associés à son genre.
Ce « climat propice à l’apprentissage22 » favorise ainsi l’acquisition de nouvelles compétences et la confiance en soi, dans le bricolage comme aux champs. L’accent est mis sur le faire : faire ensemble permet de confronter ses peurs et d’expérimenter de nouvelles manières de travailler, de s’aimer, d’éduquer des enfants, tout en incarnant des sources d’inspiration pour celleux encore inséré·e·s dans la société dominante. Il s’agit en effet de faire essaimer ces initiatives parmi celleux qui seraient susceptibles de pouvoir les rejoindre, par des œuvres artistiques, ou bien par le biais de sociabilités urbaines qui restent importantes pour les membres de la « configuration queer intersectionnelle ».
Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Azam, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », mai 2023.
Les modes de vie écoféministes ruraux sont orientés vers la subsistance, soit la réponse à ses propres besoins et à ceux du collectif par des activités productives, sans recourir à la sphère marchande et sans chercher le profit économique. Chez Maya et Sezik de la ferme des Paresseuses, par exemple, les productions de fruits, de légumes et de pain « sont avant tout destiné[es] à l’autoconsommation par les habitantes et les visiteuses », et permettent – en second lieu – « de dégager quelques revenus23 ».
Les écoféministes plantent et récoltent, élèvent des animaux (non pour les consommer mais pour leur aide au travail des champs), cuisinent, font leur bois, récupèrent des denrées alimentaires et des matériaux, construisent et rénovent leurs lieux de vie. Ces espaces domestiques, élargis aux terrains, jardins, champs et forêts alentours, octroient une sécurité matérielle aux féministes des champs, qui sont propriétaires de leurs lieux de vie. Cette sécurité peut même s’étendre à d’autres collectifs féministes, lorsqu’il s’agit par exemple de stocker le matériel encombrant de militant·e·s urbain·e·s.
Ce travail de subsistance s’adosse à la remise en question de la place prépondérante du travail rémunéré – souvent salarié – dans les quotidiens. Si Constance Rimlinger ne documente pas précisément les revenus qui permettent à ces écoféministes de subvenir à leurs besoins – d’autant plus que leurs projets professionnels ne sont pas élaborés pour être rentables –, on comprend qu’elles vivent avec le peu d’argent que procurent les minimas sociaux et/ou la vente d’une partie de leur production.
Les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible ».
Les lieux étant généralement hérités ou achetés en collectif sans recours au crédit, diminuer leur consommation leur permet de réduire leur temps de travail contre rémunération. La recherche d’émancipation et la réappropriation de son travail – rejet de la subordination, polyactivité – et de son temps, ralenti et calqué sur les rythmes naturels à l’image de la ferme des « Paresseuses » présentée dans l’ouvrage, s’appuient sur des expérimentations incessantes. Le quotidien de Vanessa, 31 ans, habitante de la ferme des Roches, s’articule ainsi entre activités rémunératrices liées à un travail indépendant (consultations ayurvédiques), activités de subsistance, et activités à la frontière entre les deux – plantation d’arbres ou élaboration de confitures et de conserves pour l’auto-consommation et la vente commerciale.
La permaculture et la biodynamie, particulièrement mises en œuvre dans les lieux appartenant à la configuration « holistique intégrationniste », reflètent les tentatives et recommencements au cœur des modes de vie écoféministes. À la ferme des Roches ou à Moulin Coz, un calendrier lunaire est consulté afin de déterminer le programme au jardin des jours à venir. Dans les Jardins de Colette, Margaret se décrit comme une personne qui « crée et dessine des jardins » : on y trouve un potager en forme d’étoile, ou encore un labyrinthe de pierres qui symbolise « la vie où l’on avance, malgré les détours24 ».
Ce sont en effet dans les trois initiatives françaises qui composent cette configuration – le Moulin Coz, les Jardins de Colette et la ferme des Roches – que s’expérimente de la manière la plus aboutie un mode de vie écologique décroissant « où les logiques du salariat et de la consommation sont déconstruites25 ». De la construction des habitats en terre-paille à l’alimentation locale végétarienne voire végétalienne, en passant par la mise en place de toilettes sèches, la récupération de nourriture, d’eau et d’objets, le bricolage, et la présence d’une éolienne : les féministes des champs sont mu·e·s par le souhait de « minimiser leur part dans le désastre écologique et de montrer qu’un autre quotidien est possible26 ».
À Moulin Coz, par exemple, l’ensemble du bâti est constitué d’habitats légers – caravanes, cabanes, roulottes. Le seul bâtiment en dur est une yourte construite grâce à une ossature en bois, isolée avec un mélange terre-paille et chauffée grâce à un poêle à bois, et on y trouve des toilettes sèches. Six panneaux solaires et une éolienne fournissent une grande partie de l’énergie domestique, et de grandes cuves accueillent l’eau de pluie. La récupération et le bricolage sont privilégiés.
Les positionnements des écoféministes font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer ».
En outre, ces engagements féministes et écologistes ruraux sont uniformément caractérisés par le soin à l’égard de l’environnement – de la terre, des animaux, des plantes. Vivre sur un lieu rural à soi, c’est le protéger de l’exploitation agricole intensive en limitant les pressions productives qui y sont exercées. C’est également préserver les semences que l’on récupère d’une année à l’autre et qui assurent le renouvellement, voire l’enrichissement, de la biodiversité. C’est enfin « vivre avec les animaux27 » qui, avec les plantes, constituent des « espèces compagnes28 » avec lesquelles ces écoféministes cohabitent, et qui nécessitent de l’attention.
À Moulin Coz, Simone valorise beaucoup la « nature » et la « diversité » des fruits et légumes qui existent – « petites », « gros », « tordus », « de toutes les couleurs29 ». A We’Moon Land, Vicki, 70 ans, dispose des coupelles d’eau destinées aux insectes et aux petits animaux lors des périodes de fortes chaleurs. L’herbe y est fauchée de manière irrégulière afin de laisser des abris et des couloirs aux animaux. À Moulin Coz, Morgane s’attarde sur le comportement de chacune des truies, qu’elle nomme – Séraphine et Philomène – et admire leur intelligence.

Bien que ces écoféministes ne s’en réclament pas, leurs positionnements font écho aux éthiques du care : elles cherchent à « maintenir », « perpétuer » et « réparer30 » leur monde. C’est ainsi un engagement politique discret et quotidien du « moindre geste31 » qu’expérimentent ces féministes rurales, à distance des « formes les plus instituées de l’engagement32 », a fortiori urbaines, et que seule l’immersion ethnographique au sein des alternatives rurales mise en œuvre dans cette enquête est en mesure de saisir.
Lutter contre une pluralité de rapports de pouvoir ?
Les féministes des champs cherchent à lutter contre les rapports de pouvoir, essentiellement de genre et à l’égard de l’environnement, mais aussi contre le racisme, le colonialisme, le validisme et la transphobie pour celleux qui appartiennent à la configuration « queer intersectionnelle » et reconnaissent l’intersection des discriminations systémiques. Ces positionnements peuvent cependant dissimuler la reproduction de rapports de pouvoir à l’intérieur, comme à l’extérieur, de ces lieux de vie.
D’une part, comme le souligne Constance Rimlinger, ces collectifs sont principalement composés de femmes et minorités de genre blanches, issues des classes moyennes-supérieures et diplômées. Si des pistes sont ouvertes au sein de certains lieux, comme la possibilité d’instituer une propriété collective ou de mettre en commun les ressources, les femmes et queers racisé·e·s, souvent précaires au vu de l’entrelacement des enjeux de race et de classe, ont moins de chance de venir s’installer dans ces lieux. Ces rapports de pouvoir sont relativement impensés à l’échelle de ces initiatives, essentiellement centrées sur le rejet de l’hétéropatriarcat.
Lire aussi sur Terrestres : Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.
De même, les initiatives relevant de la « configuration différentialiste séparatiste » reposent sur l’exclusion des personnes trans, et donc sur une transphobie en acte, questionnée par les habitantes, mais toujours à l’œuvre au moment de l’enquête. Par ailleurs, plusieurs de ces collectifs sont fondés sur l’accueil de volontaires (wwoofers), ce qui soulève la question du travail gratuit et d’une certaine forme de domination économique lorsque les hôtes doivent travailler pour participer à construire et améliorer un lieu qu’iels ne possèdent pas et sur lequel iels ne sont pas amené·e·s à vivre sur le long terme.
Se retrouver entre personnes minorisées peut cependant entraîner le rejet de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences.
D’autre, part, ces lieux de vie à l’abri de la domination patriarcale peuvent se transformer en « entre-soi33 ». C’est particulièrement le cas des initiatives appartenant aux configurations « différentialiste séparatiste » et « queer intersectionnelle » qui n’investissent pas, ou peu, les relations avec leur voisinage, et sont peu ancrées localement. À partir de ces constats posés par la chercheuse, on peut alors se demander si ces initiatives, si attentives à l’abolition des rapports de pouvoir en leur sein, ne participent pas à reproduire des rapports de classe dans leur espace social localisé34.
En effet, le souhait, légitime, de se retrouver entre personnes minorisées peut entraîner le rejet, involontaire ou par souci de distinction, de celles et ceux qui n’auraient pas les codes symboliques ou les ressources matérielles adéquats pour rejoindre ces expériences, même lorsqu’elles sont géographiquement très proches.
Constance Rimlinger souligne bien la tension inhérente à certaines initiatives, entre la volonté de faire essaimer ses idées et sa démarche en assumant une présence locale, et celle de cultiver un entre-soi féministe et protecteur. Les contacts réduits avec la population locale, appartenant souvent aux classes populaires, se fondent davantage sur des préjugés que sur des actes concrets, car il est bien stipulé qu’aucune des personnes rencontrées n’a jamais « subi d’acte d’intimidation, de menace ou de violence35 » de la part du voisinage.
En contraste avec les deux premières, la configuration « holistique intégrationniste » se fonde sur un fort ancrage local. Celui-ci s’incarne dans une multitude d’échanges non marchands – trocs, prêts, dons – entre personnes ouvertement engagées dans la cause écologiste – néo-paysan·ne·s, associations permacoles, AMAP, réseau d’agriculteurs et agricultrices bio –, davantage qu’avec les gens du coin. C’est le cas de Margaret des Jardins de Colette : arrivée sans connaître personne sur place il y a plus de trente ans, elle est désormais fortement ancrée localement dans un petit groupe informel d’entraide composé d « néoruraux ». C’est également le cas de Vanessa et Charlie de la ferme des Roches, qui, doté·e·s d’un capital culturel élevé et d’un capital militant constitué en milieu urbain, ont cherché à s’intégrer localement, en nouant notamment des liens amicaux avec des jeunes « néoruraux » du coin.
Ces modes de vie sont doublement marginalisés : parce qu’en milieu rural et parce que portés par des femmes et des minorités de genre.
On retrouve alors une tendance déjà mise en exergue par des travaux de sociologie rurale : l’engagement écologiste de personnes économiquement et/ou culturellement bien dotées peut participer à l’entretien d’un entre-soi petit-bourgeois36, a fortiori quand il se mêle à un engagement féministe d’origine urbaine adossé à une culture politique.
Visibiliser les alternatives écologiques et féministes rurales sans les idéaliser
Ce n’est ni un portrait romantisé, ni une analyse idéalisée de ces initiatives que propose Constance Rimlinger. Le propos est plus fin, car s’il présente leur potentiel émancipateur et politique en plein cœur d’une crise écologique et sociale sans précédent, il ne néglige pas leurs ornières. À ce titre, l’ouvrage pose avec brio toutes les questions qui ont traversé et traversent toujours les écoféminismes ruraux, et qui sont plus largement celles des personnes qui cherchent à s’extirper de la société capitaliste, bourgeoise, écocidaire, (post)coloniale, raciste, sexiste et validiste. Or, si les personnes qui portent ces initiatives cherchent à abolir une pluralité de rapports de pouvoir, elles semblent toutefois ne pas toujours faire preuve d’une réflexivité suffisante quant à l’homogénéité sociale de leurs collectifs.
À la différence de certains mouvements politiques et milieux militants féministes ou écologistes, qui privilégient la lutte contre le patriarcat d’un côté, et la lutte contre la destruction de l’environnement de l’autre, ces écoféministes tentent de faire converger les luttes, considérées comme profondément interconnectées, même si leurs privilèges sociaux peuvent parfois les aveugler.

La force de l’ouvrage de Constance Rimlinger est d’étudier conjointement des modes de vie écoféministes ruraux répartis sur trois continents, qui sont doublement marginalisés, parce qu’en milieu rural et parce que portés par des femmes et des minorités de genre. En partant de ces marges féministes et écologistes rurales – « la minorité au sein de la minorité37 » –, l’autrice explore le potentiel politique transformateur du quotidien en train de se faire. Ainsi, la portée de l’ouvrage est tout autant scientifique que politique. C’est à partir de l’« espace de la cause38 » écoféministe élaboré en son sein que l’on peut plus largement se demander comment construire des mondes ruraux féministes et écologistes totalement inclusifs, à partir de leurs marges queer. La typologie proposée éclaire dès lors des questions politiques centrales, particulièrement incarnées dans deux points abordés dans l’ouvrage, qui mériteraient d’être explorés plus encore.
D’une part, face à la visibilisation médiatique accrue des personnes trans ces dernières années, qui s’accompagne d’une très forte transphobie, en quoi ces collectifs permettent-ils précisément de lutter contre cette oppression systémique ou, au contraire, en quoi participent-ils à la renforcer ? Les écoféministes rurales de la configuration « différentialiste séparatiste », qui refusaient la présence de personnes trans en leur sein au cours de l’enquête de Constance Rimlinger, ont-elles depuis modifié leur position – ou non –, et sur quels arguments ?
D’autre part, il s’agirait de creuser la question des sociabilités locales entre les néo-habitantes que constituent les personnes rencontrées par la chercheuse, et les gens du coin. En effet, la comparaison entre les configurations « queer intersectionnelle » et « holistique intégrationniste », met en exergue l’entre-soi qui peut prévaloir dans certaines communautés. Or, on peut se demander comment les classes populaires et intermédiaires sans le sou installées en milieu rural depuis des dizaines d’années, dont les modes de vie sont écologiquement sobres sans néanmoins être mis en discours, pourraient être source d’inspiration, voire de ressources matérielles, pour ces écoféministes.
Parallèlement, l’implantation progressive des idéologies d’extrême-droite en milieu rural peut participer à fragiliser ces collectifs, ce qu’une enquête ultérieure serait invitée à investiguer. Par ailleurs, si l’on comprend au fil de l’ouvrage la manière dont l’installation en collectif rural queer permet d’assumer son orientation sexuelle – voire son appartenance de genre – avec confiance, on aimerait en savoir plus sur l’influence de la résidence rurale sur les rapports aux enjeux environnementaux de ces écoféministes. Des éléments seraient en effet bienvenus sur la manière dont ces lieux les socialisent en retour à la crise écologique – par le constat de la diminution de la biodiversité, de l’épandage de produits phytosanitaires et des déchets sur les bords des routes, ou encore l’apparition de maladies –, voire renforcent leur engagement écologiste, en les incitant par exemple à militer contre un projet local jugé écocidaire.
Ainsi, la typologie des trois configurations, de même que les nombreux thèmes qui sont abordés dans l’ouvrage – comme le rapport au travail rémunéré, à la spiritualité, à la « nature » et à l’agriculture, à la sexualité et au genre –, mêlés à la rigueur de l’enquête ethnographique de Constance Rimlinger, ouvrent de nouveaux questionnements, qui invitent d’autant plus à documenter les expériences collectives féministes et écologistes rurales que les mondes ruraux font l’objet d’enjeux politiques cruciaux dans des sociétés fortement inégalitaires.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, Presses Universitaires de Rennes (Rennes, 2015).
- Féministes des champs, p.14.
- Ibid., p.257.
- Jeanne Burgart Goutal, « Un nouveau printemps pour l’écoféminisme ? », Multitudes, n°67 (2017), p.17‑28.
- Féministes des champs, p.12.
- Danièle Hervieu-Léger et Bertrand Hervieu, Le retour à la nature : au fond de la forêt… l’État, Seuil (Paris, 1979); Bernard Lacroix, L’utopie communautaire. Histoire sociale d’une révolte, PUF (Paris, 1981); Anaïs Malié et Frédéric Nicolas, « Des loisirs productifs aux “alternatives”. Le rapport ambivalent des classes populaires aux pratiques agricoles et alimentaires en milieu rural », Savoir/Agir, n°38 (2016), p.37‑43; Madlyne Samak, « Le prix du “retour” chez les agriculteurs “néo-ruraux” », Travail et emploi, n°150 (2017), p.53‑78; Geneviève Pruvost, La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte, La Découverte (Paris, 2024).
- Françoise Flamant, Women’s lands. Construction d’une utopie. Oregon, USA, 1970-2010 : l’épopée des pionnières de l’écoféminisme, Editions iXe (Donnemarie-Dontilly, 2023 [2015]).
- Homme dont le genre assigné à la naissance correspond à l’identité de genre.
- Constance Rimlinger, « Travailler la terre et déconstruire l’hétérosexisme : expérimentations écoféministes », Travail, genre et sociétés, n°42 (2019), p.89‑107.
- Marlène Benquet et Geneviève Pruvost, « Pratiques écoféministes : corps, savoirs et mobilisations », Travail, genre et sociétés, n°42 (2019), p.23‑28.
- Cette date correspond à la tenue de la 21ᵉ conférence de Paris (COP21) en France qui s’est accompagnée d’actions militantes écologistes et féministes, aux premières mises en place de festivals qualifiés « écoféministes », et aux prémisses d’un cycle de publications écoféministes en France. Voir Sandra Laugier, Jules Falquet, et Pascale Molinier, « Genre et inégalités environnementales : nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes. Introduction », Cahiers du Genre, n°59 (2015), p.5‑20; Émilie Hache, Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Cambourakis (Paris, 2016).
- Françoise d’Eaubonne, Le Féminisme ou la Mort, Le Passager Clandestin (Lorient, 2020 [1974]), p.276.
- Féministes des champs, p.26.
- Ibid., p.23.
- Ibid., p.258.
- Ibid., p.22.
- Ibid., p.213-214.
- Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe (Paris, Éditions iXe, 2013 [1991]); Christine Delphy, L’Ennemi principal : économie politique du patriarcat, Syllepse (Paris, 2013 [1998]); Monique Wittig, La pensée straight, Éditions Amsterdam (Paris, 2018 [1992]).
- Geneviève Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte (Paris, 2021); Veronika Bennholdt et Maria Mies, La subsistance. Une perspective écoféministe, La Lenteur (St-Michel de Vax, 2022).
- Féministes des champs, p.199-200.
- Ibid., p.120.
- Ibid., p.207.
- Ibid., p.126.
- Ibid., p.144.
- Ibid., p.134.
- Ibid., p.217.
- Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIᵉ siècle, La Découverte (Paris, 2014).
- Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes. Chiens, humains et autres partenaires, Flammarion (Paris, 2019).
- Féministes des champs, p.182.
- Joan C. Tronto, « Du care », Revue du MAUSS, n°32 (2008), p.243‑265.
- Geneviève Pruvost, « Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : la politisation du moindre geste », Sociologie du travail, vol.57, n°1 (2015), p.81‑103.
- Féministes des champs, p.45.
- Ibid., p.103.
- Gilles Laferté, « Des études rurales à l’analyse des espaces sociaux localisés », Sociologie, vol.5, n°4 (2014), p.423‑439.
- Féministes des champs, p.128.
- Jean-Baptiste Paranthoën, « Processus de distinction d’une petite-bourgeoisie rurale », Agone, n°51 (2013), p.117‑130; Anaïs Malié, « « “C’est local, c’est ce qui nous intéresse”. Étude des constructions et usages du ‘local’ à travers les pratiques alimentaires », dans Les territoires de l’autochtonie, PUR (Rennes, 2016), p.97‑110.
- Féministes des champs, p.257.
- Laure Bereni, « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes » dans Les féministes de la deuxième vague, PUR (Rennes, 2012), p.27‑41.
L’article Subvertir les normes depuis les marges féministes rurales est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview