06.01.2026 à 11:59
Pourquoi l’obésité est, avant tout, une maladie du cerveau
Rosalia Rodriguez Rodriguez, Catedrática. Departamento de Ciencias Biomédicas, Universitat Internacional de Catalunya
Texte intégral (1786 mots)
L’obésité n’est pas due à un manque de volonté. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. C’est une maladie complexe profondément enracinée dans un cerveau adapté pour survivre à la pénurie.
L’obésité débute dans le cerveau, et nous savons aujourd’hui que son développement tout comme son traitement ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Cette pandémie silencieuse, qui progresse parallèlement au diabète de type 2 – l’une de ses principales complications – touche déjà plus d’un milliard de personnes dans le monde.
Alors que notre environnement devient de plus en plus obésogène, le cerveau continue de fonctionner selon des règles ancestrales qui rendent difficile le maintien de la perte de poids, même avec des médicaments aussi révolutionnaires que le sémaglutide (Ozempic). Ce changement de perspective transforme les traitements actuels et ouvre la voie à de nouvelles thérapies ciblant directement le cerveau.
Un cerveau ancestral dans un environnement moderne
L’obésité et le surpoids sont habituellement décrits comme un excès de graisse ou un problème métabolique. Mais leur origine profonde réside dans le système nerveux central, en particulier dans l’hypothalamus, la région qui agit comme un « thermostat énergétique ». Pendant 95 % de notre histoire évolutive, nous avons vécu dans la pénurie : marcher, chasser et cueillir étaient indispensables, et le cerveau a développé des mécanismes très efficaces pour défendre la masse graisseuse, car la perdre pouvait signifier ne pas survivre.
Ce « cerveau ancestral » fonctionne aujourd’hui dans un environnement totalement opposé : aliments hypercaloriques disponibles 24 heures sur 24, sédentarité, stress chronique, troubles du sommeil et régimes alimentaires ultratransformés.
À lire aussi : Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ?
Il en résulte un déséquilibre entre notre biologie et notre mode de vie, qui est amplifié chez les personnes qui présentent des prédispositions génétiques. À cela s’ajoute un élément que la recherche commence à explorer clairement : le système qui régule le poids ne fonctionne pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes.
L’hypothalamus : là où commence l’obésité
L’hypothalamus intègre des signaux hormonaux (comme la leptine ou l’insuline), métaboliques et sensoriels afin d’équilibrer l’énergie ingérée et celle qui est dépensée. Quand nous perdons du poids, le cerveau interprète la situation comme une menace et il active de puissants mécanismes de défense : il augmente l’appétit, réduit la dépense énergétique et renforce une « mémoire métabolique ou obésogène » qui pousse à reprendre le poids perdu.
C’est pourquoi, même si l’alimentation et l’exercice physique sont essentiels à la santé et doivent toujours constituer la première prise en charge, ils ne suffisent pas chez de nombreuses personnes pour inverser l’obésité lorsque les circuits cérébraux sont déjà altérés. Ce point n’invalide pas les bienfaits d’un mode de vie sain : il reconnaît simplement que, dans certains cas, le cerveau a besoin d’un soutien pharmacologique pour sortir de la boucle obésogène.
Quand l’hypothalamus s’enflamme (à cause du stress, d’un régime hypercalorique, d’un manque de sommeil, de troubles hormonaux ou d’une prédisposition génétique), l’activité des neurones qui régulent la faim et la satiété est perturbée. Certaines personnes parviennent à retrouver spontanément leur poids initial après avoir trop mangé ; d’autres, en revanche, présentent un « frein hypothalamique » moins efficace et prennent plus facilement du poids. La différence réside dans le cerveau.
Perspective de genre : deux cerveaux, deux réponses
Les neurones hypothalamiques AgRP (qui stimulent la faim) et POMC (qui favorisent la satiété) régulent avec précision le comportement alimentaire. Cependant, l’hypothalamus n’est pas seulement un ensemble de neurones : il comprend également la microglie et les cellules immunitaires du cerveau, dont le rôle s’est avéré déterminant. Notre groupe a décrit trois phases d’activation microgliale dans les premiers stades de la suralimentation :
Une activation précoce, rapide et réversible.
Une phase inflammatoire prolongée, qui perturbe les circuits de satiété.
Une phase finale de dérégulation, au cours de laquelle les mécanismes censés limiter la prise de poids ne fonctionnent plus.
Ces phases ne se comportent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Chez les modèles murins, les femelles présentent une réponse neuro-immune plus stable et protectrice, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles développent l’obésité plus tardivement. Ce schéma rappelle ce que l’on observe chez les femmes préménopausées.
À lire aussi : Ménopause et prise de poids : des mesures précoces pour accompagner les changements hormonaux
Avant la ménopause, les femmes ont un risque moindre de maladies métaboliques et cardiovasculaires que les hommes, grâce à l’effet protecteur des œstrogènes. Mais cette protection diminue pendant la périménopause et la ménopause, une période encore très peu étudiée et critique pour le risque cardiométabolique.
À lire aussi : À la ménopause, savez-vous que le risque cardiovasculaire augmente ? L’activité physique peut aider
De plus, dans les modèles animaux et les cultures cellulaires, nous avons détecté des altérations très précoces (au niveau de la microglie, de signaux lipidiques comme les endocannabinoïdes et de la sensibilité neuronale à l’insuline) avant même l’apparition de changements visibles dans les tissus périphériques. Cela suggère que le déclencheur initial de l’obésité est cérébral. Il est essentiel d’intégrer cette perspective de genre pour progresser vers des traitements plus précis et plus efficaces.
Nouvelles thérapies contre l’obésité : incrétines et nanomédecine ciblant le cerveau
Le traitement de l’obésité a radicalement changé depuis 2021 avec les agonistes du récepteur GLP-1. Le semaglutide et d’autres médicaments de la famille des incrétines, initialement développés pour le diabète de type 2, ont démontré une capacité remarquable à réduire le poids grâce à des actions à la fois périphériques et centrales. Cependant, ils présentent des limites connues : effets gastro-intestinaux, perte de masse maigre, reprise de poids après l’arrêt du traitement ou réponses variables selon le profil biologique du patient.
Des études récentes montrent également des différences selon le sexe : les femmes préménopausées ont tendance à mieux répondre à ces traitements que les hommes.
Un défi doit donc être relevé : nous avons besoin de traitements qui agissent directement sur le cerveau, avec une plus grande précision et moins d’effets systémiques. C’est là que la nanomédecine qui cible le cerveau ouvre de nouvelles perspectives. Au sein de notre groupe, nous développons des nanoplateformes (micelles polymères, nanoparticules protéiques ou formulations intranasales) capables de transporter des médicaments de manière sélective vers le cerveau. Ces technologies permettent d’encapsuler des molécules qui, si elles étaient administrées sans protection, seraient inefficaces ou toxiques, afin de les diriger vers les cellules qui contrôlent l’appétit et l’homéostasie énergétique.
Ces approches pourraient compléter ou renforcer les incrétines, réduire leurs effets secondaires, améliorer l’observance aux traitements et augmenter le nombre de patients qui y répondent. Elles constituent un moyen de traiter l’obésité depuis son origine cérébrale, grâce à des interventions plus personnalisées et durables.
Un regard neuf sur un problème ancien
L’obésité n’est pas due à un manque de volonté, malgré la stigmatisation dont elle fait l’objet au niveau social. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. L’obésité est une maladie complexe, profondément enracinée dans un cerveau adapté à la survie en période de pénurie. Pour la traiter, il faut adopter une double approche : promouvoir des modes de vie sains et, quand cela se révèle nécessaire, recourir à des thérapies qui agissent sur les circuits cérébraux régulant le poids.
Comprendre comment fonctionne – et comment échoue – l’hypothalamus sera essentiel pour freiner cette pandémie silencieuse du XXIe siècle. Et c’est là, dans le cerveau, que se livre la bataille scientifique la plus prometteuse.
Rosalia Rodriguez Rodriguez reçoit des financements du ministère des sciences, de l'innovation et des universités, de l'AGAUR-Generalitat de Catalogne (PRODUCTE, INNOVADORS) et du Centre de recherche biomédicale en réseau-obésité (CIBER-Obn).
06.01.2026 à 11:59
Et si quelques minutes de méditation de pleine conscience pouvaient aider à réduire le stress ?
Alexis Barbry, Maître de conférences en STAPS, Université de Lorraine
Annie Carton, Psychologie, Université d'Artois
Jérémy Coquart, Professeur des Universités (74ème section : STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Université de Lille
Texte intégral (1899 mots)
Une revue systématique de la littérature scientifique met en évidence les effets bénéfiques de temps courts de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress. Cela plaide pour une intégration de ce type de méditation dans la vie quotidienne.
Nous sommes toutes et tous confrontés au stress dans notre vie de tous les jours. Il est tout à fait normal de le ressentir. Il peut se définir comme un état de tension interne causé par une situation complexe, qui excède nos ressources cognitives, sociales ou affectives. L’important n’est pas tant le stress, mais plutôt la manière dont nous y réagissons.
La recherche souligne la nécessité de s’équiper d’outils issus de la psychologie pour nous apprendre à mieux gérer les situations perçues comme menaçantes dans l’objectif de réguler le stress.
La pleine conscience : un outil de régulation du stress ?
Parmi les techniques psychologiques, la pleine conscience a récemment connu un essor important. Bien que cette dernière soit considérée comme un concept « à la mode », elle dispose d’une longue histoire, qui aurait débuté il y a plus de 2 500 ans à travers la pensée bouddhiste. Cette pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une technique de méditation attentionnelle simple qui consiste à porter délibérément son attention sur ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement. Autrement dit, c’est être attentif au moment présent, sans se laisser contaminer par ses pensées !
La pleine conscience a pris un essor scientifique sous l’impulsion du professeur Jon Kabat-Zinn dans les années 1980. Le premier programme de pleine conscience ayant vu le jour est le Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), qui signifie « programme de réduction du stress par la pleine conscience ». Depuis le début des années 1980, d’autres programmes de pleine conscience ont émergé. Ces derniers se sont adaptés aux caractéristiques de différents publics (personnes souffrant d’épisodes dépressifs, sportifs, etc.…).
Aujourd’hui, les bienfaits de ces programmes sur la réduction du stress sont bien établis. Cependant, un des freins à la pratique de la pleine conscience réside dans la durée et dans l’engagement requis. Par exemple, le MBSR nécessite un engagement sur huit semaines, comportant une pratique quotidienne individuelle de 45 minutes et une pratique hebdomadaire en groupe de 2,5 heures.
Bien qu’efficace pour réguler les intensités de stress, la durée de ces programmes ne semble pas s’adapter à nos rythmes de vie actuels. Compte tenu de leur dimension chronophage, certains chercheurs ont proposé des temps plus courts de pleine conscience.
Quelle efficacité des temps brefs de pleine conscience contre le stress
Un programme bref de pleine conscience se réalise sur quatre semaines et engendre une pratique inférieure à 1,6 heure (100 minutes, soit une heure et quarante minutes) par semaine. La durée de la séance ne doit pas excéder 30 minutes. Bref, nous sommes bien loin des temps proposés par les programmes plus classiques comme le MBSR… Si ces temps courts s’accordent davantage à nos contraintes temporelles, leurs bénéfices sur le stress restent mal connus.
Notre interrogation a donc été la suivante : est-ce que les temps brefs de pleine conscience pourraient réduire notre stress ?
Pour répondre à cette question, nous avons effectué une revue systématique de la littérature évaluant les effets des temps brefs de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress : la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La VFC reflète l’activité du système nerveux autonome jouant un rôle crucial dans le maintien de notre équilibre.
Ce système nerveux autonome se divise en deux branches : le système nerveux sympathique (qui prédomine lors des situations stressantes) et le système nerveux parasympathique (qui prédomine lors des situations de repos). Une faible VFC est représentative d’une moindre capacité à gérer les situations stressantes, alors qu’une VFC plus élevée reflète une meilleure capacité à réguler les situations stressantes.
Les résultats de notre étude mettent en évidence que les temps courts de pleine conscience augmentent la VFC. Autrement dit, ces moments de pleine conscience parviennent à réduire notre niveau de stress.
À la vue de ces résultats, nous recommandons donc d’intégrer de brefs temps de pleine conscience dans notre quotidien pour minimiser les effets du stress et éviter que ce dernier consomme toutes nos ressources.
Un exemple pour débuter : la prise de conscience du souffle
Il existe de nombreuses manières d’introduire la pleine conscience dans notre quotidien. On distingue généralement deux types de pratiques : formelles et informelles.
Les pratiques formelles sont les plus connues. Elles consistent à s’arrêter et à se poser pour pratiquer un exercice de pleine conscience.
Par exemple, la prise de conscience du souffle est considérée comme l’exercice de référence pour s’initier à cette pratique. Il consiste à s’asseoir sur un coussin ou sur une chaise de manière digne et droite. Une fois la position correctement maintenue, il suffit de diriger intentionnellement son attention sur le souffle. L’objectif n’est pas ici de contrôler sa respiration, mais plutôt de l’observer sans chercher à la modifier.
Cet exercice peut paraître facile, mais généralement l’esprit a tendance à s’éloigner de l’exercice. C’est ce que l’on appelle le vagabondage de l’esprit. Cette errance est tout à fait normale. Elle fait partie de la nature même de l’exercice. Lorsque vous vous rendrez compte que votre esprit s’égare, la pratique de la pleine conscience vous invitera à ramener votre attention avec douceur et bienveillance vers le souffle et les sensations qui lui sont associées.Lorsque vous débuterez cet exercice, il est fort probable que vous rencontriez des difficultés à maintenir votre attention sur la respiration. Encore une fois, cela est ordinaire. À force de répéter cet exercice, vous éduquerez votre esprit à (r) amener son attention vers la respiration.
La prise de conscience du souffle n’est qu’un exemple, il existe de nombreuses autres formes de pratiques formelles (par exemple, le scan corporel qui consiste à observer les différentes sensations présentes dans notre corps).
Vous trouverez sur Internet de nombreuses vidéos et/ou audios faites par des professionnel·les qui vous permettront de pratiquer.
Un exemple d’exercice momentané (5 minutes) de prise de conscience du souffle, vous est proposé en cliquant ici ou sur le QR code ci-joint.
À noter le fait que certaines personnes ne sont pas « réceptives » à la pleine conscience. Lorsqu’ils débutent cette pratique, certains sujets peuvent également ressentir une légère angoisse quant aux faits de se poser et de centrer son attention sur sa respiration. Et dans le cadre de graves problèmes de santé mentale (dépression, anxiété…), la pleine conscience ne remplace pas une prise en charge par un professionnel de santé.
Pratiquer seul·e (ou pas), de manière formelle (ou non)
Pour débuter la pratique, on peut se faire accompagner – par une ou un médecin, psychologue, psychothérapeute, chercheur ou chercheuse, préparateur ou préparatrice mentale, etc. – mais qui doit avoir été formé à la pleine conscience dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU), d’une formation courte qualifiante par exemple. Mais ce n’est pas une obligation. Étant donné que cette pratique s’avère très simple à mettre en œuvre, tout le monde peut l’intégrer de manière brève dans son quotidien. Des livres écrits par des professionnel·les peuvent également aider.
La pleine conscience peut aussi s’intégrer de manière informelle dans notre quotidien. En effet, il est possible de marcher, de courir ou encore de manger en pleine conscience… Dans ce type d’exercices, l’objectif est d’être pleinement attentif à ce que l’on est en train de faire. Par exemple, vous pouvez essayer une fois par semaine de manger sans écrans, en étant pleinement attentif aux sensations gustatives, olfactives ou visuelles de ce que vous mangez.
Que la pratique soit réalisée de manière formelle ou informelle, nous vous conseillons de débuter par des temps de trois à cinq minutes avant d’augmenter progressivement si vous le souhaitez !
Essayez, et vous verrez. Bonne pratique !
Cette revue systématique, et donc cet article de vulgarisation, s’intègre dans la thèse CIFRE 0331 co-financée par l’Institut des Rencontres de la FOrme (IRFO) et l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT).
Annie Carton est membre du Racing Club Arras Athlétisme en tant qu'entraîneur, et vice-présidente de l'Office des Sports d'Arras en charge de la santé et du bien-être.
Jérémy Coquart a été le directeur d’Alexis Barbry, le doctorant financé.
05.01.2026 à 17:56
Vivre dans un logement trop froid : la réalité sociale de la précarité énergétique
Bérangère Legendre, Professor, Université Savoie Mont Blanc
Dorothée Charlier, Maîtresse de conférences en économie de l’énergie et de l’environnement, IREGE, IAE Savoie Mont Blanc
Texte intégral (2227 mots)
La précarité énergétique est un fléau qui concerne de plus en plus de personnes du fait de la volatilité des prix de l’énergie. Elle a des répercussions sur la santé physique et mentale, sur la vie sociale et même sur la scolarité des enfants.
Alors que l’hiver s’installe, environ 3 millions de ménages en France sont de nouveau confrontés à une difficulté majeure : celle de la précarité énergétique.
Elle se matérialise par des privations, mais également par un sentiment de honte et une exclusion sociale qui en résultent. Ses effets peuvent être multiples, allant même jusqu’à augmenter l’absentéisme scolaire. Les conséquences sociales et sanitaires, longtemps sous-estimées, sont aujourd’hui mieux documentées par la recherche.
Ce que signifie « être en précarité énergétique » au quotidien
La définition française du phénomène est large : une personne est en précarité énergétique lorsqu’elle rencontre des difficultés à disposer, dans son logement, de l’énergie nécessaire pour répondre à ses besoins de base, du fait de faibles ressources ou de conditions de logement inadéquates. Cela signifie vivre dans un logement trop froid l’hiver, trop chaud l’été, souvent mal isolé, où l’on chauffe une seule pièce pour réduire la facture, où l’on évite d’allumer la lumière, où la présence de moisissures ou d’humidité peut devenir chronique. Ces conditions entraînent fréquemment des comportements de restriction d’énergie, c’est-à-dire consommer volontairement moins que ce qui serait nécessaire au confort ou à la santé. Parfois, cela signifie également passer sous le radar des politiques publiques, car les dépenses en énergie sont volontairement modérées.
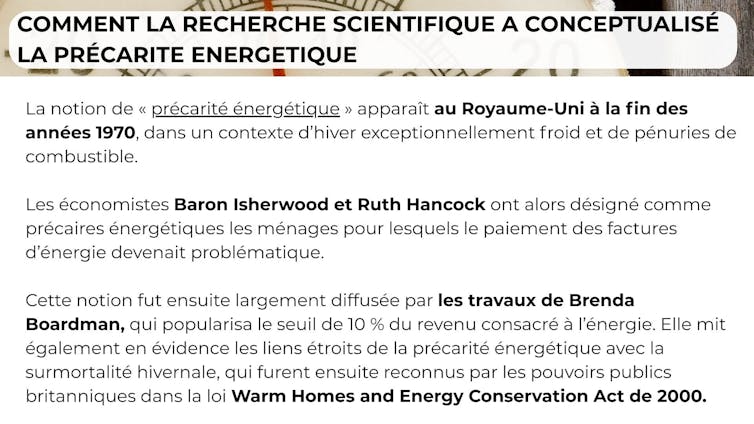
Cette situation est d’autant plus fréquente que les prix de l’énergie sont volatiles ces dernières années. En 2018 déjà, 34 millions d’Européens déclaraient ne pas pouvoir chauffer correctement leur logement. Les tensions énergétiques depuis 2021 ont encore accentué ce phénomène : les ménages les plus modestes ont consacré une part croissante de leur budget à leurs factures, réduisant leurs marges de manœuvre.
Les conditions de logement jouent également un rôle central : mauvaise isolation, appareils de chauffage vétustes, infiltrations d’eau, ventilation insuffisante, autant de facteurs qui rendent impossible le maintien d’un confort minimal à un coût acceptable.
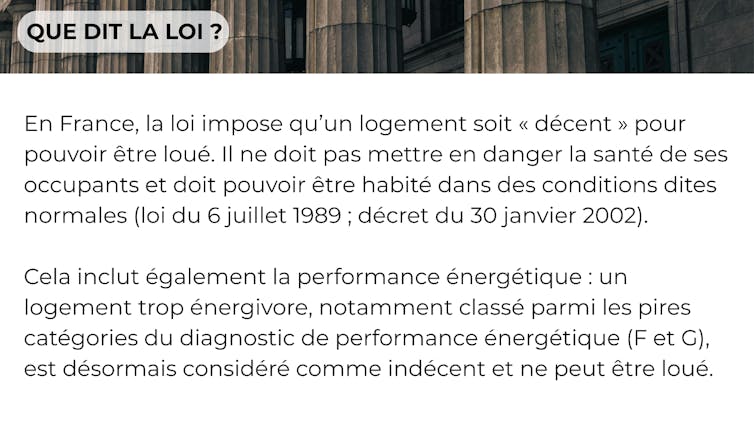
Qui sont les ménages les plus touchés ?
La recherche en économie identifie de manière cohérente trois déterminants de la précarité énergétique : bas revenus, mauvaise performance énergétique du logement et prix élevés de l’énergie. Mais au-delà de ce triptyque, les recherches récentes en la matière apportent des précisions essentielles.
En France sont particulièrement exposés :
les personnes âgées, davantage présentes dans des logements anciens, peu isolés, et disposant de faibles revenus ;
les ménages isolés, notamment les femmes seules ou les familles monoparentales, dont les dépenses fixes pèsent plus lourd dans le budget ;
les locataires du parc privé, souvent logés dans des habitats moins performants que le parc social qui est susceptible de bénéficier d’une meilleure qualité énergétique ;
les ménages vivant dans des logements anciens qui n’ont pas fait l’objet de rénovation et qui utilisent plus fréquemment du gaz ou du fioul et qui font donc face à un coût de l’énergie plus important.
Par ailleurs, les ménages « énergétiquement vulnérables », qui ne sont pas définis comme étant en précarité énergétique mais peuvent basculer en cas de choc (hausse de prix, panne d’équipement, baisse de revenu), sont souvent ignorés des politiques publiques, car mal identifiés. Ces ménages représentent un enjeu majeur pour les politiques publiques, car ils n’entrent pas dans les seuils traditionnels utilisés pour mesurer le phénomène.
Les effets de la précarité énergétique dépassent largement l’inconfort thermique. Ils touchent la santé, la vie sociale et les perspectives économiques.
Les impacts sur la santé physique
Un logement trop froid augmente les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires, aggrave les symptômes des personnes souffrant de maladies chroniques, comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, et favorise l’apparition de moisissures responsables d’allergies ou d’asthme. Être en précarité énergétique multiplierait par sept le risque de mauvaise santé pour les personnes déjà fragiles.
Les coûts associés pour la collectivité sont considérables : près d’un milliard d’euros de dépenses médicales directes en France, et plus de 20 milliards si l’on inclut les coûts indirects liés à la perte de productivité ou aux arrêts maladie.
Une dégradation marquée de la santé mentale
Un résultat central a été établi pendant la crise sanitaire du Covid-19 : la précarité énergétique a un effet causal fort et significatif sur la santé mentale, dégradant les scores d’anxiété, de dépression et de santé sociale. Être en situation de précarité énergétique aurait réduit en moyenne le score de santé mentale de 6,3 points sur 100 et augmenté le score de dépression de 5,35 points et celui d’anxiété de 6,48 points pendant cette période durant laquelle la majeure partie de la population française et européenne a été confinée à domicile à intervalles réguliers.
La situation était encore plus grave pour les personnes déjà fragilisées : pour le tiers le plus vulnérable de la population, l’effet négatif sur la santé mentale atteignait 20 points. L’utilisation des scores permet de quantifier les effets de la précarité énergétique : un score de santé de 100 indique la meilleure santé qui soit, tandis qu’un score de dépression de 100 indique le niveau le plus élevé de dépression.
Une spirale d’isolement et de honte
Plusieurs travaux sociologiques montrent également que les personnes vivant dans des logements froids ou dégradés évitent d’inviter des proches, se replient sur elles-mêmes, et peuvent éprouver un sentiment de honte ou d’échec. Les difficultés à payer les factures conduisent parfois à des coupures d’énergie ou au risque d’endettement, renforçant encore la vulnérabilité sociale.
La précarité énergétique devient ainsi un facteur d’exclusion, au même titre que la pauvreté monétaire, mais en partie invisible car liée à l’espace privé du logement.
Noel Longhurst et Tom Hargreaves, deux chercheurs en sciences de l’environnement, rapportent ainsi dans une de leur publication de 2019 les propos de Barbara, une trentenaire britannique qui souffre de précarité énergétique :
« Je ne reçois personne. Je ne reçois pas d’amis… Personne. Je ne pense pas avoir reçu d’amis depuis environ trois ans… Je n’aime pas la condensation, et c’est très important pour moi. C’est embarrassant. Je suis gênée quand je sors le matin et que je vois qu’on ne peut pas voir à travers les fenêtres. »
Des répercussions sur les trajectoires scolaires
La précarité énergétique affecte également la scolarité des enfants. Vivre dans un logement froid ou mal chauffé complique le travail scolaire à domicile, perturbe le sommeil et accroît la fatigue, avec des effets potentiels sur l’attention et l’apprentissage.
En France, le défenseur des droits souligne que ces conditions de vie dégradées portent atteinte au droit des enfants à un environnement propice aux études et peuvent peser sur leurs résultats scolaires. Ces constats rappellent que la précarité énergétique est aussi un enjeu éducatif et d’égalité des chances.
Un enjeu européen majeur, des réponses encore insuffisantes
Si la France a développé plusieurs outils (chèques énergie, aides à la rénovation, développement du parc social), la littérature montre que les politiques purement financières ont des effets limités, alors que les actions structurelles – rénovation thermique, construction de logements sociaux performants – ont un impact durable sur la réduction de la précarité énergétique.
À l’échelle européenne, la Commission a inscrit la lutte contre la précarité énergétique au cœur de la directive sur l’efficacité énergétique révisée adoptée en 2024. Mais les disparités restent fortes, et la crise énergétique a rappelé la nécessité d’une stratégie plus ambitieuse, combinant protection des ménages, transition énergétique et amélioration massive du parc résidentiel.
Bérangère Legendre a reçu des financements de la Chaire de l'Economie Environnementale (Fondation Université Savoie Mont Blanc).
Dorothée Charlier est membre de la SOLAR ACADEMY.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
