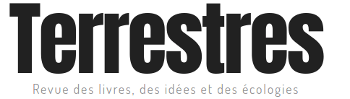06.02.2026 à 12:53
Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton
Dolorès Bertrais
Dans son livre “Désarmer le béton, ré-habiter la terre”, l’architecte et militante Léa Hobson règle son compte à la plus massive des armes de construction du capitalisme et appelle à se défaire de son emprise. Pas le choix : tôt ou tard, le béton armé qui structure nos sociétés terminera en gravats – autant le remplacer ! Compte-rendu de lecture.
L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9019 mots)
Temps de lecture : 20 minutes

À propos du livre de Léa Hobson, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, publié aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Zones ».
Avec Désarmer le béton, ré-habiter la terre, Léa Hobson, architecte, scénographe et militante écologiste, s’inscrit dans une génération de praticien.ne.s et chercheur.e.s qui refusent de considérer les matériaux de construction comme de simples données techniques. Son travail se situe au croisement de l’enquête matérielle, de la critique politique et de l’engagement militant. Autrice du chapitre « Béton » dans On ne dissout pas un soulèvement : 40 voix pour les Soulèvements de la Terre (Seuil, 2023), elle est également co-autrice, au sein du collectif forty five degrees, de Radical Rituals (2024), une enquête itinérante menée à l’échelle européenne sur les pratiques spatiales vernaculaires, les rituels contemporains et les formes de réinvention des communs face aux crises écologiques et sociales. Ces ancrages constituent le socle politique, méthodologique et épistémologique de son livre Désarmer le béton, ré-habiter la terre.
Dès les premières pages de l’ouvrage (pp. 7–14), Léa Hobson pose un diagnostic sans détour, montrant que le béton a profondément transformé les manières de construire, d’habiter et de gouverner l’espace. Elle opère ainsi un déplacement fondamental : le béton n’est pas seulement un matériau problématique, il est un symptôme. Symptôme d’un régime de croissance (minérale) fondé sur l’accumulation, la standardisation, l’effacement ou encore la ruine. Le béton devient un analyseur privilégié des rapports de pouvoir contemporains. Autrement dit, en observant attentivement le béton depuis ses conditions de production et d’extraction, ses usages quotidiens, ses dispositifs normatifs, jusqu’à ses circulations à différentes échelles, se donnent à voir les alliances structurelles entre économie, politiques publiques, normes techniques et imaginaires professionnels. Ces coalitions ont progressivement stabilisé un régime de construction fondé sur l’irréversibilité, produisant un monde bâti et des édifices qui, comme le précise l’auteure, « ne se démontent plus, peu durables et qui finissent en décharge ou sont enfouies » (p. 11), et dans lesquels le pouvoir s’inscrit durablement dans la matière.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Cette incapacité à défaire rejoint ce qu’elle nomme le « gaspillage immobilier » massif (p. 11) : bâtiments vacants, friches inutilisées, logements inoccupés, alors même que l’on continue de construire. Le paradoxe est central dans l’ouvrage : l’industrie du béton prospère sur une pénurie qu’elle contribue elle-même à fabriquer. La logique d’« obsolescence programmée1 » du bâti alimente ce qu’elle qualifie de « civilisation de gravats » (p. 12), où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.
L’introduction annonce également un autre geste, plus discret mais structurant : faire place aux femmes, à la fois dans le récit et dans la critique. Léa Hobson signale dès ces premières pages la nécessité de réinscrire les femmes, travailleuses, architectes, théoriciennes, militantes, dans l’histoire de la construction et de l’architecture, une histoire largement « écrite au masculin » (p. 12). Cette attention, au-delà d’être réparatrice, ouvre la voie à une lecture féministe et matérialiste du bâti, qui traverse l’ouvrage jusqu’à la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155) développée dans le dernier chapitre.
La logique d’obsolescence programmée du bâti alimente une « civilisation de gravats » où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.
Sur le plan de la structure, l’auteure explicite clairement son projet. Désarmer le béton, ré-habiter la terre, s’organise en trois grands mouvements, qui correspondent autant à des étapes analytiques qu’à des prises de position politiques. Il s’agit d’abord de suivre la filière béton dans toute sa matérialité, depuis l’extraction jusqu’aux ruines, afin de rendre visibles les chaînes de dépendance et les paysages et corps sacrifiés. Il s’agit ensuite d’interroger les politiques publiques et les dispositifs normatifs qui ont rendu ce matériau hégémonique, en montrant comment la norme bétonnée s’est imposée comme une évidence. Enfin, l’ouvrage se tourne vers le démantèlement, démontrant qu’il n’est pas qu’une simple substitution technique, mais une remise en cause de l’acte même de bâtir, de ses finalités, de ses cadres professionnels et de ses alliances possibles. En ce sens, le geste de Léa Hobson entreprend de désassembler les couches successives matérielles, normatives, institutionnelles qui ont rendu le béton à la fois omniprésent et invisible pour faire de « l’“habiter” une cause commune » (p. 12). À ce titre, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, est un ouvrage dont de nombreuses mains devraient s’emparer : celles des cimentiers et des industriels, bien sûr, mais aussi celles des responsables politiques, des architectes, ingénieur.e.s, urbanistes et autres praticien.ne.s de la production de l’espace, tout autant que celles des étudiant.e.s, des citoyen.ne.s, militant.e.s ou non. Car le livre ne se contente pas de documenter un système : il invite explicitement à en sortir.

Le béton comme violence lente : sols, ruines et territoires sacrifiés
Le premier chapitre, Du sable à la ruine, permet aux lecteur.ice.s d’« entrer en matières », ces matières qui constituent les sols et qui nous (sup)portent, à la fois organiques et minérales. En préférant une entrée résolument infra-ordinaire par les sols et via les vers de terre, l’auteure opère un choix qui n’a rien d’anecdotique – alors que les lombrics pourraient sembler éloignés de la filière béton. Pourtant, leur disparition généralisée depuis les années 1950 (p. 15) éclaire l’arrière-plan écologique sur lequel repose toute l’industrie cimentière. Le ver de terre devient l’indice de sols vivants en perdition, une situation aggravée par l’artificialisation systématique opérée par l’industrie du béton. L’auteure rappelle qu’entre 1960 et aujourd’hui, en France métropolitaine, près de « 17 milliards de m² de sols ont été scellés » (p. 17), sans justification démographique. L’urbanisation, l’expansion des réseaux (routiers, ferroviaires, etc.), la logistique et la spéculation foncière ne progressent pas au rythme de la croissance des populations, mais selon une logique autonome d’accumulation de surfaces artificialisées.
Ces surfaces génèrent leurs propres catastrophes : les inondations, désormais exacerbées par l’imperméabilisation ; les îlots de chaleur, qui transforment les espaces urbains en fournaises estivales ; et l’effondrement de la biodiversité, conséquence directe de la disparition des habitats vivants. « Quand le béton ne nous noie pas, il nous fait frire » (p. 19) résume en quelques mots la brutalité ordinaire d’un modèle de production de l’espace et d’une urbanisation hors sol. Dans cette perspective, les politiques publiques se révèlent largement inefficaces face aux dynamiques qu’elles prétendent réguler. L’auteure met par exemple en évidence les limites structurelles de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), régulièrement ajustée au fil des négociations politiques, et qui peine à enrayer les logiques de bétonisation. En cause, le principe même d’« artificialisation nette », qui autorise la poursuite de l’artificialisation dès lors qu’elle est compensée ailleurs (p. 21). Cette logique comptable de l’espace ouvre la voie à toute une série de requalifications administratives révélatrices. Ainsi, des espaces aussi radicalement transformés que les carrières peuvent être assimilés, dans les nomenclatures statistiques, à des « surfaces naturelles dont les sols sont nus ou recouverts en permanence d’eau, de neige ou de glace » (p.22), au même titre que les glaciers…
Le même raisonnement prévaut lorsque les déblais et déchets inertes issus du BTP sont utilisés pour combler carrières et gravières : ces sols recomposés, bien que profondément artificiels, échappent pourtant à la catégorie de l’artificialisation. Ces ajustements techniques, souligne l’auteure, permettent à la fois d’intégrer l’ouverture ou l’extension de carrières dans les mécanismes de compensation et de poursuivre, dans le même mouvement, la mise en exploitation de nouvelles terres agricoles pour accéder à des gisements supplémentaires (ibid.). Face à la destruction des sols fertiles, certains acteur.ice.s vantent les « technosols », les « anthroposols construits » (p. 23), soit des projets de géo-ingénierie censés compenser la perte du vivant. Ces savant.e.s ont oublié l’essentiel : le sol n’est pas une ressource renouvelable et la renaturation, quand elle devient un moyen de légitimer l’extraction, n’est qu’une nouvelle forme de déni (politique).
➤ Lire aussi | Le béton, matériau extraterrestre・François Jarrige (2024)
À partir de là, l’auteure entreprend de suivre la filière béton dans toute sa matérialité : les sablières, les gravières, les carrières, les cimenteries, les centrales à béton, puis les décharges et ruines où se déposent les déchets du cycle minéral. La filière (béton) laisse de nombreuses traces sur son passage (p. 25) : traces matérielles, environnementales mais aussi psychologiques (p. 67). Elle reconfigure des vies humaines et autres qu’humaines, déplace, creuse, dynamite. L’après-1945 marque un moment de bascule : explosion de l’extraction, multiplication des concessions sur fonds marins et fluviaux, et mise en place de schémas départementaux fondés sur une rationalité technocratique qui rend les territoires lisibles, mesurables et exploitables à distance. Cette vision abstraite et surplombante, qui réduit les milieux à des stocks et efface les usages et savoirs locaux, s’inscrit pleinement dans ce que le politologue et anthropologue James C. Scott analysait à travers l’« œil de l’État » : un mode de gouvernement qui simplifie le réel pour mieux l’administrer (Scott 1998).
En moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale.
Mais Désarmer le béton, ré-habiter la terre ne se contente pas d’analyser la machine industrielle, il documente également les nombreuses résistances.
Il donne à voir une constellation de mobilisations : des organisations militantes locales telles que Peuples des Dunes en Bretagne (p. 43) ou l’association Gandalf en Normandie (p. 51) aux côtés de mouvements plus largement structurés, tels qu’Extinction Rebellion et la campagnes « Fin de chantiers » lancée en 2019 (p. 63), ou d’autres actions relayées par Youth for Climate et Extinction Rebellion (p. 65). Loin de constituer une juxtaposition d’initiatives disparates, ces luttes politiques révèlent une même dynamique puisqu’elles rendent visibles les chaînes extractives du béton, des sites planifiés ou existants, d’où la matière est prélevée, jusqu’aux usines de béton prêt à l’emploi. Ces collectifs agissent précisément là où l’extractivisme opère et transforment ces espaces en lieux repolitisés. En s’attaquant aux cimentiers et aux grands groupes du BTP, ils contestent des projets ponctuels et surtout un régime matériel et institutionnel plus large. L’enjeu réside dans la production de contre-savoirs, de récits alternatifs et de nouvelles alliances entre milieux, habitant.e.s et militant.e.s.

Normes, industries et captations foncières
Dans le second chapitre, La norme bétonnée, au-delà du matériau, Léa Hobson montre comment, en moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale. À travers une généalogie minutieuse, elle rappelle que les noms devenus familiers de l’ingénierie : Vicat, Hennebique, Pavin de Lafarge (p. 80) renvoient aux origines mêmes des entreprises capitalistes qui ont bâti leur fortune sur la détention de brevets offrant l’exclusivité commerciale de formules et de procédés constructifs. La chimie innovante épouse alors l’esprit d’entreprise ; elle s’en mêle au point de devenir indissociable de l’industrialisation française qui est elle-même alimentée par la production de l’espace et son expansion. Le maillage se déploie rapidement dans presque tous les secteurs de puissance : « la construction, les autoroutes, les aéroports, l’énergie, les concessions, les télécommunications, puis la promotion immobilière » (p. 81). Dès les années 1950, les lobbies du secteur de la construction via la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), s’allient efficacement pour finalement adopter en 2017 l’appellation unificatrice de « Filière béton » (ibid.).
L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, en devient souvent le premier client du l’industrie du béton.
Cette structuration progressive du secteur ne se limite pas à une coordination économique, mais prépare et consolide un rapport privilégié à la puissance publique. L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, en devient souvent le premier client : via les infrastructures de transport, les équipements publics, les logements sociaux, les grands projets urbains reposent massivement sur le béton, renforçant une dépendance structurelle aux grands groupes du BTP. Les liens entre le BTP et la sphère politique sont anciens. En 1972, l’affaire dite Aranda, caractérisée par des scandales politico-financiers, des pratiques de corruption et de trafic d’influence, connaît une visibilité nationale à travers des « permis autorisés sur des zones inondables ou non constructibles, appels d’offres biaisés et terrains monnayés » (p. 90). Cet épisode, sans être entièrement assimilable à des controverses plus récentes – l’A69 par exemple – révèle toutefois une continuité : dans un régime où les infrastructures deviennent autant de vecteurs de pouvoir, la production de l’espace est régulièrement façonnée par des alliances opaques entre intérêts privés et décisions publiques. La loi de 1995 interdisant le financement des partis politiques sous forme de dons par les grands groupes n’a pas pour autant fait disparaître les arrangements, d’autant que l’État dépend massivement du BTP puisque 70 % des marchés publics concernent les travaux publics, et 20 % le bâtiment (p. 91). Les grandes entreprises du béton, intégrées verticalement, du cimentier au promoteur, en passant par les négociants et les aménageurs, maintiennent un contrôle systémique, renforcé par la proximité sociale entre dirigeants et responsables politiques, formés dans les mêmes grandes écoles publiques (p. 93). L’enchevêtrement des parcours fait système.
Par ailleurs, dans la méga-machine béton, la France occupe une place disproportionnée tant elle coule son béton sur tous les continents. Septième puissance économique mondiale, elle est surtout le deuxième producteur de béton prêt à l’emploi nous rappelle l’auteure (p. 89). Ce secteur continue de perpétuer un « certain impérialisme industriel » (p. 95), alors que la deuxième plus grande cimenterie du monde, située à Settat, au Maroc, appartient à (Lafarge)Holcim. Ici apparaît la dimension coloniale d’un secteur qui continue de puiser et d’épuiser ses anciennes colonies pour entretenir le cœur industriel. Car un siècle après les créations de filiales Lafarge (années 1920 et 1930) : « Nord-Africaine de Ciments Lafarge » en Algérie, « Société indochinoise de fondu Lafarge », « Chaux et Ciments du Maroc », « Société tunisienne Lafarge »2, les procédés coloniaux continuent d’opérer. Ce bétonnage global nécessite d’autres territoires-pièces, mangés à la périphérie pour alimenter la croissance minérale d’un centre toujours plus exigeant.

Revenir sur la généalogie des grands cimentiers et de leurs filiales, c’est aussi comprendre que les filières changent de nom, se recomposent, déplacent leurs responsabilités, mais que les mêmes logiques persistent (p. 99). Les scandales se succèdent – comme ceux liés aux chantiers de Vinci Constructions Grand Projets (VCGP) au Qatar, pour lesquels le groupe a été mis en examen en 2025 pour travail forcé – les « fusibles » sautent, à l’image d’Éric Olsen, PDG de LafargeHolcim contraint à la démission en 2017 après une enquête interne sur des soupçons de financement de l’État islamique en Syrie. Pourtant, les grands groupes s’en sortent grâce à des bataillons d’avocats, des aides publiques européennes ou nationales, et une capacité à maintenir l’édifice. L’excellent article de Léon Baca « Accusé Lafarge : on n’oublie pas », qui retrace près de deux siècles d’épopée Lafarge2, fait écho à la pensée de l’auteure. Alors que le procès du cimentier s’est ouvert le mardi 4 novembre 2025 devant le tribunal, pour versements d’argent à des groupes armés en connaissance de cause, dont l’État islamique responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en Syrie, Léon Baca décrypte : « Aujourd’hui Lafarge n’est plus – il fallait sans doute symboliquement se faire oublier après la lune de miel daeshienne, et LafargeHolcim (2014) est devenue Holcim (2021). La firme [Lafarge] a donc été tour à tour royaliste, réactionnaire, ultra-catholique, paternaliste, colonialiste, collaborationniste, djihadiste [en revenant sur presque deux siècles d’activités] ». Nous pourrions y ajouter le témoignage poignant de Gaëlle (une survivante du Bataclan) lors de ce procès, relayé par Médiapart le 10 décembre 2025 : « Peut-on, au nom d’un intérêt économique, financer directement ou indirectement une organisation terroriste, en sachant, ou en choisissant d’ignorer, que cette organisation tue, torture, asservit et détruit. La réponse est non. Le droit le dit. La morale le dit. L’Histoire le dit. »3 La décision de justice sera rendue le 13 avril 2026… Lafarge, LafargeHolcim (2014), Holcim (2021), note à nous-mêmes : ne jamais oublier !
➤ Lire aussi | Accusé Lafarge : on n’oublie pas・Léon Baca (2025)
Le chapitre du livre de Léa Hobson se déplace ensuite vers les métropoles et leurs périphéries, où ne règnent pas seulement la consommation accélérée des sols et la captation des terres arables mais aussi la reconfiguration en profondeur de l’acte de bâtir. La standardisation du béton, notamment à travers les dispositifs normatifs produits par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), constitue une étape décisive de cette double domination, territoriale et sociale. La norme, ici, n’est pas un simple outil technique : elle fixe un horizon du possible, verrouille les alternatives matérielles et façonne les gestes professionnels. Après 1945, bâtir en pierre devient progressivement marginal ; la norme dite “B10.001”, en définissant la gélivité (sensibilité au gel) des pierres, contribue à disqualifier durablement leur usage (p. 107). Ce basculement s’accompagne d’une profonde dépossession du rapport à la matière. On ne taille plus la pierre : on coule du béton. Cette dépossession, à la fois matérielle et symbolique, efface le travail derrière le produit fini, masque les conditions de production du bâti et naturalise un régime constructif présenté comme inéluctable. Les savoir-faire se trouvent réduits à des procédures standardisées, les corps relégués à de simples fonctions d’exécution, tandis que la machine industrielle supplante l’intelligence du geste. Si le béton semble s’affranchir de la « main » (p. 85), cette fiction d’un matériau autonome, coulé comme une évidence technique, se heurte à la réalité des corps qui le produisent. Car le béton abîme et tue : lésions cutanées, « gale du ciment », pathologies liées à la poussière de silice (classée cancérogène), rappellent combien cette industrie repose sur une exploitation ancienne, discrète et persistante. La faiblesse de la réglementation française en matière de protection des travailleur.se.s révèle cette asymétrie fondamentale, car derrière l’apparente neutralité du matériau se dissimule la violence d’une chaîne productive largement invisibilisée. Cette dimension se donne à voir avec une acuité particulière dans les géographies sociales de l’exploitation. Les travailleur.se.s du BTP, souvent issu.e.s de l’immigration, occupent des positions structurellement vulnérables au sein d’un secteur où les capacités de mobilisation collective se sont dégradées.
La standardisation du béton constitue une étape décisive d’une double domination, territoriale et sociale.
Cette vulnérabilité structurelle s’inscrit également dans un rapport de forces plus large, où les asymétries sociales se prolongent dans les arènes normatives et discursives. Les batailles de normes qui opposent bétonneurs et défenseurs des matériaux naturels sont aussi des batailles sociales ; et, là encore, l’industrie l’emporte le plus souvent. Cette hégémonie normative se double d’une remarquable capacité d’adaptation discursive. Bétons dits « verts », « bas carbone » (p. 115), labels environnementaux et certifications durables prolifèrent, tandis que des fondations industrielles, comme la fondation (Lafarge)Holcim finançant une chaire de « construction durable » à l’ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule en allemand ou « École polytechnique fédérale » (EPF) en français) (p. 113), contribuent à redéfinir les termes légitimes du débat. Le greenwashing devient une stratégie structurelle où il s’agit de transformer marginalement le produit tout en préservant intact le système qui le rend nécessaire.

La crise du logement offre un terrain supplémentaire pour observer l’hégémonie bétonnée. Léa Hobson rappelle que les politiques publiques, via les dispositifs fiscaux et les règles de construction, ont alimenté une spéculation immobilière déconnectée des besoins réels : 850 dérogations ont par exemple permis de reclasser des communes entières (p. 124), renforçant l’attractivité fictive et les rentes foncières. La pénurie supposée de logements ne résiste pas à la statistique : 18 % des logements ne sont pas occupés en permanence, parmi lesquels 3 millions de logements sont vacants. Une minorité de 24 % des ménages détient les deux tiers du parc, signe d’inégalités structurelles (p. 127). La construction neuve l’emporte, tandis que la rénovation reste sous-financée. Quant au binôme démolition-reconstruction, qui entretient une obsolescence programmée du bâti souvent justifiée au nom de la rénovation urbaine, de la performance énergétique ou de la modernisation, il permet en réalité de relancer en continu le flux minéral. Détruire pour reconstruire en est l’un des rouages.
Face à ce constat, des alternatives émergent. Des initiatives citoyennes comme House Europe (p. 129) proposent de limiter les démolitions et constructions neuves, afin de favoriser la réparation et de redonner une valeur d’usage et de sens au bâti existant au-delà des actifs financiers qu’ils représentent pour certain.e.s. À l’inverse, la rénovation urbaine institutionnelle, dont l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) constitue une figure centrale, est analysée par l’auteure comme une réponse largement illusoire aux inégalités urbaines (pp. 132-135). Les opérations qu’elle promeut, fréquemment fondées sur des logiques de démolition-reconstruction, produisent des effets sociaux particulièrement violents. Elles effacent non seulement des bâtiments, mais aussi des mémoires sociales, des usages et des formes d’attachement au lieu. En s’appuyant sur la pensée d’Henri Lefebvre (p. 139 et 140), l’auteure, comme de nombreu.ses.x autres avant elle, rappelle que le béton agit ici comme un opérateur d’inégalités socio-spatiales, en figeant les rapports de pouvoir dans la matière, en stabilisant des formes d’exclusion durable, et en rendant toute transformation ultérieure coûteuse, techniquement et politiquement. Le béton est une infrastructure de pouvoir, indissociable des régimes normatifs, économiques et institutionnels qui organisent la production de l’espace au sens lefebvrien.
➤ Lire aussi | Araser, creuser, terrasser : comment le béton façonne le monde・Nelo Magalhães (2024)
Désarmer : luttes, décroissance et réinvention du bâtir
C’est précisément contre la naturalisation du béton, analysée dans les chapitres précédents, que le dernier mouvement de Désarmer le béton, ré-habiter la terre affirme un projet explicite de désarmement. Le terme n’est ni métaphorique ni consensuel. Emprunté aux luttes pacifistes et écologistes, il engage une rupture nette avec les registres technocratiques de l’« amélioration » ou de l’« optimisation ». Pour l’auteure, certaines infrastructures sont trop destructrices pour être simplement corrigées à la marge, et le béton, tel qu’il est produit, normé et mobilisé aujourd’hui, relève de cette catégorie (pp. 141–148).
Cette perspective permet à Léa Hobson d’articuler étroitement les luttes locales contre l’extraction à une critique systémique de la production de l’espace. Les mobilisations rurales contre les carrières, les gravières ou les cimenteries, souvent reléguées aux marges du débat urbain, apparaissent ici comme des foyers d’élaboration politique majeurs (pp. 148–155). L’auteure montre que ces luttes accumulent des savoirs situés tels que les connaissances juridiques, les expertises environnementales, les pratiques de coalition ou encore les récits alternatifs du territoire. Elles constituent ainsi des laboratoires d’un autre rapport au sol, au bâti et au temps long. Elles permettent surtout de faire réémerger les questions centrales autour de l’habiter telles que : comment construire sans s’imposer ? Comment habiter sans déposséder ? (p. 152). Ces interrogations prennent une épaisseur particulière lorsque l’enquête s’ouvre aux présences plus-qu’humaines qui peuplent ces territoires en lutte, dont la chauve-souris, la genette, le hibou grand-duc, ou encore la linotte mélodieuse. Cette co-présence signale que la conflictualité engage des mondes écologiques entiers. Construire n’est jamais neutre ; c’est toujours intervenir sur des milieux, des usages, des vies humaines et non humaines. Le béton, parce qu’il fige durablement ces interventions, rend cette responsabilité particulièrement aiguë.
Dans cette perspective, des gestes souvent perçus comme mineurs, faire avec l’existant, réparer, entretenir, transformer sans démolir, ralentir les rythmes de production, acquièrent une portée profondément politique (pp. 177–180). Ils s’opposent frontalement à un système fondé sur l’accélération, la standardisation et le renouvellement permanent du bâti. Le désarmement du béton apparaît alors moins comme une solution clé en main que comme une éthique du bâtir, faite de renoncements, de négociations et de pratiques situées.

Féminisme, décolonialité et soin : élargir la critique
L’une des forces majeures de l’ouvrage réside dans l’articulation étroite que Léa Hobson opère entre critique matérialiste, féminisme et perspectives décoloniales. En introduisant la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155 et 156), l’auteure réalise un déplacement analytique décisif afin de relire l’histoire de l’architecture et de la construction depuis ses angles morts. Loin d’une critique abstraite, elle montre comment cette histoire, largement masculine, occidentale et productiviste, s’est constituée par une série d’exclusions : invisibilisation des femmes, disqualification des savoirs vernaculaires, marginalisation des pratiques situées, souvent associées à des contextes non occidentaux ou ruraux (pp. 157–164). Le béton, en tant que matériau standardisé, reproductible et exportable, a joué un rôle central dans cette entreprise d’uniformisation, en effaçant les différences locales et les relations sensibles aux milieux.
Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.
La critique féministe et décoloniale débouche alors sur une interrogation profonde sur le rôle de l’architecte et des dispositifs de formation. Léa Hobson analyse la manière dont l’architecture s’est progressivement constituée comme un service industrialisé, éloigné des pratiques artisanales et des responsabilités matérielles directes (pp.165–173). Les écoles d’architecture, en reproduisant les normes professionnelles dominantes, participent à cette dépolitisation du geste de bâtir. Repolitiser l’architecture implique dès lors de sortir des silos disciplinaires, de reconnecter l’acte de construire aux luttes sociales et écologiques, et de reconnaître que dire non, collectivement, constitue aussi un geste professionnel à part entière. En écho aux travaux récents de Mathias Rollot (Décoloniser l’architecture, 2024) et de Philippe Simay (Bâtir avec ce qui reste, 2024), Léa Hobson s’inscrit dans une critique frontale de la réduction du champ de l’architecture à une pratique formelle et disciplinaire, largement détachée de ses conditions matérielles, sociales et écologiques4 C’est dans ce prolongement que la notion de soin vient compléter et approfondir le projet de désarmement. Prendre soin des bâtiments, des sols, des infrastructures vieillissantes, c’est rompre avec la logique de la table rase et de l’innovation permanente (pp. 174–180). L’auteure propose de lire les fissures, les pathologies du béton comme les symptômes matériels de l’épuisement d’un modèle de développement. Le béton devient ainsi un matériau « malade », dont la fragilité contredit le mythe de la durabilité infinie.
Faire de l’entretien, de la réparation et de la maintenance un enjeu politique central revient alors à renverser les hiérarchies de valeur qui structurent la production de l’espace. Ces gestes, historiquement dévalorisés car associés au féminin, au domestique ou à l’invisible, acquièrent une portée critique majeure. Ils déplacent l’attention depuis l’acte héroïque de construire vers les pratiques ordinaires de maintien en vie des milieux bâtis. En ce sens, la politique du soin esquissée par l’auteure représente une véritable alternative au régime bétonné, attentive aux temporalités longues, aux interdépendances et aux vulnérabilités partagées. Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.
➤ Lire aussi | Le retour à la terre des bétonneurs・Aldo Poste (2020)

En définitive, Désarmer le béton, ré-habiter la terre s’impose comme un ouvrage précieux et dense, tant par la richesse de ses matériaux empiriques que par ses références théoriques. Il articule finement critique matérielle, analyse politique et attention aux pratiques ordinaires du bâtir. En dialoguant habilement avec de nombreux travaux récents sur le sujet5, Léa Hobson montre que le béton relève d’une infrastructure mentale, sociale et matérielle qui organise la production de l’espace, invisibilise ses chaînes extractives et dépolitise ses violences. En réinscrivant le bâti dans ses conditions écologiques, sociales et historiques, elle contribue à déplacer la critique architecturale vers une écologie politique des matériaux.
Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.
Si l’ouvrage s’inscrit principalement dans un champ francophone, ce que l’on peut éventuellement regretter, il pourrait néanmoins ouvrir une question décisive : comment cartographier, de manière multiscalaire, les géographies du béton, ses régimes d’extraction, ses imaginaires et ses effets différenciés sur les territoires et les corps ? Cette question appelle, dans le prolongement critique du livre, à penser ces géographies sans céder à une idéalisation du local ni à un repli communautaire. Car si les luttes bretonnes, normandes, ardéchoises, haut-saônoises ou encore euréliennes, et les expérimentations territoriales qu’elles portent, constituent des foyers essentiels de résistance, d’invention et de politisation des pratiques constructives, elles ne sauraient à elles seules répondre à l’ampleur d’un système productif désormais pleinement mondialisé. C’est également dans la mise en relation de ces expériences, à l’échelle européenne voire planétaire, que se joue une part décisive de la transformation à venir.
Si une partie du continent européen est aujourd’hui marquée par la saturation, la démolition-reconstruction ou l’accumulation d’infrastructures, d’autres régions du monde, en particulier en Asie et en Afrique, connaissent une phase d’expansion spatiale et urbaine massive, appelée à engloutir, dans les décennies à venir, des volumes de granulat sans précédent, soit autant de trous dans les paysages et de processus d’artificialisation qui les accompagnent. Dès lors, l’enjeu consiste à mettre en dialogue ces initiatives au-delà des frontières nationales et continentales, afin de tisser patiemment des solidarités translocales. Celles-ci doivent permettre d’articuler savoirs situés, pratiques constructives alternatives et luttes écologiques, pour penser collectivement ce que pourrait signifier habiter et bâtir autrement dans un monde déjà profondément façonné par le béton. Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.
Image d’accueil : Photo de Francisco Andreotti sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Terme que l’on retrouvait également dans l’ouvrage Béton : enquête en sables mouvants de Claude Baechtold, Alia Bengana et Antoine Maréchal, Les Presses de la Cité (2024), p. 64.
- Léon Baca, « Accusé Lafarge : on n’oublie pas ». Terrestres, décembre 2025
- Article écrit par Fabrice Arfi dans Médiapart le 10 décembre 2025 : « Procès Lafarge : “C’est dans ce moment précis, au Bataclan, que des décisions économiques abstraites deviennent des tirs sur des corps” ».
- Mathias Rollot souligne ainsi l’angle mort persistant d’une critique architecturale qui continue de commenter « les formes, les fonctions et les symboliques architecturales » à partir de « filtres entièrement disciplinaires », tout en se préoccupant « si peu de la manière dont tout ceci impacte concrètement les écosystèmes » (Rollot, 2024, p. 50). De son côté, Philippe Simay alerte sur « le risque évident à réduire le champ de compétences de l’architecte à la seule conception spatiale », au prix d’un oubli des « dimensions sociales et écologiques des conditions matérielles du projet » (Simay, 2024, p. 15), et décrit une profession ayant « intériorisé les impératifs d’optimisation » pour se mettre « au service du productivisme et de la société du gâchis » (ibid., p. 16). C’est précisément cette abstraction du projet que Léa Hobson rend lisible à travers l’hégémonie du béton : plus qu’un simple matériau, celui-ci apparaît comme une infrastructure mentale et organisationnelle qui rend possible l’industrialisation du bâti tout en invisibilisant les chaînes extractives, les savoir-faire, les corps et les territoires mobilisés. En ce sens, son analyse prolonge l’appel de Philippe Simay à « relier les montagnes aux trous, les fosses aux gratte-ciels » (ibid., p. 39), tout en rejoignant la volonté de Mathias Rollot de décoloniser l’architecture en s’attaquant non seulement à ses récits, mais aux structures mentales et matérielles qui la constituent (Rollot, 2024, p. 63). L’enjeu est de transformer radicalement ce que bâtir signifie, en réinscrivant l’acte architectural dans des relations situées, écologiques et politiques avec le monde vivant.
- À ce sujet, consulter la recension de François Jarrige Le béton, matériau extraterrestre publié dans la revue Terrestres (septembre 2024), où sont mis en dialogue quatre ouvrages majeurs sur le béton : Alia Bengana, Claude Baechtold, Antoine Maréchal, (2024). Béton. Enquête en sables mouvants, Presses de la cité ; Armelle Choplin, (2020). Matière Grise de l’urbain. La vie du ciment en Afrique, MétisPresses ; Anselm Jappe, (2020). Béton. Arme de construction massive du capitalisme, L’échappée ; Nelo Magalhães, (2024). Accumuler du béton, tracer des routes. Une histoire environnementale des grandes infrastructures, La Fabrique.
L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.
05.02.2026 à 18:45
La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse
La rédaction de Terrestres
Souhaitable, la réindustrialisation ? Déroutées par la course impériale à la puissance, les élites ultralibérales chantent le retour de l'industrie en Europe. Et si on réfléchissait plutôt à la dynamique technologique incontrôlable et à ses effets de domination ? Pour cette sixième rencontre Terrestres, retour sur la pensée du philosophe Herbert Marcuse.
L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (2675 mots)
Temps de lecture : 5 minutes
Table-ronde le jeudi 5 février avec les philosophes Aurélien Berlan, Haud Gueguen et Jean-Baptiste Vuillerod. Une rencontre organisée par Terrestres à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30). Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.
Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.
Qui connaît encore le philosophe allemand Herbert Marcuse (1898-1979) ? À la mort de celui-ci, André Gorz, figure de l’écologie politique alors en pleine ébullition, lui rend hommage : « Nous sommes tous enfants de Marcuse ». Peut-on lire cette formule comme une invitation à voir dans Marcuse un intellectuel qui a contribué à nourrir le fond théorique et politique de l’écologie politique ?
Cette sixième Rencontre Terrestres explorera cette hypothèse en revenant sur son œuvre, relue à l’aune de l’effondrement écologique et de notre dépendance extrême aux technologies. Dès 1955, alors que l’enchantement par la consommation de masse domine, Marcuse développe depuis les États-Unis une critique du consumérisme et du type d’être humain qu’il produit.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Dans Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964), Marcuse analyse la nature de la technologie moderne afin de comprendre dans quelle mesure elle participe d’un projet politique et capitaliste de domination. Cet examen le conduit à développer des thèses ambivalentes, voire contradictoires : il perçoit à la fois le caractère aliénant du pouvoir technologique, mais également ses potentialités émancipatrices dans l’optique d’une révolution permettant une réappropriation de l’infrastructure du capitalisme industriel. Dans ces conditions, comment hériter de Marcuse ? Comment actualiser les chantiers théoriques et politiques qu’il a ouverts ? Comment le lire à l’heure de la prédation généralisée et de l’emballement technologique et climatique ?
Dans un colloque intitulé « Écologie et révolution » et organisé à Paris par André Gorz en 1972, Marcuse proposait de voir dans la « guerre contre la nature » le phénomène central pour analyser le capitalisme dans sa contradiction avec les écosystèmes et les milieux de vie. À l’heure de la catastrophe écologique, il est urgent de redécouvrir les leçons stratégiques de cet auteur en vue de s’atteler à la grande tâche politique qui demeure plus que jamais la nôtre : en finir avec le productivisme et les formes de subjectivité qui en soutiennent la destructivité.

La rencontre abordera les thèmes suivants :
1/ Pourquoi relire Marcuse aujourd’hui ? Les intervenant·es nous parleront de leur intérêt pour cette œuvre et analyseront le renouveau éditorial qu’il suscite dans divers pays.
2/ Retour sur le contexte de l’écriture de l’œuvre de Marcuse : rappel biographique ; brève présentation de la théorie critique de l’Ecole de Francfort et de son rapport à Theodor W. Adorno-Max Horkheimer ; engagement politique de Marcuse aux côtés des mouvements de jeunesse des années 1960-1970 et découverte de la question écologique.
3/ Discussion autour du diagnostic de Marcuse sur la technologie moderne : quelle est la nature de l’ordre socio-technique produit par la dynamique de rationalisation et d’industrialisation ? Comment le travail, l’ordre politique et les sujets sont-ils façonnés par le développement continu des forces productives ? Comment penser avec Marcuse une transformation du travail et des techniques, au service de l’émancipation et de l’autonomie ?
4/ Analyse de la pensée écologique de Marcuse : son élaboration théorique se fait en lien étroit avec une réflexion sur le féminisme, l’anticolonialisme et l’anti-autoritarisme, dans la mesure où il s’agit à chaque fois de mettre au jour une dimension spécifique de la domination capitaliste. Penser l’Anthropocène et le Capitalocène avec Marcuse signifie qu’une écologie politique conséquente est nécessairement anticapitaliste, féministe et anticoloniale.
5/ Comment articuler une critique du mode de production capitaliste et une critique de la modernité fondée sur un partage du monde où les êtres et les choses sont hiérarchisés selon la distinction nature/culture ? On fera ici dialoguer Marcuse avec les critiques contemporaines de la nature et du naturalisme (Descola, Latour) : le philosophe allemand défendait une approche où l’idée de nature, réélaborée dans le sillage de Marx, offre un point d’appui essentiel pour appréhender et penser la domination sociale et capitaliste de la nature. Dans cette perspective, le concept de nature est indépassable ; c’est le fondement à partir duquel on peut critiquer à la fois la modernité et le capitalisme.
Le jeudi 5 février 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des mariages – 2 place Baudoyer – 75004 Paris.
Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.
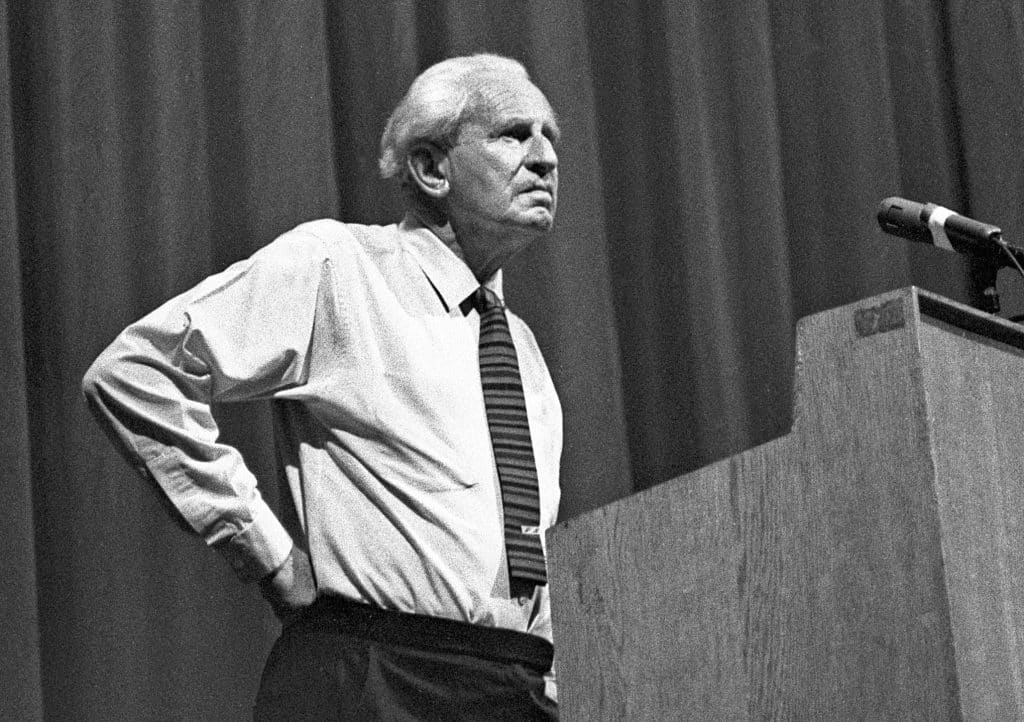
Intervenant·es :
Aurélien Berlan est maître de conférence au département de sciences économiques et gestion de l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Il a contribué aux écrits du Groupe Marcuse (De la misère humaine en milieu publicitaire, La Découverte, 2004 ; La Liberté dans le coma, La Lenteur, 2013). Il a publié un essai sur la critique de la modernité industrielle par les sociologues allemands : La Fabrique des derniers hommes (La Découverte, 2012), et une théorie de la liberté articulée au féminisme de la subsistance : Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021).
Il a notamment écrit dans Terrestres : Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance et Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre.
Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Ses travaux portent sur les sciences humaines et sociales du possible et sur l’histoire du néolibéralisme. Elle a notamment publié Herbert Marcuse. Face au néofascisme (Paris, Amsterdam, 2025) ; avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), et avec Laurent Jeanpierre : La Perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).
Elle a notamment écrit dans Terrestres : Désirer après le capitalisme.
Jean-Baptiste Vuillerod est agrégé et docteur en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie de Hegel et ses réceptions dans les pensées critiques contemporaines : la philosophie française des années 1960, l’École de Francfort, les théories féministes, l’écologie politique. Il a notamment écrit Theodor W. Adorno : La domination de la nature (Amsterdam, 2021).
Il a écrit dans Terrestres : L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes.
Pour écouter les anciennes Rencontres Terrestres, c’est ici.
Photo d’ouverture : Herbert Marcuse with his then UC San Diego graduate student Angela Davis, 1969. Crédits : Monoskop.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.
31.01.2026 à 13:15
Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France
Stéphane Tonnelat
Une balade naturaliste au nord du Grand Paris, parmi les fauvettes et les églantiers, ça vous dit ? Dans son livre “Sauver les terres agricoles”, l’ethnologue Stéphane Tonnelat raconte la lutte du Collectif pour le Triangle de Gonesse contre l’artificialisation des terres agricoles en général et le mégaprojet EuropaCity en particulier. Extrait.
L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6667 mots)
Temps de lecture : 15 minutes
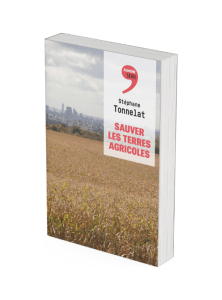
Extrait du livre de Stéphane Tonnelat Sauver les terres agricoles, paru en 2026 aux éditions du Seuil dans la collection « Écocène ». Retrouvez une présentation dessinée par Yug du récit de l’enquête de Stéphane de Tonnelat ici (2024).
Scène 12 : « Un grenier pour les oiseaux ». Où l’on découvre la biodiversité, un milieu complexe, à la fois agricole et sauvage, une écologie bâtie sur les ruines d’une économie industrielle. Bienvenue dans l’Anthropocène !1
Une visite naturaliste
Quand j’arrive à 9 heures ce samedi 25 mai 2019, sous un ciel gris blanc, une semaine après la troisième fête des terres de Gonesse, Georges le naturaliste patiente à la barrière agricole. C’est un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux raides en mèches rabattues qui lui donnent un air réservé. Mais son visage s’anime lorsqu’il sourit d’un air entendu, comme s’il était au courant d’un scoop : « J’ai eu le temps de faire un tour et j’ai entendu un oiseau intéressant, une tourterelle des bois ! On n’entend pas la même chose à l’aller et au retour, il faut vraiment prendre son temps. »
Pendant que nous attendons les autres, il repère un gravelot en vol. C’est un oiseau limicole. Le nom vient du limon, c’est-à-dire qu’il habite les vasières. Il vit habituellement au bord de rivières pourvues de bancs de sable, des rivières aux cours non contrôlés. Mais les terrains vagues peuvent lui servir de remplacement, dit-il en pointant derrière la palissade. Jeanne arrive à pied. C’est une des quelques militantes qui habite Gonesse, investie aussi dans la lutte contre la chasse et l’exploitation des animaux d’élevage. Elle nous annonce essoufflée que l’hôtel de la Patte d’Oie a été rasé. Les travaux de démolition avancent sur les bords du Triangle. Les bâtiments ont d’abord été expropriés au nom de l’intérêt général, puis abandonnés aux éléments, leur toit enlevé pour empêcher toute occupation et accélérer le pourrissement. Aujourd’hui, le nettoyage commence. La friche serait-elle mûre pour la rénovation ? Georges n’est pas d’accord. Elle grouille de vie !
Denis et Béatrice nous rejoignent. Nous commençons à marcher sur le chemin de la justice vers le petit terrain où nous nous retrouvons les dimanches. Mais Georges nous arrête pour nous faire admirer une haie : « Les buissons d’églantiers et de cornouillers sanguins ne sont pas plantés en ligne. Ils sont arrivés de façon naturelle, disséminés par les oiseaux. Les étourneaux, les grives et les merles mangent les graines au printemps, les rejettent et elles germent au printemps suivant. Ces oiseaux créent le milieu pour d’autres espèces d’oiseaux qui vont nicher dans les buissons. Il faut huit à dix ans pour que le cycle soit bouclé. »
Pour Georges, nous avons là une magnifique haie adulte. Pour moi, elle vient d’apparaître. Une autre espèce endémique est le merisier ou cerisier des oiseaux. Les stries horizontales sur le tronc montrent que c’est un spécimen âgé. Les églantiers à fleurs roses sont des rosiers sauvages. Les fleurs n’ont que cinq pétales. Les fruits s’appellent cynorhodons. Dans mon enfance, on s’en servait pour faire du poil à gratter. On peut aussi en faire des confitures. Les buissons les plus nombreux sont les cornouillers sanguins. Les rameaux sont rouges sous la lumière. Ils produisent énormément de fleurs et leurs fruits sont très consommés par les oiseaux. Ils ont les feuilles opposées et non pas alternes comme les saules, communs dans le Triangle.
Georges insiste sur un point qu’il nous répétera de différentes manières : il apprécie les haies naturelles et n’aime pas les espèces plantées par les humains, particulièrement si elles ne sont pas du coin. Les peupliers d’Italie le long du chemin sont bien alignés, preuve qu’ils ont été plantés. Cela dit, les pics en ont besoin pour se nourrir d’insectes mangeurs de bois et ils servent de perchoirs : « Les haies spontanées nous parlent. Elles nous donnent des informations sur les sols et sur les oiseaux. Les haies plantées ne parlent pas. »

Je commence à comprendre la distinction entre indigène et étranger. Il ne s’agit pas tant de distinguer les plantes rudérales des invasives que de différencier celles qui se sont implantées toutes seules de celles qui n’ont pas eu le choix, plantées de la main de l’homme. Les premières choisissent leur environnement et c’est ainsi que, si l’on connaît leurs préférences, elles en viennent à nous parler2. Les autres n’ont pas eu voix au chapitre.
Au tournant, devant les palissades de la friche de l’entreprise de traitement de déchets polluants dont le bâtiment a été récemment détruit, Georges s’exclame de dépit en voyant les genêts en fleurs et les oliviers de bohème sur la butte qui nous fait face. « Ce sont des espèces d’ornementation typiques de bords de route ! » Juste derrière passe la voie rapide qui coupe le Triangle. Mais ces espèces peuvent aussi être diffusées par les oiseaux, auquel cas elles retrouvent un peu de leur agentivité3. C’est un endroit où personne ne s’arrête habituellement. Les oiseaux, en revanche, y sont nombreux. Leurs chants se mêlent au bruit des avions qui nous survolent toutes les deux minutes. Georges nous les pointe successivement.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Une linotte mélodieuse, dont le nom vient du lin qu’elle mangerait de préférence, est perchée dans un églantier. Elle appartient à la famille des fringilles. Son bec est très court et conique, fait pour broyer des graines. Georges sort son vieux guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe pour nous en montrer une reproduction. Il l’aime bien, son guide, car il présente tous les oiseaux de la même famille sur une page. La linotte mâle a la poitrine rouge. Elle fréquente les zones buissonnantes découvertes, comme la butte que nous regardons. Ainsi, comme les haies, les oiseaux nous parlent. Ils sont pris dans le même babillage qui constitue le milieu4.
Je lui demande si c’est une espèce protégée. Cela pourrait nous aider dans le procès qui nous oppose à la Société du Grand Paris, qui menace de commencer les travaux de la ligne 17 Nord dans les champs du Triangle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné deux avis négatifs successifs en réponse à leur étude d’impact qui sollicite une dérogation pour détruire des spécimens de 17 espèces d’oiseaux. Nos observations pourraient aider Maxime, le juriste de France nature environnement, désigné par le groupe juridique pour porter ce recours. Mais Georges n’aime pas les listes d’espèces protégées. Elles n’ont pas beaucoup de sens pour lui : « Je trouve la linotte intéressante ici, car on est à côté d’une zone urbanisée. Mais dans les études d’impact, ils ne font attention qu’à la rareté. »
Pour lui, l’important n’est pas qu’une espèce d’oiseaux soit inscrite sur une liste, mais qu’elle soit présente dans un milieu improbable. Il défend la protection d’une « nature ordinaire5 » composée d’espèces communes typiques des zones périurbaines, comme ces friches agricoles et industrielles, si près de l’agglomération. Banale, cette nature est aussi menacée que celle considérée comme plus exceptionnelle et ne fait pas l’objet de protection.
On entend une fauvette, commune ici, nous dit-il, car elle aime les zones buissonnantes et ensoleillées. Un hypolaïs polyglotte le ravit. Il nous aide à le repérer avec les jumelles. Il imite les cris des autres oiseaux au début de son chant. Mais à sa façon de répéter le motif, on entend bien que ce n’est pas une linotte. On ne trouve pas l’hypolaïs dans les jardins publics. Cette « fauvette » aime les tiges dégagées pour chanter, comme celle-ci, perchée au sommet d’un arbuste6. Elle est plutôt brune avec des taches claires sur le ventre et le cou. Un accenteur mouchet se perche en haut d’un olivier de bohème pour chanter. Celui-là est plus courant. On le voit dans Paris. Dois-je comprendre que cet oiseau et cet arbre sont moins remarquables, qu’ils ne nous parlent pas autant ?
Nous apercevons une fauvette grisette, au gré de ses courts vols entre les branches. Elle est repérable à sa chorégraphie. Elle vole en suivant une ligne mélodique qui monte, puis redescend, associant le geste à la parole. Les phrases sont appelées strophes, comme si les oiseaux nous chantaient des poèmes7.
Plus avant dans le chemin, Georges repère un chardonneret. Son nom vient du chardon qui serait son régime préféré. Mais ce n’est qu’indicatif, comme la linotte. C’est la première nichée. Il pointe le parent qui nourrit le jeune avec des graines de saule fragile. À côté, un saule cendré. Ces deux espèces indiquent de l’humidité dans le sol. Les saules font des pieds mâles et des pieds femelles. Le saule Marsault, aussi présent, est moins exigeant. Ses feuilles sont plus larges et duveteuses en dessous. Il est intéressant, car il attire les abeilles au printemps.

Naturel ou artificiel ?
Au-dessus de ce bouquet de saules, Denis remarque les cheminées de dégazage du talus, résidu de la construction de la voie rapide. Les travaux remontent au début des années 1990. Les ouvriers sont tombés sur une grande poche de déchets polluants, probablement déposés par l’entreprise de « retraitement » devant laquelle nous sommes passés il y a quelques minutes. Ils l’ont excavée et transformée en deux buttes, de part et d’autre de la voie. La base de données Basol indique que 40 000 m3 de déchets non contrôlés surmontant 20 000 m3 de terres polluées ont été mis au jour sur une surface de deux hectares. C’est un des « points noirs » de Gonesse, une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis 1994 à cause des composés organiques volatiles et du benzène dont l’origine reste inconnue8. Denis pointe un morceau de bâche noire mise à jour, ce qu’on appelle une « géomembrane ». Elle n’est recouverte que de 15 à 20 centimètres de terre végétale. Dessous, les gravats et les déchets toxiques ne sont pas censés recevoir l’eau de pluie qui ruisselle sur la bâche et nourrit les saules au bord du chemin. Les travaux de la route et l’enfouissement des déchets ont fabriqué une zone humide dans laquelle les saules se sont installés. Cette haie nous parle non seulement de la nature, mais aussi des travaux de l’homme auxquels elle s’est adaptée. La confusion entre naturel et artificiel grandit dans mon esprit.
Cette observation me fait questionner la division que Georges entretient entre les espèces indigènes plantées par les oiseaux et celles apportées par l’homme. Il me semble que dans le cas ci-dessus, la distinction est difficile à maintenir. Certaines espèces comme l’olivier de bohème sont importées comme ornementation, mais on voit bien qu’aujourd’hui, elle s’est replantée toute seule avec l’aide des oiseaux et s’est intégrée à la flore locale. À l’inverse, les saules qui se plantent tout seuls bénéficient de l’humidité apportée par la bâche isolante d’un tas de déchets toxiques installé par une voie rapide. Lequel est le plus naturel ?

« Une troisième nature »
J’aurais tendance à voir ce paysage comme un résidu sur lequel de nouvelles ambitions se projettent aujourd’hui. Ces ruines industrielles et agricoles deviennent une opportunité foncière pour un projet qui cherche à minorer la biodiversité qui a grandi dans les marges des cultures et des aménagements routiers. Cela me fait penser au champignon Matsutake d’Anna Tsing9, qui ne pousse que dans les forêts ravagées par l’exploitation industrielle. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait similaire. Mais on est bien dans une friche de l’aménagement, une zone d’aménagement différé depuis 1994, qui a conservé une activité marginale agricole, mais aussi d’industrie polluante et de squats divers et variés, y compris par les plantes. Cette friche a construit sa propre diversité, une nature ordinaire « interstitielle » au sens de Pierre Sansot10, ce que Anna Tsing appelle une « troisième nature », ou « écologie férale » : « Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain11. »
Plutôt que de retrouver des haies antiques, Georges prend ce paysage comme il est, un mélange de développement et de désinvestissement urbain avec ses haies mixtes, en quelque sorte ré-ensauvagées. Il faut dire qu’on est servi par les infrastructures avec deux autoroutes, deux aéroports et trois centres commerciaux. Il est occupé par une agriculture industrielle en instance d’expulsion depuis vingt-cinq ans. Ces équipements et ces pratiques en ont fait une zone oubliée de la plupart des habitants.
➤ Lire aussi | Devant l’anéantissement du vivant, des naturalistes entrent en rébellion・Les naturalistes des terres (2023)
Lutter contre l’aliénation du vivant
De l’autre côté du chemin, Georges remarque une plante invasive, le buddleia, souvent appelée « arbre à papillons ». Elle vient de Chine (comme le groupe Wanda, partenaire d’Auchan dans le projet EuropaCity, je ne peux m’empêcher de penser à cette connexion). Elle pousse bien dans les friches, mais dès que la terre devient plus riche, elle se fait doubler, ce qui fait que sa présence reste limitée. Ce côté du chemin est marqué par une levée de terre, constituée de gravats mêlés à des déchets plastiques. Nous l’escaladons et dans le creux derrière, nous découvrons un dense taillis de saules variés et de merisiers : une nouvelle zone humide créée incidemment par l’homme. Elle ne figure pas à l’inventaire de l’étude d’impact de la ligne 17 Nord qui ne considère que les zones naturellement humides, quel que soit le sens de cette nature. Mais elle y figure comme « zone d’évitement. » Les aménageurs sont censés prendre des mesures, imposées par le code de l’environnement, pour limiter la perte de biodiversité. La première, celle à privilégier, est l’évitement. Cela signifie que les travaux ne devront pas toucher cette zone qui devient une forme de mini réserve naturelle. Le problème est que cette zone sera peut-être évitée par les travaux du métro, mais elle ne le sera pas par ceux de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) servie par la gare à venir. À quoi sert une zone d’évitement dont on sait qu’elle sera bâtie ? Au tribunal, les avocats de la SGP nous diront que ce sera aux aménageurs de la zone, qui viendront après le métro, de prévoir des mesures de réduction de l’impact et, si la zone est détruite, de compensation. Évitement, réduction et compensation, dans cet ordre, sont les trois mesures imposées. Dans la pratique, la plupart des aménageurs vont directement à la compensation, car elle leur laisse plus de place pour construire sans contrainte. Pour Georges la compensation n’a aucun sens12. Elle sépare une espèce de son milieu pour la réintroduire ailleurs. Là-bas, dans cette réserve, elle ne peut parler, car elle est sortie de l’enchevêtrement (Anna Tsing utilise le mot anglais entanglement) qui animait sa vie. Elle est aliénée dans un sens non seulement économique, car elle sert de ressource pour l’investissement, mais aussi dans un sens écologique, car elle sert de justification à la destruction de son milieu d’origine : « L’aliénation rend l’enchevêtrement de la vie et de l’espace inutile. Le rêve de l’aliénation inspire les transformations du paysage, seul un actif dégagé du reste compte ; tout le reste devient mauvaises herbes ou déchets13. »
La lecture de Tsing m’aide à comprendre le monde contre lequel se mobilise Georges. L’aliénation n’est pas une conséquence des projets d’urbanisation, mais un projet de société. Il consiste à faire du moindre aspect de la vie un élément isolé, catégorisable et quantifiable, pertinent parce que destiné à un type préétabli d’utilisation ou d’investissement, mais qui ne compte plus pour rien sorti de cette logique de valorisation14. Pour Tsing, ce projet de société ne produit que des ruines, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, dans laquelle une « écologie férale » peut ressurgir. Alors pourquoi se mobiliser si la nature finit toujours par revenir. Peut-être parce qu’à force d’hubris, ces infrastructures, comme la ligne 17 et EuropaCity, finiront par annihiler les conditions de notre propre survivance ? Non seulement nous perdrions une occasion de nous nourrir localement et de tisser des solidarités, mais en plus, à force de tout segmenter pour les besoins du marché, la féralité résurgente pourrait devenir mortifère15, à l’image de virus déterrés par les travaux, ou de ces daturas, plantes toxiques qui poussent sous les maïs du Triangle et peuvent finir dans l’ensilage destiné à nourrir les animaux d’élevage.

Un grenier continu
Au bord du chemin, nous admirons un magnifique bouillon-blanc avec ses grandes feuilles duveteuses. Ses fleurs sont très appréciées des abeilles. La potentille a des fleurs jaunes qui la font ressembler à des boutons d’or. Quelques coquelicots sont sortis dans la haie, tandis qu’aucun de ceux que nous avons plantés dans le jardin, en réponse à l’appel « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino, n’a daigné pousser. Georges remarque une aubépine qui le ravit, car, explique-t-il : « Avec les églantiers et les cornouillers sanguins, elle participe à une succession de floraisons et de graines qui peuvent nourrir les oiseaux du printemps à l’été. Elles accueillent des espèces migratrices qui n’arrivent pas à la même période. C’est un grenier continu. »
Je suis frappé par cette expression de « grenier continu. » D’un seul coup, le Triangle n’est plus seulement un grenier pour nous les humains, mais aussi pour les oiseaux. Les deux seraient-ils compatibles ? C’est peut-être ce que nous dit cette visite.
Georges et moi traversons un grand champ de blé. Les épis sont déjà bien formés alors que les tiges ne sont pas encore hautes. M. Étienne nous avait parlé de produit raccourcisseur pour prévenir le risque qu’ils se fassent coucher par une grosse pluie ou par des nuages d’étourneaux. Georges préfère les blés au maïs. Ils montent plus vite et offrent un couvert où des oiseaux peuvent nicher dès la fin du printemps. Nous entendons de nombreux cris d’alouettes et de bergeronnettes. Nous en apercevons quelques-unes voler furtivement sous le niveau des épis. Les traces des pneus du tracteur sont espacées de 36 mètres, la largeur du diffuseur d’intrants du tracteur du fils de M. Étienne qui vient de contracter un prêt de 220 000 euros pour acheter cet engin adapté aux très grandes surfaces, comme ce champ cultivé maintenant pour l’ensemble des exploitants du Triangle. Les traces offrent des sentiers tout à fait praticables. Le poids de l’engin, autour de 15 tonnes, compacte le sol et empêche toute repousse.
Nous avons la chance d’observer une bergeronnette printanière perchée sur un blé à peine plus haut que les autres. Elle est à une dizaine de mètres et, à la jumelle, nous la voyons très bien. Son ventre est jaune canari. C’est un mâle. Nous sommes saisis par cette tache de lumière qui ne nous prête pas attention. Nous échangeons des sourires complices. Les blés aussi nous parlent ! Ils sont greniers pour nous comme pour ces oiseaux. Les deux sont compatibles, ce qui me rassure.

De nouvelles raisons de se mobiliser
Je demande à Georges comment il a découvert le Triangle. Il était à un dîner où Étienne, l’avocat du Collectif, était invité et leur a expliqué qu’il défendait ces terres. Ça l’a rendu curieux. Il est venu une première fois, dans le nord du Triangle, puis à la fête la semaine dernière, où je l’ai rencontré.
– Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
– Je fais des études de terrain comme ici, pour des associations. Mais je refuse de travailler pour des bureaux d’études qui ne s’intéressent qu’à la rareté.
– Ce ne doit pas être facile de gagner ta vie avec les associations…
– Oui, c’est vrai.
Il n’élabore pas. J’ai l’impression qu’il vit de peu. Ses vêtements sont modestes. Je me dis qu’il est fidèle à ses idéaux et j’admire sa détermination à rester du côté du vivant ordinaire, celui qui ne rapporte pas d’argent, mais qui nous lie dans un enchevêtrement résistant à la marchandisation. Je lui dis que ce serait bien de dresser un inventaire qu’on pourrait comparer aux études d’impact. Le Collectif serait sûrement prêt à payer. Quinze jours plus tard, il enverra un premier inventaire qui ravira les militants. Beaucoup d’entre nous découvrent alors une nouvelle perspective sur le Triangle. Le site est plus habité que nous le croyions. Il grouille de formes de vie inconnues de la plupart d’entre nous, qui nous parlent de ce milieu et nous montrent sa nature à la fois ordinaire et connectée. Il nous montre la possibilité d’un monde fait de relations dans lesquelles nous serions pris, par opposition à celui des promoteurs qui m’apparaît maintenant comme une entreprise d’aliénation. Celles et ceux à qui cela parle ont de nouvelles raisons de s’opposer au capitalisme commercial spéculatif d’EuropaCity et à l’artificialisation des terres.
➤ Lire aussi | Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?・Marine Fauché · Virginie Maris · Clara Poirier (2022)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous., Seuil, « Points », 2016.
- David G. Haskell, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, 2017.
- Vanessa Manceron, « Exil ou agentivité ? Ce que l’anthropologie fabrique avec les animaux », L’Année sociologique, vol. 66, no 2, 2016, p. 279-298.
- Jakob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain et théorie de la signification, Paris, Denoël, 1984.
- Laurent Godet, « La « nature ordinaire » dans le monde occidental », L’Espace géographique, tome 39, no 4, 2010, p. 295-308.
- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.
- Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, 2022.
- Autorité environnementale, « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (95) », 26 avril 2017, p. 17-18.
- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2015.
- Pierre Sansot, « Pour une esthétique des paysages ordinaires », Ethnologie française, no 3, 1989, p. 239-244.
- Anna Lowenhaupt Tsing, « La vie plus qu’humaine », Terrestres, 26 mai 2019.
- Gilles J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 4, 2016, p. 601-616 ; Marthe Lucas, « Regards sur le contentieux français relatif aux mesures compensatoires : quarante ans d’attentes, de déceptions et d’espoirs portés par la jurisprudence », Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 2, 2018, p. 193-202.
- Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World…, op. cit., p. 5.
- Laura Centemeri, « Reframing problems of incommensurability in environmental conflicts through pragmatic sociology : From value pluralism to the plurality of modes of engagement with the environment », Environmental values, vol. 24, no 3, 2015, p. 299-320.
- Anna Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Paris, Seuil, « Écocène », 2025.
L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.
29.01.2026 à 15:58
Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien
Collectif
Le 28 décembre 2025, un soulèvement majeur a débuté en Iran, mobilisant une très large majorité sociale et spatiale du pays. Il a été écrasé dans le sang les 8 et le 9 janvier par la théocratie fasciste. 30 000 civil·es auraient été assassiné·es en quelques jours, 100 000 blessé·es. Cette tribune de soutien a été écrite depuis plusieurs endroits en rébellion dans le monde.
L’article Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (3645 mots)
Temps de lecture : 7 minutes
Les chiffres des morts et des blessés sont issus du récent article de la grande reporter Delphine Minoui, « “Dites au monde l’enfer que nous sommes en train de vivre” : en Iran, l’ampleur du massacre apparaît peu à peu », Le Figaro, 26 janvier 20261.
Nous vivons une tempête. Elle n’est ni nouvelle ni passagère. C’est la tempête du capitalisme, de l’impérialisme, du patriarcat et des États qui administrent la mort tout en parlant d’ordre, de stabilité ou de sécurité. Dans cette tempête, ceux d’en haut se disputent les territoires, les ressources et le pouvoir ; ceux d’en bas engagent leurs corps, leurs vies, leurs peurs et leurs espoirs.
En Iran, aujourd’hui, cette tempête frappe avec une violence particulière. Le peuple iranien s’est à nouveau mobilisé contre le régime de la République islamique qui n’a pas hésité à mener une répression violente contre celles et ceux qui descendent dans la rue. Ces mobilisations ne sont ni un fait isolé ni une réaction momentanée : elles sont le résultat cumulé de décennies d’oppression politique, d’exploitation économique, de violence patriarcale, de répression systématique et de déni des droits. Ce sont des luttes qui naissent de la base, de la vie quotidienne étouffante, de celles et ceux qui ne peuvent et ne veulent plus continuer à survivre en silence.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
En haut, les gouvernements et les puissances évaluent la situation d’un point de vue géopolitique. Ils calculent les avantages, les équilibres régionaux, les voies d’approvisionnement énergétique, les alliances opportunes. En haut, le crime est normalisé, justifié ou dissimulé sous des discours de « stabilité », de « sécurité » ou de « réalisme politique ». En haut, même ceux qui se présentent comme des ennemis du régime iranien n’hésitent pas à légitimer le massacre, lorsque celui-ci sert leurs intérêts.
Ce sont des luttes qui naissent de la base, de la vie quotidienne étouffante, de celles et ceux qui ne peuvent et ne veulent plus continuer à survivre en silence.
En bas, en revanche, le peuple iranien lutte pour la vie :
En bas, il y a les femmes qui défient quotidiennement le contrôle patriarcal.
En bas, il y a les travailleurs et les travailleuses appauvries par les politiques néolibérales.
En bas, il y a les dissidences sexuelles, les minorités religieuses, les peuples opprimés, celles et ceux qui vivent dans les banlieues touchées par la crise de l’eau, du logement et de l’emploi.
En bas, il y a celles et ceux qui sont descendues dans la rue à maintes reprises, souvent les mains vides, sans organisations étendues – détruites par la répression – et qui ont pourtant progressé plus loin que n’importe quelle opposition institutionnelle.
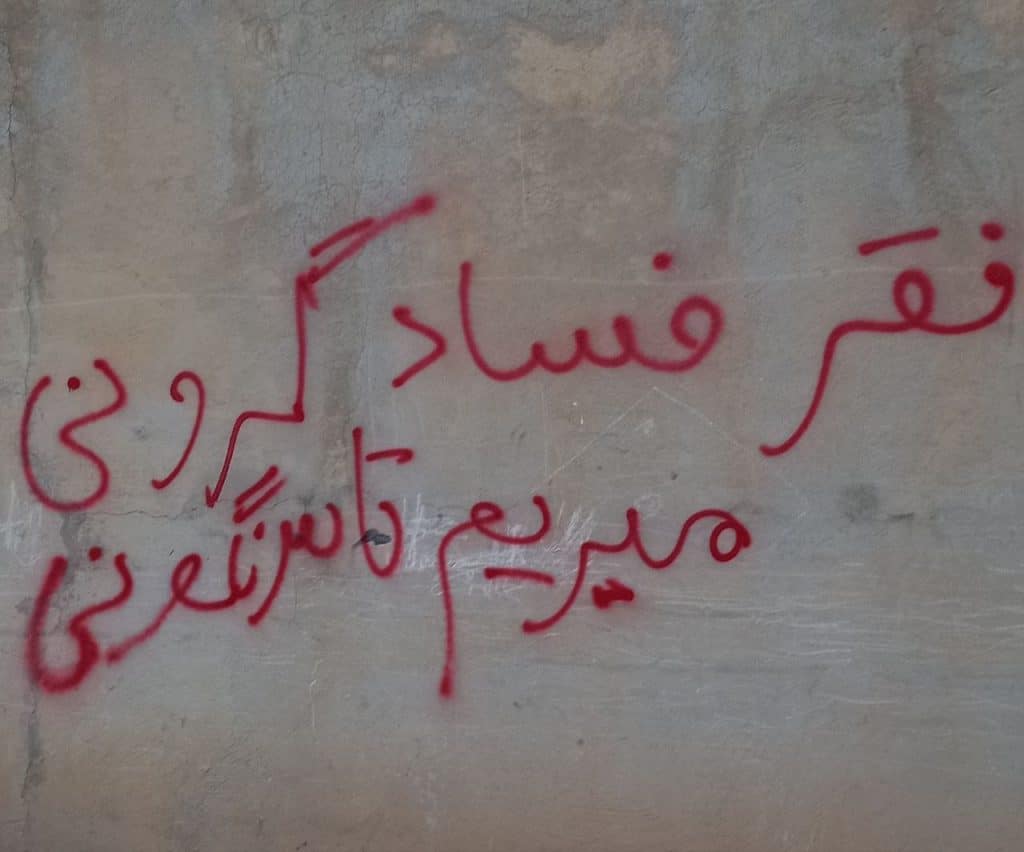
Nous dénonçons fermement la manipulation externe de ces manifestations. Aucune puissance étrangère, aucun gouvernement du Nord, aucun projet impérialiste n’a le droit d’utiliser la souffrance du peuple iranien comme un pion sur son échiquier. Cette instrumentalisation non seulement déforme les luttes réelles, mais elle met en danger plus grand encore celles et ceux qui résistent, en les transformant en prétexte pour une répression encore plus brutale.
Nous réaffirmons le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination. La liberté ne s’exporte pas et ne se négocie pas entre États. Aucune intervention impérialiste n’a jamais apporté justice ni dignité aux peuples qu’elle prétend « libérer ». L’histoire nous l’enseigne, et les ruines laissées dans leur sillage le confirment à maintes reprises.
Il y en a qui, de l’extérieur, regardent vers le haut et non vers le bas : qui justifient le régime iranien au nom d’un prétendu anti-impérialisme, ignorant que ce même régime applique à son peuple des logiques d’occupation, d’apartheid, de pillage et de néolibéralisme ; et qui promeuvent des alternatives réactionnaires, autoritaires et dépendantes, qui promettent le salut tout en reproduisant la domination.
Ce sont de fausses oppositions. Le haut contre le haut. Le pouvoir contre le pouvoir. En bas, le peuple est pris au piège entre deux forces qui se disent opposées, mais qui agissent de concert.
Notre position est claire : nous ne sommes pas avec les gouvernements, nous sommes avec les peuples. Pas avec les États, mais avec celles et ceux qui résistent. Pas avec les élites, mais avec celles et ceux qui luttent pour vivre.
La tempête est mondiale ; celles et ceux qui pensent qu’elle ne les concerne pas, qu’elle ne les touche pas, se trompent. Face à cette tempête, il n’y a ni sauveurs ni solutions venant d’en haut.
Aujourd’hui, alors que le peuple iranien est confronté à la coupure des communications, à l’état d’urgence et à la militarisation de la vie quotidienne, nous appelons à écouter les avertissements de nos compañeraset compañeroszapatistes : la tempête est mondiale ; celles et ceux qui pensent qu’elle ne les concerne pas, qu’elle ne les touche pas, se trompent. Face à cette tempête, il n’y a ni sauveurs ni solutions venant d’en haut. Ce qu’il y a, c’est la possibilité – urgente – d’unir les luttes d’en bas, de nous reconnaître dans le destin commun de celles et ceux qui résistent au capital, à l’impérialisme et à toutes les formes de domination.
Nous tendons la main au peuple iranien.
Non pas pour le materner.
Non pas pour parler en son nom.
Mais pour lui dire : vous n’êtes pas seules, vous n’êtes pas seuls.
Parce que la lutte en Iran est aussi la lutte pour la vie partout ailleurs. Et parce que ce n’est qu’en partant d’en bas, ensemble, que nous pourrons affronter la tempête et imaginer le jour après.
Janvier 2026
➤ Lire aussi | La Gen Z face à la corruption du monde・Alain Bertho (2025)
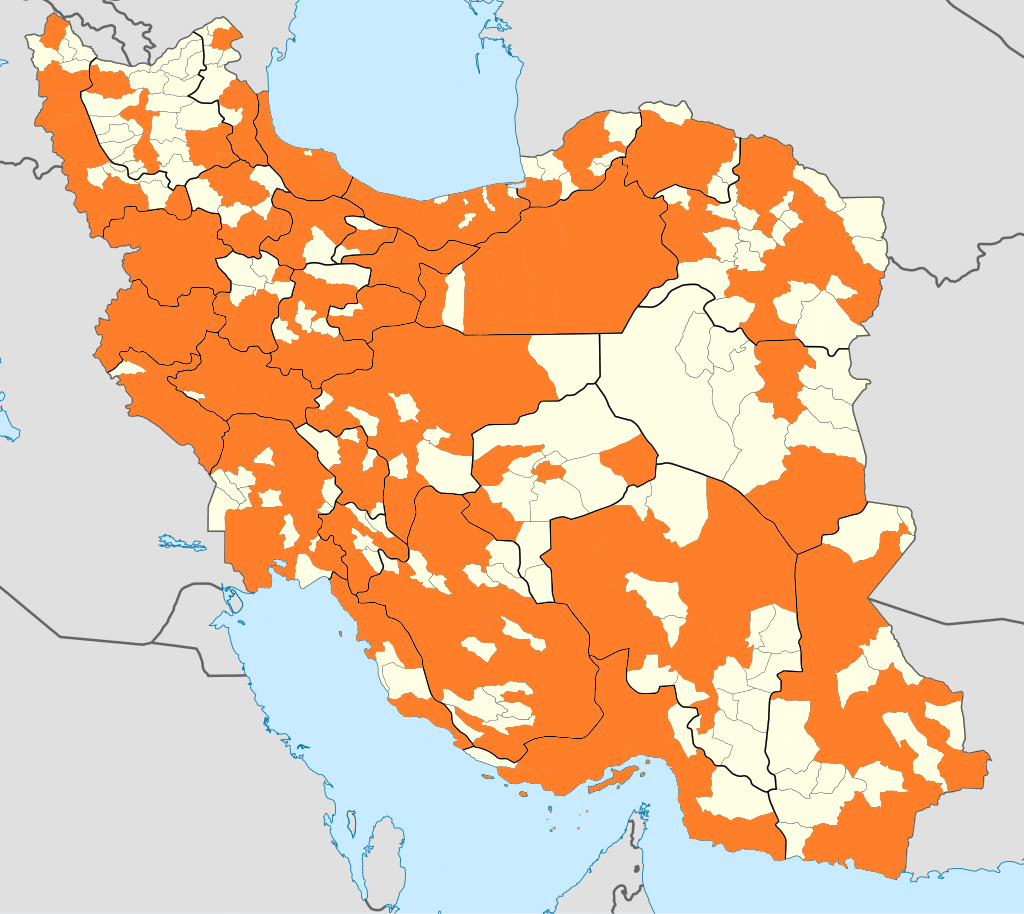
Pour associer sa signature, écrire à declaracion.iran@gmail.com
Signatures :
Armée zapatiste de libération nationale
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Αντιεξουσιαστική Κίνηση – Antiauthoritarian Movement. Greece
Acción Alternativa para la Calidad de Vida. Grecia
Alerta Feminista. Francia
Ambasada Rog, Ljubljana. Eslovenia
AmericaSol 12, Aveyron. France
Antiavtoritarna platforma. Eslovenia
Antsetik Ts’unun
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia
Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. México
Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani. Grecia
Asociación mexicana para la cooperación en Chiapas AMECOCH
Assemblea No Guerra, Palermo. Italia
Associazione Jambo. Italia
Associazione Ya Basta! Milano. Italia
Ateneo Libertario – Milano. Italia
Autogestione in Movimento-Fuorimercato. Italia
Batec Zapatista, Barcelona, Catalunya
Brigada Ricardo Flores Magón, La Paz, B.C.Sur, México
Cafe Libertad Kollektiv. Alemania
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona, Catalunya
CafeZ. Bélgica
Caracoleras De Olba, Teruel. Estado Español
Carea. Alemania
Carovane Migranti. Italia
Casa dei Popoli, Genova. Italia
Casa Madiba Network, Rimini. Italia
Casa Ojalá کاسا اوخالا. / México
Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Estado Español
Centro studi per l’Autogestione. Italia
Circolo Libertario « Emiliano Zapata », Pordenone. Italia
Citizens Summons, Bonn. Alemania
Colectivo Abya Yala. Mallorca
Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia
Colectivo Calendario Zapatista. Grecia
Colectivo La Insurgente, Jobel. Chiapas
Colectivo Zapatista de Lugano. Suiza
Collettivo UtopiA di Marigliano, Napoli. Italia
Comitato Chiapas « Maribel » – Bergamo. Italia
Comitato di Base No Muos – Palermo. Italia
Comitato piazza Carlo Giuliani. Italia
Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán
Comité de Solidaridad con Kurdistán-CDMX
Comunidad Okupa de Prosfygika, Atenas. Grecia
Confederación General del Trabajo (CGT). Estado Español
Confederazione sindacale nazionale USI 1912. Italia
Cooperazione Rebelde Napoli. Italia
Coro Libertario « La Rojinegra ». Departamento Hautes-Pyrénées 65. Francia
CSA Intifada Empoli. Italia
CSPCL, Paris. Francia
de:criminalize e.V.
El Grupo de La Puerta, Puebla/CDMX
El Tekpatl periódico crítico y de combate.
Empleados de la Cooperativa VIO.ME, Tesalónica. Grecia
Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor)
Federazione Anarchica Siciliana
Feminists for Jina
Frankfurt International. Alemania
Frente de Acción por Palestina Gudar-Javalambre, Teruel. Estado Español
Gemeinsame Kämpfen – Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie
Geo-grafías Conunitarias, Puebla. México
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.
Grupo Tlali Nantli
Gruppe B.A.S.T.A. Münster. Alemania
Gruppo Anarchico Bakunin – FAI Roma e Lazio
Ibili fundazioa, País Vasco
Iniziativa Libertaria – Pordenone/Italy
Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez
Interventionistische Linke (iL). Alemania
Kolectivo Txiapasekin. País Vasco.
Komite Internazionalistak, Ermua. Pais Vasco
La Vida, zapatisticni krožek, Ljubljana. Eslovenia
Laboratorio Popular de Medios Libres
Lumaltik Herriak. País Vasco
Lxs Hijxs del Maíz Pinto, Tlaxcala
Mexicogruppen IF. Dinamarca
Mexiko-Solidarität Österreich. Alemania
Mujeres y disidencias de la Sexta en la otra Europa y Abya Yala
Mujeres y la Sexta – Abya Yala
München International. Deutschland
Murga Los Quijotes de la Fuente Viva
Mut Vitz 13, Marsella. Francia
Mut Vitz 31 Toulouse. Francia
Nodo de Derechos Humanos (NODHO) – México
Nodo Solidale Roma/México
Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V.
Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Genova
Periódico La Flor, In Xóchitl In Cuicatl
Publicaciones de l@s Extranjer@s, Tesalonica. Grecia
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Radio Zapatista Sudcaliforniana, La Paz, Baja California Sur, México
Raíces en resistencia, Tlatelolco, Ciudad de México
Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género
Red de Resistencias y Rebeldias AJMAQ
Red de Solidaridad con Chiapas. Buenos Aires – Argentina
Red Sindical Internacional de Solidaridad y de luchas. África, las Américas, Europa y Medio Oriente
Red Universitaria Anticapitalista – México
Red Ya-Basta-Netz (Alemania)
Redazione di Comune
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista
Revista Viento Sur (Estado Español)
Sicilia Libertaria – Giornale Anarchico
SICILIEZAPATISTE Sicilia, Italia
Solidaritätskomitee Mexiko-Salzburg, Alemania.
Solidarité avec les Travailleurs en Iran – SSTI
Tatawelo. Italia
Tejiendo Organización Revolucionaria – TOR. México
Terra Insumisa Alcamo/Sicilia Sud Globale, Sizilien, Italia
Unión de Sindicatos Solidaires, Francia
Unión Popular Apizaquense Democrática Independiente (UPADI)
Vendaval, cooperativa panadera y algo más, CDMX.
Void Network. Atenas, Londres, Nueva York, Río de Janeiro.
Y Retiemble! Madrid
Ya Basta! Êdî bese! (Noreste de Italia)
20zln. Italia

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- “Selon un nouveau décompte compilé grâce à l’aide de personnels soignants dans cinq centres de référence en ophtalmologie et seize services d’urgence, le docteur Amir-Mobarez Parasta (en contact quotidien avec un réseau clandestin de médecins) dit « pouvoir confirmer la mort de 33 130 personnes ». Et encore, précise-t-il, ces chiffres sont sans doute inférieurs à la réalité, car ils ne prennent en compte ni les données issues des morgues et des cimetières, ni le grand nombre de personnes blessées n’ayant pas osé aller à l’hôpital par peur des représailles.”
L’article Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien est apparu en premier sur Terrestres.
22.01.2026 à 19:34
“Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille
Stéphane Lalut
Derrière le monde des marchandises, il y a les arrière-mondes de la production ou du transport. Derrière les écrans, il y a une énorme infrastructure matérielle et physique. Et derrière les clouds, il y a les indispensables data centers, qui prolifèrent en avalant l’espace et l’électricité. À Marseille, assaillie par les câbles, la résistance s’organise.
L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (4465 mots)
Temps de lecture : 8 minutes
Marseille. Porte d’Aix. Mars 2024.
Une cinquantaine de corps — femmes, hommes, enfants — figés devant un chantier.
Des banderoles tendues entre deux barrières métalliques : « Pas de cloud sans béton », « Nos quartiers ne sont pas vos serveurs ».
Dans les journaux, silence. Ou presque.
Dans les rues, colère.
Le cube de béton en construction derrière les grilles n’a rien de virtuel. Il est massif, épais, hérissé de gaines d’aération. Il avalera bientôt l’équivalent électrique de 30 000 foyers. Dans une ville où un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté.
Fatima, 62 ans, désigne les fenêtres de son appartement, à cinquante mètres :
« L’été dernier, on dormait plus. Le bruit des groupes électrogènes, la chaleur qui montait du bitume… Et maintenant, ils nous disent que c’est le progrès. Trois emplois, des vigiles, et le reste ? »
« Votre cloud, notre fournaise. »
Ce qui se joue ici n’est pas une exception. C’est un condensé — de ce que la novlangue numérique cherche à dissoudre : les résistances, les conflits, les corps, les lieux.
Derrière les mots — cloud, virtualisation, immatériel —, il y a des serveurs qui chauffent, des camions qui passent, des transformateurs qui vrombissent, des métaux qui s’arrachent.
Il faut reprendre depuis le sol. Depuis l’endroit exact où l’on vit. C’est cela, partir des luttes situées : non pas appliquer une théorie au réel, mais laisser le réel produire ses propres catégories.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Marseille, point d’impact
Pourquoi Marseille ?
Parce qu’une quinzaine de câbles sous-marins y atterrissent, faisant de la ville un nœud stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie1. Parce que cette connectivité — qui n’a jamais fait l’objet d’un vote — attire les opérateurs. Parce que les quartiers nord, moins chers, moins visibles, moins défendus, offrent les conditions « idéales » pour déployer ces infrastructures.
Résultat : une dizaine de data centers déjà actifs, et autant en projet. Puissance électrique cumulée : près de 80 MW aujourd’hui, environ 180 MW à terme2 — davantage que ce qui est prévu pour électrifier les quais du port. Impact carbone : celui d’une ville moyenne, concentré dans quelques arrondissements populaires.
Ce que les riverains reçoivent en échange n’est pas la promesse du numérique. Ce sont des nuisances. Des moteurs de secours qui tournent nuit et jour. Des rejets d’air chaud à 40°C dans des rues déjà suffocantes. Et cette évidence brute : l’énergie que ces centres absorbent n’ira pas ailleurs.
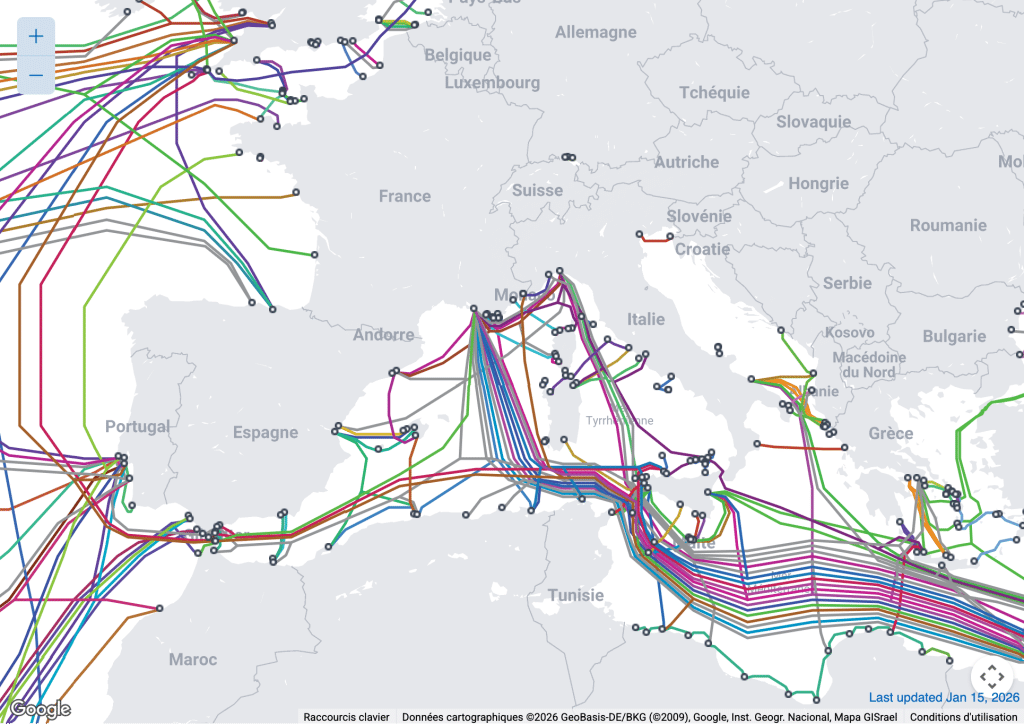
Le cloud a un corps
Guillaume Pitron l’a montré dans L’Enfer numérique3. Gauthier Roussilhe le cartographie ligne par ligne4. Le numérique est un système de transfert. Il extrait ici, refroidit là, connecte là-bas — mais les gains ne sont jamais là où se loge le désordre.
Netflix ne « flotte » pas. ChatGPT ne « s’évapore » pas. Une seconde de streaming : quelques grammes de CO₂. Une requête IA : plusieurs wattheures. Des milliards de fois par jour.
Le numérique promet la fluidité. Il produit la friction, ailleurs.
Le mensonge du cloud « vert »
Google annonce des data centers « 100 % renouvelables ». Microsoft jure être « négatif en carbone » d’ici 2030. Amazon aligne des rapports ESG comme des titres en bourse.
Mais ce verdissement est comptable, pas physique.
Lorsque Google achète de l’électricité verte, c’est souvent par certificat — les fameux Power Purchase Agreements. L’énergie renouvelable est produite ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres. Le certificat voyage ; les électrons, eux, viennent du réseau local — et quand la demande est forte, ce sont les centrales d’appoint qui répondent.
La « neutralité carbone » ? Une fiction à échéance glissante. On émet aujourd’hui. On promet de compenser demain. En plantant des arbres au Brésil. En misant sur la croissance, l’absence d’incendies. Une dette écologique gagée sur des hypothèses de long terme — pendant que le dérèglement, lui, est immédiat.
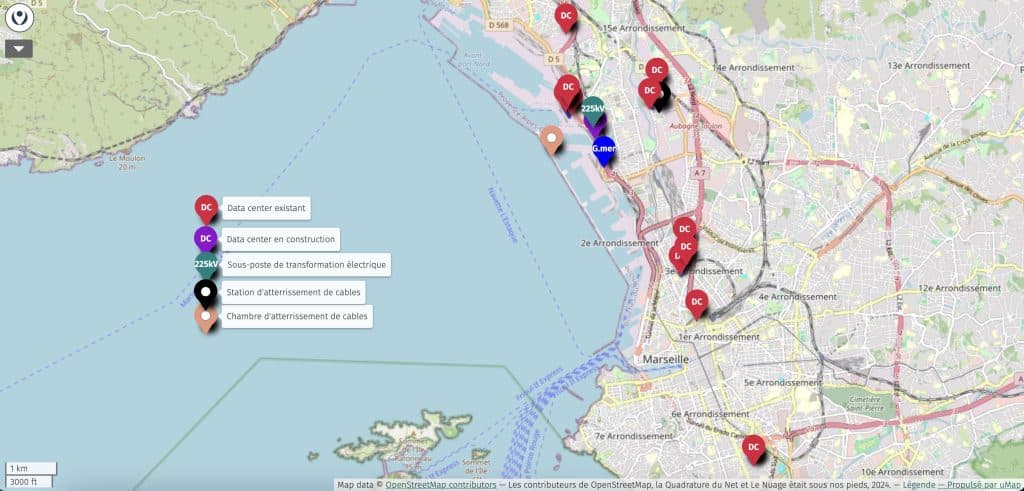
Nommer le mécanisme : la dette entropique
Le mot « externalité » est trop faible. Il suggère un à-côté, un effet secondaire. Or ici, le transfert est central. Ce n’est pas un dommage collatéral — c’est la condition même du fonctionnement.
Par dette entropique, j’entends la somme des dégâts matériels et sociaux qu’un système rejette sur d’autres lieux et d’autres corps pour continuer à fonctionner. Pour qu’un data center soit « propre » à Paris, il faut qu’un quartier surchauffe à Marseille. Pour qu’une batterie soit « verte » en Europe, il faut qu’un enfant creuse à Kolwezi (RDC).
Le concept vient de la thermodynamique. Le second principe stipule qu’on ne peut pas réduire le désordre ici sans l’augmenter ailleurs. Pas d’îlot de fraîcheur sans chaleur rejetée. Pas de machine sans perte.
Ce mécanisme prolonge ce que Gérard Dubey et Alain Gras nomment le « modèle Edison »5 : une technologie qui fait disparaître la nuisance au point d’usage, tout en la reportant ailleurs et en programmant l’oubli de ce déplacement.
Transposée aux infrastructures sociales, cette logique devient un outil d’enquête : qui absorbe le désordre ? Où le transfert s’effectue-t-il ? Par quelles techniques est-il invisibilisé ?
Ce cadre dialogue avec des travaux déjà publiés dans Terrestres. Malcom Ferdinand et Françoise Vergès6 ont analysé le « colonialisme vert » — cette écologie qui nettoie le Nord en salissant le Sud. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns7 ont théorisé la « gouvernementalité algorithmique » — ce pouvoir qui anticipe les conduites par le calcul, court-circuitant la délibération au profit du profilage. La dette entropique prolonge ces analyses en insistant sur les circuits concrets : par quels chemins le désordre passe-t-il de Palo Alto à Kolwezi, de la Silicon Valley aux quartiers nord de Marseille ?
Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.
Les extrémités du réseau
En République Démocratique du Congo, des enfants extraient du cobalt à mains nues, à quinze mètres sous terre. Ce métal entre dans les batteries — y compris celles des serveurs. Plus au nord, dans le Kivu, le tantale et l’étain des circuits imprimés alimentent depuis trente ans une économie de guerre documentée par l’ONU : mines contrôlées par des groupes armés, travail forcé, viols comme stratégie militaire. Comme l’a montré Celia Izoard dans ces pages, l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda — principal bénéficiaire du pillage — a coïncidé avec une intensification des combats8. Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.
En janvier 2023, à Lützerath, en Rhénanie, des militants ont été expulsés par la police. Le village devait disparaître pour faire place à la mine de lignite de Garzweiler. Ce charbon alimente les centrales qui fournissent l’électricité des data centers allemands.
Question posée par les occupants : Pourquoi ici ? Pourquoi nous ? Aucune réponse légitime. Seulement celle de la « nécessité énergétique » — comme si cette nécessité-là, au service de ces usages-là, allait de soi.
La carte de la dette entropique est globale. De nos écrans lisses à leurs sols creusés.
Ce que les luttes rendent visible
À Marseille, à Montpellier, à La Courneuve : des collectifs se lèvent. Ils refusent de porter le poids du progrès des autres. Ce n’est pas du nimbysme — ce réflexe du « pas dans mon jardin » qui délocalise le problème sans le résoudre. C’est une politique du refus situé : partir d’un lieu précis pour contester le système entier. Non pas « pas chez moi », mais « pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? » — et surtout : « pourquoi tout court ? »
Partir des luttes situées, c’est refuser d’appliquer une grille théorique au réel pour laisser les conflits produire leurs propres catégories. Les data centers ne sont pas des équipements neutres. Ce sont des dispositifs de pouvoir — et c’est comme tels qu’ils doivent être contestés.
Maria Kaika et Erik Swyngedouw9 ont proposé le concept de « politisation de l’infrastructure » : réintroduire le conflit démocratique là où régnait la fatalité technique. C’est exactement ce qui se joue à Marseille.
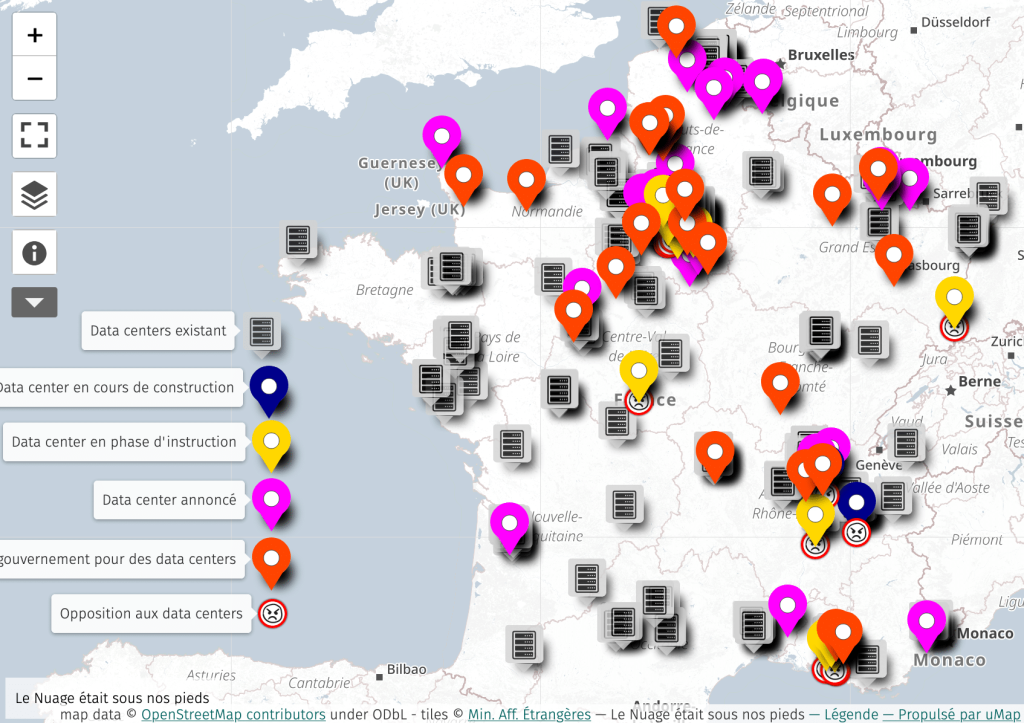
Réduire, puis politiser
Face à l’expansion du numérique, le solutionnisme technique promet que l’IA va tout « optimiser », réduire les émissions, verdir les data centers. C’est le discours de la Commission européenne, de McKinsey. Ce qu’il oublie : l’optimisation ne supprime pas le désordre — elle le déplace. Les smart cities brillent sur le dos des territoires extractifs, des travailleurs du clic à Madagascar, payés quelques centimes pour entraîner les IA.
À ce solutionnisme, la tradition technocritique — d’Illich à Ellul, de Dubey et Gras aux collectifs actuels — oppose une tout autre démarche : non pas le refus abstrait de « la technique », mais l’enquête concrète sur les systèmes techniques. Quelles technologies créent de la dépendance ? Lesquelles permettent l’autonomie ? Comment distinguer l’outil convivial de l’infrastructure qui asservit ?
La notion de dette entropique s’inscrit dans cette lignée. Elle invite à une question simple : qui paie ? Et elle conduit à deux exigences indissociables : d’abord réduire — car aucun « verdissement » ne compensera la croissance exponentielle des flux de données et de matière — puis politiser la répartition des coûts qui subsistent.
Politiser les transferts
Qui décide où installer un data center ? Quels critères président à ce choix ? Quelles compensations pour les territoires qui absorbent le désordre ? Quels droits pour refuser, contester, infléchir ?
Ce sont des questions politiques. Pas techniques. Elles doivent être traitées comme telles. Dans les conseils municipaux. Dans les enquêtes publiques. Dans la rue s’il le faut.
Ce que demandent les habitants du 2e arrondissement de Marseille pourrait devenir un principe :
→ Pas d’infrastructure entropique sans délibération locale.
→ Pas de transfert de désordre sans droit de veto.
→ Pas de modernité qui ne soit négociée.
Partager le désordre
Il n’y a pas de numérique propre. Il n’y a pas de cloud neutre. Il n’y a pas de progrès sans friction.
Mais il y a une exigence : faire que la répartition de cette friction soit un objet de délibération. Non pas décider pour les autres — mais décider avec eux, ou pas du tout.
À Marseille, les câbles plongent. Les data centers s’installent. Et dans les quartiers nord, des habitants commencent à demander : pourquoi ici ?
Ce que d’autres décrivent comme un « système d’invisibilité » climatique prend ici une forme très concrète : certains quartiers, certains corps, absorbent le désordre numérique des autres.
C’est de cette question que naît la politique.
Photo de Hunter Harritt sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Le nombre exact de câbles est en évolution rapide. L’ordre de grandeur est aujourd’hui de 17-18 câbles sous-marins reliés à Marseille, selon la manière de compter (sources : TeleGeography, La Quadrature du Net, Digital Realty, 2024).
- Selon les données des Comités d’intérêt de quartier relayées par La Quadrature du Net : 77 MW pour les data centers actuels, 107 MW pour les projets programmés. L’électrification des quais du Grand Port Maritime est estimée à 100-120 MW.
- Guillaume Pitron, L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent, 2021.
- Gauthier Roussilhe, « Situer le numérique », 2020, disponible sur gauthierroussilhe.com.
- Gérard Dubey et Alain Gras, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Seuil, 2021.
- Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019. Françoise Vergès, Une théorie féministe de la violence, La Fabrique, 2020.
- Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, n° 177, 2013.
- Celia Izoard, « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo », Terrestres, juillet 2025. Voir aussi « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation », Terrestres, juillet 2025.
- Maria Kaika et Erik Swyngedouw, “The Urbanization of Nature”, in The New Blackwell Companion to the City, Blackwell, 2011.
L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.
15.01.2026 à 19:00
“L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental
La rédaction de Terrestres
Il n’y a pas si longtemps, on pouvait encore imaginer l’écologie en train de progresser dans les esprits. Le backlash des années 2020, aussi brutal que global, semble éloigner chaque jour cette idée. Quel est ce recul ? Est-il si nouveau ? Qui veut la peau de l’écologie ? Rencontre Terrestres le 15 janvier 2026 à l’Académie du Climat, pour comprendre et résister.
L’article “L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (2305 mots)
Temps de lecture : 4 minutes
Table-ronde le jeudi 15 janvier 2026 avec la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, la géographe et activiste Sarah-Maria Hammou, les historien·nes Laure Teulières et Steve Hagimont et le chercheur en écologie politique Jean-Michel Hupé. Une rencontre organisée par Terrestres en partenariat avec Socialter, autour du livre Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie ? (Seuil, 2025), à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30).
Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.
Accord de Paris en 2015, mouvement climat en 2018… Encore récemment, on pouvait imaginer l’écologie en train de progresser dans les esprits. C’était sans compter le méchant retour de bâton des années 2020. Partout dans le monde, on observe d’importants reculs environnementaux : les rares avancées dans les politiques écologiques sont démantelées et les engagements climatiques bafoués ; la recherche scientifique est attaquée et ses financements compromis ; forages, mines et chantiers se multiplient, on investit dans la défense, dans l’IA et autres technologies mortifères au mépris des limites planétaires et de la démocratie la plus élémentaire. En Europe, les régulations sur l’agriculture, la déforestation, l’alimentation ou la chimie sont sapées au motif de « simplification »1. En France, le Code de l’environnement est sans cesse affaibli, les demandes d’une transition à la hauteur des enjeux sont balayées, les discours hostiles à l’écologie se renforcent et la répression du mouvement écologiste se déchaîne.
Partout, on l’affirme haut et fort : l’écologie, ça suffit !
Comment expliquer cette hostilité à l’égard de l’écologie alors même que les bouleversements environnementaux empirent et n’ont jamais été aussi manifestes ? Car le backlash semble s’amplifier à mesure que la biodiversité s’effondre et que les mégafeux, les inondations ou les maladies liées à la pollution augmentent. Le tout dans un contexte de polarisation croissante – les inégalités ne cessent de se creuser tandis que les idéologies réactionnaires ne cessent de gagner du terrain, semblant renforcer la possibilité d’un fascisme 2.0 que certaines décrivent comme un « survivalisme monstrueux »2.
Dans un tel contexte, quel rapport entretient la catastrophe écologique avec la violence de la réaction qui touche celleux qui veulent la prévenir ? Et comment résister à ces tendances mortifères ?
Le livre collectif Greenbacklash – Qui veut la peau de l’écologie ? (Le Seuil, 2025), analyse ces reculs environnementaux. Dans ce nouveau « manuel pour dépolluer le débat public » qui fait suite à Greenwashing (Le Seuil, 2022), scientifiques, activistes et journalistes dressent ensemble une « cartographie des forces opposées à l’écologie », pour mieux comprendre les attaques qui visent autant les individus ou les associations que les institutions et les accords internationaux.

Ils et elles montrent que le backlash, l’ensemble des discours et des mesures hostiles à l’écologie, n’est pas aussi récent qu’on pourrait le penser – on observe ce phénomène dès les années 1970 – et n’est pas non plus aussi généralisé qu’il paraît : une majorité de citoyen·nes aspirent à des politiques publiques fortes pour lutter contre les pollutions et parer au changement climatique.
En désignant les acteurs du greenbacklash – lobbies, industries, politiques, médias… – et en décrivant leurs stratégies, l’ouvrage montre que le retour de bâton est avant tout une violente réaction de ceux qui auraient beaucoup à perdre si des politiques écologiques étaient engagées.
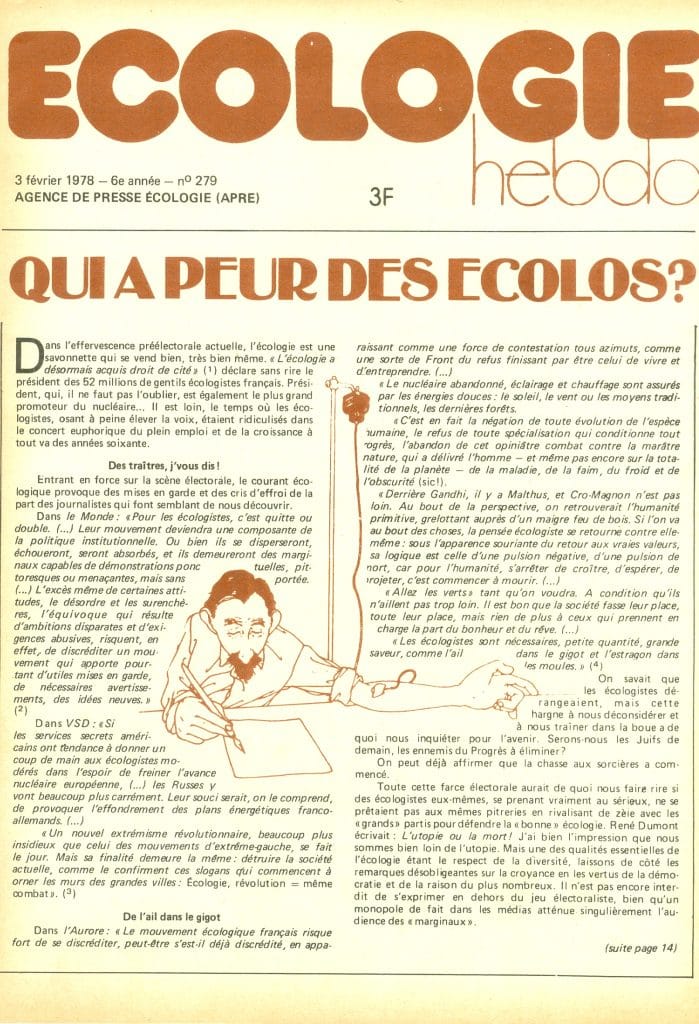
Cette table-ronde entend analyser l’offensive en cours et esquisser des voies de relance des dynamiques écologiques. Elle réunira deux autrices de contributions sur les sciences et le climat et l’écologie dans les banlieues, ainsi que les trois coordinateur·ices de l’ouvrage, qui signent également des contributions sur les accusations en « écologie punitive » ou encore le rôle des médias et des journalistes.
Intervenant·es :
Sarah-Maria Hammou est géographe et responsable des programmes Justice climatique au sein de l’association Ghett’up, autrice du rapport «(In)justice climatique» (octobre 2024)
Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et ancienne co-présidente du groupe n°1 du GIEC
Laure Teulières est historienne, maîtresse de conférence à l’Université Toulouse Jean-Jaurès
Steve Hagimont est historien, maître de conférence à Sciences Po Toulouse
Jean-Michel Hupé est chercheur en écologie politique au CNRS à l’Université Toulouse Jean-Jaurès
Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé ont co-fondé l’Atécopol (Atelier d’écologie politique) de Toulouse
La rencontre sera animée par Léa Dang de la revue Socialter et Maxime Chédin, Quentin Hardy et Emilie Letouzey de la revue Terrestres
Le jeudi 15 janvier 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des fêtes – 2 place Baudoyer – 75004 Paris
Entrée libre ! Inscription souhaitée ici : https://chk.me/i01zwCJ ♡

Photo d’ouverture : designecologist sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- Voir la chronique de Stéphane Foucart dans Le Monde du 14 décembre 2025 : « Les reculs environnementaux de l’Europe sont les premiers marqueurs de sa trumpisation ».
- Voir Naomi Klein et Astra Taylor, « La montée du fascisme de la fin des temps », Terrestres, 2025.
L’article “L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental est apparu en premier sur Terrestres.
12.01.2026 à 17:58
La logique du double pouvoir
Alessandro Pignocchi
2027. Pendant que deux mésanges débattent de l’opportunité de faire sauter une usine chimique pour y mettre une salle des fêtes, la presse est inquiète : est-ce que le nouveau président Jean-Luc Mélenchon ne serait pas en train de se faire dépasser par les mouvements sociaux qui ont permis son élection ? Une politique-fiction d’Alessandro Pignocchi.
L’article La logique du double pouvoir est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (1207 mots)
Temps de lecture : < 1 minute
Un nouveau strip d’Alessandro Pignocchi, à retrouver également sur son blog Puntish.




SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
L’article La logique du double pouvoir est apparu en premier sur Terrestres.
09.01.2026 à 12:24
Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges
Olúfémi O. Táíwò
Et si on démontait les lieux de pouvoir au lieu de faire en sorte que d’autres y accèdent ? Dans un article anticipant son livre “Elite Capture”, le philosophe étasunien Olúfémi O. Táíwò appelle à défendre les perspectives situées contre ce qu’il appelle la “déférence épistémique”, qui fragmente le collectif politique et entrave la solidarité.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (9998 mots)
Temps de lecture : 24 minutes
Ce texte est la traduction de l’article d’Olúfẹ́mi O. Táíwò, « Being-in-the-Room Privilege : Elite Capture and Epistemic Deference », paru dans la revue The Philosopher en 2021.
La traduction a été réalisée par Mathias Rollot.
La revue Terrestres et le traducteur remercient l’auteur Olúfẹ́mi O. Táíwò et son agente littéraire Stephanie Steiker de nous avoir permis de traduire cet article.
« J’ai abandonné l’idée d’écrire à ce sujet car je ne crois pas être la bonne personne pour écrire là-dessus – je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être Noir… mais je peux vous envoyer mon brouillon avec mes notes, si vous voulez. »
Un frisson m’a parcouru. C’était pourtant une proposition aussi innocente que compréhensible : ses principes éthiques invitaient Helen, journaliste indépendante, à renoncer à son sujet pour me le laisser. Pourtant, j’ai craint qu’il ne s’agisse aussi d’un piège.
Même en mettant de côté l’erreur faite au sujet des dynamiques en place dans la conversation (je suis certes Noir, mais aussi professeur associé à l’université), il y avait là un problème que j’avais rencontré de nombreuses fois par le passé. Derrière l’hypothèse que je possédais une expérience vécue qu’elle n’avait pas, on pouvait reconnaître la marque d’un horizon épistémologique, politique et culturel aussi controversé que polarisant : l’épistémologie du positionnement (standpoint epistemology)1.
Consulter un dictionnaire ne permet pas vraiment de se faire une idée des controverses autour de cette idée d’épistémologie du positionnement. L’Encyclopédie Internationale de Philosophie se borne à considérer trois affirmations a priori inoffensives :
- Le savoir est socialement situé
- Les personnes marginalisées sont avantagées pour acquérir certains types de savoirs
- Les programmes de recherche devraient refléter ces faits.
Le philosophe Liam Kofi Bright montre bien que ces affirmations peuvent être déduites 1) d’une logique empirique de base, et 2) d’une explication un tant soit peu plausible des manières dont le monde social affecte les savoirs que des groupes de personnes sont susceptibles de chercher et de trouver.
Mais si le problème ne vient pas de l’idée de base, alors d’où vient-il ? Je crois qu’il n’est pas tant lié au concept initial qu’à sa mise en pratique par les normes en vigueur. L’appel à « écouter les plus concerné·es » ou à « remettre au centre les plus marginalisé·es » est très fréquent dans bon nombre de cercles académiques et militants. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Selon l’expérience que j’en ai, quand les gens disent qu’il est important « d’écouter les plus concerné·es », ce n’est pas parce qu’ils prévoient de faire une visio avec un camp de réfugié·es ou de collaborer avec des sans-abris. Plus souvent, il s’agit plutôt de confier la légitimité de parole et l’attention à celles et ceux qui correspondent le mieux aux catégories sociales associées à ces maux – sans même se préoccuper de savoir ce qu’iels savent réellement, ou ce qu’iels ont personnellement vécu sur le sujet. Dans le cas de ma conversation avec Helen, ma race sociale semble me lier de façon plus « authentique » à une expérience qu’aucun·e de nous deux n’a jamais eue. Selon les règles du jeu telles que les comprenions, elle se sentait obligée de s’en remettre à moi. Ces règles prévalent souvent, même là où les enjeux sont importants – que ce soit au sein d’un groupe de recherche discutant des manières de comprendre un phénomène social ou d’un groupe militant discutant des cibles à viser.
Le piège n’était pas que l’épistémologie du positionnement puisse affecter la conversation, mais comment elle le faisait. De façon générale, lorsqu’on cherche à appliquer concrètement l’épistémologie du positionnement, on s’engage dans des pratiques révérencielles : faire des dons, passer le micro, croire en la parole de l’autre. C’est bienvenu dans de nombreux cas, et les normes sociales qui nous invitent à nous tenir prêt·es à les mettre en œuvre proviennent de motivations admirables : un désir de favoriser la situation sociale des personnes marginalisées, considérées comme sources de savoirs et destinataires légitimes de pratiques respectueuses. Hélas, le fait que de tels égards deviennent la règle de base, l’orientation politique par défaut, peut avoir pour conséquence d’aller à l’encontre des intérêts des groupes marginalisés, tout particulièrement au sein des cercles dominants (elite spaces).
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Certains lieux possèdent une influence et une puissance démesurée : la salle des réunions de crise, la salle du comité de rédaction, la table des négociations, la salle de conférence… (the Situation Room, the newsroom, the bargaining table, the conference room). Être dans ces lieux signifie être en mesure d’affecter les institutions et les dynamiques sociales au sens où on est alors en position de décider de ce qu’il convient de dire et de faire. L’accès à ces lieux est déjà, en soi, une forme d’avantage social, du genre de ceux qu’on ne peut acquérir que grâce à d’autres avantages sociaux préalablement acquis. D’un point de vue sociétal, les personnes les plus « affectées » par les injustices sociales associées aux identités politiques principales (genre, classe, race, nationalité) ont beaucoup plus de probabilités d’être emprisonnées, sous-employées, ou d’être dans les 44 % de la population mondiale sans accès à Internet – et donc d’être mises à l’écart des lieux du pouvoir et tout à fait ignorées par les personnes présentes dans ces lieux. Les individus qui ont le plus de chances de se trouver dans ces lieux sont, au contraire, ceux qui réussissent à passer au travers des différents mécanismes de sélection sociale filtrant les identités sociales associées à ces résultats négatifs. En d’autres termes, ces personnes sont d’autant plus susceptibles de se retrouver dans les lieux du pouvoir qu’elles sont systématiquement différentes (et donc non-représentatif·ves) des gens qu’iels sont ensuite supposées représenter une fois entrés à l’intérieur.
J’avais l’intuition que la proposition d’Helen était un piège. Non pas un piège qu’elle aurait tendu elle-même, mais un piège qui menaçait de nous piéger elle et moi de la même manière. Les normes culturelles – du genre de celles qu’on mobilise quand on introduit une déclaration par « En tant qu’homme noir… » – ont installé un ensemble de pratiques respectueuses de l’épistémologie du positionnement que beaucoup d’entre nous connaissent par cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà : les formes de révérence sociale qui en découlent finissent souvent par devenir contreproductives, et ne servir efficacement que la capture du pouvoir par les élites2, à savoir le contrôle des programmes politiques et des ressources par le groupe le plus avantagé. Si l’objectif était d’utiliser l’épistémologie du positionnement pour remettre en cause les configurations de pouvoir injustes, difficile de faire pire.
➤ Lire aussi | Nous danserons avec les montagnes・Báyò Akómoláfé (2024)
Pour expliquer ce qui ne va pas avec l’habituelle façon révérencielle (deferential) de mettre en œuvre l’épistémologie du positionnement, nous devons commencer par voir ce qui la rend si populaire. Commençons par évoquer les postures les plus cyniques : certain·es chez les plus avantagé·es d’un point de vue social, ne pas veulent pas réellement de changement social réel – iels n’en désirent que l’apparence. Par ailleurs, la révérence (deference) à l’égard des personnes liées aux communautés opprimées peut n’être qu’une performance qui édulcore, s’excuse, ou encore détourne du fait que la personne à qui est faite cette politesse a finalement déjà le privilège de se tenir dans les lieux où se prennent les décisions, et que le changement de perspective qu’elle suggère sera entendu.
Quoique j’ai l’intuition qu’il y a bien quelques vérités dans tout ça, je reste malgré tout insatisfait. La plupart des gens qui soutiennent et mettent en pratique ce genre de politesses sociales (deferential norms) ressemblent à Helen : bien intentionnés, mais confiants à l’idée que les personnes avec qui iels partagent ces lieux du pouvoir peuvent les aider à trouver l’expression qui convient à leurs engagements moraux communs. Pour expliquer le phénomène, il n’est même pas nécessaire de croire que la plupart de celles et ceux qui interprètent l’épistémologie du positionnement de la sorte sont de mauvaise foi, et on ne voit d’ailleurs même pas bien en quoi cela pourrait aider de croire cela. Les mauvais « colocataires » peuplant les lieux du pouvoir ne sont pas le problème, de la même façon que l’hypothèse selon laquelle Helen puisse être une bonne colocataire n’était pas la solution. Le problème vient de la manière dont ces lieux du pouvoir sont construits et gérés.
Pour en revenir à mon exemple initial avec Helen, la problématique n’était pas simplement que je n’ai pas grandi dans le milieu populaire et opprimé qu’elle imaginait. Épistémologiquement parlant, la situation était bien pire que ça. Bon nombre des faits sociaux qui ont rendu ma vie différente de celle des gens auxquels elle pensait sont justement les raisons pour lesquelles on me propose aujourd’hui des choses en leur nom. Si j’avais grandi dans un tel milieu, nous n’aurions probablement jamais été au téléphone ensemble, Helen et moi.

À bien des égards, notre système social repose sur un ensemble de mécanismes filtrants, qui déterminent quelles interactions peuvent avoir lieu, entre qui et qui, et donc, en définitive, quelles structures sociales les gens sont en mesure d’observer ou non. Durant la majeure partie du 20e siècle, le système de quota d’immigration des États-Unis a rendu accessible presque exclusivement aux Européens l’immigration légale et le chemin vers la citoyenneté (ce qui a valu au pays d’être considéré par Hitler comme le « leader incontesté dans l’élaboration de politiques explicitement racistes en matière de nationalité et d’immigration »3). Avant que le 1965 Immigration and Nationality Act n’ouvre de nouvelles possibilités migratoires pour les « travailleur·ses qualifié·es ».
Que mes parents aient pu intégrer cette catégorie des travailleur·ses qualifié·es explique aussi bien leur entrée sur le territoire américain que les avantages de classe et les ressources financières (notamment la richesse) dont j’ai bénéficié depuis toujours. Cette situation n’a rien d’inhabituel : la communauté immigrée nigériane-américaine est une de celles qui a le mieux réussi (ce que personne ne dit, bien sûr, c’est que les quelques 112 000 Nigérian·nes-Américain·es diplômé·es ne représentent que bien peu par rapport aux 82 millions de Nigérian·nes qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ni comment le premier fait recoupe le second). La sélectivité des lois en matière d’immigration explique bien les taux de réussite scolaire de la communauté nigériane de la diaspora qui m’a élevé ; ce qui explique à son tour comment j’ai pu intégrer les plus prestigieuses classes du lycée ; ce qui aide à son tour à comprendre comment j’ai pu poursuivre avec des études supérieures ; etc.
Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces.
Ainsi, il est assez facile de voir comment cette manière très particulière d’appliquer l’épistémologie du positionnement contribue à favoriser la capture du pouvoir par les élites. L’accès aux salles du pouvoir, aux lieux influents (rooms of power and influence), est conditionné par une longue série de sélections sociales en chaîne. Plus votre niveau social est élevé, et plus vos expériences sociales se réduisent – certains sont directement acheminés vers les doctorats, et d’autres vers les prisons. S’engager dans les questions d’identité par le biais de politesses épistémologiques, c’est risquer de reproduire les déformations produites par ces processus de sélection sociale.
Cela étant dit, il est aussi assez facile de voir, à plus petite échelle – dans une pièce, dans un champ ou dans un pan de la littérature scientifique, dans une conversation –, pourquoi ces pratiques révérencielles peuvent paraître sensées. C’est souvent un moindre mal au regard des épistémologies qui les ont précédées : la personne traitée avec déférence peut en effet être un peu mieux positionnée, épistémologiquement parlant, que les autres personnes présentes dans la pièce (the room). Ça peut aussi être ce que nous avons à faire de mieux tant que les pièces elles-mêmes ne sont pas remises en cause – quel pouvoir on y trouve, qui y est admis, etc.
Mais n’est-ce pas la dernière chose que nous devrions espérer voir changer ? Faire mieux que les normes épistémologiques que nous a légué une histoire fondée sur un genre d’apartheid explicite global, voilà un objectif affreusement bas. Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces. Et quand on en vient à débattre de justice sociale, les mécanismes sociaux qui déterminent la position de chacun sont précisément les fragments de la société que nous cherchons à confronter. Par exemple, le fait que les personnes emprisonnées ne peuvent pas participer aux discussions académiques sur la liberté qui se tiennent sur les campus universitaires est intimement lié au fait qu’elles sont en cellule.
Les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours.
La politesse épistémologique se positionne comme une solution à un double problème à la fois politique et épistémique. Hélas, non seulement cela ne permet pas de résoudre ces problèmes, mais cela en ajoute de nouveaux. On pourrait penser que les questions de justice devraient être avant tout dirigées vers la résolution des disparités en matière d’accès à la santé, de conditions de travail, ou de sécurité. Mais voilà : les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours. Les pratiques révérencielles qui ne se placent qu’au service de la question de l’attention (du genre « nous avons lu trop d’hommes blancs, maintenant il faut lire ce qu’écrivent les gens de couleur ») peuvent échouer sur le terrain de leurs propres termes : recentrer l’attention sur les orateur·ices issus des groupes marginalisés peut, par exemple, décentrer l’attention de la nécessité de changer le système social qui les marginalise.
Les élites issues des groupes sociaux marginalisés peuvent bénéficier de ce processus de bien des manières, et ce n’est pas forcément un mal pour le progrès social. Mais il faudrait vraiment être très naïf·ve pour croire que les intérêts des élites sont nécessairement – ou même supposément – alignés avec ceux de la population dans son ensemble. Considérer de la sorte les intérêts des élites, c’est faire preuve d’un genre de Reaganomics racial – une stratégie qui repose sur le fantasme d’un dialogue entre économie de l’attention et économie réelle.
Peut-être que les quelques personnes payées pour décrire le carnage permanent dans lequel nous nous trouvons, et ce, de la manière la plus authentique – culturellement parlant – et la plus radicale – cosmétiquement parlant – sont réellement en train d’emporter une victoire culturelle. Et peut-être que lorsque nous, les bavards, nous aurons gagné l’attention et l’influence que nous méritons, et que nous aurons mis la main sur le butin, son contenu ruissellera magiquement sur les travailleur·ses qui nettoient la salle après nos conférences, sur les bidonvilles des mégalopoles des Sud globaux, et même jusque dans les campagnes.
Ou peut-être pas.

Pour pouvoir évaluer de façon plus complète et plus juste l’enjeu posé par ces façons révérencieuses de pratiquer l’épistémologie du positionnement, il faudrait aller au-delà des arguments de principe et affronter les attraits émotionnels d’une telle approche. Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite. Après tout, qu’une personne soit privilégiée, au sens strict du terme – c’est-à-dire qu’elle fait partie de la moitié de la population mondiale ayant un accès garanti aux besoins fondamentaux – n’empêche pas qu’elle puisse être constamment en position d’infériorité dans les rapports de force qu’elle vit au quotidien. La politesse épistémologique est une réponse à des expériences réelles et pesantes – celles du mépris, de l’ignorance, de l’exclusion. Elle s’avère donc tout particulièrement attirante pour les membres des groupes marginalisés ou stigmatisés, en ce qu’elle intervient directement sur les pratiques moralement fondamentales que sont l’attention et le respect.
Les dynamiques sociales dont nous faisons l’expérience ont un rôle énorme dans le développement et la redéfinition de notre subjectivité politique, autant que dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais la force de l’épistémologie du positionnement – sa reconnaissance de l’importance de cette mise en situation des discours – devient sa fragilité lorsqu’elle n’est mise en œuvre qu’au moyen de pratiques révérencieuses. Mettre l’accent sur la manière dont nous sommes marginalisé·es conduit souvent à voir le monde de la façon dont nous en avons fait l’expérience. Cependant, si on adopte une perspective plus structurelle, il est peut-être plus intéressant pour comprendre le monde et la place que nous y occupons de s’attarder sur les lieux où nous n’avons jamais eu besoin d’entrer (et de considérer les raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons éviter d’y entrer). Si cela est vrai, alors toute pratique révérencieuse de l’épistémologie du positionnement empêche, en fait, tout « centrage » sur les plus marginalisé·es, voire même rend leur discours inaudible. Cela nous amène à ne nous concentrer que sur les interactions se déroulant dans les lieux que nous occupons, au détriment de celles dont nous ne faisons pas habituellement l’expérience. En plus du fait que parler au nom des autres est potentiellement problématique (en particulier quand iels ne sont pas là pour parler elleux-mêmes de leurs propres situations), s’intéresser uniquement à la question de savoir qui est dans la pièce permet d’éviter de remettre en cause la centralité de notre propre souffrance – et de la souffrance des personnes marginalisées qui parviennent à entrer dans les lieux du pouvoir avec nous.
Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite.
Ces politiques révérencieuses posent donc tout autant de problèmes que le fait d’être tenu à l’écart des lieux les plus importants du pouvoir. Or, chez celleux envers qui on fait preuve de déférence, cela peut ne faire qu’amplifier les normes et stéréotypes dont souffre la communauté marginalisée en question. Dans son ouvrage Le Conflit n’est pas une agression, Sarah Schulman écrit que, bien qu’ils aient des origines et des conséquences morales très différentes, les effets psychologiques nés du traumatisme et ceux nés du sentiment de supériorité entraînent pourtant des comportements similaires chez les personnes. Cela peut notamment conduire à déformer les enjeux d’un conflit (souvent en exagérant les dommages), ou bien à considérer l’indépendance de l’autre comme une menace (par exemple en échouant à se concentrer sur les bonnes problématiques ou les bonnes personnes). Peu importe leur origine : ce genre de comportements a des effets néfastes à la fois pour les individus qui les adoptent et pour les communautés qui les incluent — particulièrement quand ces dernières favorisent et valorisent ces comportements au lieu de les limiter ou de les digérer.
➤ Lire aussi | À mes ami·es blanc·ches・Báyò Akómoláfé (2022)
Concernant celleux qui s’inclinent, cette pratique révérencielle peut aussi avoir pour effet de favoriser la lâcheté morale. En effet, cette stratégie fournit une couverture sociale bien utile pour se délester de toute forme de responsabilité personnelle : il suffit de reporter sur d’autres héro·ïnes individuel·les, sur une classe héroïsée, ou encore sur un passé mythifié, le travail qui est le nôtre et que nous devrions accomplir aujourd’hui. La perspective des personnes sur qui cette charge est reportée a beau être plus claire sur un point ou un autre, leur point de vue général n’est pas moins subjectif et socialement déterminé que le nôtre. Plus important encore, la politesse épistémologique déplace la responsabilité qui nous incombe, pour la déposer sur d’autres que nous – et, en plus, le plus souvent, sur une version caricaturale, hyper-aspetisée et totalement fictives d’elleux.
Ce faisant, ces mêmes tactiques révérencielles ne nous isolent pas seulement de la critique, mais aussi de la possibilité de nous relier à d’autres et d’évoluer. Elles nous empêchent de nous engager authentiquement, avec une empathie réelle, dans les luttes des autres – ce qui est tout de même la condition préalable à toute forme d’alliance politique. À mesure que les questions d’identité et que les dissensus se précisent, il apparaît que les « coalitions politiques » (au sens des luttes collectives par-delà nos différences) ne sont juste que des pratiques politiques tout court. C’est pourquoi la politesse épistémologique, au même titre que l’atomisation des groupes politiques qu’elle génère, est en fin de compte parfaitement anti-politique.
Remplacer l’interdépendance par la révérence peut bien faciliter les choses sur le moment. Mais le coût global de ce court-termisme est élevé, au sens où on risque alors de saper les objectifs de l’épistémologie du positionnement, et de s’engager dans une direction politique défavorable à quiconque se bat pour la liberté plutôt que pour les privilèges, et pour la libération collective plutôt que pour des guerres de chapelle.

En quoi est-ce qu’une approche constructive (constructive approach4) de l’épistémologie du positionnement diffèrerait fondamentalement de cette approche révérencielle ? Une approche pragmatique se concentrerait sur la poursuite d’un objectif ou d’un résultat particulier, plutôt que seulement adhérer à des principes moraux ou d’éviter à tout prix la « complicité » dans l’injustice. Elle se préoccuperait surtout de la construction des institutions et s’attacherait à cultiver les pratiques de collecte partagée d’informations, plutôt que de juste vouloir « aider ». Elle se concentrerait sur la responsabilité plutôt que sur la conformité. Elle mettrait son énergie sur la question de la distribution sociale des ressources et du pouvoir, plutôt que de s’attarder sur des objectifs intermédiaires et d’aboutir à des tactiques de valorisation symboliques sans conséquences. Elle se concentrerait sur les manières dont sont construits les lieux du pouvoir, et non sur la régulation des flux de personnes à l’intérieur de ces lieux. Elle s’engagerait dans un projet de construction sociale, visant à déconstruire et reconstruire les structures sociales actuelles, les mouvements sociaux et leurs interconnections, plutôt que de se contenter de critiquer les systèmes sociaux en place.
La crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, permet de comprendre tant les possibilités que les limites d’une telle réorientation de nos manières de faire. Le Michigan’s Department of Environmental Quality (MDEQ), une agence gouvernementale de santé environnementale chargée d’aider les communautés, avec à sa disposition une équipe d’une cinquantaine de scientifiques expérimentés, s’est rendu complice de dissimulation de l’ampleur et de la gravité d’un scandale sanitaire arrivé entre 2014, début de la crise, et 2015, date à laquelle il a attiré l’attention à échelle nationale.
➤ Lire aussi | Freedom farmers, la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu, Monica M. White (2025)
Le MDEQ, autorité épistémologique et politique, a défendu le statut quo à Flint. L’agence a affirmé que « l’eau de Flint est propre à la consommation ». Elle a été citée par le Maire de Flint, Dayne Walling, dans ses déclarations d’avril 2014 « contre les affabulations et pour rétablir la vérité au sujet de la rivière Flint ». Il s’agissait alors d’engager la transition vers un captage de l’eau potable dans la rivière. Une transition orchestrée par le responsable des urgences municipales Darnell Earley – qui est Afro-Américain, tout comme bon nombre des habitant·es de la ville qu’il a contribué à empoisonner. En juillet 2014, l’American Civil Liberties Union (ACLU) rendit publique une note interne produite par l’agence fédérale Environmental Protection Agency (EPA) exprimant son inquiétude quant aux taux de plomb dans l’eau en question. En réponse, le MDEQ rédigea un rapport bidon, dans lesquels les niveaux de plomb restaient conformes aux normes en vigueur. Il avait juste mystérieusement omis de compter deux échantillons contaminés.
La réaction des habitant·es ne se fit pas attendre. Dans le mois qui suivit la transition d’une station de captage à l’autre, les riverains signalèrent bien à quel point l’eau de leur robinet avait une couleur étrange et dégageait une odeur inquiétante. Les habitant·es n’avaient pas besoin que l’oppression dont iels faisaient l’objet soit « célébrée », que l’attention soit « centrée » sur elleux, ou que tout ça soit retranscrit dans la langue de l’académisme en vigueur. Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb. Alors iels se mirent au travail.
Premièrement, il leur fallait pouvoir répondre avec la même autorité épistémologique. Pour cela, les habitant·es s’engagèrent donc dans la construction d’un nouveau lieu de pouvoir : une pièce où habitant·es et activistes pourraient se retrouver et collaborer avec les laboratoires scientifiques ayant les capacités de prouver que le rapport du MDEQ était bidon. La mobilisation organisée par les communautés habitantes de Flint permit de rallier des scientifiques bien établis à leur cause, et déboucha sur une campagne de « sciences participatives » via la distribution de kits de mesure citoyens, ce qui participa à visibiliser plus encore l’urgence et la gravité de la situation sanitaire. L’empoisonnement des enfants de Flint devint un scandale national. L’alliance entre habitant·es et scientifiques l’emporta.
Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb.
Mais ce n’était pas suffisant. La deuxième étape – retrouver une eau saine – nécessitait plus qu’une reconnaissance de la situation : il fallait désormais des ressources et des heures de travail, pour réparer le réseau hydraulique et répondre aux inquiétudes sanitaires toujours présentes. Au départ, les habitant·es de Flint ne reçurent que des moqueries et des fadaises de la part de l’élite en place (dont certaines émises par le Président des États-Unis lui-même, et ce bien qu’il partage la même identité raciale que beaucoup d’entre elleux). Mais à la suite de l’activisme acharné des habitant·es de la ville, et à mesure que grandissait la liste de leurs allié·es, quelques victoires fut arrachées : les canalisations problématiques furent finalement remplacées une à une, et l’État du Michigan a été obligé de verser plus de 600 millions de dollars de dédommagement aux familles concernées.

Ce résultat n’est en aucun cas une victoire totale : non seulement il faut en déduire les frais de justice engagés dans cette affaire, mais surtout ce dédommagement financier ne saurait annuler à lui seul les dommages subis par les habitant·es. Une épistémologie constructive ne peut garantir de victoire totale face à un système oppresseur. Aucun horizon épistémologique ne peut, de lui-même, défaire les asymétries de pouvoir à l’œuvre entre un peuple et l’impérialisme d’un système social. Mais il peut aider à rééquilibrer un peu les forces en présence – sans même qu’on ait à faire appel à une quelconque politesse épistémologique.
La justice sociale et les économies de l’information ne sont pas menacées par un manque de jargon qui permettrait de décrire plus précisément ou radicalement les afflictions épistémologiques, attentionnelles ou interpersonnelles des sans-pouvoirs.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place – en particulier si ces bases populaires peuvent favoriser une action politique efficace, et limiter ou éliminer la prédation par les élites. Rien n’arrête pour l’heure la mainmise sur ces bases populaire et leur corruption par les élites bien placées, en particulier les entreprises de la tech, et on n’assiste à aucune remise en cause : ni de l’influence exercée par l’entreprenariat sur les journaux d’information locaux, ni de la destruction et du pillage de la profession de journaliste, ni des collusions entre les grandes entreprises et les politiques à des points clés du système démocratique, ni de la prédominance d’une production de savoir universitaire favorisant les intérêts des élites, pas plus que de la diffusion par les médias traditionnels des résultats de ces processus très orientés.
Confronter ces menaces nécessite d’abandonner certains des lieux de pouvoir en place. Et d’en construire de nouveaux.
Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place.
Approcher l’épistémologie du positionnement de façon constructive est exigeant. Il faut nager à contre-courant : réfléchir de façon responsable avec celles et ceux qui ne sont pas encore dans la pièce avec nous ; construire de nouveaux lieux de rencontre au sein desquels nous pourrions nous retrouver, plutôt que de juste nous déplacer au sein des lieux de pouvoir que l’histoire nous a légué. Mais après tout, c’est probablement normal dès lors qu’il s’agit de politiques de la connaissance : la philosophe Sandra Harding a bien montré en quoi l’épistémologie du positionnement, lorsqu’elle est pleinement considérée, requiert non pas moins mais davantage de rigueur des sciences et des processus de production de la connaissance en général.
Mais voilà : un sujet important reste encore en suspens. L’approche révérencielle de l’épistémologie du positionnement est souvent inséparable d’une préoccupation et d’une reconnaissance de l’importance de l’expérience vécue. Dont, tout particulièrement, les expériences traumatiques.
À ce point de l’argumentation, je dois reconnaître manquer de distanciation et de capacité à rationaliser froidement le sujet. L’essence de ce que j’ai à dire ici tient plus de la conviction que de l’hypothèse scientifique. Heureusement, la vie des idées m’a appris au fil des années que nous n’avons pas moins à apprendre de nos convictions, quoiqu’elles se posent et se travaillent différemment. Je poursuis donc.
Je prends très au sérieux la question du traumatisme. J’ai grandi aux États-Unis, une nation fondée sur un colonialisme de peuplement, l’esclavage, le racisme et leurs conséquences respectives. Tout le monde a son lot de traumatismes historiques et collectifs ici. J’ai aussi grandi au sein de la diaspora Nigériane, une communauté vivant avec des souvenirs brûlants de génocide. Tant au niveau national qu’au niveau communautaire, bon nombre de traits de caractères, de personnalité, d’habitudes et de comportements que j’observe me semblent liés à ces histoires traumatiques. À l’échelle individuelle, j’ai pu craindre pour ma vie ou pour ma dignité, ressentir douleurs intenses et humiliation ; et je me suis vu changer en fonction de ces sentiments. Je repense souvent à ces souvenirs traumatisants. Mais je ne me dis que très rarement : « ça m’a appris quelque chose ».

Ces expériences peuvent être, si on est vraiment chanceux·ses, des éléments fondateurs de notre vie. Ce qui en sort dépend de la manière dont ces éléments s’agencent les uns avec les autres – ce que la théorie du positionnement nomme « thèse de l’accomplissement » (achievement thesis). Briana Toole met bien en lumière en quoi notre situation sociale ne nous place qu’en position de savoir quelque chose. Mais pour ce qui est du « privilège épistémique », de l’avantage, il ne peut être obtenu que par le biais d’une lutte concertée, délibérée, menée depuis cette position.
Je concède bien volontiers que l’expérience de l’oppression peut conduire à cela : je n’ai aucun doute sur le fait que l’humiliation, la privation et la souffrance peuvent construire les individus (en particulier lorsque le contexte est favorable aux luttes volontaires et structurées vers la conscientisation (consciousness raising) dont parle Toole). Mais ces mêmes expériences peuvent aussi s’avérer destructrices. Lequel de ces deux effets a le plus de chance d’advenir ? Pour ma part, je parierais plutôt sur le second. Comme l’a justement noté Agnes Callard, le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Quoiqu’en dise le proverbe, qu’elle soit ou non le fruit de l’oppression, la souffrance n’est pas un bon professeur. La souffrance est partiale : elle ne voit pas bien loin et reste tournée sur elle-même. On ne devrait pas fonder nos relations sociales sur d’autres attentes que cela là : l’oppression, ce n’est pas une classe prépa.
Le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.
Au bout du compte, ce que je crois le plus profondément au sujet de l’épistémologie du positionnement, c’est que cela demande au traumatisme quelque chose que le traumatisme ne peut offrir. Oui, l’approche constructive est exigeante. Mais la pratique de la révérence épistémologique l’est bien plus encore, tout en s’avérant aussi être bien plus injuste : elle demande aux traumatisé·es de porter sur leurs seules épaules ce que nous devrions toutes et tous travailler collectivement. Quand je pense à mon propre traumatisme, il ne me vient pas de grandes leçons de vie. Je pense plutôt à la noblesse, bien silencieuse, de la simple survie. Le fait même que ces chapitres n’aient pas été les derniers de ma vie est déjà, en soi, bien assez puissant. Je suis toujours là pour me rappeler de ces histoires, et c’est déjà pas mal.
La politesse épistémologique nous demande d’être moins que ce que nous sommes véritablement et ce, sans même que ce soit dans notre propre intérêt. Comme Nick Estes a pu le montrer dans le contexte de pratiques politiques autochtones : « qu’on parle de racisme, de citoyenneté autochtone ou d’appartenance, la fourberie des politiques actuelles en matière de traumatisme est de transformer les personnes et les luttes en question de préjudice. Elles ramènent des peuples entiers à leurs traumatismes plutôt au détriment de leurs aspirations, ou même de leur simple humanité »5. Un processus qui n’est jamais en faveur des peuples autochtones, mais destiné aux « audiences blanches et aux institutions du pouvoir ».
Je pense aussi à la prise de conscience de James Baldwin réalisant que les choses qui l’ont le plus tourmenté dans sa vie étaient « les choses qui [le] connectaient avec toustes celleux qui sont vivant·es, qui ont été vivant·es »6. Le fait que j’ai survécu à différents types d’abus et que j’ai frôlé la mort à la fois à la suite d’un accident et de violence subies (même si ces expériences diffèrent entre elles comme elles diffèrent de celles vécues par les personnes autour de moi) n’est pas une carte que je peux jouer en société, ni une arme à manier pour gagner quelques points de prestige social. Ça ne me donne aucun droit particulier pour parler, évaluer, ou décider au nom d’un groupe ou d’un autre. C’est une manifestation concrète, une expérience de la vulnérabilité qui me rapproche plutôt d’une grande partie de l’humanité. Ce n’est pas quelque chose qui s’érige entre les autres et moi comme un mur : c’est un pont qui nous relie.
Après une longue discussion, j’ai finalement répondu à l’offre d’Helen par cette proposition : et si on écrivait quelque chose ensemble ?
Note du traducteur
J’ai découvert ce texte dans Radical Futurisms, de T. J. Demos (Steinberg Press, 2023), riche ouvrage dont les pages 211-212 synthétisent bien la proposition de ce puissant article d’Olúfémi Táíwò. Il s’agit d’une traduction humaine (et non machinique-automatique par IA), réalisée à l’automne 2025, en appui sur quelques conversations informelles avec Daphné Hamilton-Jones, Céline Bonicco-Donato et Mireille Roddier. Elle a été relue par Emilie Letouzey que je remercie vivement pour l’immense travail effectué.
Image d’accueil : Signet-976 sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.
À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.
Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.
En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.
Merci  !
!
Notes
- NDT : Suivant l’invitation de Sarah Bracke, María Puig de la Bellacasa et Isabelle Clair, le concept de standpoint est traduit dans cet article par « positionnement » et non « point de vue ». Renvoyons aux explications lucides des autrices à ce sujet : « Nous faisons le choix que standpoint feminism soit traduit par féminisme ‘du positionnement’, plutôt que ‘du point de vue’, alors que cette dernière expression est la plus courante en français et que le terme standpoint est, en anglais, synonyme de viewpoint. Mais le ‘point de vue’, ou encore la ‘perspective’, exposerait notre propos à des interprétations perspectivistes voire relativistes, contraires à notre intention et à celle des auteures dont nous présentons les écrits. ‘Point de vue’ ou ‘perspective’ auraient aussi l’inconvénient de diluer l’intensité contenue dans le terme standpoint qui suggère la résistance, l’opposition, l’adoption d’une attitude, la prise de position. La traduction par ‘positionnement’ permet dès lors d’insister sur le caractère politique, actif et construit du standpoint. » Pour plus de détails à ce sujet, lire María Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs. Penser nous devons !, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170-72. » Bracke, S., Puig de la Bellacasa, M., et Clair, I. (2013), « Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.
- NDT : Sur le sujet des « elite capture », on lira d’Olúfẹ́mi O. Táíwò son ouvrage éponyme paru peu de temps après cet article : Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics (And Everything Else), Pluto Press, 2022. L’ouvrage est paru en français en novembre 2023 chez l’éditeur québécois Lux, sous le titre L’élite cannibale : comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires (et tout le reste).
- NDT : Cité notamment dans David Scott Fitzgerald & David Cook-Martin, Culling the Masses : The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Amiricas, 7 (2014), p. 36.
- Nous choisissons de traduire constructive par constructif en accord avec le choix fait par la traduction québécoise dans L’Élite cannibale, Lux, 2023).
- NDT : https://sokokisojourn.wordpress.com/2020/09/11/nick-estes-on-trauma-politics/
- NDT : “You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”— James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who You Are”, Life Magazine, mai 24, 1963.
L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.
24.12.2025 à 15:38
Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525
Aurélien Berlan
En Occident, on raconte que la liberté politique débute avec les révolutions du siècle des Lumières. A rebours de ce récit, et à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte des paysans allemands de 1525, Aurélien Berlan rappelle qu'une conception terrestre de la liberté s'est alors affirmée. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité !
L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (6284 mots)
Temps de lecture : 13 minutes
Il y a cinq cents ans eut lieu la plus puissante révolte populaire ayant ébranlé l’Europe avant 1789 : la « Guerre des paysans allemands ». Cette tentative de renversement de l’ordre féodal commence dans le sud-ouest de l’Allemagne actuelle (à l’époque, il s’agissait du Saint-Empire romain germanique), mais se diffuse bien au-delà, débordant sur les territoires suisses, autrichiens, italiens et français (dont seul l’Est est concerné, de l’Alsace à la Franche Comté1). Il ne s’agit pas vraiment d’une guerre, mais d’une série de soulèvements régionaux dont le premier commence en 1524 et le dernier est écrasé en 1526 – faisant en tout 100 000 morts. La paysannerie constitue la base sociale de ce mouvement révolutionnaire, mais celui-ci fédère également d’autres couches sociales comme les ouvriers des mines et le petit peuple des villes – raison pour laquelle on parle aujourd’hui plutôt d’une « révolution de l’homme du commun »2. Il rallie même des nobles, dont certains prennent la tête des bandes insurgées qui sillonnent les contrées en brûlant les châteaux et en pillant les abbayes, ainsi que certains prédicateurs désireux d’aller plus loin que Luther.
Ce mouvement se situe dans le sillage de la Réforme (qui commence vers 1517) et lui est étroitement lié : la remise en question par Luther de l’Église établie et de son autorité suprême, le Pape, ouvre les vannes de la contestation de la société féodale que la religion catholique contribuait à légitimer et dont elle était l’une des composantes essentielles, avec son riche clergé possédant d’innombrables domaines exploités, comme ceux des seigneurs, par une paysannerie soumise au servage. Plus précisément, elle rouvre les vannes de la contestation : la Guerre des paysans a été précédée d’une longue série de révoltes, notamment le mouvement Bundschuh qui la précède immédiatement3. Compte tenu du rôle de l’Église dans l’ordre social, ces insurrections ont souvent pris la forme de mouvements hérétiques4. Mais si les paysans, dans leur quête d’émancipation, ont pu s’appuyer sur Luther, sa critique des abus de l’Église et ses réflexions sur « la liberté du chrétien » (1520), l’instigateur de la Réforme prend finalement le parti de l’ordre et appelle les seigneurs à écraser dans le sang les « hordes criminelles et pillardes de paysans » (1525).

Le plus connu des intellectuels religieux ayant participé à la Guerre des paysans est Thomas Müntzer. D’abord partisan de Luther, ce prédicateur s’est rapidement opposé à lui pour radicaliser la Réforme dans un sens social et politique. Son nom est associé au renouveau de la vieille formule omnia sunt communia (tout est à toutes et tous), libérée des restrictions qui l’accompagnaient par le passé (relatives aux situations de nécessité : cette formule servait à justifier la transgression des règles de propriété, mais seulement en cas de dénuement extrême). Souvent présenté comme un précurseur du communisme moderne5, Müntzer en est venu à incarner la Guerre des paysans, bien qu’il n’en ait été que l’un des meneurs et l’une des tête-pensante6.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
S’il me semble important de rappeler l’existence de ce mouvement à l’occasion de son 500ème anniversaire, ce n’est pas seulement pour honorer la mémoire des vaincus de l’histoire. Cette révolte a eu la spécificité, par rapport à d’autres « jacqueries », de formuler explicitement des revendications de liberté, à l’instar des révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Elles témoignent toutefois d’une compréhension originale de la liberté, différente de celle qui s’est imposée dans notre culture depuis ces révolutions « fondatrices ». Se la remémorer n’est pas sans intérêt aujourd’hui, à l’heure où le désastre socio-écologique invite à repenser le « grand récit » de la liberté moderne7 – ce « roman occidental » (comme on parle de roman national) qui présente la modernité, depuis les Lumières, sous l’unique jour de l’émancipation. 1525 met justement en question cette manière usuelle de nous représenter notre histoire. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité. Mais ses revendications mettent en évidence une conception de la liberté basée sur les communs et la subsistance, bien différente de celle défendue dans les « déclarations des droits » au XVIIIe siècle, avec leur sacralisation de la propriété. C’est avec cette conception terrestre de la liberté que l’aspiration écologiste à l’autonomie matérielle et politique renoue aujourd’hui, en s’opposant à la conception de la liberté qui est au cœur des approches libérales, néolibérales et libertariennes : la liberté individuelle basée sur la propriété privée et son accumulation sans fin.
1525 met en question la manière usuelle de nous représenter notre histoire : 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité.
En 1525, les insurgés ont exprimé leurs griefs sous diverses formes, dont tout une série de listes de revendications. La plus connue est la brochure communément appelée Les Douze Articles de la paysannerie, sorte de plateforme adoptée en mars 1525 à Memmingen (Souabe) par les représentants de diverses bandes rebelles. Contrairement à d’autres textes contenant de nombreuses exigences locales, les Douze Articles se caractérisent par un haut degré de généralité qui contribue à expliquer leur diffusion remarquable. Comme le rappelle l’historienne Lyndal Roper dans un livre récent, « Les Douze Articles devinrent un document partout reconnu par le mouvement, même si les rebelles ne savaient pas exactement ce qu’ils contenaient, et même si de nombreuses régions les révisèrent pour les adapter aux particularités locales. Bientôt, cette brochure fut reproduite en masse, grâce à la nouvelle technique d’imprimerie, l’invention des caractères mobiles, […] et elle se répandit dans toute l’Allemagne. On pouvait tenir dans sa main ces Douze Articles, pointer du doigt chaque doléance et se référer aux passages bibliques qui prouvaient leur piété »8.
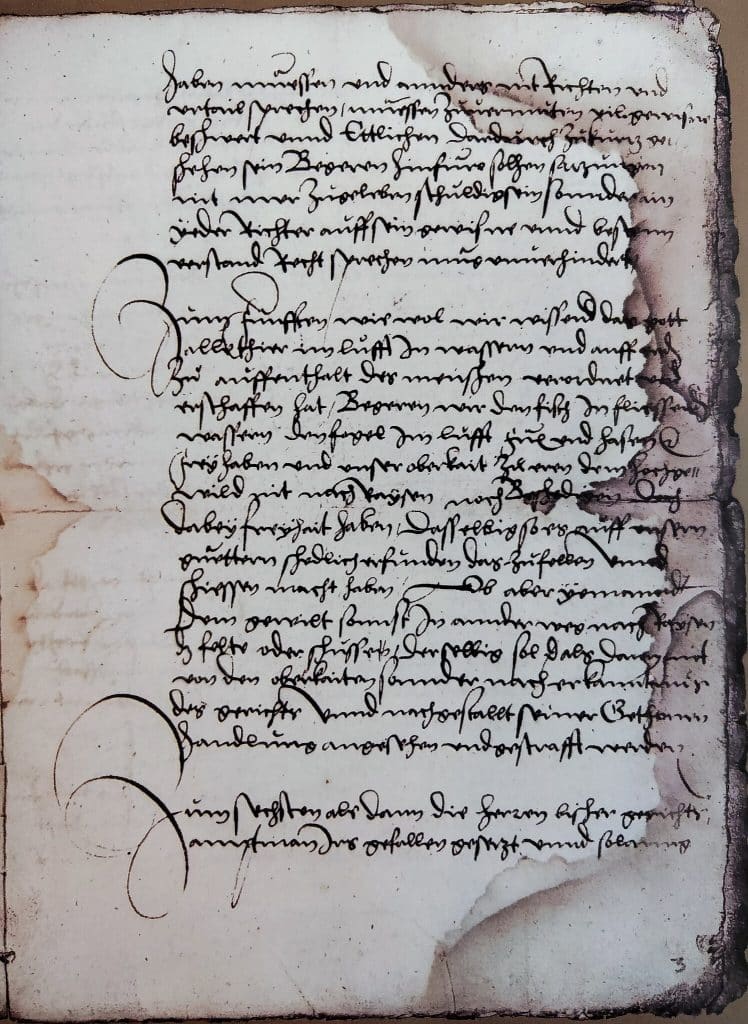
Rappelons le contenu de ces douze articles en nous basant sur une version française qui diffère de la version de Memmingen, notamment par sa concision et sa détermination9 :
Article 1. – L’Évangile doit être prêché selon la vérité, et non selon l’intérêt des seigneurs et des prêtres.
Article 2. – Nous ne payerons plus de dîmes, ni grandes ni petites.
Article 3. – L’intérêt sur les terres sera réduit à cinq pour cent.
Article 4. – Toutes les eaux doivent être libres.
Article 5. – Les forêts reviendront à la commune.
Article 6. – Le gibier sera libre.
Article 7. – Il n’y aura plus de serfs.
Article 8. – Nous élirons nous-mêmes nos autorités. Nous prendrons pour souverain qui bon nous semblera.
Article 9. – Nous serons jugés par nos pairs.
Article 10. – Nos baillis seront élus et déposés par nous.
Article 11. – Nous ne payerons plus de cas de décès.
Article 12. – Toutes les terres communales que nos seigneurs se sont appropriées rentreront à la commune10.
Pour comprendre chacun de ces articles et leur portée politique, il faudrait nous replonger dans les rapports sociaux, les modes de vie et les évolutions de l’époque (l’art. 11 fait ainsi référence à la mainmorte, une taxe à payer en cas de décès au seigneur, qui s’appropriait ainsi une partie de l’héritage). À défaut de pouvoir le faire ici, je vais me contenter d’une brève comparaison avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, afin de mettre en évidence les continuités et les différences entre la conception paysanne de la liberté basée sur les communs et la conception bourgeoise libérale fondée sur la propriété privée.
Les Douze Articles font effectivement penser à la déclaration de 1789 et sont souvent présentés, avec la Magna Carta de 1215, comme ses précurseurs. Dans la mesure où chacun des articles réclame l’abolition d’un aspect de la domination féodale, ils expriment tous l’exigence de liberté. Mais c’est l’article 7 qui la formule avec le plus haut degré de généralité : promulguer la fin du servage revient à instituer le principe d’égale liberté personnelle de tous (en 1789, c’est l’article premier). Comme en 1789, ce principe fondamental se décline en droits de participation politique, sous diverses formes : le droit d’élire et de déposer les titulaires de l’autorité (art. 8 et 10 – l’art. 5 de la Déclaration de 1789 évoque le droit de concourir à la formation de la loi et d’accéder aux emplois publics), ainsi que le droit de participer à l’application du droit (art. 9, contre la justice féodale qui était aux mains des nobles, à rebours de toute équité judiciaire – la version de Memmingen exige en outre, pour éviter l’arbitraire judiciaire, la codification du droit).
Les paysans revendiquent pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles et défendent une réappropriation des forêts et des terres accaparées par les puissants.
Signe de l’ancrage historique dans la Réforme, le premier article exige la neutralité dans l’interprétation de la Bible – la version de Memmingen exige en outre le droit pour chaque communauté d’élire (et si nécessaire de destituer) son pasteur. Trois articles portent ensuite des revendications économiques et fiscales (art. 2, 3 et 11), mais ce sont les quatre articles non encore évoqués qui manifestent toute l’originalité de la conception de la liberté portée par les insurgés. Affirmer que le gibier et les eaux sont « libres » (art. 4 et 6) est une sorte d’ellipse : ce n’est pas le gibier qui est « libre », mais les humains qui peuvent librement le chasser, ce qui suppose qu’il soit en « libre-accès ». S’il s’agit ici de revendiquer pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles (fin des privilèges), la même idée d’une réappropriation des ressources accaparées par les puissants est au cœur des articles 5 et 12, cette fois en référence aux forêts et aux terres. En toile de fond historique de ces articles, il y a le processus de privatisation des communaux (enclosures) dont Marx a montré le rôle crucial dans la genèse du capitalisme moderne, basé sur la « séparation radicale » des travailleurs avec les moyens de production et de subsistance11.
➤ Lire aussi | Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance・Aurélien Berlan (2021)
Dans les Douze Articles, la liberté a ainsi un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs. La Déclaration de 1789, elle, ne fait pas la moindre allusion à cette dimension de la question. Celle-ci n’avait pas disparu à l’époque, elle restait présente dans les cahiers de doléances. Mais la Déclaration n’est pas tant l’expression du « peuple français » invoqué dans le préambule que de la bourgeoisie en pleine ascension sociale. La centralité de la propriété en témoigne : l’art. 2 pose que les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression », et l’art. 17 que « la propriété est un droit inviolable et sacré ». La liberté est, on le voit, immédiatement associée à la propriété au sens que ce terme a pris à l’époque : la propriété privée ou, pour éviter tout malentendu, la propriété marchande (centrée sur l’abusus et non l’usus) qui caractérise le droit moderne et que l’on peut accumuler sans limite12. Or, la propriété est en ce sens la pierre angulaire de l’ordre bourgeois et capitaliste. Sa sacralisation est au cœur de la pensée libérale et néo-libérale, ainsi que de la pensée libertarienne promue par les milliardaires américains pour mettre leurs richesses à l’abri de toute limitation et de toute ponction collective.
La liberté a un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs.
Tout en partageant l’exigence d’égale liberté personnelle, les textes de 1525 et de 1789 témoignent de conceptions différentes de la liberté, ancrées dans des mondes distincts.

Les Douze Articles sont l’expression d’un monde rural et agraire « où les humains vivaient en étroite collaboration avec les animaux, le milieu naturel et où les aléas climatiques avaient une importance que les générations modernes ont souvent oubliée. Les relations entre le travail, la récolte, la nourriture et leur survie était pour eux évidentes ; la subsistance de chacun n’était pas dépendante d’entreprises puissantes et de processus industriels aussi complexes que mystérieux »13. D’où une approche matérialiste de la liberté, au sens d’un matérialisme de la subsistance profondément ancré dans le rapport à la terre, au territoire et à la communauté de celles et ceux qui l’habitent. L’égalité n’est pas seulement formelle, elle est matérielle, au sens de l’égal accès aux ressources. Celui-ci est la condition de l’autonomie matérielle, comme capacité à prendre en charge les nécessités de la vie, donc de la liberté – sinon on se retrouve sous dépendance matérielle, situation qui tôt ou tard pousse celles et ceux qui y sont acculés à se mettre au service des puissants qui contrôlent ces ressources. Indissociable de la conscience que l’accaparement des ressources est un levier de la domination sociale, cette approche de la liberté est aussi collective et même communaliste14, au sens où le partage de ressources communes en est la condition.
La capacité à prendre en charge les nécessités de la vie permet d’exercer sa liberté collectivement sans être sous la dépendance matérielle d’une structure sociale hiérarchique.
Les déclarations des droits du siècle des Lumières témoignent en revanche d’une conception plus individualiste, urbaine et abstraite de la liberté. Elles présupposent un individu coupé de toute communauté locale ainsi que des ressources permettant l’autonomie matérielle : un individu dont le modèle est implicitement le bourgeois qui, en ville, s’approvisionne par le moyen du marché – dispositif qui, dans les conditions modernes, permet aux riches de se délivrer des nécessités de la vie en se déchargeant des tâches correspondantes sur les plus pauvres. Cette liberté indissociable du marché s’éprouve dans l’expérience du choix et le sentiment de souveraineté du moi. En se nourrissant de l’élargissement des possibles et de l’accumulation de propriétés, elle se gagne contre la subsistance et les « communs » qui permettaient de l’assurer – et bien sûr contre les « gens du commun » aux dépens de qui les individus fortunés vont pouvoir vivre15.

En montrant que le principe d’égale liberté n’est pas une innovation bourgeoise, 1525 remet en question le grand récit de la liberté moderne et la manière dont notre civilisation occidentale se justifie. Ce principe était déjà au cœur des luttes paysannes depuis longtemps, mais sous une forme qui, loin d’impliquer la sacralisation de la propriété, supposait la défense des biens communs. Cette conception paysanne et communaliste de la liberté ne donne sans doute pas une aussi grande latitude d’action aux individus (du moins à celles et ceux que leur richesse met en position de pouvoir sur le marché). Mais elle n’aboutit pas en pratique à déposséder les populations de l’accès aux ressources permettant leur autonomie. En mettant des bornes à l’appropriation privée et en favorisant l’autonomie matérielle des populations, elle évoque des aspirations et des pratiques qui sont au cœur de l’écologie politique. Ce que le désastre écologique invite à questionner, ce n’est pas la liberté, mais une certaine conception qui s’est imposée contre d’autres approches, au point de les occulter complètement : une conception individualiste et marchande basée sur la propriété et l’expérience du choix, dont le triomphe actuel, chez les libertariens, pousse à l’obscurantisme socio-écologique et, au final, à l’abandon pur et simple du principe d’égale liberté.
➤ Lire aussi | Réécrire l’histoire, neutraliser l’écologie politique・Aurélien Berlan (2020)
Image d’ouverture : Chronique de Weissenau sur la guerre des paysans de 1525. Archives générales princières de Waldburg-Zeil, château de Zeil, ZA Ms 54, autour de 1525, pages 22-23.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- En ce qui concerne la France (où l’on parle de « Guerre des Rustauds »), lire Georges Bischoff, La Guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh, 1493-1525, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2011.
- Voir Peter Blickle, Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, Beck, München, 2012. Cet ouvrage comme nombre d’autres néglige les profondes inégalités qui traversaient les communautés paysannes, entre fermiers aisés, pauvres métayers et journaliers misérables, et bien sûr entre hommes et femmes.
- Littéralement : le mouvement des « souliers à lacets », en allusion au type de chaussures que portaient les gens du peuple, par opposition aux bottes des nobles. Il s’agit d’une série de révoltes paysannes dans l’Allemagne du Sud-Ouest, dont la première date de 1493 et qui s’achève avec la Guerre des paysans.
- Voir Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde/Senonevero, Genève /Marseille, 2014, chap. 1, p. 60-76 ; Yves Delhoysie & Georges Lapierre, L’Incendie millénariste, Os Cangareiros, 1987, p. 39-136 (disponible sur le site : http://basseintensite.internetdown.org).
- C’est la réception « socialiste » de Müntzer, dans le sillage de l’ouvrage très influent de Friedrich Engels, La Guerre des paysans en Allemagne (1850), Paris, Éditions Sociales, 2021. Sur la pensée de Müntzer, lire Ernst Bloch, Thomas Münzer. Théologien de la révolution (1921), Amsterdam, Paris, 2022.
- Voir l’essai de Maurice Pianzolla, Thomas Munzer ou la guerre des paysans (1958), Genève, Héros-Limite, 2015, ainsi que le roman d’Eric Vuillard, La Guerre des pauvres, Actes Sud, Arles, 2019. Voir aussi le roman du collectif italien Luther Blisset : Q. L’oeil de Carafa, Seuil, Paris, 2001.
- Voir notamment la deuxième thèse de Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l’histoire : quatre thèses », repris dans Après le changement climatique, penser l’histoire, Paris, Gallimard, 2023, ainsi que le livre de Pierre Charbonnier Abondance et Liberté (La Découverte, 2019), dont j’ai proposé une recension critique : https://www.terrestres.org/2020/11/02/reecrire-lhistoire-neutraliser-lecologie-politique/
- Lyndal Roper. Für die Freiheit : Der Bauernkrieg 1525, Fischer, 2024, introduction.
- Dans le texte de Memmingen, chaque article se présente sous la forme d’un paragraphe de quelques phrases précisant et justifiant les revendications paysannes, en renvoyant en marge à des passages de la Bible. Peut-être parce qu’il s’agit d’un texte de compromis, cette version canonique est parfois moins radicale que d’autres, notamment de la version française. Entre la version de Memmingen et celle que je cite, il y a aussi des différences de contenu : les articles ne sont pas tout à fait dans le même ordre et leur contenu varie légèrement. Par exemple, la question des corvées (impôts en travail) n’apparaît pas dans la version française, alors que leur allègement est exigé dans la version de Memmingen.
- Cité par Pianzolla, op. cit., p. 237. On peut trouver une présentation en français des Douze Articles de Memmingen dans Charles Serfass, La Tourmente 1525. La Réforme et la Guerre des paysans. Incidences en Alsace Bossue, Scheuer, Drulingen, 2007, p. 27-30.
- Karl Marx, Le Capital, Livre 1, chap. sur « l’accumulation primitive » (Ed. Sociales, 1976, p. 518).
- Voir mon analyse de la propriété moderne dans Anatomie du chez soi. De l’usage commun à la spéculation immobilière, analyse de la propriété foncière, publié dans la revue Z en 2013 : https://sniadecky.wordpress.com/2018/06/04/berlan-propriete/
- Lyndal Roper, Für die Freiheit, op. cit., introduction.
- Le grand spécialiste de la guerre des paysans Peter Blickle souligne fortement cette dimension dans Der Bauernkrig, op. cit., chap. 5.
- Sur le lien entre la liberté de choix et la délivrance, voir mon ouvrage Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021 (dont un extrait est disponible sur le site des Terrestres : https://www.terrestres.org/2021/11/27/autonomie-limaginaire-revolutionnaire-de-la-subsistance/).
L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.
11.12.2025 à 14:52
La fabrique d’un boycott : comment Israël a perdu le charbon colombien
Andreas Malm · Maxy Guedes
Jusqu’en 2024, plus de 60 % du charbon consommé en Israël provenait de Colombie. Un scandale pour les activistes palestinien·nes, mais aussi pour les syndicats colombiens et pour le président de gauche, hostile aux fossiles. Enquête haletante au cœur d’une campagne contre la relation toxique entre l'industrie minière colombienne et le militarisme israélien.
L’article La fabrique d’un boycott : comment Israël a perdu le charbon colombien est apparu en premier sur Terrestres.
Texte intégral (14122 mots)
Temps de lecture : 27 minutes
Cet article est la version française et enrichie de « The Making of a Coal Boycott. Inside the campaign to break the toxic relationship between Colombian mining and Israeli militarism », une enquête parue dans la revue Jewish Currents en octobre 2025. La traduction a été réalisée par la co-autrice.
Le 1er novembre 2023, trois semaines après le début de la guerre israélienne contre Gaza, cinq jours après l’entrée des chars dans la bande de Gaza, le lendemain de l’ensevelissement de plus de 150 Palestinien·nes sous un immeuble d’habitation à Nuseirat – dont environ la moitié étaient des enfants, beaucoup jouant au football à proximité de la maison au moment des bombardements –, un acteur fait son entrée en scène depuis l’autre côté de l’Atlantique : Sintracarbón, le syndicat des mineurs de charbon colombiens. Dans un communiqué, Sintracarbón qualifie les événements de « génocide » et appelle le gouvernement colombien à « suspendre les exportations de charbon vers Israël »1.
« Nous sommes conscients que notre travail actuel est cause de souffrance, de douleur et de mort pour nos frères et sœurs en Palestine, nous confie quelques mois plus tard Juan Carlos Solano, mineur de charbon et membre de Sintracarbón. Nous avons vu comment Israël utilise l’énergie que nous produisons pour fabriquer toute cette technologie de pointe et ces logiciels, tous ces instruments de guerre. Nous avons dit aux entreprises que nous ne voulons pas que notre travail ait cet effet dans une autre partie du monde. C’est pourquoi nous signons ces documents pour protester contre la guerre d’extermination. »
Plus proche du bain de sang, Leyla, une militante palestinienne, est galvanisée par cet appel. Originaire de Gaza mais vivant à Amman en Jordanie, Leyla, qui a souhaité conserver l’anonymat, travaille pour Disrupt Power, un collectif de recherche militant palestinien en quête de moyens pour enrayer la machine de mort. Pour elle, le charbon est la cible idéale : « Le charbon importé en Israël est directement injecté dans son réseau électrique unifié. Il alimente les colonies de Cisjordanie, l’intelligence artificielle utilisée pour bombarder Gaza, les usines d’armement, les bases : tout fonctionne à l’électricité », nous explique-t-elle lors d’un entretien en juin 2025. En collectant des données, Leyla et ses collègues découvrent que plus de 60 % de ce charbon provient de Colombie. Après avoir identifié les navires qui transportent le charbon et les ports où ils accostent, ils transmettent leurs recherches à l’Institut Palestinien de Diplomatie Publique (PIPD), une ONG basée à Ramallah.
Au printemps 2024, Amira, une militante du PIPD qui a également requis l’anonymat, quitte la Cisjordanie avec une mission : convaincre le gouvernement colombien de ne pas exporter son charbon vers Israël.
L'infolettre des Terrestres
Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.
Le décret 1047, préambule à l’arrêt des exportations de charbon colombien vers Israël
Lorsque la Grande-Bretagne occupa la Palestine à partir de 1917, elle apporta avec elle une économie fonctionnant aux combustibles fossiles. Principale source d’électricité, le charbon joua un rôle crucial dans l’accélération de la colonisation de la région. Au début du XXe siècle, les colonies juives bénéficièrent d’un accès privilégié au réseau électrique palestinien nouvellement établi2. À la fin du mandat britannique, en 1948, le Yishouv – les Juifs présents en Palestine mandataire avant la création de l’État d’Israël, majoritairement des colons récemment établis – représentait un tiers de la population, mais consommait 90 % de l’électricité. Jusqu’au début du XXIe siècle, le charbon importé demeura la principale source d’électricité produite et distribuée sur les territoires conquis en 1948 et en 1967.
Mais à l’aube du nouveau millénaire, du gaz fut découvert dans les eaux de la Palestine historique, et Israël intensifia rapidement son extraction afin d’alimenter ses centrales électriques avec cette ressource. Ce fut un succès mitigé3 : à la veille du génocide à Gaza, entre un cinquième et un quart de l’électricité du pays provenait encore de la combustion du charbon extrait en grande partie de terres violemment dépeuplées en Colombie4. En 2023, les entreprises fossiles colombiennes ont expédié pour près de 447 millions de dollars de charbon vers Israël, ce qui représente environ 5 % des exportations de charbon de la Colombie et près de la moitié des importations de cette énergie fossile pour Israël.
À la veille du génocide à Gaza, entre un cinquième et un quart de l’électricité israélienne provenait de la combustion du charbon, extrait en grande partie de terres violemment dépeuplées en Colombie.
C’est avec cette réalité en tête qu’Amira se rend à Bogota début 2024, espérant convaincre la Colombie de mettre fin à une collaboration qui a ravagé de nombreuses vies des deux côtés de l’Atlantique. Elle veut s’adresser à un gouvernement colombien qui, pour la première fois de son histoire, est composé de forces de gauche. En 2022, Gustavo Petro, ancien membre du Mouvement du 19 avril (M-19), organisation de guérilla d’extrême gauche, a été élu président de la Colombie. Il a été soutenu par une multitude de mouvements sociaux, dont Sintracarbón, les groupes indigènes et les organisations environnementales. Petro avait fait campagne avec le slogan « la politique de vie » et avec un programme de refonte de l’économie colombienne, prévoyant notamment – et c’est là le plus audacieux – de la sevrer des énergies fossiles. Après sa victoire, le gouvernement a rapidement lancé le programme de transition le plus radical jamais mis en œuvre dans un pays producteur d’énergies fossiles : interdiction totale de toute nouvelle infrastructure liée aux énergies fossiles5. Aucun contrat ne serait délivré pour l’ouverture d’une mine de charbon, le forage de pétrole ou la prospection de gaz. Alors que la COP30 de 2025 a abouti à un accord qui ne fait aucunement mention des énergies fossiles, la Colombie fait ainsi figure d’exception mondiale.
➤ Lire aussi | Il faut détruire les infrastructures des énergies fossiles・Andreas Malm (2023)
L’une des architectes de ce programme est Susana Muhamad, première ministre de l’Environnement de Petro jusqu’au début de l’année 2025. Lorsque nous la rencontrons en avril 2025, elle nous confie se préparer à mener sa propre campagne présidentielle. Figure emblématique de la justice climatique et de la protection de la biodiversité en Colombie, elle est également palestinienne, petite-fille d’un immigrant ayant fui la conscription dans l’armée britannique en 1925.
Susana Muhamad a renoué avec la Palestine lors d’un voyage en Cisjordanie en 2009. « Mon grand-père n’est jamais retourné en Palestine, mais il est resté en contact au fil des ans par courrier, notamment avec sa femme et les deux enfants qu’il avait laissés derrière lui. J’avais des dizaines de cousins éparpillés autour de Ramallah qui savaient que j’existais. Ils n’arrêtaient pas de me demander : ‘Pourquoi n’es-tu pas venue plus tôt ?’ Ces liens familiaux transcendent le temps et l’espace », nous raconte-t-elle.

C’est donc à Susana Muhamad qu’Amira, l’activiste du PIPD, choisit de rendre visite. Lorsqu’elles se rencontrent autour d’un café à Bogotá, la militante expose sa mission à la ministre. Susana Muhamad est horrifiée d’apprendre le rôle crucial que joue le charbon colombien dans le génocide en cours : « J’ai dit : « Il faut absolument que le président Petro soit au courant » – et j’ai ouvert la voie aux mouvements sociaux palestiniens pour qu’ils transmettent directement leur message au président. » Petro, qui a toujours affiché sa solidarité avec les Palestiniens, est aisément convaincu6. En juin 2024, le président annonce que la Colombie cessera ses ventes de charbon à Israël7. En août, il publie sur Twitter une brève explication : « Le charbon colombien sert à fabriquer des bombes pour tuer des enfants palestiniens »8, accompagnée de la copie d’un décret : le décret 1047, qui inscrit l’interdiction d’exportation vers Israël dans la loi9. Citant le cas du génocide sud-africain, il souligne que la Constitution colombienne « garantit le droit à la propriété privée » mais qu’« en cas de conflit entre des droits, les intérêts privés doivent céder le pas aux préoccupations publiques et sociales ».
Outre-Atlantique, la décision de Petro de se désengager concrètement du génocide commis par Israël fait des vagues. Il s’agit de la plus grande victoire à ce jour pour la campagne en faveur d’un embargo énergétique contre Israël, voire pour le mouvement de boycott dans son ensemble. Le Front populaire de libération de la Palestine et le Hamas saluent cette initiative10, publiant des communiqués élogieux à l’égard du président colombien. Pour la gauche du monde entier, les actions de Petro offrent un aperçu d’une véritable solidarité internationaliste avec la Palestine11. Enfin, un modèle à suivre ! Comme l’écrit la militante des droits humains Rula Jamal dans Jacobin : « La Colombie étant le premier exportateur de charbon vers Israël, cette décision n’est pas seulement une victoire symbolique, mais elle démontre l’impact considérable qu’un embargo énergétique plus large pourrait avoir pour mettre fin au génocide israélien à Gaza. »12
Outre-Atlantique, la décision de Petro de se désengager concrètement du génocide commis par Israël fait des vagues. Il s’agit de la plus grande victoire à ce jour pour la campagne en faveur d’un embargo énergétique contre Israël, voire pour le mouvement de boycott dans son ensemble.
En réaction à l’annonce de l’embargo, la Compagnie israélienne d’électricité, principal fournisseur d’électricité du pays, déclare être en négociations avec des « fournisseurs alternatifs » d’énergie afin d’« élargir sa marge de manœuvre ». Il n’empêche que l’asphyxie des approvisionnements colombiens menace de laisser Israël à bout de souffle en matière d’énergie.
Plus tard, il s’avéra pourtant que l’extraction minière alimentant Israël ne s’interrompit pas si rapidement. Même après l’interdiction de Petro, des navires continuèrent de quitter les ports colombiens à destination des territoires occupés, les compagnies d’extraction de charbon trouvant le moyen de contourner la loi. Le décret 1047 n’a donc pas fait cesser les exportations, mais il marqua le préambule de leur arrêt.
L’enclave charbonnière de Colombie
Avril 2025, région de Cesar au nord de la Colombie. En traversant le « couloir minier » colombien, nous nous heurtons à des murs camouflant les immenses cratères. D’imposants remparts de pierre et de scories ont été construits par les compagnies fossiles pour dissimuler ces terres désolées. Un glissement de terrain inopiné a creusé un point de vue surplombant la fosse, nous permettant d’admirer le paysage : une cuvette s’enfonçant à des centaines de mètres sous terre, des terrasses noires serpentant sur les flancs de la mine pour le passage des camions. Rien ne peut pousser, rien ne peut vivre sur cette terre. Pour reprendre les mots de l’universitaire et militant colombien Felipe Corral Montoya, qui nous accompagnait lors de ce voyage : « C’est un désert mort ».

Autrefois, racontent les habitants, cette région était baignée de bleu et de vert et l’on s’adonnait aux activités de pêche, de culture et d’élevage. Mais tout a basculé avec l’arrivée des multinationales minières. La plus grande entreprise de la région est Drummond, dont le siège social se trouve à Birmingham, en Alabama. Elle gère la ville de La Loma comme un mini-État virtuel, devenu le prototype de la ville minière : un seul grand employeur, un réseau de maisons à un étage pour les travailleurs et leurs familles. L’entreprise s’est implantée à Cesar en 1993 et a aussitôt entrepris de défricher les terres par la force13. Nombre d’habitant·es ont été contraints de vendre leurs terres : « On les a pratiquement forcés à les céder », explique une habitante de La Loma, sous couvert d’anonymat. Beaucoup se sont ensuite retrouvés dans l’impossibilité de revenir, leurs champs ayant été réduits en cendres14. Une prise de terres brutale qui s’est traduite par « la mort d’innocents, des viols, des déplacements de population. Dieu seul sait combien de paysans gisent ensevelis ici », poursuit l’habitante. « Le charbon qui sort de cette terre est taché de sang », conclut-elle.
Plus au nord, les habitant·es de la région de La Guajira ont subi le même sort15. Ici, les Wayuu — un peuple autochtone qui a survécu à la colonisation espagnole grâce à une combinaison de chance, d’adaptation, de diplomatie et de guérilla — ont subi de plein fouet la terreur16. Dans les années 1990, ce peuple a fait face à des expulsions massives et à une vague d’atrocités commises par les paramilitaires. Cela jusqu’à ce que la région puisse se vanter de posséder la plus grande mine à ciel ouvert d’Amérique latine, propriété du négociant en matières premières anglo-suisse Glencore.
« Dieu seul sait combien de paysans gisent encore enterrés ici… Le charbon qui sort de cette terre est taché de sang. »
Une habitante du village de La Loma, dans la région charbonnière de la Colombie
L’arrivée des géants miniers dans les années 1990 a coïncidé avec une intensification du conflit armé qui ravageait la Colombie depuis plusieurs décennies, opposant paramilitaires d’extrême droite et guérillas d’extrême gauche. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et l’Armée de libération nationale (ALN) sont nées des révoltes paysannes contre la concentration des terres entre les mains de grands propriétaires terriens. Ces groupes s’en prirent alors aux infrastructures de l’industrie charbonnière, faisant sauter des trains de charbon, kidnappant des cadres et des ingénieurs. En réponse, Drummond créa sa propre force paramilitaire sous l’égide de la milice d’extrême droite existante, les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)17. La compagnie basée en Alabama engagea des centaines d’hommes armés, leur fournissant des terrains d’entraînement et se coordonnant avec eux pour sécuriser le périmètre de ses mines de charbon. On installa des points de contrôle le long de la voie ferrée convoyant le charbon depuis les mines jusqu’au au port. Les gardes privés qui y étaient affectés pouvaient tirer sur toute personne jugée « suspecte ». Les paramilitaires qualifiaient alors leur mission de « nettoyage social », une stratégie visant à pousser la population à fuir par les menaces et les meurtres.

C’est ainsi que s’est constituée l’enclave charbonnière en Colombie18. Après avoir forcé à l’exode quelque 300 000 personnes, dont plusieurs milliers ont péri, Glencore et Drummond se sont emparé de l’extrême nord du pays. Les habitants expulsés furent empêchés de revenir : leurs champs avaient été transformés en terrils de charbon.
La Colombie est ainsi un cas paradigmatique d’échange écologiquement inégal, ses ressources naturelles étant constamment extraites pour alimenter le marché mondial19. La conquête de ces deux entreprises a consolidé ce schéma. La part du minerai exporté vers d’autres pays oscille entre 90 % et 97 %. L’anthracite, un charbon solide à faible teneur en soufre, est très demandé par les centrales électriques, des Pays-Bas à Israël20. « L’homme blanc mange du charbon », a déclaré une femme Wayuu à la chercheuse Aviva Chomsky : « Ni nous ni nos animaux ne mangeons de charbon, ce n’est pas notre mode de vie. »21
Situé à deux pas de Santa Marta, la première ville construite par les colons espagnols en Colombie, le « port Drummond (Puerto Drummond) » est une voie ferrée qui longe le rivage et se prolonge au-dessus de l’eau, soutenue par d’épais piliers en ciment22. De loin, la structure ressemble à une paille d’acier aspirant les matières premières de la Colombie. De près, c’est un monument noirci par la suie, symbole de l’inertie. Quelques bateaux de pêche s’approchent prudemment de l’installation, surveillée par des agents de sécurité privés.

Depuis le port, nous remontons la voie ferrée, le long de la côte de La Guajira. Elle traverse le territoire d’une communauté Wayuu. Sur cette terre aride et poussiéreuse, la population vit de l’élevage et de la pêche. Maria Dolores en est l’autorité matriarcale traditionnelle. Elle déplore la pollution du réservoir d’eau par les particules de charbon projetées depuis les trains. À cela s’ajoute le changement climatique. « Aujourd’hui, le soleil est beaucoup plus chaud qu’avant », constate-t-elle. Son fils Luis Carlos ajoute : « Quand la pluie arrive, nous sommes heureux, car nous pouvons semer, les fleurs éclosent et nos animaux ont de l’eau à boire. Mais aujourd’hui, les pluies sont faibles et rares. Le désert nous encercle. »

En empruntant les routes sinueuses qui mènent aux montagnes de la Sierra Nevada, nous rencontrons une autre communauté autochtone : celle du peuple Kankuamo, dans la ville de La Mina. Les Kankuamo ont survécu aux génocides perpétrés par les conquistadors en se réfugiant dans les hauteurs. Près d’un demi-siècle plus tard, la guerre civile et le charbon les ont rattrapés. Des centaines de Kankuamo ont été assassiné·es, des familles entières déplacées, plusieurs sites sacrés de la communauté ont été perdus au profit de l’expansion des mines. La poussière de charbon a contaminé l’eau et la terre. « Lorsque nous avons commencé à revendiquer la possession ancestrale de ces territoires, le conflit armé s’est intensifié et les demandes de titres miniers se sont multipliées dans la région. Ils voulaient nous déplacer pour mener à bien leurs mégaprojets, car les montagnes sont riches en or et en charbon. Le peuple Kankuamo a été menacé d’extermination », nous raconte Daniel Maestre Villazón, tout en frottant régulièrement le « poporo » traditionnel, une calebasse évidée contenant de la poudre de coquillages broyés.

Les Kankuamo ont réagi en affirmant leur identité et en rappelant leurs droits. « Nous sommes actuellement en train de retrouver la culture et les traditions que nous avions abandonnées », explique Maestre Villazón. Les Kankuamo entretiennent une relation spirituelle avec la « nature sacrée », constamment menacée par l’extractivisme et désormais aussi par le changement climatique. « Le climat est devenu instable. Pendant de longues périodes, il ne pleut presque pas, puis il y a des cyclones beaucoup plus violents qu’avant. Même ici, dans les montagnes, le climat n’est plus ce qu’il était. » Il montre du doigt un sommet montagneux : « Avant, il était recouvert de neige. »
Glencore et Drummond figurent toutes deux sur la liste du Guardian des 100 entreprises qui ont le plus contribué à embraser la planète sous l’effet des énergies fossiles23.
Dans ces zones sacrifiées résultant de la mainmise sur les ressources naturelles, une litanie de malheurs s’est abattue24 : effondrement de l’agriculture ; pénuries d’eau dues au détournement de dizaines de rivières par les mines25 ; pollution atmosphérique attaquant les poumons, les yeux et d’autres organes ; maisons fissurées par les explosions souterraines ; animaux et humains tués par les trains de charbon. Lorsque la contamination atteint des niveaux intolérables, les communautés déjà déplacées doivent être à nouveau « réinstallées ». Ces dépossessions alimentent l’extrême pauvreté dans le pays le plus inégalitaire du continent.

L’implication d’Israël dans le conflit armé en Colombie
Israël est profondément impliqué dans cette histoire d’extraction destructrice. Tout au long du conflit armé colombien, des acteurs israéliens ont contribué à ouvrir la voie à Drummond et Glencore, en assistant et en équipant les forces militaires de droite. Une histoire d’implications sordides largement documentées, et encore vive dans les mémoires en Colombie26. Comme le soulignait le syndicat Sintracarbón dans son premier appel en novembre 2023, le charbon envoyé aujourd’hui dans les centrales de la machine génocidaire est « lié au rôle d’Israël dans la formation de groupes militaires et paramilitaires impliqués dans le conflit armé qu’a subi notre pays ». D’autres pays qu’Israël ont certes acheté davantage de charbon à la Colombie. Mais aucun n’a laissé une empreinte aussi déterminante sur le développement sanglant de cette industrie.
D’autres pays qu’Israël ont certes acheté davantage de charbon à la Colombie, mais aucun n’a laissé une empreinte aussi déterminante sur le développement sanglant de cette industrie.
Il est un nom que les souvenirs de cette période évoquent inévitablement. C’est celui de Carlos Castaño, le fondateur de l’AUC, les « forces d’Autodéfense Unies de Colombie » – une milice d’extrême droite. Au début des années 1980, ce jeune Colombien anticommuniste s’installe en Israël pour deux ans. Il suit des cours dans des écoles militaires ainsi qu’à l’Université hébraïque. Dans son autobiographie, il décrit cette expérience en termes élogieux : « Je n’ai pas seulement appris l’entraînement militaire en Israël. C’est là que j’ai acquis la conviction qu’il était possible de vaincre les guérilleros en Colombie. J’ai commencé à comprendre comment un peuple pouvait se défendre contre le monde entier. (…) De fait, j’ai repris des Israéliens l’idée d’autodéfense [par la large diffusion] d’armes ; chaque citoyen de ce pays est un soldat en puissance. »27
À son retour chez lui, Castaño entre dans l’armée et gravit les échelons des paramilitaires. En 1997, il les unifie sous le commandement de l’AUC, dont l’une des branches s’est spécialisée dans le défrichage des terres pour Drummond. En 2001, ses membres assassinent trois dirigeants syndicaux28 à la demande du PDG de l’entreprise29. Glencore en profite également. En 1997, des hommes armés font irruption dans le village de Santa Fe en clamant : « Nous sommes de l’AUC et Carlos Castaño est notre commandant. Nous allons rester ici pour procéder à un nettoyage social. »28 Après l’exécution sommaire d’un garçon de 13 ans, les habitants prennent la fuite. Leurs biens sont déclarés « abandonnés » et vendus aux enchères. Une grande partie des terres finissent par être intégrées à la concession de Glencore. À l’échelle nationale, ce sont les AUC qui commettent la majeure partie des massacres et des déplacements massifs pendant la guerre.
Israël a fourni près de 40 % des armes utilisées par l’armée pour combattre les guérilleros en Colombie.
L’implication d’Israël dans le conflit armé dépasse largement le cas de Carlos Castaño. Au milieu des années 1980, des rebelles des FARC, alliés à des syndicalistes et des intellectuels de gauche, fondent un parti politique appelé Unión Patriótica (Unité patriotique). L’État colombien réagit en anéantissant physiquement le parti, tuant plus de 6 000 de ses membres – cadres, maires, candidats à la présidentielle – en l’espace de vingt ans. L’opération à l’origine de ces meurtres est en partie conçue par Rafael Eitan, agent du Mossad et ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Yitzhak Rabin. Par ailleurs, l’AUC elle-même a bénéficié d’un entraînement intensif dispensé par Yair Klein30, un autre vétéran et mercenaire israélien qui a également prêté ses services aux escadrons de la mort du cartel de Medellín, l’organisation criminelle de narcotrafic fondée par Pablo Escobar31. (En 2001, le gouvernement colombien a demandé son extradition d’Israël, en vain32.) Israël a également fourni près de 40 % des armes utilisées par l’armée pour combattre les guérilleros26 : le drone Hermes, testé pour la première fois sur les champs de bataille de Gaza33, était particulièrement apprécié en Colombie34, tout comme le Galil, un fusil automatique de fabrication israélienne.

À l’opposé du spectre politique, on trouve l’image quasiment en miroir de ces intrications : une partie de la gauche colombienne a créé des liens avec la résistance armée palestinienne. Dans les années 1970, le groupe de guérilla M-19 a envoyé ses combattants s’entraîner dans les camps de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). « Durant notre lutte armée, mes camarades sont allés au Sahara s’entraîner avec l’OLP. C’est là qu’est né notre amour pour la Palestine », nous a confié le président colombien Gustavo Petro, lui-même ancien membre du M-19, qui ne regrette pas ce passé35. En 1981, le M-19 a manifesté sa solidarité avec l’OLP en attaquant l’ambassade d’Israël à Bogota36. Après le massacre de Sabra et Chatila en 1982, le groupe a attaqué l’ambassade une seconde fois.
La position de Gustavo Petro est en tout point opposée à celle de ses prédécesseurs, issus de la droite.
En avril 2025, nous avons retrouvé Petro dans le palais présidentiel, en face de la Cour suprême. C’est cette même cour qui fut prise d’assaut par les commandos du M-19 voilà 40 ans, lors de leur action la plus spectaculaire en 1985, au cours de laquelle 300 personnes avaient été prises en otage, dont des juges. Dans le raid de l’armée qui a suivi, près de 100 personnes sont mortes. Un mois plus tôt, Gustavo Petro avait été arrêté, condamné pour possession d’armes, emprisonné et soumis à la torture. Aujourd’hui, il a aménagé son bureau de président comme le foyer confortable d’un militant de gauche, rempli de livres marxistes. Sur un meuble trône une colombe coiffée d’un keffieh.
La position de Petro est en tout point opposée à celle de ses prédécesseurs, issus de la droite. En 2013, le président Juan Manuel Santos s’était rendu à Jérusalem pour serrer la main de Netanyahu et signer un accord de libre-échange entre les deux pays. Dans le journal Haaretz, il s’est dit « très fier » que la Colombie soit qualifiée d’« Israël de l’Amérique latine »37. Évoquant l’utilisation d’équipements militaires israéliens, Santos – qui avait été ministre de la Défense au plus fort de la guerre menée par l’État contre les guérillas marxistes – affirmait aux dirigeants israéliens : « Grâce à votre technologie et à nos ressources, nous pouvons créer une synergie considérable. » Son successeur, Ivan Duque, a repris le flambeau. En novembre 2021, Duque a visité à son tour Israël, où il a assisté à un exercice naval, fait l’éloge de l’accord de libre-échange, inauguré le premier « bureau du commerce et de l’innovation » colombien hors du pays, et s’est entretenu avec des responsables israéliens au sujet des menaces supposées du Hezbollah à la frontière vénézuélienne38.

Désormais, le camp de gauche pro-palestinien est au pouvoir en Colombie. Mais jamais Israël et la Palestine n’ont cessé de peser sur les luttes internes dans le pays.
Le sang qui a coulé en Colombie continue d’être associé à cette terre lointaine. « Ils sèment la mort et la destruction partout où ils passent », déclare une ancienne combattante des FARC, en pointant le lien entre les compagnies charbonnières, les États-Unis et Israël. La plupart des membres de cette guérilla se sont démobilisés depuis l’entrée en vigueur de l’accord de paix en 2016. Ils mettent désormais leur conscience marxiste au service de projets autres que la lutte armée, comme la transition énergétique. Lors d’un cours sur la transition énergétique équitable qui se tient dans une université populaire de Fonseca, à La Guajira et auquel nous assistons, un participant déclare : « Nous sommes du côté de ceux qui souffrent de la guerre. Nous sommes du peuple. Nous soutenons la décision de Petro d’arrêter d’exporter du charbon ».
➤ Lire aussi | Face aux pénuries d’énergies fossiles・Charles-François Mathis (2022)
Un vice caché dans le décret ? Campagne de boycott, saison 2
En août et septembre 2024, juste après la signature du décret 1047, les exportations de charbon vers Israël ont chuté à zéro. En octobre de la même année, la compagnie Glencore a expédié un dernier navire, puis s’est tourné vers d’autres clients pour vendre le charbon extrait de La Guajira. Depuis ses mines et ses quais de chargement portuaires sud-africains le négociant en matières premières a continué de transporter le carburant vers Israël — et l’on ne peut exclure un détournement du charbon colombien depuis d’autres ports. Selon toute apparence, la société a cependant respecté l’interdiction, peut-être usée par la pression militante39 de longue date40. Mais la compagnie Drummond a agi différemment.
Face à la résistance des élites économiques et aux ressources limitées du nouveau gouvernement, les mouvements sociaux colombiens ont été mis à contribution pour surveiller le respect de l’embargo par les compagnies charbonnières41. À Bogota, l’Institut palestinien de diplomatie publique (PIPD) a chargé Helena Müllenbach Martínez, cofondatrice de la campagne internationale Resist Glencore, de veiller au respect de la loi. Avec des militants de Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) Colombie, elle a identifié 28 navires de Drummond se dirigeant directement vers Hadera et d’autres ports israéliens, entre octobre 2024 et avril 2025. Au total, un million de tonnes de charbon colombien auraient ainsi été injectées dans le réseau d’export vers Israël, soit environ les deux tiers de la quantité moyenne d’avant l’embargo. Près d’un an après le décret 1047, les navires de Drummond avaient donc fait en sorte que la Colombie reste le principal fournisseur de charbon de l’occupation. Alors que Glencore et Drummond se partageaient auparavant la chaîne d’approvisionnement à parts égales, cette dernière l’a monopolisée sans grande difficulté, tout en évitant d’attirer l’attention sur cette activité ou sur ses anciennes relations avec les paramilitaires.
Près d’un an après le décret 1047, les navires de Drummond avaient fait en sorte que la Colombie reste le principal fournisseur de charbon de l’occupation.
La compagnie fossile a non seulement profité de l’absence de contrôle gouvernemental, mais aussi d’une faille dans le décret lui-même. Selon l’article 3 du décret 1047, l’interdiction d’exporter ne s’applique pas aux contrats signés avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est à dire au milieu de l’année 2024, comme c’est le cas pour le contrat liant Drummond à Israël. C’est cet article que le ministère du Commerce a invoqué lorsque le PIPD et la branche colombienne du mouvement BDS ont exigé des explications sur la possibilité pour Drummond de bafouer l’interdiction. « D’une certaine manière, le décret se contredit. D’un côté, il privilégie les droits humains à la propriété privée. De l’autre, il considère les obligations commerciales comme sacrées. Techniquement, Drummond n’enfreint donc peut-être pas le décret », nous a expliqué Helena Müllenbach Martínez, cofondatrice de la campagne internationale Resist Glencore, lors d’un entretien en juin, visiblement frustrée.
Dès lors, la coalition hétéroclite d’acteurs qui avait mobilisé le soutien au boycott initial se remet à l’action. Le PIPD transmet aux ministères concernés les données recueillies sur le contournement du décret. En mai, la Garde indigène Wayuu – un réseau de protection communautaire non armé – se joint à divers groupes alliés pour bloquer les mines de charbon de Cesar et La Guajira pendant une journée, brandissant des drapeaux palestiniens et réclamant un embargo effectif. Des groupes Wayuu et des syndicats organisent des réunions avec des représentants du gouvernement pour leur faire part de leur opposition au contournement de l’interdiction. Sintracarbón publie un communiqué véhément réitérant son appel au boycott – communiqué signé également par le syndicat des travailleurs du pétrole et la fédération nationale des peuples autochtones42.
À son siège de La Loma, Drummond sent la pression monter. La société publie un communiqué pour contester sa culpabilité : « Les exportations de charbon vers Israël ont été effectuées conformément à l’autorisation accordée par le gouvernement national », affirme-t-elle, soulignant que ses expéditions ont été approuvées par le ministère du Commerce, conformément à l’article trois.

Jusqu’à cette vague de protestations, Petro semble ne pas avoir été informé de la subversion de son décret. « Drummond nous trompe peut-être », lâche-t-il lors de notre entretien. Mais face à cette campagne dénonçant le mépris de Drummond pour son ordre, le président revient sur le devant de la scène. Mi-juillet 2024, il fait recouvrir le palais présidentiel de drapeaux palestiniens. Le 23 du même mois, il prononce un discours – érudit et quelque peu décousu comme il en a l’habitude – sur la catastrophe climatique, s’attardant sur la question du boycott du charbon43. Il semble désormais bouillonner de rage. « Ne suis-je qu’une coquille vide, une marionnette dans un théâtre qu’ils appellent la politique, alors que le véritable pouvoir se trouve ailleurs ?… L’exportation de charbon vers Israël est interdite. C’est un ordre du président de la République. » Il interpelle Drummond, l’accusant d’avoir assassiné des travailleurs et d’avoir bafoué une décision démocratique. Le président blâme également son ancien ministre du Commerce, Carlos Reyes – un libéral, qui l’aurait « trompé » en insérant l’article trois dans le décret –, le qualifiant de « complice du génocide à Gaza ». Il jure de ne plus laisser « une seule tonne de charbon » atteindre Israël, et appelle les ouvriers et les Wayuu à bloquer les mines et les ports si les exportations se poursuivaient44.
Cependant, dès le lendemain du discours de Petro, Drummond envoie un autre navire : le Fortune quitte son port colombien chargé de près de 100 000 tonnes de charbon, à destination d’Israël45. Petro perd alors son sang-froid. En tant que commandant en chef des forces armées colombiennes, il ordonne à la marine46 d’intercepter toute nouvelle cargaison47. Si la compagnie tente de contourner la loi, elle se heurtera à l’intervention de navires de guerre. Une telle annonce est sans précédent dans l’histoire des initiatives de boycott ; peut-être l’est-elle aussi dans l’histoire des relations entre États et capitaux étrangers. Helena Müllenbach Martínez accueille favorablement la nouvelle : « Tant que les navires se trouvent dans les eaux colombiennes, il est en droit d’envoyer la marine, déclara-t-elle. C’est incroyable pour les autres pays de voir qu’une telle chose est possible. » Depuis l’ordre donné à la marine, PIPD n’a enregistré aucun départ de navire. Un approvisionnement de plusieurs décennies vers Israël s’est brutalement interrompu.
En juillet 2025, Petro ordonne à sa marine d’intercepter toute future livraison à Israël – une annonce sans précédent dans l’histoire des initiatives de boycott, et peut-être aussi dans celle des relations entre États et capitaux étrangers.
Le 20 août 2025, une autre raison de se réjouir survient pour les activistes : la présidence publie un second décret, le n°094948, qui annule l’article 3 du décret 1047 et instaure une interdiction totale des exportations de charbon vers Israël. En un seul trait de stylo, les contrats que Drummond avait signés avec Israël avant 2024 – et qui couraient jusqu’en 2036 – sont tous rendus caducs.
Mais cette loi n’est probablement qu’un épisode de plus dans une lutte de longue haleine. Après le décret 1047, Glencore et Drummond ont intenté 17 procès au gouvernement colombien, réclamant à chaque fois des millions de dollars en arguant le respect d’accords de libre-échange. Désormais, « il y aura encore plus de procès, car Drummond comptait sur une décennie de ventes supplémentaires et les contrats ont maintenant été annulés », déclare Helena Müllenbach Martínez.

Plus incertaine encore sera la situation en 2026, lorsque la Colombie élira un nouveau président. Les derniers sondages offrent une lueur d’espoir d’un maintien de la gauche49, mais la droite, voire l’extrême droite, reste susceptible de le reconquérir50. Parmi les principaux candidats figure Abelardo de la Espriella, qui aspire à devenir le Donald Trump colombien51. Après une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères, il a annoncé que, s’il devenait président, il établirait l’ambassade de Colombie à Jérusalem, et promouvrait une alliance stratégique avec Israël et les États-Unis comme pierre angulaire de sa politique étrangère et de sécurité52. Une position très éloignée de celle de l’actuel président Petro qui annonçait encore en octobre 2025 l’expulsion des diplomates israéliens du pays, ainsi que la rupture des accords de libre-échange avec Israël, après l’arrestation de deux citoyens colombiens voyageant à bord de la flottille humanitaire à destination de Gaza53.
À peine l’encre présidentielle était-elle sèche que des parlementaires conservateurs et des candidats à la présidence exigeaient que la Cour suprême colombienne abroge le décret 094954. Selon Müllenbach Martínez, « ce nouveau décret peut être annulé en 24 heures s’ils obtiennent gain de cause ».
➤ Lire aussi | Total face au réchauffement climatique (1968-2021)・Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta (2021)
Quel que soit l’issue de l’initiative colombienne de boycott, celle-ci a inspiré de nombreux acteurs des mouvements pour la Palestine et le climat. « Enfin un gouvernement qui a pris des mesures contre Israël. Beaucoup de pays du Sud étaient censés faire bien plus pour la Palestine, pour perturber économiquement la machine génocidaire. Mais jusqu’à présent, et nous sommes en septembre 2025, seule la Colombie s’y emploie », déplore Mohammed Usrof. Le Gazaoui, qui vit au Qatar, a participé à la création de l’Institut palestinien pour la stratégie climatique. Ces dernières années, il est devenu le visage de la jeunesse palestinienne lors des Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Usrof, qui a perdu 70 membres de sa famille lors des massacres de Khan Younis, fonde de grands espoirs sur les enseignements du boycott colombien. Il n’est pas le seul : les efforts pour pérenniser et diffuser cette expérience se sont multipliés.
Quel que soit l’issue de l’initiative colombienne de boycott, celle-ci a inspiré de nombreux acteurs des mouvements pour la Palestine et le climat.
Lors de la récente COP30 au Brésil, la campagne pour un embargo énergétique s’est concentrée sur ce pays : le Brésil s’est officiellement engagé à la fois à atténuer le changement climatique et à mettre fin à sa complicité avec le génocide. Toutefois, alors que les syndicats de travailleurs du pétrole ont exhorté le président Luiz Inácio Lula da Silva à suivre l’exemple de Petro55, le président du syndicat des travailleurs pétroliers de Rio de Janeiro a indiqué que les compagnies brésiliennes ont vraisemblablement poursuivi leurs livraisons vers Israël via l’Italie56. Réagissant au rapport publié par l’ONG Oil Change International à l’occasion de la COP3057, retraçant l’origine de plus de 21 millions de tonnes de carburant envoyées à Israël lors de son offensive contre Gaza, Mohammed Usrof y voit une confirmation de
« ce que les Palestiniens et les mouvements pour la justice climatique affirment depuis longtemps : les chaînes d’approvisionnement en combustibles fossiles sont des armes de guerre. Les gouvernements et les entreprises qui continuent à vendre du pétrole, du diesel et du kérosène à Israël, même par le biais d’intermédiaires, alimentent le génocide. Les États doivent imposer un embargo énergétique total et combler les lacunes juridiques qui rendent la complicité profitable. Les peuples doivent se soulever contre les États complices et imposer un embargo énergétique populaire. Lors de la COP30, nous devons définir ce qu’est le leadership climatique, et sa seule définition est de fermer les pipelines de la guerre, et non de les dissimuler derrière la comptabilité carbone. »
Du point de vue de militants du collectif palestinien Disrupt Power comme Leyla, le modèle de l’embargo colombien est pourtant mûr pour être mis en place par d’autres pays. Elle détaille les ingrédients de ce boycott réussi : « Un syndicat a lancé le mouvement, puis des mouvements de solidarité se sont mobilisés et des décideurs politiques ont pu être influencés. Un embargo énergétique venant de la base peut réellement aboutir. Le défi consiste désormais à le mettre en œuvre dans d’autres pays, comme l’Afrique du Sud, le Brésil et la Turquie. Ces chaînes d’approvisionnement ne seront pas démantelées en un jour. »
En effet, en Afrique du Sud par exemple, devenue l’un des fronts du mouvement de boycott58, la Fédération sud-africaine des syndicats (SAFTU) s’est bien indignée de la poursuite des échanges commerciaux avec Israël59, mais cela n’a pas empêché le pays de continuer d’y exporter du charbon. Ses livraisons ont même progressé, ce qui vaut au gouvernement d’être accusé de « double discours », puisqu’il a dans le même temps saisi de la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye d’une plainte contre Israël, affirmant que ce dernier violait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide60.

De façon plus abstraite, cet épisode peut être perçu comme une illustration frappante du conflit entre deux dialectiques.
La première est une dialectique de destruction. Le charbon colombien a alimenté l’occupation et le génocide en Palestine61, tandis que le militarisme israélien a contribué aux déplacements de population et aux destructions en Colombie, ces deux forces alimentant ensemble le dérèglement climatique. Vu depuis le nord de la Colombie, le génocide actuel à Gaza apparaît comme un aboutissement de cette dialectique : l’anéantissement physique de la Palestine est la conséquence directe d’un système mondial conçu pour détruire le plus grand nombre au profit d’une minorité. Petro l’a d’ailleurs souligné dans son discours du 23 juillet 2025 : « Que font-ils à Gaza ? Ils nous montrent comment le pouvoir du carbone peut tous nous anéantir si nous ne nous rebellons pas. (…) Monsieur Carbone détient le pouvoir mondial. (…) Nous devons détruire Monsieur Carbone, sinon il nous détruira tous, ainsi que tous les êtres vivants qui nous entourent. »43
D’un autre côté, il y a une dialectique de résistance. Le boycott du charbon est né d’une remarquable réciprocité entre les mouvements sociaux en Colombie et en Palestine et – fait unique – d’un pouvoir exécutif de gauche. Une fois au gouvernement et à la présidence, Muhamad et Petro ont fièrement répondu aux appels des campagnes extraparlementaires et ont, à leur tour, encouragé les militants. Cette situation est néanmoins exceptionnelle, et nécessite une lutte constante pour la maintenir dès lors qu’un appareil d’État bourgeois s’efforce de perpétuer le statu quo et qu’une droite revancharde est prête à reconquérir le pouvoir. Les mouvements ont actionné le frein d’urgence du train du charbon. Reste à savoir s’ils parviendront à l’arrêter.
Image d’accueil : mine de Cerrejón, Colombie du nord, 2013. Wikimedia.

SOUTENIR TERRESTRES
Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.
Soutenez Terrestres pour :
- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques
- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains
- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole
- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant
Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..
Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.
Merci pour votre soutien !
Notes
- Sintracarbón, « Nuestra posición sobre la agresión de Israel a Gaza », 2023. Communiqué de presse.
- https://www.ucpress.edu/books/electrical-palestine/paper
- https://www.somo.nl/powering-injustice/
- https://en.globes.co.il/en/article-israelis-pay-for-delay-in-replacing-coal-fueled-power-stations-1001431911
- https://jacobin.com/2025/08/colombia-fossil-fuels-climate-petro
- https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/President-Petro-The-unleash-of-genocide-and-barbarism-on-the-Palestinian-people-is-what-awaits-the-exodus-231201.aspx
- https://apnews.com/article/colombia-israel-coal-exports-467a61fed8c0779f27a3179629717436
- https://x.com/petrogustavo/status/1825200803415515506?lang=en
- https://www.mincit.gov.co/getattachment/be2ca966-58d6-444c-bcb1-6ed057e6975e/Decreto-1047-del-14-de-agosto-de-2024.aspx
- https://english.almayadeen.net/news/politics/hamas-commends-colombia-s-ban-on-coal-exports-to–israel
- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0377919X.2025.2457884 ; https://jacobin.com/2024/06/colombia-coal-embargo-israel-war-gaza
- https://jacobin.com/2024/06/colombia-coal-embargo-israel-war-gaza
- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21624887.2024.2416850
- https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jpe/article/id/5280/
- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2022.2054511
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621004655
- https://paxforpeace.nl/publications/the-dark-side-of-coal/
- https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003044543-18/political-economy-coal-light-climate-mineral-energy-policies-lina-mar%C3%ADa-puerto-chaves-felipe-corral-montoya
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800905005252?casa_token=ck0OQ-cubZgAAAAA:U3YnHovFzeLJJBXP4rI3WHae_28HyexBbBBZCtwNywHS8ChmEH9T_XTXd61e_cQ81SJhSfsLysA
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800916315373?casa_token=Hgb0PEMWNegAAAAA:Q3piThJR3luXFyJH5UIE_0-xDtPbmkDl6ARLFHBdcQp45PWxV_m1C99s3B6Ip9xoB-CvdLiyBh8
- https://read.dukeupress.edu/labor/article-abstract/13/3-4/197/42294/Empire-Nature-and-the-Labor-of-Coal-Colombia-in
- L’entreprise prétend que le port figure parmi les ports « ayant la plus grande capacité de chargement au monde ». Voir https://drummondltd.com/en/our-operations/the-port/puerto-drummond/
- https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800915004012?casa_token=KXZmCSzqyF4AAAAA:RKrAxGCx6yG1Tzp1OMK_B_Vo9-Isv4id87CtNFqFP0MeXqrEDMdooHlwC9vhQVpHwFKPwlTaah0
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718522000185 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718522000185
- https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/colombiaisrael-nexus-toward-historical-and-analytic-contexts/09B58D46CBCD3DFFD963C7435D5094E5
- https://misionverdad.com/traducciones/el-rol-de-agentes-israelies-en-el-genocidio-politico-colombiano
- https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/import/import/pax-dark-side-of-coal-final-version-web.pdf
- https://colombiareports.com/late-us-coal-tycoon-personally-ordered-union-killings-in-colombia/
- https://www.democracynow.org/2000/6/1/who_is_israels_yair_klein_and
- https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1989/08/26/612589.html?pageNumber=5
- https://www.ynet.co.il/article/4020290
- https://www.versobooks.com/products/2684-the-palestine-laboratory?srsltid=AfmBOorPuILE1pCf28ND7nrk483UK96hPSfpAAvI8612V2gZzofgSGRq
- https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2012-08-17/colombia-orders-mixed-fleet-hermes-450-and-900-uavs
- https://www.infobae.com/colombia/2024/03/27/gustavo-petro-reitero-que-el-m-19-era-aliado-de-los-arabes-miembros-del-grupo-entrenaron-con-milicias-palestinas/
- https://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-diplomatica-con-israel-la-historia-de-como-el-m-19-atento-dos-veces-contra-embajada-de-ese-pais-cuando-petro-militaba-en-esas-filas/202345/
- https://www.haaretz.com/2013-06-16/ty-article/.premium/proud-to-be-the-israel-of-latin-america/0000017f-f7a0-d318-afff-f7e337760000
- https://www.timesofisrael.com/hezbollah-planned-to-murder-israeli-in-colombia-to-avenge-soleimani-report/ ; https://www.gov.il/en/pages/president-herzog-meets-with-colombian-president-ivan-duque-marquez-8-november-2021
- https://londonminingnetwork.org/2024/06/glencore-showing-improvement-in-self-presentation/
- https://realmedia.press/resisting-glencore/
- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0377919X.2025.2457884
- https://www.instagram.com/p/C7hrbOwIpRu/
- https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-Petro-Urrego-en-la-Primera-Cumbre-de-Financiamiento-para-las-Transiciones-250724.aspx
- https://www.instagram.com/reel/DMdwacjo0xe/
- https://bdsmovement.net/news/Colombia-Drummond-Continues-To-Fuel-Israels-Genocide
- https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/colombian-president-gustavo-petro-orders-navy-to-block-coal-shipments-to-israel-alleging-that-shipments-have-continued-despite-ban-including-due-to-corporate-pressure/
- https://www.middleeastmonitor.com/20250725-not-a-single-ton-colombian-president-orders-navy-to-ban-coal-shipments-to-israel/
- https://www.mincit.gov.co/getattachment/7f172db2-0189-4fb6-9af7-eecdf9a4d909/Decreto-0949-del-28-de-agosto-de-2025.aspx
- https://latinamericareports.com/first-poll-in-months-sheds-light-on-contentious-2026-colombian-elections/12839/
- https://jacobin.com/2025/04/colombia-petro-election-pacto-historico
- https://www.youtube.com/watch?v=L1Xyi4l_3Z8
- https://www.infobae.com/colombia/2025/11/26/abelardo-de-la-espriella-afirma-en-mi-gobierno-instalare-la-embajada-en-jerusalen/
- https://latinamericareports.com/colombia-expels-israeli-diplomats-ends-trade-agreement-following-flotilla-detentions/12501/
- https://www.infobae.com/colombia/2025/09/04/radicaron-una-demanda-ante-el-consejo-de-estado-para-tumbar-el-decreto-que-prohibe-la-exportacion-de-carbon-a-israel/
- https://www.middleeasteye.net/news/brazilian-oil-trade-unions-urge-government-impose-oil-embargo-israel
- https://www.esquerdadiario.com.br/Como-o-petroleo-brasileiro-vira-combustivel-na-Italia-pra-abastecer-Israel-e-o-genocidio
- https://oilchange.org/news/countries-fueling-gaza-genocide/
- https://mg.co.za/the-green-guardian/2024-11-20-sa-accused-of-double-standards-for-selling-coal-to-israel-while-condemning-genocide-in-gaza/
- https://africa.businessinsider.com/local/markets/south-african-unions-demand-action-after-un-report-accuses-israel-of-genocide-in-gaza/ccbflsh
- https://passblue.com/2025/04/21/coal-from-south-africa-keeps-flowing-to-israel-despite-the-icj-genocide-case/
- https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-albanese-palestine-2025/
L’article La fabrique d’un boycott : comment Israël a perdu le charbon colombien est apparu en premier sur Terrestres.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview