27.02.2026 à 18:33
Syrie : une nouvelle fois, les Kurdes abandonnés par leurs alliés régionaux et par les Occidentaux
Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université
Texte intégral (2006 mots)
Les forces kurdes ont perdu énormément de terrain face à l’avancée de celles de Damas. Le nouveau régime syrien a su habilement manœuvrer pour mettre fin au projet kurde du Rojava, en passe d’être totalement anéanti à la grande satisfaction de la Turquie. Les Kurdes irakiens et turcs ne se risquent pas à secourir leurs compatriotes de Syrie. Tout cela se passe dans l’indifférence des Occidentaux, qui s’étaient pourtant largement appuyés sur les Kurdes syriens durant la lutte contre Daech…
Considérées depuis leur création en 2015 comme un acteur puissant en Syrie, les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont dernièrement vu leur influence s’étioler. Depuis le début du mois de janvier 2026, leurs positions s’effondrent avec une rapidité qui étonne les observateurs. Après leur avoir repris Alep, la grande ville du nord-ouest du pays, le 11 janvier, les troupes loyalistes syriennes du gouvernement central dirigé par Ahmed al-Charaa ont imposé aux FDS de se retirer de toutes leurs positions situées sur l’Euphrate, le 17 janvier.
Depuis, rien n’arrête la progression des troupes de Damas, qui ont récupéré toute la province de Deir-es-Zor et la majorité de la province d’Hassaké.
Les FDS étaient autrefois maîtresses d’un tiers du territoire syrien, le Rojava, rebaptisé en 2018 Administration autonome du nord-est de la Syrie (AANES), région particulièrement riche en pétrole. Leur emprise a été réduite à peau de chagrin : elles ne contrôlent plus que la poche de Kobané, la ville de Hassaké et leur fief historique dans le nord-est du pays autour de la ville de Qamechli.
En position de force, le président syrien exige par le cessez-le-feu du 20 janvier 2026 l’absorption totale des milices kurdes dans l’armée syrienne ainsi que l’intégration totale de l’AANES dans un État syrien centralisé et autoritaire : on voit donc mal à ce stade ce qui pourrait empêcher la disparition imminente du Rojava. Comment un acteur apparemment aussi influent que les FDS a-t-il pu s’effondrer aussi rapidement ? Et peut-on espérer une issue plus favorable pour le Rojava que la pure et simple absorption par l’État central syrien ?
Un Rojava dépourvu de sanctuaire
Le facteur le plus évident et pourtant le moins mis en valeur par la presse pouvant expliquer l’incapacité des FDS à tenir leur position tient aux spécificités géographiques du nord-est de la Syrie.
L’essentiel du Rojava est traversé par la Jéziré (Jazira en arabe), une vaste plaine ouverte aride sans aucun réel obstacle topographique ou hydrographique le long duquel construire une ligne de défense. La défense du Rojava reposait sur la « coupure humide » de l’Euphrate, dont la largeur et le débit importants rendaient difficile la progression des troupes syriennes. Les positions kurdes le long du fleuve constituaient autant de verrous qui ont sauté depuis l’accord du 20 janvier avec le pouvoir syrien.
Entre l’Euphrate et la rivière Khabour, aucun obstacle ne peut freiner la progression des troupes syriennes. D’autant que la rivière Khabour, à l’image de tout le bassin hydrographique de l’Euphrate, s’écoule du nord au sud dans la région, et ne peut donc ni entraver l’avancée de troupes syriennes remontant la rivière depuis le sud, ni empêcher une éventuelle avancée turque depuis le nord.
Ensuite, contrairement à leurs homologues irakiens, les Kurdes syriens ne peuvent compter sur aucun massif montagneux pouvant leur servir de refuge. Or, on sait à quel point les sanctuaires montagneux ont joué un rôle important dans les insurrections kurdes contre l’État central irakien (la République d’Irak issue du coup d’État d’Abbdel Karim Kassem). L’armée irakienne avait échoué à soumettre les montagnes de Cheekha Dar en 1961 dans le Kurdistan irakien, contribuant ainsi à la constitution d’un sanctuaire de guérilla endémique dans la région d’Erbil. De même, l’insurrection de 1991 contre le régime de Saddam Hussein parvient à soustraire ces régions montagneuses au contrôle de l’État.
Privées de sanctuaires naturels, les milices kurdes syriennes pourraient concentrer leurs défenses autour des centres urbains de Kobané, d’Hassaké et de Qamichli pour repousser les forces syriennes. Cependant, ces villes risquent de se retrouver rapidement assiégées et condamnées à la reddition — et ce, d’autant plus vite qu’elles comportent d’importantes populations arabes qui pourraient se soulever contre les Kurdes. Les territoires du Rojava abritent en effet une forte minorité arabe, dans un contexte régional marqué par le réveil du nationalisme arabe.
Pierre Firode sera l’un des intervenants au webinaire « Face aux bouleversements du monde : quels espoirs pour la paix ? » que nous organiserons le 10 mars prochain à 18h, en coopération avec le Forum mondial Normandie pour la paix, et qui portera aussi bien sur la situation au Proche-Orient que sur la diplomatie par la force de Donald Trump et les mobilisations de la Gen Z de par le monde. Inscription gratuite ici.
La composante arabe des FDS a massivement fait défection depuis mi-janvier, ce qui explique la rapidité de la conquête rapide par l’armée syrienne de la province de Deir-ez-Zor et de toute la vallée de l’Euphrate. En plus du nationalisme arabe parfois nourri par le ressentiment anti-kurde, le régime syrien peut s’appuyer sur le soutien des cheikhs, les chefs de tribu arabes soucieux de réintégrer une Syrie unifiée et arabe.
À cet égard, Al-Charaa se place dans la continuité de sa gestion de la bande d’Idlib de 2017 à 2024 où son groupe, Hayat Tahrir al-Cham, avait pris le soin d’associer les cheikhs à la gouvernance du territoire. Si l’on considère que le Rojava forme une mosaïque où les Arabes et les Kurdes s’entremêlent, on comprend que les Kurdes ne disposent pas de véritables sanctuaires à la différence de l’Irak ce qui rend la défense du Rojava difficile, pour ne pas dire impossible.
Cette défection des tribus arabes a poussé les Kurdes à rechercher un accord avec Damas et aboutit aux accords du 31 janvier par lesquels les forces kurdes abandonnent leur projet d’un Rojava autonome (c’est-à-dire leur contrôle sur l’administration et les ressources des territoires du nord-est du pays) et se voient en échange absorbées par l’armée syrienne.
Un Rojava isolé sur le plan diplomatique
L’autre faiblesse stratégique structurelle du Rojava tient à son isolement diplomatique complet, tant à l’échelle régionale qu’internationale. Les FDS ne peuvent pas s’appuyer sur leurs voisins kurdes irakiens. En effet, le gouvernement régional du Kurdistan irakien autonome (GRK) s’engage depuis les années 2010 dans un processus de rapprochement avec Ankara lui permettant d’exporter son pétrole via la Turquie et de se développer grâce aux investissements turcs tout en disposant d’un allié face à l’État central irakien.
En retour, le GRK se doit de renoncer à l’envoi d’armes et de combattants au PKK en Turquie ainsi qu’aux FDS en Syrie. Le Kurdistan irakien pourrait en effet jouer le rôle de sanctuaire transfrontalier pour les Kurdes de Syrie qui profiteraient alors de l’effet refuge de la frontière irako-syrienne pour échapper aux offensives de Damas. Mais cela suppose un soutien du GRK ; or ce dernier ne prendra certainement pas le risque de franchir les lignes rouges fixées par Ankara et de renoncer aux fruits d’une décennie de rapprochement et de réconciliation avec la Turquie.
L’isolement du Rojava se constate aussi à l’échelle internationale où les soutiens historiques des Kurdes, américains et européens, semblent avoir abandonné leurs anciens alliés dans la lutte contre l’État islamique. À cet égard, on peut souligner les efforts diplomatiques du président syrien pour isoler les Kurdes de leurs alliés occidentaux. En s’impliquant dans la lutte contre l’État islamique aux côtés des Américains, Al-Charaa entend devenir le nouveau partenaire des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme dans la région, fonction jusqu’alors dévolue aux Kurdes.
Ce transfert de la lutte contre Daech des Kurdes vers Damas rend le soutien des États-Unis aux Kurdes caduc. Dans cette optique, Al-Charaa essaie d’apparaître comme un partenaire fiable des États-Unis en acceptant le transfert des prisonniers de l’EI vers l’Irak ou en s’impliquant dans la sécurisation des camps abritant les familles d’anciens combattants de l’EI, comme celui d’Al Hol.
Le président syrien est aussi soucieux de ne pas franchir les lignes rouges européennes en matière de droit humanitaire international, comme le montre l’ouverture récente d’un corridor humanitaire pour venir en aide aux civils de Kobané. Al-Charaa connaît la charge symbolique de la ville, qui représente aux yeux des sociétés européennes le combat kurde contre Daech en 2014, et veut éviter la mobilisation médiatique qu’entraînerait un drame humanitaire dans cette ville.
Kurdes abandonnés, Occidentaux discrédités
Ainsi, les caractéristiques géographiques tant physiques qu’humaines expliquent la grande précarité dans laquelle se retrouve actuellement le Rojava. Encerclées, condamnées à protéger un territoire indéfendable, les FDS ne peuvent compter ni sur le soutien de leurs homologues irakiens, ni sur celui des puissances occidentales, qui ont pourtant beaucoup contribué à la construction du Rojava.
Comme en 2019 lors de l’opération turque Source de Paix, le sort des Kurdes de Syrie pourrait être sacrifié sur l’autel de la Realpolitik, qui incite à privilégier l’entente avec les puissances régionales comme la Turquie ou la Syrie au détriment du respect du droit des peuples et du droit humanitaire international.
Cette approche, partagée par la Maison Blanche et en partie par l’Union européenne, saborde pourtant la crédibilité et l’implantation des puissances occidentales au Moyen-Orient qui, en abandonnant leurs alliés historiques comme les Kurdes pour des partenaires de circonstance, contribuent au recul des valeurs démocratiques dans le monde.
Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.02.2026 à 17:13
Le discours sur l’état de l’Union de Trump, ou la perversion des « mythes américains »
Jérôme Viala-Gaudefroy, Spécialiste de la politique américaine, Sciences Po
Texte intégral (1878 mots)
Le discours sur l’état de l’Union est censé exposer les priorités d’un président devant le Congrès et le pays. En 2026, Donald Trump en a fait tout autre chose : moins une feuille de route qu’un récit de restauration nationale, où se mêlent triomphe personnel, mythologie nationale et mise à l’épreuve publique des loyautés partisanes.
Le discours annuel sur l’état de l’Union est l’un des grands moments institutionnels de la vie politique états-unienne. En principe, le président, devant l’ensemble des membres du Congrès, y expose ses priorités, justifie ses choix, annonce des mesures et tente de convaincre au-delà de son camp. Le 24 février 2026, Donald Trump a bien respecté le décor constitutionnel. Mais il a bien moins présenté un programme ou un agenda législatif que mis en scène un récit de restauration nationale centré sur sa personne. Il s’agit d’ailleurs du discours l’état de l’Union qui contient le moins de propositions programmatiques depuis cinquante ans, selon The Economist.
Dès les premières lignes, le ton est donné : « notre nation est de retour », puis « c’est l’âge d’or de l’Amérique ». Le discours ouvre donc sur l’annonce d’un retour à la grandeur. Trump n’est pas un chef de gouvernement décrivant des lignes politiques, il est le sauveur d’une nation qui était en perdition. Il affirme avoir hérité d’« une nation en crise », affligée par « une économie stagnante », « des frontières grandes ouvertes » et « des guerres et le chaos partout dans le monde ». Un an plus tard, affirme-t-il, tout aurait changé grâce à la « transformation sans précédent » et au « revirement historique » qu’il aurait impulsés. Dans son discours, la politique n’est pas racontée comme gestion, compromis ou promesse, mais comme retournement quasi miraculeux de l’histoire.
Une jérémiade trumpienne
Pour comprendre ce récit, il faut se pencher sur la structure profonde du discours (écrit par ses conseillers Ross Worthington et Vince Haley). Il emploie un schéma ancien de la rhétorique politique états-unienne : celui d’une nation dévoyée, menacée, puis ramenée sur le bon chemin. C’est la structure classique de la jérémiade issue des sermons basés sur la figure biblique de Jérémie, puis reprise par les puritains de Nouvelle-Angleterre : la chute, le redressement, puis la destinée retrouvée.
Le premier temps est celui de la déchéance. Trump ne se contente pas d’évoquer des difficultés : il construit un imaginaire de crise totale. La frontière serait le point de passage d’une « invasion », le crime incontrôlé, l’économie humiliée, le monde livré au chaos. La nation n’aurait pas simplement traversé une période difficile ; elle aurait été, jusqu’à son retour à la Maison Blanche, « à l’agonie ».
Le second temps est celui du sauvetage. « Aujourd’hui, notre frontière est sécurisée », proclame-t-il ; « notre esprit est restauré » ; « l’Amérique est à nouveau respectée ». Tout le vocabulaire du discours renvoie à la renaissance : retour, restauration, rétablissement, fierté retrouvée. L’idée n’est pas seulement qu’un changement de majorité a eu lieu, mais qu’un ordre perdu a été rétabli.
Le troisième temps est celui de la destinée. Trump relie explicitement son mandat au 250e anniversaire de l’indépendance, à « l’esprit de 1776 », puis conclut que « notre destin est écrit par la main de la Providence ». Cette tonalité religieuse n’a rien d’exceptionnel dans ce type d’allocution, tant les présidents états-uniens inscrivent souvent la nation dans une mission historique sous le regard de Dieu. Mais, chez Trump, elle sert aussi à suggérer que son retour au pouvoir s’inscrit lui-même dans cette destinée.
En réalité, Trump capte les grands mythes nationaux pour les mettre au service de sa propre personne. La foi, la grandeur « américaine » ou la mission historique des États-Unis ne servent plus à rassembler autour d’un destin commun : elles servent à ériger le président en sauveur indispensable, comme lorsqu’il déclare, n’hésitant pas à parler de lui-même à la troisième personne : « La seule chose qui se dresse aujourd’hui entre les États-Uniens et une frontière totalement ouverte, c’est le président Donald J. Trump. »
Un spectacle de loyauté
Le discours sur l’état de l’Union n’est jamais seulement un texte : c’est aussi une mise en scène. Depuis Ronald Reagan, les invités dans les tribunes, les récits individuels, les pauses et les réactions de la salle sont utilisés comme incarnation d’un mini-récit moral : victime innocente, héros ordinaire, mère endeuillée, vétéran exemplaire. C’est une succession de scènes émotionnelles dans une logique dramaturgique.
Le moment le plus révélateur est sans doute celui où Trump lance aux parlementaires : « Si vous êtes d’accord avec cette affirmation, levez-vous et montrez votre soutien. » L’affirmation est formulée de manière à piéger l’opposition : « Le premier devoir du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains, pas les immigrés illégaux. » Si ses adversaires se lèvent, ils valident son récit. S’ils restent assis, il peut les présenter comme hostiles à la protection des citoyens.
On est là au cœur d’une rhétorique du test de loyauté. Lorsqu’il lance aux démocrates restés assis qu’« ils devraient avoir honte », puis les qualifie un peu plus loin de « fous », Trump ne cherche pas seulement à les discréditer ; il met en scène une opposition morale entre, d’un côté, les patriotes et, de l’autre, ceux qu’il présente comme les traîtres et les ennemis du bon sens. Le Congrès n’apparaît plus comme un lieu de délibération entre adversaires légitimes, mais comme une scène où l’opposition est sommée de se révéler publiquement.
Une seule intrigue, quel que soit le sujet
L’une des clés du discours est qu’il raconte finalement toujours la même histoire, quel que soit le thème abordé.
Immigration, économie, sécurité, politique étrangère : tout est réorganisé autour d’une même matrice morale. Le pays aurait été trahi, exposé, affaibli ; des ennemis clairement identifiables en auraient profité et lui seul aurait la capacité de restaurer la grandeur de l’Amérique. Une grande partie de ce récit repose pourtant sur des affirmations fausses, exagérées ou trompeuses. Ces distorsions brouillent le débat public et fabriquent une perception altérée du réel. Peu importe puisqu’il s’agit moins d’établir des faits que de consolider une intrigue simple, dramatique et politiquement efficace.
Sur l’immigration, cette logique est particulièrement visible. Trump parle d’« invasion à la frontière », associe les « immigrés illégaux » au crime, au fentanyl et à la violence, puis relie cette question à celle des élections en demandant des mesures destinées à empêcher les « personnes non autorisées » de voter dans les « élections américaines sacrées ». La frontière, la citoyenneté et l’intégrité électorale fusionnent ainsi dans un même récit de protection du corps national.
L’économie obéit à la même logique. Trump ne se présente pas comme un pédagogue expliquant des mécanismes ou des contraintes, mais comme celui qui aurait remis l’Amérique debout. Les prix « s’effondrent », les revenus « augmentent rapidement », le pays serait redevenu « le plus attractif du monde ». Là encore, la technicité – et la réalité des faits – importe moins que l’image du redressement.
La politique étrangère, enfin, est aussi abordée selon cette approche. Lorsqu’il parle de l’Iran, de l’OTAN, de l’Ukraine, du Venezuela ou des cartels latino-américains de la drogue, Trump développe moins une doctrine cohérente qu’un imaginaire de puissance. La formule la plus révélatrice est sans doute « la paix par la force ». L’international devient ainsi le théâtre où se mesure la crédibilité du chef.
Une religion civique personnalisée
Le dernier trait marquant du discours est la place accordée au religieux et au providentialisme. Trump se félicite d’« un immense renouveau de la religion, de la foi, du christianisme et de la croyance en Dieu ». Il appelle aussi à réaffirmer que « l’Amérique est une nation sous Dieu ». Puis il pousse encore plus loin cette logique en déclarant que, « quand Dieu a besoin d’une nation pour accomplir ses miracles, il sait exactement à qui s’adresser », et que « notre destin est écrit par la main de la Providence ».
À lire aussi : « Make Religion Great Again » : la place de la religion dans l’État trumpien
Ces formules ne sont pas de simples ornements pieux. Elles donnent au récit politique une intensité quasi sacrée. Trump s’inscrit ici dans la tradition états-unienne de la religion civile, où la nation est investie d’une mission historique. Mais il en accentue la dimension partisane et personnelle : ce registre sert moins à universaliser le consensus qu’à souder un camp et à suggérer que le redressement national passe par un leadership incarné.
Au fond, ce discours dit quelque chose de plus large sur le trumpisme en 2026. Il ne rompt pas avec la tradition des grands mythes présidentiels états-uniens ; il les transforme. Il reprend les thèmes les plus classiques – la nation trahie, la renaissance, la Providence, 1776, la mission, la grandeur – mais les réorganise autour d’une figure de sauveur plus personnelle, plus spectaculaire et plus conflictuelle que chez ses prédécesseurs.
Le discours sur l’état de l’Union cesse alors d’être un simple bilan institutionnel. Il devient un rite de restauration nationale – et, en même temps, un test public de loyauté.
Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.02.2026 à 15:38
Contre le tabagisme, l’alcoolisme, l’insécurité routière… le marketing social en santé est plus efficace que la communication
Karine Gallopel-Morvan, professeur santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP)
François Bourdillon, Médecin de santé publique, Sciences Po
Sylvain Gautier, Médecin de santé publique et médecine sociale, PHU Santé publique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Texte intégral (2056 mots)
Le succès de campagnes de marketing social, comme le « Mois sans tabac », dont l’efficacité a été évaluée scientifiquement, montre comment cette stratégie peut se révéler payante pour déclencher des changements de comportements bénéfiques pour la santé. La restructuration annoncée de Santé publique France, qui met en œuvre les campagnes de prévention en santé, pourrait conduire à un recentrage vers la communication, au détriment du marketing social qui a pourtant fait ses preuves.
De nombreux pays s’appuient sur la démarche du marketing social pour élaborer des campagnes de prévention dont le but est de changer les comportements de santé. En France, cette mission est principalement assurée par Santé publique France, l’agence nationale de santé publique, dont un des rôles est d’« améliorer et protéger la santé des populations ».
Santé publique France intervient dans des domaines aussi variés que les déterminants de santé (tabac, alcool, drogues, nutrition, environnement, etc.), les maladies infectieuses (Covid-19, grippe…), la santé sexuelle, la santé mentale, les pathologies chroniques comme les cancers, le diabète, etc. L’agence a pleinement intégré le marketing social dès sa création, en 2016.
A l’époque, ce positionnement avait suscité des débats, notamment quant à sa valeur ajoutée par rapport aux campagnes de communication « classiques » qui avaient été mobilisées par le passé. Ce choix stratégique a pourtant permis à Santé publique France de développer des interventions de prévention plus efficaces pour déclencher des changements de comportement.
Depuis, d’autres acteurs, associatifs et publics, ont recours au marketing social. Par exemple, depuis 2020, le « Défi de janvier » (Dry January) vise à questionner individuellement et collectivement notre rapport à l’alcool et changer nos habitudes de consommation pour inciter à un changement de comportement vis-à-vis de ce produit. Cette initiative, qui connaît un succès croissant, est portée par un collectif d’associations. Elle a lieu tous les ans sans l’appui des pouvoirs publics.
Le marketing social : des techniques de marketing commercial appliquées à la santé
L’association des deux termes, « marketing » et « social », est née en 1971. Le marketing social consiste ainsi à transposer certaines techniques du marketing commercial à des programmes sociaux et de santé, dans l’objectif d’en améliorer l’efficacité en matière de changement de comportements.
Son principe fondamental repose sur une connaissance approfondie des publics cibles, afin d’adapter les interventions à leurs caractéristiques, leurs besoins et leurs contraintes. Cette compréhension s’appuie à la fois sur des enquêtes et les apports de la littérature scientifique, afin d’identifier les déterminants des comportements de santé et leurs leviers de modification.
Le marketing social prend également en compte l’environnement dans lequel s’inscrit l’intervention, notamment les facteurs concurrents du comportement promu, comme le marketing des industries du tabac, de l’alcool ou de l’alimentation ultratransformée. Ces pratiques commerciales “concourrentes” à la santé sont connues sous le terme de « déterminants commerciaux de la santé ». Le but sera ici de bloquer la publicité de ces firmes (avec des régulations et interdictions), ou d’apposer des avertissements sanitaires sur les publicités et packagings afin de contrer les messages marketing attractifs.
Le marketing social repose par ailleurs sur une segmentation des populations, donnant lieu à des programmes différenciés selon les spécificités des individus : âge, genre, environnement social, ancrage communautaire, niveau de littératie (niveaux de lecture, d’écriture et de compréhension des textes), etc.
« Mois sans tabac »,« Défi de janvier » et autres marques sociales
Si la campagne de marketing social est amenée à durer, il est opportun qu’elle s’appuie sur une marque qui aide à la mémoriser, à se l’approprier et à l’apprécier : « Mois sans tabac », le « Défi de janvier », ou encore Sam de la Sécurité routière sont des marques sociales connues de toutes et tous.
Chaque programme est ensuite décliné opérationnellement pour chaque cible, autour d’objectifs de changement de comportement, et mis en œuvre selon le « modèle des 5 c » :
le comportement à adopter (par exemple, arrêter de fumer) ;
des aides et solutions proposées pour réduire les coûts et freins à l’adoption de ce comportement (applications, préservatifs gratuits ou à faible coût…) ;
une capacité d’accès aisée aux aides et comportements (rendez-vous rapide pour un dépistage, éthylotests disponibles dans les bars…) ;
une communication créative qui mobilise des canaux variés (médias, réseaux sociaux, etc.) ;
des collaborations avec des acteurs proches des publics bénéficiaires (associations, éducateurs, professionnels de santé) pour assurer la diffusion de l’intervention.
Enfin, toute campagne de marketing social s’inscrit dans une logique d’évaluation, afin de vérifier que les objectifs souhaités ont bien été atteints au regard des moyens mobilisés (évaluations de processus, d’impact et médicoéconomiques).
Marketing social et communication : une différence fondamentale
Ainsi, si la communication est nécessaire pour dérouler une campagne de marketing social (un des 5C), elle n’est pas suffisante. C’est la conclusion de nombreuses études ayant analysé l’efficacité des interventions élaborées selon les principes du marketing social et qui se déroulaient dans des contextes et milieux variés (lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme ou les drogues illicites ; promotion de l’activité physique et de la nutrition à l’école, en entreprise, etc.) puis sur des cibles différentes (population défavorisée, adolescents, professionnels de santé, grand public, etc.).
Les chercheurs sont arrivés à la conclusion suivante : si les campagnes de communication peuvent agir sur les connaissances, les représentations, les normes, ou encore si elles informent sur l’existence d’un service, elles ne déclenchent pas, à elles seules, des changements de comportement si les autres composantes du marketing social n’y sont pas associées.
L’exemple emblématique du « Mois sans tabac »
L’exemple de la campagne annuelle « Mois sans tabac » lancée en 2016 par Santé publique France et adaptée de la campagne britannique Stoptober est illustratif de l’intérêt du marketing social. Cette intervention inédite en France en a intégré tous les ingrédients pour inviter les fumeurs à faire une tentative d’arrêt du tabac pendant 30 jours, en novembre, et optimiser ainsi leurs chances d’arrêter durablement.
Elle s’est basée sur les modèles théoriques de changement de comportements (théorie de la contagion), une connaissance des parties prenantes et de la cible visée, une prise en compte de la « concurrence » (l’industrie du tabac), une segmentation réfléchie (campagne ciblant les fumeurs quotidiens souhaitant arrêter de fumer, âgés de 18 à 64 ans et les plus vulnérables).
De plus, cette campagne s’appuie sur une proposition comportementale atteignable (arrêter de fumer pendant un « mois »), une marque chaleureuse et conviviale ainsi que des aides et services accessibles facilement et gratuitement ou à un prix très faible (site Internet, coaching personnalisé, numéro de téléphone, kit pour arrêter…).
L’accent est mis sur les bénéfices de l’arrêt. Puis, des collaborateurs et partenaires assurent la diffusion de la campagne et de ses services vers les lieux de vie des fumeurs (associations, pharmacies, entreprises, etc.). Enfin, une campagne de communication est diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Cette combinaison s’est révélée bénéfique puisque les évaluations quasi continues de la campagne « Mois sans tabac » ont montré son efficacité pour inciter les Français à arrêter de fumer, bien plus que les précédentes campagnes qui se basaient essentiellement sur la communication.
« Mois sans tabac » a ainsi joué un rôle dans l’augmentation des tentatives d’arrêt du tabac (les éditions 2018 et 2019 auraient chacune généré environ 50 0000 tentatives), ainsi que sur l’arrêt du tabac à plus long terme. De plus, l’OCDE a estimé que si elle était maintenue sur la période 2023-2050, cette campagne permettrait d’économiser en moyenne 7 euros par an en dépenses de santé pour 1 euro investi.
Renoncer au marketing social : un retour en arrière pour la santé publique
Dix ans après sa création, la restructuration de Santé publique France annoncée par le gouvernement en janvier 2026 pourrait conduire à un abandon du marketing social au profit d’un « recentrage stratégique » sur la communication, qui serait désormais pilotée par le ministère de la santé et l’Assurance-maladie. Les pouvoirs publics justifient cette évolution par la volonté d’« offrir aux citoyens des messages plus clairs » et « une meilleure efficacité ».
Penser que le recentrage sur la communication et l’abandon du marketing social pourrait être aussi efficace et efficient n’est pas fondé, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan empirique. Il faut alors se questionner les réels motifs qui poussent à cette décision : coupe budgétaire, volonté de reprise en main du contenu des messages au détriment des données probantes et des évaluations de campagnes, influence des lobbys ?
L’avenir nous le dira, mais cette évolution pourrait s’opérer au détriment de l’efficacité des politiques de prévention et, in fine, de la santé des Français.
Karine Gallopel-Morvan a reçu des financements de l’INCa, l’IRESP, JApreventNCDs, le Fonds de lutte contre les addictions, la Ligue contre le cancer, Ramsay fondation, l’ARS Bretagne
Ancien Directeur général de Santé publique France 2016-2019
Sylvain Gautier est vice-président de la Société Française de Santé Publique (SFSP) et membre du Comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT). Il est président du Conseil national professionnel de santé publique (CNP-SP) et membre du Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP).
27.02.2026 à 10:02
Atmospheric dust: the overlooked suspect in urban air pollution
Emmanouil Proestakis, National Observatory of Athens
Texte intégral (1720 mots)
Cities are rapidly becoming the defining residential space of human life. Over 55% of the global population lived in urban areas in 2018, a proportion projected to reach nearly 68% by 2050, according to the United Nations (UN).
While this unprecedented urban growth fuels innovation and economic activity, it simultaneously concentrates human exposure to environmental stressors and intensifies urban environmental pressures. In this context, the World Health Organization (WHO) has underlined the multifaceted challenges and severe risks that poor air quality poses to socioeconomic activities and human health. And although emissions – such as NO₂, SO₂, CO₂ and O₃ – are the usual suspects when it comes to air quality degradation, our recent study highlights that atmospheric dust that accumulates over urban areas represents an additional and considerable, yet frequently overlooked, contributor to adverse health implications.
Mineral dust’s impact on Public health deserves more attention
Among the aerosol species contributing to air quality degradation, atmospheric dust originating from natural sources and anthropogenic activities is often considered less consequential. However, this assumption overlooks a growing body of research evidence reporting on airborne dust as a health hazard and neglects several important facts.
To begin with, dust is not a marginal component of the total aerosol load. By mass, dust is the second-most abundant aerosol type globally, surpassed only by sea-salt particles, and the dominant component of the atmospheric aerosol load over large continental areas.
More specifically, it has been estimated that natural sources – mainly arid and semi-arid areas – emit around 4,680 teragrams (Tg) (1 Tg= 1 billion kilograms) of dust into the atmosphere each year. Yet, this estimate does not account for all the dust present in the atmosphere.
Globally, natural processes contribute to approximately three quarters of the total dust load, with the remaining quarter linked to human activities frequently evolving around urban and highly industrialised areas, including transportation, infrastructure development, land-use change, deforestation, grazing and agricultural practices.
To put this into perspective, this staggering airborne dust mass exceeds 615,000 times the equivalent weight of the Eiffel tower released globally into the atmosphere each year.
Furthermore, these particles composing the atmospheric dust layers are far from uniform in size. Large-scale experiments, (designed to study atmospheric pollutants in detail) focusing on mineral dust and employing airborne in situ instrumentation have revealed that particles in wind-transported atmospheric layers range widely in size, from less than 0.1 μm (roughly the size of a SARS-CoV-2 virus (coronavirus) to more than 100 μm (approximately the diameter of a human hair).
More concerning is that accumulated evidence from epidemiological studies links airborne dust to multiple adverse health outcomes. While coarse mineral dust is often considered relatively harmless, typically causing minor skin irritation or allergic reactions even over long exposure periods, it is a completely different story when it comes to fine particles. Because of their small size, these fine particles allow for deep lung penetration that potentially triggers respiratory and cardiovascular diseases, allergic reactions, even cancer. Beyond these direct effects, scientists are still exploring the role of dust as a carrier for bacteria, as suggested by meningitis outbreaks in the Sahel desert.
Fine particles, big questions
These concerns naturally raise a series of questions: to what extent have the fine-mode and coarse-mode fractions of airborne dust changed over highly industrialised and densely populated urban areas in the past two decades?
Can we detect meaningful, increasing or decreasing temporal trends in these changes? Which major cities currently experience, or are likely to experience in the near future, dust concentrations exceeding WHO air quality safety thresholds?
Megacities under the microscope: 15 years of satellite observations reveal how dust levels are changing
To gain a better understanding of how much dust urban populations are actually breathing in, our recent study examined satellite-based Earth observations spanning over 15 years. We examined the accumulation and temporal dynamics of dust in the lowest atmospheric layer above the Earth’s surface in 81 of the world’s largest cities and urban areas (with populations exceeding 5 million), where human activity and exposure are most prevalent. The results reveal several important takeaways:
Atmospheric dust unequivocally poses a hazard to public health in a substantial number of major urban areas worldwide. Based on population data and projections provided by the UN approximately 9 out of 10 of the roughly 800 million people living in the 81 largest cities are exposed to dust levels exceeding annual-mean air quality safety thresholds. A clear geographic pattern emerges, with the most affected urban areas located in the Middle East, the Indian subcontinent, East Asia, and the Sahel.
Dust levels appear to be declining in most large cities. However, this encouraging, seemingly positive news comes with two important caveats: in many cases, the temporal declining trends are not statistically significant and frequently the overall dust burdens remain considerable. In other words, even where reductions are observed, they may not translate into meaningful reductions in health risk.
Looking ahead to the near future, the challenge is unlikely to disappear. According to estimates provided by UN, urban populations in these megacities are projected to grow, reaching more than 1 billion people in the mid-thirties.
Consequently, atmospheric dust will remain an environmental health hazard, however, of a lower degree due to the apparent declining atmospheric load compared to present-day conditions, yet potentially affecting a larger number of individuals.
From science to policy: tackling the hazard of airborne dust
In response to mounting scientific evidence that airborne dust poses a risk to human health, countries are strengthening air quality legislation and launching national and international initiatives to confront dust-related challenges.
Efforts such as the World Meteorological Organization’s SDS-WAS, DANA and CAMS NCP among others, reflect growing collaboration to improve monitoring, modelling, and the translation of science into practical solutions. At the same time, governments are moving to align regulations with WHO recommendations.
For instance, the European Union’s revised Ambient Air Quality Directive explicitly recognises natural aerosols like dust as a cumulative health hazard. Together, advancing research, coordinated policy, and improved regulation provide a stronger foundation for action.
As urbanisation accelerates, tackling air quality, including atmospheric dust, is becoming central to protecting public health, strengthening urban resilience, and ensuring a more sustainable future for the world’s rapidly growing cities.
Created in 2007 to help accelerate and share scientific knowledge on key societal issues, the Axa Research Fund – now part of the Axa Foundation for Human Progress – has supported over 750 projects around the world on key environmental, health & socioeconomic risks. To learn more, visit the website of the AXA Research Fund or follow @ AXAResearchFund on LinkedIn.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!
Emmanouil Proestakis has been supported by the AXA Research Fund for postdoctoral researchers under the project entitled “Earth Observation for Air-Quality – Dust Fine-Mode (EO4AQ-DustFM).
26.02.2026 à 15:33
Les fausses publications scientifiques menacent de submerger la recherche contre le cancer
Baptiste Scancar, Scientifique spécialisé en intégrité scientifique, Institut Agro Rennes-Angers
David Causeur, Enseignant-chercheur, Institut Agro Rennes-Angers
Texte intégral (2164 mots)

Une étude récente pointe un chiffre alarmant : plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024. Cette production s’accélère et menace la production scientifique honnête.
Produire de la connaissance par la recherche scientifique donne lieu à une forte compétition entre équipes et individus, dans laquelle une publication dans une revue prestigieuse peut changer la trajectoire d’une carrière. Même si beaucoup remettent en cause les règles actuelles de cette compétition, l’évaluation de la qualité d’un chercheur repose essentiellement sur le nombre de ses publications, sur leur impact – mesuré par le volume des citations qu’elles génèrent – et sur le prestige des revues dans lesquelles elles sont publiées. L’importance de ces indicateurs dans l’obtention de rares financements et la progression des carrières individuelles contribue à encourager des comportements contraires à l’intégrité scientifique, tels que le recours à des pratiques frauduleuses.
Ce contexte a notamment favorisé l’émergence et la forte croissance d’organisations spécialisées dans la vente de faux articles scientifiques, les « paper mills » ou « fabriques à articles ». Ces dernières sont suspectées d’avoir produit des milliers d’articles au cours des dix dernières années, compromettant des pans entiers de la littérature scientifique. Dans notre étude, publiée dans le British Medical Journal (BMJ) en janvier 2026, nous estimons que plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024.
Alors que ces articles représentaient moins de 1 % des publications scientifiques annuelles en 1999, leur taux s’élève désormais à 15 % du contenu produit chaque année. La recherche contre le cancer est en danger : les fausses publications se répandent, et une intensification de ce problème est à prévoir.
Une production à échelle industrielle
Les « fabriques à articles scientifiques » produisent et vendent en quantités quasi industrielles de faux articles scientifiques. Elles adoptent même des techniques de marketing classique, en faisant de la publicité en ligne et en proposant à leurs clients de sélectionner leur place dans la liste des auteurs d’un article préfabriqué (la première et la dernière position étant souvent perçues comme plus prestigieuses) ainsi que le niveau de réputation du journal dans lequel l’article sera publié. Des recherches ont montré que le coût de ce service pouvait varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, et d’aucuns suspectent que certaines « fabriques à articles » pourraient même fournir un « service après-vente », par exemple apporter des corrections ou des réponses aux commentaires des lecteurs après publication, sur les sites des éditeurs ou sur les plateformes collaboratives, comme PubPeer.
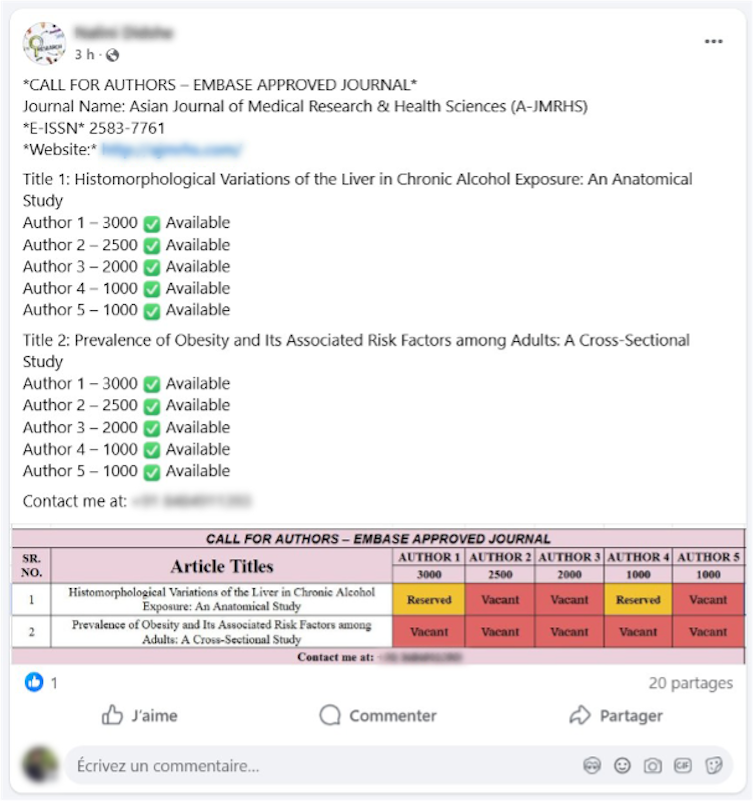
Le nombre de publications attribuées aux « fabriques à articles » a explosé au début des années 2010, attestant l’existence d’un système frauduleux à grande échelle. L’essor de ces organisations est souvent présenté comme une conséquence de la culture dite du « Publish or Perish » (« Publier ou périr »), qui séduit une clientèle, composée de doctorants, de chercheurs et de cliniciens en difficulté, pour laquelle la publication est devenue une condition d’accès à un diplôme, un emploi ou une promotion.
Ce phénomène est d’ailleurs amplifié par l’existence d’agents intermédiaires et de réseaux organisés qui dépassent la simple production de manuscrits et interviennent en contournant et en accélérant les processus éditoriaux et de publication (les articles frauduleux peuvent être acceptés et publiés beaucoup plus rapidement que les articles authentiques). Cette collusion entre fabricants et éditeurs peu scrupuleux contribue à augmenter fortement la cadence de publication d’articles frauduleux, au point qu’elle peut largement dépasser celle des articles authentiques.
Les fabriques tirent leur productivité de modèles de rédaction prédéfinis, qui réutilisent souvent des fragments de texte et d’images issus de leurs productions précédentes. Cette méthode a favorisé la publication d’articles présentant des similarités de forme, comportant les mêmes tournures de phrases, les mêmes schémas expérimentaux ainsi que les mêmes erreurs méthodologiques ou stylistiques dans la littérature biomédicale, et notamment dans la recherche contre le cancer.
Ces indices permettent de suivre leur piste et d’identifier systématiquement leurs productions, comme dans le cas des images manipulées ou des « phrases torturées » (des reformulations hasardeuses de termes techniques, par exemple « péril de la poitrine » à la place de « cancer du sein »).
Une méthode de détection simple mais efficace
Notre combat contre la fraude scientifique débute en 2024 lorsque Baptiste Scancar, auteur de cet article, alors étudiant en master de science des données, part en Australie pour travailler sur la fraude scientifique avec Jennifer A Byrne (professeure de cancérologie à l’Université de Sydney) et Adrian Barnett (professeur de statistiques à la Queensland University of Technology). Jennifer avait constaté depuis des années le dévoiement de sa discipline, l’oncologie moléculaire, contaminée à grande échelle par les fausses publications, sans prise de conscience des communautés ni des institutions de recherche. L’objectif de cette collaboration était de créer une méthode généralisable à de grandes quantités d’articles pour détecter les productions des « fabriques à articles » dans le domaine du cancer, afin d’en mesurer l’ampleur et d’alerter sur le problème sous-jacent.
L’observation de fortes ressemblances stylistiques dans le titre et le résumé des articles frauduleux a conduit l’équipe à s’orienter vers des méthodes d’analyse centrées sur ces sections des articles, par ailleurs librement accessibles sur des plateformes de diffusion scientifique en ligne, comme PubMed. L’objectif est alors d’utiliser un algorithme d’intelligence artificielle pour différencier les articles authentiques des articles frauduleux, en identifiant des motifs communs à une liste d’articles identifiés comme frauduleux par l’observatoire Retraction Watch. Cette approche est finalement couronnée de succès, atteignant des performances d’identification très élevées (9 articles sur 10 sont bien classés par l’algorithme).
Après cette première étape, le projet se poursuit en France depuis 2025. L’équipe est complétée par David Causeur, également auteur de cet article. L’outil est amélioré par une analyse fine des erreurs d’identification et la méthodologie est affinée. Le modèle est alors utilisé pour analyser l’ensemble des publications liées au cancer depuis 1999, soit plus de 2,5 millions d’articles accessibles dans la base de données de PubMed, et les résultats sont alarmants. Environ 250 000 articles, quasiment 10 % des études, sont signalés comme textuellement similaires à des productions de fabriques à articles. Leur nombre est passé de 238 en 1999 à plus de 26 000 en 2020. Cette progression n’épargne pas les revues les plus prestigieuses (top 10 des journaux), où la proportion d’articles signalés dépasse également 10 % en 2022.
La répartition géographique des auteurs met en évidence une prédominance marquée de la Chine, avec près de 180 000 articles recensés, loin devant les États-Unis (10 500 articles) et le Japon (6 500 articles). Les publications suspectes sont retrouvées dans des revues de nombreux éditeurs, couvrant l’ensemble des types de cancer et la plupart des thématiques de recherche.
Un moment crucial pour la recherche scientifique
La présence massive d’articles frauduleux dans le domaine du cancer pose plusieurs problèmes majeurs.
Tout d’abord, le partage des connaissances scientifiques est aujourd’hui pollué massivement par les fausses informations, et les acteurs de la recherche peinent à mettre en place des actions correctives. L’ampleur de ces infractions majeures à l’intégrité scientifique doit aussi conduire à une réflexion sur le poids donné au volume des publications dans l’évaluation des projets de recherche et des équipes de chercheurs elles-mêmes. La validation implicite de connaissances scientifiques frauduleuses par leur publication, parfois dans des revues prestigieuses, compromet les processus d’attribution de financements et ouvre la voie à leur propagation en cascade par citation.
Par ailleurs, la recherche fondamentale sur le cancer, qui constitue la cible privilégiée des « fabriques à articles », précède le développement de traitements thérapeutiques, dont l’efficacité est menacée par la fraude à grande échelle, au détriment des patients.
Le développement récent des modèles de langage génératif, tels que ChatGPT, menace de rendre la détection des contenus frauduleux plus difficile et pourrait décupler la productivité de ces organisations. Par analogie avec le dopage dans le sport, il est à craindre que ce jeu du chat et de la souris entre détecteurs et fraudeurs ne débouche pas sur une éradication du problème, mais sur une escalade des stratégies de fraude.
En revanche, les politiques publiques d’évaluation de la recherche peuvent y remédier, en réduisant la pression à la publication que subissent les chercheurs. Il est urgent de redonner à la qualité intrinsèque des productions scientifiques plus de place dans leur évaluation, avant que la distinction entre contenu authentique et fabriqué devienne impossible.
Baptiste Scancar a reçu des financements du National Health and Medical Research Council (NHMRC), organisme Australien de financement de la recherche médicale.
David Causeur a reçu des financements de l'ANR.
26.02.2026 à 15:33
Municipales 2026 : l’extinction nocturne de l’éclairage augmente-t-elle vraiment la délinquance ?
Chloé Beaudet, Doctorante en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay
Texte intégral (2153 mots)
À l’approche des élections municipales de mars prochain, l’extinction nocturne de l’éclairage public, qui s’est généralisée ces dernières années sur fond d’augmentation des coûts de l’énergie et de prise de conscience des dangers pour la biodiversité, cristallise les inquiétudes en matière de sécurité. Pourtant, la première étude nationale menée en France montre que cette politique n’entraîne pas d’augmentation générale des faits de délinquance. Elle n’a qu’un effet limité sur les cambriolages, qui reste très faible : un cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements.
De nombreuses communes françaises ont choisi, ces dernières années, d’éteindre partiellement ou totalement leur éclairage public la nuit. Cette tendance s’est fortement accélérée à l’automne 2022, dans un contexte de flambée des prix de l’électricité. Une cartographie des extinctions nocturnes, publiée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) à l’été 2025, montre ainsi que 62 % des communes (sur les 19 262 étudiées) ont mis en place une politique d’extinction nocturne de l’éclairage public.
Ces décisions permettent aux collectivités de réaliser des économies d’énergie et de réduire leurs dépenses, tout en limitant les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé humaine, en forte augmentation ces dernières années.
À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, ces mesures sont toutefois de plus en plus contestées dans certaines villes en raison du sentiment d’insécurité qu’elles suscitent chez une partie de la population.
Jusqu’à présent, aucune étude scientifique en France n’avait analysé le lien entre l’extinction de l’éclairage public et la délinquance. À l’international, les travaux sur cette question sont rares et ont, jusqu’à présent, abouti à des résultats contrastés.
C’est pour combler ce manque que je me suis intéressée à cette problématique dans le cadre de ma thèse, soutenue en décembre 2025, en menant la première étude empirique évaluant l’impact de l’extinction de l’éclairage public sur la délinquance, à l’échelle nationale. Ses résultats montrent qu’éteindre l’éclairage la nuit n’a pas d’effet sur la plupart des faits de délinquance étudiés. Elle a toutefois un impact léger sur les cambriolages, qui reste très limité et s’applique surtout aux contextes urbains.
Pas d’effet sur la majorité des faits de délinquance
L’étude, qui a passé au crible les statistiques de délinquance entre 2017 et 2023 des communes de plus de 1 500 habitants, montre que l’extinction de l’éclairage public n’a aucun effet pour la grande majorité des faits de délinquance étudiés : dégradations et destructions volontaires, violences sexuelles, vols non violents, vols de véhicules et d’accessoires ainsi que trafic et usage de stupéfiants.
Un faible effet positif a toutefois été mis en évidence pour les cambriolages. Celui-ci est statistiquement significatif, mais reste limité : on parle ici d’une augmentation de 0,35 cambriolage pour 1 000 logements (soit environ 1 cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements). Autrement dit cet impact correspond à environ 3,4 % du nombre de cambriolages observés en moyenne par an dans les communes ayant recours à l’extinction nocturne.
Des analyses plus fines montrent que cet effet est concentré dans les communes à forte densité de population, que l’Insee considère comme « grands centres urbains » et « centres urbains intermédiaires ». Aucun impact n’est observé dans les communes à plus faible densité, telles que les ceintures urbaines et les petites villes.
Pour les faits de délinquance, tels que la violence physique, les vols violents avec ou sans arme et les vols dans les véhicules, le modèle utilisé dans l’étude n’était pas applicable. Il n’est donc pas possible de conclure, pour ces faits, à la présence ou à l’absence d’un effet de l’extinction de l’éclairage public.
À lire aussi : Éclairer la ville ou protéger la biodiversité : faux dilemme
Délinquance et éclairage nocturne, des données inédites
Pour parvenir à ces résultats, j’ai croisé deux sources de données.
La première est une base inédite qui identifie, pour chaque commune, si et depuis quand l’éclairage public est éteint. Elle s’appuie sur les travaux du Cerema, qui a eu recours à des images satellites nocturnes pour détecter des ruptures soudaines dans les séries temporelles de radiance – c’est-à-dire la lumière visible depuis l’espace – susceptibles de correspondre à des extinctions de l’éclairage public.
J’ai ainsi adapté cette méthodologie pour améliorer les performances de l’algorithme de détection et mieux distinguer les extinctions des autres changements de l’éclairage public, comme le passage à des lampes LED. La performance du modèle a ensuite été vérifiée à partir d’une base de données regroupant plusieurs centaines de communes dont les pratiques d’extinction étaient connues, notamment grâce à un partenariat avec le programme ACTEE, ce qui a permis de valider empiriquement la robustesse de l’algorithme.
Cette base de données a ensuite été croisée avec les données administratives du ministère de l’intérieur, qui recensent, pour chaque commune et chaque année, le nombre de faits de délinquance sur la période 2017-2023.
Une fois les données croisées, l’enjeu était d’identifier un lien de causalité – et non d’établir une simple corrélation – entre extinction de l’éclairage public et la délinquance. Pour cela, l’étude s’est appuyée sur la méthode des « doubles différences », couramment utilisée en économie.
Concrètement, cette approche consiste à comparer l’évolution de la délinquance dans les communes qui ont éteint leur éclairage public, avant et après la mise en place de la mesure, à celle observée dans des communes comparables n’ayant pas procédé à une extinction.
Le principe est d’isoler l’effet propre de l’extinction nocturne, en neutralisant les tendances temporelles et les différences structurelles entre les deux groupes. De plus, les autres facteurs susceptibles d’influencer la délinquance, (par exemple, la taille de l’unité urbaine, la couleur politique du maire, ou la distance de la ville au quartier prioritaire de la ville le plus proche), ont ainsi été pris en compte.
Les cambriolages ont-ils été déplacés vers les communes éclairées ?
Des analyses complémentaires suggèrent que, s’agissant des cambriolages, il n’y a pas, a priori, de phénomène de déplacement vers les communes voisines restées éclairées lorsque certaines communes pratiquent l’extinction nocturne. En revanche, il serait pertinent de mener des travaux supplémentaires pour déterminer si de tels effets de report existent à une échelle plus fine, au sein même des communes, entre des quartiers éteints et des quartiers adjacents restés éclairés.
Une étude menée en Angleterre et publiée en 2023 apporte à cet égard des éléments intéressants : elle met en évidence une baisse des vols dans les véhicules dans les rues éteintes, accompagnée d’une hausse de ces faits dans les rues voisines demeurées éclairées. En France, la granularité des données actuellement disponibles ne permet pas d’analyser ces phénomènes à une échelle infracommunale.
Plus largement, malgré l’absence d’effets ou les effets très limités observés, de futures recherches pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière ces résultats pour l’ensemble des faits de délinquance étudiés. Il serait notamment utile d’examiner si les effets – lorsqu’ils existent – varient selon le moment de la journée ou de l’année, selon certaines caractéristiques du tissu urbain, ou encore si l’extinction de l’éclairage modifie les comportements, comme la vigilance des riverains ou la fréquentation de l’espace public. Ces approfondissements contribueraient à concevoir des politiques publiques adaptées.
Ce que les collectivités locales peuvent en retenir
Les résultats de cette étude ne permettent pas de conclure à une augmentation massive de la délinquance liée à l’extinction de l’éclairage public. Pour les communes qui souhaitent mettre en place ces politiques afin de réduire la pollution lumineuse ou maîtriser leurs dépenses énergétiques, ce constat est rassurant. Pour autant, ces mesures peuvent susciter un sentiment d’insécurité chez une partie de la population, qui ne doit pas être négligé.

Dans une autre étude, nous avons montré qu’il est possible de concevoir des politiques d’éclairage à la fois socialement acceptables et bénéfiques pour la biodiversité. Les résultats soulignent qu’une approche uniforme est peu efficace : les politiques d’éclairage nocturne doivent être pensées localement, à une échelle fine, au lampadaire près, afin d’être efficaces.
Enfin, il est important de rappeler que la lutte contre la pollution lumineuse ne se limite pas à l’extinction de l’éclairage public. De nombreuses mesures de réduction – comme l’adaptation de l’intensité ou de la température de couleur – sont largement mieux accueillies par la population, comme l’illustrent notamment les retours observés à Montpellier (Hérault).
À lire aussi : Éclairage public : les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ?
Chloé Beaudet est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l'Observatoire de l'Environnement Nocturne du CNRS. Elle a reçu des financements de l'INRAE et AgroParisTech en tant que chercheuse à l'UMR Paris-Saclay Applied Economics (PSAE).
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- Gauche.Media
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
