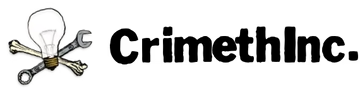
08.02.2026 à 00:59
Quelques banalités de base concernant la manifestation du 31 janvier à Turin : Reflexion sur le conflit à partir d'une nuit d'émeute
Texte intégral (6254 mots)

Le 18 décembre 2025, la police a expulsé le centre social historique Askatasuna à Turin, qui était squatté depuis 1996. Après une première manifestation convoquée immédiatement après l’expulsion, un appel a été lancé pour une deuxième grande manifestation le 31 janvier.
Les journaux rapportent que 50,000 personnes ont pris la rue. Sur Corso Regina Margherita, la rue où se trouvait le centre social, les affrontements avec la police ont duré pendant plusieurs heures. Un véhicule blindé a prit feu; des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un policier qui, laissé seul, a été frappé par des manifestants. De manière générale, la marche a été caractérisée par des confrontations d’une intensité plutôt rare en Italie ces temps-ci.
Quelque chose est en train de changer dans le paysage italien. Le mouvement pro-palestinien a explosé en solidarité avec la flottille qui a pris la mer pour Gaza à l’automne 2025 a rassemblé des millions de personnes dans les rues, y compris une nouvelle génération qui n’avait jamais participé auparavant à des actions directes. Les événements qui se sont déroulés à Turin au cours du mois dernier montrent que cette phase n’est pas terminée. Alors que l’autoritarisme gagne du terrain à travers le monde, nous voyons également les signes d’une colère ingouvernable parmi la population.
Nous présentons ici, une réflexion sur la manifestation du 31 janvier qui est récemment parue en italien.

1. Le meilleur héritage que la tradition des centres sociaux pouvait laisser aux plus jeunes est une célébration rageuse de ses funérailles.
Le 31 janvier a été plusieurs choses à la fois. Un cortège massif et transversal, la recomposition tardive des différentes pièces d’une gauche antagoniste en crise, écrasée entre l’avancée de la droite réactionnaire et l’imbécillité politique absolue du front progressiste, un dernier souffle de la longue expérience des centres sociaux qui touche désormais à sa fin. Dernier souffle d’une trajectoire qui a certainement connu l’une de ses expressions les plus conflictuelles à travers le centre social turinois, mais qui semble depuis longtemps prise dans une parabole de déclin inexorable. Nous n’écrivons pas ces lignes pour nous en prendre aux vestiges de cette entité que l’on appelle le Mouvement, pour en souligner les limites ou les erreurs. Nous tenons plutôt à dire clairement ce que nous avons vu le 31, au-delà du déroulement prévisible d’un défilé national des centres sociaux, de la gauche traditionelle, de cette partie de la société qui s’est rassemblée autour de la bataille pour la défense de la Sumud Flottilla.
Dans les rues de Turin, il y avait des milliers de jeunes qui n’appartiennent à aucun collectif, structure ou groupe militant. Il y avait des jeunes d’à peine vingt ans ou parfois moins, qui, à la fin du Corso San Maurizio, à l’approche du tournant vers les barrages policiers, se sont équipés, ont formé avec détermination un blackblock et se sont préparés à se battre. Ils ont attaqué la police, ont résisté aux charges, les ont repoussées en avançant et en reculant, mètre par mètre, pendant deux bonnes heures. Ce ne sont pas des choses que l’on voit tous les jours. Ces camarades gravitent dans le monde de la politique radicale, ils sont peut-être descendus dans la rue pour la première fois lors des manifestations pour la Palestine, et ont ressenti un appel irrésistible à venir à Turin.
Pourquoi ? Dans de nombreux cas, il s’agit de personnes qui, pour des raisons d’âge, n’ont même pas vécu personnellement l’histoire de l’Askatasuna ou d’un autre centre social, mais qui ont néanmoins répondu à un appel qui n’est pas celui de l’opposition au gouvernement, d’un discours politique précis sur l’économie de guerre ou les coupes dans les services publics, mais à la promesse d’une explosion de colère, d’une révolte, d’un événement qui renverse les rapports de force au moins pour la durée d’une journée.
On ressort transformé de l’expérience de l’affrontement et ouvert à de nouvelles possibilités : ce que la politique de mouvement peut faire, c’est laisser le champ libre pour que ces possibilités prennent corps et espace

2. Le victimisme ne sert à rien, il faut raconter les faits d’une façon qui rende compte de leur puissance.
Il faut cesser d’avoir honte d’exister. Les fascistes expriment leurs idées avec une virulence effrénée, ils sont à l’offensive dans tous les domaines et sous toutes les latitudes. De l’autre côté, la gauche est l’expression la plus pure d’un moralisme impuissant qui constitue l’autre face des régressions fascistes, celle qui, pendant des décennies, leur a cédé du terrain, par lâcheté et stupidité, préparant ainsi leur victoire. Mais la gauche ne se contente pas d’être vaincue, elle veut entraîner tous les autres dans son amour morbide pour la défaite et l’impuissance. C’est pourquoi, au premier signe de colère et de révolte, elle se livre à des condamnations hystériques et incohérentes : soit elle occulte la réalité du soulèvement, soit elle lance des anathèmes furieux. Face à ce bombardement de mensonges, il faut conserver un peu de lucidité.
Celleux qui sont descendus dans la rue ne sont pas des victimes de la violence policière, qui est une réalité constante et brutale, mais ont courageusement décidé d’affronter cette violence, de s’y préparer, de la renvoyer à l’expéditeur autant que possible. Essayons de rendre sa dignité à cette conduite, celle de la rébellion manifeste, qui est l’acte politique par excellence, dont tout découle. Les raisons de l’émeute sont innombrables : elles s’accumulent au travail, dans la rue, en famille, à l’université, lors d’un contrôle d’identité. Elles résident dans les conditions insupportables que nous vivons tous les jours, dans un avenir catastrophique qui est cyniquement imposé aux nouvelles générations. Sur le Corso Regina, les affrontements ont commencé avant même que les premières lignes du cortège, protégées par des boucliers et des casques, ne soient arrivées. Beaucoup, pour faire un clin d’œil à la gauche, joueront la carte du victimisme, souligneront la violence de la police dans la rue, iront jusqu’à déformer les faits en racontant qu’un cortège sans défense a été soudainement et sans raison chargé à froid par les forces de l’ordre.
Pour qui était présents, tout cela ne peut que paraître ridicule. Ce que nous avons ressenti en voyant les CRS de dos, regardant leurs véhicules en flammes, ne peut être représenté dans la célébration de la défaite, et ne peut peut-être être représenté du tout. De la volonté de réagir et de l’intensité de l’émeute peut naître une puissance politique à la hauteur du présent.

3. La fracture entre qui défent cette société et qui se révoltent est une guerre entre deux mondes. Il n’y a pas ni de language ni logique commune.
Maintenant, ils parlent de lui et écrivent sur lui, le psychologue, le sociologue, l’imbécile. Et ils parlent de lui et écrivent sur lui, mais il reste toujours clandestin.
—G. Manfredi, “Dagli appennini alle bande”
Le silence est menaçant, c’est une étrangeté qui s’accumule, qui ne donne aucun signe compréhensible, et qui finit par exploser […] Ils veulent nous faire parler. Mais nous n’avons rien à dire dans leurs lieux délégués. Leur politique, leur culture, sont des auto-dénonciations. Nous gardons le silence. Silence menaçant de l’étrangeté, de l’absentéisme, du refus, de l’appropriation spontanée, latence d’une nouvelle explosion qui se prépare.
—Collettivo A/Traverso, Alice è il diavolo
Il n’est pas possible de combler le fossé entre celleux qui manifestaient de manière offensive dans la rue et celleux qui, appartenant au monde de l’opinion publique, de la culture et de la classe politique, ont simplement fait preuve d’impuissance, de servilité et de démence (sénile). L’altérité de l’expérience des premiers, face à la lâcheté des seconds, est trop profonde pour qu’il puisse y avoir une quelconque compréhension, inutile d’essayer de débattre, les justifications tourneraient en rond. Ce n’est pas la même langue, et ce n’est pas non plus la même réalité. Ce qui exaspère terriblement le monde progressiste d’un establishment qui n’a plus aucun crédit moral, intellectuel, ni même un sens banal de la décence, c’est le refus de cette génération de dialoguer, de se comprendre, de gaspiller des mots inutiles. Il s’agit d’un silence menaçant qui caractérise les mouvements subversifs, de manière cyclique, depuis longtemps, mais qui revient aujourd’hui avec force. Une opacité et un silence menaçants qui font sauter la machine neutralisante du réformisme, la livrant à sa nature fasciste, la contraignant à embrasser ouvertement les tons hystériques de la pire rhétorique policière : matraques, ordre, condamnations unanimes et sainte inquisition.
Mais comment parler à qui permet un génocide retransmis en direct à la télévision, à qui nit l’évidence de l’effondrement éthique et existentiel, avant même biophysique, de cette civilisation, et recouvre d’un vernis coloré un désastre qui s’aggrave chaque jour davantage ? Comment parler à celleux qui falsifient le sens des mots jusqu’à le faire disparaître complètement ? La vérité, c’est que cette société n’a rien à offrir et que, avant tout, elle n’a aucun sens à offrir qui rende la vie digne, elle n’a aucune ressource subjective autre que la rapacité, le privilège, le nihilisme le plus immoral et le plus lâche. Alors, il vaut mieux que vous ne compreniez pas le mélange d’affection, d’émotions, de solidarité et de force collective qui se dégage d’une journée comme celle du 31. Continuez à broder dessus des récits invraisemblables et des classifications tellement stupides que vous êtes les seuls à pouvoir y croire. Nous essaierons toujours d’être ailleurs que là où vous nous cherchez.

3bis. Le portrait-robot de ceulleux qui se rebellent, le catalogage des sujets sur le terrain, est un travail de police qui doit être rejeté, d’où qu’il vienne. S’éloigner de cette logique est une mesure élémentaire d’hygiène et de stratégie.
« L’effort visant à nous identifier selon les logiques éprouvées de deux siècles de contre-révolution se retourne de manière risible et ignoble contre ceux qui voudraient nous emprisonner dans une formule, afin de nous livrer plus facilement aux murs de la prison. »
—Puzz, “Provocazione” (1974)
Si les tentatives maladroites de la presse, de la politique et des intellectuels autoproclamés de comptoir tendent toutes à donner un profil, à désigner un responsable des affrontements, profitons de leur stupidité et préservons l’opacité que cela nous garantit. Les journalistes et les commentateurs divers vont se creuser les quelques neurones qu’ils ont dans la tête pour tenter de « comprendre ces jeunes », d’« isoler les violents du reste du cortège » ou de se lancer dans des interprétations périmées et indigestes de la psychologie des foules. Nous serons également pris en étau entre qui tentera de nous coller des étiquettes tout aussi agaçantes et, surtout, issues de la même façon de comprendre le monde : « dans la rue, il y avait le grand front contre le gouvernement Meloni », « voici enfin apparaître le nouveau et véritable sujet politique (après les Maranzas,1, la génération Z, les écologistes, la convergence des luttes, les travailleurs du savoir, les travailleurs de la logistique, les jeunes, les précaires…) », tonneront-ils du haut de leurs immeubles occupés qui sentent le vieux.
Peu importe que ce travail laborieux et ridicule de profilage vise à réprimer, enfermer et diaboliser, ou bien à comprendre les raisons, expliquer, récupérer et – pourquoi pas ? – soigner. Rejetons-le. Celleux qui se révoltent font partie d’un peuple qui manque, d’une puissance anonyme et inclassable qui ne se définira que par la stratégie politique et la cohérence éthique que nous serons capables d’organiser. Quand et comment, cela ne regarde que nous.

4. Le retour des émeutes est toujours synonyme du retour de l’organisation autonome en bandes.
Quelques amis se parlent, des petits groupes se créent et deviennent anonymes. La police est attaquée bien avant que les casques et les boucliers n’arrivent à proximité des premiers camions. Pendant deux heures, les attaques se poursuivent par groupes, on se déplace, on essaie de contourner les obstacles, de prendre l’ennemi par surprise. Une dynamique inhabituelle dans ce pays, mais qui s’est déjà produite à d’autres occasions. On pourrait même presque affirmer que lorsque quelque chose se produit, c’est toujours sous cette forme. Des bandes apparaissent et disparaissent, nous les avons vues dans l’autonomie post-68, à Gênes au début de ce millénaire [lors des manifestations violentes contre le sommet du G8 en 2001], puis encore le 15 octobre, 2011 à Rome et sur les places contre le confinement. Plus le temps passe, plus les bandes restent orphelines d’une tradition politique lourde comme un boulet, fille de ce mouvement ouvrier vaincu il y a déjà 50 ans, qui rend le terrain après les charges semblable à des sables mouvants. Pour certains, c’est un deuil, un malheur tombé du ciel pendant la marche glorieuse et séculaire vers le socialisme, pour nous, c’est de l’air pur.
Alors que l’avenue centrale du Corso Regina était bondée, les rues latérales dégagées offraient des perspectives d’attaque intéressantes. D’un point de vue tactique, il y a certainement beaucoup à améliorer. Mais peu importe, le temps joue en notre faveur. Nous apprendrons de nos erreurs.

4bis. Il n’y a pas d’agitateurs extérieurs, mais la conscience d’un enjeu international.
« Il y avait des Français, des Espagnols et des Grecs ». « Les violents viennent de toute l’Europe ». Pour beaucoup de politiciens et de journalistes, l’un des points centraux de l’affaire est précisément celui-ci : la présence de non-Italiens dans les manifestations. Un mélange confus de théories du complot (les infiltrés) et de délires sur des modèles organisationnels paramilitaires, utilisé pour expliquer une réalité somme toute assez simple. L’accumulation d’expériences issues des cycles de soulèvements passés, à travers le monde, contribue spontanément à tisser un réseau de contacts et d’amitiés qui dépasse les frontières nationales. Est-ce si étrange ? L’une des récriminations les plus courantes à l’encontre des protagonistes des émeutes est qu’ils cherchent un exutoire éphémère et instinctif à leurs frustrations existentielles, sans se soucier de construire une perspective politique.
Mais la possibilité que de tels moments se transforment en une force politique solide et durable dépend précisément de la sédimentation stratégique des expériences, des relations et des techniques. Le fait que l’internationalisme soit devenu, même pour la gauche, un mot tabou ou une accusation criminalisante, n’est qu’un autre signe de son état de sclérose avancée. Il serait ridicule de dénoncer la catastrophe en cours si l’on n’a pas l’ambition de s’organiser en tant que force mondiale.

5. La révolte fait voler en éclats la machine infernale de la gauche et de la droite, le dispositif contre-révolutionnaire qui porte les fascistes au pouvoir dans tout l’Occident.
Nous vivons une époque historique marquée par une contre-révolution effrénée. Après une longue série de soulèvements et d’insurrections qui ont secoué le monde à plusieurs reprises, au moins jusqu’en 2019, le spectacle qui s’offre à nous est plutôt désolant. Une soumission absolue de la gauche à l’agenda du capitalisme cybernétique et ultralibéral, agrémentée d’un mépris ostentatoire envers quiconque ne se plie pas aux raisons du progrès, du marché ou de la raison démocratique, a inexorablement préparé la victoire sans appel de la pire droite fasciste. Le mépris pour le retard et l’irrationalité pour qui se révolte, qu’il s’agisse d’automobilistes avec un gilet jaune, d’agriculteurs ou de réfractaires à la surveillance sanitaire, a été un ingrédient décisif dans la préparation de cette victoire. À tel point que la droite, aujourd’hui au pouvoir, a réussi, au fil des décennies, à se draper dans les couleurs de l’alternative, de la contestation, s’appropriant même le mot « révolution ».
À force de vouloir incarner le front du Bien et de l’Ordre, la gauche est seule responsable des dérives fascistes actuelles et de leur renforcement constant. Mais ce n’est pas tout : l’appel à se rassembler dans un camp antifasciste bien aligné et raisonnable, au nom de la lutte contre la peste brune et le danger autoritaire, alimente encore plus un cercle vicieux dans lequel la gauche et la droite se soutiennent mutuellement dans leur fonction contre-révolutionnaire.
Ce n’est pas un phénomène historique inédit : la droite avance avec arrogance, la gauche exprime sa nature conformiste dans la défense de l’ordre et la normalisation institutionnelle. Il en résulte que tout discours politique qui souhaite intervenir dans la sphère publique, pris dans cette machine contre-révolutionnaire, est immédiatement écrasé, rendu incompréhensible. Ou bien il est réabsorbé dans l’un des deux pôles. En ce sens, les formes de guérilla urbaine, attaquées de tous côtés et de toutes parts, sont un geste qui sert à montrer en surface la solidarité évidente entre toutes les composantes de la machine gouvernementale et propagandiste, entre toutes les versions de la sphère publique. En mettant en lumière la fausse alternative entre fascistes et progressistes, que les manifestations pour la Palestine n’avaient que partiellement mise en évidence, les révoltes montrent la possibilité d’une opposition politique effective, de pratiques et de comportements qui, bien qu’encore embryonnaires, libèrent l’espace pour quelque chose de mieux. Quelque chose de plus sérieux et de plus enthousiasmant, que nous nous obstinons à appeler possibilité révolutionnaire.

|

|
5bis. Seule la révolte dans la rue a le pouvoir de faire face aux fascistes.
Nous avons dit que la gauche a construit le consensus des fascistes pendant des décennies. Nous sommes maintenant confrontés à une situation paradoxale où ces personnages désignent les attaques contre la police et les troubles dans la rue comme une faveur objective à la répression, qu’ils soutiennent eux-mêmes haut et fort. Inutile de gaspiller notre salive pour répondre à ces misérables. Nous soulignons simplement quelques constantes historiques qui sont évidentes pour quiconque n’est pas complètement aveuglé. En 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, nous avons assisté à une explosion de violence qui a secoué la ville de Minneapolis et les États-Unis de Trump. Cela a conduit à l’incendie de commissariats, de véhicules de police, à des attaques et à des pillages généralisés. Le monde démocratique et progressiste, en Amérique et sous toutes les latitudes, s’est empressé de faire passer pour un « mouvement pacifique » ce qui, selon tous les témoignages crédibles, était en fait un mouvement insurrectionnel. Neutralisation, suppression et répression s’équilibrent dans l’entreprise visant à effacer la possibilité subversive qui se profile dans ces moments-là.
Le résultat politique de l’annulation et la récupération de la révolte est aujourd’hui sous les yeux de tous. La masquer sous le couvert d’une opposition pacifique n’a pas empêché le trumpisme de revenir avec encore plus de force : domestiquer la rupture est non seulement contre-productif, mais aussi dangereux. Cependant, les événements de 2020 n’ont pas été inutiles, car il est assez clair que le souvenir de la révolte n’est pas étranger aux formes de résistance qui apparaissent aujourd’hui contre l’occupation militaire de nombreuses villes et les rafles fascistes de l’ICE. À Minneapolis même, le scénario de guerre civile, de plus en plus manifeste, a déjà conduit à plusieurs meurtres de sang-froid. Les personnes qui ont empêché les arrestations en première ligne, en essayant d’entraver les opérations de police et en enfreignant la loi, ont donné l’exemple d’une résistance courageuse et efficace. Dans un contexte de durcissement de la violence répressive et de la réaction, il est d’autant plus évident que le chœur démocratique ne sert à rien.
Nous laissons au lecteur deux questions : celleux qui descendent dans les rues de Minneapolis au péril de leur vie ressemblent-ils davantage aux jeunes gens qui ont eu le courage d’affronter la police à Turin, ou aux commentateurs bien-pensants qui les condamnent depuis chez eux ? Si le réseau d’organisation et de solidarité qui se structure autour des émeutes, au lieu de céder au chantage d’un retour à la normale, perfectionnait ses moyens et s’organisait pour durer, sommes-nous sûrs qu’un processus de transformation plus radical et plus profond serait une option si absurde ? Pour notre part, nous savons que lorsque le fascisme a connu des revers, c’était précisément lorsque les révoltes ont éclaté, tandis que lorsque la gauche est intervenue, le fascisme a triomphé. Weimar docet. [En référence à la république qui prévalait avant l’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne.] Dans l’histoire comme aujourd’hui, le contraire de la droite n’est pas la gauche, mais la révolution

|

|
5ter. La théorie du complot des infiltrés est une opération policière à la hauteur de son époque, donc tout à fait invraisemblable et de très mauvaise facture.
Bien sûr, les infiltrés existent, les groupes révolutionnaires en ont découvert et expulsé à maintes reprises et on pourrait citer de nombreux exemples. En aucun cas, il est vraiment décourageant de le répéter, les « infiltrés » ne peuvent déterminer l’issue d’un manifestation, se regrouper par centaines avec une disposition claire et évidente à l’affrontement, prendre naturellement les premières lignes et contraindre, grâce à des instruments de contrôle psychique très sophistiqués, le reste de la manifestation à les suivre, à les soutenir, à ne pas abandonner la place. C’était évident en 2001 à Gênes, ça l’était en 2011 à Rome, ça l’est en 2026 à Turin. D’ailleurs, le 31 janvier a été l’une de ces occasions où le décalage entre celleux qui ont pratiqué l’affrontement en personne et le reste des manifestants était minime, presque personne n’a fui, presque tout le monde a compris les raisons de ce qui se passait. Qui pense que de telles dynamiques sont imputables à l’infiltration a le cerveau dévasté par une exposition permanente à l’abrutissement médiatique et aux technologies numériques, et jusqu’ici, on pourrait aborder la question avec une tolérance compatissante. Vieillir bien n’est pas donné à tout le monde.
Le problème, c’est que la dénonciation des infiltrés , lorsqu’elle prend racine, crée des fantômes collectifs qui ont souvent favorisé le travail de la police, conduisant à des attitudes de suspicion et de délation. Il serait bon, par souci de ridicule et de prudence, voire de lucidité, de mettre fin à ces absurdités.

6. Précision terminologique sur la signification des termes « courage » et « lâcheté ».
L’une des expressions les plus odieuses du bouleversement linguistique éhonté et orwellien qui caractérise le discours public est celle qui évoque, dans la bouche de nombreux politiciens et journalistes, la question du courage. Nous sommes habitués à un usage du vocabulaire dans lequel chaque mot est utilisé pour signifier son contraire : la paix est le règne de l’économie de guerre, l’économie verte empoisonne la planète et la civilisation consiste à se soumettre, à être indifférent à la souffrance des autres, à marcher droit alors que toutes sortes d’injustices et de violences sont perpétrées à deux pas de nous. Si nous n’étions pas si régulièrement éduqués à un tel usage du langage, nous serions stupéfaits d’entendre des pamphlétaires à deux balles et des ministres qui, du haut de leur tribune, qualifient de lâches les jeunes qui étaient dans la rue samedi. Cela fait bouillir le sang. Essayons de nous représenter la scène : quelqu’un qui affronte pendant des heures, sous les tirs de gaz lacrymogènes à hauteur d’homme et les charges incessantes, au péril de sa vie et au risque de finir en prison, les forces de police armées et hyper-équipées d’un État, peut-il être qualifié de lâche ? Les mercenaires qui agissent en toute impunité pour défendre l’ordre sont en revanche un exemple de courage, tout comme les gratte-papiers et les politiciens qui dispensent des jugements moraux sans avoir jamais pris de risque de leur vie. Il suffirait de s’attarder sur cette comparaison et de réfléchir aux termes pour mesurer à quel point vous ne comprenez rien.

|

|
6bis. Qualifier l’incident du policier à terre d’exemple de « violence sauvage » revient à ignorer ce qu’est la violence.
Un CRS finit à terre alors qu’il tente d’en faire trop lors d’une charge. Le reste du peloton l’abandonne sans hésiter. Certains manifestants lui donnent des coups de pied pendant quelques secondes et, dans l’agitation, il reçoit également un coup de marteau dans le dos, tout à fait calibré. Un geste d’autodéfense élémentaire, mesuré, juste et salutaire. Deux jours plus tard, il est déjà sorti de l’hôpital, presque indemne, ce qui n’aurait certainement pas été le cas s’il avait été « martelé ». Cependant, c’est la version des journaux et du récit officiel : une agression furieuse, bestiale, d’une violence impitoyable qui fait horreur.
La mystification est tellement flagrante qu’elle parle d’elle-même, mais il vaut la peine de dire quelques mots. Le premier est qu’à force de subir, l’envie de se venger et de riposter est le symptôme d’un instinct vital plus que compréhensible. Celui qui a frappé l’agent à terre, l’empêchant de se lancer avec enthousiasme dans le passage à tabac des manifestants, s’est défendu lui-même et a défendu les autres. Et il faut le remercier. Tout comme tous celleux qui ont distribué du Maalox, aidé celleux qui étaient à côté d’eux, protégé de toutes les manières possibles le reste du cortège. Le citoyen lambda qui s’indigne des quelques coups de matraque reçus par le flic est victime d’une identification masochiste avec son bourreau, son problème est psychopathologique avant d’être politique.
À une époque où le mot « révolution » est utilisé pour désigner les choses les plus absurdes, au point que même le chef du gouvernement a qualifié les manifestants de samedi de « pseudo-révolutionnaires », pouvez-vous nous expliquer dans quelle révolution les forces de l’ordre n’ont pas reçu, au minimum, une bonne dose de coups de matraque ?

Que peut-on faire après une journée comme celle du 31 ? Une fois l’événement terminé, il y a au moins deux attitudes possibles face à son legs.
On pourrait dire « nous avons plaisanté », essayer de rendre plus digeste l’intensité et la violence de quelque chose qui nous dépasse, qui est dangereux et qui pourrait avoir des conséquences imprévues. Des conséquences non seulement en termes pénaux ou répressifs, mais aussi en termes de désorganisation ou de crise des formes d’organisation connues, d’impossibilité de reproduire les modes d’action politique que nous avons connus jusqu’à la veille. Les alliances politiques sous le signe de l’unanimisme se fissurent, la propagande ennemie divise le consensus en diabolisant les pratiques les plus offensives, on se retrouve dans une situation inconfortable. La première option consiste à tenter de recomposer ce consensus en reconstruisant une grande famille unique, de ramener l’expérience de l’affrontement – dans ce qu’elle a de plus dérangeant – à un récit édulcoré et rassurant qui convienne à tous les goûts. La tactique de recomposition a posteriori, qui consiste à tenter de recoller les morceaux, vise à minimiser l’attaque contre la police, à mettre l’accent sur les violences envers les manifestants et à reprendre le rôle des « gentils » dans la lutte commune contre les politiques gouvernementales. C’est une tactique qui trouvera - avec difficulté - un certain soutien dans une partie du monde intellectuel et politique, mais nous doutons qu’elle puisse aller très loin. Les images des troubles sont encore trop vivaces dans l’esprit de tous. Le pire, c’est qu’une telle attitude crée un décalage paralysant pour qui a vécu ce moment et se souvient bien à quel point l’explosion de colère collective n’avait rien de « défensif ».

|

|
Une deuxième façon de réagir correspond plutôt à un pari : plus risqué, car avoir toutes les voix, toutes les opinions contre soi n’est jamais une position confortable. Mais aussi plus authentique et passionnante. Dire aux personnes qui se sont battus dans la rue que ce qui s’est passé est grave, que la destruction a sa propre rationalité politique, qu’on peut croire en l’intensité de cette expérience et l’organiser en une possibilité concrète et générale. Nous avons parlé de la résistance contre l’ICE en Amérique, qui représente au moins en partie une image de notre avenir proche, sous le signe de la guerre civile et de la cruauté fasciste. La rencontre entre les gestes d’opposition dans la rue, en défi ouvert à la police, les réseaux de soutien et d’organisation populaire, et une possible intensification du conflit, représentent une indication fondamentale de nos futures défis.
Les personnes qui ont vécu la place du 31, qui prennent conscience de l’état du monde dans lequel ils vivent et de l’ampleur de son désastre, savent qu’ils ne peuvent rien attendre des alliances politiques institutionnelles, des protections juridiques, des mouvements d’opinion. Ce n’est qu’en croyant profondément à l’impact de la révolte, aux amitiés qui s’y tissent, à la chance qu’elle se transforme en une puissance révolutionnaire, que l’on peut s’immuniser contre l’épidémie de stupidité et de cynisme qui semble avoir contaminé nos contemporains.
« … face à cette façade de marbre, si nous continuons à creuser, nous trouverons peut-être un filon d’or. C’est peut-être cela, la révolution. »


|

|
-
« Maranza » est un terme péjoratif désignant les populations racialisées, avec une connotation criminelle et générationnelle (faisant souvent référence à la population marocaine dont le nom est dérivé, mais pas uniquement), largement utilisé dans le journalisme. Dans le contexte italien, il évoque un large éventail de significations, impliquant l’incompatibilité et le conflit avec l’ordre existant. ↩
07.02.2026 à 00:59
Les barrages filtrants : Une tactique mise en place dans les « Villes Jumelles » pour lutter contre l’ICE et défendre votre quartier
Texte intégral (6234 mots)

Cette semaine, les manifestant·e·s des « Villes Jumelles » ont expérimenté les barrages filtrants, un moyen de surveiller les allées et venues des agents fédéraux et, dans certains cas, d’entraver leurs activités. Nous présentons ici un guide pour mettre en place des barrages filtrants, partageons des récits d’individus présents sur des barrages filtrants dans les « Villes Jumelles » la semaine dernière, et concluons par un aperçu plus large de l’histoire et du potentiel de ce modèle.
Vous pouvez trouver des informations actualisées sur l’utilisation des barrages filtrants dans les villes jumelles ici.
Les barrages filtrants
L’hiver 2026 a été marqué par une lutte prolongée dans les « Villes Jumelles ». D’un côté, il y a les mercenaires des services de l’immigration et des douanes (ICE), la tentative de Donald Trump de créer une force de police fédérale qui n’aurait de compte à rendre qu’à lui seul, dans le but immédiat de commettre un nettoyage ethnique et, à plus long terme, de terroriser toute forme d‘opposition. De l’autre côté, on trouve les habitant·e·s des « Villes Jumelles », poussé·e·s par leur conscience à protéger leurs voisin·e·s et à défier la tyrannie. Leur résistance s’est traduite par la création de réseaux d’intervention rapide qui suivent les mouvements de l’ICE et entravent leurs tentatives d’enlèvement. Elle a également donné lieu à des actions de blocage devant le bâtiment fédéral, à une grève générale et à des émeutes qui ont contraint l’ICE et la police à se retirer des quartiers.
Au cours de la dernière semaine et demie, nous avons assisté à l’émergence d’une nouvelle tactique : le barrage filtrant.
Comme on peut le voir dans les « Villes Jumelles », les barrages filtrants sont des barricades qui transforment les intersections en ronds-points, tenus par des membres des réseaux d’intervention rapide qui vérifient la présence de véhicules de l’ICE. Les barrages filtrants ont pour fonction de ralentir ou d’arrêter les forces d’occupation ; tous les autres véhicules sont autorisés à passer et reçoivent un sourire. En plus de cette fonction de « filtrage », les barrages servent également de centres informels pour partager de la nourriture, rencontrer des voisin·e·s, réaliser des créations artistiques collectives, jouer de la musique, faire des projets et répondre à d’autres besoins immédiats de camaraderie et de relation humaine.
Cette tactique a provoqué la colère de l’ICE et de la police locale, ce qui est un indicateur de son efficacité. Afin que ce modèle puisse se diffuser, nous présentons un guide pratique, un bref aperçu de l’histoire récente de cette tactique et quelques enseignements tirés des précédentes actions de barrages filtrants, illustrés par des récits d’expériences menées la semaine dernière.

Un guide étape par étape
Les barrages filtrants constituent un moyen simple et efficace de résister à l’occupation de nos communautés. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques ami·e·s ou voisin·e·s déterminé·e·s et de matériel généralement facile à trouver. L’objectif est de ralentir la circulation, sans la bloquer complétement, afin d’identifier les véhicules potentiels de l’ICE. Plus il y a de barrages filtrants, plus la stratégie est efficace.
Le matériel nécessaire
- Des barrières routières telles que des cônes de signalisation ou d’autres obstacles routiers
- Du vieux mobilier ou des palettes en bois pour fortifier le barrage
- Des gilets de haute visibilité pour la sécurité routière
- Des panneaux de signalisation pour diriger correctement la circulation et exprimer son opposition à l’ICE
Les différents rôles
- Des « scanneurs » qui sont en charge de surveiller les voitures qui passent dans les rues et de vérifier les plaques d’immatriculation en utilisant la base de données des véhicules connus utilisés par l’ICE ; une personne par sens de circulation.
- Des expéditrices et expéditeurs pour aider à diriger la circulation ; là encore, une personne par sens de circulation.
- Des personnes chargées de la communication pour diffuser les informations en direct sur les différents fils de communication des réseaux d’intervention rapide.
- Une coordinatrice ou un coordinateur chargé·e de veiller à ce que tous les postes soient pourvus à tout moment.
- Des renforts pour bloquer rapidement les véhicules de l’ICE si besoin.
Plus il y a des participant·e·s, mieux c’est, mais même un petit groupe d’individus déterminés peut mettre en place un barrage efficace. Assurez-vous de discuter en amont de ce qu’il faut faire lorsque vous rencontrerez l’ICE, qu’il s’agisse de bloquer le carrefour pour les empêcher de passer ou simplement transmettre l’information de leur présence à toutes les autres personnes concernées.

Les leçons des « Villes Jumelles »
Si les barrages filtrants sont une tactique relativement nouvelle dans la résistance à « l’opération Metro Surge », les barricades ont déjà pris diverses formes dans les « Villes Jumelles ». Après le meurtre de George Floyd par la police en 2020, les personnes en deuil ont transformé le lieu de son assassinat en George Floyd Square, maintenant une zone autonome auto-organisée. Dans le même temps, plusieurs groupes ont pris en main la sécurité de leur communauté, comme Rocksteady Alliance, Powderhorn Safety Collective, Little Earth Protectors et les Brown Berets. Certains de ces groupes ont mis en place des points de contrôle autour de leurs quartiers.
Pendant la rébellion qui a éclaté à Whittier en réponse au meurtre d’Alex Pretti le 24 janvier, des personnes ont érigé des barricades sur plusieurs routes. Cela a inspiré les gens à ériger des barricades sur University Avenue lors de la manifestation bruyante devant l’hôtel Home2 qui a eu lieu la nuit suivante et à construire les différents barrages filtrants qui sont apparus par la suite dans les « Villes Jumelles ».
Les premiers barrages filtrants de 2026 ont vu le jour grâce à des patrouilles à pied organisées par les réseaux d’intervention rapide. Peu après le début de l’opération Metro Surge, les membres des groupes d’intervention rapide qui avaient choisi de ne pas poursuivre les véhicules de l’ICE en voiture ou à vélo ont commencé à prendre position aux coins des rues, aux intersections et sur les trottoirs de leurs quartiers, en particulier dans les zones où vivaient les populations ciblées par le harcèlement de l’ICE. Ces patrouilles à pied servaient à la fois à surveiller en permanence les activités de l’ICE dans une zone donnée et de créer une force mobile de réserve capable de documenter, d’intervenir et d’interférer avec les opérations des agents de l’ICE lorsqu’ils pénétraient dans les quartiers.
Certains des moments les plus spectaculaires de l’opposition observés jusqu’à présent au cours de l’opération Métro Surge ont été des réactions spontanées de membres des patrouilles à pied et des groupes d’intervention rapide qui ont courageusement cherché à défendre leurs voisin·e·s contre les enlèvements. En raison des tactiques éclair d’enlèvement de l’ICE, le succès de ces formes de défense reposait sur la présence de membres de la communauté arrivant très rapidement sur les lieux d’intervention de l’ICE ou sur la présence préalable de défenseuses et défenseurs dans la zone en question.
Les premiers barrages filtrants ont vu le jour dans les zones où les membres des patrouilles à pied et les défenseuses et défenseurs du quartier se rassemblaient sur des ronds-points et dans des rues secondaires, le plus souvent autour d’un feu de joie, ce qui permettait à plusieurs personnes de surveiller l’arrivée potentielle des véhicules conduits par les agents de l’ICE. Ces premiers « barrages » filtrants étaient essentiellement des ronds-points occupés. Leur objectif était principalement de ralentir la circulation, afin de donner aux défenseuses et défenseurs du quartier le temps de vérifier si des agents de l’ICE se trouvaient à l’intérieur des véhicules. Au début, il n’existait aucun mécanisme réel permettant d’arrêter les véhicules de l’ICE. Néanmoins, certains comptes rendus font état de véhicules de l’ICE faisant demi-tour et abandonnant certains itinéraires après avoir vu qu’ils étaient surveillés par des membres des patrouilles du quartier.
Depuis début février, les défenseuses et défenseurs communautaires du sud de Minneapolis ont adopté une attitude plus conflictuelle vis-à-vis des barrages filtrants. Alors que ces barrages n’étaient auparavant déployés que dans les rues résidentielles secondaires, les organisatrices et organisateurs de ces actions ont commencé à déplacer les barricades vers des artères plus fréquentées, connues pour être régulièrement empruntées par les agents de l’ICE. Alors que les barrages précédents ne devaient faire face qu’à un nombre limité de véhicules, leur déplacement vers des rues plus larges signifiait que les barricades devaient traiter des centaines de véhicules par heure tout en restant vigilantes face à une éventuelle activité de l’ICE.
À la suite d’une intervention directe de Tom Homan, le tsar des frontières au sein de l’administration Trump, la police de Minneapolis a pris d’assaut les trois barricades les plus importantes, une action qui a entrainé la fermeture temporaire de toutes les barricades de la ville. Cependant, il est facile de reconstruire un barrage filtrant.

Des barricades autour du lieu où l’ICE a assassiné Alex Pretti le 24 janvier 2026.
Voici quelques conseils pour les futur·e·s défenseuses et défenseurs des communautés qui se retrouveront sur les barricades.
Définissez vos intentions et planifiez en conséquence
Pour celles et ceux qui souhaitent avant tout documenter les activités de l’ICE et les relayer dans des fils de discussion dédiés aux groupes d’intervention rapide, la création d’un simple rond-point devrait suffire à ralentir les véhicules de l’ICE suffisamment longtemps pour pouvoir les identifier ou les dissuader de tenter de s’engager dans une rue. D’autres personnes, plus axées sur le soutien et la consolidation des liens de la communauté, ont mis en place des barrages qui se transforment en fêtes de quartier, servant à la fois de points de surveillance et d’espaces de rencontre pour renforcer la cohésion au sein la communauté.
Cependant, si vous souhaitez arrêter les véhicules de l’ICE et les repousser d’une zone en particulier, vous devez vous préparer à l’avance et concevoir votre barrage en conséquence. Lors d’un des plus grands barrages filtrants, deux véhicules transportant des agents de l’ICE ont pu passer car les manifestant·e·s n’étaient pas prêt·e·s à les arrêter. Les membres de la communauté se sont adapté·e·s en déployant des barrières de fortune construites à partir de palettes, qu’iels ont placées sur la route afin d’arrêter les voitures suffisamment longtemps pour vérifier leurs plaques d’immatriculation dans la base de données des véhicules appartenant à l’ICE. Iels ont renforcé ces barrages en utilisant des meubles, des palettes et d’autres objets, et ont décidé de défier directement l’ICE. Le lendemain, lorsqu’un véhicule de l’ICE s’est présenté, iels ont confronté le conducteur et l’ont finalement contraint à fuir la zone.
La gentillesse et la communauté sont essentielles
La défense de la communauté repose sur le consentement de cette dernière. En particulier lorsqu’iels déploient des stratégies plus assertives telles que les points de contrôle, les organisatrices et organisateurs doivent se montrer amicaux·ales et accueillant·e·s envers les conducteurs·rices et les passant·e·s. Jusqu’à présent, les barrages filtrants ont été populaires dans les « Villes Jumelles », recevant un large soutien sous forme d’encouragements, de nourriture et de fournitures. Les groupes qui souhaitent mettre en place des barrages filtrants doivent le faire avec le soutien le plus large possible de la communauté, en prenant toutes les mesures nécessaires pour que les barrages ne perturbent pas la vie quotidienne d’une manière que les gens n’apprécieraient pas.

Photo aimablement fournie par Minneapolis Spring.
Les rôles, les rôles, les rôles
Une fois que vous avez déterminé ce que vous essayez d’accomplir, assurez-vous que chacune et chacun d’entre vous ait un rôle clairement défini. Lorsque l’ICE arrivera sur place, tout se passera très vite, dans le bruit et ce sera intense. À ce moment-là, il sera trop tard pour discuter de ce qu’il faut faire. L’efficacité d’un barrage dépend de la réaction de chaque individu : empêcher l’accès dans une telle situation signifie agir avec rapidité, précision et coordination.
Qui s’occupe de vérifier les plaques d’immatriculation ? Qui communique avec les fils de discussion des groupes d’intervention rapide aux sujets des faits et gestes de l’ICE dans la zone contrôlée ? Qui s’occupe des barrières de palettes au point de contrôle ? Qui s’occupe d’entretenir le feu ? Ce sont là des questions que tous les groupes de défense des quartiers devraient se poser à l’avance et réexaminer tout au long du blocus. N’ayez pas peur de vous adapter aux situations et de changer de rôle si nécessaire. Les situations changent et évoluent, nous aussi.
Choisissez votre lieu d’action en fonction de vos objectifs
Les barrages les plus importants sur les grandes artères sont plus susceptibles d’aboutir à une confrontation directe avec les agents de l’ICE. Cependant, ce n’est peut-être pas votre objectif. Les barrages plus modestes dans les rues résidentielles peuvent perturber les opérations à plus petit échelle ou protéger des lieux spécifiques.
Si les barrages routiers de grande ampleur sont plus spectaculaires, ils sont également plus susceptibles de subir la pression des forces de l’ordre locales qui collaborent avec les forces fédérales. Pour les groupes communautaires qui cherchent à défier directement l’ICE ou à dénoncer la complicité des autorités locales et étatiques, cela peut être une bonne chose ; pour d’autres, cela peut être inutile.

Combattons l’ICE, ne nous battons pas entre nous
L’objectif des barrages filtrants est simple : protéger les voisin·e·s et instaurer une culture de résistance face à l’injustice. Il est presque inévitable que certaines personnes réagissent avec colère, mais ce n’est pas le rôle des défenseuses et défenseurs de la communauté de les convaincre ou d’entrer en conflit avec elles. Si ces personnes ne sont pas affiliées aux forces de l’ordre ou ne collaborent pas avec elles, celles et ceux qui tiennent les barricades doivent simplement les laisser passer. Choisir ses combats est un élément fondamental de la résistance. Pour être efficace, une culture de résistance à l’État doit cultiver une culture du respect envers nos voisin·e·s, même celles et ceux que nous trouvons énervant·e·s, grossier·ère·s ou que nous considérons comme étant en tort. Cet état d’esprit est essentiel pour cultiver une lutte populaire.
De même, certaines personnes s’opposeront aux tactiques d’action directe, en formulant leurs préoccupations au nom de la sécurité ou de la désescalade. Pourtant, choisir de ne pas résister à l’ICE est également une décision qui a de graves conséquences. Celles et ceux qui s’organisent dans un contexte particulier doivent prendre leurs propres décisions en fonction de leur compréhension des dynamiques spécifiques à l’œuvre au sein de leurs communautés. Nous ne pourrons peut-être pas convaincre tout le monde, mais en nous concentrant sur une éthique de défense communautaire participative, nous pouvons avancer l’esprit clair, le cœur fort et la certitude que rien de ce qu’iels peuvent nous opposer n’est plus fort que l’esprit des personnes qui ont choisi, contre toute attente, de résister.

Photo aimablement fournie par Minneapolis Spring.
Compte rendu 1 : le 2 février 2026
Nous avons mis en place le point de contrôle vers 8h30. Après environ 30 minutes, une voiture de l’ICE est passée sans que nous nous en apercevions. Quelques minutes après son passage, un message radio a été diffusé pour confirmer qu’il s’agissait bien d’un véhicule de l’ICE et nous a demandé de rester vigilant·e·s.
Peu après, un autre véhicule de l’ICE est arrivé à toute vitesse vers le point de contrôle, il s’est déporté sur la voie opposée pour éviter d’être arrêté et a pris la fuite.
Vers 10 heures, nous avons entendu des sifflets et des klaxons, signalant la présence de l’ICE dans le quartier. Au moins une demi-douzaine de personnes se sont précipitées pour intervenir. Le véhicule a pris la fuite, mais s’est accidentellement dirigé vers le point de contrôle. Lorsque le conducteur s’en est rendu compte, il a fait demi-tour et est reparti en direction de la foule. Le véhicule s’en est sorti avec quelques légers dommages au niveau de son feu arrière et du rétroviseur côté conducteur.

Compte rendu 2 : le 2 février 2026
Je me suis joint·e à un groupe de voisin·e·s car nous étions intrigué·e·s par le barrage filtrant installé au niveau de la 32ème rue et de Cedar. Nous voulions en savoir plus sur leurs activités, leurs objectifs et déterminer si nous pouvions mettre en place une initiative similaire dans notre quartier.
Nous avons traversé la zone en voiture pour voir quelle était l’ambiance qui régnait dans le quartier. S’agissait-il d’un simple poste de contrôle, d’un barrage filtrant, d’un point de patrouille fixe ou d’autre chose ? Les personnes qui se tenaient debout au milieu de Cedar avec des palettes nous ont fait signe de la main et nous avons répondu par quelques coups de klaxon en signe de solidarité. Leur rond-point fonctionnait comme un moyen de dissuasion, un peu comme un·e hôte·sse d’accueil dans un magasin, mais avec plus de chaleur humaine que ce que l’on peut attendre d’un·e employé·e en charge de la clientèle.
Lorsque nous sommes arrivé·e·s, une demi-douzaine de personnes étaient occupées à ériger des barricades, deux de chaque côté du carrefour de Cedar (la rue principale) et deux au milieu de l’intersection, relayant les contrôles d’immatriculation et les rapports SALUTE des groupes d’intervention rapide aux personnes postées sur Cedar. Les murs de la barricade était constituée d’un mélange de palettes en bois, d’équipements de circulation, de meubles, de caddies et de bâches. Au centre de la barricade, il y avait des sièges et des tables de fortune où l’on trouvait des affiches, des équipements de protection individuelle et de nombreuses collations et boissons. Au milieu se trouvait un foyer, offrant un feu modeste mais bien entretenu pour réchauffer les membres des patrouilles et toute autre personne qui passait par là.
Contrairement aux postes de contrôle mis en place par la Garde nationale, on avait vraiment l’impression que les barrages filtrants rassemblaient la communauté. Lorsque nous nous sommes approché·e·s de la barricade, nous avons été immédiatement accueilli·e·s. Si vous avez déjà surveillé les activités de l’ICE, il est plus facile de s’approcher et d’engager la conversation en demandant ce qui se passe et si quelqu’un a besoin d’aide ou de provision. Évidemment, vous serez mieux traité·e·s si vous essayer d’être utile, mais l’entraide fait partie de ce qui nous distingue de l’ICE (puisque nous aussi, nous cachons nos visages).
Les deux gars au milieu s’en sortaient bien côté ravitaillement : ils disaient que de plus en plus de gens apportaient des provisions ou les leur remettaient simplement en passant en voiture. Nous sommes resté·e·s au milieu de la barricade à discuter un peu. Finalement, je suis allé·e parler à certaines des personnes qui se trouvaient plus au sud sur Cedar.
La personne qui tenait le morceau de bois en contreplaqué sur lequel elle venait d’écrire à la bombe « ICE OUT » (« ICE DÉGAGE ») m’a dit qu’elle était là depuis environ trois heures ; l’autre personne était arrivée environ une heure plus tôt et avait décidé de l’aider. Après avoir discuté un moment, elle m’a fait savoir qu’elle devait bientôt partir, alors j’ai pris sa place et je me suis posté·e sur Cedar avec un talkie-walkie. Nous n’avons obtenu aucune confirmation positive des plaques d’immatriculation que nous avons relevées pendant que j’étais à mon poste.
Alors que j’étais sur Cedar, un type est arrivé en voiture et nous a donné trois pizzas. Un autre, au volant d’une voiture sur laquelle une fresque avait été peinte à la main, m’a tendu une représentation en carton et en trois dimensions d’un doigt d’honneur fixé sur un bâton avec l’inscription « FUCK ICE » (« NIQUE L’ICE »). Aucun des deux n’a dit un mot. Un autre type a ralenti, baissé sa vitre et demandé si nous avions besoin de quelque chose. Après que la personne qui s’occupait du feu ait demandé plus de bois, l’homme a levé le pouce et est revenu dix minutes plus tard avec un énorme sac poubelle rempli de bois de chauffage, comme s’il était le Père Noël.
Environ 90% des interactions que j’ai eues là-bas ont été positives : des coups de klaxon en signe de solidarité, des signes de la main, des saluts, des gens qui baissaient leur vitre pour nous remercier ou nous demander si nous avions besoin de quelque chose. Tous les chauffeurs de bus scolaires qui passaient par là baissaient également leur vitre pour nous remercier.
Les seules interactions négatives ont eu lieu avec quelques véhicules plus imposants. Aucun camion à 18 roues n’est passé par le point de contrôle, mais certains chauffeurs de camions n’ont pas apprécié l’espace restreint que la barricade créait sur la route. Néanmoins, nous n’avons connu aucune altercation verbale ou physique.
Nous avons vu deux policiers passer le rond-point sans causer de problème, nous faisant un petit signe de tête ou nous saluant poliment depuis leur volant. Je suppose que ces gestes ne reflétaient pas l’opinion personnelle de ces agents.
Plus tard, j’ai vu un camion du shérif avec ses gyrophares allumés à l’extrémité sud de Cedar, bloquant la route. J’ai dit à ma/mon pote de signaler sa présence au centre de communication, et j’ai quitté mon poste pour aller demander ce qui se passait. L’agent se trouvait à l’extérieur du camion et dirigeait la circulation hors de Cedar.
« Hé ! Est-ce que vous fermez cette route pour détruire la barricade ? »
« Ouai, désolé, certain·e·s résident·e·s se sont plaint·e·s, donc nous devons nous en débarrasser. »
Quand je suis revenu·e à la barricade, le feu était éteint et tout le monde était sur le trottoir. Un seul policier poussait tout ce qui restait debout. Des voitures de police bloquaient le carrefour, ainsi qu’un van rempli de policiers en tenue anti-émeute. Un camion poubelle est arrivé derrière les forces de l’ordre et les officiers ont jeté tout ce qu’ils pouvaient à l’intérieur. Nous avons rassemblé tout ce que nous pouvions, en sauvant la nourriture et les fournitures et le matériel d’entraide. Les forces de l’ordre sont parties aussi vite qu’elles étaient arrivées.
Cela n’a pas eu l’effet escompté sur le moral, je pense. Nous avons perdu beaucoup de choses, mais notre état d’esprit était : comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois ?

Une brève histoire de l’obstruction
La tendance pratique d’une population insurgée à affirmer son contrôle sur l’espace à l’aide de barricades est probablement aussi ancienne que les villes elles-mêmes. La barricade est l’expression politique d’un principe mécanique fondamental : avec les moyens appropriés, tout flux peut être interrompu ou toute route peut être bloquée. Le château dispose de sa porte et de son pont-levis, la ville de ses remparts, etc.
Au cours de la dernière décennie de luttes sociales et écologiques, cette stratégie a pris diverses formes. Sur la ZAD (Zone à Défendre) de Notre-Dame-des-Landes, où un mouvement populaire de squatteuses et de squatteurs a cherché à empêcher le gouvernement et des entreprises de construction privées de bétonner des terres agricoles historiques pour y construire un aéroport, l’occupation du territoire a conduit à la prolifération de barricades diverses, notamment des tranchées et même le creusement de tronçons entiers de route. Plusieurs régions de la ZAD sont ainsi devenues inaccessibles aux véhicules à moteur, tandis que d’autres n’étaient accessibles qu’avec plus ou moins de difficultés. Si aucune barricade n’était exactement identique à une autre, la tendance était de s’éloigner des structures temporaires et éphémères au profit de constructions plus durables.
Au cours de cette même période, une lutte explosive menée par les enseignant·e·s en 2016 à Oaxaca a donné lieu à des occupations de courte durée, mais à fort impact, des principaux axes routiers. Les blocages de Oaxaca ont été l’expression radicale d’un paradigme de lutte familier à celles et ceux d’entre nous qui ont grandi après l’apogée du mouvement syndical classique et qui ont appris à attaquer l’économie depuis des positions extérieures à celle-ci.
Dans le paradigme classique, les grèves dans les usines bloquent le travail productif, forçant ainsi l’arrêt de la production, tandis que les grèves des dockers bloquent le travail circulatoire, empêchant les navires et les camions de charger et de décharger leurs marchandises. Cependant, comme l’enseignement n’est ni un travail productif ni un travail circulatoire, les enseignant·e·s qui cherchaient à avoir un impact sur les résultats financiers de l’État et de la classe dirigeante ont dû choisir un lieu d’intervention adapté à leur propre initiative. Se rendant sur les autoroutes, les enseignant·e·s, leurs familles et leurs soutiens ont occupé des positions stratégiques telles que les péages et les échangeurs routiers afin de bloquer de longs tronçons de route. Cela a parfois pris des formes spectaculaires, comme l’incendie de semi-remorques pillés placés en travers de plusieurs voies. L’interruption du trafic routier a permis au mouvement des enseignant·e·s d’exercer un contrôle sur la circulation des marchandises afin d’infliger un préjudice financier à l’État et à la bourgeoisie au pouvoir. Cependant, comme l’a souligné un·e enseignant·e lors d’une interview, l’arrêt n’était pas censé être total : les enseignant·e·s laissaient passer « les voitures, mais pas les camions transportant des marchandises pour de grandes entreprises comme Walmart et Coca-Cola ». En d’autres termes, le modèle de cette barricade n’était pas celui de la tranchée, mais celui du filtrage.
Quelques années plus tard, toujours en France, une version combinant les modèles de la ZAD et de Oaxaca a vu le jour. Pendant le mouvement des gilets jaunes de 2018-2019, des milliers d’habitant·e·s de petites villes ont investi les ronds-points, où iels ont construit des cabanes et des abris à partir de palettes. Pour la plupart, iels ont choisi des ronds-points situés à l’entrée de leur ville, à côté des bretelles d’accès aux principales autoroutes. Comme à Oaxaca, cela a permis au mouvement de se positionner stratégiquement pour contrôler la circulation des marchandises par camion ; comme les zadistes, leurs occupations ont également joué un rôle positif, servant de centres d’auto-organisation, de partage et de rencontre politique. Sur les ronds-points, les participant·e·s au mouvement ont pu se retrouver et interagir avec les voisin·e·s et les ami·e·s qui passaient par là.
Un événement similaire s’est produit en Colombie en 2021, entraînant la fermeture de villes entières.
Ce qui se passe dans les « Villes Jumelles » représente une autre expression innovante du barrage filtrant, bien qu’il soit utilisé contre un ennemi différent avec des objectifs différents. Plutôt que de cibler le flux de marchandises, les barrages filtrants des « Villes Jumelles » répondent à la nécessité de lutter contre la terreur fasciste de l’État. À cette fin, ils représentent le développement d’une nouvelle stratégie dans une dialectique évolutive du jeu du chat et de la souris entre les agents de l’ICE et les membres des réseaux d’intervention rapide qui les poursuivent, enregistrent leurs faits et gestes et entravent leurs actions. Au lieu de poursuivre les agents, les barrages filtrants ouvrent la possibilité de les exclure de zones entières de la ville en affirmant et revendiquant le contrôle populaire sur les moyens de circulation.

Des barricades autour du lieu où l’ICE a assassiné Alex Pretti le 24 janvier 2026.
Le potentiel de croissance
Dans son livre La Barricade : Histoire d’un objet révolutionnaire, Eric Hazan observe que la vertu de la barricade réside dans sa tendance « à proliférer et à former un réseau qui traverse l’espace de la ville ». C’est cette « faculté de multiplication rapide » qui lui confère son pouvoir offensif. Hazan écrit que : « les barricades victorieuses sont celles qui immobilisent les forces de répression, paralysent leurs mouvements et finissent par les étouffer jusqu’à les rendre impuissantes. » Comme il est facile de contourner une ou deux barricades, pour que celles-ci fonctionnent efficacement comme une arme, elles doivent proliférer partout, car ce n’est qu’en conjonction les unes avec les autres qu’elles deviennent efficaces pour contrôler les mouvements de l’ennemi sur un terrain déterminé. Bien que la semaine dernière les expériences de barrages filtrants dans les « Villes Jumelles » aient attiré l’attention en ligne, elles commencent seulement à se répandre.
En plus d’entraver les mouvements de l’ennemi, les barrages filtrants peuvent remplir d’autres fonctions utiles. Si les réseaux d’intervention rapide ont permis à des individus d’agir de concert grâce à des discussions en direct sur Signal coordonnées par des répartiteurs, avec des conductrices et conducteurs se rassemblant autour des lieux ciblés par l’ICE pour se disperser tout aussi rapidement, le principal type de connexion qu’ils ont facilité était mobile, temporaire et à distance. En créant des lieux fixes où des voisin·e·s peuvent se retrouver, coopérer et collaborer, les barrages filtrants offrent un point de départ pour retisser le tissu de la vie quotidienne.
Contrairement au modèle des « centros », dans lequel les gens se rassemblaient sur les lieux des raids de l’ICE visant les travailleuses et travailleurs journaliers, les barrages filtrants tirent parti de la géographie et des ressources des quartiers résidentiels, permettant à des activités habituellement réservées à la sphère privée de prendre une dimension politique fédératrice, tout en intégrant des activités culturelles souvent réservées à d’autres lieux : lectures de poésie, repas-partage, créations artistiques, batailles de boules de neige, spectacles de hip-hop, formations sur les droits, etc. Si la fonction politique des barrages filtrants est circonscrite et spatiale, leur rôle dans la vie des voisin·e·s qui vivent dans les quartiers où ils sont implantés est intrinsèquement illimité et devrait favoriser un large éventail d’expérimentations.

Des barricades autour du lieu où l’ICE a assassiné Alex Pretti le 24 janvier 2026.
02.02.2026 à 11:46
Ils tirent des gaz lacrymogènes sur des enfants : L’assaut fédéral contre la marche syndicale « ICE Out! » à Portland
Texte intégral (2672 mots)

Le 31 janvier, des manifestant·e·s à Portland ont défilé jusqu’au bureau local des Services de l’immigration et des douanes (ICE). En réponse, et sans qu’aucune provocation n’ait eu lieu, les agents de l’ICE les ont attaqués avec diverses armes dangereuses, recouvrant la zone de gaz lacrymogène et blessant plusieurs jeunes enfants. Plutôt que d’intimider les habitant·e·s de Portland, cette attaque effrontée n’a fait que les galvaniser contre l’ICE. Dans le récit qui suit, des participant·e·s à la manifestation racontent les événements tels qu’ils se sont déroulés.
« Je suis convaincue que la police nous aide davantage que je ne pourrais le faire en dix ans. Elle crée plus d’anarchistes que les personnalités les plus en vue liées à la cause anarchiste ne pourraient en créer en dix ans. Si elle continue ainsi, je lui en serai très reconnaissante ; elle me fera gagner beaucoup de temps. »
Le 31 janvier, au lendemain de la grève nationale organisée pour protester contre les brutalités commises par les Services de l’immigration et des douanes à travers le pays, un rassemblement et une marche réunissant cinq mille personnes ont eu lieu à Elizabeth Caruthers Park à Portland, dans l’Oregon. Le thème était « Les travailleuses et travailleurs disent à l’ICE de dégager ! »

Des ouvrier·ère·s défilant vers les locaux de l’ICE à Portland avec leur syndicat brandissent une banderole sur laquelle on peut lire « Les travailleuses et travailleurs disent à l’ICE de dégager ! »
Contrairement aux manifestations de masse précédentes, qui évitaient tout contact direct avec le département de la Sécurité intérieure (DHS), l’objectif déclaré était de défiler vers le tristement célèbre bureau local de l’ICE. Depuis la recrudescence des agressions du DHS l’été dernier, ce bureau est devenu la cible quotidienne de manifestations rassemblant entre 5 et 200 personnes.
De nombreuses et nombreux militant·e·s radicaux·les ont vu dans cette marche un potentiel plus important que dans les manifestations habituelles. Elle avait été planifiée bien à l’avance, en mettant délibérément l’accent sur la classe sociale, le capitalisme et les infrastructures logistiques, et les organisateurs se sont efforcés de contacter divers syndicats et autres organisations. En conséquence, un consensus tacite s’est dégagé pour que, après la fin de la marche et du rassemblement, une tentative sérieuse soit faite pour paralyser les locaux de l’ICE. Cette décision s’inspirait en partie du changement de dynamique au sein de la foule de manifestant·e·s qui s’était rassemblée devant le bureau local après le meurtre d’Alex Pretti le 24 janvier.

Un·e manifestant·e anti-ICE brandit une pancarte représentant une ligne de policiers fédéraux, sur laquelle on peut lire « Voyous en rangers » et « Les fascistes de l’ICE ».
Cependant, les forces du DHS présentes à l’antenne locale n’ont pas attendu longtemps pour déployer leurs armes.
Alors que la manifestation se dirigeait vers le bâtiment de l’ICE sur South Macadam Avenue, des agents des services fédéraux de protection et des agents des douanes et de la protection des frontières ont fait leur apparition. Certaines personnes dans la manifestation les ont hués. Les mercenaires ont répondu à leurs paroles et à leurs gestes en attaquant la foule avec toute une panoplie d’armes « moins létales », recouvrant la zone de gaz lacrymogène et tirant au hasard sur la foule avec des balles de poivre et des grenades assourdissantes.
Cette manifestation rassemblait plus de jeunes personnes et d’enfants, y compris des enfants en bas âge, que les manifestations habituelles à Portland. Les agents fédéraux n’ont pas épargné ces dernier·ère·s, mais les ont attaqués avec la même violence que celle utilisée contre les adultes. Des images horribles ont circulé après coup, montrant des enfants souffrant des effets des gaz lacrymogènes.
Peu après l’arrivée de la manifestation, des agents fédéraux sont apparus sans avertissement et ont immédiatement attaqué sans discernement les manifestant·e·s avec des gaz lacrymogènes et d’autres munitions.
Il est important de souligner que beaucoup de ces jeunes ne sont pas simplement des victimes passives. Elleux aussi ont résisté au régime. Beaucoup d’entre elleux ont quitté les cours le 30 janvier et ont participé à des marches aussi radicales que la marche des travailleuses et travailleurs du 31 janvier. Par exemple, les élèves du lycée McDaniel, qui s’étaient auto-organisé·e·s, ont quitté les cours ce jour-là et ont défilé sur une artère principale de la ville. Selon certain·e·s jeunes qui ont participé aux deux rassemblements, les discours prononcés à la fin de cette manifestation étaient au moins aussi enflammés que ceux de la manifestation des travailleuses et travailleurs. Lors du rassemblement de clôture de la manifestation du lycée McDaniel, un ancien membre des Black Panthers de Portland s’est joint aux élèves qui, en tant qu’immigrants ou enfants d’immigrants, ont pris la parole pour dénoncer la gravité de la situation actuelle et la nécessité d’agir.
Certain·e·s de ces élèves ont participé à la manifestation syndicale, beaucoup d’entre elleux s’étaient équipé·e·s de matériel de protection individuelle, sachant que les forces de l’ordre pouvaient attaquer les manifestant·e·s, même s’iels étaient « pacifiques ». La brutalité des agents fédéraux n’est pas une grande surprise pour celles et ceux qui comprennent que la violence étatique est un moyen d’imposer un contrôle social plutôt que de répondre à des menaces réelles, mais elle n’en reste pas moins révoltante.
Après avoir été chassé·e·s du périmètre du bâtiment de l’ICE, les manifestant·e·s ont commencé à regagner le parc, criant des insultes aux agents fédéraux entre deux bouffées d’air. Il y avait tellement de monde qu’il était difficile pour beaucoup d’échapper aux nuages toxiques qui s’étendaient sur plus de six pâtés de maisons.

Un nuage de gaz lacrymogène au-dessus du bâtiment de l’ICE à Portland, éclairé d’une teinte orangée suite à l’explosion d’une grenade assourdissante.
Une fois que la plupart des manifestant·e·s furent de retour dans le parc, le rassemblement de clôture de la manifestation commença. Après de nombreux lavages des yeux, quelques discours et une interprétation de Bella Ciao, l’événement syndical fut officiellement clos. Quelqu’un annonça que celles et ceux qui le souhaitaient et en étaient capables devraient retourner au bureau local de l’ICE pour montrer aux autorités fédérales ce que nous pensions de leurs actions. Compte tenu du nombre de personnes qui ont vu les images des deux exécutions publiques perpétrées par l’ICE au cours du moins dernier, la violence répressive dont ils ont fait preuve à Portland le 31 janvier devrait être à présent moins choquante. Néanmoins, le fait de l’avoir subie directement a permis à de nombreuses et nombreux participant·e·s présent·e·s à la manifestation de prendre conscience que les agents fédéraux sont nos ennemis. Comme l’ont dit des anarchistes grec·que·s en 2008, les gaz lacrymogènes aident à y voir plus clair.
Au coucher du soleil, des centaines de personnes en colère se sont rassemblées devant le centre de l’ICE. Rapidement, le bruit de coups rythmés a couvert les chants et les cris ; la foule s’est retournée pour voir des individus masqués frapper sur une benne à ordures tout en la poussant vers l’allée principale menant au bâtiment fédéral. L’allée en question est le principal goulot d’étranglement pour faire entrer et sortir les véhicules – et donc les agents et les prisonniers – de l’établissement. Des acclamations ont éclaté lorsque les manifestant·e·s ont poussé la benne contre le portail.
Les gens sont restés debout sans crainte dans d’épais nuages de gaz lacrymogène après que les agents fédéraux soient sortis pour lancer un deuxième salve d’armes chimiques.
Une ligne d’agents a ouvert la porte pour sécuriser la benne à ordures. Pendant ce temps, certaines personnes ont commencé à démonter la protection en contreplaqué qui se trouvait sur un côté du bâtiment. Après s’être regroupés, les agents fédéraux ont envoyé une autre équipe pour attaquer les personnes dans la foule. Bien que quelques manifestant·e·s aient riposté avec des jets de projectiles et que d’autres aient réagi en libérant des personnes des mains des agents fédéraux, les mercenaires ont tiré une nouvelle salve de gaz lacrymogène, de balles de poivre et de grenades assourdissantes, dispersant suffisamment la foule pour procéder à quelques arrestations.
Malgré leur violence, les gens ne se sont pas laissé intimider. Le ton a commencé à changer ici, à Portland. Nous assistons au retour des tactiques qui étaient courantes en 2020. Certaines personnes se présentent avec des gants, prêtes à renvoyer les grenades lacrymogènes sur les mercenaires qui les lancent ; d’autres les suivent avec des souffleurs à feuilles, essayant de renvoyer la fumée sur les fédéraux, ou utilisent des cônes de signalisation pour éteindre les grenades lacrymogènes.

Un agent fédéral debout sur le toit d’un bâtiment de l’ICE à Portland, pointant un pistolet à balles de poivre vers les manifestant·e·s.
Ailleurs ce soir-là, un streamer d’extrême droite a vécu une mauvaise expérience. Cette personne et ses acolytes harcèlent depuis des mois les manifestant·e·s anti-ICE, bénéficiant parfois de la protection offerte par les responsables de la sécurité des manifestations. Au lieu de se lancer dans des disputes inutiles avec lui, certain·e·s antifascistes ont apparemment choisi de l’affronter alors qu’il ne s’y attendait pas. Il existe certainement des cas où des commentateurs d’extrême droite ont bâti leur carrière en prétendant avoir été victimes de persécutions, mais dans ce cas précis, cette action semble avoir réduit la capacité de l’extrême droite à soutenir les autorités fédérales. Les streameurs de droite ont lancé un appel à attaquer un événement anti-ICE le jour suivant, le 1er février, mais malgré toutes leurs fanfaronnades, ils ne se sont pas montrés.
Cette nuit-là, beaucoup d’entre nous ont appris qu’une agence Enterprise Rent-a-Car avait été attaquée quelques jours auparavant pour avoir collaboré avec l’ICE. À Portland, tout le monde savait depuis 2020 qu’Enterprise Rent-a-Car collaborait avec l’ICE, mais cela n’a été confirmé à l’échelle nationale qu’après que les autorités de Chicago l’aient mentionné dans le cadre des récents scandales liés au changement de plaques d’immatriculation. La nouvelle a également circulé qu’une agente de l’ICE, Rita Soraghan, avait enfin quitté son domicile après avoir reçu la visite de deux manifestations bruyantes ces derniers mois.
L’ICE enlève un nombre massif de personnes et les envoie dans ce qui s’apparente à des camps de concentration pour y effectuer des travaux forcés. Certaines des personnes kidnappées sont renvoyées dans leur pays d’origine où elles courent un risque considérable d’être tuées, exilées dans des prisons d’un pays qu’elles n’ont jamais visité, ou disparaissent purement et simplement. Les agents de l’ICE assassinent ouvertement dans la rue les personnes qui s’opposent à ces actes ignobles. Les tribunaux et les politiciens sont, au mieux, impuissants et au pire des complices. Quelles que soient les paroles fortes prononcées par les maires de Minneapolis et de Portland, ils ne souhaitent que réparer l’apparence de la paix sociale afin que les institutions du pouvoir puissent maintenir leur contrôle. Il faudra probablement une révolte d’une ampleur bien supérieure à ce qui s’est passé en 2020 pour changer le cours des choses.
Les anarchistes n’auraient pas pu déclencher seul·e·s le soulèvement de 2020. Mais le courage est contagieux et nous avons contribué à allumer les balises qui ont poussé les gens à se révolter ouvertement. Plus récemment, les manifestations contre Telsa (« Telsa Takedown ») ont prouvé que des actions directes de faible intensité ciblant des infrastructures logistiques peuvent combler le fossé qui existe entre les attaques clandestines et les manifestations publiques symboliques. Nous toutes et tous, quelle que soit notre situation, nous pouvons agir pour ouvrir la voie aux changements dont nous avons désespérément besoin.
Alors que la violence de l’ICE, du CBP (« Customs and Border Portection », le Service des douanes et de la protection aux frontières étatsunien) et des frontières en général s’étend de plus en plus à l’intérieur du pays, la situation ne fera qu’empirer tant que nous ne prendrons pas de mesures décisives à grande échelle. Mais Portland et Minneapolis ne se battent pas seules. Au lieu de battre en retraite, les gens se rassemblent pour se protéger et se soutenir mutuellement. De plus en plus de personnes choisissent d’intervenir chaque fois que les autorités fédérales font leur apparition.
Pour le meilleur ou pour le pire, ce n’est que le début.

Un·e manifestant·e anti-ICE brandit une pancarte sur laquelle on peut lire : « Quelque part en Amérique, une petite fille se cache dans un grenier et écrit à propos de l’ICE. »
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Ctrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique ‧ Asie ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- Infomigrants
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J
- I.C.I.J
- OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie