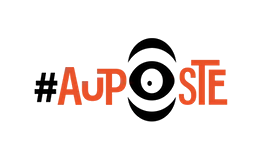
17.02.2026 à 18:20
Big Brother sourit encore, le film-alerte de Raoul Peck
Texte intégral (522 mots)
De la Birmanie coloniale à la guerre d’Espagne, de Trump à Bolloré, il relie passé et présent avec une rigueur implacable. Le dialogue navigue entre cinéma, mémoire, propagande et responsabilité démocratique. Il revient sur son travail, ses recherches, sa science du montage. Un dialogue lumineux, où chaque mot compte — parce que, justement, c’est par les mots que tout commence.
« Orwell : 2+2=5 » est bien plus qu'un documentaire sur George Orwell. C’est une boîte à outils pour comprendre notre époque. Avec ce film, Raoul Peck – l'immense réalisateur haïtien – plonge dans les derniers mois de la vie de l’écrivain britannique, alors qu’il achève 1984. Au-delà de la biographie, Peck montre comment les concepts orwelliens (Big Brother, novlangue, double pensée) sont devenus nos réalités quotidiennes --- des régimes autoritaires aux démocraties en crise. Par un montage percutant, mêlant archives (Guerre d'Espagne, Gaza, Trump, Poutine, Fox News, l'Empire britannique), fictions, news et I.A., Peck interroge : comment résister ? Comment transmettre ? Comment éviter que 2 + 2 n’égalent définitivement 5 ? Rencontre avec un réalisateur pour qui le cinéma est une arme de mémoire. Un honneur que de le recevoir ce soir.
La rencontre avec Raoul Peck
Raoul Peck affirme qu’Orwell a «établi la boîte à outils du totalitarisme» et qu’il décrit «la dégradation du langage» comme condition préalable à «la dégradation de la démocratie».
Il insiste sur l’importance quotidienne de défendre les institutions : «La démocratie, c’est un élément qu’il faut défendre tous les jours, que ce n’est pas un bien de consommation.»
Fort de son histoire personnelle en Haïti, il évoque la dictature et la peur : «À la maison, il fallait parler tout bas pour qu’on ne nous entende pas.»
Il analyse la manipulation lexicale contemporaine : «Quand on n’arrive plus à nommer les choses, on se perd.»
Sur la concentration des médias, il prévient : «Quand dans une société, la communication se retrouve entre les mains d’une minorité, ça devient un problème démocratique.»
Concernant Orwell, il rappelle : «1984, c’est un avertissement.» et souligne que l’auteur écrivait à partir de son vécu, notamment en Birmanie et en Espagne.
Il revendique une indépendance artistique totale : «Les considérations économiques ne peuvent pas être un argument pour ne pas faire les films que je fais.»
Sur la propagande moderne, il cite Steve Bannon : «Flood the zone with shit» pour illustrer la stratégie d’«inonder la zone» afin d’empêcher toute réflexion critique.
À propos du mensonge politique : «Le mensonge organisé […] est une partie intégrante du totalitarisme.» et «Le totalitarisme exige une altération continue du passé.»
Enfin, il appelle à l’engagement concret : «On ne peut plus se contenter d’envoyer des petits messages.» et rappelle que partout «les jeunes filles de Téhéran […] mettent leur vie en danger».
16.02.2026 à 08:36
Scandale Epstein ou le miroir d’une élite offshore + France : la carte électorale n’est pas (du tout) celle qu’on raconte + l’affaire Quentin D.
Texte intégral (802 mots)
A 7h30: Thomas Vonderscher, éditeur et historien, co-auteur avec Youssef Souidi de Nouvelle cartographie électorale de la France (Textuel), sera avec nous pour tordre le cou à certains clichés: ainsi, contrairement à une idée tenace, le RN n’est pas majoritaire chez les précaires. Leur travail révèle une France politique fragmentée : un RN ancré dans le périurbain et les classes moyennes, une gauche urbaine aux électorats distincts, et une coalition présidentielle soutenue par les plus aisés.
A 8h30, avec Martine Orange, co-fondatrice de Médiapart, on discute de sa thèse sur Epstein: Il est impossible de dissocier le financier criminel du monde dans lequel il évolue. Les millions de documents publiés par le département de la justice des États-Unis renvoient l’image hideuse et glaçante d’une classe dirigeante globalisée qui a prospéré avec le néolibéralisme et fait désormais sécession.
Sans oublier la météo des luttes, notre revue de presse antifa, les convocations de la semaine, radio police, revue de presse de la maison poulaga.
Chaque lundi matin, Au Poste tente de mettre un peu de trouble dans l’ordre médiatique dominant. "France Déter" accueille des invité·e·s, tient des revues de presse particulières, donne le temps des nuages et des luttes, explore le passé, étrille le présent. C’est en direct, c’est fait maison. Préparez le café!
La rencontre avec Thomas Vonderscher et Martine Orange
Thomas Vonderscher présente une méthode fondée sur le croisement des résultats du ministère de l’intérieur et des données sociales de l’INSEE: «on croise 3 jeux de données, on a évidemment les données du ministère de l’intérieur qui donnent les résultats par bureau de vote», ce qui permet selon lui de «produire une cartographie qui nous permet de se passer de sondage» et d’atteindre «une finesse au niveau des près de 70 000 bureaux de vote en France».
Il distingue quatre blocs structurants du paysage politique: «un quatrième bloc et auquel on tient beaucoup qui est l’abstention», précisant que «ce quatrième bloc, on l’appelle l’iceberg» car «c’est le bloc majoritaire».
Sur le vote RN et les classes populaires, il affirme: «Dans ces 5% les plus faibles, qu’est ce qu’on voit? C’est que l’extrême droite n’arrive pas en tête», rappelant que «c’est l’abstention qui est largement majoritaire» et que «c’est la gauche unie qui arrivent avec quasiment un quart des électeurs».
Concernant la présence d’immigrés et le vote d’extrême droite, il souligne la régularité statistique: «quand il y a 0% d’individus nés hors de l’Union européenne, là, l’extrême droite fait largement son meilleur score» tandis que «là où il y a 30% et plus, l’extrême droite arrive à moins de 10% des inscrits».
Sur le front républicain, il observe une évolution: «En 2024, réapparition du Front Républicain», détaillant que «l’extrême droite progresse de 5 points, mais la gauche elle progresso d’11 points» et que «ceux qui profitent le plus de ce front républicain (…) c’est la coalition présentielle et la droite traditionnelle».
Martine Orange replace l’affaire Epstein dans un système global: «Il est impossible de dissocier le financier criminel du monde dans lequel il évolue», estimant que «c’était aussi le problème d’une classe qui savait et qui s’est tue».
Elle définit le néolibéralisme financier comme «la volonté de financiariser absolument tous les éléments de la vie, quel qu’ils soient, et d’en tirer un profit quelconque», décrivant «un système qui est bâti sur la corruption, le chantage».
Sur le offshore, elle est explicite: «le offshore, c’est des gens qui (…) ne veulent plus avoir rien à faire avec un État», et résume: «L’ offshore, c’ est, la loi n’ est pas pour moi, je suis au-dessus des lois».
Elle décrit une élite mondialisée sans ancrage: «c’t’une transhumance permanente», ajoutant que «ils se déplacent et ils ne veulent rien avoir à faire avec personne».
Enfin, elle met en garde contre les amalgames et les dérives: «ce n’est pas parce qu’il y a des personnes qui sont malhonnêtes que le monde entier est malhonnête», insistant sur la nécessité de «faire un vrai travail de journaliste» et de «vérifier, peser».
13.02.2026 à 19:04
« Démocratiser le travail, libérer le temps » : l’utopie qui pourrait sauver la planète
Texte intégral (719 mots)
Et si le travail était central dans la question écologique? Cette intuition, André Gorz, philosophe, journaliste l’a eue dès les années 1970. Car le travail est une aliénation et s’inscrit dans une idéologie productiviste incompatible avec la préservation de l’environnement. Plutôt que de chercher à toujours produire davantage, nous devrions au contraire faire preuve de "réalisme écologique" et envisager la décroissance. Pour cela, Gorz prône une "réforme révolutionnaire": l’autogestion du travail, de nos besoins et rythmes de vie.
En pratique, c’est en rapprochant mouvement ouvrier et luttes écologistes que ce projet émancipateur pourrait voir le jour. Des thématiques toujours d’actualité cinquante ans plus tard, dont le mouvement écolo pourrait s’inspirer aujourd’hui.
Céline Marty est professeure agrégée de philosophie et docteure en philosophie. Elle a soutenu une thèse consacrée à André Gorz, dont elle a tiré l’ouvrage L’écologie libertaire d’André Gorz. Démocratiser le travail, libérer le temps (2025), après avoir publié Découvrir Gorz (2025) et Travailler moins pour vivre mieux (2021).
Hélène Assekour
La rencontre avec Céline Marty
La transition écologique et l’emploi : Céline Marty rappelle que la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. « Oui, il y a des enjeux écologiques, mais on ne veut pas que les travailleurs soient des perdants. » Elle souligne l’importance de repenser les métiers pour éviter de sacrifier des vies au nom de l’écologie.
Les bullshit jobs : Elle évoque le concept de bullshit jobs, ces emplois inutiles qui occupent une place centrale dans notre société. Une critique acerbe de l’organisation actuelle du travail.
André Gorz et l’écologie libertaire : Marty s’appuie sur les travaux d’André Gorz pour défendre une vision libertaire de l’écologie, où le travail serait démocratisé et le temps libéré. « Adieu au prolétariat » devient un leitmotiv pour repenser notre rapport à l’emploi.
La réduction du temps de travail : « Il faut travailler moins. » Une affirmation radicale, mais selon elle, nécessaire pour concilier bien-être et préservation de la planète.
La délégation du pouvoir politique : « Moi mes affaires économiques sont trop importantes pour que je participe à la vie politique, donc je délègue ce pouvoir politique à des représentants pour me consacrer à la ville économique. » Une critique de la séparation entre économie et politique, qui empêche une véritable transition.
Redéfinir le travail : « Redéfinir le travail. » Pour Marty, il ne s’agit pas seulement de créer des emplois verts, mais de repenser en profondeur ce que signifie « travailler ».
L’utopie réaliste : « Démocratiser le travail, libérer le temps. » Une proposition concrète pour sortir du modèle actuel, où le travail est synonyme d’aliénation.
L’impact de la crise écologique : « Comment aussi la crise écologique va impacter nos métiers, nos emplois, nos travaux à l’avenir ? » Une question centrale pour anticiper les bouleversements à venir.
Le rôle des entreprises polluantes : « Comment on fait quand on dénonce des entreprises polluantes pour réfléchir aussi au sort des personnes qui sont employées par ces entreprises ? » Un dilemme qui divise les écologistes.
L’écologie comme levier de changement : « L’écologie libertaire d’André Gorz. » Marty voit dans l’écologie une opportunité de transformer notre société, y compris notre rapport au travail.
La fin du travail tel qu’on le connaît : « Je travaille mon piano. » Une métaphore pour illustrer l’idée d’un travail épanouissant, loin des logiques productivistes.
Le pouvoir des travailleurs : « Il faut que les travailleurs aient leur mot à dire. » Une condition essentielle pour une transition juste et équitable.
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Ctrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique ‧ Asie ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- Infomigrants
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J
- I.C.I.J
- OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie