
Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles
08.10.2023 à 17:30
A propos de ce qui s'approche, par Giorgio Agamben
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1066 mots)

En exergue d'un de ses premiers poèmes, le poète grec né à Alexandrie Constantin Cavafy a transcrit une phrase de Philostrate qui dit : “Les dieux sentent l'avenir, les hommes ce qui arrive, les sages ce qui vient“. Les sages laissent aux dieux - ou aux experts - la prédiction du futur, toujours lointain et manipulable, et aux journalistes la connaissance - généralement très confuse - du présent : seulement ce qui s'approche, seulement ce qui est imminent les concerne et les affecte.
Le moment décisif, celui qui nous intéresse réellement et nous émeut, n'est pas celui où nous entrevoyons un événement futur, situé à un moment donné du temps chronologique, aussi grave soit-il (même la fin du monde, que les hommes n'ont fait et ne font qu'annoncer et même dater); c'est plutôt quand nous percevons que quelque chose est en train d’arriver.
"Le royaume est proche ( eggiken )" annonce Jean le Baptiste à propos de la venue du messie. Le verbe grec eggizo dérive de l'ancien nom de la main ( eggye ) et indique donc quelque chose qui est à portée de main, qui peut presque être touché. Il appartient à l’essence du royaume (et à la fin qui coïncide avec lui) d’être proche. Tout ce qui nous remue et nous émeut a la forme de quelque chose qui se rapproche, qui va nous toucher.
Cependant, la proximité dont il s’agit ici n’est pas objectivement mesurable, elle n’est pas simplement moins éloignée dans le temps chronologique. Si tel était le cas, il s'agirait encore d'une forme d'avenir, de ce que les sages ne veulent pas ou ne peuvent pas ressentir. Le proche est plutôt quelque chose que nous avons voulu éloigner et qui pourtant nous voisine. La pensée est cette faculté de détachement, penser une chose - qu'elle soit petite ou lointaine dans le temps - c'est la rendre proche, la rapprocher. La proximité n'est pas une mesure du temps, mais une transformation de celui-ci, elle n'a pas à voir avec des siècles ou des jours, mais avec une altérité et un changement dans l'expérience de la durée.
Ce temps, si incommensurable et pourtant toujours proche, les Grecs, pour le distinguer du chronos , le temps qui peut être calculé et numéroté, l'appelaient kairós , et le représentaient comme un enfant qui court vers nous avec des ailes aux pieds, et ne peut être saisi que par la mèche qui pend à son front. C'est pourquoi les Latins l'appelaient occasio , « la brève occasion des choses : si vous la saisissez, vous la retenez, mais une fois qu'elle s'est enfuie, même Jupiter ne pourrait pas la récupérer ». Et aux pharisiens qui demandent à Jésus un « signe du ciel », il a répondu avec colère : « Vous êtes capables de juger des signes qui annoncent la pluie ou du beau temps, mais des signes du kairoi, qui annoncent ce qui vient, vous ne pouvez pas les voir », . Et quand Paul veut définir la transformation de la vie messianique, il écrit : « Le temps, le kairos, a été raccourci, il s'est contracté » (le verbe qu'il utilise désigne à la fois l'ajustement des voiles et la contraction des membres d'un animal avant de sauter).
Car c'est bien de cela qu'il s'agit finalement, dans la vie, comme dans la pensée et en politique : savoir percevoir les signes de ce qui approche, de ce qui n'est plus temps, mais seulement occasion, perception d'une urgence et d'une imminence qui nécessite un geste ou une action décisive. La vraie politique est le domaine de cette urgence et de cette proximité particulière, et c'est ainsi qu'il faut envisager la guerre en Ukraine ou au Haut-Karabakh : il ne s'agit pas de plus ou moins de distance, mais de quelque chose qui s'approche, qui ne quitte pas pour devenir proche. D'un kairós , c'est-à-dire, selon un dicton d'Hippocrate, de quelque chose « dans lequel il y a peu de chronos , peu de temps mesurable » : mais c'est précisément cette infime parcelle de temps qu'il faut pouvoir capter.
Giorgio Agamben, le 30 août 2023
Traduction L’AQ, le texte original en italien se trouve sur le site de l’éditeur Quodlibet.
01.10.2023 à 15:52
La guerre atomique et la fin de l'humanité. Par Giorgio Agamben
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1831 mots)

En 1958, Karl Jaspers publie un livre sous le titre La bombe atomique et l'avenir de l'humanité dans lequel il entend interroger radicalement - comme le dit le sous-titre - la conscience politique de notre temps. La bombe atomique - commence-t-il dans l'introduction - a produit une situation absolument nouvelle dans l'histoire de l'humanité, la plaçant devant l'alternative incontournable : " Ou l'humanité entière sera physiquement détruite ou l'homme devra transformer sa condition éthico-politique ". Si autrefois, comme ce fut le cas dans les premières communautés chrétiennes, les hommes s'étaient fait des « représentations irréelles » d'une fin du monde, aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, l'humanité a la “possibilité réelle” de s'anéantir et de la vie sur Terre. Cette possibilité, même si les hommes ne semblent pas en avoir pleinement conscience, ne peut que marquer un nouveau départ pour la conscience politique et impliquer « un tournant dans toute l'histoire de l'humanité ».
Près de soixante-dix ans plus tard, la « possibilité réelle » de l'autodestruction de l'humanité, qui semblait ébranler la conscience du philosophe et impliquer immédiatement ses lecteurs (le livre fut largement commenté) semble être devenue une évidence, que journaux et hommes politiques évoquent chaque jour. comme une éventualité tout à fait normale. A force de parler d'urgence - où l'exception devient, on le sait, la règle - l'événement que Jaspers considérait comme inouï est présenté comme un événement tout à fait banal dont il appartient aux experts d'évaluer l'opportunité et l'imminence. Puisque la bombe a cessé d'être une « possibilité » décisive pour l'histoire de l'humanité et nous concerne au contraire de près comme une « casualité » parmi d'autres qui définissent une situation de guerre,
Treize ans plus tard, dans un essai significativement intitulé L'Apocalypse déçoit, Maurice Blanchot est revenu interroger le problème de la fin de l'humanité. Et il l'a fait en soumettant les thèses de Jaspers à une critique discrète, mais non moins efficace. Si le thème du livre était la nécessité d'un changement d'époque, il est surprenant que "de la part de Jaspers, dans le livre qui est censé être la conscience, la reprise et le commentaire de ce changement, rien n'a changé - ni dans le langage, ni dans la pensée, ni dans les formules politiques, qui sont préservées et même enfermées autour de préjugés de toute une vie, certains très nobles, mais d'autres très étroits...". comment est-il possible qu'une question qui met en jeu le destin de l'humanité, et dont le traitement ne peut que supposer une pensée entièrement nouvelle, n'ait pas renouvelé le langage qui l'exprime et ne produise que des considérations partielles et partisanes dans l'ordre politique ou urgentes et passionnantes dans l'ordre spirituel, mais identiques à celles que l'on entend répéter en vain depuis deux mille ans ? ". L'objection est certainement pertinente, car non seulement le livre de Jaspers se présente comme une vaste monographie académique qui entend examiner le problème sous tous ses aspects, mais ce que l'auteur entend opposer à la destruction est le lieu commun d'"une paix universelle sans bombes atomiques, avec une nouvelle vie économiquement fondée sur l'énergie nucléaire". Il est tout aussi singulier de constater que la bombe atomique est flanquée, comme un danger tout aussi mortel, du régime totalitaire du bolchevisme, avec lequel il est impossible de composer.
Le fait est, semble suggérer Blanchot, qu'une telle perspective apocalyptique est nécessairement décevante, car elle présente comme un pouvoir entre les mains de l'humanité quelque chose qui, en vérité, n'est pas tel. Il s'agit, en effet, " d'une puissance qui n'est pas en notre pouvoir, qui renvoie à une possibilité dont nous ne sommes pas maîtres, une probabilité - appelons-la probable-improbable - qui n'exprimerait une puissance propre que si nous la maîtrisions sans risque ". Mais pour l'instant, nous sommes tout aussi incapables de la maîtriser que de la vouloir, et ce pour une raison évidente : nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, car cette humanité, capable d'être totalement détruite, n'existe pas encore dans son ensemble. D'une part, il y a un pouvoir qui ne peut pas s'autonomiser, et d'autre part, comme sujet prétendu de ce pouvoir, une communauté humaine, "qui peut être supprimée, mais pas affirmée, ou qui ne pourrait être affirmée d'une certaine manière qu'après sa disparition, par le vide, impossible à saisir, de cette disparition, quelque chose, donc, qui ne peut même pas être détruit, parce qu'il n'existe pas " (p. 124).
Si, comme cela semble indéniable, la destruction de l'humanité n'est pas une possibilité dont l'humanité dispose consciemment, mais reste confiée à la contingence des décisions et évaluations largement aléatoires de tel ou tel chef d'État, l'argument de Jaspers est alors détruit de fond en comble, car les hommes qui n'ont pas effectivement la faculté de se détruire eux-mêmes ne peuvent même pas prendre conscience de cette possibilité pour transformer éthiquement et politiquement leur conscience. Jaspers semble répéter ici la même erreur que Husserl avait commise lorsque, dans une conférence de 1935 sur "La philosophie et la crise de l'humanité européenne", bien qu'il ait identifié les "déviations du rationalisme" comme la cause de la crise, il avait néanmoins confié à une "raison" européenne indéfinie la tâche de guider l'humanité dans son interminable progression vers la maturité. L'alternative déjà clairement formulée ici entre " une disparition de l'Europe devenue de plus en plus étrangère à elle-même et à sa vocation rationnelle " et une " renaissance de l'Europe " en vertu d'un " héroïsme de la raison " trahit la conscience inavouable que là où il y a besoin d'" héroïsme ", il n'y a plus de place pour cette " vocation rationnelle " (dont il est précisé qu'elle distingue l'humanité européenne " du sauvage Papou ", au moins autant que ce dernier diffère d'une bête).
Ce qu'une raison bien pensante n'a pas le courage d'accepter, c'est que la fin de l'humanité européenne ou de l'humanité elle-même, livrée à des aspirations anodines et vaines qui laissent intact le principe qui en est responsable, finit par se renverser, comme l'avait deviné Blanchot, en "un simple fait dont il n'y a rien à dire, sinon qu'il est l'absence même de sens, quelque chose qui ne mérite ni exaltation ni désespoir et peut-être même pas d'attention". Aucun événement historique - ni la guerre atomique (ou, pour Husserl, la Première Guerre mondiale), ni l'extermination des Juifs, et encore moins la pandémie - ne peut être hypostasié en un événement d'époque, si l'on ne veut pas qu'il devienne une idolum historiae incompréhensible et vide, que l'on ne peut plus penser ou affronter.
L'argument de Jaspers, qui discrédite l'incapacité de la raison occidentale à penser le problème d'une fin qu'elle a elle-même produite, mais qu'elle n'est en aucun cas capable de maîtriser, doit donc être abandonné sans réserve. Confronté à la réalité de sa propre fin, il tente de gagner du temps en transformant cette réalité en une possibilité qui pointe vers une réalisation future, vers une guerre atomique que la raison peut encore éviter. Il aurait peut-être été plus cohérent de supposer qu'une humanité qui a produit la bombe est déjà spirituellement morte, et que c'est à la conscience de la réalité et non à la possibilité de cette mort qu'il faut commencer à penser. Si la pensée ne peut raisonnablement pas poser le problème de la fin du monde, c'est parce que la pensée est toujours dans la fin, elle fait toujours l'expérience de la réalité et non de la possibilité de la fin. La guerre que nous craignons est toujours en cours et n'est jamais terminée, tout comme les bombes larguées à Hiroshima et Nagasaki n'ont jamais cessé d'être larguées. Ce n'est qu'à partir de cette prise de conscience que la fin de l'humanité, la guerre atomique et les catastrophes climatiques cessent d'être des fantômes qui terrifient et paralysent une raison incapable de les affronter, pour apparaître pour ce qu'ils sont : des phénomènes politiques déjà présents dans leur contingence et leur absurdité, que, précisément pour cette raison, nous ne devons plus craindre comme une fatalité sans alternative, mais que nous pouvons affronter chaque fois en fonction des cas concrets dans lesquels ils se présentent et des forces dont nous disposons pour les contrer ou les fuir. C'est ce que nous avons appris au cours des deux années qui viennent de s'écouler et, face à des gouvernants qui se montrent de plus en plus incapables de gérer l'urgence qu'ils ont eux-mêmes produite, nous entendons en tirer le meilleur parti.
7 octobre 2022
Giorgio Agamben
10.09.2023 à 15:01
Paolo Virno / la connaissance comme principale force productive, et ses conséquences
L'Autre Quotidien
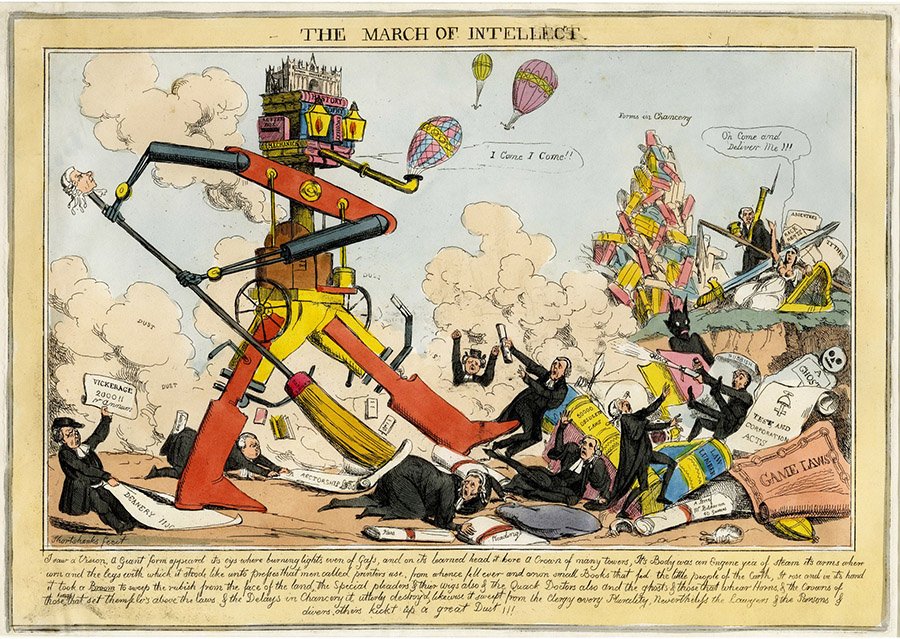
Texte intégral (3006 mots)

Un texte central pour la définition et l'analyse du mode de production post-fordiste est le « Fragment sur les machines » de Karl Marx (tel que titré par la revue Quaderni Rossi, qui a publié sa première traduction italienne en 1962), un passage des Éléments fondamentaux pour la critique de l'économie politique (Grundrisse) (tome II, XXIe siècle, pp. 216-230). Dans ces pages, écrites presque en apnée en 1858 sous la pression d’engagements politiques pressants, se trouvent des réflexions sur les tendances fondamentales du développement capitaliste qui ne peuvent être retracées ailleurs dans l’œuvre de Marx et qui, en fait, sonnent comme des alternatives aux formules habituelles.
Marx y soutient une thèse peu « marxiste » : la connaissance abstraite – la connaissance scientifique en premier lieu, mais pas seulement – est appelée à devenir, précisément en raison de son autonomie par rapport à la production, rien de moins que la principale force productive, reléguant travail fragmenté et répétitif à une position résiduelle. Il s’agit d’une connaissance objectivée dans le capital fixe, incarnée (ou plutôt : infusée) dans le système automatique des machines. Marx utilise une image très suggestive pour indiquer l'ensemble des connaissances qui constitue l'épicentre de la production sociale et, en même temps, préordonne toutes les sphères vitales : il parle d'un intellect général. « Le développement du capital fixe révèle à quel point la connaissance sociale générale est devenue une force productive immédiate et, par conséquent, les conditions du processus de la vie sociale elle-même sont passées sous le contrôle de l'intellect général et ont été remodelées en conséquence ». General intellect : l'expression anglaise (dont l'origine est inconnue) est peut-être une réponse à la volonté générale de Rousseau, ou un écho matérialiste de Nous poietikos , « l'intellect agent » séparé et impersonnel dont parle Aristote dans De Anima ( III, 429a-430a). ).
La tendance à la prééminence du savoir fait du temps de travail une « base misérable » : le travailleur est désormais placé à côté du processus productif, au lieu d'en être l'agent principal. La soi-disant « loi de la valeur » (c'est-à-dire que la valeur d'une marchandise est déterminée par le temps de travail qui y est incorporé), que Marx considère comme l'architrave des relations sociales actuelles, est cependant effondrée et réfutée par le développement capitaliste lui-même. Cependant, le capital reste intrépide « mesurant les gigantesques forces sociales ainsi créées comme temps de travail » (ndlr : le capital, dit Marx ; mais, pourrions-nous ajouter, aussi le mouvement ouvrier organisé, qui a fait de la centralité du travail salarié sa solide justification).
C’est à ce stade que Marx propose une hypothèse émancipatrice très différente des plus connues qu’il a exposées dans d’autres textes. Dans le « Fragment », la crise du capitalisme n'est plus attribuée aux disproportions inhérentes à un mode de production réellement basé sur le temps de travail dépensé par les individus (elle n'est plus attribuée, donc, aux déséquilibres liés au plein validité de la loi de la valeur, par exemple la baisse du taux de profit). Ce qui ressort plutôt au premier plan, c’est la contradiction déchirante entre un processus productif, désormais fondé directement et exclusivement sur la science, et une unité de mesure de la richesse qui continue de coïncider avec la quantité de travail incorporée dans les produits. L'expansion progressive de cet écart conduit, selon Marx, à « l’effondrement de la production basée sur la valeur d’échange » et donc au communisme.
Ce qui ressort de l’ère post-fordiste est la pleine réalisation factuelle de la tendance décrite par Marx, mais sans implications révolutionnaires ni même conflictuelles. Plus qu’un foyer de crise, la disproportion entre le rôle joué par les connaissances objectivées dans les machines et l’importance décroissante du temps de travail a donné naissance à des formes de domination nouvelles et stables. Le surplus de temps, c’est-à-dire la richesse potentielle, s’est manifesté sous forme de misère : chômage technique, retraites anticipées, chômage structurel (causé par l’investissement et non par son manque), prolifération des hiérarchies. La métamorphose radicale du concept même de production continue de s’inscrire dans la sphère du travail soumis à un modèle. Plus qu’une allusion au dépassement de ce qui existe, le « Fragment » est une boîte à outils pour le sociologue. C'est le dernier chapitre d'une histoire naturelle de la société. Il décrit une réalité empirique visible par tous. Un exemple suffit. Dans les dernières phrases du texte en question, Marx dit que, dans la société communiste, l'individu complet, sans amputation, entrera dans la production. C'est-à-dire l'individu modifié par une part importante de temps libre, par une consommation culturelle, par une certaine « capacité de jouir » accentuée. Eh bien, il n’y a personne qui ne voit que le processus de travail post-fordiste bénéficie, à sa manière, précisément de cette transformation, tout en la privant de toute aura libératrice. Ce qui est appris, vécu et consommé en dehors du temps de travail est ensuite utilisé dans la production de biens, devient partie intégrante de la valeur d’usage de la force de travail et est calculé comme une ressource rentable.
Pour retrouver le fil du conflit dans la situation nouvelle, il faut faire une critique fondamentale du « Fragment ». Marx a identifié l' intellect général (c'est-à-dire la connaissance comme principale force productive) avec le capital fixe, avec la « capacité scientifique objectivée » dans le système des machines. Ce faisant, il a négligé le côté par lequel l' intellect généralElle est présentée comme une œuvre vivante. L’analyse de la production post-fordiste impose cette critique. Dans le soi-disant « travail autonome de deuxième génération », mais aussi dans les procédures de fonctionnement d'une usine radicalement innovante comme Fiat à Melfi, il n'est pas difficile de reconnaître que le lien entre connaissance et production n'est en aucun cas épuisé par le système machine, mais elle s'articule plutôt dans la coopération linguistique des hommes et des femmes, dans leur action commune concrète. Dans le contexte post-fordiste, les constellations conceptuelles et les schémas logiques jouent un rôle décisif, qui ne peut jamais s'incarner dans un capital fixe, mais est indissociable de l'interaction d'une pluralité de sujets vivants. L'« intellect général » comprend donc les connaissances formelles et informelles, l'imagination, les inclinations éthiques, la mentalité, "jeux de langage". Dans les processus de travail contemporains, certaines pensées et discours fonctionnent comme des « machines » productives.en soi , sans avoir besoin d'adopter un corps mécanique ni même une âme électronique. Et c'est précisément dans cette rupture progressive entre l'intellect général et le capital fixe, dans cette redistribution partielle du premier au sein du travail vivant, qu'il faut discerner la matrice des conflits, la condition des grands et petits « désordres sous le ciel ».
Nous appelons intellectualité de masse la totalité du travail vivant post-fordiste (et non, remarquez, un secteur spécialement qualifié du secteur tertiaire) parce qu’elle est le dépositaire de compétences cognitives qui ne peuvent être objectivées dans le système des machines. L’intelligentsia de masse est aujourd’hui le moyen par excellence par lequel l’ intellect général est apprécié . Il ne s’agit bien entendu pas de l’érudition scientifique d’un travailleur individuel. Ce sont seulement (mais ce « seulement » est tout) les aptitudes les plus génériques de l'esprit qui passent au premier plan, gagnant le rang de ressource productive éminente : faculté de langage, disposition à apprendre, mémoire, capacité d'abstraction et d'établissement de corrélations. , tendance à l’introspection. Par l'intelligence généralel' intellect en général doit être compris littéralement . Ce ne sont pas les œuvres de la pensée (un livre, une formule algébrique, etc.) qui sont en cause, mais la simple faculté de penser. Décrire la relation entre l'intellect généralet œuvre vivante post-fordiste, il suffit de se référer à l’acte par lequel tout locuteur recourt à la potentialité inépuisable du langage pour faire une énonciation contingente et irremplaçable. Le langage (comme l'intellect, la mémoire, etc.) est la chose la plus diffuse et la moins « spécialisée » qui puisse être conçue. Ce n’est pas le scientifique, mais le simple orateur qui est un bon exemple d’intelligentsia de masse. Cette dernière n’a donc rien à voir avec une nouvelle « aristocratie ouvrière » ; il est plutôt situé à ses antipodes.
Puisqu'il organise le processus productif et le « monde de la vie », l'intellect général est, oui, une abstraction, mais une abstraction réelle, dotée d'une opérabilité matérielle. Cependant, en étant constitué de connaissances, d'informations, de paradigmes épistémologiques, l'intellect général diffère de la manière la plus péremptoire des « abstractions réelles » typiques de la modernité : celles donc qui donnent corps au principe d'équivalence . Alors que l'argent, « l'équivalent universel » précisément, incarne dans son existence indépendante la commensurabilité des produits, des travaux et des sujets, l'intellect général établit au contraire les prémisses analytiquespour tous les types de pratique. Les modèles de connaissances sociales n'assimilent pas les différentes activités de travail, mais se présentent comme une
« force productive immédiate ». Ce ne sont pas des unités de mesure, mais constituent le budget excessif de possibilités opérationnelles hétérogènes.
Ce changement dans la nature des « abstractions réelles » – c'est-à-dire le fait que ce sont les connaissances abstraites, et non l'échange d'équivalents, qui ordonnent les relations sociales – a une implication importante au niveau des affects. Plus précisément, elle constitue le fondement du cynisme contemporain (atrophie de la solidarité, solipsisme belliqueux, etc.). Pourtant, le principe d’équivalence, qui sous-tend les hiérarchies les plus strictes et les inégalités les plus féroces, garantit une certaine visibilité des liens sociaux, ainsi qu’un simulacre d’universalité. A tel point qu'elle se joignait, de manière ouvertement idéologique et contradictoire, à la perspective d'une reconnaissance mutuelle sans restriction, à l'idéal de communication égalitaire, à telle ou telle « théorie de la justice ». L'intellect général, tout en déterminant avec une puissance apodictique les présupposés des différents processus productifs et des « mondes vitaux », occulte néanmoins la possibilité d'une synthèse, n'offre pas l'unité de mesure d'une équation, frustre toute représentation unitaire. Le cynisme d'aujourd'hui reflète passivement cette situation, faisant de la vertu une nécessité.
Le cynique reconnaît, dans le contexte particulier dans lequel il opère, le rôle prédominant joué par certains modèles épistémiques et l'absence simultanée de véritables équivalences. Mettez de côté l’aspiration à une communication dialogique transparente. Renoncez d’emblée à la recherche d’un fondement intersubjectif de sa praxis, ainsi qu’à la revendication d’un critère partagé d’évaluation morale. Abandonnez toutes les illusions sur la possibilité d’une « reconnaissance mutuelle » égale. La chute du principe d’équivalence est perçue, dans le comportement du cynique, comme un abandon à tout prix de l’exigence d’égalité. Au point qu’il confie l’affirmation de lui-même précisément à la multiplication effrénée des hiérarchies et des inégalités qui semble impliquer la centralité nouvellement acquise du savoir dans la production.
Le cynisme contemporain est une forme d'adaptation subalterne au rôle central joué par l'intellect général .
Selon une longue tradition, allant d’Aristote à Hannah Arendt, la pensée est une activité solitaire, dénuée de manifestations extérieures. La notion marxiste d’ intellect général contredit cette longue tradition. Parler d’une « intelligence générale », c’est en fait parler d’une intelligence publique. Dans le post-fordisme, la « vie de l’esprit » devient extrinsèque, partagée, commune. Quelles sont les conséquences de la publicité pour l’intellect ? On peut en signaler au moins deux.
Le premier concerne la nature et la forme du pouvoir politique. La publicité particulière de l’intellect se manifeste indirectement dans le domaine de l’État à travers la croissance hypertrophique des appareils administratifs. L'administration, et non plus le système politico-parlementaire, est le cœur de l'État : mais c'est précisément parce qu'elle représente une concrétion autoritaire de l'intellect général, le point de fusion entre savoir et commandement, l’image inversée du surplus de coopération. Il est vrai que le poids croissant et décisif de la bureaucratie dans le « corps politique », la prééminence du décret sur la loi, est constaté depuis des décennies : mais ici, je voudrais indiquer un seuil sans précédent. Bref, nous ne sommes plus confrontés aux processus bien connus de rationalisation de l’État, mais, au contraire, nous devons désormais observer l’avènement de la nationalisation de l’intellect. L'expression ancienne « raison d'État » acquiert pour la première fois un sens non métaphorique.
La deuxième conséquence concerne le caractère effectif du régime post-fordiste. Alors que le processus de production traditionnel reposait sur la division technique des tâches (celui qui fabrique la tête de l'épingle ne s'occupe pas du corps de l'épingle, et vice versa), l'action de travail centrée sur l'intellect général repose sur la participation commune à la « vie de l'esprit », c'est-à-dire le partage préalable de compétences communicatives et cognitives génériques. Le partage de l’intellect général devient le véritable fondement de toute praxis. Dès lors, toutes les formes d’action concertée fondées sur la division technique du travail diminuent.
La fin de la division du travail, lorsqu’elle est réalisée dans un régime capitaliste, se traduit cependant par une augmentation des hiérarchies arbitraires ou des formes de coercition qui ne sont plus médiatisées par les rôles et les tâches. Mettre en œuvre le commun, c’est-à-dire l’intellect et le langage, si d’un côté il rend fictif la division technique impersonnelle du travail, de l’autre il induit une personnalisation visqueuse de l’assujettissement. Le rapport incontournable à la présence d’autrui, implicite dans le partage de l’intellect, est vu comme un rétablissement universel de la dépendance personnelle.
Enfin, il faut se demander si la publicité particulière de l'intellect, évoquée aujourd'hui comme une exigence technique du processus productif, n'est pas plutôt la base d'une forme radicalement nouvelle de démocratie, d'une sphère publique antithétique à celle enchâssée dans l'État et son « monopole de décision politique ». La question fait apparaître deux profils différents, entre lesquels existe pourtant la complémentarité la plus étroite. L’intellect général ne s’affirme comme sphère publique autonome que si le lien qui l’unit à la production marchande et au salariat est rompu. En revanche, la subversion des rapports de production capitalistes ne peut désormais se manifester qu’avec l’institution d’une sphère publique non étatique., d'une communauté politique dont l'intellect général est la pierre angulaire .
Paolo Virno
Cet article de Paolo Virno a été initialement publié sous le titre « Intellect général », dans Adelino Zanini et Ubaldo Fadini (éd.), Lessico Postfordista. Dizionario di idee della mutazione , Milan, Feltrinelli, 2001, pp. 146-152.
31.08.2023 à 21:25
Hommage à Mario Tronti : le Royaume est là, si nous le voulons
L'Autre Quotidien

Texte intégral (5186 mots)
Je t'aimais, maintenant j'y vais
J'étais communiste
J'avais un rêve, un espoir
Adieu amour, adieu
(Baustelle, L'homme du siècle ) .
Mario Tronti est décédé le 7 août, à son domicile de Ferentillo, à l'âge de 92 ans ; un « âge de patriarches » a-t-il déclaré à l'occasion du 90e anniversaire d'Ingrao [1] , tout comme il a dû le dire plus tard de lui-même avec une pincée de son ironie habituelle, à la fois aiguë et douce.
Pour une grande partie du petit et du grand public, son nom est lié à son premier et jeune livre, Ouvriers et Capital, publié chez Einaudi en 1966 [2] , qui fut plus tard défini comme « la bible de l'opéraïsme ». Un livre qui, quelle qu'en soit la manière dont on veut le juger, a marqué, à proximité de 68, et surtout des grandes luttes ouvrières de 1969, une grande innovation mais aussi une rupture théorique forte dans le marxisme de la seconde moitié du XXe siècle, ce siècle dur et difficile auquel il est toujours resté fidèle.
Le premier ouvrage
Dans ces pages, Tronti a réalisé ce qu'on appelle la « révolution copernicienne » dans l'interprétation du conflit entre le capital et le travail : vient d' abord le sujet ouvrier et ses luttes, après le capital et son développement ; donc la tactique va au parti, la stratégie va au mouvement ouvrier, précisément ce qu'il appelle dans l'un des passages les plus célèbres et les plus lourds de conséquences la « stratégie du refus ».
Il y avait déjà, à y regarder de plus près, dans ce renversement de perspective, un aspect du radicalisme évangélique auquel Tronti fera plus tard directement référence : les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Conflit extrêmement radical, expression organisée de la force des opprimés et pourtant conflit sans violence : « Le conflit est connaissance. (…) La force est le négatif de la résistance, la violence est le positif de l'agression. (…) La grève est une décision collective par excellence, une action qui interrompt les activités, c'est un dire non, non à la poursuite du travail, une lutte non-violente, un conflit sans guerre. Le conflit de classes comme alternative civilisationnelle à la guerre de massacre, car ce sont « les formes de lutte [qui] révèlent les objectifs du mouvement » [3] .
Un communisme hétérodoxe
Workers and Capital a été un véritable choc également par son langage, son style et ses références théoriques : autant de matériaux étrangers à l'orthodoxie communiste de l'époque. À une culture militante qui en Italie était encore empêtrée dans le “Diamat” de Staline (soit une version ultra-simpliste du matérialisme dialectique, pour résumer) combiné à la triade Croce-Gentile-Gramsci, Mario Tronti opposait l'impact prodigieux de la pensée négative et de la culture de crise.
Nietzsche et Weber furent introduits à grand bruit dans les murs des usines, les notes de Mahler «entre un adagio désespéré et un bientôt majestueux» [4] accompagnèrent la marche des grévistes et la grande littérature de la crise, de Musil à Mann en passant par Dostoïevski imprègne même la réflexion sur le parti. Tous les concepts de l’économie politique sont devenus source de conflits et ceux-ci, sortis de l’usine, sont venus comme une lave incandescente investir la société entière. La revue culturelle du Parti communiste italien, Rinascita, n’a aimé ni l’idée ni le livre.
Mais l’histoire théorico-militante de Mario Tronti ne s’arrête certainement pas avec ce livre. Dans ces lignes, je voudrais plutôt rappeler le Tronti des dernières décennies, celui qui, après la phase de « l'autonomie du politique » des années 1970 [5] , étape importante et généralement mal comprise, s'est aventuré dans l'étude de théologie politique, d'abord expérimentée dans une union inédite et audacieuse de la théorie développée par Carl Schmitt avec la tradition marxiste - "Karl und Carl", comme le dit un chapitre de son ouvrage “La politique au coucher du soleil” - puis dans la culture d'une spiritualité qui s'enfonce dans les profondeurs et les hauteurs de l'Écriture, des Pères de l'Église et de la littérature monastique.
Et enfin, le communisme messianique de Walter Benjamin, l'insurrectionnisme eschatologique d'Ernst Bloch et le saint Paul apocalyptique-révolutionnaire de Jacob Taubes, tous appelés par Tronti à apporter une correction forte à la fois à l'apocalypticisme réactionnaire exprimé par la théologie politique de Schmitt et à l'aridité du matérialisme, qu'il soit dialectique ou historique.
En fait, c'est lors d'un dialogue public que nous avons eu il y a quelques années dans un petit théâtre romain que Tronti a dit, en prononçant bien les mots, qu'« en fin de compte, le matérialisme est une chose pour les bourgeois ». C’est dans cet horizon, je crois, qu’il faut comprendre sa définition de « révolutionnaire conservateur ». Réaliste oui, matérialiste non.
Échec de la révolution et théologie politique
La théologie politique lui est certes venue de la lecture précoce que Tronti faisait, parmi les premiers à gauche, de Schmitt et des grands conservateurs, mais elle concernait aussi une évaluation plus subtile d'ordre existentiel, personnel : il fallait « corriger » le sens de l'histoire jusqu'à la subjectivité, puisque « toute la Modernité était à l'opposé de l'Annonce » [6] .
En 1980, dans un débat sur le terrorisme, répondant à Angelo Bolaffi, qui affirmait que la limite de la gauche résidait dans le fait qu'elle avait produit une théologie de la révolution, il répondit, avec une de ses réponses classiques et cinglantes : « C'est justement parce qu'il y a « eu l'échec de la révolution en Occident, la révolution est devenue théologie » [7] . Ou du moins, c'en était devenu un pour lui. La défaite, l’échec, voire l’humiliation, sont devenus pleinement des catégories théologico-politiques puis transformés en autre chose .
Pour Tronti des années entre les deux millénaires, la dimension théologique, de symptôme et de tentative de réponse à une catastrophe historique, devait correspondre au besoin de résistance subjective, exprimé paradoxalement à travers un approfondissement de la crise. Parce que c'est le christianisme lui-même, l'Évangile, qui est « krisis», dans son vrai sens de choix et de décision. Crise de subjectivité, crise de l'histoire, crise du « monde ». Mais surtout une crise révolutionnaire parce qu'elle a été vécue pour et avec les plus petits, les expropriés, les opprimés, les humiliés et les offensés : la partie de l'humanité à laquelle Tronti s'est toujours senti intimement « appartenir », avec son point de vue partisan qu'il Il faut toujours lutter et encore contre la totalité de « ce monde » tel qu'il est : injuste, violent, égoïste, nihiliste, individualiste.
Le capitalisme pour Tronti n'était plus seulement un mode de production haineux, défendu par un système politico-idéologique tout aussi haineux, mais une construction anthropologique vertigineuse, une idée et une pratique destructrice de la Terre et de la Personne qui campait dans les âmes, corrompant l'âme. esprits, sapant leur capacité à discerner le bien du mal. Il ne s’agissait plus pour lui d’une crise du mode de production ou des rapports de classes, ni de celle de la politique comme gestion des affaires de l’État, mais d’une « crise de civilisation » verticale.
Le problème du marxisme, disait Tronti, était précisément de ne pas avoir été capable de proposer une anthropologie à la hauteur de son époque et du défi qu'elle représentait. Et c'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre sa déploration constante, comme une blessure ouverte, du choc qu'il considérait comme absurde et qui existait pourtant entre le mouvement communiste et le christianisme, arrivant à des conclusions très proches de celles du Père Turoldo, un homme , moine, partisan et poète pour lequel nous partagions une grande passion, qui écrivait un jour : « le communisme pourrait être la véritable révolution des pauvres ; à une condition, que la loi de la pauvreté ne soit pas trahie. Au lieu de cela, tout a lamentablement échoué. Le “rerum” de “Cupido” (Ndt : fait référence à la phrase de Pline le jeune : “omnium rerum cupido languescit, quum facilis occasio est”, en français : “Tous les désirs s’affaiblissent lorsqu’on a facilement l’occasion de les satisfaire” n'a pas été pris en compte, de la possibilité du péché (...) on pensait créer un communisme quelle que soit la force de la religion, alors que l'essence de la vraie religion est de "se garder pur de ce monde" [ 8 ] .
Mais l'hypothèse du paradigme théologico-politique a aussi permis la révélation d'une vérité indicible pour de nombreux militants de gauche : si avec Schmitt on supposait que « tous les concepts de la doctrine de l'État sont des concepts théologiques sécularisés », alors, selon suggestion de Walter Benjamin, il est également vrai que « tous les concepts de la doctrine révolutionnaire sont des concepts théologiques sécularisés », comme nous l'écrivions dans un texte de 2020 intitulé Xeniteia. Contemplation et combat [9] .
Cet article était censé ouvrir un petit chantier de recherche à travers lequel, avec la contribution d'autres amis, nous voulions tenter de repenser le lien « originel » entre christianisme et communisme, notamment à travers cette tradition monastique qui a profondément inspiré la réflexion trontienne des derniers temps. décennies et sa propre vie, traversée par l'amitié avec le moine de l’ordre camaldule Dom Benedetto Calati et avec Enzo Bianchi ainsi que leurs communautés.
Le communisme comme forme de vie
« Original » car, nous en avons beaucoup parlé ces dernières années, Tronti était finalement convaincu que le communisme n'était pas réductible au marxisme, qui reste néanmoins un épisode important, mais qu'il avait une profondeur historique plus large et une dimension transcendante magnétique, indiquant une "forme de vie" que l'on contemple dans les lignes lumineuses des Actes des Apôtres et que l'on peut ensuite suivre au fil de la contre-histoire des pauvres et des opprimés : "Que l'idée du communisme ait à voir avec le christianisme primitif est un fait que le mouvement communiste du XXe siècle n’a pas envisagé. C'est une lacune grave" [10] . Et c'est d'ailleurs peut-être le seul moyen de sauver l'esprit du communisme de l'oubli annihilant auquel « ce monde », l'histoire des vainqueurs, destine ses antagonistes.
Mais donc, si d'une part la théologie politique concerne les catégories fondamentales de la politique moderne, de l'État et des conflits de pouvoir - disons, pour simplifier, les catégories du « que faire ? - d'autre part, révéler les racines théologiques du communisme signifie tourner notre regard vers le thème de la spiritualité, c'est-à-dire vers « comment le faire ? », ou vers « comment vivre » ici et maintenant, peut-être aussi vaincu que Tronti lui-même l’a admis sans hésitation, mais sans jamais abjurer l'ancienne promesse de libération.
Bref, le thème de la spiritualité comme forme de vie, puisque selon Tronti c'était le communisme pour beaucoup de sa génération : une manière d'être avant même une doctrine ou le rêve d'une institution alternative. Dans un échange de lettres que nous avions autour d'un de mes textes sur la spiritualité [11] , il écrivait : « Fondamentalement, d'une certaine manière, la civitas Dei (Ndt : la Cité de Dieu) , contrairement à la civitas hominis (Ndt : la Cité des hommes), attend toujours là la force de l'esprit qui entend y parvenir. L’homme nouveau est alors cette force proactive génératrice, et non le produit final de la réalisation. »
Encore des renversements de perspective : d'abord la force de l'esprit, puis la réalisation ; d'abord l'homme nouveau, puis les structures. Le contraire de ce qu’avaient fait les révolutions du passé. Dans lequel, au début, dit Turoldo, il y a toujours la puissante présence désorganisatrice de l'Esprit, mais les révolutionnaires ne savaient pas ou ne voulaient pas la suivre et se sont donc perdus en croyant que l'homme nouveau devait être le résultat des unités de production, comme le chantait le CSI (Consortium des Musiciens Indépendants) : « Rêve Technologique Bolchevique/Mécanique Mystique Athée/Machine Automatique-pas d'âme » (CSI, Unité de Production, 1998 ) .
Cultiver la spiritualité
En réalité, si l'on s'en tient à ce qu'écrit Tronti, la théologie politique elle-même appartient au passé [12] , il faut l'étudier et l'utiliser, pour saisir le lien entre « politique et transcendance » [13] , mais sans se faire d'illusions sur le présent, donc que ce qui reste à faire de toute urgence est la culture d'une spiritualité forte et peut-être tournée vers un autre continent, celui du « mysticisme et de la politique » que le regretté Tronti a souvent rappelé, également à travers des auteurs contemporains comme le théologien indo-catalan Raimon Panikkar, qu’il avait rencontré par l’intermédiaire de sa fille Antonia qui a une profonde connaissance de Panikkar [14] .
Il le cite par exemple lors d'une conférence tenue à Rome en 2006, dans laquelle il tentait d'expliquer ce qu'était pour lui la « spiritualité » : « La spiritualité a une longue histoire. Cela nous vient de loin. Panikkar parle de ce troisième sens qui est – dit-il – comme une lueur plus ou moins claire de conscience que dans la vie il y a quelque chose de plus que ce qui est perçu par les sens ou prévu par l'esprit. (…) ce n'est pas une extension horizontale, vers ce qu'on ne connaît pas encore ou que l'on n'est pas encore, c'est plutôt un saut vertical vers une autre dimension de la réalité (…) Rester sur terre en montant, et ça n'est pas plier sous quelque chose. Quelle est la condition pour être libre (...) Et pourtant cette conflictualité de la spiritualité - c'est de cela dont je parle. [15] .
Au lieu de continuer à étendre de manière nihiliste la sécularisation des concepts théologiques, Tronti semblait engagé dans la direction opposée, c'est-à-dire dans la rethéologisation des concepts sécularisés du politique, comme l'a souligné à juste titre le philosophe et théologien suédois Mårten Björk [16 ] .
D'autre part, c'est Tronti lui-même qui, en 1992, dans un essai intitulé de manière significative « Au-delà de l'ami-ennemi », écrivait : « Devrions-nous, en tant que philosophie du futur, assumer le projet d'une re-théologisation des concepts sécularisés ? C’est un problème de réflexion sur la politique, mais aussi de pratique de la politique. Peut-être devrions-nous revenir à la distinction entre « nouveaux cieux » et « nouvelles terres ». Il faut se donner le courage de proposer à nouveau le « royaume » utopique d'un autre monde d'hommes et pour les hommes » [17] .
Les temps de Bailamme
En fait, l'un des laboratoires de pensée les plus intéressants que Tronti a contribué à animer entre les années 80 et 90 du siècle dernier, avec des croyants et des non-croyants, était celui de la revue Bailamme qui portait comme sous-titre programmatique non " revue de théologie et politique » mais de « revue de spiritualité et politique » [18] .
Vous apprécierez la différence. Le “et” qui est placé là, au milieu, est important. Il indique une possible conjonction mais aussi un possible conflit, une tension qui n'est jamais complètement résoluble et qui, précisément pour cette raison, est capable de générer une pensée alternative et même d'orienter une vie. et en lui donnant une forme [19] .
Il existe donc deux camps : non opposés, plutôt étroitement liés et pourtant différents. D'une part celle théologico-politique des recherches sur le pouvoir et les formes de conflit qui l'entourent, sans jamais oublier la dimension transcendante qui agite et informe tout, de l'autre celle de la spiritualité comme « armure » de la subjectivité contre le culte du l'ego annoncé par le libéralisme existentiel, comme l'élan de la liberté de l'esprit dans et contre le désert mondain, comme celui de l'espoir contre tout espoir qui déchire jusqu'au plus profond, comme l'utopie concrète d'un autre monde, celui qui « devient possible » (...) seulement lorsque cela devient nécessaire" [20] . C'est tout ce dont parle son dernier grand livre, auquel il tenait beaucoup, De l'esprit libre, dans lequel il revendique le choix d'une spiritualité «non pas pour lui-même, mais contre le monde (…). Être en paix avec soi-même, c'est entrer en guerre contre le monde» [21] .
Et en parlant d'espérances, dans l'un de ses plus beaux textes récemment écrits [22] , Tronti a enfin donné sa définition de la théologie politique, qui, je crois, mérite d'être rappelée et méditée ici : « Dans le Magnificat on lit : renverser les puissants, élever les humbles. Voici le théologique. Comment faire tomber les puissants, comment élever les humbles. Voici le politique. » Encore une fois : l'Esprit inspire et guide, l'homme politique suit et tente d'œuvrer à la réalisation du royaume.
Théologie de la libération
Tronti me disait qu’il nous fallait approfondir nos connaissances sur la théologie de la libération car, écrivait-il, « il y a effectivement des combats là-bas ». Et donc : contemplation – en regardant les pères du désert – et combat – en regardant les barricades évangéliques du Sud du monde.
Son doute, que je partage, était de savoir si un discours comme celui de la théologie de la libération pouvait vraiment être implanté ici, en Occident, où les pauvres, les derniers, en tant que sujets, sont « désormais non seulement méconnus, mais aussi méconnaissables, pour “la Cause” (du communisme), comme on disait autrefois.»
Cette invisibilité de ces derniers, qu'il commença, je crois, à reconnaître grâce à l'intense amitié qu'il entretenait avec le jésuite Pio Parisi, le toucha profondément [23] . Il faut pouvoir « voir au-delà » , justement, et dans son dernier discours public de juin dernier, paraphrasant le Jésus de L’Évangile selon Saint-Jean 9.39, il exprimait ainsi son espérance, qui était aussi une incitation au combat : « celui qui ne voit pas verra , celui qui voit sera aveuglé ». [24] .
Gigi Roggero, qui était l'organisatrice de cette dernière rencontre, écrit que dans cette phrase il y a « un Jésus qui ne tend pas l'autre joue. Un Jésus très benjaminien, qui se bat pour venger le passé. Un Jésus qui divise le monde en deux. Riches et pauvres, pour le christianisme primitif. Travailleurs et capital, pour nous. Ami et ennemi, dans le lexique du réalisme" [25] .
Je crois qu'un aspect chiliastique résonne dans ce commentaire qui est effectivement présent chez un certain Tronti – aspect que, je dois le dire, j'ai moi-même cultivé depuis longtemps – et donc une impatience, donc une tentation, pour laquelle la division finale n'est pas, comme c'est le cas dans l'Évangile et comme le dit effectivement Walter Benjamin [26] , entre les mains du Messie, mais il est sécularisé et donc il doit être fait ici et maintenant de nos propres mains, et tant pis, si avec l'ivraie, des blés aussi sont arrachés.
Le mystère d'une vie
Et pourtant Mario Tronti, comme toute vie humaine, est un mystère, et il y avait aussi en lui une autre tension, un corps à corps avec la Parole, à travers laquelle je crois qu'il a ressenti que la révolution dernière, vraie et définitive, la grande division eschatologique , la "rupture totale", comme le disait Bonhoeffer, n'est pas à la portée de nos possibilités et qu'il nous appartient maintenant peut-être d'agiter ce "feu dans l'esprit", qui nous a toujours conduit au combat, pour le faire brûler dans le cœur, tandis que nous tournons notre regard vers le haut, nous efforçant, certainement, de hâter l'avènement du royaume ; mais c'est une précipitation qui ne correspond pas à notre imposition au monde, à une décharge de volonté de puissance, mais plutôt à la force et à l'intensité de notre désir.
Dans cet article que nous avons écrit ensemble, à la phrase "un royaume, il nous a été annoncé, qui est déjà parmi nous", c'est sa main qui a ajouté "si nous le voulons". C'est quelque chose qui a à voir avec une conversion du cœur et un désir de communion dans l'esprit, d'où découle une politique .
C'est du moins ainsi que je comprends les paroles qu'il m'a écrites il y a deux ans : « Si je comprends bien, le sens du voyage est configuré dans le sens du retour pour combiner, dans et contre toutes les répliques de l'histoire, de la liberté et du communisme. Liberté de l'esprit pour résister au monde, communisme des esprits pour monter au royaume." Le choix du verbe est intéressant : « monter ». Mais c’est juste, parce que Son royaume n’est pas de « ce monde » et que la direction de la liberté est vers le haut.
Il y aurait encore tant de choses à dire et le moment viendra, mais maintenant, cher Mario, pendant que nous autres continuons à regarder les choses « per speculum in aenigmate » (Ndt : de manière confuse, inversée, comme dans un miroir) et nous préparons à mordre encore la poussière, peut-être que désormais vous voyez, savez et aimez déjà « facie ad faciem » dans la communion des esprits. Ainsi soit-il.
Marcello Tarì
Notes
[1] « L'époque des patriarches » dans Mario Tronti, On ne peut pas l'accepter , édité par Pasquale Serra, Ediesse, Rome 2009, pp. 133-141.
[2] Récemment réédité par la maison d'édition DeriveApprodi.
[3] M. Tronti, La politique au coucher du soleil , Einaudi, Turin 1998, pp.58-59.
[4] M. Tronti, Politique et destin , Luca Sossella, Rome 2006, p.19.
[5] M. Tronti, Sur l'autonomie de l'homme politique, Feltrinelli, Milan 1977.
[6] M. Tronti, La politique au coucher du soleil , cit., p.10
[7] Horst Mahler, Pour la critique du terrorisme . Avec une comparaison entre G. Amato, A. Bolaffi, S. Rodotà, M. Tronti, De Donato, Bari 1980, p.116.
[8] David Maria Turoldo, La prophétie de la pauvreté , Servitium, Milan 2012, pp. 31-32.
[9] Le texte a été publié sur deux sites qui ne sont plus en ligne, dellospiritolibero.it et quieora.ink, et a eu un vaste retentissement international.
[10] « Essai sous forme d'entretien avec Mario Tronti » dans La révolution en exil. Écrits sur Mario Tronti , édités par Andrea Cerutti et Giulia Dettori, Quodlibet, Macerata 2021, p.349. Ce livre a été publié à l'occasion du 90ème anniversaire de Tronti.
[11] Marcello Tarì, Vient d'abord l'esprit ,https://www.altraparolarivista.it/2022/01/22/prima-viene-lo-spirito-marcello-tari/ .
[12] M. Tronti, « Nostro Maestro Eckhart, da Agostino » dans M. Tronti, Cenni di Castella , Cadmo, Fiesole 2001. « Il y avait une théologie politique. Il n'y a pas de théologie politique. En parcourant et en utilisant consciemment les catégories du politique comme concepts théologiques sécularisés, beaucoup de choses ont été apprises. Mais c'est aussi une saison passée. C'est révolu depuis longtemps", pp.161-162.
[13] « Pourquoi la théologie politique » dans M. Tronti, De l'extrême possible , édité par Pasquale Serra, Ediesse, Rome 2011, pp.83-87, p.86.
[14] Il est utile de signaler ici la conférence que Tronti a tenue à l'église de San Gregorio al Celio, le 9 mai 2021, à l'occasion des « Dialogues monastiques » organisés par Antonia Tronti et Don Mario Zanotti et qui, cette année-là, concernaient l'œuvre de Raimon. livre Panikkar, Simplicité bénie. Le défi de se découvrir moine , Cittadella, Assise 2007. La conférence, intitulée "Le moine entre histoire et contre-histoire", peut être écoutée à cette adressehttps://www.monasterosangrerio.it/it/registrazioni .
[15] « L'esprit qui bouleverse le monde » (16 novembre 206) dans M. Tronti, Le démon de la politique. Anthologie d'écrits (1958-2013) , édité par M. Cavalleri, M. Filippini et JMH Mascat, il Mulino, Bologne 2017, p.618 et p.619. Ce texte a été recueilli par Tronti, sous un titre différent, dans son Sur l'esprit libre. Fragments de vie et de pensée, Il Saggiatore, Milan 2015.
[16] Mårten Björk, « La rethéologisation du politique. Mario Tronti et la lutte contre l'histoire » dans La révolution en exil , cit., pp.231-248.
[17] M. Tronti, Le dos tourné vers l'avenir. Pour un autre dictionnaire politique, Editori Riuniti, Rome 1992, p.26.
[18] Plusieurs de ses articles publiés dans Bailamme ont ensuite été réédités dans Avec son dos vers le futur.
[19] Il m'écrit à ce propos «Nous insistons sur ce 'et' entre politique et spiritualité».
[20] M. Tronti, De l'esprit libre , cit., p.219.
[21] Idem, p. 226-227.
[22] M. Tronti, Espoirs désespérés
[23] Tronti a parlé à plusieurs reprises de Pio Parisi en relation avec les "invisibles", par exemple dans l'Introduction au volume, édité par le Centro Studi per la Riforma dello Stato, La théologie de saint Paul peut-elle intéresser l'homme politique ? , Franco Angeli, Milan 2021. Di Parisi et un autre jésuite, Pino Stancari, racontent ici le P. 19: «Je les appelle les existants invisibles (…) les gens qu'on ne voit pas sont les seuls avec qui cela vaut la peine d'avoir une relation d'échange humain, car tous ceux qu'on voit sont perdus». À propos des «invisibles», Tronti a également déclaré: «Ce sont des personnalités en conflit avec le monde et que le monde fait payer en ne les connaissant pas ou en ne les reconnaissant pas. Les dictatures les frappent durement. Les démocraties les ignorent subtilement», dans M. Tronti, Non si puòccetto, cit., p.36. Personnellement, j'ai pris conscience de l'expérience de Pio Parisi et de Pino Stancari à travers une autre «invisible», Maria Luisa Matera.
[24] C'est le dialogue entre Tronti et le philosophe Adelino Zanini qui a eu lieu à l'occasion du Festival DeriveApprodi en juin dernier. La vidéo de la réunion, que je vous recommande vivement de regarder, est disponible ici :https://www.machina-deriveapprodi.com/post/la-politica-al-tramonto-dialogo-tra-adelino-zanini-e-mario-tronti .
[25] Gigi Roggero, En guerre contre le monde. Pour Mario Tronti, https://www.machina-deriveapprodi.com/post/in-guerra-col-mondo-per-mario-tronti .
[26] «Seul le Messie lui-même réalise tout événement historique et précisément dans le sens où lui seul rachète, complète et produit le rapport entre celui-ci et le messianique lui-même». C'est la première et brutale phrase du « Fragment théologico-politique » de Walter Benjamin, Le concept de critique dans le romantisme allemand. Écrits 1919-1922 , Einaudi, Turin 1982, p.171.
Auteur : Marcello Tarì est auteur et traducteur. Il s'est occupé des mouvements antagonistes italiens et de la théorie politique. Ses volumes sont : Ice Era Thin , DeriveApprodi 2012 et Non Existence the Unhappy Revolution , DeriveApprodi 2017. Ces dernières années, ses recherches portent sur la spiritualité et la politique avec un radicalisme évangélique. Avec son ami et professeur Mario Tronti, il a animé la rubrique Xeniteia de 2020 à 2022 . Contemplation et combat .
02.07.2023 à 12:37
Les Lumières bourgeoises et l'élimination de la nuit, par Robert Kurz
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4455 mots)

Les classes révolutionnaires, au moment de l'action, ont conscience de faire éclater le continuum de l'histoire. La Grande Révolution introduisit un nouveau calendrier. Le jour qui inaugure un calendrier nouveau fonctionne comme une accélérateur historique. Et c'est au fond le même jour qui revient sans cesse sous la forme des jours de fête, qui sont des jours de commémoration. Les calendriers ne mesurent donc pas le temps comme le font les horloges. Ils sont les monuments d'une conscience historique dont toute trace semble avoir disparu en Europe depuis cent ans, et qui transparaît encore dans un épisode de la révolution de Juillet 1830. Au soir du premier jour de combat, on vit en plusieurs endroits de Paris, au même moment et sans concertation, des gens tirer sur des horloges. Le rejet le plus explicite du temps mécanique de la pendule se produisit lors de la révolution des "trois glorieuses" du 27 au 29 juillet 1830. Auguste Barthelemy et Joseph Mery, deux Marseillais qui vivaient à Paris, furent témoins de cet événement. Il leur inspira un poème dont voici un extrait:
“Ah ! sur Paris encor qu’un beau soleil demeure ;
Qui le croirait ! on dit qu’irrités contre l’heure,
De nouveaux Josués, au pied de chaque tour,
Tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour".
Dans une note, les deux poètes ajoutaient: “ C’est un trait unique dans l’histoire d’une insurrection ; c’est le seul acte de vandalisme exercé par le peuple contre les monuments publics, et quel vandalisme ! qu’il exprime bien la situation des esprits au 28 au soir ! avec quelle rage on regardait tomber l’ombre, et l’impassible aiguille, marcher vers la nuit comme dans les jours ordinaires ! Ce qu’il y a de plus singulier dans cet épisode, c’est qu’on a pu le remarquer à la même heure, dans différents quartiers ; ce ne fut pas une idée isolée, un caprice d’exception, mais un sentiment à peu près général ". (...)
Walter Benjamin, " Le concept d'Histoire " in Oeuvres, Paris, Folio, p. 440
Aujourd'hui encore, plus de deux cents ans plus tard, nous sommes éblouis par la splendeur de l’Aufklärung, des Lumières bourgeoises. L'histoire de la modernisation s'enivre de métaphores qui évoquent la lumière. Le soleil éclatant de la raison est cru capable de percer les ténèbres de la superstition et de rendre visible le désordre du monde, pour enfin façonner la société selon des critères rationnels.
Les ténèbres ne sont pas perçues comme l'envers de la vérité, mais comme le royaume du diable. Même les humanistes de la Renaissance se sont opposés à leurs ennemis en les qualifiant d'hommes des ténèbres. Goethe aurait crié sur son lit de mort en 1832 : “Mehr licht ! Plus de lumière !”. Un classique ne pouvait pas quitter la scène de manière plus élégante !
Les romantiques se défendaient contre la froide lumière de la raison en se tournant synthétiquement vers les religions. Face à la rationalité abstraite, ils prônaient une irrationalité non moins abstraite. Plutôt que de s’enivrer de métaphores inspirées de la lumière, c’est de l’obscurité qu’ils se saoulaient, comme Novalis dans son « Hymne à la nuit ».
Mais ce simple retournement de la symbolique de l’Aufklärung passait en fait à côté du problème. Les romantiques n’ont nullement dépassé un unilatéralisme jugé suspect, ils ont juste occupé l’autre pôle de la modernisation, devenant alors véritablement les zélateurs « obscurantistes » d’une pensée réactionnaire et cléricale.
Mais la symbolique de la modernisation peut être critiquée par un autre biais, en dénonçant la déraison paradoxale de la raison capitaliste elle-même. Car, en effet, les métaphores modernes de la lumière sentent le brûlé du mysticisme. Un au-delà, source de lumière éclatante, comme le représente la raison moderne, évoque la description des empires des anges, éclairés par l’éclat divin ou les systèmes religieux de l’Extrême-Orient, d’où nous vient le concept de « l’illumination ». Même si la lumière de la raison moderne est censée être d’ici- bas, elle a tout de même un caractère sacrément transcendantal. L’éclat céleste d’un Dieu tout simplement impénétrable s’est sécularisé dans la banalité monstrueuse de la fin en soi capitaliste, dont la cabale de la matière est l’accumulation insensée de la valeur économique. Il ne s’agit pas là de raison, mais d’un non-sens supérieur ; et ce qui brille est l’éclat d’une absurdité qui blesse les yeux.
Héritiers des Lumières
La raison irrationnelle de l’Aufklärung veut tout mettre en lumière. Mais cette lumière n’est pas seulement un symbole appartenant au monde de la pensée, elle a aussi une signification socio-économique réelle. Et c’est justement ce qui a été fatal au marxisme et au mouvement ouvrier : s’être sentis les véritables héritiers de l’Aufklärung et de sa métaphore sociale de la lumière. L’Internationale, l’hymne du marxisme, dit du merveilleux avenir socialiste que « le soleil [y] brillera toujours ». Un caricaturiste allemand a pris cette phrase au mot, montrant « l’empire de la liberté » où des hommes en sueur lèvent la tête vers le soleil et soupirent : « voilà trois ans qu’il brille et ne veut plus se coucher ».
Ce n’est pas une simple boutade. Dans un certain sens, la modernisation a véritablement fait « de la nuit, le jour ». En Angleterre qui, comme on sait, a été la pionnière de l’industrialisation, l’éclairage au gaz a été introduit au début du XIXème siècle pour se propager par la suite dans toute l’Europe. D’ici la fin de ce même siècle, il avait déjà été remplacé par l’électricité. On sait depuis longtemps que la confusion entre jour et nuit due à la lumière froide des soleils artificiels perturbe le rythme biologique des humains et provoque des troubles psychiques et physiques. Et pourtant, il n’y aura bientôt plus aucun refuge contre ce violent éclairage planétaire.
Karl Marx, lui-même héritier des Lumières, avait très bien constaté que l’activité sans répit de la production capitaliste était « démesurée ». Cette démesure ne peut en principe tolérer aucun temps obscur. Parce que le temps obscur est aussi celui du repos, de la passivité et de la contemplation. Le capitalisme exige l’extension de son activité jusqu’aux dernières limites physiques et biologiques. En ce qui concerne le temps, ces limites sont déterminées par la rotation de la terre sur elle-même, donc par les 24 heures de la journée astronomique ayant une partie claire (face au soleil) et une partie obscure (détournée du soleil). La tendance du capitalisme est d’étendre la part active à la journée astronomique dans sa totalité. La partie nocturne dérange cette tendance. Ainsi production, circulation et distribution des marchandises doivent fonctionner 24h/24, parce que « time is money ». Le concept de « travail abstrait » [2]* dans la production moderne de marchandises n’inclut donc pas seulement son extension absolue, mais aussi son abstraction astronomique : un processus analogue au changement des mesures de l’espace.
De nouvelles mesures pour l'espace et le temps

Le système métrique a été instauré en 1795 par la Révolution française et s’est propagé à la même vitesse que l’éclairage au gaz. Les mesures de l’espace qui se basaient sur des partie du corps humain (pied, pouce, etc.), aussi différenciées et multiples que les cultures humaines, ont été remplacées par la mesure astronomique abstraite du mètre qui se veut correspondre au quarante millionième de la circonférence de la terre. Cette unification de la mesure de l’espace correspondait à la représentation du monde de la physique newtonienne qui devait elle-même inspirer l’économie mécaniste du marché moderne, analysée et prônée par Adam Smith (1732-1790). La mise en marche de la machine mondiale économique du capital était corrélée à la représentation de l’univers et de la nature comme une machine grande et unique et les mesures astronomiques devenaient leur code commun. Cela ne concerne pas seulement l’espace, mais aussi le temps. Au mètre astronomique, mesure de l’espace abstrait, correspond l’heure astronomique, la mesure du temps abstrait; et elles sont aussi les mesures de la production capitaliste de marchandises.
C’est ce temps abstrait qui a permis d’étendre la journée du « travail abstrait » à la nuit et de grignoter le temps de repos. Le temps abstrait pouvait être détaché des choses et des conditions concrètes. La plupart des anciennes mesures de temps, telles que les sabliers ou les horloges à eau, ne disaient pas
« l’heure qu’il est », mais étaient réglées sur des processus concrets, pour mesurer leur« durée. On pourrait les comparer à ces petits gadgets qui sonnent quand l’œuf est cuit. Ici la quantité du temps n’est pas abstraite, mais orientée sur une certaine qualité. Le temps astronomique du « travail abstrait » est au contraire détaché de toute qualité. La différence devient évidente quand, par exemple, on lit dans des documents du Moyen Âge que le temps de travail des serfs sur des grands domaines durait « de l’aube à midi ». Cela veut dire que le temps de travail n’était pas seulement plus court dans l’absolu, mais aussi relativement, car il variait selon les saisons et était plus court en hiver qu’en été. L’heure astronomique abstraite, par contre, a permis de fixer le début du travail « à six heures », indépendamment de la saison et du rythme biologique des humains.
Le temps des montres

C’est pourquoi le capitalisme est aussi l’époque des réveils, ces montres qui arrachent les gens de leur sommeil par un signal strident pour les chasser vers leur poste de travail, éclairé artificiellement. Et une fois que le début du travail a été avancé dans la nuit, on a pu, à l’autre bout, y repousser aussi la fin du travail. Ce changement a aussi un caractère esthétique. En même temps que la rationalité économique abstraite « dématérialise » en quelque sorte l’environnement, parce que la matière et son contexte doivent se soumettre aux critères de la rentabilité, elle le dé-dimensionne et le dé-proportionne aussi. Si les bâtisses anciennes nous paraissent parfois plus belles et plus agréables que les modernes et si nous constatons que par rapport aux bâtiments « utilitaristes » d’aujourd’hui, elles ont quelque chose d’irrégulier, c’est parce qu’elles ont été construites en utilisant les mesures basées sur le corps humain et que leurs formes sont adaptées à leur environnement. L’architecture moderne, par contre, utilise des mesures d’espace astronomiques et des formes « dé-contextualisées », détachées du milieu. La même chose est vraie pour le temps. L’architecture moderne du temps également est dé-proportionnée et dé-contextualisée. Non seulement l’espace est devenu moche, mais le temps aussi.
Au XVIIIème siècle et au début du XIXème, la prolongation aussi bien absolue que relative du temps de travail par l’introduction de l’heure astronomique abstraite était encore ressentie comme une torture. Les gens se sont longtemps défendus désespérément contre le travail de nuit lié à l’industrialisation. Il était considéré comme immoral de travailler avant l’aube ou après le coucher du soleil. Quand, au Moyen Âge, des artisans devaient exceptionnellement, pour des raisons de dates, travailler la nuit, il fallait les nourrir copieusement et les rémunérer comme des princes. Le travail de nuit était un cas rare. C’est un des grands « mérites » du capitalisme que d’avoir réussi à faire de la torture du temps la mesure normale de l’activité humaine.
La diminution du temps de travail absolu après les débuts du capitalisme n’y a rien changé non plus. Au contraire, au XXème siècle, le travail en roulement s’est étendu de plus en plus. A l’aide d’un fonctionnement par deux ou trois équipes, les machines doivent si possible tourner sans arrêt, interrompues seulement par de courtes pauses pour réglage, entretien et nettoyage. De même, le temps d’ouverture des magasins et supermarchés doit se rapprocher le plus possible des 24 heures. Dans nombre de pays, comme par exemple les Etats-Unis, il n’y a plus aucune réglementation pour régir la fermeture des magasins et sur beaucoup de boutiques trône le panneau « ouvert 24h/24 ». Depuis que la technologie de communication microélectronique a globalisé les flux financiers, la journée monétaire d’un hémisphère se prolonge directement dans celle de l’autre. « Les marchés financiers ne dorment jamais », dit la publicité d’une banque japonaise.
Dormir moins?

La lumière de la raison moderne, c’est l’éclairage du travail de nuit. Parallèlement à la globalisation de la concurrence, l’impératif social externe se mue pour l’individu en coercition intériorisée. De même que la nuit, le sommeil devient son ennemi, parce qu’en dormant, il rate des chances et se trouve livré sans défense aux attaques de l’Autre. Le sommeil de l’homme de l’économie marchande devient court et léger comme celui d’une bête sauvage, et ceci proportionnellement à sa « volonté de réussite ». Il existe des séminaires pour managers où l’on peut apprendre des méthodes de minimisation du sommeil et certaines écoles de self management prétendent aujourd’hui sérieusement : «L’homme d’affaires idéal ne dort jamais», exactement comme les marchés financiers !
Mais la soumission des hommes au « travail abstrait » et à sa mesure de temps astronomique n’est pas possible sans un contrôle total. Ce contrôle global exige une surveillance et une observation générales qui nécessitent la lumière, un peu comme au cours d’un interrogatoire, le policier braque une lampe sur le visage de son prisonnier. Ce n’est pas pour rien que le mot Aufklärung a en allemand un second sens: la reconnaissance de l’ennemi. Une société où chacun est l’ennemi de l’autre et de lui-même – parce que tous doivent servir le même Dieu sécularisé du Capital – devient par nécessité logique un système de surveillance et d’auto-surveillance totales.
Dans un univers mécaniste, l’homme aussi doit être une machine et être traité mécaniquement. Dans ce but, les lumières de l’Aufklärung l’ont dressé et rendu « transparent ». Dans son livre « Surveiller et punir » (1975), le philosophe Michel Foucault montre comment cette « visibilité » est devenue un piège historique. Au début du XIXème siècle, le capitalisme exerçait la surveillance totale par une « pédagogie de maison de redressement », inventée par le « philosophe utilitariste » libéral Jeremy Bentham (1748-1832), un système sophistiqué d’organisation, de punition et même d’architecture s’appliquant aux prisons, aux usines, aux bureaux, aux hôpitaux, aux écoles et aux maisons de redressement.
La société marchande n’est pas la sphère d’une communication libre, mais celle de l’observation et du contrôle, comme dans l’utopie négative « 1984 » de George Orwell. Alors que, dans les dictatures totalitaires, ce contrôle et cette surveillance sont extérieurs et exercés par des appareils d’Etat et de police bureaucratiques, en démocratie le contrôle est intériorisé, entretenu par les médias commerciaux. Les projecteurs des camps de concentration sont devenus les lumières d’un monstrueux parc d’attraction. Ici, on ne discute pas librement, on mire à la lumière. Dans la démocratie commerciale, ce système s’est tellement affiné que les individus obéissent spontanément aux impératifs capitalistes et, tels des robots programmés, suivent aveuglément la voie qui leur est tracée.
En contradiction avec sa propre exigence sociale, le marxisme, en intégrant la pensée mécanique de l’Aufklärung et sa symbolique perfide de la lumière, est devenu un protagoniste du « travail abstrait ». Tout ce qui a été despotique dans le marxisme vient de ce libéralisme moderne et éclairé. Quant aux Romantiques qui voulaient rendre justice au côté obscur de la vérité, ils n’ont pas été les chantres de l’émancipation sociale mais ceux de la Réaction. Ce n’est que libérés de cet emprisonnement réactionnaire que la nuit, le sommeil et le rêve pourraient devenir les mots d’ordre d’une critique sociale émancipatrice. La résistance contre le Marché total naîtra peut-être quand, radicalement, les gens s’arrogeront le droit à une bonne grasse matinée.
Robert Kurz
traduction française parue dans le magazine francophone Archipel n°113. Ce texte est également paru dans une version légèrement différente dans le recueil d'articles de Robert Kurz, Avis aux naufragés, Lignes, 2005.
NOTES
[1] Pour des raisons de compréhension, nous avons gardé dans la plupart des cas le mot allemand «Aufklärung», même s’il s’agit bien de la «pensée rationaliste» moderne en général. L’adjectif « aufklärerisch » a été traduit par «moderne» (N.d.T.)
[2] Dans la théorie marxienne, le «travail humain» a un «double caractère». D’un coté le «travail concret» (tisser, bâtir, taper sur un clavier, etc.), de l’autre le «travail abstrait», «dépense productive de matière cérébrale, de muscle, de nerf, de mains, etc.» (Marx) qui, par la quantification de sa dépense en temps, crée la «valeur» des marchandises et les rend commensurables. (N.d.T.)
*Note du livre : "Travail abstrait" : Marx explique que si les marchandises peuvent s'échanger contre un équivalent général (l'argent), c'est qu'elles ont une "substance commune". Cette "substance commune", c'est la valeur et, à l'origine de la valeur, il y a le travail abstrait, càd le travail indifférencié, égalisé, spécifique au capitalisme. Kurz souligne que le travail abstrait revêt l'aspect d'une tautologie sociale, car ce travail produit à nouveau du travail, du travail sous une autre forme, du travail cristallisé (les marchandises supports de valeur). Dans ce cadre, la dépense de force de travail est une fin en soi, le travail vivant produit du travail mort. Le procès de travail est ici parfaitement circulaire (N.D.T.).
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?