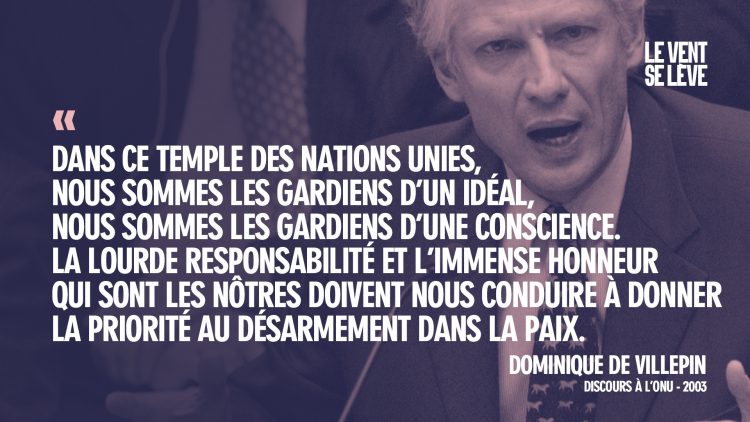Selon les soutiens de Javier Milei, il faut laisser le temps faire son oeuvre. Les réformes sont douloureuses, mais elles finiront par porter leurs fruits – un argument martelé par le service de communication de la Casa Rosada. Si les « miléistes » demandent du temps avant de juger, Le Figaro fait déjà l’éloge de celui qu’il nomme « le Trump Argentin ». Au risque de se muer en caisse de résonance de la présidence argentine, à l’instar d’une partie de la presse française. Celle-ci salue notamment la maîtrise supposée de l’inflation ; et peu importe qu’elle ait été permise par une compression historique du pouvoir d’achat. L’excédent budgétaire dégagé par Milei provoque le même émerveillement ; et peu importe qu’il ait été obtenu en retardant le paiement des salaires et des dividendes. La Casa Rosada n’est pas avare de chiffres mirobolants, qui sont repris sans distance critique ; quand bien même ils ont été obtenus au prix d’un triturage des données minutieusement organisé par l’État. Décryptage.
Entre deux tweets où elle se compare à Salomé Saqué, l’éditorialiste Eugénie Bastié parvient à louer la « thérapie de choc » de Javier Milei et à se demander si elle ne ferait pas du bien à la France. Que cela ait eu des résultats catastrophiques en Grèce n’est qu’un détail qui passe sous les radars des fins analystes de plateaux, lesquels ont souvent pour caractéristique commune une formation médiocre en économie.
Ce petit milieu médiatique était resté bien silencieux lors des deux premiers trimestres du mandat de Milei, où les principaux indicateurs macro-économiques ont été peu reluisants. Qu’à cela ne tienne : il suffisait d’accuser le gouvernement précédent, dont les résultats économiques étaient effectivement assez mauvais. Milei l’avait d’ailleurs annoncé : les débuts seront difficiles, mais une fois l’économie « assainie » les résultats se feront sentir.
Le miracle semble enfin se produire. Là où tous les autres néolibéraux ont échoué, Milei serait en train de réussir à réduire déficit, pauvreté et inflation, tout en évitant les effets récessifs maintes fois provoqués par ces politiques d’ajustement structurel.
L’autre élément explicatif de la baisse de l’inflation peut se résumer comme suit : si personne n’a de quoi manger, la pression sur les prix s’adoucira.
Alors que le chômage augmente, que l’informalité bondit, que la consommation recule et que le pouvoir d’achat s’effondre, les « bons résultats » fièrement annoncés et maintes fois loués par des journalistes qui ne se sont jamais rendus en territoire argentin laissent songeur. L’observateur peut légitimement se demander : qui a raison ?
L’inflation : combattre un problème structurel par une bombe à retardement
Malgré une inflation annuelle de 112%, l’une des plus élevées du monde, Milei annonce une baisse du taux mensuel, qui ne serait plus que de 2.4%. Étant donnée la manière dont le gouvernement Milei combat l’inflation, nul doute que celle-ci diminue – bien que dans des proportions sans doute moindres qu’annoncées.
Il faut dire que l’Argentine est en proie à un cycle infernal depuis des décennies. Du fait de sa position dans le commerce international et sa structure productive, le pays connaît des déficits commerciaux chroniques, les prix des matières premières et des commodities qu’il exporte augmentant moins vite que ceux des biens de capital qu’il importe. Cela provoque une pression structurelle à la dépréciation du peso. Les importateurs, lésés, reportent ce manque à gagner sur les biens qu’ils vendent au marché intérieur, et les commerçants le répercutent sur les prix finaux. Il faut ajouter que l’effet-signal est performatif : personne n’attend que ses coûts soient impactés pour augmenter le prix de la marchandise offerte.
 À lire aussi...
Javier Milei, le dollar et les BRICS : le vrai tournant dans…
À lire aussi...
Javier Milei, le dollar et les BRICS : le vrai tournant dans…
D’un autre côté, si les revenus en pesos perdent du pouvoir d’achat en raison de l’inflation, les agents économiques ont toutes les chances de s’en prémunir à travers des valeurs-refuge : et notamment le dollar. D’où la hausse de sa demande, et la dépréciation subséquente du peso. Autrement dit, si la dépréciation provoque l’inflation, cette dernière vient alimenter la première dans un cycle infernal difficile à briser.
Ces contraintes en tête, le gouvernement de Javier Milei a mis en place deux dispositifs anti-inflation. Le premier, court-termiste, consiste en une série d’annulations de dettes envers l’État, conditionnées par le retour des capitaux cachés dans des paradis fiscaux ou investis dans des activités spéculatives à l’étranger. Une mesure à usage unique, et qui ressemble furieusement à une mobilisation de la puissance publique pour effacer les dettes des plus aisés, sous couvert de lutte contre l’inflation.
Le second consiste en une forme de carry trade – pratique surnommée « bicyclette financière » par les Argentins. Il s’agit de freiner la dépréciation du peso par une méthode simple : proposer des bons du trésor très rémunérateurs en monnaie nationale. Mais une fois ceux-ci parvenus à maturité, les investisseurs convertissent leurs gains en sens inverse, dans une monnaie dont ils sont assurés de la fiabilité : ils troquent une somme supérieure de peso contre des dollars. Et d’où sortiront ces nouveaux billets verts ? Des réserves de change argentines. Pour maintenir leur niveau, le gouvernement a donc tendance à accroître l’endettement du pays en dollars, ce qui ne va pas sans nouvelles négociations avec le FMI.
Cette tendance à en revenir au dollar n’est pas la seule. Actuellement, les spéculateurs choisissent plutôt de réinvestir leur pactole dans un nouveau cycle, et ne se reportent pas encore massivement sur le dollar [comme le montre la structure de la dette argentine représentée par le graphique ci-dessous NDLR].

Source : Office du budget du Congrès.
Si le stock total de dette a augmenté durant la gestion de Milei, cela s’explique pour le moment surtout par la hausse de l’endettement en pesos. Un phénomène présenté par les libertariens argentins comme manifestation d’une confiance retrouvée dans la monnaie nationale, mais qui ne doit pas faire illusion.
En effet, si le stock de dettes en dollars diminue, c’est pour deux raisons. D’une part, il faut être bien peu averti – très « risquophile » selon l’expression consacrée – pour prêter des dollars à l’Argentine. Les investisseurs connaissent la fragilité du modèle Milei, contrairement aux « économistes » du Figaro. D’autre part, il s’agit là d’un stock mesuré en valeur notionnelle (prix du titre sur le marché secondaire multiplié par la quantité de titres en circulation). Si la valeur du stock diminue, c’est que les titres de dette argentine s’échangent à moindre prix. En clair : on se défait déjà des titres de dette argentine.
Il faut ajouter que si la dette en dollars diminue au profit de celle en pesos, c’est en raison du carry trade, et que celui-ci est par nature insoutenable. Prétendre au (mal nommé) « prix Nobel » en économie ne semble pas être une condition suffisante pour le comprendre.
La première limite que rencontre le système du carry trade consiste simplement dans le stock de devises dont dispose la banque centrale argentine. En effet, au fur et à mesure qu’un investisseur se lance dans de nouveaux cycles de « bicyclette financière », la quantité de pesos à reporter sur le dollar en fin de jeu augmente. Lorsque les investisseurs estimeront le jeu trop risqué, ils tenteront de sécuriser leurs gains en se reportant massivement vers le dollar – un processus que la littérature économique nomme « envol vers la qualité » (fly to quality).
S’il n’en existait que deux, la seconde limite se situerait au niveau de « l’économie réelle ». Un peso trop fort favorise les importations au détriment de l’industrie nationale et des exportations. L’industrie nationale, mal en point, est exposée à faillites en chaîne. Quant aux exportateurs, ils n’ont aucun intérêt à vendre avec un dollar si bon marché. Leur attentisme compromet davantage l’entrée de devises sur le marché des changes argentin. Si le gouvernement Milei se targue d’avoir des comptes équilibrés en 2024, la balance commerciale est sous pression, et le déficit inévitable. Si cela n’est pas compensé par un excédent durable ailleurs, une seule solution subsiste : appauvrir suffisamment la population pour diminuer les importations. Une fois dans cette situation, il faudra dans tous les cas importer ce que les Argentins continueront à consommer, creusant inévitablement le déficit commercial et aggravant par la même occasion la pression sur le stock de devises…
De plus, la faillite de la production nationale ne fera qu’accroître le « risque pays » tout en rendant les dettes publiques impayables. Dans les deux cas, les investisseurs financiers prendront tôt ou tard leur « envol vers la qualité », précipitant une dépréciation brutale du peso. Le gouvernement disposera alors d’options limitées : contrôler la circulation des capitaux – on image mal les « libertariens » au pouvoir imposer de telles restrictions -, renflouer les réserves de la banque centrale avec de la nouvelle dette – ce qui présente des limites évidentes en pleine hémorragie – ou laisser filer le taux de change – ce qui fera exploser l’inflation en retour. On peut d’ores et déjà deviner que Javier Milei optera pour un alliage des deux dernières options.
Les plus ingénus parleront d’incompétence, mais ce modèle n’en relève pas. Il fonctionne très bien pour ceux qui soutiennent sa mise en place. Il permet un formidable transfert de richesse vers les spéculateurs – au détriment des travailleurs argentins.
On peut faire la pari que l’explosion aura lieu après les législatives à venir, à l’instar de ce qui s’était passé avec le très libéral Mauricio Macri (2015-2019), avec qui Milei finalement a fait alliance malgré son discours « anti caste » en campagne. Macri avait en effet mis très ponctuellement en place des politiques de relance keynésienne pour contenir la hausse de la pauvreté qu’il avait lui-même créée, afin de ne pas trop dégrader la situation économique avant les élections de mi-mandat. Milei, de son côté, doit maintenir le taux de change coûte que coûte avant les législatives afin d’éviter une vague d’inflation de court terme, quitte à flamber 600 millions de dollars de réserves de change en quelques jours. Comme aiment à le dire les commentateurs d’opposition : « tic-tac, tic-tac, tic-tac… ».
Pour diminuer l’inflation, diminuer le pouvoir d’achat – et trafiquer les chiffres
L’autre élément explicatif de la baisse de l’inflation peut se résumer comme suit : si personne n’a de quoi manger, la pression sur les prix s’adoucira. Malgré les annonces mirobolantes du gouvernement sur une supposée hausse des salaires réels, le pouvoir d’achat diminue. Comment l’expliquer ?
Les hausses actuelles, de l’ordre de 305 % pour l’eau, 189 % pour l’électricité, 564 % pour le gaz et 601 % pour les transports, sont totalement sous-évaluées
Le salaire (par ailleurs surestimé par les statistiques officielles) n’indique pas forcément grand-chose du pouvoir d’achat dans la mesure où le premier ne prend pas en compte les unités de consommation. Si on considère par exemple l’évolution du salaire minimum lors de ces douze derniers mois, le constat est sans appel : on observe une hausse de 80%. Par contre, si on la confronte aux 120% d’inflation sur l’année 2024, on comprend que les travailleurs ont perdu du pouvoir d’achat. Actuellement, le salaire minimum s’élève à environ 270 dollars, qui se trouve sous le seuil de pauvreté, de 300 dollars.
La variable la plus pertinente pour évaluer les variations de niveau de vie est le « reste à vivre », c’est-à-dire ce qu’il reste du revenu une fois déduites toutes les dépenses contraintes. Si le gouvernement se garde bien de diffuser des statistiques officielles la concernant, nul doute que la hausse indiscriminée des tarifs des services publics ainsi que la réduction de la couverture santé augmente les dépenses contraintes du plus grand nombre et diminue leur « reste à vivre ». Par exemple, le gouvernement a restreint l’accès aux médicaments pour les retraités ou encore pour les patients atteints de cancer.
Pour masquer cette détérioration, Javier Milei a inauguré un chapitre inédit dans l’histoire argentine des manipulation statistiques, pourtant déjà fournie. Les mêmes qui dénonçaient la sous-estimation de l’inflation par les kirchnéristes sont aujourd’hui bien silencieux.
Alors que le taux de pauvreté officiel avait respectivement atteint 54,8% et 51% au premier et au deuxième trimestre, Milei annonce fièrement sur son compte twitter – écrivant au passage que « ce gouvernement est le meilleur de l’Histoire » – que ce taux ne serait plus que de 38,9% aujourd’hui. Victoire ! Dans un élan d’optimisme, le président prédit un taux de 0% en 2025, une promesse à faire pâlir Ferdinand Lop et Isidore Cochon. Là où même la Suède a échoué, l’Argentine réussira.
Si on regarde de plus près, on découvre que ce chiffre n’est pas issu de l’Indec (traditionnellement chargé de mesurer la pauvreté), mais du « Ministère de capital humain », créé par Javier Milei. Celui-ci a signé un accord avec l’Université Catholique Argentine (UCA), qui a pour coutume de mesurer la pauvreté de manière parallèle à l’Indec. Avant cette la signature de cet accord, l’UCA avait annoncé un taux de pauvreté de 46,8%, et Milei l’avait publiquement critiquée. Mais après la signature de l’accord, ce chiffre passe à… 38,9%. Pas de quoi alerter les « grands reporters » du Figaro, naturellement.
Ce chiffre n’est toutefois pas une invention sans queue ni tête, mais plutôt le fruit d’une méthodologie de calcul très discutable. En effet, un détail technique dans la mesure de la pauvreté, autrefois peu significatif, est devenu central avec l’inflation. L’UCA évalue la pauvreté en comparant les revenus déclarés par les ménages pour le mois précédent (via l’Enquête Permanente des Ménages) au coût du panier de base du mois actuel, ce qui crée un décalage d’un mois entre les revenus et les prix.
Avec une faible inflation, ce décalage a peu d’effet. Mais en cas de forte inflation, il devient crucial. Par exemple, si un individu déclare avoir gagné 200 000 pesos en octobre, et que le panier de base coûtait 180 000 pesosce mois-là mais a grimpé à 216 000 en novembre à cause d’une inflation de 20 %, il serait considéré comme pauvre selon cette méthode. Pourtant, en comparant ses revenus au panier d’octobre, il ne le serait pas. Ce décalage amplifie les chiffres de la pauvreté lorsque l’inflation accélère et les réduit lorsqu’elle ralentit – comme on l’a observé récemment. Par conséquent, maintenir d’une part ce décalage dans la méthode de calcul surestime l’effet de la baisse de l’inflation sur la diminution de la pauvreté.
D’autre part, avec une inflation est sous-estimée, une partie de la baisse du taux de pauvreté s’explique par la baisse non pas de l’inflation réelle, mais par celle d’une variation positive de l’IPC calculé sur un panier mal pondéré. Ici encore, le gouvernement Milei se livre à une manipulation statistique de haute volée, qui concerne le panier de biens qui sert de calcul à l’indice des prix. Au-delà de toutes les discussions méthodologiques qui lui sont associées, il faut pointer les gros manquements actuels. Le panier représentatif en vigueur a été constitué en 2004, à une époque où les pondérations étaient sensiblement différentes.
Par exemple, le poids relatif des tarifs des services publics y est marginal, car à l’époque ils étaient fortement subventionnés par l’administration Kirchner. On comprend alors que les hausses actuelles, de l’ordre de 305 % pour l’eau, 189 % pour l’électricité, 564 % pour le gaz et 601 % pour les transports, sont largement sous-évaluées dans la variation de l’indice des prix à la consommation, étant sous-pondérées. En effet, il ne suffit pas de calculer la variation de ces prix en gardant leur poids relatif de 2004, encore faut-il les pondérer en fonction de ce qu’ils représentent réellement dans le panier de biens !
Il existe une autre manière de réduire rapidement le taux de pauvreté monétaire, indépendamment de la justesse du calcul de l’inflation. Comme l’analyse Bruno Lautier dans ses travaux, la distribution des individus se situant sous le seuil du pauvreté n’est pas homogène. Il existe souvent un « plateau » juste en dessous du seuil. Pour réduire rapidement le taux, il suffit d’abaisser légèrement le seuil ou de faire monter le « plateau », à travers la hausse d’un subside par exemple. La droite latino-américaine n’a cessé de prétendre que les dizaines de millions de Brésiliens sortis de la pauvreté par Lula le devaient à de tels mécanismes. Elle reste néanmoins très silencieuse sur le modus operandi de Milei, qui a procédé à une
Dans le même temps, la pauvreté structurelle, la plus massive, ne bouge pas. Mesurée par le manque d’accès à un certain nombre de biens et de services publics et privés (eau courante, logement, électricité, canalisations…), il est même probable qu’elle augmente avec le gouvernement actuel. Mais nous ne le saurons que dans plusieurs années.
Le taux de pauvreté ne prend pas en compte plusieurs éléments clés. À revenus monétaires constants, vivre dans un pays où les services publics sont gratuits n’aura pas les mêmes implications que vivre dans un pays où le gouvernement accroît leur coût.
D’autre part, il faut considérer l’appauvrissement de ceux qui se trouvent au-dessus du seuil sans pour autant l’atteindre, et celui de ceux qui se trouvaient déjà en dessous du seuil. En effet, un même seuil peut correspondre à des structures de la pauvreté très différentes. Il est d’ailleurs très probable que les pauvres se soient appauvris, et que la « classe moyenne » se situe maintenant juste au-dessus du seuil de pauvreté, sans pour autant que cela ne change le taux.
Présenté comme une « révolution libertarienne », le modèle Milei n’a rien de nouveau. Il reconduit les politiques initiées sous la dictature de Videla (1976-1983), réactualisées par Carlos Menem durant les années 1990 et Mauricio Macri (2015-2019)
Certains chiffres le laissent présumer. Par exemple, le chômage dans l’économie formelle a bondi de 22%. Ou encore, la consommation de viande bovine atteint le niveau le plus bas de son histoire, ou en tout cas depuis 1914, année depuis laquelle la mesure existe. À moins de supposer une vague de véganisme en 2024 en Argentine, les causes sont de toute évidence à chercher dans la situation économique. Pour finir, en septembre 2024 les ventes des supermarchés et des grossistes affichaient un effondrement de 12.8% en glissement annuel. Cela s’explique très probablement par une « classe moyenne » qui s’appauvrit.
« Révolution libertarienne » ou retour à l’ordre oligarchique ?
Outre la lutte contre l’inflation et la diminution de la pauvreté, la Casa Rosada a mis en avant un solde budgétaire primaire est à l’équilibre. La « tronçonneuse » de Javier Milei s’est dirigée contre les fonctionnaires, dont le corps a subi une suppression de 33 000 emplois en un an dans le cadre d’une réduction de 30% des dépenses publiques. Tandis que les libéraux exultent face à la détresse des travailleurs du public, des patients se retrouvent sans soignants à l’hôpital.
Ce que certains oublient de dire, c’est qu’il est facile d’avoir des excédents budgétaires primaires lorsque les salaires des fonctionnaires ne sont pas versés. Autrement dit, les déficits sont différés dans le temps. Mais encore, il est tout aussi aisé d’avancer fièrement l’excédent du compte capital de la balance des paiements lorsque l’on retarde le paiement de dividendes, chose que dénonce régulièrement l’opposition.
De quoi Milei est-il le nom ? Une réponse à cette question impose de sortir du domaine technique pour appréhender les enjeux politiques. Loin d’être le président « anti-caste » qu’il avait promis en campagne, il n’a cessé d’en faire partie. Si les promesses n’engagent que ceux qui y croient, il est tout de même frappant de voir le candidat du renouveau gouverner avec de vieux dinosaures argentins, comme sa ministre de Sécurité intérieure Patricia Bullrich ou Luis Caputo, actuellement ministre de l’économie, célèbre pour sa propension à emprunter au FMI.
Si Milei réduit les dépenses de l’Etat en stigmatisant les fonctionnaires, il est beaucoup moins disert concernant ses amis, comme Marcos Galperin. Ce « Jeff Bezos argentin », n’est autre que le PDG de Mercado Libre, l’équivalent d’Amazon pour l’Amérique latine, entreprise qui bénéficie de cent millions de dollars de subsides de l’Etat par an. Une pratique qui n’est pas inconnue à la dynastie Milei – la fortune de son père étant en grande partie due aux largesses de l’Etat.
Le « modèle Milei » est synonyme d’un immense transfert de richesses du bas vers le haut, accompagné d’un pillage continu des ressources naturelles et des biens publics. Le gouvernement a en effet fait voter une batterie de lois – alors que l’opposition dénonce l’achat pur et simple de votes de parlementaires – qui crée d’immenses facilités dans l’appropriation des ressources stratégiques pour le capital étranger, tandis que de nombreuses entreprises publiques sont ouvertes à la privatisation. Loin d’apporter un quelconque bénéfice à la population laborieuse, il ne s’agit là que d’un partage du gâteau entre puissants. Jusqu’à mener l’Argentine sur le chemin du non-retour ?
Lorsque le carry-trade s’effondrera – et il s’effondrera inévitablement – l’illusion des « bons résultats » de Milei volera en éclats. La baisse de l’inflation mensuelle – à mettre en regard avec une inflation annuelle de 112% – ne vaut rien tant qu’il existe un retard de change. Lorsque les investisseurs prendront leur « envol vers la qualité » après avoir saigné les réserves argentines, ils laisseront un écrasant stock de dettes qui ne seront payées qu’à travers la surexploitation des travailleurs. C’est sans doute l’une des raisons qui conduit le gouvernement à vouloir imposer des journées de douze heures dans le cadre de sa « loi travail »…
La crise financière pointe déjà son nez : la Banque Centrale « brûle » ses réserves pour contenir l’hémorragie et maintenir le taux de change coûte que coûte avant les législatives, tandis que de grands groupes industriels sont déjà en faillite ou quasi-faillite. Présenté comme une « révolution libertarienne », le modèle Milei n’a en réalité rien de nouveau. Ce sont exactement les mêmes politiques qui ont été appliquées par la dictature de Videla et Galtieri (1976-1983), par le néolibéral Carlos Menem durant les années 1990 ou encore par Mauricio Macri (2015-2019) plus récemment, avec exactement le même résultat : une hausse de l’endettement en dollars, le retour du FMI, la hausse de la pauvreté et du chômage et bien sûr, l’inévitable accélération de l’inflation.
Les apparents « bons résultats » de Milei sont soit une illusion basée sur une bombe à retardement, soit obtenus à travers des compromis méthodologiques ou des subsides. Assez cocasse pour quelqu’un qui taxait ses prédécesseurs de « populistes » lorsqu’ils se livraient aux mêmes pratiques.
Le modèle Milei est donc une réussite. Il réussit très bien à certaines fractions de la bourgeoisie argentine et aux investisseurs financiers étrangers. Mais rien de nouveau sous le soleil pour les travailleurs, qui subissent ce transfert de richesse du bas vers le haut, opéré par la même « caste » que dénonçait Milei en campagne mais qui gouverne à présent avec lui.
Ou bien, finalement, « la caste » c’était les travailleurs ?