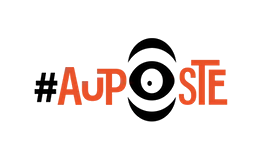
06.03.2026 à 09:00
Désarmons le béton avec Léa Hobson
Lire plus (217 mots)
Chaque seconde, 150 tonnes de béton sont coulés dans le monde, ce qui en fait le matériau le plus utilisé par l’homme - sans écriture inclusive, car le béton est aussi affaire masculine. De l’extraction de granulats qui annihile les cours d’eau à la transformation, fortement émettrice de CO2, jusqu’au déchet, inerte et qui finit en décharge, l’industrie du béton est une catastrophe écologique.
Et pour quel usage ? Se cachant derrière la nécessité de « créer des logements » (qui pourrait s’y opposer ?), le béton participe surtout massivement à artificialiser des terres, stériliser des sols, grignoter des espaces agricoles et naturels, au nom d’une idéologie de la construction qui semble indépassable. Car derrière ce matériau qu’on finit par ne plus voir tant il est omniprésent, se cache un véritable système, industriel et masculin, authentique incarnation du capitalisme, au cœur du pouvoir d’État.
Comment, alors, désarmer le béton ? On en parle avec Léa Hobson. Architecte, scénographe, elle est aussi militante écologiste et membre des Soulèvements de la Terre, et l’autrice de Désarmer le béton. Ré-habiter la terre (2025).
03.03.2026 à 09:00
« L’antifascisme est devenu une lutte à défendre »
Lire plus (215 mots)
La rencontre avec Hervé de La Horde
La Horde, est un collectif antifasciste qui propose des outils aux militants: un site, du matériel visuel, deux livres chez Libertalia et deux jeux pédagogiques. Sur la violence, la position est claire: c'est l'extrême droite qui impose le rapport violent, et les antifas n'ont d'autre choix que d'y répondre — impossible de «s'en remettre à l'État et donc à la police», gangrenée par l'extrême droite. Concernant les images lyonnaises: «le fait d'être heurté, d'être choqué n'implique pas une condamnation morale et définitive des antifascistes qui se sont défendus ce jour-là.»
Le vrai scandale reste le deux poids deux mesures: «la mort de Deranque a beaucoup occupé presse et classe politique, alors qu'il y a eu d'autres morts» — des dizaines, reléguées en faits divers. Sur la normalisation: «Qu'ils ont gagné, c'est la banalisation de leurs idées» — mais pas la bataille des esprits. L'autocritique est assumée: le mouvement s'est trop longtemps reposé sur un antifascisme d'évidence. «Le Siamo tutti antifascisti, c'est un très beau slogan, mais c'est un slogan pour se rassurer.»
02.03.2026 à 07:00
Iran : « La libération ne va jamais venir par les bombes » + révélations sur Némésis
Texte intégral (538 mots)
La rencontre avec Somayeh Rostampour
Somayeh Rostampour, sociologue au CNRS spécialiste des mouvements sociaux en Iran et au Kurdistan, ouvre l'émission depuis la diaspora, la voix chargée d'une inquiétude concrète: sa sœur à Téhéran, ses proches à Sanandaj filmant les bombardements depuis leur fenêtre. Elle replace les bombardements dans leur contexte: une révolte populaire massive venait de secouer 32 provinces iraniennes, et cette intervention extérieure vient précisément l'écraser. «C'était la guerre contre la politique, la guerre vraiment contre la révolution, parce que s'il y a un changement, les gens souhaitent que ça soit fait par eux-mêmes.»
Elle insiste: la population ne voulait pas de bombes, elle voulait juger elle-même ses bourreaux. «La libération, elle ne va jamais venir par les bombes, il n'est jamais venu par les bombes dans des parties du monde.» Elle décrit une société iranienne diverse, épuisée économiquement — 40% de pauvreté, sa sœur professeure gagnant 80€ par mois, payant le même loyer qu'à Paris —, prise en étau entre un régime dictatorial et des puissances impérialistes. Sur la diaspora royaliste qui applaudit les bombardements, elle est sans ambiguïté: très organisée, liée aux extrêmes droites occidentales et à Némésis depuis des années, elle ne représente pas la majorité iranienne.
«On peut dire clairement que 80% de la population est clairement contre ce régime», mais aussi contre cette guerre. Son livre «Femmes en armes, savoirs en révolte, Du militantisme kurde à la Jineolojî» (Agone) éclaire le mouvement kurde révolutionnaire comme modèle d'émancipation féministe et populaire, à rebours des armées d'État: «C'était une révolution dans la révolution, c'était une révolution des femmes dans la Révolution.»
La rencontre avec Thomas Lemahieu
Thomas Lemahieu, journaliste d'investigation à L'Humanité, révèle ensuite le contenu d'une boucle Telegram de 154 messages entre une cadre de Némésis et des dirigeants du groupuscule néo-fasciste Audace Lyon. La cadre, désignée comme Ornella, y propose explicitement d'«être deux, trois filles attroupées là où vous voulez les choper, un peu comme pour faire l'appât» afin que des néo-fascistes puissent tomber sur des étudiants antifascistes. Le dirigeant d'Audace Lyon mis en examen dans une autre affaire — Calixte Guy — est celui-là même qui aurait donné des coups de pied à la tête d'un militant antifasciste.
Lemahieu souligne la banalité des échanges: «C'est la tranquillité avec laquelle un traquenard se prépare.» Némésis a répondu en parlant de «calomnie» tout en laissant entendre implicitement que les échanges existent bien. Sur le financement, le journaliste confirme des liens avec Périclès, la structure de Stérin, et des assistantes parlementaires de Némésis employées par un député RN. «Il passe maintenant par la structuration avec l'empire médiatique de Vincent Bolloré, mais aujourd'hui ça dépasse évidemment Bolloré.»
23.02.2026 à 18:00
#AuPutain 5 ANS !
Texte intégral (538 mots)
5 ans après nos premiers lives bricolés sur Twitch, Au Poste change de dimension. Nouveau site, nouveaux outils, abonnements directs, verbatims, archives enrichies : notre média indépendant poursuit sa bataille culturelle, fidèle à sa ligne — défendre les libertés fondamentales, refuser la dépendance aux plateformes et construire, grâce à ses soutiens, un espace de débat libre, long et exigeant.
23.02.2026 à 07:00
Thomas Portes : « L’objectif affiché est de détruire La France Insoumise »
Texte intégral (808 mots)
Des symboles détournés aux manifestations néonazies de Lyon, Geoffrey Dorne et Ricardo Parreira dévoilent les codes, les réseaux et les méthodes de recrutement.
Suit Thomas Portes, qui défend un antifascisme parlementaire assumé et répond aux critiques visant la France Insoumise.
Entre bataille culturelle, guerre des images et offensive médiatique, le débat fait du bien.
La rencontre avec Thomas Portes
Il dénonce le traitement médiatique de la manifestation de Lyon et l’inversion des responsabilités : «on a renvoyé dos à dos les fascistes et les antifascistes».
Il affirme que la cible politique actuelle est claire : «L’objectif affiché là c’est de détruire la France Insoumise», évoquant une offensive médiatique coordonnée.
Il analyse la période politique comme un moment critique : «Nous sommes dans une période pré-fasciste», établissant un parallèle historique avec les dynamiques autoritaires.
Il justifie l’intégration de Raphaël Arnault à l’Assemblée et défend la complémentarité entre antifascisme institutionnel et antifascisme de rue.
Il revient sur la minute de silence et précise ne pas y avoir assisté personnellement, expliquant les enjeux politiques liés à la séquence.
Il dénonce la normalisation des thématiques d’extrême droite dans l’hémicycle et l’espace médiatique, évoquant une saturation permanente des débats par ces sujets.
Il appelle à reconstruire un antifascisme large et populaire, articulé à un projet social et politique de rupture, estimant que la lutte antifasciste ne peut être dissociée des combats sociaux.
La rencontre avec Ricardo Parreira et Geoffrey Dorne
Geoffrey Dorne présente Icono-fascisme comme la continuité du site Indextreme, structuré autour de «100 symboles qui sont des symboles qui sont réappropriés par l’extrême-droite». Il insiste sur la volonté de produire «un objet qui reste, qui soit durable», destiné aussi aux CDI et établissements scolaires.
Il explique que le livre ne se limite pas à un inventaire graphique mais comprend une réflexion sur «la question tout simplement de la sémiologie graphique», insistant sur «l’importance des sens, des symboles dans le graphisme».
Dorne identifie trois stratégies de manipulation : «la stratégie de l’inversion», qui consiste à «prendre un symbole progressiste et de le retourner» ; «la stratégie de l’euphémisation», soit «prendre un symbole explicitement fasciste et on l’adoucit» ; et «la stratégie de la confusion», où «plus c’est flou, plus c’est un peu brumeux et nuageux, plus tout le monde s’y perd».
Il précise que nombre de symboles analysés sont détournés : «la plupart des symbole que l’on présente sont des signes qui sont réappropriés, qui ont été pillés», certains «n’ont rien demandé et qui pourtant se font réapproprier par l’extrême droite».
Ricardo Parreira martèle la nécessité de qualification idéologique claire : «L’extrême droite est raciste, l’extrème droite est homophobe, transphobe, islamophobre, antisémite». Il affirme que la dédiabolisation ne change rien à la nature idéologique.
Il alerte sur la puissance visuelle des signes : «C’est des moteurs visuels qui ont une charge émotionnelle», expliquant que ces symboles agissent «même inconsciemment» dans les processus d’identification culturelle.
À propos de la manifestation lyonnaise, il affirme que «Ces événements-là, ils sont faits pour une chose, c’était de recruter les plus jeunes», détaillant le rôle des réseaux sociaux, Telegram et du maillage territorial de l’extrême droite.
Il décrit la démonstration publique comme un message codé adressé aux sympathisants : «nous les Néonazis, on est là, on arrive», analysant la manifestation comme un signal de normalisation et de puissance.
Il développe la logique idéologique sous-jacente aux slogans et symboles tels que «On est chez nous», en les replaçant dans l’histoire antisémite française, de Drumont à Maurras, et dans une perspective ethnodifférencialiste contemporaine.
Enfin, il explicite le projet politique radical qu’il attribue aux mouvances néonazies : «le projet politique d’aujourd’hui c’est d’abord la rémigration», décrivant une stratégie visant la déportation massive des personnes non-blanches hors d’Europe.
22.02.2026 à 09:00
Burn Out Militant (et comment l'éviter)
Lire plus (471 mots)
Comment faire en sorte que celles et ceux qui s’engagent continuent à (tenter de) changer le monde sans s’esquinter la santé ? Comment éviter la surchauffe.
Pour en causer, on reçoit Hélène Balazard, chercheuse en science politique et Simon Cottin-Marx, sociologue, auteurs de Burn-out militant – Comment s’engager sans se cramer (Payot, 2026)
La rencontre avec Hélène Balazard et Simon Cottin-Marx
Les auteurs rappellent l’ampleur de l’engagement associatif en France : 22 millions de personnes participent à des associations, dont 10 millions de bénévoles actifs, mais «un militant c’est quelqu’un qui va défendre une idée politique» tandis qu’«un bénévole c’est quelqu’un qui va s’engager gratuitement, sans contrepartie, pour une cause».
Le burn-out militant repose sur trois symptômes précis : «un sentiment d’épuisement», «la déshumanisation des relations interpersonnelles» et «la perte de sens», avec ce constat brutal : «les gens, ils sont crevés».
Parmi les causes structurelles, ils identifient «la culture du sacrifice personnel», «une impossible prise en charge du bien-être par les organisations» et «les répressions… de plus en plus fortes envers le monde associatif».
Ils insistent sur la responsabilité collective : «à aucun moment, on est en train de responsabiliser les individus» car «il y a une responsabilité collective à l’épuisement des individus».
Le mythe du héros solitaire est déconstruit : «derrière chaque individu, il y a un collectif» et «toute victoire, c’est surtout derrière toute victoire, il y a un collectif».
L’exemple de Rosa Parks montre que «son acte héroïque s’inscrit dans une organisation collective» préparée de longue date par la NAACP.
Face à la surcharge numérique, certaines organisations instaurent un droit à la déconnexion : «entre 19h30 et 8h30, on ne s’envoie rien», preuve que «on se mettait la pression entre elles».
Les violences internes doivent être anticipées : il faut «recueillir la parole des victimes», «faire une enquête» et «protéger évidemment la victime».
La répression extérieure pèse lourd : «le contexte épuise», notamment quand «il n’y a pas d’argent, les gens ne sont pas formés et les victimes sont toujours laissées à l’abandon».
Malgré tout, ils réaffirment la nécessité d’agir : «S’engager, c’est génial», «on a besoin des militants pour changer le monde» et il ne faut «pas oublier de prendre soin de nous et de nos luttes».
18.02.2026 à 20:25
Violences politiques, Quentin D. : l’émotion contre la contextualisation
Texte intégral (1117 mots)
Faut-il s’arrêter au choc ou interroger une séquence inscrite dans des années d’affrontements entre extrême droite et antifascistes ? Derrière le drame, une question traverse le plateau : la contextualisation est-elle encore possible ? En amont de ce séisme, Extrêmorama revenait sur 50 ans d’histoire du FN/RN, et de sa longue liste des numéros 2. Avec cette question : Bardella, “Tu quoque mi fili”… Toi aussi, mon fils ?
Sébastien Bourdon, est l'auteur de «Drapeau noir, jeunesses blanches. Enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale" (Éditions du Seuil, 2025).
Joseph Beauregard, de «François Duprat, l'homme qui inventa le Front national» (Denoël), et de "Dans l'Ombre des Le Pen. Une histoire des n°2 du FN" (Nouveau Monde)
Sarah Proust, Première adjointe Paris XVIIIe (PS) et autrice de «Front National: Le Hussard Brun Contre la Republique» (Le Bord de l'eau, 2013) et «Apprendre de ses erreurs. La gauche face au Front national» (Jean Jaurès, 2017).
Débat Quentin Déranque. Avec Nicolas Lebourg et Sebastien Bourdon
Sebastien Bourdon décrit sa réaction immédiate à l’annonce de la mort de Quentin Deranque : «Ce que j’ai ressenti, malheureusement, c’est plutôt une absence de surprise», rappelant «des affrontements très réguliers à Lyon entre groupes d’extrêmement radicales et groupes anti-fascistes» et évoquant «un contexte d’implantation particulièrement forte des différentes mouvances extrêmement radicales dans la ville de Lyon».
Sébastien Bourdon dresse un panorama précis des groupes identitaires implantés à Lyon, évoquant «les royalistes représentés essentiellement par l’Action française», mais aussi «Génération L’Identitaire» qui a ouvert «un bar La Traboule puis une salle de sport attenuante La Gaugé» dans le Vieux-Lyon. Il mentionne également les «nationalistes révolutionnaires, néonazis, identitaires et autres» actifs localement, ainsi que le groupe «Audace», présenté comme «groupe nationaliste révolutionnaire actif à l’heure actuelle» lié à la mouvance néo-fasciste locale. L’ensemble compose, selon lui, une implantation «au long cours» où «toutes les mouvance qui ont été représentées» coexistent dans la ville.
Il souligne que «des images de personnes au sol frappées, en fait on le voit assez régulièrement», expliquant l’existence de «canaux sur les réseaux sociaux, notamment sur la messagerie Telegram» qui «servent à revendiquer des violences ou en tout cas des affrontements».
Nicolas Lebourg insiste sur la puissance du choc visuel : «C’est un jeune homme qui se fait massacrer au sol», distinguant cette scène d’«un affrontement entre 20 gaillards de chaque côté».
David Dufresne tente de replacer le drame dans une dynamique plus large : «Parmi ces agressions, 70% émanent d’activistes de droite, visant en majorité les personnes racisées ou perçues comme telles, et des adversaires politiques», rappelant que «les agressions ont plus que doublé par rapport à la précédente période, 96-2016».
Nicolas Lebourg analyse l’évolution des pratiques violentes : «Tout ce que tu vois dans ces affaires, les gants coqués, etc, les gazeuses, c’est des usages post-2017» et affirme que «c’est vraiment la poursuite d’une dynamique».
Le débat s’élargit à la sociologie lyonnaise. Nicolas Lebourg décrit «Lyon une ville bourgeoise», évoque «la droite lyonnaise est une droite de notable» et précise que «la plupart des membres des groupuscules dont on parle fréquentent des paroisses qui sont des paroisse de la notabilité lyonnaise».
Il ajoute que «les bourgeois font d’autres aussi bon racistes que les autres» et rappelle que ces milieux «n’aimaient pas le FN», le jugeant «vulgaire», dessinant un ancrage social spécifique.
Sébastien Bourdon insiste sur le décalage entre la perception immédiate et la compréhension ultérieure des faits : «les toutes premières images qui sortent, c’est la scène de lynchage en tant que telle», mais «depuis, on a d’autres images qui permettent de mieux comprendre cette scène», soulignant la difficulté d’analyser «à l’instant T» un événement déjà saturé d’émotion.
David Dufresne interroge le traitement médiatique différencié : «nous n’avons pas des images des trois militants kurdes», «pas plus que nous avons des images de la mort d’Ishem Mirraoui», posant la question de l’émotion sélective.
Enfin, l’émission met en tension émotion et analyse. À la question de savoir si «la contextualisation, il n’y en aura pas», les intervenants opposent le temps long de la recherche à l’instantanéité des images, révélant une fracture entre sidération médiatique et compréhension politique.
Débat Bardella. Avec Sarah Proust et Joseph Beauregard
Le débat s’ouvre sur la dynamique des radicalités. Nicolas Lebourg rappelle que «dans les groupuscules que ça se passe», soulignant que les thématiques qui paraissent marginales aujourd’hui structurent souvent «ce qui vont être au cœur de l’espace public ensuite».
Sarah Proust analyse la stratégie de normalisation du RN et estime que «le RN a réussi à faire oublier son histoire», décrivant un processus de transformation d’image sans rupture doctrinale fondamentale.
Joseph Beauregard insiste sur cette continuité idéologique : «les idées sont toujours là», expliquant que la mutation observée est avant tout une évolution de présentation et de stratégie.
Nicolas Lebourg décrit un fonctionnement concurrentiel structurant : «il y a un marché des militants dans la vie politique», où les différents groupes se répartissent rôles, postures et degrés de radicalité.
Sarah Proust souligne le travail d’implantation territoriale et culturelle, évoquant une progression qui passe par «la bataille des mots» et par l’installation durable dans le paysage médiatique et politique.
Joseph Beauregard rappelle que «toutes les courants sont implantés», insistant sur la coexistence de sensibilités variées — royalistes, identitaires, nationalistes révolutionnaires — qui participent d’un même écosystème idéologique.
Nicolas Lebourg insiste sur la profondeur historique des recompositions : les radicalités ne surgissent pas ex nihilo, elles s’inscrivent dans des traditions anciennes qui se réactualisent selon les contextes politiques.
Enfin, le débat met en tension stratégie électorale et matrice idéologique : entre dédiabolisation, ancrage militant et production intellectuelle des marges, les intervenants décrivent un continuum entre radicalité groupusculaire et conquête institutionnelle.
17.02.2026 à 18:20
Big Brother sourit encore, le film-alerte de Raoul Peck
Texte intégral (522 mots)
De la Birmanie coloniale à la guerre d’Espagne, de Trump à Bolloré, il relie passé et présent avec une rigueur implacable. Le dialogue navigue entre cinéma, mémoire, propagande et responsabilité démocratique. Il revient sur son travail, ses recherches, sa science du montage. Un dialogue lumineux, où chaque mot compte — parce que, justement, c’est par les mots que tout commence.
« Orwell : 2+2=5 » est bien plus qu'un documentaire sur George Orwell. C’est une boîte à outils pour comprendre notre époque. Avec ce film, Raoul Peck – l'immense réalisateur haïtien – plonge dans les derniers mois de la vie de l’écrivain britannique, alors qu’il achève 1984. Au-delà de la biographie, Peck montre comment les concepts orwelliens (Big Brother, novlangue, double pensée) sont devenus nos réalités quotidiennes --- des régimes autoritaires aux démocraties en crise. Par un montage percutant, mêlant archives (Guerre d'Espagne, Gaza, Trump, Poutine, Fox News, l'Empire britannique), fictions, news et I.A., Peck interroge : comment résister ? Comment transmettre ? Comment éviter que 2 + 2 n’égalent définitivement 5 ? Rencontre avec un réalisateur pour qui le cinéma est une arme de mémoire. Un honneur que de le recevoir ce soir.
La rencontre avec Raoul Peck
Raoul Peck affirme qu’Orwell a «établi la boîte à outils du totalitarisme» et qu’il décrit «la dégradation du langage» comme condition préalable à «la dégradation de la démocratie».
Il insiste sur l’importance quotidienne de défendre les institutions : «La démocratie, c’est un élément qu’il faut défendre tous les jours, que ce n’est pas un bien de consommation.»
Fort de son histoire personnelle en Haïti, il évoque la dictature et la peur : «À la maison, il fallait parler tout bas pour qu’on ne nous entende pas.»
Il analyse la manipulation lexicale contemporaine : «Quand on n’arrive plus à nommer les choses, on se perd.»
Sur la concentration des médias, il prévient : «Quand dans une société, la communication se retrouve entre les mains d’une minorité, ça devient un problème démocratique.»
Concernant Orwell, il rappelle : «1984, c’est un avertissement.» et souligne que l’auteur écrivait à partir de son vécu, notamment en Birmanie et en Espagne.
Il revendique une indépendance artistique totale : «Les considérations économiques ne peuvent pas être un argument pour ne pas faire les films que je fais.»
Sur la propagande moderne, il cite Steve Bannon : «Flood the zone with shit» pour illustrer la stratégie d’«inonder la zone» afin d’empêcher toute réflexion critique.
À propos du mensonge politique : «Le mensonge organisé […] est une partie intégrante du totalitarisme.» et «Le totalitarisme exige une altération continue du passé.»
Enfin, il appelle à l’engagement concret : «On ne peut plus se contenter d’envoyer des petits messages.» et rappelle que partout «les jeunes filles de Téhéran […] mettent leur vie en danger».
16.02.2026 à 08:36
Scandale Epstein ou le miroir d’une élite offshore + France : la carte électorale n’est pas (du tout) celle qu’on raconte + l’affaire Quentin D.
Texte intégral (802 mots)
A 7h30: Thomas Vonderscher, éditeur et historien, co-auteur avec Youssef Souidi de Nouvelle cartographie électorale de la France (Textuel), sera avec nous pour tordre le cou à certains clichés: ainsi, contrairement à une idée tenace, le RN n’est pas majoritaire chez les précaires. Leur travail révèle une France politique fragmentée : un RN ancré dans le périurbain et les classes moyennes, une gauche urbaine aux électorats distincts, et une coalition présidentielle soutenue par les plus aisés.
A 8h30, avec Martine Orange, co-fondatrice de Médiapart, on discute de sa thèse sur Epstein: Il est impossible de dissocier le financier criminel du monde dans lequel il évolue. Les millions de documents publiés par le département de la justice des États-Unis renvoient l’image hideuse et glaçante d’une classe dirigeante globalisée qui a prospéré avec le néolibéralisme et fait désormais sécession.
Sans oublier la météo des luttes, notre revue de presse antifa, les convocations de la semaine, radio police, revue de presse de la maison poulaga.
Chaque lundi matin, Au Poste tente de mettre un peu de trouble dans l’ordre médiatique dominant. "France Déter" accueille des invité·e·s, tient des revues de presse particulières, donne le temps des nuages et des luttes, explore le passé, étrille le présent. C’est en direct, c’est fait maison. Préparez le café!
La rencontre avec Thomas Vonderscher et Martine Orange
Thomas Vonderscher présente une méthode fondée sur le croisement des résultats du ministère de l’intérieur et des données sociales de l’INSEE: «on croise 3 jeux de données, on a évidemment les données du ministère de l’intérieur qui donnent les résultats par bureau de vote», ce qui permet selon lui de «produire une cartographie qui nous permet de se passer de sondage» et d’atteindre «une finesse au niveau des près de 70 000 bureaux de vote en France».
Il distingue quatre blocs structurants du paysage politique: «un quatrième bloc et auquel on tient beaucoup qui est l’abstention», précisant que «ce quatrième bloc, on l’appelle l’iceberg» car «c’est le bloc majoritaire».
Sur le vote RN et les classes populaires, il affirme: «Dans ces 5% les plus faibles, qu’est ce qu’on voit? C’est que l’extrême droite n’arrive pas en tête», rappelant que «c’est l’abstention qui est largement majoritaire» et que «c’est la gauche unie qui arrivent avec quasiment un quart des électeurs».
Concernant la présence d’immigrés et le vote d’extrême droite, il souligne la régularité statistique: «quand il y a 0% d’individus nés hors de l’Union européenne, là, l’extrême droite fait largement son meilleur score» tandis que «là où il y a 30% et plus, l’extrême droite arrive à moins de 10% des inscrits».
Sur le front républicain, il observe une évolution: «En 2024, réapparition du Front Républicain», détaillant que «l’extrême droite progresse de 5 points, mais la gauche elle progresso d’11 points» et que «ceux qui profitent le plus de ce front républicain (…) c’est la coalition présentielle et la droite traditionnelle».
Martine Orange replace l’affaire Epstein dans un système global: «Il est impossible de dissocier le financier criminel du monde dans lequel il évolue», estimant que «c’était aussi le problème d’une classe qui savait et qui s’est tue».
Elle définit le néolibéralisme financier comme «la volonté de financiariser absolument tous les éléments de la vie, quel qu’ils soient, et d’en tirer un profit quelconque», décrivant «un système qui est bâti sur la corruption, le chantage».
Sur le offshore, elle est explicite: «le offshore, c’est des gens qui (…) ne veulent plus avoir rien à faire avec un État», et résume: «L’ offshore, c’ est, la loi n’ est pas pour moi, je suis au-dessus des lois».
Elle décrit une élite mondialisée sans ancrage: «c’t’une transhumance permanente», ajoutant que «ils se déplacent et ils ne veulent rien avoir à faire avec personne».
Enfin, elle met en garde contre les amalgames et les dérives: «ce n’est pas parce qu’il y a des personnes qui sont malhonnêtes que le monde entier est malhonnête», insistant sur la nécessité de «faire un vrai travail de journaliste» et de «vérifier, peser».
13.02.2026 à 19:04
« Démocratiser le travail, libérer le temps » : l’utopie qui pourrait sauver la planète
Texte intégral (719 mots)
Et si le travail était central dans la question écologique? Cette intuition, André Gorz, philosophe, journaliste l’a eue dès les années 1970. Car le travail est une aliénation et s’inscrit dans une idéologie productiviste incompatible avec la préservation de l’environnement. Plutôt que de chercher à toujours produire davantage, nous devrions au contraire faire preuve de "réalisme écologique" et envisager la décroissance. Pour cela, Gorz prône une "réforme révolutionnaire": l’autogestion du travail, de nos besoins et rythmes de vie.
En pratique, c’est en rapprochant mouvement ouvrier et luttes écologistes que ce projet émancipateur pourrait voir le jour. Des thématiques toujours d’actualité cinquante ans plus tard, dont le mouvement écolo pourrait s’inspirer aujourd’hui.
Céline Marty est professeure agrégée de philosophie et docteure en philosophie. Elle a soutenu une thèse consacrée à André Gorz, dont elle a tiré l’ouvrage L’écologie libertaire d’André Gorz. Démocratiser le travail, libérer le temps (2025), après avoir publié Découvrir Gorz (2025) et Travailler moins pour vivre mieux (2021).
Hélène Assekour
La rencontre avec Céline Marty
La transition écologique et l’emploi : Céline Marty rappelle que la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. « Oui, il y a des enjeux écologiques, mais on ne veut pas que les travailleurs soient des perdants. » Elle souligne l’importance de repenser les métiers pour éviter de sacrifier des vies au nom de l’écologie.
Les bullshit jobs : Elle évoque le concept de bullshit jobs, ces emplois inutiles qui occupent une place centrale dans notre société. Une critique acerbe de l’organisation actuelle du travail.
André Gorz et l’écologie libertaire : Marty s’appuie sur les travaux d’André Gorz pour défendre une vision libertaire de l’écologie, où le travail serait démocratisé et le temps libéré. « Adieu au prolétariat » devient un leitmotiv pour repenser notre rapport à l’emploi.
La réduction du temps de travail : « Il faut travailler moins. » Une affirmation radicale, mais selon elle, nécessaire pour concilier bien-être et préservation de la planète.
La délégation du pouvoir politique : « Moi mes affaires économiques sont trop importantes pour que je participe à la vie politique, donc je délègue ce pouvoir politique à des représentants pour me consacrer à la ville économique. » Une critique de la séparation entre économie et politique, qui empêche une véritable transition.
Redéfinir le travail : « Redéfinir le travail. » Pour Marty, il ne s’agit pas seulement de créer des emplois verts, mais de repenser en profondeur ce que signifie « travailler ».
L’utopie réaliste : « Démocratiser le travail, libérer le temps. » Une proposition concrète pour sortir du modèle actuel, où le travail est synonyme d’aliénation.
L’impact de la crise écologique : « Comment aussi la crise écologique va impacter nos métiers, nos emplois, nos travaux à l’avenir ? » Une question centrale pour anticiper les bouleversements à venir.
Le rôle des entreprises polluantes : « Comment on fait quand on dénonce des entreprises polluantes pour réfléchir aussi au sort des personnes qui sont employées par ces entreprises ? » Un dilemme qui divise les écologistes.
L’écologie comme levier de changement : « L’écologie libertaire d’André Gorz. » Marty voit dans l’écologie une opportunité de transformer notre société, y compris notre rapport au travail.
La fin du travail tel qu’on le connaît : « Je travaille mon piano. » Une métaphore pour illustrer l’idée d’un travail épanouissant, loin des logiques productivistes.
Le pouvoir des travailleurs : « Il faut que les travailleurs aient leur mot à dire. » Une condition essentielle pour une transition juste et équitable.
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Ctrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique ‧ Asie ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- Infomigrants
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J
- I.C.I.J
- OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie