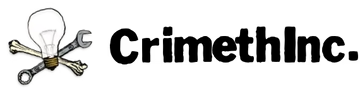09.10.2023 à 00:36
« Une superpuissance nucléaire et un peuple dépossédé » : Un anarchiste de Jaffa, à propos de la violence en Palestine et de la répression israélienne
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (9911 mots)

Le 7 octobre, le Hamas, parti au pouvoir dans la bande de Gaza, a franchi les murs de séparation qui encerclent la zone pour mener une série d’attaques. Le gouvernement israélien a répliqué par une opération militaire de grande envergure. Si les deux parties ont pris pour cible des civils et des soldats, ces événements ne peuvent être compris qu’au prisme de plusieurs décennies de répression et de nettoyage ethnique.
Au moment de ces attaques, nous terminions un entretien avec Jonathan Pollak, un anarchiste de Jaffa, une ville palestinienne majoritairement arabe jusqu’à encore récemment. Participant de longue date au collectif Anarchist Against The Wall 1 et à d’autres actions de solidarité anticoloniale, Jonathan est actuellement poursuivi et risque une peine de prison pour avoir participé à une manifestation en début d’année. Dans l’entretien qui suit, il nous partage sa perception du nouveau cycle de violences qui se déroule actuellement. Il témoigne également de la façon dont le système judiciaire israélien oppresse structurellement les Palestinien·nes, explique comment soutenir les prisonnier·es palestinien·nes, et évalue l’efficacité des efforts de solidarité qui se sont déployés au fil des ans.
Pour plus de contexte sur la situation en Israël et en Palestine, vous pouvez consulter notre histoire de l’anarchisme israélien contemporain, notre reportage sur le soulèvement de Haïfa en 2021, et notre couverture du conflit politique au sein de la société israélienne au début de cette année.
Nous espérons partager les perspectives des anti-autoritaires de Gaza dès que nous aurons réussi à communiquer avec elles et eux. En offrant cet espace à une personne qui a grandi dans la société israélienne, nous ne cherchons pas à mettre particulièrement en avant le point de vue ou la personnalité de citoyen·nes israélien·nes, mais plutôt à montrer que la situation ne peut être réduite à un conflit ethnique binaire, de la même façon que nous l’avons fait en publiant les points de vue des anarchistes russes sur l’invasion de l’Ukraine. La photo ci-dessus, prise par Oren Ziv/ActiveStills, montre des manifestants brûlant des pneus dans la ville de Beita.
Intensification des hostilités
Le samedi 7 octobre, alors que nous nous apprêtions à publier cet entretien, le Hamas a mené une vague d’attaques coordonnées. Le gouvernement israélien a réagi en lançant une offensive militaire à grande échelle. Comment perçois-tu ces événements depuis l’endroit où tu te situes ?
C’est un événement d’ampleur historique pour la résistance palestinienne au colonialisme israélien, qui se poursuit toujours aujourd’hui. Il est trop tôt pour savoir exactement ce qui va se passer, et je préfère donc parler du contexte général de la situation plutôt que de donner une analyse d’une affaire encore en cours et dont les détails ne sont pas encore clairs. Tout ce que je pourrais dire maintenant pourrait être dépassé dans quelques heures.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que d’horribles journées sont à venir.
La version courte de cette histoire est que les forces du Hamas ont réussi à briser le siège qu’Israël impose brutalement à la bande de Gaza et à pénétrer dans les colonies israéliennes de l’autre côté du mur, voire à s’en emparer complètement dans certains cas. Le nombre de morts du côté israélien s’élève à plusieurs centaines, et les images diffusées dans les médias sont effroyables et choquantes, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais je m’avance un peu.
Certains des termes que j’utilise dans ce contexte peuvent être déroutants pour les personnes qui suivent un peu ce qui se passe en Palestine et qui sont habituées à ce que le terme « colonies israéliennes » soit réservé aux zones occupées par Israël à partir de 1967. Je pense cependant qu’il est nécessaire de comprendre Israël comme un projet colonial à part entière, et le sionisme comme un mouvement colonial pour la suprématie juive. Il serait négligent d’ignorer la longue histoire du nettoyage ethnique israélien, qui a abouti en 1948 au nettoyage ethnique des Palestinien·nes par Israël, et que l’on connaît sous le nom de Nakba. La bande de Gaza d’aujourd’hui, qui n’est qu’une fraction du district de Gaza de la Palestine d’avant 1948, est le foyer de réfugié·es de 94 villes et villages du district historique qui ont été complètement dépeuplés. Aujourd’hui, 80 % des résident·es de la bande de Gaza sont des réfugié·es, assiégé·es dans une zone qui, avec ses 365 km², est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Les villes qui ont été prises ou attaquées par les Palestiniens au début des combats actuels sont quelques-unes des villes dépeuplées dont certain·es des réfugié·es ont été dépossédé·es.
Dans les médias internationaux, l’histoire est principalement présentée soit comme une guerre bilatérale entre Israël et Gaza, soit comme une agression palestinienne unilatérale et insensée, dépourvue de tout contexte. Le contexte qui manque, bien sûr, est que les Palestinien·nes ont connu des années et des années d’assujettissement colonial, et c’est particulièrement vrai pour les Palestinien·nes de la bande de Gaza.
Comme je le disais, les images sont sordides et épouvantables. Il est impossible de ne pas en être affecté. Cependant, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Au-delà du contexte historique déjà mentionné, dans les deux dernières décennies, Gaza a été encore et encore réduite en poussière par les raids aériens et les opérations militaires israéliennes. Maintenant, une fois de plus, les bombardements ont recommencé et, au sein des courants dominants de la société israélienne et de ses médias, il est ouvertement question de perpétrer un génocide à Gaza. Si rien n’est fait pour l’empêcher, il pourrait effectivement avoir lieu.
Si nous demandons aux Palestinien·nes de ne pas se tourner vers la violence, nous ne devons pas oublier à quelle réalité iels sont confronté·es. Quand les Palestinien·nes de Gaza ont manifesté en 2017 et 2018 contre la clôture israélienne qui les emprisonne, iels ont été abattu·es par centaines. Les images qui circulent actuellement sont sordides et choquantes. Je n’ai pas l’intention de les euphémiser, de les justifier ou de les excuser, mais au cours de la lutte, le chemin de la libération prend presque toujours des tournants épouvantables.
L’African National Congress [une des principales organisations-cadres de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud] est souvent citée par ignorance comme un point de référence pour celles et ceux qui cherchent à soutenir que la violence n’a aucun rôle à jouer dans la lutte. Mais après la création de son aile militaire, le MK [uMkhonto we Sizwe, « Lance de la Nation »], l’ANC n’a jamais renoncé à la violence. Nelson Mandela [membre de l’ANC et cofondateur du MK] a refusé de la récuser, même après plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement. En 1985, le président de l’ANC, Oliver Tambo, a déclaré au Los Angeles Times,
« Par le passé, nous disions que l’ANC ne prendrait jamais délibérément la vie d’innocent·es, mais aujourd’hui, en regardant ce qui se passe en Afrique du Sud, il est difficile d’affirmer que des civil·es ne vont pas mourir. »
Le contexte de lutte ici est celui d’une superpuissance nucléaire et d’un peuple dépossédé. Le colonialisme ne faiblit pas. Il ne reculera pas de lui-même, même si on le lui demande gentiment. Le décolonialisme est une cause noble, mais le chemin pour y parvenir est souvent laid et entaché de violence. En l’absence d’alternative réaliste pour parvenir à la libération, les gens sont contraints de commettre des actes injustifiables. C’est la réalité fondamentale de la disparité du pouvoir. Demander à ce que les opprimé·es agissent toujours de la manière la plus pure, c’est leur demander de rester à jamais dans la servitude.

Un manifestant évacuant un enfant blessé par un tir israélien pendant une manifestation à Beita. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
L’affaire judiciaire
Revenons un peu en arrière – Jonathan, tu es en plein procès dans un tribunal qui dépend du gouvernement israélien, accusé d’avoir lancé des pierres pendant une manifestation en Cisjordanie. Peux-tu nous expliquer le contexte dans lequel tu as été arrêté ?
J’ai été arrêté à Beita, un village près de la ville de Naplouse en Cisjordanie.
Beita a une longue tradition de résistance au colonialisme israélien. C’était un des centres de la résistance durant la Première intifada (1987-1993). Début 1988, une vingtaine d’hommes de Beita et de la ville voisine de Huwara ont été encerclés par l’armée israélienne après avoir été identifiés par le Shin Bet, la tristement célèbre police secrète israélienne, comme étant impliqués dans des jets de pierre. Ils ont été attachés avec des serflex puis les soldats leur ont brisé les os à coup de pierres et de matraques. Les soldats exécutaient l’ordre direct du ministre de la Défense de l’époque, Yitzhak Rabin, qui avait publiquement appelé à une politique consistant à « briser les bras et les jambes ».
Plus tard la même année, Beita a été le théâtre de l’un des incidents les plus marquants de l’intifada, quand un groupe de jeunes colons israéliens, mené par l’extrémiste Romam Aldube, a fait une incursion dans la ville sous prétexte d’y faire une sortie à l’occasion de Pessa’h. Après qu’Aldube a abattu un résident du village dans les oliveraies entourant la ville, le groupe a continué à l’intérieur même de Beita, où il a été accueilli par des habitants sortis pour se défendre. Les colons ont finalement été désarmés par les habitants, mais pas avant que leurs tirs ne tuent deux autres Palestiniens ainsi qu’une jeune fille de 13 ans, abattue par erreur par Aldube lui-même au cours de l’affrontement.
À la suite de cet incident, de nombreux appels ont été lancés dans la société israélienne pour « rayer Beita de la carte ». En représailles, et bien que les détails de l’incident aient déjà été clarifiés pour les militaires via plusieurs débriefings opérationnels, l’armée israélienne a détruit quinze maisons du village et arrêté tous les hommes, puis déporté six d’entre eux en Jordanie.
Ces dernières années, Beita a été marquée de conflits constants avec l’armée israélienne et les colons qui cherchent à établir des colonies sur des terres volées appartenant à la ville. La manifestation lors de laquelle j’ai été arrêté, le 27 janvier, faisait partie d’un soulèvement local qui a commencé en mai 2021, à la suite de l’établissement d’une colonie israélienne dans la zone de Jabel (mont) Sabih aux abords de la ville. Pendant ces manifestations, dix personnes ont été tuées par des tirs israéliens, certains par des tirs de sniper. Des milliers de personnes ont été gravement blessées et des centaines ont été arrêtées. Le soulèvement est parvenu à forcer l’évacuation des colons, mais seulement de façon temporaire et avec la promesse du gouvernement qu’ils seraient plus tard autorisés à revenir. Après le départ des colons, l’endroit a été utilisé comme base militaire et, récemment, les colons sont revenus occuper les maisons construites avec l’aide du gouvernement.
J’ai été arrêté lors d’une descente de la police aux frontières (une unité paramilitaire de la police israélienne) dans le village, après une manifestation. Au poste de police, j’ai entendu deux officiers qui m’avaient arrêté préparer ensemble leurs déclarations ; ils m’ont ensuite inculpé pour agression aggravée contre des officiers de police (jet de pierres), obstruction contre des officiers de police, et émeute. J’ai été détenu en prison pendant trois semaines, puis assigné à résidence en raison de la détérioration de mon état de santé.

Des familles de Palestinien·nes détenu·es attendent qu’on les laissent entrer dans la prison/tribunal militaire d’Ofer, près de Ramallah. Photograph by Oren Ziv/ActiveStills.
Tu as demandé à être jugé par un tribunal militaire plutôt que civil, comme le sont les Palestinien·nes. Peux-tu nous expliquer le sens de cette demande ?
Je ne suis évidemment pas un admirateur de l’État, ni de celui-ci ni d’aucun autre. Mais dans les soi-disant démocraties, la notion de violence légitime de l’État – qui est le fondement même des systèmes juridiques et répressifs – découle d’une fausse éthique de la justice et d’une idée erronée selon laquelle ces systèmes représentent les intérêts collectifs de celles et ceux qui sont soumis·es à son autorité.
Il existe un mécanisme unique dans l’apartheid israélien, qui n’existait même pas dans le système d’apartheid sud-africain. En Cisjordanie, il existe deux systèmes judiciaires parallèles : un pour les Palestinien·nes, et un pour les colons juif·ves. En étant accusé des mêmes délits – même quand ils ont lieu au même endroit, au même moment et pendant les mêmes circonstances – je serai poursuivi et jugé dans le cadre du droit pénal civil tandis que mes camarades palestinien·nes seront confronté·es à un tribunal militaire, ce qui montre bien la réalité d’une dictature militaire totale. Pour appréhender les Palestinien·nes, le gouvernement utilise des forces armées, qui les arrêtent souvent au milieu de la nuit, violemment et l’arme à la main. Il peut s’écouler jusqu’à 96 heures avant de voir un juge (24 heures pour moi), et même quand c’est finalement le cas, ce juge sera un soldat en uniforme, tout comme le procureur. Iels seront jugé·es selon la loi militaire draconienne d’Israël, sans doute sans possibilité de liberté sous caution, et leur peine sera prononcée après leur condamnation dans un système ou moins d’une personne sur 400 est acquittée.
Ce double système judiciaire est souvent mentionné comme l’une des principales composantes de l’apartheid israélien. C’est une manifestation si éclatante de l’apartheid que même certain·es sionistes modérés ne peuvent l’occulter. Pourtant ils ne reconnaissent pas qu’il s’agit d’un élément fondamental du sionisme en tant que mouvement de colonisation, car iels se concentrent uniquement sur l’occupation de 1967 et sur le contrôle par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. On entend souvent dire que le système est mauvais, mais qu’il n’est pas raciste puisque la distinction se fait sur la citoyenneté. Cette affirmation est fausse. Il existe une minorité palestinienne (20 % de la population israélienne) dont les membres vivent sur les zones occupées par Israël en 1948 et disposent de la citoyenneté israélienne (contrairement aux Palestinien·nes qui vivent en Cisjordanie ou dans la bande Gaza, qui vivent sous le contrôle d’Israël en tant que sujets sans citoyenneté). On le sait assez peu, mais même les Palestinien·nes qui disposent de la citoyenneté sont parfois jugé·es par les tribunaux militaires de Cisjordanie. La vérité en la matière est simple : j’ai été inculpé devant un tribunal civil parce que l’État me considère comme Juif. Si j’avais été un Palestinien possédant la citoyenneté israélienne, j’aurais probablement été jugé devant un tribunal militaire. Le système fonctionne selon des critères ethniques et religieux.
Les lois elles-mêmes sont différentes, et la loi militaire n’est en fait pas une législation, mais plutôt un ensemble de décrets émis par le commandement militaire de la région. L’un de ces décrets, l’Ordre 101, interdit par exemple tout rassemblement de nature politique de dix personnes ou plus (par exemple, un repas au cours duquel on parle politique), même si ce rassemblement a lieu sur une propriété privée. C’est un délit passible de dix ans de prison. De même, toute organisation politique ou association peut être déclarée hors-la-loi, ce qui arrive régulièrement.
Je vois l’anarchisme comme une idéologie – ou plutôt un mouvement – de lutte. Je crois qu’en général l’activisme ne devrait pas être moralisateur (c’est-à-dire complaisant et paternaliste), mais plutôt dirigé vers un changement effectif. En soi, il n’y a rien de positif à perdre du temps en prison au lieu d’essayer de faire quelque chose d’utile à l’extérieur. J’ai demandé à être jugé par une cour militaire afin de mettre en lumière un système dont très peu sont conscient·es, et en même temps, pour essayer de le saper. Nous avons donc présenté un argument juridique assez solide, compte tenu des limites du droit israélien, mais la cour l’a simplement ignoré sur la base d’un point technique inventé de toute pièce – un bricolage juridique assez impressionnant. Ma décision de refuser de reconnaître la légitimité du tribunal après que ma requête a été rejetée faisait également partie de ma stratégie.
Il existe également une raison plus fondamentale pour laquelle je refuse de coopérer avec la cour et de me conformer aux procédures, qui découle de ma compréhension du pouvoir et de ma propre expérience des systèmes judiciaire et carcéral. Ces systèmes sont conçus de telle sorte que l’on est toujours en train de plaider ou d’attendre, toujours à la merci du pouvoir, dénué·e de toute agentivité.
La non-coopération renverse tout ce système de contrôle. Elle permet de récupérer du pouvoir et de l’agentivité dans une situation dans laquelle vous êtes censé ne pas en avoir. Il y a certainement un prix à payer, et il faut le considérer à chaque fois, selon les circonstances. Je ne préconise pas cette stratégie dès que l’on est confronté au système judiciaire, mais j’ai constaté qu’elle avait le mérite de me redonner beaucoup de contrôle sur la situation.
Mes chances d’être acquitté ou d’éviter la prison étaient inexistantes au départ, je n’avais de toute façon pas grand-chose à perdre.

Une vue du tribunal militaire d’Ofer depuis l’extérieur. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Ce n’est pas la première fois que tu fais face à une peine de prison, non ?
Non… Je crois que c’est peut-être la sixième fois, mais je ne suis pas sûr à cent pour cent. Par contre, mes camarades palestinien·nes entrent et sortent de prison en permanence, et il est très difficile d’imaginer une vie sans la menace de l’emprisonnement, étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons. En fait j’ai de la chance (ou le privilège) d’avoir passé si peu de temps en prison au cours de vingt et quelques années de militantisme. Ça aussi, c’est une des conséquences de l’apartheid israélien.
Tu as mentionné que tu avais été relâché plus tôt cette année à cause de problèmes de santé. Peux-tu nous décrire les conditions de vie dans les différents établissements où tu as séjourné ?
Tout comme le système judiciaire, l’emprisonnement est lui aussi ségrégué. Il existe des quartiers et des prisons différentes pour les prisonnier·es politiques palestinien·nes (Israël les appelle « prisonniers de sécurité ») et pour tous·tes les autres. Les conditions sont bien plus difficiles pour les prisonnier·es politiques, dont les visites sont plus limitées, qui n’ont pas accès au téléphone, entre autres restrictions. Cependant, l’organisation, la solidarité et parfois même la résistance y sont également plus fortes. Malgré le fait que je suis poursuivi sur des accusations politiques pour lesquelles les Palestinien·nes sont classé·es « prisonnier·es de sécurité », et bien que j’ai demandé à être détenu avec mes camarades, j’ai toujours été classé comme un détenu « normal ».
Le système israélien comporte trois niveaux d’incarcération distincts : la détention avant inculpation, la détention après inculpation et l’emprisonnement après la condamnation. La détention avant l’inculpation est la phase où les conditions sont les plus mauvaises, où l’accès au monde extérieur est le plus limité. À cette étape, les communications téléphoniques et l’accès à une télévision ou une radio sont interdits, tout comme l’achat de fournitures à la cantine. Aucun livre ou matériel de lecture n’est autorisé, à l’exception de la Bible ou du Coran. Légalement, vous avez droit à une heure de promenade par jour, mais il est rare d’avoir ne serait-ce que quelques minutes. Certaines de ces conditions s’améliorent progressivement une fois que vous êtes inculpé·e ou condamné·e, selon la prison et le quartier dans lequel vous vous trouvez.
Les conditions matérielles sont très variables. Le nombre de personnes dans une même cellule peut aller de deux à vingt ; j’ai connu les deux extrêmes. Je préfère généralement disposer du plus d’intimité possible, mais ça dépend vraiment de qui sont les compagnons de cellule. Être coincé dans une cellule avec une seule autre personne peut être assez difficile à supporter, surtout pour quelqu’un comme moi qui n’est pas très doué pour faire la conversation.
Les drogues et les addictions sont également un problème, et il y en a beaucoup qui circule. Antidouleurs, opiacés, agonistes opioïdes, on trouve de tout. Mais l’approvisionnement n’est jamais stable et il arrive donc souvent d’être bloqué dans une cellule avec plusieurs personnes qui naviguent entre sevrages forcés et défonce. Il y a toujours des bagarres pour avoir une part du peu qui arrive jusqu’aux cellules. Les détenu·es non fumeur·ses ont techniquement le droit d’être placé·es dans des cellules non-fumeurs, mais c’est seulement théorique. En réalité, la seule cellule non-fumeurs dans laquelle j’ai été détenu était une cellule d’isolement. Je n’ai même pas eu droit à une cellule non-fumeurs quand j’ai contracté une bronchite aiguë.
La forme de violence la plus répandue entre détenu·es à part les bagarres à coup de poing est le coup de surin (les filtres de cigarettes brûlés et pressés sont très répandus et faciles à se procurer) et les aspersions d’eau bouillante mélangée à du sucre.
Je suis végan depuis près de trente ans. Je souffre de diabète de type 1 et d’intolérance au gluten (maladie cœliaque) ; je fais aussi de l’épilepsie depuis que j’ai reçu un tir de gaz lacrymogène en pleine tête lors d’une manifestation. Cela fait de la nourriture une lutte constante en prison, car je ne peux pratiquement rien manger qui ait été préparé dans une cuisine de prison. Il faut en général attendre entre une et deux semaines pour que de la nourriture soit disponible et encore plus longtemps pour obtenir tout ce dont j’ai besoin et à quoi j’ai droit. Entre-temps, mon régime alimentaire se compose essentiellement de concombres et, quand j’ai de la chance, de carottes.
Pendant mon dernier passage en prison, j’ai perdu environ 12 kilos en trois semaines – environ 15 % de ma masse corporelle. J’ai contracté une bronchite aiguë qui a fait grimper ma glycémie à des niveaux potentiellement mortels.
J’ai eu la chance d’être assigné à résidence sous caution, principalement en raison de mon état de santé. C’est une chance que les Palestinien·nes n’ont pas. Cette expérience d’incarcération m’a fait douter de la manière dont gérer mon affaire politico-judiciaire, et m’a peut-être même un peu brisé. Il m’a fallu un moment pour récupérer physiquement, et encore plus pour revenir à moi mentalement et émotionnellement. Je devais prendre des décisions sur la façon de gérer l’affaire, mais aucune des options n’était bonne et je n’étais pas en état de les prendre. Au final, j’ai réalisé que j’étais face à un choix binaire : soit je devais revenir sur l’accord que j’avais passé avec moi-même quand adolescent j’avais découvert le monde miroir du véganarchisme, et réalisé à quel point le monde était tordu et foutu, soit je devais le respecter et… continuer à vivre. C’est un choix plutôt facile, non ? Presque pas un choix du tout finalement.
Fais-tu l’objet d’autres accusations ?
À part les accusations dont on a déjà parlé, quelques affaires sont en cours – des accusations pour lesquelles je n’ai pas encore été inculpé, mais je pourrais l’être. La plus notable est celle d’« incitation à la violence et au terrorisme » suite à un article que j’ai publié quand j’étais emprisonné en 2020, qui appelait les gens à soutenir et à rejoindre la résistance palestinienne au colonialisme israélien.

Des manifestant·es à Beita emploient une tactique de « confusion nocturne » pour harceler les colons, en faisant clignoter des pointeurs laser et des lumières sur la colonie, en marchant vers elle avec des torches enflammées et en dirigeant vers elle la fumée de pneus enflammés. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Est-ce que tu reçois du soutien de la part de groupes de la société israélienne, depuis la Palestine, à l’international ? Qu’est-ce que les gens peuvent faire pour vous soutenir, toi et celles et ceux qui s’organisent ici ?
J’ai des cercles de soutien au sein de la communauté anarchiste et parmi les Palestinien·nes. Je pense que la chose la plus utile à faire en ce moment est de soutenir les campagnes de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) à l’encontre d’Israël. Il y en a beaucoup, c’est relativement efficace et il est assez facile de s’y impliquer.
Pour ce qui est de me soutenir, j’ai l’impression que soutenir la lutte des prisonnier·es palestinien·nes en général est la meilleure façon de me soutenir personnellement.
Il y a actuellement plus de 5 000 Palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes. Environ un quart sont ce qu’Israël appelle des « détenu·es administratifs », qui peuvent être maintenu·es en détention indéfiniment, sans accusation ni procès, sur base de « preuves secrètes ».
Il est estimé qu’un homme palestinien sur cinq vivant sous l’administration israélienne a été incarcéré au moins une fois par Israël.
L’organisation qui soutient le mieux les prisonnier·es palestinien·es est l’Association Addameer de soutien aux prisonniers et de défense des droits de l’Homme2: une organisation palestinienne non gouvernementale qui travaille à soutenir les prisonnier·es palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes et palestiniennes. Fondée en 1991 par un groupe de militant·es intéréssé·es par les droits de l’Homme, le centre propose une aide juridique gratuite aux prisonnier·es politiques, défend leurs droits au niveau national et international, et travaille à mettre fin à la torture et aux violations des droits des prisonnier·es par le biais de suivis, de procédures légales et de campagnes de solidarité.
Addameer est l’une des six principales organisations de la société civile palestinienne qu’Israël a qualifiée d’organisation terroriste sans autre forme de procès en 2021, sur la base là-aussi de « preuves secrètes ». Iels font un travail crucial pour soutenir les prisonnier·es politiques palestinien·nes détenu·es par Israël ou par l’Autorité palestinienne et il est essentiel de les soutenir.
Samidoun est un réseau international d’activistes qui s’efforcent de construire une solidarité avec les prisonnier·es palestinien·nes dans leur lutte pour la liberté. Iels travaillent à sensibiliser et à fournir des ressources sur les prisonnier·es politiques palestinien·nes, leurs conditions, leurs demandes, et leur lutte pour la liberté, pour eux, leurs compagnons et pour leur terre. Samidoun s’efforce également d’organiser des campagnes locales et internationales afin de faire advenir des changements et de défendre les droits et les libertés des prisonnier·es palestinien·nes.
Vous pouvez suivre l’évolution de mon affaire ici grâce à mon groupe de soutien local. Ce sera probablement encore dans quelques mois, mais quand je retournerai en prison, ça me ferait plaisir de recevoir du courrier. La façon la plus simple de faire ça est d’envoyer un mail à la même adresse que la dernière fois que j’étais derrière les barreaux support.jonathan@proton.me, et il me sera transmis. Je ferai mon maximum pour répondre, même si mes possibilités sont assez limitées, car les timbres postaux sont rares. Comme toujours quand on écrit à des prisonnier·es, il faut garder à l’esprit que toutes les correspondances sont surveillées.
Historique
Tu as participé à la création d’Anarchists Against the Wall, un collectif qui a bénéficié d’une certaine reconnaissance internationale au début des années 2000. Qu’est-il advenu de ce projet ? Et à quoi ressemble le mouvement anarchiste en Israël aujourd’hui ?
Je n’aime pas vraiment présenter ça comme si j’avais « participé à la création » d’AAtW, surtout parce qu’il me semble que c’est une description erronée de la façon dont ce groupe – et en fait la plupart des groupes d’action directe – a commencé. Il n’y a pas eu un moment en particulier. Au début du millénaire, la Seconde intifada était à son apogée, et nous étions un petit groupe de personnes rejoignant la résistance palestinienne et pratiquant l’action directe. Ça a pris de l’ampleur et nous nous sommes regroupé·es, mais nous n’avons jamais « fondé » un groupe. Même le nom n’a pas vraiment été un choix intentionnel. Nous avions pour habitude d’envoyer des communiqués de presse avec un nom différent à chaque fois. C’est par hasard que ce nom avait été utilisé le jour où l’armée a tiré à balles réelles sur l’un d’entre nous. Dans la frénésie médiatique qui a suivi, nous avons profité de notre notoriété et conservé ce nom.
Vingt ans plus tard, le projet AAtW n’existe plus, mais je pense qu’il y a des leçons à en tirer, à la fois positives et négatives. De la même façon que tout ça a commencé, l’AAtW n’a pas disparu à un moment donné, il s’est étiolé. Les anarchistes vivent dans la société contre laquelle iels luttent et ne sont pas immunisé·es à ses maux. La lutte contre les dynamiques de pouvoir est toujours difficile et je pense que, vers la fin, il était trop difficile de ne pas rester embourbé·es dans nos problèmes. On parle d’un groupe assez restreint de personnes dont les liens politiques ont été en grande partie forgés par l’affinité et la confiance. Un autre point important à souligner, la dissolution de l’AAtW a été contemporaine du reflux de la résistance palestinienne à la fin des années 2010.
Après que je sois déjà parti, le groupe s’est effondré en raison de désaccords fondamentaux sur les questions de violence et de non-violence. L’histoire de l’anarchisme contemporain en Israël publiée par CrimethInc. en 2013 raconte à mon avis assez bien cette partie de l’histoire, bien que je sois en désaccord avec certaines des autres questions abordées dans le texte.
Les anarchistes sont toujours impliqué·es dans la résistance au sionisme et à la colonisation israélienne. En accord avec ses « origines », le mouvement anarchiste en Israël reste aussi très attaché à la question du droit des animaux. Les gens qui font partie du mouvement sont impliqués dans le soutien aux réfugié·es et aux personnes sans-papiers, dans l’activité culturelle et contre-culturelle, dans l’éducation radicale, etc.
Cependant, bien que les anarchistes soient présent·es à chaque fois qu’un activisme radical émerge, j’ai l’impression qu’il n’existe pas de mouvement anarchiste distinct pour le moment, peut-être en raison de l’absence d’une forte tradition anarchiste ici.

Jonathan Pollak arrêté lors d’une manifestation dans le village cisjordanien de Nabi Saleh en 2011. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
De ce point de vue, qu’est ce qu’Anarchists Against the Wall a réussi à accomplir selon toi ? Quelles leçons – ou au moins quelles hypothèses – transmettrais-tu aux anarchistes d’ailleurs sur la base de tes expériences ?
Je pense qu’à cause de l’exposition relativement importante dont a bénéficié AatW, les gens ont tendance à faire de ce collectif plus que ce qu’il n’était en réalité. Au début, ce n’était guère plus qu’un petit groupe de personnes très déterminées, un groupe affinitaire élargi en fait. Il s’est ensuite un peu développé, avec quelques dizaines de personnes composant son noyau et peut-être quelques centaines d’autres gravitant autour de manière sporadique.
À mes yeux, la caractéristique la plus importante d’AAtW était l’abandon des fausses allégeances nationales et même des identités, en faveur d’un changement de camp pour rejoindre directement la lutte des Palestinien·nes contre le colonialisme israélien. Dans une société soudée et militariste comme Israël, c’était un écart considérable par rapport aux traditions de la gauche. Ce n’est sans doute pas grand-chose, mais c’était quand même extraordinaire. Notre but était de reconnaître notre position privilégiée, et de l’utiliser en la renversant dans notre relation avec la résistance palestinienne. Pas pour arriver comme des chevaliers blancs, mais plutôt comme une ressource. Nous avions comme principe de base de rejoindre la lutte palestinienne et de suivre les recommandations des Palestinien·nes.
Je crois que le fait de nous considérer comme des allié·es participant à la lutte plutôt que comme des sympathisant·es issu·es du contexte de la société israélienne a été la plus grande contribution de l’AatW, et celle qui a eu l’effet le plus durable, y compris en dehors de son cercle le plus proche.
En tant que groupe initialement petit et très soudé, il n’était au début pas nécessaire d’articuler beaucoup de questions. Certaines choses étaient très claires pour la plupart des personnes impliquées, alors qu’elles étaient très tabou dans la politique israélienne, même dans les franges les plus radicales – par exemple, notre attitude envers la violence, notre place dans la lutte ou notre position antagoniste vis-à-vis d’Israël. Tout cela s’est dilué et est devenu sans doute plus confus à mesure que le groupe a pris en importance. AAtW était à l’époque la seule organisation qui soutenait directement la résistance populaire en Cisjordanie, ce qui signifie qu’au fil du temps, des personnes ont rejoint le groupe en partageant certains des principes de base sans pour autant être d’accord avec l’orientation politique d’origine. Rétrospectivement, en commençant comme un petit groupe homogène d’action directe, nous n’avions pas à disposition les outils pour faire face à ce qui allait arriver.
Je suis à peu près certain que la solution ne se trouve pas dans une ligne politique stricte, mais je considère que les désaccords qui ont émergé sur des sujets comme le militantisme ou la question de savoir si nous devions adopter une perspective israélienne ou anti-israélienne ont été le principal catalyseur de mon départ du groupe. Peut-être que c’est la leçon à retenir, que la bonne vieille organisation anarchiste en groupes affinitaires est le meilleur moyen de permettre une organisation à plus grande échelle tout en conservant l’autonomie et la diversité, et sans forcer un compromis politique étouffant. Bien sûr, il n’existe pas de solution miracle, et certains des problèmes auxquels l’AAtW a été confrontée après mon départ n’avaient rien à voir avec tout cela, mais j’ai le sentiment qu’il s’agit quand même d’une leçon pertinente à retenir.
Quel impact le nouveau gouvernement a-t-il eu sur les sociétés israéliennes et palestiniennes dans leur ensemble ? Comment la nouvelle législation limitant les pouvoirs de la Cour Suprême peut-elle affecter la situation, à la fois pour toi personnellement, mais aussi pour les activistes en général ? [Cette question et la réponse qui suit ont été rédigées avant les événements du 7 octobre.]
Le gouvernement actuel est l’un des pires et des plus dangereux qu’Israël ait jamais connu, et pourtant la barre est haute. Il exprime et applique de manière flagrante des politiques de nettoyage ethnique. Les menaces qu’il représente sont nombreuses, mais la plus importante est sans doute celle qui lui est la moins spécifique : ce gouvernement est l’incarnation de la course effrénée de tous·tes les politicien·nes israélien·ne vers l’extrême droite. Le principal point de discorde au sein de la société israélienne, et celui qui attire le plus l’attention à l’échelle internationale, est l’attaque contre le système judiciaire – mais il s’agit là d’un désaccord presque esthétique, maquillé sous la forme d’une lutte pour la démocratie. En réalité, il s’agit d’un conflit interne sur la meilleure façon de gérer et de maintenir la suprématie juive, qui jouit d’un soutien presque total dans la société israélienne, y compris parmi les soi-disant libéraux.
Les changements spécifiques que la coalition actuelle cherche à mettre en œuvre affaibliront sans doute les tribunaux et les rendront certainement un peu moins libéraux, mais les tribunaux n’ont jamais défendu nos droits et encore moins ceux des Palestinien·nes, et n’ont jamais freiné les politiques gouvernementales. Même pas un peu. Le système judiciaire israélien est et a toujours été une pierre angulaire du colonialisme israélien entre le fleuve et la mer ; il a été essentiel pour permettre la mise en œuvre des politiques sionistes et fournir au système qui les entoure un habillage juridique libéral de bon aloi. Israël dépend de sa capacité à se présenter et à se vendre comme une soi-disant démocratie dynamique. L’affaiblissement du système judiciaire pourrait être préjudiciable, mais je crois que la perspective d’une victoire du mouvement de protestation représente un danger encore plus grand pour la lutte globale contre le colonialisme et l’apartheid.
Le mouvement de protestation est dominé par un amalgame de militaires réservistes, d’anciens hauts responsables de la célèbre police secrète israélienne, le Shin Bet, d’économistes libéraux, et de divers autres groupes de sionistes et de nationalistes. Quelques éléments plus radicaux se sont aussi impliqués, mais leur rôle et leur influence sont minimes. Le drapeau israélien est composé de symboles juifs, et est un emblème de l’exclusivité et de la suprématie juive, et ce n’est donc pas une surprise qu’il soit le principal symbole du mouvement de protestation. Ces groupes sont attachés à l’idée qu’Israël est une démocratie et que la suprématie juive n’est pas en contradiction avec cette idée. Dans l’ensemble, c’est aussi le sentiment le plus répandu parmi les foules qui participent aux manifestations. Toute victoire du mouvement sera utilisée pour renforcer l’idée erronée et dangereuse selon laquelle la démocratie israélienne a triomphé, suggérant à tort que la démocratie israélienne a déjà existé.

Manifestants à Beita. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Les anarchistes ont-ils joué un rôle dans les manifestations ?
La question de la participation aux manifestations a divisé les anarchistes locaux. Alors que beaucoup se sentent exclu·es, certain·es se sont impliqué·es dans le « Bloc radical », qui, comme son nom l’indique, est une coalition souple de radicaux·ales participant aux manifestations. De ce que j’en comprends, iels se considèrent davantage comme des contre-manifestant·es.
Bien que je respecte le choix d’essayer de mobiliser la société israélienne et les efforts qui sont investis là-dedans, je pense néanmoins qu’il s’agit d’une erreur étant donné les circonstances actuelles. Le mouvement de protestation est si vaste – et si fermement enraciné dans l’idée qu’Israël est une démocratie qui doit être sauvée – qu’il aspirera, cooptera ou éliminera toute tendance divergente en son sein. Pour les raisons expliquées précédemment, je crois que le mouvement actuel est peut-être la plus grande menace pour la lutte contre le colonialisme depuis les accords d’Oslo, et qu’Israël est capable de l’utiliser pour rétablir sa position internationale de la même façon que les accords d’Oslo avaient été utilisés pour se remettre de la Première intifada au début des années 1990. À cette époque, tout ce qui s’est passé en fin de compte, c’est le renforcement de la domination sur les Palestinien·nes et l’intensification de leur dépossession.
Dans les années 1990, l’extrême droite israélienne, qui considérait les accords d’Oslo comme un compromis défaitiste, s’y était opposée et était descendue massivement dans la rue. Nous aussi, nous opposions aux accords – car il était clair déjà à l’époque qu’ils seraient utilisés par Israël pour sa propre réhabilitation ou pire, pour éradiquer le soulèvement palestinien. À aucun moment, cependant, nous n’avons considéré rejoindre les manifestations massives de la droite pour contrecarrer l’exécution des accords. Je crois que la situation aujourd’hui est assez similaire. Peut-être qu’un exemple plus familier serait à chercher dans l’opposition de nombreux fascistes et nazis à la globalisation. Est-ce que quiconque pourrait ne serait-ce qu’imaginer se joindre à eux ?
Pour autant, mon malaise à l’idée de participer de près ou de loin aux manifestations pour la fausse démocratie est plus profond. Je pense que dans une situation coloniale comme celle de la Palestine, notre rôle n’est pas, et ne devrait pas être celui de modéré·es dans au sein d’une société coloniale. Nous devons rejeter cette société, son point de vue, sa politique interne. Nous devons comprendre que la disparité du pouvoir signifie que le changement ne peut pas venir de l’intérieur de la société israélienne. Notre rôle est de l’affaiblir, de créer des failles, de semer la division, de résister fermement. En période de conflit, nous ne devons pas essayer de nous frayer un chemin dans la société israélienne, mais de nous en éloigner et de lutter contre elle.
Depuis l’extérieur, toute la région ressemble à une poudrière prête à s’enflammer. Que faudrait-il pour que quelque chose de positif se produise ? Qu’est-ce qui te donne de l’espoir ?
Je ne préfère pas faire le commerce de l’espoir, car comme tout commerce, c’est un spectacle de tromperie. J’ai grandi dans le mouvement de libération animale du milieu et de la fin des années 1990, à l’époque de la première « Peur verte ». Je me souviens d’avoir lu une lettre que Free (Jeff Luers) avait envoyée depuis sa cellule à un zine, peut-être un an ou deux après sa condamnation, et qui a eu un impact durable sur moi. C’était il y a longtemps et je n’arrive pas à retrouver cette lettre même si internet est censé rendre les documents les plus rares accessibles d’un clic. Je vais sans doute répondre un peu à côté, mais Free, condamné à plus de vingt ans de prison, évoquait la rébellion du ghetto de Varsovie pour montrer que l’espoir ou la perspective de réussite n’est pas un critère pertinent de lutte ou de résistance. Cela a fait mouche pour moi à l’époque, et c’est encore le cas aujourd’hui.
Le futur ne peut pas être prédit. Un·e bon·ne ami·e qui avait été impliqué·e dans la résistance clandestine au régime d’apartheid en Afrique du Sud m’a confié que la fin des années 1980 avait été la période la plus sombre. [Le président Pieter Willem] Botha était au pouvoir, les États-Unis soutenaient encore fermement l’Afrique du Sud blanche en tant qu’important bastion antisoviétique, et la fin de l’apartheid était encore loin d’être en vue. Puis l’URSS s’est effondrée et la situation géopolitique a radicalement changé, presque du jour au lendemain. Au début, tout le monde croyait que tout était terminé, car les Soviétiques étaient les principaux soutiens de l’ANC. Mais un effet secondaire moins évident était que le gouvernement d’apartheid pro-occidental d’Afrique du Sud se trouvait soudainement beaucoup moins important dans le monde post-Guerre froide ; le fait qu’un fort mouvement existait déjà sur place pour profiter de ces changements géopolitiques a été à l’origine du changement politique et de la chute (imparfaite) de l’apartheid.
La morale de l’histoire c’est qu’il faut organiser et construire des mouvements de résistance même quand tout semble perdu. Ma vision de l’anarchisme n’est pas utopique. À mes yeux, chaque victoire, chaque succès, doit immédiatement être perçue comme un échec, comme une structure de pouvoir à combattre et à abattre. On dit que le mieux est l’ennemi du bien, mais c’est seulement parce qu’on manque d’imagination et que le bien n’est jamais assez bien. L’imperfection est une constante, mais on continue de se battre, transformant chaque victoire en défaite puis en lutte.

Jonathan Pollak escorté à une audience de placement en détention provisoire au tribunal de première instance de Jérusalem, les jambes entravées. Photographie de Oren Ziv/ActiveStills.
Appendice: Déclaration de Jonathan Pollak suite à sa condamnation
Dix manifestants ont été tués par les soldats israéliens dans le village cisjordanien de Beita près de Naplouse depuis que les manifestations ont commencé, en mai 2021. Le 27 janvier de cette année, j’ai été arrêté par des agents de la police aux frontières israélienne alors que je rentrais chez moi après une manifestation contre le colonialisme israélien et le vol des terres du village en vue de l’établissement d’une nouvelle colonie exclusivement juive. J’ai ensuite été inculpé pour jet de pierres, et je me tiens maintenant devant ce tribunal pour plaider ma cause. L’affaire repose uniquement sur les faux témoignages des trois agents de la police aux frontières qui m’ont arrêté. La police a refusé de mener une enquête sérieuse au-delà de ces témoignages, même après que j’ai explicitement rapporté avoir entendu les trois agents coordonner leurs témoignages entre eux. Contrairement à la police, qui ne pouvait pas se donner la peine de le faire, j’ai des preuves qui discréditent les témoignages des agents et montrent qu’ils sont truffés de mensonges. Dans des conditions normales, ce serait un procès que je serais heureux de laisser se dérouler jusqu’au bout.
Les circonstances, cependant, sont loin d’être normales. Cette affaire, de manière inhabituelle, se déroule après que l’accusé – moi – a demandé à ce que le procès se déroule non pas à la cour pénale israélienne, mais plutôt dans un tribunal militaire bien plus draconien, où les Palestinien·nes sont jugé·es pour des faits similaires. J’ai demandé à être jugé par un tribunal militaire, car c’est là que mes camarades palestinien·nes, qui sont régulièrement arrêté·es lors de manifestations comme celle après laquelle j’ai été arrêté, sont jugé·es et condamné·es à de lourdes peines sur la base de maigres preuves, souvent fabriquées de toutes pièces. Comme on pouvait s’y attendre, le procureur s’est opposé à cette demande et le tribunal l’a rejetée. Le raisonnement médiocre (et pas tout à fait exact) du procureur de la République était que mon lieu de vie ne se trouvait pas en Cisjordanie. Cependant, les colons israéliens qui vivent et travaillent en Cisjordanie ne sont, par principe, pas non plus inculpés par les tribunaux militaires. Où se trouve alors leur « lieu de vie » ? Le principal argument de la cour pour rejeter ma demande était que les délits pour lesquels j’étais poursuivi n’étaient pas classés comme des délits « de sécurité ».
Je ne suis pas expert en droit et je n’ai pas les outils pour évaluer la légalité de la décision de la cour, et je n’y accorde de toute façon pas beaucoup d’importance. Mais une chose est sûre : les Palestinien·nes, et pas seulement celles et ceux qui vivent directement sous la dictature militaire qu’Israël exerce en Cisjordanie, sont jugé·es par milliers dans les tribunaux militaires israéliens pour des chefs d’accusation identiques ou similaires. Je ne suis épargné d’un tel sort que parce que l’État me considère à la fois comme un citoyen et comme un membre de la religion juive dominante. Mon ami Tareq Barghouth – un Palestinien habitant à Jérusalem et ancien membre du barreau israélien – a été jugé, reconnu coupable et condamné par un soldat israélien en uniforme dans un tribunal militaire en Cisjordanie. Pendant ce temps, Amiram Ben Uliel, un habitant d’un avant-poste colonial israélien en Cisjordanie et meurtrier de la famille Dawabsheh, qui a été reconnu coupable d’infractions terroristes autrement plus graves, a été jugé dans un tribunal civil à Jérusalem.
Il y a à peine deux mois, des colons israéliens ont abattu Qussai Ma’atan dans le village de Burqa en Cisjordanie. Deux colons ont été arrêtés pour suspicion de meurtre. Au même moment, des habitants de Burqa ont également été arrêtés pour des soupçons bien moins graves, à savoir d’avoir participé aux affrontements qui ont suivi l’invasion de leur village par des colons. Plusieurs audiences ont eu lieu dans l’affaire des colons. Elles ont été tenues dans un tribunal civil israélien, avant même qu’une seule audience ait eu lieu dans l’affaire des Palestiniens, qui a été jugée par un tribunal militaire. La raison est simple, les Palestinien·nes ne doivent être présenté·es à un tribunal qu’après un délai de 96 heures, soit quatre fois le délai prévu par le Code pénal israélien.
Cette politique discriminatoire a beau en effet être considérée comme légale selon les standards de la loi israélienne, au fond, dans son cœur, elle n’en reste pas moins l’expression distincte du régime d’apartheid d’Israël entre le fleuve et la mer.
Mais la loi n’est pas la justice. L’apartheid sud-africain était protégé par la loi en son temps, comme le colonialisme français en Algérie, la suprématie blanche en Rhodésie et d’innombrables autres régimes coloniaux vaincus qui étaient manifestement injustes. La loi, dans les faits, est souvent conçue pour être le contraire de la justice.
L’injustice du statu quo est si évidente et indéniable que même l’ancien chef du célèbre Mossad, Tamir Pardo, a été récemment forcé de reconnaître que « dans un territoire où deux peuples sont jugés selon deux systèmes judiciaires, il s’agit d’un État d’apartheid. »
Cette affaire, malgré ce que la lecture de l’acte d’accusation pourrait laisser penser, n’a pas grand-chose à voir avec une émeute, ou avec l’obstruction et l’agression de policiers, mais plutôt avec la répression et la criminalisation de la résistance au colonialisme israélien et à son régime d’apartheid. Ma réponse aux accusations et aux faits décrits dans l’acte d’accusation n’est pas pertinente. Puisque la manière même dont cette audience est menée est une expression de l’apartheid israélien, ma coopération serait de la complaisance. Depuis plus de vingt ans j’ai consacré mon temps à lutter contre le régime colonial d’Israël, et je ne veux ni ne peux coopérer avec lui maintenant, même si ma décision signifie que je serai à nouveau mis derrière les barreaux.
Par conséquent, bien que n’ayant aucune intention d’admettre quelque chose que je n’ai pas fait, je n’interrogerai pas les témoins de l’État, je n’appellerai personne pour me défendre et je ne témoignerai pas moi-même ; je ne contesterai pas les soi-disant preuves de l’accusation ni ne présenterai la moindre preuve pour me défendre. Le colonialisme israélien et son régime d’apartheid sont illégitimes dans leur essence même. Ce tribunal est illégitime. Les procédures dans cette affaire, qui complètent d’autres procédures dans des tribunaux militaires parallèles et illégitimes, dont la raison d’être est la suppression de la résistance, sont toutes illégitimes. La seule réponse raisonnable à cette accusation, à cette réalité, est la lutte pour la liberté et la libération. Aucune voix n’est plus forte que celle du soulèvement !
23.09.2023 à 11:52
Paroles d’anarchistes d’Arménie et d’Azerbaïdjan : Sur la violence au Haut-Karabakh
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (6527 mots)

Cette semaine, un nouveau cycle de violences a éclaté dans la zone contestée du Haut-Karabakh, également connue sous le nom d’Artsakh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Des anarchistes en Arménie et en Azerbaïdjan proposent leur analyse de la situation.
Contexte
Le génocide arménien a laissé une profonde cicatrice sur la région située entre la mer Égée et la mer Caspienne. Il y a une centaine d’années, le gouvernement de l’Empire ottoman supervisait le meurtre de plus d’un million d’Arménien·nes, ouvrant ainsi la voie à l’émergence de la Turquie en tant qu’état ethnonationaliste.
Suite à un pogrom ayant ciblé les Arménien·nes dans la ville azerbaïdjanaise de Soumgaït en février 1988, le mouvement d’indépendance arménien prend de l’ampleur en Union soviétique, et particulièrement au Haut-Karabakh, une région à majorité arménienne entourée de régions à majorité azerbaïdjanaise. En décembre 1991, peu après la déclaration d’indépendance de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, les Arménien·nes du Haut-Karabakh déclarent leur indépendance de l’Azerbaïdjan. Les deux gouvernements entrent en guerre pour le contrôle de cette région. Le conflit n’a pas été résolu et les hostilités ont repris en 2020.
Jusqu’à présent, le gouvernement de Russie avait joué le rôle de médiateur en négociant le cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et en installant des troupes de « maintien de la paix » au Haut-Karabakh. Mais alors que la Russie est enlisée en Ukraine et se trouve de plus en plus dépendante du gouvernement turc, le gouvernement azerbaïdjanais a pu profiter du soutien du président turc Recep Tayyip Erdoğan et de la richesse provenant de l’augmentation des revenus pétroliers pour reprendre les hostilités. Dans un premier temps, le Haut-Karabakh a été soumis à un blocus qui l’a privé de ses ressources, puis, cette semaine, l’armée azerbaïdjanaise a attaqué la région, tuant au moins plusieurs dizaines de personnes. Bien que le gouvernement autoproclamé du Haut-Karabakh ait capitulé, le dernier chapitre de cette tragédie ne fait que commencer. Il y a lieu de s’attendre à une poursuite de la violence d’État, à des nettoyages ethniques et à des déplacements de population, ce qui ne pourra qu’aggraver la crise des réfugié·es en Arménie et dans les zones alentour.
Comme nous l’avions anticipé, la guerre continue de s’étendre dans la région, du Yémen à la Syrie, et de l’Ukraine à l’Arménie. :
L’invasion de l’Ukraine préfigure sans doute ce qui risque d’arriver ailleurs. Au cours des dernières décennies, les gouvernements du monde entier ont investi des milliards de dollars dans les technologies de maintien de l’ordre et les équipements militaires tout en ne prenant que très peu de mesures pour lutter contre l’accroissement des inégalités ou la destruction de l’environnement. Alors que les crises économiques et écologiques s’intensifient, de plus en plus de gouvernements chercheront à résoudre leurs problèmes intérieurs en engageant des conflits avec leurs voisins.
En tout état de cause, cette analyse sous-estime le rôle des conflits ethniques alimentés par l’État pour faire office de soupapes de pression afin de pallier aux échecs du capitalisme et de l’État – non seulement en Palestine, en ex-Yougoslavie et au Kurdistan, mais également aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump.
Les violences dans le Haut-Karabakh démontrent une nouvelle fois que les individus ne peuvent pas compter sur les structures de l’État pour les protéger. Confronté·es à une campagne de violence ethnique qui dure depuis des siècles, les habitant·es sont pris·es au piège entre le gouvernement azerbaïdjanais qui cherche à s’emparer de leurs terres et de leurs ressources, et le gouvernement arménien, qui a abandonné toute prétention à assurer leur sécurité. Ni le gouvernement russe ni les gouvernements européens ne souhaitent intervenir. Tous ces gouvernements se livrent dans les faits à des rackets à la protection, qui laissent les habitant·es à la merci de l’ethnonationalisme et du militarisme d’État.
Il ne s’agit pas d’un argument pour soutenir l’armée arménienne. Au fil des ans, le gouvernement arménien, ses forces militaires et ses soutiens ont également commis le genre d’atrocités qui se produisent généralement lors de conflits portant sur les territoires et les ressources. Il est donc urgent de s’organiser contre les conflits ethniques, la violence d’État et la conquête coloniale sous toutes leurs formes. Pour être efficace, cette lutte doit avoir lieu de part et d’autre de chaque frontière, de part et d’autre de chaque conflit.
Nous présentons ici un extrait d’une déclaration anti-guerre provenant d’Azerbaïdjan ainsi que trois textes d’anarchistes d’Arménie.

Mouvements anti-guerre en Azerbaïdjan
Il a été difficile de maintenir le contact avec les anarchistes et les autres autres groupes anti-autoritaires en Azerbaïdjan, notamment à cause de la politique de répression en cours actuellement. Comme d’habitude, la répression interne est une composante essentielle pour créer les conditions d’une mobilisation contre un ennemi extérieur, qui sert alors à détourner l’attention des problèmes intérieurs. Le gouvernement d’Azerbaïdjan a par exemple utilisé des logiciels espions à la fois pour cibler des personnes en Arménie et pour mettre en place une vague d’arrestations visant les éléments de la société azerbaïdjanaise qui s’opposent à la guerre.
Pour une perspective anti-guerre depuis l’Azerbaïdjan, on pourra lire l’extrait suivant d’un manifeste anti-guerre publié par des anarchistes et des « jeunes de gauche » en 2020:
La récente phase d’escalade entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Haut-Karabakh démontre une fois de plus à quel point le cadre de l’État-nation est dépassé par les réalités actuelles. Le seul ennemi que nous ayons à combattre est notre incapacité à dépasser la logique de division des personnes entre humain·es et non-humain·es sur la seule base de leur lieu de naissance. Elle ne mène qu’à l’établissement de la supériorité des « humain·es » sur les « autres » déshumanisé·es comme seule façon de penser la vie commune à l’intérieur de certaines frontières territoriales. Cette logique qui occupe nos esprits et nous empêche de penser au-delà des narratifs et d’imaginer nous-mêmes nos vies est celle que nous imposent les gouvernements nationalistes prédateurs.
C’est elle qui nous rend inconscient·es des conditions d’exploitation de notre propre survie dans nos pays respectifs dès que la « nation » lance son appel pour la protéger de « l’ennemi ». Notre ennemi n’est pas un·e quelconque arménien·ne que nous n’avons jamais rencontré·e et que nous ne rencontrerons probablement jamais. Notre ennemi, ce sont les gens au pouvoir qui appauvrissent et exploitent les gens et les ressources de notre pays à leur profit depuis plus de vingt ans.
Ils ont été intolérants à l’égard de toute dissidence politique, opprimant sévèrement les dissident·es à l’aide de leur gigantesque appareil de sécurité. Ils se sont accaparé des sites naturels, des littoraux, des ressources minérales pour leur propre plaisir et usage, et en ont limité l’accès pour les citoyens ordinaires. Ils ont détruit notre environnement, abattu des arbres, contaminé l’eau et procédé à une « accumulation par dépossession » à grande échelle. Ils sont complices de la disparition de sites et d’objets historiques et culturels à travers tout le pays. Ils détournent les ressources de secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection sociale au profit de l’armée, permettant à nos voisins aux ambitions impérialistes – la Russie et la Turquie – d’engranger des bénéfices.
Curieusement, tout le monde est conscient de ce fait, mais une soudaine amnésie collective frappe dès que la première balle est tirée à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
Nous recommandons également la lecture de cette déclaration du Collectif féministe pour la paix en Azerbaïdjan :
Nous nous opposons avec véhémence à cet endoctrinement et rejetons l’asservissement des personnes au nom de la nation, fondée sur la haine et l’altérisation. Nous appelons l’Azerbaïdjan à mettre fin à la terreur qu’il exerce à l’encontre des populations arméniennes du Karabakh. Notre appel s’étend au peuple d’Azerbaïdjan, que nous exhortons à faire preuve de rationalité et d’empathie, et à ne pas admettre que leurs griefs soient instrumentalisés pour les désirs nationalistes du régime, et à ne pas permettre que leurs corps soient exploités pour la cupidité capitaliste de l’État et de l’élite dirigeante.

La situation en Artsakh, les conditions en Azerbaïdjan
Ceci est le point de vue d’un anarchiste russe vivant en exil à Erevan.
Le 19 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé son opération « anti-terroriste » contre le Haut-Karabakh. Des rapports font déjà état de victimes civiles.
Malgré la capitulation des autorités de la république autoproclamée et les négociations récemment entamées entre les dirigeants militaires et politiques, l’Azerbaïdjan continue de bombarder Stepanakert et d’autres zones peuplées de l’Artsakh. La résistance spontanée de la population locale continue également. On rapporte que les habitant·es de certains villages auraient refusé d’être évacué·es et auraient affirmé préférer mourir que partir. Des combats désespérés se poursuivent, opposant des fusils yougoslaves à des drones.
Nous avions déjà exprimé notre soutien aux victimes de l’agression azerbaïdjanaise, tout comme nos camarades de la diaspora anarchiste russe de Tbilisi, qui s’organisent également dans leur communauté là-bas. Nos camarades ici à Erevan ont collecté de l’aide humanitaire pour venir en aide aux réfugié·es. Le café « Mama-jan » coopère avec la diaspora juive de la ville, et ouvre ses portes pour rassembler de l’aide pour celles et ceux qui souffrent.
De notre point de vue, le gouvernement azerbaïdjanais cherche à mettre en place la « solution finale à la question arménienne » dans le territoire du Haut-Karabakh.
Ce conflit a commencé à la fin des années 1980. Dans un contexte de libéralisation, les Arménien·nes du Haut-Karabakh sont descendu·es dans les rues par dizaines de milliers pour protester contre la violation de leurs droits dans l’Azerbaïdjan soviétique et pour demander la réunification avec leur patrie historique, l’Arménie, divisée au début du XXe siècle entre les bolchéviques et les Turcs kémalistes. La population arménienne de la ville de Soumgaït faisait face à la fois à la répression et aux pogroms. Une guerre a commencé, accompagnée d’une épuration ethnique, et a entraîné le déplacement de centaines de milliers de réfugié·es des deux côtés. L’Azerbaïdjan a perdu la guerre, mais ne s’est pas réconcilié.
Il est important de comprendre la guerre dans le contexte politique et social existant en Azerbaïdjan. La famille Aliyev a régné sur l’Azerbaïdjan pendant des décennies. Selon Bashir Kitchaev, un journaliste anti-guerre avec qui j’ai eu le plaisir de communiquer personnellement à Tbilisi, ils n’ont pas fait grand-chose pour la population, qui connaît des conditions de pauvreté généralisées ; au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l’agrandissement de l’armée azerbaïdjanaise et sur la propagation de la haine ethnique.
Aux côtés du gouvernement turc, le gouvernement azerbaïdjanais participe à une campagne internationale visant à nier le génocide arménien, qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes, ainsi qu’à mettre en place un embargo économique de l’Arménie. Les enfants azerbaïdjanais apprennent à l’école que « les Arménien·es sont des ennemi·es ». Les Aliyev ont systématiquement entrepris de détruire les monuments arméniens – ils ont par exemple détruit, dans la région du Nakhichevan, le cimetière de khatchkars de la ville de Djoulfa et l’ont transformé en terrain d’entraînement militaire. Tout cela a pour but d’effacer l’héritage culturel arménien de ces terres.

Erdoğan et Aliyev.
En 2020, l’armée azerbaïdjanaise a repris ses opérations en pleine pandémie, en employant des groupes islamistes qui avaient précédemment participé aux offensives contre les Kurdes à Afrin ainsi qu’en utilisant des armes turques, et notamment des armes à sous-munitions. Par la suite, le président Ilham Aliyev a créé le soi-disant « Musée de la victoire », exposant publiquement des statues de cire représentant des soldats arméniens et des casques pris à des Arméniens qui avaient été tués.
Les provocations se sont poursuivies malgré les accords de cessez-le-feu. L’armée azerbaïdjanaise a ouvert le feu à plusieurs reprises, enlevé des personnes, bombardé et occupé le territoire internationalement reconnu de la République d’Arménie, puis à partir du 12 décembre 2022, a bloqué la région du Haut-Karabakh, interdisant l’accès à la seule autoroute reliant les Arménien·nes de cette région au reste du monde.
Cela a fait de 120 000 Arménien·nes, dont 30 000 enfants, des otages. Le gouvernement azerbaïdjanais a interrompu l’approvisionnement en gaz et en électricité pendant le rude hiver caucasien. Des milliers d’écoles et de crèches ont été fermées. La nourriture a commencé à disparaître des rayons, la famine a éclaté et les hôpitaux ont commencé à manquer de médicaments.

Le « Musée de la victoire » en Azerbaïdjan.
Le 23 avril 2023 – date dédiée à la mémoire des victimes du génocide de 1915 – Aliyev a mis en place un checkpoint militaire et posé aux Arménien·nes du Haut-Karabakh un ultimatum : accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise ou être expulsé·es.
Aujourd’hui, après avoir affamé plus de cent mille personnes pendant plusieurs mois, le régime profite du fait que l’attention publique est tournée vers la guerre en Ukraine pour mener à bien son nettoyage ethnique.
Une victoire azerbaïdjanaise aggravera la violence ethnique dans la région, et mettra en danger la vie de milliers de personnes. Elle renforcera le régime qui a persécuté et torturé les anarchistes azerbaïdjanais et la gauche anti-guerre et consolidera la position de l’impérialisme turc. Elle pourrait aussi remettre en question l’indépendance de l’Arménie.
Aliyev a parlé à plusieurs reprises du soi-disant « corridor de Zangezur », une autre partie de l’Arménie qu’il cherche à incorporer à l’Azerbaïdjan ; il a déclaré : « Erevan est notre terre historique, et nous, Azerbaïdjanais, devons retourner sur ces terres historiques ». Dans le contexte du bombardement de Sotk, de Djermouk et des autres territoires d’Arménie, cela suscite certaines craintes.
Ces déclarations visent-elles simplement à renforcer la position du gouvernement azerbaïdjanais dans les négociations ou reflètent-elles une intention sérieuse ? Difficile à dire. Mais il est indiscutable que toute victoire du militarisme azerbaïdjanais ou de l’impérialisme turc représentera un recul pour les anarchistes et les autres mouvements sociaux, car elle établira un régime militaire dans les territoires conquis qui s’intensifiera et s’étendra à la fois vers l’extérieur et l’intérieur. Une terre brûlée pour les anti-autoritaires.
Je suis le dernier à défendre l’État arménien avec sa ploutocratie et ses violences policières, mais le gouvernement azerbaïdjanais ne représente pas une meilleure alternative. Diverses organisations, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières, et d’autres encore critiquent le gouvernement azerbaïdjanais et le qualifient d’autoritaire. Dans le classement de la Freedom House qui classe les pays selon leur liberté politique, l’Arménie et République non reconnue du Haut-Karabakh sont placées bien plus haut en termes de droits humains et de démocratie que l’Azerbaïdjan.
Selon des militants des droits humains, il y a environ cent prisonniers politiques dans les prisons azerbaïdjanaises. Les journalistes sont emprisonné·es, soumis·es au chantage et contraint·es à l’exil. Le pays a récemment adopté une « loi sur les médias » par laquelle les autorités comptent faire disparaître le journalisme indépendant. Les journalistes qui ont fui le pays font face à des menaces d’enlèvement et l’un d’entre eux aurait subi trois tentatives d’assassinat.
Le gouvernement d’Azerbaïdjan entretient un culte de la personnalité autour d’Heydar Aliyev, le père du président actuel. En 2016, lors d’une des fêtes dédiées à l’ancien dictateur, deux anarchistes azerbaïdjanais ont été arrêtés – Giyas Ibrahimov and Bayram Mamedov.
Ils avaient tagué des messages anarchistes sur un monument dédié au dictateur dans la capitale, Bakou. La police les a arrêtés, torturés et emprisonnés sur la base de fausses accusations liées à la drogue ; ils prétendent avoir trouvé exactement un kilogramme d’héroïne dans chacune de leurs maisons. Mamedov est décédé plus tard dans un accident à Istanbul. Les organisations de défense des droits humains ont reconnu Giyas Ibrahimov comme un prisonnier d’opinion. Lors du déclenchement de la deuxième guerre du Haut-Karabakh, Giyas a signé la déclaration de la jeunesse de gauche contre la guerre ce qui lui a valu de subir à nouveau la répression.
Bayram Mammadov et Giyas Ibrahimov face à la sentence. Dans cette séquence, l’avocat Elchin Sadigov déclare que Bayram Mammadov a indiqué dans sa déposition au tribunal que les accusations de trafic de drogue portées contre eux étaient des représailles pour les graffitis sur la statue ; les proches de Bayram ont déclaré qu’il ne fumait même pas. L’avocat affirme également que Giyas Ibrahimov avait refusé de témoigner sous la torture au cours de l’enquête.
Les minorités nationales autochtones sont également victimes de discrimination de la part du gouvernement azerbaïdjanais. Certains peuples, comme les Tats, ne peuvent pas étudier leur propre langue dans les établissements d’enseignement. Dans les zones densément peuplées par de petits groupes ethniques, la plupart des pouvoirs politiques et économiques sont concentrés dans les mains des Azerbaïdjanais·es de souche. Les Talysh vivant dans le sud du pays se voient interdire l’utilisation du mot « Talysh », que ce soit sur les panneaux des restaurants ou dans les livres d’histoire locale. Les représentant·es de groupes minoritaires qui s’expriment sont confrontés à la répression et aux accusations d’« extrémisme » et de « séparatisme ». Par exemple, l’un des dirigeants du mouvement Sadval, qui militait pour l’autonomie des Lezgins en Russie et en Azerbaïdjan, a été emprisonné et tué.
Aliyev était l’un des principaux alliés d’Erdoğan quand la Turquie a envahi le Rojava. La victoire d’Aliyev dans le Haut-Karabakh va conforter ceux qui cherchent à faire advenir un empire pan-turc, en intensifiant la pression sur les mouvements anti-coloniaux et anti-autoritaires dans toute la région.

L’anarchiste Giyas Ibrahimov fait une nouvelle fois face à la répression pour une déclaration anti-guerre en 2020.
Pendant des milliers d’années, les habitants de l’Artsakh ont vécu sur ces terres, ont construit des écoles, des maisons et des temples. L’anarchiste arménien Alexander Atabekyan est né en Artsakh et s’est lié d’amitié avec Pierre Kropotkine. Nous nous rappelons de ses mots :
« Le lien naturel avec son foyer, avec la patrie au sens littéral du terme, devrait être appelé territorialité, par opposition à la souveraineté étatique, qui est une unification forcée au sein de frontières arbitraires.
L’anarchisme, tout en rejetant la souveraineté étatique, ne peut pas nier la territorialité.
L’amour de la terre natale et de la tribu non seulement n’est pas étranger, mais est en fait caractéristique d’un·e anarchiste, comme de toute autre personne. »
À la suite des anarchistes au Rojava, nous appelons à soutenir le peuple de l’Artsakh.
Liberté pour les peuples – mort aux empires !
Artsakh, nous sommes avec toi !

Le graffiti peint par Bayram Mammadov et Giyas Ibrahimov: « Nique le système ».
La situation à Erevan
Sona, une anarcha-féministe arménienne parle des manifestations à Erevan, des machinations des politicien·nes arménien·nes, et de l’avenir incertain de la région.
Les manifestations ont commencé dans la soirée du 19 septembre. Les manifestant·es ont commencé à se rassembler à deux endroits à Erevan : le bâtiment du gouvernement sur la place de la République et l’ambassade de Russie. Les expatrié·es russes ont également organisé un petit rassemblement au monument Myasnikyan.
Le 19 septembre, des manifestant·es ont commencé à se rassembler spontanément sur la place de la République, mais dans l’après-midi du 20 septembre, les forces politiques de Robert Kocharyan s’y étaient déjà organisées pour monopoliser l’espace. Elles représentent quelque chose d’encore pire pour le gouvernement qui dirige actuellement l’Arménie. Kocharyan a été le deuxième président de ce pays ; bon ami de Poutine, il représente une politique pro-Kremlin. Pour les partisan·nes de Kocharyan, les rassemblements offrent une opportunité d’améliorer leur position et de s’approcher du pouvoir, mais cela n’aidera pas les habitant·es du Haut-Karabakh ou les réfugié·es qui arriveront de cette région.
Les soutiens de Kocharyan demandent la démission de Nikol Pashinyan, l’actuel Premier ministre arménien, et déclarent être prêt·es à partir en guerre, bien qu’il soit en réalité trop tard pour combattre – l’Artsakh s’est déjà rendu. La police a attaqué les manifestant·es avec des grenades assourdissantes.
Un peu moins de personnes s’étaient rassemblées à l’ambassade russe ; le rassemblement qui s’y est déroulé concernait des forces qui soutiennent le gouvernement actuel. Bien qu’un canal telegram ait annoncé que des membres de l’intelligentsia et du mouvement de gauche s’étaient rassemblés à l’ambassade, ce n’était pas exact, ne serait-ce que parce qu’il n’existe pas de mouvement de gauche en Arménie.
Le canal telegram progouvernemental Bagramyan 26 a appelé à bloquer l’ambassade russe, mais tout en restant poli·es avec la police. La police n’a rien fait lors de ce rassemblement, bien qu’il ait été interdit tout comme la manifestation à la place de la République.
C’est toute l’hypocrisie de notre gouvernement : il interrompt un rassemblement et en autorise un autre. Mais la responsabilité de l’abandon de l’Artsakh n’incombe pas seulement au Kremlin, mais également au gouvernement de Pashinyan, ainsi qu’aux précédentes forces politiques qui ont dirigé l’Arménie. Les problèmes qui ont mené à la guerre de 2020 à la situation actuelle ne datent pas d’hier ; tout un ensemble de forces politiques en Arménie et dans d’autres pays est impliqué.
La démission de Pashinyan ne ramènera pas celles et ceux qui sont mort·es dans cette guerre ni dans celle de 2020, ni dans les précédentes ; elle n’aidera en rien les habitant·es de l’Artsakh. Elle n’aidera pas les personnes qui ont été privées de leurs maisons, de leurs terres ou de leur santé, qui ont été affamées pendant plusieurs mois. L’Artsakh n’existe plus, c’est tout. Si les forces pro-Kremlin arrivent au pouvoir, l’Arménie deviendra une enclave de la Russie.
La position actuelle du gouvernement de Pashinyan est de ne pas interférer dans le conflit entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan. C’est une position pour le moins hypocrite, étant donné que tous·tes les résident·es de l’Artsakh disposent de passeports arméniens et qu’iels utilisent la monnaie arménienne. L’Artsakh est quasiment un État arménien. Des Arménien·nes comme nous y vivent.
Pashinyan est un politicien pro-occidental. Il a commencé à critiquer le Kremlin, menaçant de quitter l’OTSC [Organisation du traité de sécurité collective, dont font partie l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan]. Ces derniers mois, il a déclaré que l’Arménie n’était pas un allié de la Russie dans la guerre avec l’Ukraine et a commencé à envoyer de l’aide humanitaire en Ukraine. Si le gouvernement de Pashinyan reste au pouvoir, l’Arménie deviendra un pays plus orienté vers l’Europe tout en cédant des territoires les uns après les autres.
Il existe une troisième option, mais elle est peu probable. Une junte militaire pourrait prendre le pouvoir. Mais ce serait également un mauvais scénario.
La reddition de l’Artsakh est la dernière frontière qui sépare l’Azerbaïdjan de l’annexion de territoires arméniens. Si l’Arménie rend l’Artsakh sans même tirer un coup de feu en réponse, cela signifie que d’autres provinces se rendront tout aussi facilement – la prochaine sera Syunik, puis Sevan. La question de savoir si l’Arménie sera encore sur les cartes dans cinquante ans reste ouverte.
Il existe plusieurs positions au sein de notre cercle anarchiste à Erevan, mais tout le monde s’accorde pour dire que l’agression de l’Azerbaïdjan en Artsakh est un acte de génocide. Nous y voyons l’influence du Kremlin, le résultat de la géopolitique russe.
Hier, j’étais sur la place de la République, avant qu’elle ne soit reprise par les forces pro-Kocharyan. J’ai pensé qu’il était de mon devoir d’être au côté des parents des soldats morts, aux côtés des habitant·es de l’Artsakh qui ont été évacué·es en 2020, aux côtés de mes compatriotes qui expriment leur protestation contre l’inaction de l’armée et des autorités arméniennes.
Je vis personnellement cette situation avec beaucoup d’émotion. Je ne peux pas demander la démission de Pashinyan parce qu’il n’existe pas de meilleure alternative actuellement, mais je réalise que le gouvernement a fait de cette situation un véritable gâchis. Je ressens une grande solidarité avec mes compatriotes et j’ai de la peine pour toutes celles et ceux qui sont morts dans cette guerre et dans celle des années 1990.
Je réalise que tous ces sacrifices ont été vains. Tout est perdu. Je participe moi-même aujourd’hui à la collecte d’aide humanitaire. C’est particulièrement important compte tenu de l’expérience de 2020, quand l’État ne s’est pas occupé des réfugié·es. Iels étaient simplement installé·es dans une usine désaffectée, dans laquelle il n’y avait absolument rien, seulement des murs nus. Ce sont des bénévoles qui ont installé eux-mêmes des toilettes dans le bâtiment.
Je n’encourage pas les gens à se rendre aux rassemblements. Le premier jour, de nombreuses personnes ont participé aux rassemblements et ce qui s’est passé était largement spontané. Mais depuis, chaque point de rassemblement public a été saisi par un politicien et ses partisans.
À la place, je vous suggère plutôt de vous rendre à notre point de collecte d’aide humanitaire, l’espace de co-working Letters and Numbers dans la rue Tumanyan. Ramenez de l’aide humanitaire et participez au tri afin que, lorsque les réfugié·es arriveront, nous soyons prêt·es à leur donner quelque chose. C’est maintenant très important pour aider des milliers de personnes de l’Artsakh, mais nous n’avons pas encore assez de bras.
Initiatives humanitaires en Arménie
- L’espace Letters and Numbers et la Banque alimentaire arménienne ont ouvert un point de collecte d’aide humanitaire. Merci d’amener de la nourriture non périssable et des vêtements à St. Tumanyan, 35G, Yerevan.
- Le fond bénévole d’aide aux victimes de la guerre « Ethos » St. Khorenatsi 30, Yerevan.
- La collection de Sasha Manakina peut être consultée sur ce lien. Sasha est l’une des héroïnes du nouveau zine Alarm !
- La Viva Charitable Foundation fournit des médicaments, soigne les blessé·es et aide l’Artsakh depuis 2016.
Analyse : l’Arménie en 2023
Après la publication des textes précédents, nous avons reçu l’analyse suivante de Garren, un libraire anarchiste installé à Erevan.
Le 19 septembre 2023, les forces armées de l’Azerbaïdjan ont lancé une opération « anti-terroriste » contre les Arménien·nes du Haut-Karabakh – une tentative d’exterminer pour de bon la population arménienne du Karabakh.
Pour le peuple arménien, la question du Karabakh a une signification double. La première guerre dans les années 1990, la victoire initiale contre l’Azerbaïdjan, et les échecs diplomatiques des dirigeants politiques arméniens de l’époque ont défini la vie des Arménien·nes au cours des décennies qui ont suivi. Dans le même temps, la crise du Karabakh a été utilisée pour étouffer les dissensions et décourager les critiques du nationalisme arménien et, jusqu’en 2018, pour exercer un chantage à la guerre sur les Arménien·nes (la stratégie favorite du régime de Kocharyan).
Kocharyan et ses alliés n’ont pas exactement échoué dans leurs tentatives de négocier la paix en 1997-1998. Ils ont plutôt consciencieusement saboté toute tentative de paix par arrogance et par supériorité présumée sur l’Azerbaïdjan, puis utilisé le capital social qu’ils avaient acquis en tant que victorieux combattants en Artsakh pour transformer l’Arménie en un fief personnel dans lequel ils pourraient amasser des fortunes. Le régime précédent a profité de la misère de la guerre pour s’enrichir et pour vendre l’Arménie au plus offrant, en l’occurrence aux capitalistes russes et arméniens.
En bref, ils ont privé les Arménien·nes de leur avenir en échange de capitaux et du contrôle d’une nation entière. Et maintenant, après une nouvelle atteinte aux droits des Arménien·nes du Karabakh, ces mêmes forces de l’ombre appellent à un coup d’État en Arménie pour renverser l’administration démocratiquement élue de Nikol Pashinyan.
Le manque de qualifications politiques de Pashinyan a été illustré lors d’une visite à Stepanakert en 2019, durant laquelle il a affirmé de manière provocante que « l’Artsakh est l’Arménie ». Si la République d’Arménie avait pris des mesures pour reconnaître officiellement l’Artsakh, peut-être que ses mots n’auraient pas été si imprudents. Mais le fait que toutes les entités internationales aient reconnu le contraire montre que cette phrase ne pouvait être qu’une provocation irréfléchie et inutile. L’insouciance et l’esprit de clocher ont tendance à caractériser les nationalistes ; outre le caractère populiste de l’administration Pashinyan, celle-ci ne semble pas faire exception à la règle.
N’importe qui pourrait vous dire que la vie en Arménie depuis 2018 est nettement différente de ce qu’elle était précédemment. Les progrès sociaux qui avaient été accomplis ont été stoppés net par la guerre de 2020. Les événements de la semaine dernière correspondent au pivot stratégique de la République d’Arménie vers l’ouest, une démarche clairement méprisée par les dirigeants politiques russes, comme on peut le voir au travers des récentes déclarations de Marie Zakharova et de Dmitry Peskov. L’administration Pashinyan n’a d’autre choix que de se tourner vers un Occident indifférent qui ne s’intéresse pas vraiment au bien-être des Arménien·nes, mais qui cherche à capitaliser sur la présence chancelante de la Russie dans le Caucase du Sud pour ses propres raisons géopolitiques et économiques. La soi-disant « opposition » a disposé de deux opportunités pour congédier l’administration actuelle par les urnes, mais leur incompétence mêlée à la puanteur persistante de décennies de gouvernement autoritaire a rendu la chose impossible. Maintenant leurs bienfaiteurs tentent de mettre en œuvre la stratégie favorite des nationalistes conservateurs : le coup d’État.
Lorsque les Arménien·nes ont pris des mesures pour se libérer de leur dépendance économique et de la mentalité coloniale servile que leur imposait un impérialisme russe toujours plus fragile, le gouvernement russe (qui ne pouvait pas risquer d’endommager sa relation avec la Turquie) a autorisé l’Azerbaïdjan à exercer une pression sur les Arménien·nes par le biais d’un blocus économique, de la torture exercée à la fois sur les combattants et les civils, et d’actes de guerre. De même, ils encouragent les troubles politiques en Arménie par l’intermédiaire de leurs services de renseignement et de leurs partisans poutiniste-kocharyotes.
Dans notre ère politique de plus en plus polarisée, interdépendante et volatile, une tendance a empoisonné le discours politique populaire. Les gens ont tendance à se focaliser uniquement sur les mots et les actions d’un Premier ministre, d’un président ou d’un dirigeant quelconque. Ce type de myopie occulte l’appareil politique, économique et social qui détient le pouvoir sur la reproduction sociale et les processus historiques qui ont conduit à ce moment. Dans le cas de l’Arménie, Nikol Pashinyan est seulement un politicien, extrêmement faible de surcroît. Nous sommes devenu·es tellement obsédées par les actions des individus que nous négligeons le pouvoir de l’action collective. La stratégie d’organisation politique de masse a été pratiquement abandonnée par la gauche arménienne, elle-même quasi inexistante. N’oublions pas, le mouvement Karabakh de la fin des années 1980 et du début des années 1990 était un mouvement populaire, tout comme l’était la « révolution » de 2018.
Le joug de la bureaucratie stalinienne et de l’esprit de clocher traditionnel pèsent lourdement sur la vie sociale et politique arménienne. Une politique réactive s’est installée, une politique qui appelle à déstabiliser un gouvernement qui fait face à une crise des réfugié·es et à une potentielle invasion. Tant qu’un mouvement capable de reproduire la vie quotidienne et de défendre la territorialité arménienne ne se matérialisera pas, l’appel à destituer Pashinyan du pouvoir n’est rien d’autre qu’un appel aux armes futile lancé par des opportunistes et des aventuriers.
05.09.2023 à 22:27
Pour comprendre l’usage des lois RICO contre le mouvement pour la défense de la forêt d’Atlanta : Des poursuites massives cherchent à criminaliser toute contestation
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (2390 mots)

Depuis début 2023, le parquet de l’État de Géorgie menaçait de mettre en examen les militant-es opposé-es à la construction de la « Cop City » [littéralement : la Ville des keufs], un centre d’entraînement et de militarisation de la police, pour avoir supposément enfreint les Lois sur les organisations motivées par le racket et la corruption (le RICO Act). La semaine dernière [fin août 2023], Chris Carr, le Procureur général de Géorgie, a utilisé ces lois pour inculper 61 personnes dans le comté de Fulton.
En mettant dans le même panier sans aucune distinction des dizaines d’interpellé-es dont une grande partie ne s’est apparemment jamais rencontrée afin de fabriquer une affaire d’association de malfaiteurs, les autorités en charge des poursuites cherchent à criminaliser le mouvement de contestation lui-même. Cette affaire illustre la répression politique qui cherche à étouffer l’activisme et la contestation sous toutes ses formes dans une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Vladimir Poutine. Elle devrait préoccuper tout-te-s celleux qui se préoccupent des libertés civiles, comme celle de manifester, de militer contre les violences policières et l’autoritarisme ou encore pour la défense de l’environnement.
La mise en examen n’a pas l’air d’indiquer que le parquet avait en sa possession des informations inédites concernant l’existence d’une entreprise criminelle dans le sens où ce mot est généralement employé. Au lieu de ça, il a opposé de nouveaux chefs d’inculpation aux personnes dont il avait déjà les noms suite à des interpellations passées et cherchent maladroitement à l’heure actuelle de les faire passer pour un groupe criminel cohésif.
Parmi les inculpé-es, 42 personnes avaient déjà été accusé-es de « terrorisme » pour avoir supposément participé au mouvement #StopCopCity, pour beaucoup d’entre elleux sur la base des actions aussi anodines que le fait de rentrer dans la forêt ou faire des publications sur les réseaux sociaux. Trois autres avaient eu des poursuites pénales pour avoir distribué des prospectus. Et encore trois autres avaient été accusé-es en mai dernier de « blanchiment d’argent » et d’autres crimes pour avoir organisé le soutien juridique aux militant-es. Aucune de ces anciennes affaires n’a encore abouti en une seule condamnation.
La seule chose qui lie tou-te-s les accusé-es, c’est qu’iels semblent tou-te-s avoir été arrêté-es par le passé, parfois totalement par hasard, sur la seule suspicion de s’opposer au projet étatique de détruire la Forêt de Weelaunee.
Le Conte de deux affaires RICO
Même si l’inculpation a eu lieu dans le comté de Fulton, c’est le Procureur générale de l’État de Géorgie qui est en charge des poursuites. Cela semble indiquer qu’il y aurait des divergences parmi les autorités, mais on ferait mieux de se demander à quel point celles-ci peuvent réellement être profondes.
Le procureur du comté de Dekalb, membre du Parti démocrate, s’était déjà retiré de toutes les affaires liées au centre d’entraînement policier en juin dernier, prétextant les divergences irréconciliables avec le Procureur général, qui fait partie des républicains. Le juge assigné à cette nouvelle affaire RICO s’en est lui aussi immédiatement dessaisi. Jusque là, aucun juge ne s’était récusé des affaires liées au mouvement pour mettre fin à la Cop City, même quand ils avaient des liens explicites avec le projet de construction du centre de militarisation de la police.
Dans le comté de Fulton rivalisent désormais deux affaires RICO : la première visant Donald Trump, poursuivi par le procureur de district de cette commune, et la deuxième qui vise les personnes s’opposant à la construction du centre d’entraînement policier, menée par le Procureur général de l’État.
Il reste à voir s’il y a un conflit important entre les procureurs locaux du Parti démocrate et ceux de l’État de Géorgie qui sont des républicains. Les républicains auraient sans doute lancé ces poursuites, même si Fani Williams, procureure du district de Fulton County, n’avait pas mis en examen Donald Trump et ses sbires, mais maintenant ils vont pouvoir s’appuyer sur les poursuites visant Trump pour rallier leur base en soutien à l’accusation lancée contre les militant-es écologistes. Pour de nombreux-ses électeur-ices démocrates, le recours aux lois RICO contre Trump servira seulement à légitimer le système judiciaire dans son ensemble et les mises en examen liées à ces lois plus particulièrement, même lorsque les deux servent principalement contre les communautés opprimées et les mouvements contestataires. Le fait que les républicains poussent cette affaire au niveau de l’État offre aux politiciens démocrates la possibilité du déni plausible pour pouvoir continuer à remporter les élections, leurs électeur-ices désapprouvant de la criminalisation de la contestation. En ce qui les concerne, la plupart des politiciens démocrates dépendent tout autant de la police que les républicains. Ils tout aussi enthousiastes de voir la Cop City se construire et les mouvements d’opposition être rendus inefficaces.
Même si les deux affaires RICO représentent deux factions rivales de classe politique, les mêmes grands jurés qui avaient mis en examen Donald Trump sont responsables d’inculper celleux qui sont accusé-es de « racket » pour avoir protesté contre la Cop City. Le système judiciaire est une infrastructure centrale servant à canaliser la violence étatique. Alors que les démocrates naïfs peuvent présenter la justice comme un frein aux aspirations des autocrates, celle-ci s’adapte naturellement à toute forme de répression ciblant les opprimé-es, et c’est bien là son rôle principal.
La criminalisation des idées
Comme on a pu le voir en mai dernier, ce n’est pas la première fois que les grandes entreprises et la police se servent des lois RICO de manière arbitraire afin d’intimider celleux qui s’opposent à l’accaparement du pouvoir par elles. Par exemple, de 2016 à 2019, l’entreprise responsable de l’oléoduc Dakota Access s’est appuyée dessus pour poursuivre en justice l’ONG modérée Greenpeace. Tous ces chefs d’accusation ont fini par être abandonnés, mais ces poursuites servent à intimider et à immobiliser leurs cibles, elles représentent ainsi un effort continu de la part des corporations et de la police de mieux subordonner le système judiciaire à leur propre programme.
Lors d’une conférence de presse annonçant les poursuites, le procureur a affirmé que le droit de Géorgie était écrit de telle manière qu’il n’était pas nécessaire pour les participant-es à une entreprise criminelle de se connaître pour que l’accusation reste applicable : tout ce qui est nécessaire, c’est que ces personnes travaillent dans le même but. L’« entreprise criminelle » est définiede manière si floue que cela crée un terrain pour accuser n’importe qui ayant participé à un mouvement social dans ces dix dernières années d’avoir enfreint les lois RICO.
Dans le dossier de mise en examen, le parquet souligne que les accusé-es sont poursuivi-es simplement pour s’être opposé-es à la construction d’un centre de militarisation de la police :
Defend the Atlanta Forest [le nom du mouvement pour défendre la forêt de Weelauney à Atlanta] ne recrute pas depuis un seul endroit ; les membres de Defend the Atlanta Forest n’ont pas non plus une histoire de travail commun en tant que groupe localisé. Néanmoins, ce groupe partage une opposition commune à la construction du Centre d’entraînement du Département de police d’Atlanta, aux entreprises de construction associées au projet, ainsi qu’aux entreprises propriétaires des chantiers qui entourent la forêt.
« Trois idéologies principales constituent le mouvement Defend the Atlanta Forest, » poursuit le texte, une « idéologie anti-forces de l’ordre, » « la protection de l’environnement à tout prix, » et « une idéologie anarchiste. » Ici se fait le procès des idées.
Sans citer aucune source, l’accusation attribue les affirmations les plus rocambolesques à « l’organisation » dans son ensemble, par exemple : « Tortuguita [militant-e assassiné-e par les policiers lors d’un raid du camp dans la forêt d’Atlanta le 18 janvier 2023] a trouvé la mort en cherchant à tuer un flic en défense de la forêt de Weelaunee. » Cette phrase contredit explicitement le récit du meurtre de Tortuguita qui prévaut au sein de nombreux mouvements qui cherchent à préserver la forêt.
Assez rapidement le dossier d’accusation, dédie cinq pages entières spécifiquement aux trois accusé-es à qui on reproche l’association avec le Fond de solidarité d’Atlanta. Leurs noms réapparaissent encore et encore au fil des pages du dossier. En plus de criminaliser l’« anarchisme », l’opposition à la police et la préoccupation pour l’environnement dont chacun-e d’entre nous dépend pour sa survie, un autre objectif central de l’accusation consiste clairement à créer un précédent pour criminaliser le soutien juridique aux personnes arrêtées dans le cadre des actions contestataires.
De même, l’accusation présente le fait de « distribuer des flyers, » d’« occuper une cabane dans les arbres, » ou d’être présent-e dans la forêt « avec du camouflage, du matériel de camping et des vivres » comme des actes pouvant constituer une entreprise criminelle.
Dans le dossier se retrouve répétée une affirmation déjà démentie par le passé concernant le caractère supposément « terroriste » du mouvement pour la défense de la forêt de Weelaunee :
Le Département de la Sécurité intérieure (le DHS) des Etats-Unis a classifié ces individus comme étant des prétendus Extrémistes Domestiques Violents.
En réalité, selon le DHS lui-même,
Le Département de la Sécurité intérieure ne classifie ni ne désigne aucun groupe comme des extrémistes domestiques violents.
Afin de justifier l’appellation de « terroriste », le dossier d’accusation cite une note du DHS, mais cette note réitère simplement les propos du parquet de Géorgie, d’après lesquels les accusé-es seraient des « extrémistes domestiques violents », tout en y rajoutant le qualificatif « prétendus » pour remettre en question cette affirmation. Le parquet de Géorgie cherche à répéter un mensonge jusqu’à ce que celui-ci devienne la vérité.
En 2020, le DHS était l’une des institutions fédérales sur lesquelles s’est appuyé Donald Trump dans sa tentative de maîtriser les manifestations, notamment à Portland dans l’État d’Oregon. Cette organisation ne court pas la réputation d’hésiter à soutenir la répression. Le fait qu’il y ait une tension apparente entre comment le parquet de Géorgie le DHS et les communiqués du DHS lui-même montre seulement à quel point les procureurs de Géorgie sont prêts à prendre des risques.
Il y a une troisième affaire RICO connue à Atlanta : il s’agit de la mise en examen de[s rappeurs] Young Thug, Gunna et Young Slime Life, qui considère des paroles de chansons, des publications sur les réseaux sociaux et des articles de vêtements comme preuves du racket criminel. Dans ces deux cas, le parquet interprète les statuts RICO de l’État de Géorgie de manière aussi large que possible pour justifier de faire passer ces personnes pour des co-conspirateurs sur la base d’un récit entièrement fabriqué concernant leurs idées et leur identité.
Pour reprendre la formulation tortueuse de l’accusation, « les anarchistes violents cherchent à faire passer le gouvernement pour des oppressionnistes violents [sic]. » En s’appuyant sur ces chefs d’inculpation, l’État de Géorgie montre son dévouement sans faille à l’oppression, en commençant par n’importe qui est suspecté de s’exprimer contre leur violence.
C’est loin d’être probable que cette affaire RICO va réussir. Mais si elle le fait, elle aura des répercussions massives sur d’autres mouvements sociaux aux États-Unis. Qu’elle réussisse ou non, elle marquera un nouveau point bas dans l’usage du harcèlement judiciaire ciblant l’opposition. Tou-te-s celleux qui ne souhaitent pas se retrouver dans un État totalitaire devra mettre son poids derrière la campagne de soutien aux inculpé-es et résister à cette tentative de poser un nouveau précédent juridique à la répression étatique.
Vous pouvez faire un don ici pour soutenir les inculpé-es de cette affaire.

10.08.2023 à 01:10
L'apprentissage des flammes : Quelques enseignements depuis les révoltes en France
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (5756 mots)

En juin 2023, dans la ville de Nanterre, en banlieue parisienne, la police a brutalement assassiné un adolescent du nom de Nahel Merzouk, poursuivant ainsi un modèle de violence post-coloniale dirigé contre une partie de la population française traitée comme des citoyen.ne.s de seconde zone. En réponse, des milliers de personnes dans les banlieues de Paris et d’autres villes françaises se sont révoltées pendant plusieurs jours, attaquant les mairies et les commissariats de police, pillant les magasins et se défendant contre la police. Dans la réflexion suivante, un participant aux mouvements de ces dernières années revient sur la révolte de juin 2023 et les mouvements qui l’ont précédée, en explorant les limites qu’ils ont atteintes et en s’interrogeant sur ce qu’il faudrait pour qu’ils aboutissent à une transformation révolutionnaire.
Pour d’autres réflexions sur les mêmes événements, vous pouvez commencer ici.
“Combien de temps tout ceci va encore durer
Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter
Dommage que l’unité n’ait été de notre côté
Mais vous savez que ça va finir mal, tout ça
La guerre des mondes vous l’avez voulu, la voilà
Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ?”-Qu’est ce qu’on attend pour foutre le feu (What are we waiting for to start the fire?), NTM, 1996
Si les suites de la révolte ne sont pas encore écrites, nous aimerions déjà proposer quelques pistes d’apprentissages que ce mouvement et ceux des dernières années nous encouragent à creuser pour continuer à chercher des issues victorieuses aux soulèvements à venir en France et ailleurs.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
0. Révoltes
Lors de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites en France (février-mai 2023), des camarades de la plate-forme chilienne Vitrina Distópica me demandaient si nous assistions à une révolte ou non en France. À l’époque, j’avais conclu que, à l’exception de quelques nuits très chaudes après le décret autoritaire de la loi en mars, peu d’éléments nous permettaient de reconnaître une révolte.
Je pensais alors qu’il s’agissait plutôt d’un mouvement social à la française, très fort mais très classique. Loin d’une révolte réellement dangereuse pour le pouvoir comme ont pu l’être le soulèvement des gilets jaunes ou les révoltes de ces dernières années au Chili, en Iran au Liban, á Hong Kong pour ne citer que eux.
Je concluais cependant qu’il était légitime de se questionner si cette mobilisation, qu’elle soit perdante ou gagnante, n’était pas un signe que nous vivions une période pré-révolutionnaire en France avec sa succession de mouvements toujours plus rapprochés, massifs et offensifs.
Si les événement de ce début d’été confirment l’intensité de la période, le choix du mot révolte pour les qualifier, n’est pas anodin. Si nous utilisons le mot, ce n’est pas parce qu’il serait plus politique que celui d’émeute (qui détient lui même un contenu déjà hautement politique) mais plutôt à cause de caractéristiques particulières présentes cette fois ci dans le mouvement : fulgurant, spontané, offensif, entièrement auto-organisé et enfin sans revendications parcellaires mais bien une volonté claire de “faire justice soi-même” et surtout “faire mal à l’État”.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
I. Violence et Dignité
Plus l’humiliation et la dégradation des conditions de vie est importante plus la révolte sera violente. L’exercice de la violence par les opprimé.e.s contre ses oppresseurs est un mode d’expression autant qu’un moyen de recouvrir sa dignité. En effet, la violence révolutionnaire peut être une voie pour les peuples dominés de construire une nouvelle dignité (comme l’ont abordé de différentes manières Elsa Dorlin, Frantz Fanon ou Miguel Enríquez).
L’intensité de la révolte en France mais aussi par exemple au Chili (2019) et en Iran (2019 surtout, mais aussi 2022) nous donne une idée du degré de rage et d’humiliation accumulée par les marges1 de ces “nations”.
Le rôle des révolutionnaires n’est pas de contenir cette rage mais de l’aider à se choisir un horizon stratégique, à atteindre ses objectifs, et à résister à la contre-attaque de l’ordre. Construire une force capable de convertir la rage en puissance.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
II. Médiations
Comme pour les gilets jaunes, le niveau de violence exercée par les insurgé.e.s est aussi une preuve du manque et de la faiblesse de “médiations” (corps intermédiaires dit-on ici parfois) entre ces populations et le Régime. Médiation au sens négatif de maintien de l’ordre social (mairie, police, parfois travailleur.e.s sociaux.ales2 et organisations religieuses) mais aussi plus positif d’espaces politiques organisés capables de soutenir la juste colère pendant la révolte et dans la durée.3
Même quand des associations ou des organisations locales4 existent, elles ont souvent du mal à mobiliser une base large, notamment les jeunes, et possèdent rarement des objectifs politiques au-delà de leur territoire.5 Un constat ne se limitant pas aux quartiers populaires mais à la majorité des espaces d’organisations territoriales en France.
Comme ailleurs, cela démontre le manque d’organisations radicales et autonomes issues ou ancrées dans ces quartiers ayant la capacité à la fois d’agir sur la vie quotidienne et d’avoir des objectifs et stratégies politiques à long terme.
En France comme ailleurs, des forces comme celles-ci ont déjà existé. On peut penser bien sûr aux Black Panthers Party (BBP) ou aux Young Lords (organisation d’immigré.es portoricain.e.s construit sur le modèle des BBP), le MIR chilien et son travail dans les poblaciones (quartiers populaires au Chili) ou encore le PKK et de son ancrage populaire à Bakur (Kurdistan turc occupé). En France on peut penser aussi au rôle précurseur du Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) qui a tenté dans les années 90 de lier luttes locales et perspectives nationales contre les violences policières et pour l’organisation autonome des quartiers populaires.
Cependant, depuis la révolte de 2005, il semble que, en plus des collectifs pour la libération de la Palestine pendant des moments d’agression comme en 2014, les seules organisations politiques et sociales qui soient parvenues à mobiliser une base populaire dans les banlieues furent, les organisations islamistes dans leurs différentes déclinaisons.6
Jusqu’en 2015-2016 seulement, car suite aux attentats djihadistes des années 2010 une écrasante offensive idéologique et répressive de l’Etat contre les musulman.e.s sans distinction (en raison de l’amalgame constant fait entre musulmans, islamistes, djihadistes etc.) a considérablement affaibli des espaces qui paradoxalement étaient aussi des espaces de médiations, et parfois d’apaisement, dans les quartiers.
Une répression sans différence qui a également augmentée la colère et le sentiment d’être des citoyen.ne.s de seconde zone de nombreux.ses musulman.e.s vivant dans les quartiers populaires.
III. Peur-dépendance
Chacun des mouvements des dernières années en France ont été éteints uniquement par la répression. Cette situation met le gouvernement Macron dans une situation de peur-dépendance vis-à-vis de l’institution policière.
Le néolibéralisme sauvage qu’il a pour rôle de mettre en place en France ne pouvant exister qu’avec l’imposition de la police, cela explique que ce pouvoir est un de ceux qui redoute le plus sa police. C’est pour cela qu’il ne réagit en rien aux menaces de sédition d’Alliance et Unsa Police.7
La police comprend très bien la dépendance qui la lie autant à Macron et profite de l’occasion pour augmenter son pouvoir et son autonomie.
Cette situation (courante et inhérente au rôle de la police) nous pousse à penser que si quelques ajustements de la police ne sont pas impossibles, on ne peut s’attendre à aucune réforme affaiblissant réellement l’institution.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
IV. Assassinats politiques
Lancée par les noirs et les quartiers populaires américains, le soulèvement déclenché par la mort de George Floyd a vite été suivi par une partie de la société américaine. Les émeutes se sont transformées en une révolte multiraciale beaucoup plus large. De plus, organisations de gauche, anti-racistes, pour l’abolition de la police, anarchistes ont rejoint massivement le mouvement. Même les médias et de nombreuses multinationales ont pris position face au rapport de force imposé.
Contrairement aux Etats Unis et comme en 2005, aucune partie de la société française n’a participé à la révolte des jeunes de ses quartiers populaires.
Un paradoxe notable est qu’en France même, pendant le soulèvement américain (juin 2020), un puissant collectif justice et vérité, le comité Adama(8) fut capable d’organiser une marche impressionnante (et offensive) réunissant près de 100 000 personnes à Paris pour soutenir la révolte de George Floyd.
Aujourd’hui, dans le contexte de la mort de Nahel, la marche blanche organisée en son hommage a réuni moins de 20 000 personnes. Et une semaine après la révoltes, les manifestations dans les grandes villes du pays (Paris, Lyon, Marseille etc.) jamais plus de 2000.
L’assassinat de George Floyd, après la participation spontanée de nombreuses classes sociales ainsi que par l’action de nombreuses forces organisées, fut considéré rapidement comme éminemment politique (et légitime) aux Etats Unis, puis dans le monde entier.
La mort de Nahel n’a pas reçu un tel traitement.8 Le reste de la population ne l’a pas rejoint et, en France,9 personne n’a été capable de lui donner la portée politique de l’assassinat de George Floyd.
V. Conscience transnationale
Si, en France, la segmentation de la société a empêché la contagion de la révolte, c’est dans les quartiers populaires de Suisse et de Belgique que les insurgé.e.s ont trouvé du soutien. Sans aucun appel d’une quelconque organisation, on a ainsi vu éclater à Lausanne comme à Bruxelles des émeutes de colères similaires.
Dans les consciences, les frontières au sein même de la société française (de classe ou de race) ont été plus fortes que les frontières nationales. Les conditions de vie ont parlé, au-delà du mirage des nations.
Le succès de la manifestation et les émeutes qui l’ont suivies à Paris pour George Floyd en 2020 comme celles en Suisse et Belgique pour Nahel montrent l’existence, ou a minima la naissance, d’une conscience de classe transnationale entre jeunes racisé.e.s de quartiers populaires.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
VI. Conditions révolutionnaires et segmentations
Le nombre successif de mouvements à forte intensité en France montre à la fois la présence de conditions pour déclencher un mouvement révolutionnaire en même temps que ce qui repousse son arrivée.
Généralement, quand la répression éteint une révolte, le traumatisme causé étouffe les velléités de la génération réprimée pendant un bon moment. La reprise de l’agitation est seulement possible si ce ne sont pas exactement les mêmes personnes dans la rue.
En France, si la répression augmente à chaque mouvement (avec son lot de mutilés, éborgnés et même morts comme ce mois-ci) elle n’éteint en rien les mouvements sociaux et les émeutes qui se succèdent depuis au moins 2016.
Une situation, qui a une échelle bien entendu radicalement moindre, rappelle la succession de révoltes en Iran. 2009, 2017, 2019 (on parle de 1500 morts pour cette seule révolte) et bien sûr la révolution féministe de 2022.
Si dans un pays comme dans l’autre, ces chiffres donnent une idée de la combativité des peuples en question, (de son héroïsme, dans le cas de l’Iran) on peut aussi expliquer cette répétition par le fait que ce ne sont pas les mêmes segments de la population qui se soulèvent successivement.
Pour prendre l’exemple de l’Iran, en 2009, on parle essentiellement des classes moyennes des grandes villes, en 2017, 2019 des classes les plus populaires, en 2022 des femmes et des minorités non “perses”.10
Pour la France, en 2016 (mouvement contre la loi travail) : étudiant.e.s et travailleur.e.s politisé.e.s (le “peuple de gauche”) ; En 2018 (Giles Jaunes) : une classe populaire blanche des marges ; En mars 2023 (mouvement contre les retraites) : mélange des deux. Juin 2023 jeunes racisé.e.s de la périphérie.
Dans le cas français par exemple, rappelons aussi que si les quartiers populaires n’ont été que peu soutenus, inversement ils ont peu participé au dernier mouvement contre les retraites ou au soulèvement des gilets jaunes.11
Ce décalage entre ces mouvements ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’interactions entre elles. Rappelons que le puissant mouvement social du printemps 2006 suivait de près la révolte des banlieues de l’automne 2005. Dans le sens inverse, la révolte de cet été suit la mobilisation du printemps 2023. A chaque fois, moins de 3 mois séparent les deux. Reste qu’il existe encore peu de liaisons entre eux.
Ainsi, cela crée une situation certes brûlante, mais oú les vagues d’attaque en ordre dispersé empêchent la possibilité d’un tsunami suffisamment puissant pour faire chuter les régimes en question.
En même temps, cette multiplication de mouvements prouve la présence de conditions objectives pour créer un mouvement révolutionnaire très puissant.
“Les luttes trouvent leur force dans leur capacité à tisser ensemble différents fragments du prolétariat. Le soulèvement n’a été couronné de succès que parce que, dans tout le pays, des personnes de tous horizons et de toutes communautés ont trouvé leur propre façon de participer”.
-Paper Planes, ici concernant la révolte de 2022 au Sri Lanka
En effet, á l’inverse de la situation iranienne ou française, on voit que les soulèvements qui ont vu un corps social déclencheur (paysan.ne.s indien.ne.s, indigènes en Équateur, lycéen.ne.s au Chili, noirs aux Etats Unis etc.) être suivis par une large partie de la société,12 sont parvenus à obtenir des victoires structurelles (bien que souvent provisoires) : arrêt du financement et pseudo refonte de plusieurs polices locales aux Etats Unis, chute du régime au Soudan, processus constituant au Chili, chutes des gouvernements au Sri Lanka ou au Liban etc.
Même si aucun n’a pour l’heure réussi à s’opposer au retour à la “normale”.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
VII. Construire le peuple
Avec leur appel à l’unité, les Gilets Jaunes, comme tous les soulévements de notre époque12 avaient dérouté les espaces politiques habitués à des séparations nettes.
Lors du mouvement, l’omniprésence des symboles français n’était pas un motif pour rester en dehors et rappelait plutôt que toute insurrection populaire aujourd’hui est “impure”, déroutante.
Dans de tels surgissements les insurgé.e.s utilisent symboles et espaces disponibles et rassembleurs. En 2018 en France, ceux utilisés par le mouvement rappelaient plus la présence de la Révolution française (1789-93) au sein de la culture populaire que la signature de l’extrême droite.
“Si l’on dit alors que «le peuple» est dans la rue, ce n’est pas un peuple qui aurait existé préalablement, c’est au contraire celui qui préalablement manquait. Ce n’est pas «le peuple» qui produit le soulèvement, c’est le soulèvement qui produit son peuple, en suscitant l’expérience et l’intelligence communes, le tissu humain et le langage de la vie réelle qui avaient disparu.”
-“À nos amis”, Comité invisible
Ce n’est qu’en acceptant que les gilets jaunes produisaient eux même leur notion du “peuple” qu’on peut comprendre l’attaque de l’ancienne Bourse le 1er décembre par un paysan électeur du FN au côté d’un militant autonome d’orginie marocaine et surtout d’un jeune de quartier d’une quizaine d’année au cri de ce dernier : “C’est nous le peuple…. Wallah c’est nous le peuple !”13
Néanmoins, en participant à la révolte à partir d’un rond-point de la banlieue parisienne, nos échanges avec des habitant.e.s issus de l’immigration (récente ou ancienne) nous avaient, à l’époque, fait prendre conscience que beaucoup étaient attiré.e.s par la révolte mais préféraient garder une certaine distance avec celle-ci. Certain.e.s craignant les éléments racistes, d’autres nous expliquant ne pas pouvoir ou savoir comment participer à un mouvement qu’ils.elles définissaient comme « pour les Français ».
Cela nous fit comprendre qu’au delà de l’instrumentalisation par les médias et le pouvoir de la présence réelle de composantes et de comportements racistes, l’utilisation de référents, qui bien que subversifs, restaient quasi-exclusivement franco-français (drapeaux, guillotine, Mai 68, Commune de Paris, Conseil de la résistance) constituait une des limites à l’extension du soulèvement. Les appels à être “tous.tes gilets jaunes” étaient peu accompagnés d’actes permettant au soulèvement de s’ouvrir ’effectivement aux différentes communautés du territoire français.14
Ce caractère national de la grande majorité des révoltes de notre époque encourage d’autant plus à combattre de l’intérieur les tendances nationalistes et les groupes fascistes qui tentent de profiter des troubles. En France, le mouvement antifasciste le fit physiquement et avec succès dans les manifestations des gilets jaunes tandis que plusieurs groupes de gilets jaunes le firent en mettant en avant des symboles transnationaux.15
La révolte des jeunes, de son côté, n’ayant pu faire porter sa voix et ayant été éphémère, n’a pu adresser le moindre appel à être rejoints ni expérimenter de telles jonctions.
Ces deux mouvements, et le fossé qui les séparent, nous font prendre conscience du manque de forces capables de favoriser des ponts entre les révolté.e.s du territoire. Pendant les soulèvements, mais aussi avant et après.

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
A d’autres époques, des organisations en avaient fait un objectif central. On peut penser à la Rainbow coalition de Chicago, lancée par Fred Hampton en 1969, qui réunit des organisations Young Patriots (qui portaient des drapeaux confédérés), des black panthers, des Portoricains, des Young Lords, des Amérindiens, des Asiatiques et des jeunes socialistes.
Les Wobblies des IWW, aux Etats Unis encore, s’étant construit contre le racisme des syndicats américains, ont fondé au début du XXe un syndicat transnational capable d’unir des travailleur.e.ss asiatiques, noirs, blanc, latinos et fut capables de s’exporter dans le monde entier. Le MIR (encore lui) réussit de son côté et manière assez unique dans l’histoire du Chili a créer une alliance entre mapuches et campesino.a.s chilien.ne.s.
Plus récemment en France des collectifs et espaces aussi variés que le comité Adama et ses appels à rejoindre les Gilets Jaunes, Verdragon (espace d’écologie populaire) à Bagnolet et le Hangar (squat contre la gentrificarion) à Montreuil tentent de créer des jonctions entre quartiers populaires et différentes populations. Les gilets noirs, menés par des exilé.e.s et appuyé.e.s par leurs soutiens français.e.s, ont repris le symbole du gilet et lancé un mouvement pour obtenir la régularisation administrative de tous les migrant.e.s en France, ainsi qu’un logement et des conditions de vie décentes. Ils ont tissé des liens avec des groupes tels que le Comité Adama et avec la Brigade populaire de solidarité lors de la première vague de la pandémie de COVID-19. Enfin, la Cantine syrienne et le réseau internationaliste les Peuples Veulent tout comme la Maison aux volets rouges et son festival essaient quant à eux.elles de créer des espaces politiques communs entre exilé.e.s arrivé.e.s récemment en France et les populations locales.16
Autant de tentatives d’étendre la notion classique de peuple aux populations qui habitent réellement le territoire français.
Ce n’est qu’en favorisant, amplifiant et parfois unissant des expériences de ce type que nous serons à même de créer ce peuple au sens nouveau. Ce peuple reformulé, dépassant, sans les nier, ses disparités et histoires. Ce peuple révolutionnaire.
“Il est temps que cela cesse, fasse place à l’allégresse
Pour que notre jeunesse d’une main vengeresse
Brûle l’état policier en premier et
Envoie la république brûler au même bûcher, ouais
Notre tour est venu, à nous de jeter les dés.”NTM, Qu’est ce qu’on attend pour foutre le feu, 1996

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
Un grand merci aux ami.e.s et camarades dont les réflexions et les retours ont nourri ce texte.
Gloire aux insurgé.e.s.
-Lucas Amilcar

29 juin 2023, Nanterre. Crédit ‘ @tulyppe.
-
Nous utilisons ici le mot “marges” au sens de Bell Hooks c’est à dire population opprimée vivant à la périphérie des centres capitalistes, mais détentrice d’un potentiel radical unique. Voir son excellent livre “De la marge au centre.” ↩
-
Eux.elles même refusant souvent de garder ce rôle : “Et nous, on est entre les jeunes et la police. On est les médiateurs de la fausse paix sociale que le gouvernement essaie d’instaurer.” Ou encore : “Qu’est-ce qu’on fait ?” interroge le trentenaire, figure respectée de son quartier. La réponse de l’autre fuse : « Rien du tout. C’est fini, on n’est pas des pompiers. » ↩
-
Sur les causes et les stratégies de l’Etat pour en arriver là, on conseille “Bâillonner les quartiers” de Julien Talpin. ↩
-
Rappelons cependant, qu’il y a des forces qui depuis 2005 ont réussi à créer des espaces politiques ou des tribunes importantes et parfois subversives : les médias Echo-banlieue et le Bondy Blog, les espaces du Hangar de Montreuil ou de Verdragon á Bagnolet, Diaty Diallo et son puissant ouvrage “Deux secondes d’air qui brûle”, le Comité Adama et le réseau justice et vérité pour ne citer qu’eux. ↩
-
Il existe bien sûr des exceptions comme le Réseau d’Entraide Vérité et Justice qui rassemble des collectifs contre les violences d’État sur tout le territoire. ↩
-
Rappelons que comme les marxistes dans les années 70 par exemple, les islamistes sont traversés par des tendances, tactiques , alliances et désaccords en France et ailleurs (groupes publics non violents et djihadistes pratiquant la.lutte armée, salafistes de différents courants, Frères musulmans et autres groupes concurrents etc.). ↩
-
Un communiqué menaçant écrit au début de la révolte pour prévenir le gouvernement que la police scrute la réponse de l’État et se tient prêt à entrer en “résistance”. ↩
-
Contrairement au traitement des médias internationaux ou à l’ONU par exemple qui ont bien plus questionné le rôle de l’État et de police et de leur racisme structurel. ↩
-
Ce qui ne veut pas dire qu’il fût inexistant. Les éboueurs de Paris (vivant majoritairement en banlieue parisienne) furent le fer de lance du mouvement pour les retraites. Les manifestations Gilets jaunes virent de nombreux.ses habitant.e.s des quartiers populaires et des centaines de jeunes participer aux nuits insurrectionelles du 1er et 8 décembre. Cependant localement dans les deux cas il y eu peu de présence locale et continue (de ronds points) à l’exception notamment de Champigny, Montreuil ou Rungis dans le cas de la banlieue parisienne. ↩
-
On peut penser par exemple á la thawra au Liban oú toutes les confessions, habituellement opposées se sont retrouvées côte à côte ; aux supporters de foot de Istanbul (Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray) ou de Santiago (Colo Colo et de la UC) ennemis mortels, affrontant ensemble la police lors de la révolte de Gezi et de la Revuelta Chilena ; ou encore pendant l’Aragalaya, le soulèvement au Sri Lanka de 2022 lors duquel moines boudistes et le mouvement queer, Cingalais.e.s et Tamoul.e.s se sont soulevé.e.s ensemble. ↩ ↩2
-
Wallah : mot arabe courant chez la jeunesse issu de l’émigration et milieu populaire signifiant : Je le jure sur Allah-Dieu. Scène vécue par l’auteur. ↩
-
Ailleurs dans le monde on peut penser à l’utilisation du terme “azadi” (liberté) dans la révolution syrienne comme un appel aux communautés kurdes ; en Iran l’utilisation du slogan “ Kurdistan les yeux et la lumière de l’Iran” utilisé par les communautés turkmènes ; l’utilisation du drapeau Mapuche au Chili et Kabyle en Algérie pendant le Hirak. ↩
-
Nous pensons par exemple aux gilets jaunes de Montreuil, de Toulouse, de Commercy qui, plutôt que de dénoncer la marseillaise ou le tricolore, décidèrent de diversifier les références, d’organiser des discussions sur les enseignements de la révolution syrienne, le hirak algérien ou le Kurdistan; de multiplier drapeau palestinien, drapeau noir ou arc-en-ciel, de faire des banderoles et des tags en arabe ou en espagnol (“Que se Vayan todos” ou “الشعب يريد إسقاط النظام”). Des gestes qui restèrent malheureusement isolées. ↩
-
On s’excuse d’avoir utilisé majoritairement des exemples de banlieue parisienne concernant la France, territoire que nous connaissons mieux car j’y vit depuis 30 ans. ↩
02.07.2023 à 03:54
Justice pour Nahel : Les origines de l'insurrection en France
CrimethInc. Ex-Workers Collective
Texte intégral (3198 mots)

Le texte suivant nous a été envoyé par des camarades français le troisième jour des émeutes qui font suite au meurtre de Nahel Merzouk par la police de Nanterre, en banlieue parisienne. Il propose une analyse de la situation présente, ainsi qu’un bref historique de la lutte contre les violences policières en France depuis les années 1970.
L’intensité de la répression policière, judiciaire, et médiatique à laquelle le mouvement fait face depuis la semaine dernière est particulièrement féroce. Au moment où nous publions cet article, on connaît au moins trois morts dans les rues, sans compter Nahel.1 Plutôt que de se concentrer sur le déploiement des forces de police spécialisées et des acronymes de tous types à travers le pays (le RAID, la BRI, le GIGN…), nous préférons faire le récit des efforts des jeunes qui risquent leur vie pour Nahel, et pour affirmer leur propre existence.
Dans la rue, on entend beaucoup dire que la colère et l’intensité des affrontements ressemble aux émeutes de 2005. De la même façon qu’en 2005, les émeutes firent suite au mouvement étudiant, le soulèvement qui nous occupe aujourd’hui fait suite au mouvement social contre la réforme des retraites, brutalement réprimé au printemps. Malgré l’augmentation constante de ses moyens et sa quasi-totale impunité légale, les derniers mois pourraient faire penser que la police est en train de perdre un peu de sa légitimité effective et de sa capacité à faire peur à la population, pour la maintenir dans une position de passivité.

Justice pour Nahel
3 nuits d’émeutes, pour l’instant. Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, adolescent de 17 ans, est assassiné par un policier à moto lors d’un contrôle routier à Nanterre. Après un refus d’obtempérer (confirmé par l’un des passagers de la voiture), Nahel a été violemment menacé, “je vais te mettre une balle dans la tête” et frappé par les policiers à travers la vitre de sa voiture, avant d’être abattu alors que sa voiture fonçait à tombeau ouvert dans un mur – non pas par ce qu’il a tenté de fuir, mais par ce que sonné par les coups portés par les policiers, il a accidentellement relâché son frein à main et a appuyé sur la pédale de l’accélérateur. Tout ça, nous le savons parce que la scène a été filmée dans sa quasi-intégralité. La vidéo de l’assassinat de Nahel est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle clé dans le mouvement en train de se construire.2
La réaction de la rue ne s’est pas fait attendre. Dès le 27 juin, des affrontements violents ont éclatés dans plusieurs quartiers d’immigration de l’île de France (à Nanterre, Mantes la Jolie, Boulogne-Billancourt, Clichy sous Bois, Colombes, Asnières, Montfermeil) mais aussi à travers la France (Roubaix, Lille, Bordeaux…). Le 28 juin, malgré l’unanimité du champ politique concernant l’ignominie de ce meurtre crapuleux, malgré l’inculpation du meurtrier pour homicide volontaire, malgré les premiers appels au calme du gouvernement et des franges les moins téméraires de la gauche, la révolte se propage à d’autres villes (Neuilly sur Marne, Clamart, Wattrelos, Bagnolet, Montreuil, Saint Denis, Dammarie les Lys, Toulouse, Marseille…).
En parallèle, la famille de Nahel s’est constituée en Comité Vérité et Justice, notamment grâce à l’aide précieuse d’Assa Traoré et d’anciens militants du Mouvement Immigration Banlieue. La mère de Nahel, modèle de dignité et de courage a appelé à une grande marche blanche « de révolte » à Nanterre le 29 juin. Cette grande marche a réuni quelques 15.000 âmes, qui ont reproduit le dernier trajet en voiture de Nahel en marchant au rythme de slogans comme « Tout le monde déteste la police », « Flic violeur assassin » et bien sûr, « Justice pour Nahel ». Une pancarte se demandait « combien de Nahel n’ont pas été filmé ? ». Il est clair lors de cette marche que la mort de Nahel a énormément choqué et que beaucoup de manifestant-e-s marchent en solidarité avec la famille de la victime. Mais les revendications touchent à quelque chose de plus large : la place qu’occupe la police dans notre société et le rôle qu’elle y joue. Et comme s’ils en avaient conscience, les porcs ont décidés de gazer cette marche jusqu’alors pacifique à son arrivée à la préfecture (Note : l’institution qui représente l’État central au niveau départemental/cantonal) de Nanterre, déclenchant une nouvelle vague d’affrontement qui est allée jusqu’à toucher le très chic quartier d’affaire de la Défense. « S’ils nous laissent pas faire la Marche, on va tout niquer », entendait-on parmi les jeunes émeutiers.

Il serait inutile de lister tous les quartiers et toutes les villes qui ont rejoint le mouvement le soir du 29 juin, tant ils sont nombreux. Cette troisième soirée de révolte a fait prendre au mouvement une ampleur inédite. Ce mouvement protéiforme fait preuve d’une rare et salvatrice détermination : Les « jeunes de quartiers » en lutte incendient des bâtiments publics (commissariat municipale et nationale, école, bibliothèque municipale, préfectures, mairies), des voitures, des deux roues et des trottinettes, détruisent du mobiliers urbains, pillent des grandes surfaces, incendient des chantiers et bien sûr, affrontement la police notamment grâce aux mortiers/feux d’artifices qui sont devenus en quelques années « l’arme » d’autodéfense privilégiée de la jeunesse qui subit au quotidien le harcèlement et l’arbitraire policier.

L’explosion insurrectionnelle que connaît le pays n’a rien d’hasardeuse. Elle est spontanée, au sens où elle est largement horizontale, imprévisible, et invente constamment de nouvelles formes de luttes en adéquation avec les aspirations qui la détermine. Mais cette révolte s’inscrit tout de même dans un contexte. Ce contexte, c’est d’abord celui de la gestion française de l’immigration post-coloniale. Grosse merdo, l’État français, a, à partir du milieu des années 60, eu recours à de la main d’œuvre « issue » de ses ex-colonies en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Ces travailleurs, que l’État français ne souhaitait pas voir construire une vie en France, ont d’abord été parqués dans des bidonvilles puis dans des grands ensembles – ou « cité » situé à la périphérie des grandes villes – en banlieue.3 Lorsqu’il est devenu évidemment au responsable public qu’il faudrait composer avec les noirs et les arabes (à partir des années 70) les partis politiques de droite comme de gauche ont constitué une véritable politique d’exception visant à maintenir les frontières raciales et à contrôler une population en permanence soupçonnée de représenter une menace pour l’ordre établi. La gestion de ces quartiers d’immigration est donc largement policière : C’est à la police (et aux préfectures) que revient le rôle de contrôler les activités quotidiennes des habitant-e-s des quartiers populaires d’immigration. Ces quartiers sont, de fait, largement des lieux d’expérimentation en ce qui concerne le maintien de l’ordre à la française. Concrètement, cela se matérialise par des brimades, humiliations et intimidations quotidiennes. La jeunesse issue de l’immigration post-coloniale, en plus d’être exclue de la vie politique du pays, est en permanence contrôlée, insultée, arrêtée, et toutes les activités que les moins chanceu-ses-x pratiquent pour survivre sont fortement criminalisées.
Ce contexte, c’est aussi de la longue histoire des assassinats racistes et policiers en France. La race est, en France comme aux États-Unis, le corollaire de l’exercice d’une violence gratuite sur des individus déshumanisés. La place démesurée qu’occupe la police dans les quartiers d’immigration et le racisme qui structurent les rapports entre l’État français et la jeunesse issu de l’immigration post-coloniale fait que des centaines de jeunes hommes noirs et arabes ont été assassinés par la police depuis le milieu des années 70. Les quartiers ont, depuis longtemps, politisé cette question des violences policières. La Marche pour l’Égalité, lancée en 1982, a démarré à la suite d’un assassinat policier. La ville de Vaulx-en-Velin, symbole de la violence de l’État envers sa jeunesse non-blanche, connaît des épisodes émeutiers tous les 10 ans depuis 1979. Le Mouvement Immigration Banlieue, organisation autonome composée de militants issus des quartiers populaires, se battaient avant tout pour obtenir vérité et justice pour les familles victimes de bavure policière. L’insurrection de 2005 a débuté précisément parce que deux jeunes adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, ont été poussé à la mort par le harcèlement policier. On peut citer également les meurtres de Lamine Dieng en 2005, Adama Traoré en 2016, le viol de Théo Luhaka en 2017, plus récemment ou encore le meurtre d’Ibrahima Bah en 2019. Chaque fois, le même scénario (que vous reconnaîtrez sans doute) : les porcs tuent, puis se protègent en mentant. Parfois, une vidéo, ou un mouvement permettent de remettre en cause la version policière et de déclencher une procédure judiciaire contre les assassins. Mais ces procédures, en raison du manque d’indépendance de la justice aboutisse rarement à des condamnations. En France, la police jouit d’une totale impunité.
Si l’on en doutait encore, ces derniers jours ont bien montré que l’Etat prend soin de ses chiens de garde. La personne qui a révélé le nom du policier qui a tué Nahel sur les réseaux sociaux a été très rapidement condamnée à 18 mois de prison ferme (dont 12 avec sursis).

Ce contexte, c’est enfin celui de l’état paradoxal du conflit de classe en France. Tous les ans, ou presque, un mouvement d’ampleur éclate en France depuis 2016. La séquence actuelle que nous vivons actuellement est radicalement émeutière. Cette radicalisation de la contestation entraîne avec elle une radicalisation de la répression policière et la police s’est constituée depuis quelques années en véritable force politique autonome. Ce qu’il faut comprendre, c’est que compte tenu de l’impopularité des politiques néolibérales menées depuis maintenant plusieurs années en France, les gouvernements qui se succèdent en France depuis 2016 ne tiennent que grâce à leur police. Conscient de l’état du rapport de force entre police, État, gouvernement et population, les syndicats policiers d’extrême droite s’organisent pour obtenir toujours plus de moyens de répressions ainsi que des avantages sociaux divers. Par exemple, la police a obtenu en 2017 une loi leur permettant d’utiliser leurs armes en cas de refus d’obtempérer. Cette loi a eu pour conséquence principale d’augmenter drastiquement le nombre de cas d’assassinats policiers recensés en moyenne chaque année : si, avant 2017, la police tuait 15 à 20 jeunes noirs et arabes par an, elle en tue actuellement à peu près 40 chaque année actuellement (avec un pic à 51 en 2021). De plus, les moyens ainsi que les effectifs policiers ont drastiquement augmenté depuis quelques années. Le mouvement social a face à lui une police de plus en plus militarisée. Cette militarisation croissante de la police est un des principaux facteurs d’impuissance de la gauche en France. Concrètement, cela se traduit par une situation sociale dramatique, dont les premières victimes sont les femmes habitantes dans les quartiers d’immigration. Nos mères.

Ce mouvement protéiforme est pour l’instant difficile à analyser. Je ne peux pour ma part parler que ce que j’ai constaté dans la ville où j’habite, qui se situe en très proche banlieue parisienne. Les stratégies du mouvement se concentrent autour de 3 tactiques qui ont fait leur preuve : les affrontements violents avec les forces de l’ordre, la destruction de « symboles » républicains, et les pillages.
Les affrontements avec les forces de l’ordre ont principalement lieux à l’intérieur des grands ensembles/les cités. « Allume-les ! » Vous avez tous-tes vu ces images : les policiers sont visés par des tirs de mortiers, des bombes agricoles, des jets de pierres, ou de mobilier urbain par des personnes parfois très jeunes. Les stratégies offensives adoptées à la tombée de la nuit sont moins motivées par l’expression d’une solidarité avec Nahel, que par une volonté de vengeance envers celles et ceux – les porcs – qui contrôlent, humilient et tabassent au quotidien. Comme un renversement (temporaire?) du rapport de force. Dans ces moments d’affrontement, il n’y a pas de slogans, pas de revendications gauchistes, simplement une volonté radicale d’en découdre qui s’exprime en équipe (composée de jeunes qui se connaissent depuis longtemps), sans aucune autre forme de médiation.
Les jeunes (souvent des adolescents) ne détruisent rien au hasard. On attaque les préfectures et les mairies pour des raisons évidentes, les écoles et les collèges qui excluent, trient et mettent au travail, les commissariats qui permettent à la police d’agir et d’enfermer, les caméras de surveillance qui permettent de surveiller, les transports en commun trop rares ou nouvellement installés uniquement pour les petits gentrifieurs de merde, ou encore les chantiers des Jeux Olympiques responsables de la gentrification.
Enfin, c’est en matière de pillage que le mouvement est le plus créatif. Les voitures et les scooters sont très importants dans les stratégies de pillage. Les voitures permettent de forcer les portes et les grilles, tandis que les scooters permettent de partir rapidement une fois le pillage effectué. Les scooters jouent par ailleurs un rôle crucial dans le cadre des affrontements avec les forces de l’ordre. Sans entrer dans le détail, la mobilité est un élément crucial des batailles rangées qui se déploient une fois la nuit tombée. Niveau pillage tout y passe, mais contrairement à ce qu’on peut entendre ici et là, ces pillages n’ont rien de festif ou récréatif : ce qui est auto-réduit, ce sont majoritairement des produits de première nécessité et des médicaments. Ce que révèlent peut-être ces pillages c’est que le mouvement actuel, déclenché par la mort de Nahel est aussi un mouvement contre la vie chère.
Entendu à 4h du matin dans un supermarché de banlieue parisienne : « tout ça, je le prends pour ma daronne ».

En dépit du caractère éminemment universel des revendications portées par le mouvement et de la centralité des luttes contre les violences policières dans le mouvement social depuis 2016, les perspectives d’alliance entre la gauche et les jeunes émeutiers sont encore maigres. La gauche partisane se complet dans les appels au calme et les appels à « refonder une police républicaine » pour « rétablir le dialogue entre la police et sa population ». La gauche révolutionnaire (principalement trotskyste, en France) soutient activement le Comité Vérité et Justice pour Nahel, mais n’a rien à dire du soulèvement en cours. Quant à la gauche libertaire et aux autonomes, ielles se cantonnent pour l’instant à un rôle d’observation et de soutien logistique et juridique (même si certains d’entre nous participent activement aux émeutes, en déployant une énergie et une solidarité qu’on ne peut que saluer). Finalement, peu importe : le mouvement continuera, et les jeunes qui y participent semblent n’avoir que faire du soutien d’un camp auquel ils n’ont pas le sentiment de faire partie.

Pour aller plus loin
- “Quand naissent les insurrections” : Commentaires à chaud sur l’embrasement provoqué par l’assassinat de Naël à Nanterre le 27 juin.
Nanterre, cité Pablo Picasso.
-
Une quatrième personne est morte, assassinée par la police d’un tir de flashball dans la poitrine à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche. ↩
-
Le 5 juillet, d’après BFMTV, Emmanuel Macron aurait envisagé la possibilité de couper les réseaux sociaux type Snapchat et Twitter en cas de crise. ↩
-
Voir, par exemple, La Menthe Sauvage, de Mohammed Kenzi.] ↩
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?