
Accès libre
06.05.2025 à 14:43
Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent
Que recèle l’intérêt des politiques culturelles pour les tiers-lieux ? Et en quoi sont-ils inspirants pour nombre d’équipements culturels ? Arnaud Idelon retrace ici l’évolution d’un mouvement au prisme des attentes des professionnels de la culture.
L’article Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (3608 mots)

En 2018, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) publie sa revue titrée Tiers-lieux culturels, un modèle à suivre ? À l’interrogation se proposent de répondre une douzaine d’experts, issus du mouvement tiers-lieux et des politiques culturelles. Parmi eux, Raphaël Besson propose dans son article « Les tiers-lieux culturels : chronique d’un échec annoncé » d’analyser comment de nombreux lieux culturels sortent, peu à peu, d’une logique d’équipement, pour repenser leurs modes de médiations, endosser d’autres fonctions, s’ouvrir à d’autres pratiques culturelles et s’intégrer davantage à leurs territoires d’ancrages. Quant à l’auteur du présent article, avec « Tiers-lieux culturels : nouveaux modèles ou stratégies d’étiquette ? », il inscrit le jeune mouvement dans une perspective plus longue de politiques culturelles, remontant aux lieux intermédiaires et indépendants, friches culturelles et autres territoires de l’art afin de savoir si les promesses des tiers-lieux culturels s’avèrent effectives ou simple tour de passe-passe sémantique.
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Selon le recensement de 2023 de France Tiers-Lieux, 51 % d’entre eux proposent des activités culturelles quand 31 % se définissent comme des tiers-lieux culturels ou lieux intermédiaires ou indépendants. Entre inspiration et crispation, l’objet tiers-lieu ne laisse pas le monde de la culture indifférent. S’il s’agit de replacer ce phénomène dans une perspective historique plus longue et, à fortiori, celle des nouveaux territoires de l’art qui, de l’aveu de Fabrice Lextrait dans son rapport F. Lextrait, Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de l’action culturelle : rapport à M. Michel Duffour, Secrétaire d’État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, mai 2001. de 2001, ont connu ce même balancier attirance/répulsion « Nous avons eu à la fois des initiatives publiques pour accélérer le mouvement et le réprimer. Nous avons eu à la fois des coproductions avec les institutions culturelles et un mépris caractérisé. Nous avons eu à la fois dans la presse des incantations en faveur du mouvement et des ignorances ségrégationnistes. » Fabrice Lextrait, interviewé dans le cadre de la rédaction de cet article le 3 février 2025., il est aussi question d’appréhender ce que recèle cet intérêt des politiques culturelles pour l’objet tiers-lieux. En quoi le mouvement tiers-lieu est inspirant pour nombre d’équipements culturels ?
Nous y répondrons en explorant les promesses qu’ils portent ou semblent porter et, en creux, ce que cela raconte des actuels manques, désirs et besoins des équipements culturels. Comment ces derniers peuvent avoir à butiner dans le mouvement tiers-lieu, pour repenser leurs pratiques en 2025, au prisme d’enjeux sociétaux et culturels actualisés par les transitions, le climat politique ambiant et le futur incertain des politiques culturelles ?
Les promesses des tiers-lieux ?
Les tiers-lieux ont le vent en poupe dans les politiques culturelles, en témoignent la tribune de Fabrice Raffin en février 2022 dans Libération (« Des tiers-lieux pour une nouvelle politique culturelle ? ») ou la note initiée par la sénatrice PS Sylvie Robert en 2024 avec la Fondation Jean Jaurès (« Quelle politique publique en faveur des tiers-lieux culturels en milieu rural ? »). Deux exemples parmi la myriade d’autres signaux faibles d’un intérêt grandissant du monde de la culture pour les tiers-lieux : le ministère de la Culture organise depuis deux années consécutives des visites de tiers-lieux avec des délégations internationales, met à l’agenda du Forum Entreprendre dans la Culture de nombreux modules dédiés aux tiers-lieux, emploie le vocable dans son appel à projets « Quartiers culturels créatifs » ou rejoint avec la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à démocratie culturelle (DG2TDC) le groupement d’intérêt public France Tiers-Lieux pour penser les politiques publiques dédiées aux tiers-lieux culturels, tandis que des collectivités territoriales ou encore l’Institut français se font accompagner pour reconsidérer leur mode de fonctionnement depuis les tiers-lieux. À l’instar de la médiathèque de la Gare de l’Utopie dans le Parc du Livradois-Forez ou encore la scène nationale Malraux à Chambéry, des équipements s’hybrident avec des démarches de tiers-lieux, contribuant à refondre leur mode d’adresse, dans la continuité des expérimentations des bibliothèques troisième-lieu quand des équipements naissants – tels les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil – invoquent le tiers-lieu comme source d’inspiration voire modèle. De leur côté, des professionnels de la culture passent de l’institution aux tiers-lieux, dans un sens comme dans l’autre, avec de plus en plus d’agilité, signe que les deux référents ne se renvoient pas dos à dos mais jouent de leurs complémentarités.
Un déclencheur ? « La crise du Covid-19 a eu un effet loupe et a montré l’importance des lieux physiques propices à la rencontre, à la convivialité, le besoin d’espaces d’hyperproximité et de lien social », souligne Alice-Anne Jeandel, responsable de l’animation des communautés professionnelles à l’OPC. Pour Juliette Kaplan, directrice du pôle développement et relations extérieures de Mixt (Nantes), cet intérêt pour les tiers-lieux naît de la nécessité d’un renouvellement de méthodes et du constat de l’essoufflement d’un certain modèle de l’institution culturelle : « Les critiques que l’on se faisait à nous-mêmes sur nos lieux de spectacle vivant nous incitaient à élargir nos visions et à profiter de ces temps de travaux et de réflexion sur le projet d’équipement pour benchmarker, se former, et nous inspirer d’autres méthodes de travail, dont celles éprouvées par les tiers-lieux, afin d’augmenter notre compréhension de ce que nous étions en train de faire. » Les tiers-lieux apparaissent alors pour beaucoup comme un nouvel horizon pour penser des formes culturelles plus contributives et participatives, s’articulant à des modes de gouvernance plus ouverts, associant une diversité de parties prenantes, hybridant usages et publics, faisant le choix de la chronotopie (plusieurs fonctions pour un même espace selon la temporalité) et de l’intensité d’usage, et élargissant ainsi leurs sources de financement.
Parmi les potentiels que les tiers-lieux sont prêts à faire éclore : une culture transitive, en prise avec l’époque, la mise en œuvre des droits culturels, des programmations résolument tournées vers l’émergence, une certaine agilité organisationnelle, une approche située et contextuelle, et leur capacité à adosser aux pratiques culturelles des espaces-temps de vie quotidienne, de rencontre et de convivialité, permis notamment par la pluralité des postures possibles pour les personnes les fréquentant (tantôt public d’un concert, tantôt contributeur au sein d’un chantier participatif, demain membre d’un groupe de travail thématique). Enfin, et surtout, ils ouvrent une piste pour le renouvellement des publics et une lutte contre l’érosion des pratiques culturelles diagnostiquées par nombre d’institutions culturelles.
Des promesses en écho avec celles qu’incarnaient, trois décennies plus tôt, les nouveaux territoires de l’art tels que décrits par Fabrice Lextrait lorsqu’on lui demandait à quels titres ces « lieux-tiers » questionnaient alors le monde institutionnel de la culture : « Ce que les friches, les tiers-lieux culturels ont cultivé et doivent continuer à cultiver est le principe de cette permanence artistique qui peut garantir, en fonction de chaque contexte (géographique, temporel, culturel), la capacité de production des parcours artistiques. Le deuxième élément est bien sûr la nature des publics et des populations, mobilisés par les nouveaux territoires de l’art. Des “loulous” Les mots et l’utopie – Armand Gatti. Hommage. Radio Grenouille, 2017. acteurs associés à des spectacles, aux “raveurs” des premières Utopia, des migrants en cours de langue aux tout-petits des crèches, des publics de restaurants, aux auditeurs de radios libres, les nouveaux territoires de l’art ont montré que les fondements de l’action culturelle étaient vivants et qu’ils incarnaient une utopie concrète pouvant essaimer, mais surtout un cadre d’utopie concrète permettant à chaque territoire de générer ses propres modèles Entretien avec Fabrice Lextrait le 2 mars 2025.. »
Ce cadre, capable d’essaimer en se fondant dans les singularités des territoires d’ancrage, relève ainsi moins d’un modèle que d’une « méthode tiers-lieux ». Au nombre de ses principes d’action : une programmation ouverte – voire une non-programmation – pour laisser émerger les usages au fil du temps. Les espaces deviennent alors des outils au service de la vie locale, accompagnés par des équipes qui facilitent ces dynamiques, comme le résume bien l’expression de « régie des possibilités locales », employée par l’association Yes We Camp. Cette approche repose sur l’acceptation de l’incertitude, la place laissée à l’expérimentation sans craindre l’erreur, et une capacité constante à ajuster le projet en fonction du contexte. Elle s’accompagne d’une attention partagée au lieu dans une logique de contribution collective. Des formes d’organisations et de gouvernance ouvertes donnent place et voix à la diversité des usagers et des usages. Enfin, en pariant sur l’intensification de ces derniers et sur la chronotopie, la capacité à hybrider les activités permet une diversification des publics, des modes d’appropriation comme des ressources au sein de modèles socio-économiques propices à des péréquations vertueuses.

Le tiers-lieu : horizon d’attente ou symptôme ?
Des promesses qui font programme et disent en creux le désir de refonte des modes d’intervention depuis l’institution culturelle, tant pour les services de collectivités qui veulent créer (ou réhabiliter) par le biais d’une commande politique un nouveau lieu sur leur territoire, avec l’envie de décloisonner et de partir des usages, que pour les professionnels des structures culturelles et artistiques qui s’intéressent à la transformation du projet, aux différentes formes d’organisations, aux modèles économiques, à la gouvernance, en recherche de nouvelles manières de faire, alternatives aux fonctionnements traditionnels. Ainsi s’inspirer de l’objet tiers-lieux permet de faire évoluer les organisations elles-mêmes et le travail vers des formes plus collaboratives. Ou le tiers-lieu comme vecteur d’accompagnement au changement et d’extension du référentiel des politiques culturelles au prisme de la réciprocité entre lieu culturel et son territoire et l’émergence d’instances participatives autour des programmations.
Le tiers-lieu, modèle d’inspiration, se fait aussi le révélateur d’un certain climat des politiques culturelles actuelles, ainsi que des doutes et aspirations des équipes des institutions et équipements culturels confrontés aux enjeux quotidiens, ou s’essayant à la prospective. Ainsi peut-on se poser la question : de quoi cet intérêt pour les tiers-lieux est-il le symptôme dans les politiques culturelles ? Pour Alice-Anne Jeandel, cet aveu est multifactoriel, transverse et éminemment politique : « Les acteurs culturels s’interrogent beaucoup sur les enjeux de transition, de renouvellement des publics et les tiers-lieux sont des modes de faire qui peuvent aider à repenser les lieux quand les institutions se heurtent à des enjeux de gouvernance, de participation, de relation au territoire, et des modèles économiques fragilisés… La question des transitions est par nature transversale. Les tiers-lieux peuvent nous aider à relever les défis des transitions sociétales et à remettre les lieux culturels au centre de la société et de ses enjeux. » Au-delà du renouvellement des publics ou de l’hybridation des modèles économiques, c’est donc la question du sens de la culture qui se joue dans cet horizon tiers-lieu : la prise en compte du territoire, la mixité des usages, l’implication des parties prenantes, des formes de redistribution du pouvoir avec des gouvernances plus ouvertes et, de façon sous-jacente, le criant besoin de « faire évoluer le modèle de l’institution qui est à bout de souffle » dans un secteur marqué par l’affaiblissement du service public culturel, le vieillissement des publics, la verticalité de l’adresse des formes artistiques et culturels (selon une logique d’offre), la monofonctionnalité des espaces, et l’inertie organisationnelle peu encline aux changements.
Pour Stéphanie Béziau, directrice de la culture de la Ville de Rezé (44), le mouvement tiers-lieu est autant source d’inspiration que miroir déformant pour les équipements culturels : « Le tiers-lieu correspond à la nécessité d’intégrer ces modes opératoires nouveaux pour repenser le service public de la culture à l’heure où l’on ressent un essoufflement des formes descendantes et, en face, l’émergence de projets culturels plus ancrés, plus sobres également. Si l’on ne fait pas ce virage, nos équipements culturels vont être remis en question. Mais cela n’est pas simple avec les équipes, il faut prendre le temps nécessaire pour changer de curseur et aider toutes les parties prenantes à prendre les choses à bras-le-corps et, surtout, se sentir légitime à le faire. La démarche itérative et expérimentale des tiers-lieux peut constituer un changement de paradigme brusque, mais peut aussi correspondre pour les équipes à un ressenti de perte d’expertise et perte de sens. L’autre risque est de “faire tiers-lieu” comme une injonction que l’on ne questionne plus, en perdant les intentions initiales, et nos horizons communs. »
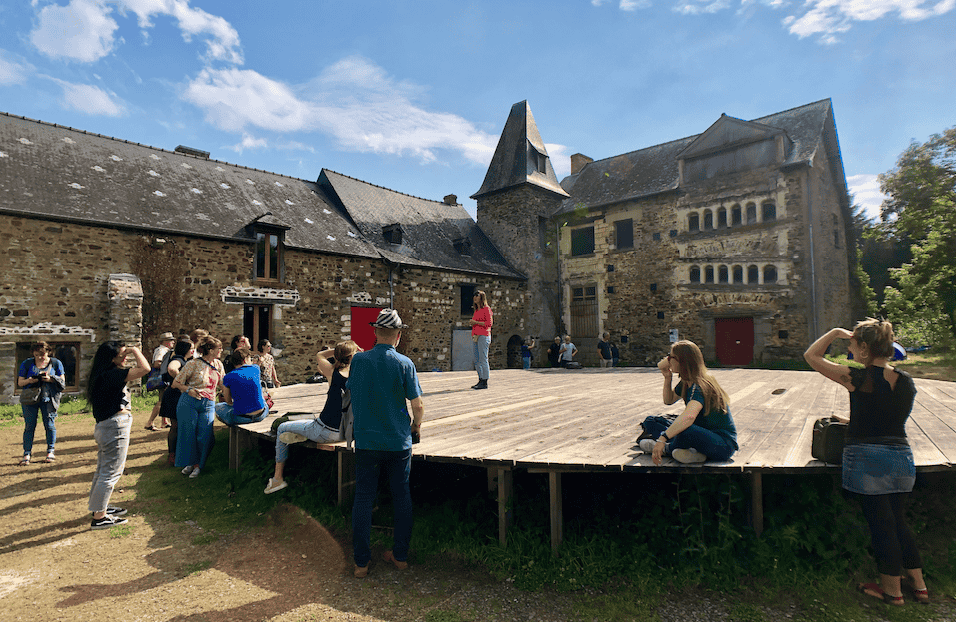
Repenser les politiques culturelles depuis les tiers-lieux ?
Alors, comme l’appellent de leurs vœux Fabrice Raffin ou Sylvie Robert, faut-il construire une politique culturelle depuis les tiers-lieux, devenus, depuis 2017, « un modèle à suivre » ? Ou repenser les institutions culturelles depuis les expérimentations menées par ces tiers-lieux, en faveur d’une culture transitive, transsectorielle, usant de la chronotopie, de logiques contributives et de formes de gouvernance plus ouvertes ? Il s’agit en tout cas de ne pas opposer tiers-lieux et équipements culturels et de sonder leurs complémentarités L’étude menée par le collectif de recherche Cluster 93 en Île-de-France montre bien comment tiers-lieux et équipements sont partis d’un même continuum tant dans les trajectoires des artistes que dans les usages des publics.. Le piège principal consiste à voir dans les tiers-lieux un modèle générique de sortie de crise https://shs.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-96?lang=fr&tab=sujets-proches, à moindres frais lorsque ceux-ci démontrent que l’on peut faire beaucoup avec peu (notamment par leur capacité à diversifier les sources de financement), et ainsi niveler par le bas le service public de la culture. Un autre risque serait que les politiques culturelles prennent un virage low cost, en s’inspirant des tiers-lieux uniquement pour leur capacité à inventer de nouveaux modèles économiques dans un contexte budgétaire contraint – au détriment des conditions déjà précaires dans lesquelles ces lieux et leurs équipes évoluent.
Un défi bien identifié par Eléonore Havas, coordinatrice du tiers-lieu La Basse Cour dans l’ancienne ferme du château de la Prévalaye à Rennes : « Il ne s’agit surtout pas, en matière de politique publique, de défendre une baisse de ressources pour les institutions culturelles qui ont par ailleurs besoin de davantage de moyens pour faire évoluer leurs modèles vers les droits culturels et d’autres types de médiation. La proposition portée par les tiers-lieux doit être complémentaire. À Rennes, le tissu territorial qui se met en place entre des tiers-lieux comme La Basse Cour ou l’Hôtel Pasteur et des institutions comme Les Champs Libres, permet de substituer à un registre concurrentiel celui de la solidarité, de la complémentarité, et d’un plaidoyer commun. »
Un débat qui résonne avec ceux contemporains du rapport Lextrait en 2001, selon ce dernier : « L’instituant qu’incarnent les nouveaux territoires de l’art n’a jamais été contre l’institué des institutions culturelles. Je dirais même qu’instituant et institué ressentent aujourd’hui encore plus qu’il y a trente ans de nécessaires alliances contre la domination du marché et de l’économie du libre-échange, hélas de plus en plus souvent incarnée dans certaines de nos politiques publiques. Ce qui s’est généré depuis trente ans doit se cultiver dans le champ d’un instituant transversal qui n’est pas la marge, mais le centre de nos problématiques d’évolution, et/ou de révolution de systèmes. Friches, tiers-lieux, NTA, ne doivent pas être un alibi du système, ne doivent pas être la marge. Ils doivent être le ferment, l’accélérateur du mouvement, de la refondation des institutions. » Il s’agit alors, comme le programme la formation de l’OPC « Réinventer les équipements culturels à l’heure des tiers-lieux », de butiner dans chaque modèle en présence pour esquisser les contours des lieux culturels de demain, au service des transitions, dans un rapport de réciprocité pouvant par ailleurs s’appuyer sur la mobilité de plus en plus présente de travailleurs de la culture passant de l’un à l’autre et contribuant à hybrider les référentiels.
Pour aller plus loin :
- https://observatoire.francetierslieux.fr/quels-lieux-entre-politique-culturelle-et-pensee-politique-de-la-culture/
- https://observatoire.francetierslieux.fr/les-droits-culturels-en-lieux/
- https://observatoire.francetierslieux.fr/relire-rapport-lextrait-en-2022/
-
M.-P. Bouchaudy, F. Lextrait, Un abécédaires des friches, laboratoires, fabriques, squats, espaces, intermédiaires, tiers lieux culturels, Paris, Sens & Tonka, 2023.
-
O. Hamant, De l’incohérence, Paris, Odile Jacob, 2024.
L’article Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
24.04.2025 à 10:04
Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism
Visiter le site d’une catastrophe naturelle ou humaine à Fukushima ou à la Nouvelle Orléans à la suite de l’ouragan Katrina, faire une excursion dans une favela au Brésil ou un township en Afrique du Sud… une offre de « dark tourism » a émergé à côté des circuits traditionnels. Si le terme est relativement récent, défini […]
L’article Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Lire plus (163 mots)
Visiter le site d’une catastrophe naturelle ou humaine à Fukushima ou à la Nouvelle Orléans à la suite de l’ouragan Katrina, faire une excursion dans une favela au Brésil ou un township en Afrique du Sud… une offre de « dark tourism » a émergé à côté des circuits traditionnels. Si le terme est relativement récent, défini d’abord par des chercheurs puis repris par le secteur touristique, ce tourisme de l’étrange n’est pas nouveau. Hécate Vergopoulos, travaille sur ce phénomène et a notamment étudié le cas de Tchernobyl. Que raconte cet attrait pour les lieux macabres ? Comment des États peuvent-ils gérer ce patrimoine difficile ? Quelles motivations à visiter de tels sites ? Faut-il les patrimonialiser ?
L’article Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
17.04.2025 à 14:30
Écologie du livre : miser sur l’interprofession
La filière du livre et de la lecture n’est pas exempte d’enjeux écologiques, mais ceux-ci tardent à s’incarner dans la construction d’une politique cohérente. Comment impulser et mettre en œuvre cette transition dans un secteur aux acteurs variés, aussi bien en typologie qu’en échelon géographique ? Et quelle part prennent les bibliothèques sur le sujet ?
L’article Écologie du livre : miser sur l’interprofession est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (2747 mots)

À quelles problématiques fait face le secteur du livre et de la lecture en matière d’écologie ?
Mélanie Mazan – L’Association pour l’écologie du livre analyse la filière du livre et de la lecture au prisme des pensées de l’écologie : un écosystème écologique doit être diversifié, équilibré, en interdépendance et non délétère pour les éléments qui le composent ainsi que pour les autres écosystèmes. Félix Guattari F. Guattari, « Les trois écologies », EcoRev’, no 43(1), p. 5-7. conceptualise à cet égard trois écologies qui doivent être travaillées ensemble, car pour agir sur l’environnement (écologie matérielle), les cadres économiques et sociaux doivent évoluer (écologie sociale), et pour cela nos cadres de pensées doivent le permettre (écologie symbolique). Au regard de cette approche, plusieurs problématiques se dégagent. La première est que le livre est certes un objet culturel, mais c’est aussi un produit manufacturé adossé à une industrie papetière extrêmement polluante et gourmande en ressources (bois, énergie, eau…) qui fait pression sur le vivant. Son économie est également fortement basée sur les flux de transport (importation du papier, distribution…). En second lieu, se pose la question du gaspillage puisqu’on estime au minimum à 25 000 tonnes le nombre de livres pilonnés en France par an (soit 13,9 % des livres distribués) – un chiffre qui fait néanmoins débat, le bureau d’études BASIC l’évaluant plutôt entre 20 % et 25 % si l’on inclut la part de pilon sur stock Un livre français – Évolutions et impacts de l’édition en France, Basic, 2017.. L’économie du livre – et notamment les librairies – est par ailleurs noyée sous un flux de nouveautés. Cette surproduction – en nombre de titres et en volume – est induite et admise par le système, intégrée dans les modèles économiques. Au-delà de ces enjeux environnementaux et matériels, nous constatons enfin un manque de diversité des œuvres accessibles puisque quatre groupes d’édition financiarisés (Hachette, Éditis, Madrigall et Média-Participations) détiennent 70 % du marché de l’édition, avec 41 % rien que pour le groupe Hachette (chiffres 2023). Cette concentration crée un déséquilibre au sein de l’écosystème, puisque ces groupes écrasent et invisibilisent les acteurs indépendants, avec une force de frappe sur les plans de la production, de la distribution et de la prescription médiatique impossible à égaler par la petite et moyenne édition. Ce déséquilibre économique met en danger l’indispensable bibliodiversité (diversité culturelle appliquée au livre) qui nourrit la richesse des représentations et des imaginaires au sein de nos sociétés.
Mélanie Cronier – J’ajouterai aussi une autre problématique à laquelle fait face le secteur : son organisation en silos. Cela entraîne une faible interconnaissance entre les différents corps de métiers qui n’aide pas à avoir une vision écosystémique. Plutôt que de faire corps sur des sujets comme l’urgence climatique et la concentration éditoriale, les professionnels se renvoient souvent la balle. Il serait donc temps de passer de cette logique concurrentielle à une dynamique plus coopérative, tout en prenant en compte la diversité des réalités.
Que représenterait un livre « soutenable » ?
M.M. – Sur le plan matériel, nous ne savons pas, aujourd’hui, fabriquer du papier ou de l’encre de manière complètement neutre. Nous ne savons pas non plus faire du papier local, écologique, dans des forêts gérées écologiquement en quantité suffisante pour répondre à la demande actuelle – seuls y parviennent partiellement quelques acteurs en Europe, notamment en Scandinavie. Nous pouvons noter cependant des avancées sur le plan de l’éco-conception des livres (en jouant sur les formats, les encres, les typographies…) et des améliorations quant aux performances environnementales des lignes de production industrielle. L’enjeu principal reste celui de la surproduction pour sortir d’une logique de flux, de nouveauté et de vitesse. Un livre reste en moyenne trois à quatre semaines sur une table de librairie avant d’être renvoyé à l’éditeur et n’a pas le temps de trouver son lectorat. Le taux de retour par trimestre est de 22 % en moyenne et de 62 % pour les nouveautés Selon une étude du Syndicat de la librairie française.. Ralentir et donner plus de temps à chaque titre est encore un impensé. Plus globalement, il existe une vraie tension entre la notion de livre comme objet culturel d’intérêt général ou collectif et le livre comme produit industriel soumis à des logiques marchandes.
M. C. – Il faut souligner qu’il existe peu de données chiffrées quant au poids du secteur en matière d’environnement, mis à part le rapport du Shift Project « Décarbonons la culture ! » publié en 2021 On y lit que la production et la commercialisation d’un livre représentent environ 1,8 kg de CO2 par exemplaire, dans le cas d’un ouvrage acheté en librairie de centre-ville. La production représente environ 40 % des émissions ; l’activité d’édition, de diffusion et de distribution autour de 20 % ; la librairie un peu moins de 30 % des émissions ; et enfin les déplacements des clients vers la librairie plus de 10 % des émissions moyennes par livre. (Cf. The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », novembre 2021. Partie « Décarboner le livre, la lecture, l’édition et la chaîne du livre », p. 92 à 138).. Des études – de la part du ministère de la Culture et du Centre national du livre – sont néanmoins en projet. À noter, par ailleurs, que le livre est le seul objet qui n’est pas concerné par la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ni la R.E.P. papier qui fixe la responsabilité élargie du producteur d’un produit. Cela pourrait être un levier pour responsabiliser les producteurs de livres. Subsiste néanmoins une question : qui serait qualifié de producteur dans cette chaîne ?
Quels sont les acteurs à même d’impulser et mettre en œuvre cette transition ?
M. M. – Les acteurs de la filière du livre et de la lecture sont extrêmement nombreux (de la fabrication de la pâte à papier jusqu’aux points de vente ou de diffusion du livre) et beaucoup ont « la tête dans le guidon » – comme dans toutes les filières économiques. Nous avons donc besoin de structures qui soutiennent, accompagnent et font du lien, pour proposer des espaces de réflexion notamment sur les questions écologiques. Malheureusement, les structures régionales du livre qui font partie de ces lieux de dialogue interprofessionnel sont actuellement mises en danger par les baisses imposées des dotations des collectivités, et plus dramatiquement en Pays de la Loire.
M. C – En effet, la subvention de la Région – qui représente 75 % du budget de fonctionnement de Mobilis – est diminuée de 50 % en 2025 et sera totalement supprimée en 2026. L’association va perdurer, mais elle n’aura plus de salariées pour proposer de l’accompagnement, faire de la formation, organiser des journées professionnelles et publier des ressources. Or l’enjeu en matière de politiques publiques se situe dans le soutien aux structures régionales pour le livre. Tout le travail mené jusqu’à aujourd’hui sur les questions écologiques se nourrit des observations de terrain des professionnels que nous avons pris le temps d’écouter, dont nous avons recueilli et rassemblé les initiatives. Cela a lancé une véritable dynamique, dans une logique bottom-up. Si demain ces structures disparaissent, nous pouvons craindre un repli sur soi des professionnels.
M. M. – Au niveau national, la structuration est forte via les syndicats et les fédérations, mais elle est organisée par métier – le Syndicat national de l’édition SNE, Charte environnementale de l’édition de livres : un guide des bonnes pratiques, octobre 2021. et le Syndicat de la librairie française SLF, Écologie en librairie : bonnes pratiques et inspirations, 2024. ont par exemple publié des guides de bonnes pratiques – alors que la transformation écologique nécessiterait aussi et avant tout d’être pensée à l’échelle de la filière. L’Association pour l’écologie du livre se retrouve être le seul espace d’échange véritablement interprofessionnel au niveau national. Cela avance néanmoins depuis quelques mois et le sujet commence à être abordé dans différents événements professionnels du secteur.
Comment s’articulent les différentes politiques locales, régionales et nationales autour de ces enjeux ?
M. M – Il peut être important de rappeler que nous avons la chance d’être encore dans un pays exceptionnel en matière d’aide publique à la création et à l’édition. Le prix unique du livre est également une exception culturelle. Ces financements permettent de maintenir un écosystème indépendant malgré le contexte de concentration éditoriale. Toutefois, en matière de transition écologique, il n’existe pas de politique ni d’aide nationale dédiée hormis le timide plan de soutien qu’a lancé le Centre national du livre en mai 2024 qui s’appuie sur la feuille de route définie par le ministère de la Culture en 2022. Le plan Alternatives vertes 2, dans le cadre de France 2030, constitue un moyen pour accompagner des initiatives, mais de façon assez indirecte. C’est donc majoritairement aux niveaux local et régional que cela se structure. Mobilis est le seul pôle régional à avoir un temps plein dédié aux questions écologiques, mais son travail a infusé dans toutes les régions. Ces structures font réellement de la politique publique ou parapublique. L’échelle politique locale pourrait être un levier à approfondir bien que les villes et métropoles ne soient pas, à ce jour, très actives sur l’économie du livre, qui n’est pas dans leur compétence. Les régions sont davantage concernées par cet accompagnement au développement économique.
M. C. – Les communes et les départements ne sont peut-être pas très actifs sur l’économie du livre mais n’oublions pas les politiques de lecture publique. Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt qui achètent des livres sont des acteurs importants de cet écosystème du livre et de la lecture. Les bibliothécaires sont assez investis dans ces réflexions et se forment à ces questions.
Quelle part, justement, prennent les bibliothèques sur ce sujet de la transition écologique ?
M. C. – Leurs leviers sont multiples : d’un point de vue matériel, on peut citer la gestion du bâtiment, l’énergie, la gestion du désherbage (qui vise à élaguer la collection de documents), l’équipement des ouvrages ; elles peuvent également être attentives à mettre en avant l’édition indépendante dans leurs politiques d’acquisition. L’Association des bibliothécaires de France a une commission « bibliothèques vertes » et tient un Blog qui partage des bonnes pratiques et des ressources, car elles ont déjà cette habitude de travailler en réseau. Elles peuvent avoir un impact direct sur les habitants : au-delà du prêt de livres, les bibliothèques sont de véritables lieux de vie, et sont par définition des lieux écologiques où l’on peut mutualiser des espaces, aller aux toilettes, bénéficier du chauffage…
M. M – Les bibliothèques sont un acteur essentiel pour penser le futur de l’écosystème du livre. Au sein de notre association, nous menons des ateliers d’éco-fiction, c’est-à-dire de la fiction d’anticipation dans un environnement à forte contrainte écologique. Dans 90 % des cas, nous revenons à une démarchandisation du livre et à une réappropriation du livre comme un commun. Inévitablement, dans ces éco-fictions, les bibliothèques prennent une place centrale dans la ville ou le village. Elles deviennent un lieu de vie, d’accueil, d’échange de savoirs, de mutualisation des outils technologiques… Aujourd’hui, la bibliothèque est mise au ban des réflexions sur l’économie et l’écologie du livre, alors que d’un point de vue économique elle a un énorme impact sur le chiffre d’affaires des libraires locales. En matière d’acquisition, il y aurait cependant un travail à mener pour aider les librairies indépendantes à accéder à ces marchés publics. Mutualiser des livres est également dans l’ADN des bibliothèques et cela constitue un levier important pour contrer la surproduction, pour augmenter la durabilité et la circulation des livres.
M. C. – On entend beaucoup parler de la notion de « circuit court » mais en matière de fabrication du livre, c’est impossible. Cela se joue plutôt du côté de sa diffusion. À cet endroit, les bibliothèques peuvent promouvoir – par le biais de leur politique documentaire – un document cadre qui permet de définir clairement des choix et engagements. À titre d’exemple, la médiathèque L’Échappée aux Sorinières (44) a annoncé réserver 20 % de ses acquisitions à l’édition régionale, pour soutenir l’édition en Pays de la Loire qui se retrouve mécaniquement en difficulté à la suite des annonces de la présidente de Région. Une autre bibliothèque, à Rezé (44), implique les habitants dans le choix des livres qu’ils souhaitent avoir dans leur bibliothèque. Pour finir, il y a la question du désherbage qui peut se travailler au niveau local, en nouant des partenariats avec des associations dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est par l’établissement de dynamiques de coopération que nous pourrons réellement faire bouger les lignes.
L’article Écologie du livre : miser sur l’interprofession est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
10.04.2025 à 09:40
Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé
De plus en plus de collectivités, mais aussi d’institutions publiques ou de promoteurs privés, font appel à des entreprises spécialisées en ingénierie culturelle pour des missions de politique culturelle, de réhabilitation d’équipements, de création d’événements… Un marché crucial dans le paysage culturel, avec un risque croissant de standardisation et de concentration.
L’article Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (2435 mots)

Article paru dans L’Observatoire no 63, décembre 2024
Une enquête du Monde (12 avril 2024) sur l’attribution du label « capitale européenne de la culture » à la ville de Bourges nous apprend que le maire Yann Galut avait au départ fait appel à une société d’ingénierie culturelle, Troisième Pôle. Mais le résultat escompté s’est fait attendre : « le projet patine », écrit le journaliste Laurent Carpentier. Au bout du compte, la ville décide d’arrêter sa collaboration avec cette agence pour confier le projet à Pascal Keiser, directeur de théâtre et commissaire d’exposition, qui s’était déjà occupé de la candidature de la ville belge de Mons comme capitale européenne de la culture. Un choix porteur : Bourges rafle la mise et organisera l’événement en 2028. Ces sociétés d’ingénierie, qui emportent aujourd’hui nombre d’appels d’offres dans le secteur culturel, seraient donc faillibles ?
La directrice de Troisième Pôle, Caroline Couraud, nous donne sa version des faits : « La ligne d’orientation politique a changé. Au départ, la ville de Bourges nous a demandé d’imaginer un projet le plus participatif possible, en dialogue avec les habitants. Puis le maire a souhaité avoir un interlocuteur unique, à l’ancienne. Il peut être plus facile dans certains cas pour un élu d’avoir face à lui une seule personne. »
Mais le rétropédalage de Bourges semble plutôt une exception. Aujourd’hui, la tendance est surtout de voir les collectivités territoriales se tourner vers des sociétés extérieures pour réaliser ce qu’elles faisaient encore en interne il y a quelques années. Un effet donc d’aubaine pour les acteurs du secteur. « La baisse des dotations publiques a amené les collectivités à se réorganiser, à externaliser davantage pour gagner sur leurs masses salariales », constate Vincent Carry, directeur général d’Arty Farty, qui gère les Nuits sonores à Lyon et la Gaîté lyrique à Paris, et a développé en son sein une activité d’ingénierie culturelle. « Ce sont majoritairement les villes moyennes qui font appel à nos services. Les grandes villes peuvent davantage le faire en interne », observe Caroline Couraud. Il arrive également que des opérateurs culturels en tant que tels sollicitent des sociétés d’ingénierie pour des missions de développement, économique ou bâtimentaire. Anne-Caroline Jambaud, codirectrice du pôle Coordination et Liens d’Arty Farty, note que « la complexité des dispositifs de financement public incite aussi à faire appel à des sociétés d’ingénierie, car les structures culturelles ne sont pas assez outillées ». Les établissements publics ou parapublics ne sont pas les seuls commanditaires. Des promoteurs immobiliers passent également des appels d’offres à ces sociétés, en particulier pour accompagner la transformation de friches industrielles en tiers-lieux. Les missions sont extrêmement variées, depuis l’étude de politiques culturelles jusqu’à des recommandations pour l’aménagement d’espaces, en passant par du conseil artistique ou l’accompagnement de dossiers européens. Ces agences d’ingénierie ont donc entre leurs mains une (grande) partie de l’avenir du paysage culturel.
La tendance est surtout de voir les collectivités territoriales se tourner vers des sociétés extérieures pour réaliser ce qu’elles faisaient encore en interne il y a quelques années.
Multiplication des acteurs et complexité des missions
Les sociétés qui répondent à ces appels d’offres sont de différentes natures. Les plus grands cabinets d’audits et de conseils investissent désormais le créneau culturel, notamment EY (anciennement appelé Ernst & Young), l’un des leaders mondiaux en ce domaine, ou encore le groupe In Extenso, qui compte près de 6 200 collaborateurs. Ces entreprises développent un modèle duplicable qui leur permet de répondre à un maximum d’appels d’offres. « Les collectivités peuvent être séduites par l’image d’autorité due à la taille de ces agences et au prestige de leur marque. Par exemple, un maire peut parfois plus facilement faire accepter un projet de nouvelle médiathèque en disant que c’est EY qui le lui recommande », nous souffle un observateur du secteur, qui craint un effet de concentration du marché de l’ingénierie culturelle. À la suite de notre demande d’interview, la direction de la communication d’EY nous a indiqué que « les équipes ne prenaient pas la parole sur le sujet en raison du changement de gouvernance actuel en interne ». Prompt à répondre aux appels d’offres, EY semble moins réactif avec les journalistes. Dans le secteur, certaines voix critiquent également les méthodes de ces groupes qui vont toujours aller dans le sens de leur commanditaire.
L’économie sociale et solidaire (ESS) s’empare aussi de ce créneau. La branche culture du groupe SOS, géant de l’ESS, compte en son sein l’agence Troisième Pôle. Elle développe des projets à Marseille, Saint-Ouen, Sèvres. Par sa gouvernance et son mode organisationnel, l’ESS diffère nettement du secteur culturel institutionnel. Il n’empêche : les deux mondes cherchent à se rencontrer. Et l’ingénierie en est une porte d’entrée. « Comment hybrider les financements ? Comment créer de l’innovation en servant l’intérêt général ? Ces pistes nous semblent passionnantes à explorer, pour dépasser notamment les barrières public/privé, nous dit Sarah Yanicostas, directrice générale Culture du groupe SOS. Notre but est de coconstruire avec les artistes, les habitants, les associations, et de permettre l’accès à la culture pour des publics au parcours de vie cabossé. » Reste des freins dans la philosophie même des projets : « L’ESS pense beaucoup plus en évaluation d’impact que le secteur culturel, poursuit Sarah Yanicostas. C’est un monde qui est encore trop cloisonné, qui regarde parfois de haut les publics qu’il ne connaît pas. »
En parallèle, on voit aussi de plus en plus d’associations ou d’opérateurs culturels développer en leur sein une activité d’ingénierie. Ces acteurs de terrain mettent en avant leur expérience. « Comme nous gérons plusieurs structures culturelles, nous ne sommes pas une agence hors-sol. On est dans le faire. Nous sommes de bons capteurs de l’évolution des usages », nous dit Vincent Carry, avant de préciser : « Nous faisions toujours un peu d’ingénierie culturelle, mais désormais ce volet a vocation à se développer. » Arty Farty a ainsi remporté des appels d’offres pour des missions sur des halles à Marseille et Toulouse, un festival à Reims, une école à Lyon.
Enfin, les grands établissements publics se mettent également sur ce créneau. À Paris, le Centquatre compte ainsi une équipe d’une douzaine de personnes dédiée à cette activité, dont la moitié est composée d’urbanistes, géographes, architectes. « L’un de nos domaines de prédilection, ce sont les projets d’urbanisme culturel, souligne Martin Colomer-Diez, directeur de l’ingénierie culturelle du Centquatre. Avant même de développer un département spécifique, nous avons été sollicités par des institutions, des gouvernements qui cherchaient à réhabiliter des lieux patrimoniaux. Tout le monde veut aujourd’hui sa friche culturelle. » L’arrivée des établissements publics sur le marché fait grincer des dents. Pour Caroline Couraud, « c’est de la concurrence déloyale. Ces institutions sont subventionnées. Elles recrutent désormais des collaborateurs pour se développer sur ce créneau. Et en face, les commanditaires espèrent ainsi obtenir un mini-Centquatre ». Une vision que Martin Colomer-Diez ne partage pas : « On doit être rentable comme une société privée. Nos marges servent à financer l’activité artistique du Centquatre. Et en aucun cas, nous ne cherchons à faire un mini-Centquatre, bien au contraire, nous recherchons à mettre en avant l’identité de chaque projet. En revanche, si certains acteurs viennent vers nous, c’est peut-être aussi grâce à notre réputation de service public. »
On l’aura compris : sur ce marché, chaque agence essaie de se distinguer. EY avec son expertise économique, SOS avec son volet social, le Centquatre avec son axe urbanistique ou encore Arty Farty avec sa dimension éditoriale, comprenant en son sein un pôle Idées… Steven Hearn, fondateur il y a vingt-cinq ans de Troisième Pôle, observe l’évolution de l’ingénierie culturelle : « La première génération a été incarnée par une figure comme Claude Mollard, fondateur de l’agence ABCD, qui organisait les grands projets culturels du pays. Puis on est passé à une vague de techniciens. Aujourd’hui, on repolitise l’ingénierie culturelle, en prenant en compte les questions de développement durable, d’inclusion. »
Si les sociétés se développent sur ce créneau, est-ce par appât du gain ? Sur le plan économique, les témoignages sont nuancés. « Il y a un fantasme sur les sociétés de conseil. Mais cela dépend de la taille des structures. Nous faisons pour notre part un million d’euros de chiffre d’affaires et arrivons à être à l’équilibre », nous dit Caroline Couraud, précisant que la moitié de ses équipes télétravaillent en région – comme pour faire mentir le cliché de la société parisienne donnant des leçons à la province. « On perd beaucoup d’appels d’offres. Or à chaque fois, c’est un temps important qui est mobilisé. Dans les concours d’architecture, les équipes shortlistées sont payées. Ce n’est pas le cas dans notre domaine », regrette Vincent Carry. Récemment, Arty Farty a ainsi consacré beaucoup de temps au projet du Théâtre national de Strasbourg, qui voulait réhabiliter un ancien auditorium situé dans ses murs mais aujourd’hui inutilisé. C’est le Centquatre qui a remporté la mise. Arty Farty réalise en ingénierie culturelle un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 000 euros – une mission rapporte entre 5 000 et 30 000 euros. La branche ingénierie culturelle du Centquatre ne souhaite pas de son côté communiquer le montant de son chiffre d’affaires.
Externaliser des missions de préfiguration qui se révéleront décisives dans le développement de l’offre Culturelle n’est-il pas quelque peu paradoxal ?
Enjeux politiques et éthiques : quel avenir pour l’ingénierie culturelle ?
Le développement des agences françaises passe aussi par l’étranger, où elles exportent leur savoir-faire. Troisième Pôle et Arty Farty ont par exemple toutes deux travaillé en Afrique de l’Ouest. Il peut s’agir aussi bien de missions de développement culturel que d’études de dispositifs techniques.
Reste des questions éthiques. « Contrairement à d’autres agences, nous n’avons pas candidaté pour des appels d’offres en Arabie saoudite, alors même que le pays se développe sur le plan culturel », nous dit Steven Hearn. Pour le projet d’Al-Ula, au nord-ouest du pays, le régime wahhabite a en effet travaillé avec nombre de sociétés françaises, notamment Accor. La France a même mis en place Afalula, une agence pour le développement d’Al-Ula. Les sociétés d’ingénierie s’inquiètent aussi devant la nature de certains appels d’offres. « Des promoteurs immobiliers veulent profiter de la culture pour créer un phénomène de gentrification et ainsi faire s’envoler les loyers », observe Anne-Caroline Jambaud. « On y a cru au départ, mais on s’est rapidement rendu compte que, dans l’orientation donnée à ces tiers-lieux, la culture n’était qu’un prétexte pour vendre de la bière », nous dit Steven Hearn, qui confie aussi avoir refusé de concourir au projet controversé d’EuropaCity, méga centre de loisirs et de commerce en Île-de-France finalement abandonné. L’intérêt général est parfois bien loin… De l’autre côté, les acteurs de l’ingénierie se félicitent de voir se développer les projets en milieu rural. « La place de la culture y est un enjeu démocratique, d’autant plus avec la menace de l’extrême droite », dit Vincent Carry.
Mais une question fondamentale se pose : externaliser des missions de préfiguration qui se révéleront décisives dans le développement de l’offre culturelle n’est-il pas quelque peu paradoxal ? « On a fait en sorte de rendre leur externalisation inévitable, en réduisant le personnel et en créant des dispositifs techniquement de plus en plus complexes. C’est finalement une question politique : veut-on confier l’avenir culturel du pays à des grandes agences de conseil et d’audit ? », nous dit un observateur du monde culturel, sous couvert d’anonymat. Face à ce libéralisme grandissant, tout l’enjeu est d’arriver à garder une diversité d’acteurs sur ce marché. La confiscation des missions d’ingénierie entre les mains de quelques agences pourrait constituer un risque majeur de standardisation du paysage culturel.
Portrait d’Antoine Pecqueur : photo Léa Crespi © Flammarion
L’article Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
03.04.2025 à 10:02
Les années Lang
Dans ce 9e épisode, Guy Saez décrypte les grandes lignes de la politique culturelle d’une figure incontournable en la matière : Jack Lang, ministre phare, qui a obtenu le doublement de son budget. Doté de moyens considérables, il œuvre fortement à la valorisation des artistes et entame une rénovation profonde des institutions culturelles, mais sa politique […]
L’article Les années Lang est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Lire plus (151 mots)
Dans ce 9e épisode, Guy Saez décrypte les grandes lignes de la politique culturelle d’une figure incontournable en la matière : Jack Lang, ministre phare, qui a obtenu le doublement de son budget. Doté de moyens considérables, il œuvre fortement à la valorisation des artistes et entame une rénovation profonde des institutions culturelles, mais sa politique fait aussi l’objet de virulentes contestations. Ainsi, l’évolution de la société viendra par la suite questionner ses fondamentaux. En quoi sa politique complexe et audacieuse a-t-elle consisté ?
Partenaires
Un podcast imaginé par l’OPC et le Comité d’histoire du ministère de la Culture.
L’article Les années Lang est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
27.03.2025 à 14:42
Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ?
Le 11 mars 2023, Guillaume Diop est nommé danseur étoile de l’Opéra national de Paris. Un moment historique : en plus de trois siècles d’existence, il est le premier artiste noir à atteindre ce grade prestigieux. Si cette nomination est perçue comme un symbole de progrès, elle met aussi en lumière une réalité bien ancrée : le ballet classique reste majoritairement blanc. Mais pourquoi ? Entre héritage esthétique, sélection rigoureuse et entre-soi, comment la diversité est-elle prise en compte dans le recrutement des danseurs ? Des questionnements auxquels Thomas Nabais a consacré son mémoire de Master.
L’article Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (1128 mots)

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai vingt-quatre ans et je suis actuellement en première année de master « Direction de projets culturels » à Sciences Po Grenoble. Auparavant, j’ai obtenu une licence de sciences humaines appliquées à l’université Grenoble Alpes. Mon parcours est un peu particulier parce qu’il s’est étendu sur plusieurs années car, en parallèle, je suis sportif de haut niveau : je pratique la danse sur glace en couple. Je pense que c’est aussi cette fibre-là, ce côté artistique du sport qui m’a amené à avoir un intérêt plus poussé pour la danse et à travailler sur ce sujet dans mon mémoire.
Je suis actuellement en stage à Villa Glovettes pour quelques mois, et j’apprends beaucoup : je découvre une large palette de compétences professionnelles dans le secteur culturel. Et puis ça me fait voir le Vercors d’une autre façon parce que, depuis dix ans, j’en ai une approche plutôt sportive et là, je le regarde autrement.
Comment est née l’envie de travailler sur ce sujet de mémoire ?
J’ai depuis longtemps une fascination pour l’Opéra de Paris – et pour la danse en général. Je me suis dit que ce serait une opportunité d’aller creuser, fouiller et voir l’arrière de la scène. Dépasser le simple fait d’apprécier le ballet, la danse, le mouvement et l’histoire pour aboutir à une réflexion. Cela faisait également écho à un cours que j’avais suivi l’année dernière et qui m’avait vraiment fait prendre conscience que les questions de société traversent le secteur culturel.
En pensant à la danse et à cette problématique de diversité ethno-raciale, la danse classique et l’Opéra de Paris me sont immédiatement venus en tête pour ces raisons de traditions que l’on connaît. J’ai trouvé que c’était un beau point de tension entre quelque chose que j’admire et un sujet important qui m’a tenu en haleine pendant tous ces mois durant lesquels j’ai réalisé ce travail.
Votre terrain d’enquête vous a-t-il surpris ?
Oui et non. Je savais d’avance que l’Opéra de Paris serait un terrain assez verrouillé, surtout pour ce sujet sensible et délicat. Je me doutais qu’il allait falloir faire preuve de perspicacité, de persévérance et de finesse pour aborder cette question si j’avais l’occasion de m’entretenir avec des membres de cette institution.
Dans le même temps, j’avais bien conscience aussi que dans les traditions, l’histoire du ballet et de l’Opéra, il existe une sorte de racisme inhérent, tout un contexte de colonisation et d’impérialisme occidental, et c’est aussi ça qui m’intéressait : comment cette histoire et ces traditions qui sont encore représentées sur la scène de l’Opéra de Paris entrent en tension avec les enjeux contemporains de diversité. Mais je dois reconnaître avoir été surpris par la vitesse à laquelle ce dernier s’en est saisi en mettant des choses en place depuis cinq ans. Les résultats ne pourront se voir que sur un temps assez long, parce que ça demande des réflexions de fond tant sur les procédures de recrutement pour intégrer l’École que sur la conception plus large de l’institution, mais je trouve que là, ça a quand même beaucoup évolué à plein d’endroits : avec le comité de la diversité, la contextualisation des œuvres, la manière de représenter les danseurs et les danseuses, de les maquiller et de les coiffer, etc. En cinq ans, pour une telle institution aussi ancrée et installée, ça m’a donné un peu d’espoir.
Depuis l’affaire George Floyd, notamment, j’ai l’impression que beaucoup d’institutions se sont questionnées sur leur rapport à la blanchité, au racisme, et aux discriminations. Il y a eu aussi le manifeste des artistes et du personnel de l’Opéra pour dénoncer l’absence de diversité, un changement de direction, très volontaire sur cette question, etc. Tout ça a donné un cadre général qui fait avancer les choses. On sent bien aujourd’hui que c’est incontournable. L’Opéra a une réelle volonté de se moderniser et de s’éloigner de l’image poussiéreuse que l’on pourrait en avoir. Il est donc obligé de prendre en compte ces questions de diversité, de même que le problème de la transition écologique, par exemple.
Que voudriez-vous faire évoluer dans le secteur culturel ?
J’aimerais évidemment plus de représentation de toutes les diversités (ethno-raciale, de genre, des corps, etc.) sur scène mais aussi en coulisses, que ce soit dans la danse, le cinéma, le théâtre. On voit très rarement des personnes plus âgées qui dansent passé quarante ans. Tout comme au cinéma, c’est bien connu que, passé un certain âge, une femme a moins de chance d’être retenue pour un film. Cela peut paraître facile de dire ça, mais voir davantage de diversité est réellement quelque chose que je souhaite parce que ce sera sans doute une force pour s’adresser à d’autres publics. Ce qui rejoint la notion des droits culturels et l’idée de « faire culture » tous ensemble. Donc, en tous points de vue, la diversité est une force essentielle pour y parvenir.
L’article Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
25.03.2025 à 10:20
Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres
En France, et plus largement en Europe, certains acteurs culturels ont fait le choix de l’indépendance, que celle-ci soit politique, institutionnelle ou économique. Une position peu évidente à tenir pour parvenir à concilier valeurs désintéressées et viabilité, spontanéité créative et professionnalisation, engagement militant et recherche de stabilité.
L’article Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (3306 mots)

Article paru dans L’Observatoire no 63, décembre 2024
L’indépendance de la production culturelle n’est pas un sujet nouveau. Déjà, Pierre Bourdieu, lorsqu’il analysait l’autonomisation du champ artistique à la fin du XIXe siècle, considérait que l’indépendance constituait, avec « l’investissement dans l’œuvre » (efforts, sacrifices, temps), « un critère assez indiscutable de la valeur de toute production artistique et, plus largement, intellectuelle P. Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1998 (1992). ». Et ce, compte tenu des pressions externes (politiques, religieuses et économiques) et internes (« les séductions de la mode ou les pressions du conformisme éthique ou logique – avec, par exemple, les problématiques obligées, les sujets imposés, les formes d’expression agréées »). Cependant, ce sujet a récemment attiré l’attention des chercheurs en sciences sociales sur fond de processus de concentration accélérée du secteur culturel et de fragilisation de ses producteurs indépendants face à la concurrence accrue des grands groupes ainsi que de la précarité des financements publics de la culture en Europe Voir par exemple : O. Alexandre, S. Noël, A. Pinto (dir.), Culture et (in)dépendance. Les enjeux de l’indépendance dans les industries culturelles, Bruxelles, Peter Lang, 2017 ; numéros thématiques des revues Sociétés contemporaines, no 111, 2018, et NECTART, no 11, 2020 ; S. Tarassi, « Multi-Tasking and Making a Living from Music: Investigating Music Careers in the Independent Music Scene of Milan », Cultural Sociology, vol. 12 (2), 2018..
Bien que ses contours ne soient pas exactement tracés, en règle générale on considère que le secteur culturel indépendant réunit les initiatives qui se donnent pour objectif prioritaire d’éviter l’intervention d’acteurs externes dans la production culturelle afin de maximiser le degré d’autonomie de la création. Des désaccords existent notamment sur les frontières à partir desquelles celui-ci devient insuffisant pour qu’une initiative ne soit plus considérée comme indépendante. Quant aux sources potentielles de l’hétéronomie redoutées par les acteurs indépendants, on y retrouve systématiquement les acteurs politiques (qu’il s’agisse des institutions d’État ou de partis et mouvements), mais aussi et surtout ceux économiques (conglomérats, sponsors, etc.), voire parfois les effets de mode, pressions et attentes provenant de la concurrence et du marché artistique. Les institutions culturelles publiques (musées, théâtres, etc.) ne sont pas perçues comme faisant partie du secteur indépendant, aussi bien que les entreprises appartenant aux grands groupes des industries créatives.
Dans ce contexte, nous avons récemment conduit une enquête sociologique, avec ma collègue Anne-Marie Autissier, sur l’exemple du réseau européen Reset! Réseau regroupant les acteurs culturels européen se revendiquant de l’indépendance, lancé en avril 2022 par l’association lyonnaise Arty Farty : https://reset-network.eu. qui fournit des éléments intéressants quant à la définition et aux pratiques de l’indépendance de la production culturelle en Europe A.-M. Autissier, Y. Kryzhanouski, Valeur(s) et conditions de l’indépendance culturelle. Autonomie et indépendance selon les membres du réseau européen Reset!, Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, 2024.. Un des aspects, dont fait état notre analyse, concerne le conflit qui peut être ressenti par les acteurs culturels indépendants entre spontanéité et durabilité de leur activité d’une part, et engagement désintéressé et professionnalisation – voire commercialisation – d’autre part. En s’appuyant sur les résultats de l’enquête, notamment les entretiens avec les acteurs, cet article examine les tensions inhérentes à l’ethos associé au statut de l’« indépendant », mais aussi les réponses pratiques, administratives et organisationnelles qui y sont apportées afin d’atteindre des équilibres susceptibles de résoudre ces contradictions dans leurs activités. Deux modalités, liées à la dimension économique de l’indépendance, s’avèrent particulièrement sensibles : la professionnalisation et la commercialisation (la recherche de profit).
Entre spontanéité passionnée et stabilité professionnelle
La première contradiction de l’activité culturelle indépendante vient de la dualité entre professionnalisation et passion. En effet, l’institutionnalisation et la stabilisation professionnelle comportent des risques de bureaucratisation, de routinisation, de rigidité et de perte du caractère expérimental de la création qui s’opposent à la spontanéité et au modèle d’activité que les acteurs culturels perçoivent comme une vocation et un engagement. À l’inverse, l’engagement volontaire et bénévole apparaît à la fois comme « le point fort et le point faible du secteur culturel Lorsque la source n’est pas précisée, les citations proviennent des entretiens avec les acteurs culturels réalisés dans le cadre de l’enquête. » qui expose, lui aussi, à d’autres risques : précarisation, insécurité de l’emploi, manque de longévité des projets, mais également exploitation économique structurelle. L’offre importante du travail gratuit que représente le bénévolat contribue à baisser les standards et les conditions d’emploi dans le secteur, surtout compte tenu de la haute fréquence à laquelle on y a recours dans l’activité culturelle indépendante.
Pour toutes ces raisons, les acteurs que nous avons interrogés se prononcent en règle générale en faveur de la professionnalisation du secteur indépendant, à condition qu’elle soit contrôlée et graduelle. Tout en aspirant à la consolidation des effectifs, ils voient dans la stabilisation salariale un risque de transformation de leur activité en un métier comme un autre.
On peut citer plusieurs façons de contrôler ces processus de professionnalisation et d’institutionnalisation. Par exemple, les initiatives culturelles indépendantes se limitent souvent à un effectif réduit de salariés plus ou moins permanents, avec un recours au bénévolat et/ou aux contrats ponctuels : c’est le cas de plusieurs structures étudiées qui ont un ratio de 3-4 salariés pour 15-18 bénévoles. Un autre choix peut aussi être fait en matière de temps de travail : si, pour certains, la priorité est de proposer des contrats à temps plein à un petit nombre d’employés, d’autres emploient à temps partiel plus de personnes mais celles-ci doivent travailler à côté pour avoir des revenus suffisants.
Cette professionnalisation souvent incomplète de la culture indépendante se reflète aussi dans la gestion des parcours et dans la prise des décisions organisationnelles. Parfois, face à la lenteur de progression des carrières due au manque de ressources, on incite les employés à changer fréquemment de poste ou de fonction, ce qui permet d’éviter la routinisation et l’impression de stagnation professionnelle. L’organisation horizontale et égalitaire, surtout lorsqu’elle s’appuie sur le bénévolat, aide par ailleurs à compenser la faiblesse des rétributions matérielles. Toutefois, elle peut s’accompagner de difficultés liées à l’attitude du « passager clandestin » en sachant qu’à la différence des modèles classiques de gestion du personnel, les critiques de la faible participation sont moins légitimes dans le cadre bénévole, volontaire et non hiérarchique. Cette situation peut devenir frustrante pour certains et provoquer des départs lorsqu’ils constatent que leurs collègues ont les mêmes droits tout en contribuant moins qu’eux. L’objectif « managérial » des initiatives indépendantes réside donc dans le fait de trouver un modèle équitable de prise de décisions, suffisamment démocratique et efficace.
Enfin, il faut mentionner que les impulsions vers la professionnalisation proviennent parfois de l’extérieur. Ainsi un interviewé évoque-t-il la tendance à la « professionnalisation involontaire » du secteur culturel en Suède. Il s’agit d’un effet de la grande disponibilité des financements publics conditionnés par un statut légal défini qui incite à la stabilisation et salarisation des effectifs. Selon cette même source, il en résulte une cooptation de la culture indépendante dans le domaine institutionnel contribuant ainsi à diminuer la spontanéité des activités créatives.
La culture indépendante est caractérisée par l’inhérente contradiction entre caractère commercial de l’activité et ethos de l’engagement désintéressé.
Entre engagement et profit
Au-delà du sujet de la professionnalisation, et en lien avec celui-ci, la culture indépendante est caractérisée par l’inhérente contradiction entre caractère commercial de l’activité et ethos de l’engagement désintéressé. On peut situer toutes les initiatives indépendantes entre ces deux pôles allant de l’entreprise à l’association sans but lucratif. Si, parmi les acteurs culturels interrogés, un consensus semble se dessiner sur le fait que le profit ne doit pas constituer la principale finalité de leur activité, une analyse plus détaillée révèle que le rapport à la question de la légitimité du profit économique varie. D’aucuns estiment que sa recherche est indispensable afin de s’inscrire dans la durée et gagner en autonomie vis-à-vis des partenaires externes. D’autres, au contraire, refusent les visées de l’activité lucrative par principe : l’objectif est de défendre des valeurs d’ordre social et politique, construire ou représenter des communautés, donner voix ou fournir un lieu sûr aux minorités vulnérables, etc.
Plusieurs solutions sont adoptées pour réconcilier ces deux piliers de l’activité culturelle indépendante et adapter son volet économique à un ethos désintéressé. Tout d’abord, si parmi les acteurs interrogés, un grand nombre considèrent important de maintenir un certain degré de commercialisation pour la stabilité et l’autonomie du projet, tous insistent sur le fait qu’elle doit être réalisée dans un esprit « artisanal » propre aux structures indépendantes et avoir une portée limitée. Une interviewée a avancé les concepts de « croissance gérable » (sustainable growth) et de « développement durable » (sustainable development) comme devant régir l’activité économique des initiatives indépendantes. Ce choix « auto-imposé » de ralentir la croissance de l’activité vise à éviter la distorsion des objectifs qui pourrait advenir à la suite de l’augmentation de profits. De manière plus pragmatique, fixer une limite à leur redistribution permet de maîtriser la commercialisation : l’une des structures étudiées réserve ainsi 30 % de ses profits au financement de l’initiative et en redistribue 70 % à ses membres. Un autre outil, également mentionné dans les entretiens, est le choix d’une forme juridique spécifique, telle l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui se rapproche de la coopérative dans son mode de fonctionnement et permet de parer à la tentation d’une recherche de profit : « On a marqué dans les statuts [de la société] l’impossibilité de redistribuer sous forme de dividendes plus de 50 % des profits s’il y en a, c’est la règle de base de toutes les coopératives. […] On se met des garde-fous à une potentielle […] voracité d’acteurs qui arriveraient dans l’entreprise. » La transparence financière accrue, y compris pour les partenaires externes et le public, permet, elle aussi, de préserver l’initiative face aux logiques de profit. Pour aller dans cette direction, une structure envisageait même d’établir en son sein « des collèges et des comités consultatifs […] pour donner voix au chapitre à différents groupements comme les utilisateurs, […] les représentants de la filière culturelle, des syndicats, peut-être même une partie pour les institutions [publiques], donc pour en faire aussi une forme d’agora dans l’entreprise qui ait un pouvoir directionnel ».
Une gestion et une sélection avisées des sources et des modes de financement constituent, elles encore, une stratégie dans la recherche du bon dosage entre profit et engagement. L’équilibre entre financements privés et publics, externes et propres, provenant de multiples sources, est considéré comme essentiel, car il assure une réelle durabilité et solidité à l’initiative tout en maîtrisant sa commercialisation. Un autre moyen de limiter cette dernière est de ne pas laisser les fonds et les investisseurs privés entrer dans le capital, en optant plutôt pour une forme obligataire de financement À la différence d’actions qui font rentrer des acteurs externes dans le capital d’une entreprise et ainsi dans le processus de prise de décisions, l’emprunt obligataire représente un simple prêt contracté par l’entreprise qui doit être remboursé aux conditions définies, mais qui ne suppose pas de participation dans le processus décisionnel., lorsque l’initiative contracte une dette remboursable. Dans cette configuration des relations, les bailleurs de fonds n’interviennent pas directement dans les prises de décisions ni dans la gestion de la structure, et n’en tirent pas de dividendes ajustés à la performance économique.
Un autre dispositif cité par les interviewés consiste à dissocier activités commerciales et projets désintéressés grâce à la création de deux structures formellement distinctes. Par exemple, une initiative française dispose de deux organisations juridiquement séparées : une société par actions simplifiée (SAS) pour la production culturelle à caractère commercial et une association loi 1901 pour les projets non lucratifs. Une structure portugaise, quant à elle, est à la fois une chaîne de télévision sans but lucratif et une compagnie de production vidéo qui poursuit des objectifs d’ordre économique. Dans ce cas de figure, le profit tiré de l’activité commerciale est souvent réinvesti dans les projets non lucratifs, d’utilité publique ou économiquement moins viables, mais artistiquement novateurs.
Le profit tiré de l’activité commerciale est souvent réinvesti dans les projets non lucratifs, d’utilité publique ou économiquement moins viables, mais artistiquement novateurs.
Dans la même logique de recherche d’équilibre, les structures qui possèdent un bar ou des établissements de restauration publique (tels ceux que l’on rencontre dans les tiers-lieux, clubs ou salles de concerts) peuvent s’appuyer sur les recettes qu’apporte cette composante pour financer les événements gratuits ou d’autres projets non commerciaux. Ainsi, un tiers-lieu parisien a trouvé de ce point de vue la stabilité suivante : le lieu peut être privatisé les lundis et mardis, et ouvert au public du mercredi au dimanche. Cette privatisation et les ventes du bar sont les deux principales sources de financement de la structure. Une partie du profit est redirigée vers la programmation culturelle souvent engagée en faveur des causes sociales ou ouvrant la scène aux nouveaux artistes encore peu connus. Les catalogues d’artistes ou la programmation dans le secteur musical et événementiel (labels, agences artistiques, clubs, salles de concerts, festivals) veillent aussi à articuler une approche solidaire et engagée à la recherche de profit : « Les artistes qui tournent font manger ceux qui ne jouent que très peu et qui sont émergents. »
La diversification de l’activité – par exemple, lorsqu’une initiative culturelle qui ne s’y destinait pas crée un média ou un label de musique – représente à la fois des sources de revenus complémentaires et un outil pour gérer la communication. Toujours dans cette perspective, un interviewé inscrit son magazine musical indépendant en ligne dans une stratégie professionnelle multiforme : il perçoit son revenu des contrats qu’il conclut en tant que consultant artistique avec des marques et autres entreprises, tout en utilisant son magazine à des objectifs immédiatement moins commerciaux, y compris pour son autopromotion. Il y publie notamment des articles originaux (opinions, longs formats) et consolide sa réputation, sans attendre que le magazine rapporte du profit.
Reste à ajouter que la commercialisation peut aussi être encadrée et limitée par la localisation géographique de certaines structures – qu’elle soit volontaire ou subie. Par exemple, le représentant d’un club de musique, situé dans un bâtiment industriel à la périphérie d’une capitale européenne connue pour sa vie nocturne, nous a signalé que cette position éloignée par rapport aux centres touristiques servait de « filtre » contre la commercialisation excessive que pourraient apporter le public de masse et l’exploitation marchande de l’initiative.
Le concept d’indépendance dans la culture a des significations multiples et sa définition évolue constamment. Le sens qui lui est associé varie en fonction de la période, du pays et de la région, mais derrière les différences dues aux contextes politico-économiques dans lesquels évoluent les initiatives culturelles indépendantes en Europe on constate une forte convergence autour des enjeux et défis liés au fonctionnement quotidien des structures. En arrière-plan, la question qui se pose est aussi celle des « bonnes » politiques publiques pour la culture indépendante. Comment valoriser l’indépendance des acteurs culturels ? Quelles mesures peuvent être envisagées afin de minimiser la vulnérabilité du secteur indépendant face aux crises ? Une réflexion attentive accompagnée d’une mobilisation des acteurs professionnels et politiques semblent aujourd’hui nécessaires pour sauvegarder et préserver la diversité et la dimension expérimentale du secteur culturel en Europe.
L’article Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
20.03.2025 à 10:53
Entraves et atteintes à la liberté de création : quelle évolution pour les collectivités territoriales ?
Bibliothèques incendiées, œuvres dégradées, expositions ou spectacles déprogrammés… comment les collectivités perçoivent-elles ces entraves et atteintes à la liberté de création ? Et sont-elles en augmentation ? C’est à ces questions que s’est intéressé le baromètre 2024 de l’OPC. François Lecercle en commente les résultats et interroge la tendance à minorer les entraves, souvent mal identifiées en tant que telles par les collectivités ou parfois justifiées par la protection des personnes que l’œuvre est susceptible de blesser.
L’article Entraves et atteintes à la liberté de création : quelle évolution pour les collectivités territoriales ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (2989 mots)
Le baromètre 2024 est riche d’enseignements sur l’évolution des budgets alloués à la culture et des priorités de la politique culturelle des collectivités. Ces informations sont particulièrement éclairantes, au moment où beaucoup d’institutions culturelles sont fragilisées, dans un contexte d’inflation et de réduction budgétaire. S’il est moins développé, le volet de l’enquête consacré aux entraves à la liberté de création et de diffusion et aux atteintes aux œuvres ou aux équipements culturels donne malgré tout des indications sur la façon dont les collectivités perçoivent l’évolution de ces entraves et atteintes. Des informations plus poussées sur les auteurs, sur leurs motivations et sur les modalités de leur action auraient été utiles pour notre analyse. Néanmoins les réponses aux questions ouvertes offrent un aperçu des quelques faits qui ont frappé les responsables culturels et permettent de dégager certaines indications générales.
Une sous-évaluation des entraves ?
Dans un grand nombre de collectivités, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’entrave ou d’atteinte : globalement, on relève 83 % de réponses négatives pour les entraves et 76 % pour les atteintes, contre seulement 10 % de réponses positives pour les entraves (8 % plus qu’avant, 2 % autant) et 17 % pour les atteintes (13 % plus qu’avant, 4 % autant). On peut se demander si, dans certains cas, ces réponses négatives tiennent moins à une absence de faits avérés qu’à une forme d’inattention. Les collectivités qui ne sont pas sensibilisées au phénomène ont sans doute tendance à ne pas en tenir registre, surtout si les faits n’ont pas eu une audience médiatique importante. Il est possible que certaines collectivités aient tendance à minorer les pressions contre la liberté de création et de diffusion parce qu’elles n’ont pas encore pleinement intégré l’idée que les entraves concertées avec menaces sont, depuis la loi du 7 juillet 2016, un délit puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
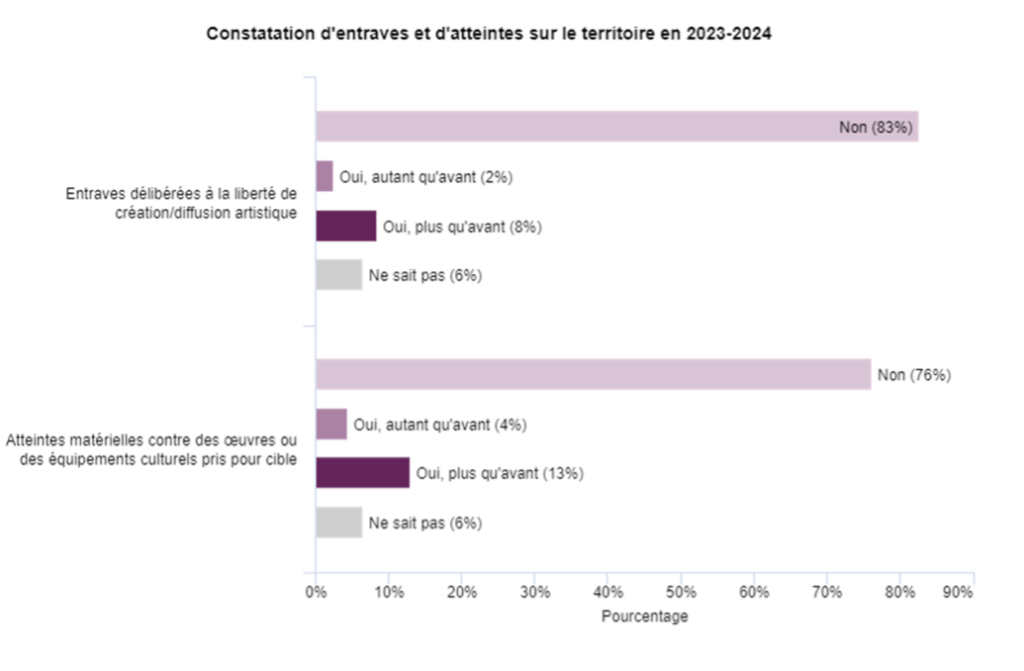
On peut aussi faire l’hypothèse que les responsables de collectivités ont de la difficulté à percevoir certaines de leurs actions comme des entraves et qu’ils remarquent surtout celles imputables à des agents extérieurs. Quand ils ont été amenés à se prononcer en faveur d’une interdiction, c’est à leurs yeux une juste réaction aux « dommages » qu’une œuvre risque d’infliger aux spectateurs potentiels ou à une partie d’entre eux. S’ils sont à l’origine de l’entrave, les responsables de collectivité auront donc tendance à la considérer comme une mesure de protection des personnes que l’œuvre est susceptible de blesser. Parfois, ils invoqueront l’ordre public, alors qu’en réalité la motivation sera plus prosaïque : la peur de déplaire, en particulier aux tenants d’un certain ordre moral. Il n’est pas rare de voir des responsables déprogrammer des manifestations, dès que des protestations se font entendre, comme ce fut le cas à Toulouse, en février 2023, quand la mairie annula un atelier de lecture pour enfants qui devait être animé par des drag-queens, dans une médiathèque Les exemples cités dans l’article ne sont pas issus du baromètre de l’OPC.
Il faudrait, pour être précis, distinguer les entraves internes, venant des autorités et tutelles administratives ou politiques, des entraves externes, qui sont le fait de groupes de pression formels ou informels, identifiés ou non. Ce sont les entraves internes qui risquent d’être mal repérées. D’autant plus que certaines sont indirectes : ainsi du festival de théâtre Sens Interdits de la région lyonnaise, dont l’organisation, en septembre 2023, a été compromise alors que des artistes maliens, nigériens et burkinabés n’ont pu y participer, le Quai d’Orsay ayant brutalement arrêté la délivrance des visas dans ces trois pays. Ces entraves venues d’en haut, dont les motivations ne sont pas culturelles, sont sans doute assez rares. Bien plus fréquentes sont les interventions des autorités régionales ou locales, dont certaines visent les institutions culturelles en tant que telles. Elles connaissent des formes douces, quand la politique culturelle devient la dernière des priorités. Elles sont bien plus brutales quand des coupes drastiques sont opérées dans le budget de la culture, comme ce fut le cas, en décembre 2024, dans la région des Pays de Loire (73 % de baisse), et au conseil départemental de l’Hérault, en janvier 2025, où le président, après avoir annoncé une suppression totale du budget culture, a fait marche arrière et annoncé une coupe de 48 %. Parfois ce sont des institutions précises qui sont ciblées. Le cas le plus notable est celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le spectacle vivant a vu ses subventions amputées, jusqu’à la suppression pure et simple. Les motivations étaient clairement politiques : le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon a fait la une des médias, en avril 2023, lorsque la région lui a brutalement retiré la totalité de ses subventions après la critique de l’orientation de sa politique culturelle par le directeur du théâtre, se prononçant en tant que responsable syndical. C’est assurément un cas extrême mais il est représentatif d’une tendance marquée des responsables politiques à s’arroger un rôle discrétionnaire dans les choix culturels des collectivités dont ils ont la charge. La presse s’en fait régulièrement l’écho. Citons encore, en janvier 2024, l’exposition de photos sur des familles roms jetées à la rue à Montreuil, organisée par l’association culturelle de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) : le maire a opposé son veto à cause du sujet, « trop sensible politiquement » pour les administrés. Cette intervention a été dénoncée sur Mediapart et l’exposition a pu se tenir ailleurs, mais d’autres échappent à l’attention, impossibles à dénoncer, faute de preuves, puisque les décisions sont prises dans le secret des bureaux. Ainsi, une exposition de photos sur un sujet considéré comme sensible politiquement, pourtant lancée par une institution culturelle prestigieuse, a été annulée par la volonté d’un président de conseil départemental : il a clairement signifié qu’il n’en voulait pas, mais sans laisser de trace écrite. Nous en avons eu vent, à l’Observatoire de la liberté de création, mais les agents chargés de l’exposition n’ont pas voulu alerter les médias, de peur de mesures de rétorsion, car les quelques mails attestant l’intervention politique auraient immédiatement permis d’identifier les fuites. Certains élus peuvent se livrer à des abus de pouvoir et des délits caractérisés sans que ceux-ci soient dénoncés sur la place publique. Le fait que les institutions culturelles dépendent de subventions est pour beaucoup dans cette omerta. Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, qu’autant de collectivités aient l’impression qu’il n’existe pas d’entraves.
Des atteintes plus facilement perçues
Le baromètre fait apparaître une différence sensible entre entraves et atteintes, ces dernières étant plus fréquemment attestées : 7 % de plus de réponses positives pour les atteintes que pour les entraves et 7 % de moins de réponses négatives. Que les collectivités soient plus sensibles aux atteintes qu’aux entraves peut s’expliquer de trois façons. Tout d’abord, la tendance à ne pas percevoir les entraves comme telles, surtout quand elles viennent des responsables. Ensuite la visibilité des atteintes aux œuvres qui sont plus spectaculaires et plus durables, alors que les entraves peuvent être discrètes. Enfin, les atteintes semblent avoir été surévaluées en raison des émeutes de 2023. Non pas qu’on ait déclaré des atteintes inexistantes, mais certaines, même si elles ont endommagé une œuvre ou un équipement culturel, ne relèvent pas d’une action concertée contre les biens culturels. Cela apparaît clairement dans une réponse aux questions ouvertes, qui fait état d’une atteinte purement accidentelle, quand une médiathèque a brûlé parce qu’une voiture avait été incendiée à côté. En outre, ainsi que les médias l’ont relayé, les institutions culturelles sont parfois victimes d’une violence urbaine qui n’a pas vraiment de dimension culturelle. Les émeutes déclenchées par la mort de Nahel, à Nanterre, en juin 2023, se sont rapidement étendues à la France entière et ont gagné jusqu’aux départements d’outre-mer. Elles ont certes endommagé des équipements culturels, mais parmi bien d’autres types d’équipement. La colère des émeutiers s’est tournée contre la police (des commissariats ont été attaqués), contre des symboles d’autorité – et notamment celle de l’État – mais aussi contre tout ce qui était à portée de main. Elle a visé en particulier les médiathèques, avec des tentatives d’incendie, par exemple à Marseille, ou des incendies effectifs, comme à Amiens ou à Metz (où une médiathèque a été entièrement détruite). Les théâtres également ont été attaqués : la façade et le hall de la MC93, la porte et le hall de l’Opéra du Rhin, à Strasbourg, le Colisée à Roubaix et un théâtre de Val-de-Reuil ont été dégradés. Il est difficile de considérer globalement ces faits comme des atteintes à la culture. Sauf dans quelques cas où les émeutiers ont pu s’en prendre aux symboles d’une culture dont ils se sentaient exclus, les équipements culturels ont plutôt été des victimes collatérales, ce qui relativise quelque peu l’augmentation des atteintes constatée par un certain nombre de collectivités. Il ne faudrait pas en conclure que les atteintes sont négligeables, mais il faut pondérer l’impression qu’on peut avoir, à première lecture, que le patrimoine culturel est en danger, tandis que l’activité culturelle est relativement préservée.
Des atteintes et des entraves qui se diversifient
On peut tirer de l’enquête deux autres indications. Les entraves semblent un phénomène surtout urbain ou du moins elles sont plus facilement repérées dans un contexte urbain : 16 % des métropoles et 17 % des communes supérieures à 100 000 habitants en ont constaté, contre 4 % des communes de 50 000 à 100 000. Mais cette différence s’estompe pour les atteintes : 21 % des métropoles et 26 % des communes supérieures à 100 000 habitants, contre 24 % de celles de 50 000 à 100 000.
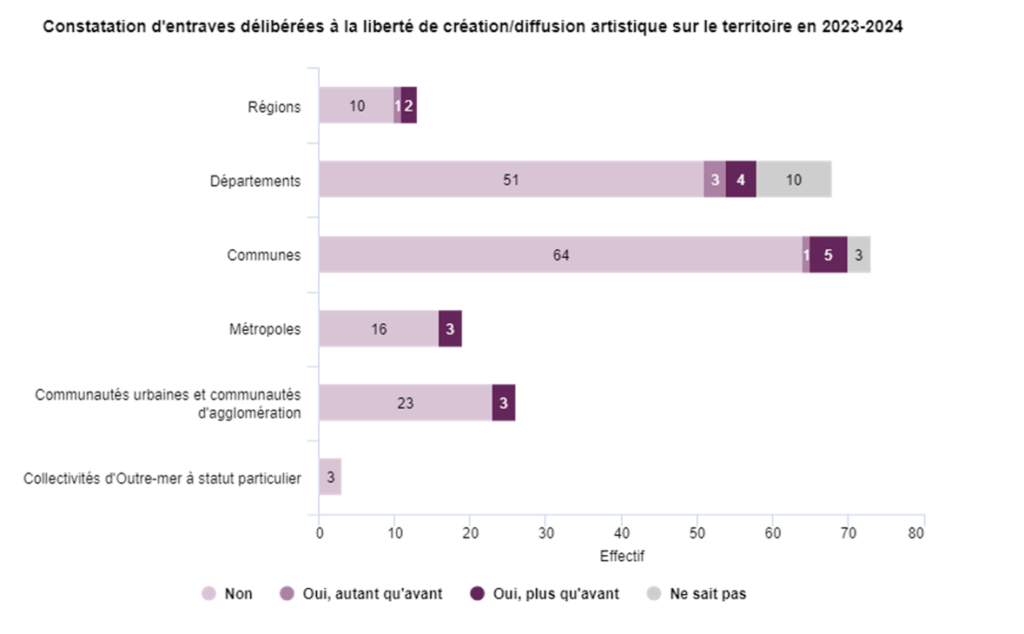
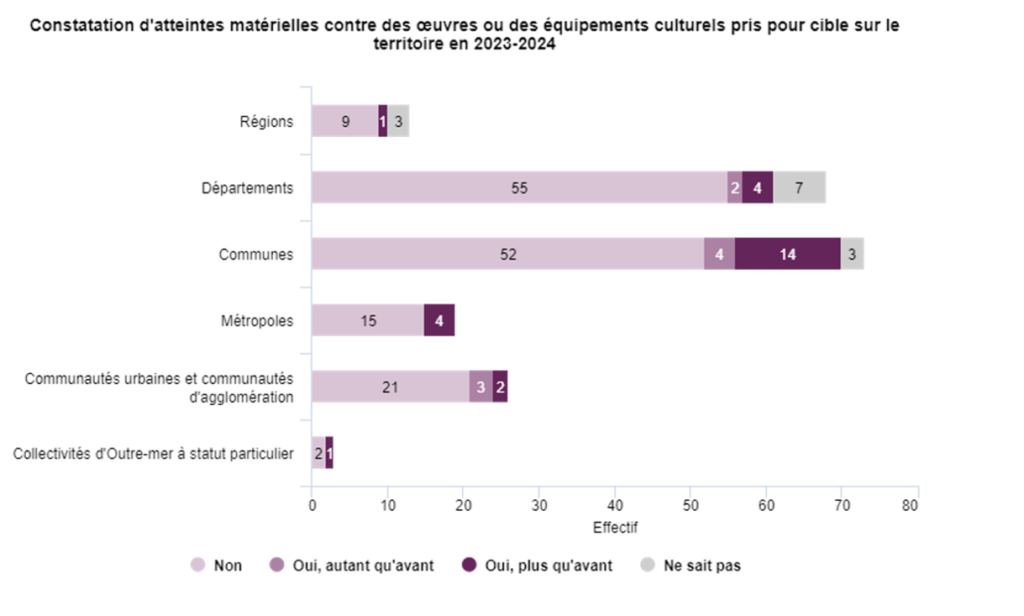
La dernière indication est que, même si les émeutes de l’été 2023 ont un peu faussé la perception des atteintes, la tendance est à l’augmentation car, dans les collectivités où des entraves et des atteintes ont été constatées, l’augmentation l’emporte nettement sur la stabilité : 8 % d’augmentation contre 2 % de stabilité pour les entraves, et 13 % d’augmentation contre 4 % de stabilité pour les atteintes. Autrement dit, parmi les collectivités qui ont constaté des entraves ou des atteintes, trois à quatre fois plus nombreuses sont celles qui notent une augmentation que celles qui ne voient pas d’évolution.
Les réponses aux questions ouvertes ne permettent pas de dégager une image nette de l’évolution et des nouvelles tendances, mais elles confirment ce que nous remarquons, à l’Observatoire de la liberté de création. Les entraves et les atteintes se sont diversifiées, c’est là le premier point. Il y a vingt ans, elles étaient essentiellement le fait d’activistes politiques et religieux situés à l’extrême droite. Depuis quelques années, avec la montée de nouvelles organisations ayant pour objet de lutter contre diverses formes de discrimination, on a vu se multiplier des revendications contre des artistes accusés de délits ou de crimes sexuels ou contre des œuvres accusées de diffuser une idéologie sexiste, raciste ou discriminatoire. Plus récemment, des activistes s’en sont pris à des œuvres pour attirer l’attention sur l’urgence climatique, étant précisé que jusqu’à ce jour, aucune atteinte irréversible n’a été portée aux œuvres, utilisées comme un moyen d’attirer l’attention sur une cause qui ne les concerne pas vraiment. À noter que ce type d’action semble en recul, certains groupes y ayant renoncé, car il est mal perçu par le public.
Le deuxième point est que, en dépit de la diversification des auteurs et des motivations, les menaces les plus sérieuses continuent de venir de l’extrême droite politique et religieuse, les activistes se sentant confortés par son influence grandissante dans les urnes. Ces atteintes se développent sur deux terrains. Le premier est l’accusation de blasphème, de profanation ou d’atteinte à la dignité religieuse : soit l’œuvre porte atteinte aux valeurs religieuses ou familiales traditionnelles, soit elle est présentée dans une église, même si celle-ci est désacralisée ou si la présentation a été dûment autorisée par les responsables ecclésiastiques. Le second est la protection de l’enfance, la moindre référence à la sexualité devenant prétexte à des accusations d’incitation à la pédopornographie. C’est le cheval de bataille d’associations de parents d’élèves, comme Parents vigilants ou Parents en colère, qui s’emploient, souvent efficacement, à empêcher des spectacles ou lectures sur le genre et qui essaient de faire retirer des bibliothèques les titres qui leur déplaisent pour des raisons politiques, morales ou religieuses.
Souvent moins visibles et plus difficiles à démontrer sont les abus de pouvoir des responsables politiques, qui s’arrogent un droit de regard sur les choix des institutions culturelles ou qui pèsent sur l’attribution des financements en fonction de leurs options idéologiques. De tels cas sont d’autant plus problématiques que ces entraves, reconnues par la loi depuis 2016 comme des délits, sont le fait de ceux-là mêmes censés veiller à son application.
Certes, les entraves et atteintes ne sont pas quotidiennes, mais elles vont croissant. Par conséquent, il est urgent de mieux cerner les contours du phénomène et son évolution. Le grand nombre de collectivités qui n’en ont pas connaissance peut paraître rassurant. Mais nous craignons que certains faits ne soient ignorés ou du moins pas jugés assez importants pour qu’on en garde trace, ou encore que des responsables se permettent d’intervenir sans considérer qu’ils outrepassent leurs attributions.
Il importe donc d’inciter les collectivités à plus de vigilance. C’est en étudiant de plus près ces actes qu’on apprendra à les contrer et, éventuellement, les prévenir. Pour mieux apprécier la gravité des faits et les menaces qui pèsent actuellement sur la liberté de création et de diffusion des œuvres, il serait utile d’aider les collectivités à mieux les identifier, et de les inciter à effectuer les signalements et à les archiver. Pour cela, il est hautement souhaitable qu’elles désignent un responsable qui organise un système de veille. Mais pour que ces collectivités prennent mieux conscience de la façon dont les entraves s’organisent, il faudrait pouvoir recueillir des informations sur la nature des faits, l’identité des auteurs et autrices (si elle est connue) et les motivations (si elles sont explicites ou si on peut les conjecturer).
Disposer de données est aussi un moyen d’alerter et de responsabiliser les collectivités. L’Observatoire de la liberté de création est en position d’intervenir en cas de menace de censure. Il peut le faire par des moyens qui vont de la médiation à la procédure. Il est un interlocuteur privilégié et expérimenté et peut être consulté en toute confidentialité. Sur son site, un onglet permet de signaler les faits dont on a connaissance.
L’article Entraves et atteintes à la liberté de création : quelle évolution pour les collectivités territoriales ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
18.03.2025 à 10:03
Les créatifs du Sud global, facteurs d’espoir et de stabilité
Alors que la mobilité internationale demeure un élément fondamental dans la trajectoire professionnelle des artistes, de nombreuses inégalités persistent quant à une véritable liberté de circulation pour les créatifs du Sud global. Des déséquilibres qu’analyse Ferdinand Richard à l’aune de schémas de coopération hérités du passé, formatés par des rapports verticaux et bilatéraux très peu en résonance avec le désir de transversalité d’une nouvelle génération. Comment créer les conditions d’une mise en réseau Nord/Sud mais aussi Sud/Sud pour ces jeunes créatifs ? Ce texte plaidoyer en faveur d’une coopération culturelle renouvelée et respectueuse des droits humains formule un ensemble de propositions.
L’article Les créatifs du Sud global, facteurs d’espoir et de stabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (3069 mots)

Comme chacun le constate, les bouleversements géopolitiques des deux dernières décennies transforment nos vies et nos sociétés dans ce qu’elles ont de plus essentiel. Les alertes se multiplient. Nous assistons au retour de l’ancienne division du monde en blocs antagonistes s’affrontant à travers des doctrines impérialistes, des nationalismes exacerbés et des peurs populistes. L’instrumentalisation de la relation Nord/Sud par les totalitarismes devient de plus en plus évidente et ne rencontre sur le terrain qu’une faible opposition de la part des pays démocratiques.
Succédant avec plus ou moins de bonheur au concept de « tiers-monde » et recouvrant un ensemble hétérogène de pays, la notion de « Sud global » est aujourd’hui privilégiée pour rassembler les 134 pays représentés au sommet du G77+Chine qui s’est tenu à Cuba à la mi-septembre 2023.
Malgré l’évolution rapide des industries culturelles et créatives, nombreux sont ceux qui, dans le monde culturel et artistique européen, restent encore attachés à l’idée que, même si le Sud global abrite de nombreux artistes de qualité, il serait trop empêtré dans les turbulences économiques et politiques pour être significativement source d’initiatives dans le domaine de ces industries.
Une des conséquences de cette approche est que, hormis quelques programmes régionaux de l’Union européenne et de l’Unesco, la collaboration artistique et culturelle entre le Nord et le Sud se contente aujourd’hui de répéter, sous couvert de « diplomatie culturelle », des schémas de « coopération » hérités du passé. Elle reste formatée par des rapports verticaux, bilatéraux, inévitablement soumis à des décisions prises par les institutions publiques, très peu en résonance avec le « bouillonnement transversal » propre aux jeunes générations de créatifs, et à l’exception de quelques fondations privées, il n’existe pas à ma connaissance de possibilités de financer le voyage d’un ou d’une artiste du monde arabe qui souhaiterait se mettre en réseau avec ses collègues d’Amérique latine ou d’Asie du Sud-Est, et vice versa.
Fort de ces constats, cet article souhaite modestement rendre justice à l’apport au bien commun de ces floraisons créatives du Sud, à leur rôle déterminant dans la modélisation du monde culturel de demain, et soumettre quelques propositions.
Une envolée créative sous contrainte
Aujourd’hui, le Sud global affiche de plus en plus son immense potentiel créatif. Il suffit de constater, par exemple, l’irrépressible émergence de l’art contemporain en Afrique, le foisonnement du cinéma au Moyen-Orient, la puissance du théâtre en Indonésie, l’effervescence de la musique en Amérique du Sud, etc.
Certaines grandes entreprises privées y voient une source de concepts de « marketing » aptes à séduire de nouvelles générations de consommateurs. La création issue du Sud global est déjà au cœur de toutes les convoitises marchandes, y inclus celles des fonds d’investissement les plus sauvages. Même s’il souffre de divers handicaps, en particulier des séquelles d’un Nord colonisateur, plusieurs facteurs expliquent son impressionnante envolée :
- la jeunesse de sa population, bien sûr, dont, depuis cinquante ans, la démographie est incomparablement plus vigoureuse qu’au Nord. Une jeunesse au sein de laquelle une avant-garde croissante est de mieux en mieux éduquée, familière des nouveaux paradigmes digitaux, souvent plus polyglotte qu’au Nord, affranchie du poids des traditions et des clans, concernée par le bien commun autant que celle du Nord… ;
- ses nouveaux entrepreneurs, agiles, flexibles, résilients, habitués à se développer sans aides d’État, autonomes, « rebondissants »… ;
- le coût de son travail, qui lui permet d’offrir à distance des services comparables pour des tarifs incomparables avec ceux du Nord ;
- la richesse et la diversité de son patrimoine culturel, terreau extraordinaire pour des idées nouvelles, des formes audacieuses ;
- l’obligation qu’il a de faire émerger, à court ou moyen terme, une nouvelle image politique positive, inventive, solidaire.
L’industrie des contenus, qui sera probablement l’un des secteurs majeurs de l’économie globale post-pétrole dans les prochaines décennies, l’a bien compris et y a déjà posé ses jalons. Pour rappel, les fonds d’investissement internationaux Notamment Providence Equity Fund., les grandes plateformes de distribution, les multinationales du loisir sont déjà à l’œuvre depuis longtemps, investissant annuellement plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la fabrication et la distribution de ces « contenus », non seulement pour asseoir leur monopole, mais aussi pour les faire fabriquer à bas coût. De fait, cela favorise, sous des dehors « chics et softs », la « médiocrisation » des idées et des désirs, un contrôle finalement aussi totalitaire que celui des vieux empires, une nouvelle forme de néocolonialisme.
Cette position commercialement dominante implique un contrôle esthétique (et forcément politique) sur les « créatifs »,sur leur liberté de création, leur droit à l’expression – tels que garantis par les traités internationaux (Déclaration universelle des droits de l’homme), Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturellesde l’Unesco en 2005, etc.), traités pourtant ratifiés par la quasi-unanimité des États – et génère chez ceux-ci, constamment à la recherche de partenaires financiers, une autocensure grandissante et inquiétante.
Non seulement dans les pays du Nord, mais aussi dans certains des pays les plus riches du Sud global, des gouvernements mènent des négociations avec ces « global investors » et prennent des dispositions pour « canaliser » la création dans la perspective d’un juteux commerce, se prétendant « ultralibéral » mais assujetti à des contraintes politiques éventuellement antilibérales, la plaçant sous un contrôle permanent, tout en bafouant les engagements internationaux cités plus haut.
Friands de créatifs bien formés et dociles, les pays riches du Sud – autant que ceux du Nord – en attirent des centaines, et cette quête de ressources intellectuelles peut entraîner de graves dommages pour les pays moins fortunés d’où ces artistes sont issus, sous une forme aussi contestable que le pillage de leurs ressources naturelles. À cet égard, réaffirmons avec force que, du point de vue des droits humains, le concept « d’immigration sélective » souvent utilisé en Occident, mais aussi dans certains pays riches du Sud global, est éthiquement inacceptable.
Les effets néfastes de ces stratégies nuisent d’abord aux nouvelles générations de créatifs du Sud global, réduisant leur position « d’artistes libres », « d’inventeurs » propres à contribuer au développement de leurs communautés, à celle de rouages asservis à l’appareil de production globalisé, privant ces populations des éléments propices à leur émancipation. Si l’on ajoute à ces effets le décalage entre la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle progresse et la lenteur structurelle de l’établissement des lois qui devraient l’encadrer, force est de constater à quel point un ou une jeune artiste vivant dans ces parties du monde fait face à un amoncellement de difficultés.
Quels leviers pour l’émancipation des artistes et créatifs du Sud global ?
Pourtant, dans un avenir possiblement mutualisé avec le Sud global, « mis en réseau », et afin de préserver au mieux sa floraison artistique et culturelle, fondement de l’émancipation de ses populations, de nombreuses et excitantes options s’offrent à l’imagination.
Je présente ici quelques hypothèses de travail. Il y en a certainement d’autres.
• Un programme de mobilité pour les artistes et créatifs
Nul n’est besoin de souligner la grande similarité des jeunes artistes ou acteurs culturels dans le monde entier, non pas du point de vue de leurs racines respectives, mais bien de leurs rêves futurs, espoirs, enjeux, difficultés, défis, etc. Quarante ans de contacts avec ces vagues successives d’émergences créatives dans de nombreuses parties du Sud global ne me laissent aucun doute à ce sujet.
Nul n’est besoin de souligner non plus à quel point la rencontre physique entre créatifs génère la profusion d’idées nouvelles, l’expérimentation, les convergences, mais aussi le poids politique de la mise en réseau, le renforcement des initiatives locales, la résistance collective à la médiocrité, etc.
Il est donc urgent d’activer un programme de mobilité pour les artistes et les acteurs culturels dans cette dimension Sud-Sud car il permettrait aux bénéficiaires de dépasser les seuls accords bilatéraux et de développer enfin une mobilité multilatérale à la hauteur des ambitions de ces nouvelles générations.
Il redonnerait aussi de la visibilité et un sang neuf à la coopération internationale culturelle de nos pays, nécessairement partenaires, et aurait certainement un poids stratégique à opposer aux nouveaux impérialismes. Il apporterait, enfin, de l’espoir à tous ces jeunes créatifs qui attendent des signes forts de la part des pays démocratiques. En la matière, au Fonds Fanak, nous pouvons témoigner de l’exceptionnel résultat du rapport investissement (modeste)/bénéfices (durables) de ces mobilités.
Dans un premier temps, et considérant l’ampleur de la tâche, je proposerais de soutenir les mobilités des « entrepreneurs culturels » sous toutes leurs formes, car ce sont eux qui donnent du travail aux créatifs. En s’appuyant sur les nombreux incubateurs d’industries culturelles et créatives, un programme de mobilité à l’usage de leurs bénéficiaires et de leurs employés favoriserait grandement les savoir-faire, expériences et marchés indépendants, etc. Une première phase expérimentale dédiée au soutien d’une vingtaine de bénéficiaires permettrait d’affiner le programme d’aide.
• Un réseau mondial d’éducation artistique en ligne
Compte tenu de l’inquiétante évaporation des budgets publics destinés à l’éducation des enfants dans de nombreux États du Sud global, je souhaiterais ici attirer l’attention sur les dangers induits par le secteur privé de l’éducation en ligne, en fort développement auprès des classes moyennes montantes du Sud global, qui est quasiment contrôlée par ces mêmes « global investors ».
Dans cette éducation en ligne, tout ce qui peut contribuer à l’émancipation des enfants – et donc des populations futures –, en particulier l’éducation artistique, le droit à la créativité individuelle, l’expérimentation, l’histoire, etc. est pratiquement exclu. Cela revient à conduire la jeunesse vers un avenir de consommation passive de produits de loisirs de basse qualité (produits par les mêmes investisseurs), ou vers des formations professionnelles ciblées, verticales, de « techniciens-exécutants ».
Finalement, dans ces pays, cette coûteuse éducation artistique privée en ligne réservée aux classes éduquées et classes moyennes accentue inexorablement une fracture sociale déjà existante en tous points du globe, facteur d’instabilité politique et défavorable à l’émancipation des peuples.
Face à ce croissant et dangereux déséquilibre dont on parle peu, à ses effets dévastateurs sur le long terme, un site public international dédié à l’éducation artistique, d’accès gratuit, multilingue, non commercial, animé par des artistes et des opérateurs culturels, devrait être mis à disposition des écoles primaires du Sud global.
• Un site multilingue gratuit d’archivage des expériences, narratifs, rapports d’activité, et son programme corollaire de restitutions d’expériences par des créatifs
Comme évoqué à de multiples reprises en d’autres lieux, dans le domaine de l’action culturelle et de la création artistique, la perte des expériences passées est dramatiquement coûteuse – autant pour les initiatives individuelles que pour les institutions qui les financent –, forçant les uns et les autres à sans cesse réinventer la roue sans profiter des expériences passées.
Cette disparition des données artistiques et culturelles est un fléau mondial, même si, au Nord, des tentatives de « mémorisation culturelle et artistique » (Global Grand Central, par exemple) voient périodiquement (mais difficilement…) le jour. Nous parlons là d’archiver les innombrables rapports, témoignages, narratifs, etc. relatant les activités artistiques ou culturelles passées, représentant une somme inouïe de savoir-faire et d’expériences qui pourraient être éminemment utiles à de nombreux projets naissants, mais qui échappent totalement aux regards.
Il est urgent de construire une banque de données mondiales mettant à disposition ces expériences, une ressource collaborative, ouverte, et de lui associer un programme régulier de « lectures/conférences » en ligne, où des innovateurs et innovatrices restitueraient et partageraient de manière concrète leurs expériences et les savoir-faire qui en ont découlé.
• Une « banque civile culturelle et créative » pour le soutien de la créativité au Sud
L’accès des jeunes créatifs aux services bancaires et financiers est, dans le Sud global, d’une tout autre difficulté que dans le Nord. Combinée à la quasi-absence de subventions publiques pour les petites structures de la société civile, cette précarité financière obère lourdement toute planification, tout investissement de moyen terme, et, partant, toute capacité de partenariat financier international.
La mise en place d’un système de financement participatif semble une des seules solutions à ce handicap récurrent. Il devrait s’appuyer sur un partenariat entre consortium public plurinational et système d’autofinancement mutualisé, tel qu’il en existe déjà dans d’autres domaines d’activité (artisanat, etc.). De même qu’il pourrait s’orienter vers la multiplication de « petits » prêts, agiles, adaptés aux emprunteurs, plutôt que vers la difficile et longue mise en place de « gros » programmes, toujours hors de portée de la société civile.
Concevoir un tel objet serait un défi particulièrement excitant pour de jeunes diplômés du secteur bancaire du Sud global. Un appel à propositions dans ce domaine permettrait d’avancer des solutions surprenantes.
• Un forum mondial de la créativité au Sud
Enfin, tous ces jeunes créatifs tireraient un grand bénéfice à se retrouver régulièrement, à la fois pour renforcer la dynamique commune et se « réencourager mutuellement », mais aussi pour affirmer leur poids politique aux yeux des décideurs mondiaux.
En dépassant les formats anciens, cette grande rencontre pourrait donner lieu à une « convention », à un « marché de la créativité », à un « summer camp » où les participants seraient amenés à engager toutes sortes de partenariats, conclure des accords de production, expérimenter des formes d’action nouvelles. Il n’est pas interdit d’imaginer que des Capitales européennes de la culture s’y emploient.
Repenser les rapports culturels Nord-Sud
En conclusion, il m’apparaît qu’envisager un équilibre mondial durable et viable ne se fera pas sans repenser les rapports culturels du Sud et du Nord, dans une vision de long terme, par une approche digne, respectueuse, libérée de toute instrumentalisation, par une « coconstruction » ouverte et équitable avec et entre toutes les jeunesses de ces pays.
Soulignons au passage les diverses répercussions qu’une telle orientation pourrait générer dans de nombreux domaines, à court ou moyen terme :
- Au Nord, elle mettrait en évidence la contribution globale de la jeune création issue du Sud, son impact positif sur le « vivre-ensemble », ici et là-bas.
- Globalement, elle contribuerait à répondre à certains problèmes auxquels personne aujourd’hui n’apporte de solution vraiment durable, tels que l’hyper-urbanisation sauvage, la dépendance intellectuelle croissante de certains pays, l’omniprésente mainmise des monopoles, la centralisation excessive.
- Enfin, elle contribuerait, au Nord comme au Sud, à reconsidérer la fracture dangereusement grandissante entre les classes sociales éduquées, « cultivées », et celles qui ne le sont pas, entre zones urbaines et zones excentrées, dont la traduction en termes de richesse/pauvreté est le premier facteur de conflits.
Mais un tel engagement implique qu’on en finisse avec l’instrumentalisation des droits culturels de chacun, qu’elle soit le fait de groupes de pression (communautarisme) ou d’autoritarisme (nationalisme culturel). De nos jours, cette manipulation néfaste perdure et prolifère, alors même qu’existent à cet égard, depuis de nombreuses années, de clairs engagements internationaux, rédigés et votés par la plupart des nations du monde, tous basés sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci, faut-il le rappeler, concerne en priorité les individus, et non les groupes humains : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit » (article 1 de la DUDH).
De fait, l’égalité en dignité exclut toute domination culturelle, étape première de la barbarie. Finissons-en…
L’article Les créatifs du Sud global, facteurs d’espoir et de stabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
13.03.2025 à 09:31
Faire unité de la diversité paysagère
Non loin de la grotte Chauvet, le Partage des eaux sillonne la montagne ardéchoise sur 80 km en suivant une ligne géographique invisible que seule la narration artistique permet de révéler. À travers ce projet qu’il a conçu pour le parc naturel régional des Monts d’Ardèche, David Moinard donne à voir la fabrique d’une matrice paysagère intimement liée à son territoire et plaide pour des parcours mi-culturels mi-touristiques capables de renouveler un tourisme local afin d’arpenter et de se relier de façon sensible au paysage comme au vivant.
L’article Faire unité de la diversité paysagère est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
Texte intégral (3187 mots)

Dans les projets que vous concevez au sein de l’Atelier Delta, vous dites que la question centrale est « de raconter un territoire comme on raconterait une histoire ». Pourquoi ? Qu’apportent ces récits territoriaux ?
David Moinard : Aborder les territoires à partir du récit permet aux projets artistiques qui s’y pensent et qui s’y ancrent de ne pas être perçus comme des sortes d’ovnis, totalement déconnectés de l’endroit où ils prennent place, mais au contraire de faire en sorte qu’ils s’ajustent parfaitement à ses spécificités, à ses qualités. Ces récits racontent évidemment des choses très différentes selon les territoires, en fonction de leurs histoires, des enjeux politiques ou de l’intention de départ. Pour Estuaire, par exemple, l’intuition de Jean Blaise était que la Métropole Nantes-Saint-Nazaire n’avait pas d’existence symbolique aux yeux des habitants alors qu’elle existait déjà politiquement et juridiquement depuis un certain nombre d’années. Nous nous sommes donc demandé comment faire symbole pour unir ces deux villes en s’appuyant sur le lien géographique qui les a toujours reliées, à savoir le fleuve Loire. Il n’y avait pas de commande politique venant de la Métropole, mais cela n’a pas empêché le projet de s’incarner ensuite politiquement et de bénéficier de soutiens financiers très importants. Avec Le Partage des eaux, en revanche, la commande venait du parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche. Là, il ne s’agissait évidemment pas de « faire métropole », mais pour autant, du fait de la géographie compliquée, de l’étendue du parc et de la disparité des bassins de vie, il y avait aussi cette idée de faire unité de la diversité paysagère – ce qui rejoint cette même ambition symbolique.
S’agissant du Partage des eaux, justement, quel est le fil rouge de ce récit ?
D.M. : Pendant la phase de préfiguration du projet – qui a duré un peu plus d’un an –, je suis allé à la rencontre des nombreux acteurs du territoire afin de multiplier les points de vue : l’équipe du parc, les acteurs politiques et ceux du tourisme, des entreprises et des habitants, des associations, des hébergeurs (gîtes, hôtels, restaurateurs), des historiens, géologues, scientifiques, etc. Il est toujours intéressant de voir qu’entre différents acteurs, les points de vue et les usages du territoire peuvent parfois être assez contradictoires. J’ai parallèlement acheté des cartes à différentes échelles, routières et de randonnée – car explorer la géographie d’un territoire offre toujours un nombre considérable de clés pour le comprendre – et je me suis mis à sillonner le PNR des Monts d’Ardèche. Assez rapidement, je me suis aperçu que la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée passait au sein du parc, parfois à sa frontière occidentale, parfois en son cœur. C’est une ligne invisible dans le paysage mais essentielle pour comprendre la géographie de notre pays puisqu’elle sépare les deux grands bassins-versants de la France métropolitaine. D’un côté de la ligne, la Méditerranée est toute proche et l’érosion a donc été puissante, creusant des vallées profondes aux pentes raides qui constituent le paysage de montagne emblématique des Cévennes. De l’autre côté de la ligne, l’Atlantique est à plusieurs centaines de kilomètres et l’eau s’écoule donc lentement du plateau ardéchois, ce qui donne ce paysage doux et légèrement vallonné. La diversité paysagère s’explique donc grâce à cette ligne géographique « magique » et je me suis dit qu’elle constituait le fil rouge rêvé.
C’est à partir de cette matrice paysagère que s’est écrit le projet avec les artistes. Pour concevoir ce parcours artistique de 80 km, le long du GR7 sur la montagne ardéchoise, ils se sont nourris du regard des habitants et de tous ceux qui ont une connaissance aiguisée du territoire (géologues, historiens, géographes…) et chaque œuvre a été imaginée à partir de cette matière, pour chacun des sites choisis. Ce qui me fascine toujours autant dans la création artistique à l’aune d’enjeux territoriaux, c’est que cela permet de poser un regard totalement neuf sur les territoires qui vient renouveler celui de ses propres habitants. Ce sont ces regards sensibles qui permettent de changer une perception et de relier les gens. Je dis souvent que l’opinion divise et que le sensible relie.

Gilles Clément a été le premier artiste que j’ai invité à m’accompagner, dès la préfiguration du projet. Je lui ai demandé plusieurs choses : trouver un moyen de rendre visible la ligne de partage des eaux dans le grand paysage, arpenter cette ligne pour la rendre compréhensible et palpable alors qu’elle est immatérielle et qu’elle ne se repère pas à l’œil nu. Il m’a aussi fait découvrir un texte magnifique, empli de poésie et de malice, qu’il avait écrit quelques années auparavant sur le mont Gerbier-de-Jonc, dans lequel il raconte l’ascension qu’il en avait faite l’été après une longue période de sécheresse. En fin de journée, il avait découvert de l’eau qui perlait sur la roche sans comprendre d’où elle provenait (car ce ne pouvait être ni de la rosée ni de la pluie). Il avait alors fait l’hypothèse que la source de la Loire était le mont Gerbier-de-Jonc lui-même. Constitué de basalte, ce gros rocher emmagasine la chaleur tout au long de la journée et, au contact de la fraîcheur nocturne, transforme l’humidité de l’air en eau liquide, comme le feraient les tours à eau de certains déserts arides. Nous lui avons donc demandé de matérialiser son texte par la création d’une œuvre. C’est de là que provient La Tour à eau. Fabriquée en phonolite (la roche volcanique qui constitue le Gerbier), elle a été placée pile sur la ligne de partage des eaux : à l’intérieur de cette colonne creuse se trouve un bassin qui récupère l’eau et deux trop-pleins qui se déversent, pour l’un, côté atlantique, et pour l’autre côté méditerranéen, comme si cette tour ajoutait de l’eau à chacun des fleuves, le Rhône et la Loire. La Tour à eau est une œuvre typiquement narrative, car elle raconte toute cette histoire ; elle est d’ailleurs très vite devenue l’un des symboles du plateau ardéchois – et notamment du « Pays des Sucs » – ainsi qu’un lieu de promenade pour les gens du coin.

Ce qui me fascine toujours autant dans la création artistique […] c’est que cela permet de poser un regard totalement neuf sur les territoires qui vient renouveler celui de ses propres habitants.
Comment s’articulent dimension artistique et objectif touristique ? Est-ce que cette mise en récit du territoire engendre aussi une autre manière de penser le tourisme ?
D.M. : La dimension touristique faisait partie du cahier des charges car le parc avait obtenu des financements pour la préfiguration du projet dans un cadre précis : l’ancien exécutif régional avait mis en place un « Grand projet Rhône-Alpes » qui identifiait, dans la région, différents équipements ou projets novateurs qu’il souhaitait pousser afin d’en faire des locomotives de développements territoriaux. Il y avait par exemple la vallée de l’agriculture biologique dans le Diois et, pour l’Ardèche, l’ouverture de l’espace de restitution de la grotte Chauvet. La grotte ayant été classée au patrimoine mondial de l’Unesco très peu de temps après sa découverte, le site allait inévitablement accueillir énormément de touristes. Or, il se situe à l’endroit le plus touristique de l’Ardèche, à savoir le secteur des Gorges, qui compte déjà près de 2,5 millions de nuitées touristiques sur la période estivale. Dans la perspective de cette ouverture de la « grotte Chauvet 2 » (la plus grande réplique de grotte ornée au monde), la région avait donc proposé que des aides soient également apportées à de nouveaux projets afin que les retombées touristiques ne bénéficient pas seulement à cette zone déjà très fréquentée, mais profitent plus largement au territoire. À l’époque, le parc était présidé par Lorraine Chénot très convaincue par l’importance des projets culturels et artistiques pour un territoire. Elle souhaitait qu’une proposition artistique puisse trouver sa place dans le prolongement de la grotte Chauvet en reliant les plus anciennes traces d’art de l’humanité à la création la plus contemporaine. L’idée était aussi de déplacer les flux touristiques, dans la mesure où ils ne sont pas du tout équivalents entre le PNR des Monts d’Ardèche et les gorges de l’Ardèche. Ce ne sont ni les mêmes touristes, ni la même affluence.
Je trouve cela très sain lorsque ces deux objectifs (culture et tourisme) sont clairement liés et assumés dès l’origine d’un projet. Le monde de la culture regarde trop souvent celui du tourisme avec beaucoup de méfiance alors que chacun de nous est un touriste à un moment de sa vie ! Inversement, le tourisme a tendance à considérer que ce type de parcours artistique s’adresse d’abord à une élite et non au grand public, ce qui non seulement est méprisant mais surtout relève d’un à priori qui ne se vérifie pas factuellement. Ces deux secteurs campent sur leurs positions et entretiennent une forme de défiance l’un envers l’autre, alors que chacun a son intérêt et sa noblesse propre. Les projets artistiques tels qu’Estuaire ou Le Partage des eaux, qui placent le sensible au cœur de la démarche tout en assumant une volonté d’attractivité touristique, ont ceci d’intéressant qu’ils permettent de rompre avec les recettes toutes faites du tourisme dont le principal écueil est l’uniformisation. C’est typiquement ce que l’on voit dans de nombreux musées et écomusées aujourd’hui où tout le monde a basculé dans le « tout tablette »… ça finit par être très lassant, sans compter que ces dispositifs sont souvent en panne !
On peut créer, grâce au sensible, une émulation sans forcément entraîner une dérive de “disneylandisation”.
Quel regard portent les habitants sur des projets tels que celui-ci qui visent la mise en tourisme de leur territoire ?
D.M. : La question du lien aux habitants – même s’ils ne sont pas considérés comme des « touristes » par définition – est pour moi essentielle dans le développement du tourisme. Le premier objectif pour le succès d’une manifestation est que les habitants s’en emparent. S’ils ne deviennent pas ambassadeurs du projet sur leur territoire, ça ne prend pas et ça n’attire personne de l’extérieur. C’est pour cette raison qu’avec des propositions d’une telle ampleur, il ne faut pas rater leur inscription territoriale et la manière dont elles font écho aux désirs des habitants. Les projets artistiques doivent éveiller une curiosité, une envie. Cela a été palpable dans le cadre du Partage des eaux où il y a eu une véritable appropriation par un grand nombre d’acteurs et d’habitants. C’est également vrai pour les élus. Les premiers à avoir répondu présents sont ceux des petites communes de la montagne ardéchoise. Je me rappelle le maire de Borne, un minuscule village d’une quarantaine d’habitants, qui a perçu immédiatement que le projet était ancré et que son ambition n’était pas de satisfaire une élite citadine, mais qu’il mettait un coup de projecteur sur la montagne ardéchoise, là où d’habitude, regrettait-il, « on est souvent les oubliés ».
Ne nous leurrons pas non plus : il y a aussi systématiquement des réticences qui s’expriment de la part d’habitants ou de professionnels qui se demandent pourquoi l’on met de l’argent sur un projet artistique et pas sur la rénovation des routes ou autres actions. Je pourrais citer nombre d’exemples en ce sens. Mais je constate que lorsque la proposition est sincère par rapport au territoire et qu’elle renouvelle le regard que l’on pouvait porter sur lui, alors cela rend fier tout le monde et il arrive régulièrement que les plus rétifs au départ finissent par dire à l’artiste : « Surtout ne changez rien ! »
L’œuvre qui a fait couler le plus d’encre est celle de Felice Varini, Un cercle et mille fragments, à l’abbaye de Mazan, composée de cercles tracés à la feuille d’or sur les murs et les toits des différents bâtiments du site historique. Cette œuvre-là est très intéressante par rapport à la question du tourisme. Lorsque nous avons demandé les autorisations auprès des Monuments historiques, nous étions très incertains quant à l’issue de notre démarche, tant l’œuvre s’appuyait sur le patrimoine bâti. Mais dès la première réunion, on nous a dit en gros : « Ça fait des années que l’on veut mettre en valeur cette abbaye qui est un site historique extraordinaire sans savoir comment faire. Là, vous nous offrez une réponse sur un plateau ! » Certes, cette œuvre a ses détracteurs – ceux qui estiment que c’est du « tag » – mais elle a aussi énormément de défenseurs qui, grâce à elle, ont découvert l’abbaye, y compris des gens de la vallée de l’Ardèche qui n’avaient jamais mis les pieds dans ce site pourtant absolument magnifique ! C’est un peu la même chose avec Le Phare de Gloria Friedmann : il y a une auberge juste avant le sentier de randonnée – car c’est une œuvre que l’on découvre après une heure de marche –, et l’aubergiste dit qu’il n’y a pas une journée sans qu’un visiteur aille voir le phare. Pour moi, ces deux exemples mettent bien en valeur ce que l’alliance entre tourisme et culture peut apporter. On peut créer, grâce au sensible, une émulation sans forcément entraîner une dérive de « disneylandisation ». Il y a une autre dimension qui m’importe beaucoup : une œuvre dans un site naturel nous relie à ce qui nous entoure, aux paysages, aux éléments vivants qui les composent. Notre regard gagne en empathie grâce à l’art. Cela rejoint ce que Baptiste Morizot défend quand il écrit B. Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2022. que la crise écologique est une crise de la sensibilité. Je m’associe complètement à cette idée et c’est vraiment ce qui m’anime dans ces projets : qu’ils activent et développent le sensible présent en chacun de nous.

L’article Faire unité de la diversité paysagère est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE / RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord / Proche & Moyen-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- L'Insoumission
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?