Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles
09.09.2025 à 11:59
Grèves, blocages, amours sauvages

Texte intégral (645 mots)

L’air du temps

Jorja Smith : Rose Rouge
Le haïku sur la tête
Devant l'éclair -
Sublime est celui
Qui ne sait rien !
Bashô
L'éternel proverbe
Demain est souvent bien loin.
Proverbe lituanien
Les mots qui nous parlent
La raison est régulière comme un comptable.
La vie anarchique comme un artiste.
Georges Canguilhem

Varvara Rodchenko : Elapsed time
08.09.2025 à 11:23
« On n’associe plus assez la lecture à l’idée de plaisir » Interview de la fondatrice du festival Cultissime

Texte intégral (6095 mots)
Les 26,27 et 28 septembre 2025, vous avez rendez-vous à Angers pour la deuxième édition de Cultissime, un festival où la lecture est pensée sous forme ludique et participative et où les œuvres cultes sont partout. Rencontre avec Phalène de La Valette, fondatrice du festival pour en découvrir les coulisses.

Un festival de littérature au sens large mais qui met à l’honneur la bande dessinée partout, avec LEO en invité d’honneur, qui sera au programme des rencontres en plus de séances de dédicaces. Sa venue est en amont de la sortie d’un beau livre en novembre Le bestiaire des mondes d’Aldebaran, avec des dessins originaux de LEO et les commentaires de l’éthologue et chercheuse en neurosciences comportementales Olivia Le Moëne.
Dans un article précédent, je vous parlais des invité.e.s —avec pas mal d’artistes de bande dessinée— et le programme commence à se préciser. Le vendredi, Xavier Coste & Antoine de Caunes évoqueront leurs lectures fondatrices vis-à-vis de la création, autour de leur album commun. Le dimanche Audrey Audrey Alwett, Mini Ludvin & Norah Moretti seront sur scène pour échanger autour de la notion d’héros et héroïnes, d’hier et d’aujourd’hui, avec le fil rouge de leurs séries Princesse Sarah, Grimoire d’Elfie, Magic Charly. Et le samedi Marguerite Abouet, Hannelore Cayre et David Foenkinos parleront d’adapter à l’écran leurs propres récits mais laissons la parole à Phalène de La Valette qui vous en parle dans cette interview.
Avant de lancer le festival, Phalène de La Valette était journaliste et a été rédactrice-en-chef du Point Pop, la branche culture du magazine Le Point. En plus de son implication dans Cultissime depuis 2023, elle est également éditrice free-lance. Son œuvre cultissime : Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien.
Côté programmation, vous mettez LEO en invité d’honneur (et l’an dernier c’était Jean Van Hamme), Marguerite Abouet et l’une des marraines de l’événement, il y a un lien très fort avec la bande dessinée à Cultissime ?
Phalène de La Valette : Oui, bien sûr !
À Cultissime, on pense sincèrement que ce qui compte avant tout, c’est le plaisir de lire. Et la bande dessinée est évidemment un grand plaisir de lecture, il n’y a qu’à voir les nombreuses œuvres cultes qu’il y a en bande dessinée. Donc forcément, on y accorde beaucoup de place dans la programmation de Cultissime.
Mais c’est valable pour tous les genres, on essaye d’équilibrer la programmation, justement pour que tous les goûts de lecture puissent s’y retrouver.

Tu es toi-même une grande lectrice de bande dessinée ? Est-ce que tu peux en profiter pour nous parler de ton rapport aux livres, à la culture ?
P. dlV. : Je suis une grande lectrice tout court et je dévore de la bande dessinée. Ce n’est pas un hasard si Jean Van Hamme était le premier invité d’honneur — je suis une grande fan de Thorgal et une grande partie de sa biblio. Et j’ai beaucoup lu LEO quand j’étais jeune aussi !
Mon rapport à la lecture est simple : j’ai eu la chance de tomber dedans quand j’étais petite. Et plus on lit, mieux on lit. Je fais partie de la génération Harry Potter. Des millions d’enfants —et d’adultes— qui d’un coup ont senti que la lecture était faite pour eux alors que ce n’était pas forcément le cas avant. Et depuis, se sont ouverts tout un tas d’horizons.
Et c’est vraiment l’objectif de Cultissime : de donner un maximum d’opportunités et de portes d’entrée vers la lecture. On croit profondément que la lecture, c’est ce qui permet —je dirais presque— à la société de fonctionner.
Justement quelle est votre position par rapport au discours ambiant — pas forcément tout le temps justifié— de dire que les Français, ou les jeunes, lisent moins ? Ou alors plus sur téléphone… Comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
P. dlV. : Il y a un recul de la pratique de la lecture. Mais on parle souvent des jeunes, et on a tort, parce que ce ne sont pas que les jeunes qui lisent moins. Toute la société, même les gros lecteurs ont un temps de lecture moindre.
Certes il y a de la lecture sur smartphone, ou des lectures sur écran, mais si tu prends le temps de lecture plaisir —pas pour m’informer comme le journal, ni pour apprendre par exemple— juste la lecture plaisir : la lecture est souvent le dernier loisir vers lequel on se tourne. Quand tu as du temps, jeune ou moins jeune, quand tu dois choisir ce que tu vas faire de ce temps libre, on n’associe plus assez la lecture à l’idée de plaisir.
Il y a une idée d’éducation, d’information voire de corvée ou d’effort, mais pas assez de plaisir. C’est moins le cas dans la bande dessinée, heureusement, et elle est un énorme vecteur de lecture. Il ne faut pas penser que parce que ton gamin ne lit que la bande dessinée, il ne lira jamais rien d’autre. Ce n’est pas vrai du tout, au contraire. Je peux en témoigner, mon fils de 6 ans a eu le déclic de la lecture avec une BD (Le Grimoire d’Elfie) et après les avoir dévorés, c’était parti pour la lecture des bouquins.
En fait, il y a autant de profils de lecteurs que de lecteurs, il ne faut pas imposer une porte d’entrée, un style de littérature, un style de livres… Il faut multiplier les possibilités pour que les enfants puissent s’emparer de la porte qui leur convient et, ensuite, se laisser embarquer.

Tu parlais tout à l’heure d’un festival implanté dans la ville, est-ce que vous avez une programmation pour les scolaires aussi ?
P. dlV. : L’année dernière, on avait accueilli quasiment 400 élèves avec tout un programme, mais c’était énormément de logistique. Cette année, on propose une journée scolaire : on part sur 4 écoles du territoire avec deux auteurs jeunesse et un slameur. On a toute une programmation pour 8 classes de CM1-CM2.

Vous êtes 11 dans l’équipe, comment se prépare un tel festival ? C’est une organisation à l’année ?
P. dlV. : C’est très particulier cette année, parce que j’ai un peu l’impression de refaire une deuxième « première édition ». Parce qu’avec ce qui s’est passé, avec le retrait des subventions de la région Pays de la Loire, qui a coupé quasiment toutes les subventions culturelles dans la région —on n’est pas du tout les seuls touchés, sauf qu’on venait de se lancer ! Et ça a été très compliqué de relancer cette deuxième édition avec un budget grevé de 100 000 euros en moins.
On a dû revoir tous nos plans et budgets prévisionnels. Dans le budget prévisionnel, il était prévu que l’équipe, quasi 100% bénévole, puisse se rémunérer en année 2. Du coup, on a dû laisser tomber et on est restés bénévoles. Sauf pour quelques postes techniques où on a besoin d’employer des professionnels à 100% de leur temps.
Globalement, c’est un projet passionnel. Toute l’équipe croit à l’importance de la lecture et qu’il y a des choses à réinventer dans les salons. Ce qu’a dit LEO — « Cela fait longtemps que j’ ai mis fin à ma participation à des festivals, préférant garder mon énergie pour continuer à travailler mes BD à un rythme soutenu. Mais votre festival m’a semblé à part. »— ça m’a fait très plaisir, parce que c’est exactement ce qu’on essaye de faire. De faire différemment, pour réinventer un peu les choses.
La plupart des festivals —et je ne critique pas, c’est formidable aussi—sont thématisés, que ce soit en direction d’une catégorie d’âge, soit en direction d’un certain profil de lecteur ou d’un certain genre. On a fait le choix pour Cultissime de ne pas du tout avoir de catégories et de multiplier tous les genres. Même si tu regardes les prix Cultissime, il y a des choses très variées, et mises à égalité.

Comment définissez-vous la ligne éditoriale ? Et qu’est-ce qui change pour cette nouvelle édition ?
P. dlV. : Ce qui change, c’est que l’on est sur plusieurs lieux. Ça va être une configuration différente, cette année on est en plein centre-ville —dans des lieux iconiques comme le château d’Angers et la Collégiale Saint-Martin— ce sera un festival plus ancré au niveau de la ville.
Pour revenir à la question de la ligne éditoriale, le fil rouge est toujours les œuvres cultes. Et c’est quoi une œuvre culte ? Tu as à la fois une définition hyper universelle : ce sont les références partagées par tout le monde —même si tu n’aimes pas Alexandre Dumas, tu sais que Les Trois mousquetaires, c’est culte. Et puis après, tu as le côté hyper personnel : on a tous notre propre panthéon d’œuvres cultes —même si personne ne connait, ça peut être une œuvre culte pour toi et donc, ça a un impact. C’est ça qui nous permet de jouer la variation et d’accueillir tous les types de littérature, et demander les œuvres cultes des auteurs invités ça permet aussi de mettre des coups de projecteurs sur des œuvres oubliées ou au contraire universelles.
C’est pour ça que vous avez lancé les prix Cultissimes dès la 1ère édition ? Qu’est-ce que ces prix représentent ?
P. dlV. : C’est un pari. Ce qu’on ne voulait pas, c’est qu’on se dise que Cultissime « c’est un festival des œuvres du passé ». On est un festival de littérature vivante —on accorde une grande place aux littératures classiques parce qu’elle nourrit la littérature actuelle— mais on croit aussi que demain, tu peux avoir une œuvre culte qui naît d’un coup comme Harry Potter ou d’autres très récentes.
L’idée de ces prix, c’est donc d’essayer de repérer, parmi tout ce qui sort chaque année— et ça signifie à beaucoup de publications— les œuvres qui vont rester. Et qu’on trouvera encore en bibliothèque, en librairie dans 5,10,15 ans… Ça vaut la peine de mettre un coup de projecteur dessus, parfois c’est un choix évident, parfois c’est un gros pari et parfois ça ne marchera pas du tout.

J’ai présenté les invité.e.s dans un article précédent, il y a pas mal d’auteurices de bande dessinée, dont une exclue avec les auteurs de Wonder Woman & Harley Quinn – La Souffrance et le Don, Sylvain Runberg & Miki Montlló qui seront en dédicace le jour de la sortie de l’album. Comment choisissez-vous les invité.e.s ?
P. dlV. : D’abord par goût ! On a une équipe assez variée, avec leurs coups de cœur, leurs envies d’invité.e.s. Ensuite, on a évidemment essayé aussi d’être à l’écoute des éditeurs et des événements importants pour eux : comme quand Urban nous dit que c’est un de leurs enjeux de la rentrée parce que c’est la première fois que les personnages de Wonder Woman et d’ Harley Quinn sont traité par des français et espagnol directement —ça match avec nous et on les accueille. Et bien sûr, il y a les envies du public !

Il y a une spécificité aussi dans ce festival, c’est vous proposer des ateliers, des ateliers créatifs, des ateliers d’écriture, des ateliers de découverte, comment ça se passe ?
P. dlV. : C’est la même idée, d’offrir de multiples possibilités. Par exemple, si tu prends un enfant de n’importe quelle catégorie d’âge, l’idée est qu’il puisse trouver dans Cultissime la porte d’entrée qui lui convient. Et parfois, c’est une porte directe— l’auteur qu’il aime bien— et parfois ça va être complètement détourné : un spectacle, une initiation à l’escrime avec d’Artagnan et Cyrano, des jeux, des animations, etc. C’est pour ça qu’on a pas mal d’ateliers et d’animations à destination de tous les âges.
Y compris pour les adultes avec les ateliers d’écriture, qui sont vraiment des opportunités d’être coachés par des auteurs. Et ça plait pas mal. La démarche est toujours la même, c’est vraiment de donner la possibilité de passer un bon moment.
Si les festivals de bande dessinée sont assez festifs, l’image des festivals littéraires, c’est quand même quelque chose d’assez plan-plan, où tu fais la queue pour avoir une dédicace et puis écouter une conférence. L’idée c’est d’avoir ça aussi —parce que c’est important et qu’on aime ça aussi— mais d’avoir un côté très festif, très familial : comme tu pourrais passer une journée ou une après-midi à la fête foraine. Même si tu détestes lire, tu peux t’amuser à Cultissime.
Le programme est très riche, qu’est-ce que tu conseillerais aux festivaliers qui ne savent pas par quoi commencer ?
P. dlV. : De venir rencontrer LEO, parce qu’il va être de plus en plus rare qu’il se déplace et qu’il fasse des dédicaces —même son éditrice est étonnée. C’est un événement en tant que tel.
Une porte d’entrée intéressante est de regarder dans la librairie du festival : quelles sont les œuvres cultes des différents auteurs que j’apprécie. Les infos sont disponibles, et si tu aimes Marguerite Abouet par exemple, tu vas découvrir qu’est-ce qui la nourrit : parfois ce sont des choses que toi-même tu connais, et parfois pas du tout. Et c’est sympa de pouvoir découvrir quelque chose que ton auteur aime.
Et ce que j’aime bien aussi, c’est quand on a la possibilité de croiser des regards qui n’ont a priori rien à voir. Par exemple on a une table ronde sur « s’adapter soi-même au cinéma » avec Marguerite Abouet, David Foenkinos et Hannelore Cayre —trois profils littéraires qui ont rien à voir entre eux— qui ont le point commun d’avoir écrit le scénario de l’adaptation de leur propres livre ou BD. Ça donne souvent des trucs assez riches.
Rendez-vous dans moins d’un mois, les 26,27 et 28 septembre à Angers pour le festival. La billetterie est ouverte à cette adresse, pour le programme, c’est ici.
Thomas Mourier, le 8/09/2025
-> Les liens renvoient sur le site Bubble qui vend les ouvrages évoqués

08.09.2025 à 08:16
La Culottée, mais c’est quoi ?

Texte intégral (2326 mots)
Qu’est-ce qu’on peut faire quand on ne sait que bien faire ? On peut essayer de plaire, mais sans compromission, c’est devenu compliqué au fil des tik-tokeries qui tiennent lieu de rendez-vous cult-turels… Jean Songe a trouvé la solution au Sud, comme Pierre Escot à Paris. Et on va donc parler du Sud et de La Culottée.

Soyons réalistes : tu es un auteur âgé, tu vis depuis longtemps en province, tu n’as pas de réseau parisien, tu publies relativement peu et tu vends très peu, alors qu’est-ce qui t’as poussé à créer ta structure éditoriale, La Culottée ?
Jean Songe : Eh bien, pour ces mêmes raisons que tu viens de citer, augmentées du fait que j’avais de plus en plus de difficultés relationnelles avec les maisons d’édition “officielles “ et de mon insatisfaction grandissante à leur égard à cause de leur manque de soutien dans la promotion de mes récit-enquêtes qu’elles acceptaient pourtant de publier et de leur refus de publier mes romans noirs ou un “ truc “ inclassable comme “ D10S, tangos pour Maradona “. Donc, quitte à vendre très peu, autant se faire plaisir, renouer avec une pratique “underground“, DIY, comme aux temps ancestraux de “Combo !“ et des Editions Black Mony que nous avions montés avec David Dufresne, car « la vie est un sport et un passe-temps rock’n’roll », et éditer mes textes inédits et ceux d’auteurs dont j’apprécie le taf.

En quoi La Culottée se démarque-t-elle des autres maisons d’édition ?
J.S. : Beaucoup de “ petits “ éditeurs soignent leurs ouvrages et La Culottée se place dans leur lignée. Un livre est un Tout. J’ai souffert du degré 0 d’inventivité graphique pour mes 2 derniers bouquins “ officiels “. Pour les couvertures de La Culottée, je voulais des belles illustrations et comme j’ai des amis qui sont de brillants artistes, comme Jean-Christophe Chauzy (et son fiston Etienne), j’ai fait appel à leurs talents, ou bien c’est l’auteur qui a sa petite idée visuelle (dans le cas de Francesco Pittau, il a sollicité Stéphane Oiry). Je souligne que les dessinateurs participent gracieusement à La Culottée (et chapeau à eux). Je pense que l’esthétique dessinée des couvertures de La Culottée tire l’œil du futur lecteur. Concernant les textes, en forçant un peu le trait, je pourrais citer Jana Cerna (qui mérite de figurer au panthéon des Lettres rien que pour son titre “ Pas dans le cul aujourd’hui “) qui encourage « Une œuvre qui ne sera pas aseptisée, à faire dégueuler et chier celui qui la consomme, à faire surgir en lui tout à la fois un sentiment de bonheur et d’horreur, une œuvre sans limites et qui ne se laissera imposer des limites par rien et à aucun moment. » Des livres conçus pour des personnes qui ne lisent pas ou qui ont perdu le goût de lire et pour les encourager je tiens à ce que le prix des ouvrages soit accessible, dans une fourchette de 5 à 15 euros maximum. Il faut rappeler que le livre est une espèce menacée, en voie de disparition, alors que c’est peut-être la plus belle invention humaine, celle qui te relie télépathiquement avec l’esprit de son créateur mort ou vivant, à une vitesse de lecture d’environ 200 millisecondes par mot.

Quelle est ta programmation pour les mois à venir ?
Début septembre, 3 titres très différents : “ Poèmes écrits dans ma voiture “, un recueil de poésie de Al Denton, déroutant et inclassable, “ Mala “ un court roman de Francesco Pittau (reconnu pour ses récits destinés à la jeunesse), que je qualifie de “ roman d’apprentissage contemporain “, qui est lisible dès un âge tendre et enfin la réédition de “ Bibi la Bibiste “, le plus court roman de la littérature paru en 1918, pré-Dada, iconoclaste. Ces 3 ouvrages représentent bien la diversité de La Culottée, et leur parution sera accompagnée par le numéro 1 de La Déculottée, une revue semestrielle qui met en valeur les auteurs présents et à venir (et des morts que je ressuscite, La Culottée a ce super-pouvoir). Dans les bien vivants à suivre, je peux citer Christian Casoni et son formidable roman noir “ Un méchant coup de pompe “, un mix de Simenon moderne et de Pierre Siniac (j’endosse l’entière responsabilité de la comparaison), ça sortira en décembre avec “ Le show du lapin “, un conte très déconnant d’une jeune autrice mystérieuse et, coup de tonnerre (scoop), un ouvrage d’“ intervention civique “, soit les dix meilleures interviews pratiquées en 2025 par mon complice et meilleur ami, David Dufresne, dans son médium audiovisuel Au Poste !; et ça va dépoter ! J’ai à peu près un an de visibilité pour les futurs bouquins, fiction, poésie, intervention civique, réédition (dont un Prix Nobel de littérature oublié aujourd’hui), et certainement des recueils d’images (Thierry Guitard pour en citer un). Je compte publier environ 9 titres par an, mais comme l’impression à la demande (le mode opératoire que j’ai choisi ) permet une très grande souplesse et rapidité d’exécution, absolument rien ne m’empêche de publier très vite un ouvrage pas prévu au programme (tiens comme le Flipbook qui sera offert pour une commande de 20 euros en septembre)…
Les livres sont à commander en ligne sur :
ou en s’adressant à : editions.laculottee@gmail.com

07.09.2025 à 13:13
En Puisaye, un jour revoir les trognes avec Wanda Skonieczny

Texte intégral (2439 mots)
Bien davantage qu’un travail photographique, Trognes est une œuvre dont la justesse met en exergue l’équilibre fragile du monde qu’elle donne à voir. Ici, l’homme se fond dans une nature qui murmure la possible éternité renouvelée. Cet équilibre offert au regard du lecteur fait écho, comme pour mieux rendre hommage, à des citations de Colette. Qui d’autre mieux qu’une femme libre pouvait écrire Gaïa sans jamais la nommer ?

Depuis combien de temps travaillez-vous sur les « trognes » ? Comment vous est venue l’idée ? Pourquoi y avoir associé Colette ?
Wanda Skonieczny : J’ai entamé ce projet sur les arbres émondés il y a trois ans. Je travaille dans la lenteur, avec des temps de gestation longs, au minimum deux ans. Je venais alors de m’installer à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le village natal de Colette. J’effectuais une résidence dans sa maison et plus particulièrement dans son jardin, que je photographiais en nocturne et à l’aube, loin des regards.
Fascinée par ses mots et sa description de la nature, elle est devenue mon guide pour comprendre cette nouvelle terre d’accueil. Comme elle, j’ai voulu passer le muret de la maison pour aller vers les bois environnants. Je cherchais alors à réaliser des portraits d’arbres blessés et me relier aux êtres. C’est alors que j'ai rencontré Hugues Barrey, vice-président du Centre Permanent de Protection pour l’Environnement (CPIE).
Il a pris le relais et m’a simultanément fait découvrir ces arbres caractéristiques en Puisaye et mis en lien avec des figures locales. Chacun choisissait sa trogne. Avec ce projet, j’ai pu prendre conscience de l’importance du patrimoine paysan pour l’environnement. Cela a ouvert à une nouvelle voie ma démarche impliquée désormais vers l’art et le vivant.
« Pour des desseins innocents, pour une liberté qu'on ne nous refusait pas, nous sautions la grille, quittions les chaussures, empruntant pour le retour une échelle inutile, le mur bas d'un voisin. »
Dans les bois de Saint-Sauveur [Claudine à l'école]
« Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins, c'est les bois, les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir... Des prés verts les trouent par places, de petites cultures aussi, pas grand-chose, les bois superbes dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, peu nombreuses, juste ce qu'il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois.
Chers bois ! Je les connais tous ; je les ai battus si souvent. Il y a les bois-taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage, ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguet, et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeurs suffocantes à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids ; vingt fois je me suis arrêtée, haletante, en trouvant sous ma main, près de la "passe-rose", une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant ; ce n'était pas dangereux, mais quelles terreurs ! Tant pis, je finis toujours par y retourner seule ou avec des camarades ; plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m'agacent, ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles velues et des araignées des bruyères, si jolies, rondes et roses comme des perles, ça crie, c'est fatigué, – insupportables enfin.
Et puis il y a mes préférés, les grands bois qui ont seize et vingt ans, ça me saigne le cœur d'en voir couper un ; pas broussailleux, ceux-là, des arbres comme des colonnes, des sentiers étroits, où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d'une façon inquiétante. Dieu, que je les aime ! Je m'y sens tellement seule, les yeux perdus loin entre les arbres, dans le jour vert et mystérieux, à la fois délicieusement tranquille et un peu anxieuse, à cause de la solitude et de l'obscurité vague... Pas de petites bêtes, dans ces grands bois, ni de hautes herbes, un sol battu, tour à tour sec, sonore, ou mou à cause des sources ; des lapins à derrière blanc les traversent ; des chevreuils peureux dont on ne fait que deviner le passage, tant ils courent vite ; de grands faisans lourds, rouges, dorés ; des sangliers (je n'en ai pas vu) ; des loups – j'en ai entendu un, au commencement de l'hiver, pendant que je ramassais des faines, ces bonnes petites faines huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois des pluies d'orage vous surprennent dans ces grands bois-là ; on se blottit sous un chêne plus épais que les autres, et, sans rien dire, on écoute la pluie crépiter là-haut comme sur un toit, bien à l'abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout éblouie et dépaysée, mal à l'aise au grand jour.
Et les sapinières ! Peu profondes, elles, et peu mystérieuses, je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leur chant sous le vent. Avant d'y arriver, on traverse des futaies serrées, et, tout à coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d'un étang, un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toutes choses ! Les sapins poussent dans une espèce d'île au milieu ; il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c'est défendu ; on y cuit n'importe quoi, une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain bis faute d'autre chose ; ça sent la fumée amère et la résine, c'est abominable, c'est exquis.
J'ai vécu dans ces bois dix années de vagabondages éperdus, de conquêtes et de découvertes ; le jour où il me faudra les quitter j'aurai un gros chagrin. »
Ce livre présente la partie photographique de la série, mais ce travail est protéiforme et multidisciplinaire. Pourriez-vous nous présenter votre démarche et les différents médiums utilisés ?
Wanda Skonieczny : Effectivement, je trogne la photographie. Je l’efface et l’ouvre pour la recomposer ensuite à la mine de plomb ou à la pierre noire. Elle est pour moi une graine, que je fais germer par le dessin, en ramifications débordantes se prolongeant hors du cadre. Fascinée par le détail, les photographies basculent de la miniature aux agrandissements parfois monumentaux, pour épouser les lieux échelle 1 et faire corps avec eux.
Dans ces jeux d’installation invitant à faire du lien, je prolonge et pousse la photographie à sortir du cadre, dans des suites graphiques intemporelles. Cela a toujours été, je cherche à creuser l’image pour aller au-delà des couches superficielles. Le choix des sujets et des supports est très important pour cela. Les photographies peuvent être tirées sur bois ou en piezo, elles ne sont jamais glacées, prenant l’aspect de la cendre, de morceaux de bois charbonneux ou parfois de la gravure. C’est une relation particulière ; avec la photographie, j’aime prolonger les instants dans ces traitements.
Que souhaitez-vous transmettre à travers cet ouvrage ?
Wanda Skonieczny : Ralentir la course du temps et créer une zone d’apaisement. Une parenthèse. Par ailleurs, j’aspire à un retour à l’authenticité. J’espère ici relier au vivant, en questionnant notre place et notre rôle aujourd’hui face à la nature. Personnellement je trouve que l’art contemporain n’évoque que trop peu les sujets liés à la ruralité et au monde paysan.
Cet ouvrage cherche à faire redécouvrir ces arbres à « têtes rondes » comme le disait Colette et je fais le vœu qu’avec ses mots, elle nous fasse « regarder » autrement en guidant notre regard vers le haut, dans un message d’espoir et de persévérance.
TROGNES - ÉDITION LIMITÉE, NUMÉROTÉE & SIGNÉE PAR LA PHOTOGRAPHE
Corridor Éléphant Éditions propose depuis dix ans des livres d’artistes émergents en édition de collection, limitée, numérotée et signée.
Le livre est disponible en édition de collection, numérotée, imprimée sur un papier 170 g, avec une couverture pelliculée mate 400 g. Format 21 x 15 cm. 82 pages. 37 photographies.
L'édition de collection est imprimée en France et envoyée par nos soins dans un très beau papier de soie bleu cacheté.
Afin de permettre d'imprimer le plus grand nombre d'exemplaires en édition de collection, nous vous proposons des lots composés du livre et de tirages de photographies extraites du livre.
Acquérir le livre en édition limitée, c’est acquérir un objet unique faisant lien avec l'auteure.
Bientôt la fin de la souscription fin octobre, un super ouvrage à s’offrir et conseiller à ses proches !

Tous les détails ici
Jean-Pierre Simard à l’éditing le 8/09/2025
Wanda Skonieczny - Trognes - éditions Corridor Eléphant - sortie fin octobre
07.09.2025 à 12:50
Guedra Guedra et l'Afrique moderne polyrythmique fissa fissa de Mutant

Texte intégral (676 mots)
Avec MUTANT, le producteur et DJ marocain Abdellah M. Hassak, alias Guedra Guedra, repousse les frontières du son et des genres. Nouvelle signature du label Smugglers Way (Braxe & Falcon), Guedra Guedra dévoile bien plus qu'un album : une odyssée afrofuturiste, un manifeste musical qui puise dans la richesse des traditions africaines tout en les propulsant dans une techno incisive et organique.
Des field recordings captés entre le Maroc, la Guinée et la Tanzanie tissent la trame de ce disque vibrant. Entre dub tribal, pulsations électroniques et percussions ancestrales, Guedra Guedra redéfinit les codes du clubbing, tout en honorant l'héritage culturel africain. Un équilibre rare entre modernité électronique et mémoire collective. MUTANT n'est pas qu’une prouesse sonore - c'est un acte politique. Chaque titre questionne les notions d'identité, de décolonisation culturelle et de reconnexion aux racines. Un album puissant, viscéral, traversé par une énergie rythmique contagieuse. De quoi faire flipper les réacs anti-woke racistes…
MUTANT explore les thèmes de l'identité, du panafricanisme, de l'afrofuturisme et de la décolonisation, faisant le pont entre l'héritage musical du continent et des éléments de techno, de bass music et de dub.
Les titres de l’album célèbrent la richesse des formes polyrythmiques africaines et remettent également en question la manière dont cette richesse a longtemps été marginalisée par les outils technologiques et les systèmes de pensée façonnés par la logique occidentale et les modèles de standardisation.
Parce que l’été ne se termine vraiment jamais, profitez-en !
Jean-Pierre Simard, le 8/09/2025
Guedra Guedra - Mutant - Smugglers Way / Domino

07.09.2025 à 12:29
Livres à voir avec Livres Uniks 6

Texte intégral (1386 mots)
Le mot dans l’image. Nous parlons. Nous prononçons des mots. Nous parlons avec des mots que nous échangeons, et les mots sont porteurs de sens, d’information. Si nous pouvons nous comprendre, c’est que nous nous accordons sur le sens des mots. L’image, elle aussi, peut parler — il n’y a pas d’image muette. Une image parle à travers des couleurs, qui sont ambivalentes par définition. Elle parle à travers des formes ; ces formes peuvent devenir des symboles, elles sont davantage un langage concret. Même une image « vide » (en existe-t-il ?) parle.

Theodora Kanelli, Atlas d’une hybris II ., 2025 - Technique mixte (crayon de couleur, peinture à l’huile, etc.) sur supports variés (toile, papier aquarelle, papier calque, etc.). — 180× 70× 60 cm. Courtesy de l’artiste.
Si l’écriture s’introduit dans une image, elle devient, avec ses mots, partie intégrante de l’image dans notre perception. En tant qu’instrument conceptuel, quand l’écriture est aussi une partie conçue de l’image, il importe de savoir si elle vise à être une information, un moyen de composition, ou bien les deux.

Tino Di Santolo, Sans titre, série Sismographie., 2023 Dessin au graphite et crayon de couleur sur carnet. — 30 × 20 cm. Courtesy de l’artiste.
L’écriture dans l’image incite à lire — réflexe de notre expérience quotidienne –, de la même manière que nous percevons d’abord un visage dans l’image, que notre attention se focalise d’emblée sur un visage, et ensuite nous discernons et lisons les formes, les couleurs, le matériau, etc. Cette écriture-là peut être une médiation vers le « discernement » et elle peut initier de bonnes ou de fausses pistes (sommes-nous censés discerner un sens ?). En caractères d’imprimerie ou manuscrite, elle induit une lecture, sous la forme d’un simple fragment écrit ou d’une calligraphie, de manière enfantine ou savamment conçue, tracée distraitement ou gribouillée en passant, maladroitement à dessein ou le plus objectivement possible. Ainsi le spectateur tentera-t-il de découvrir quelle fonction, quelle place occupe l’écriture. Selon le genre d’écriture et de lecture, l’image devient plus éloquente, plus frappante, peut- être plus énigmatique, plus poétique… Le signe archaïque des origines, gravé sur la terre, peint sur les murs, mystérieux, fragment d’écriture en tant que force d’ouverture ou de fermeture, recèle du poétique. L’écriture est réalisation, elle est une forme : ligne, surface, manque, creux, perspective diminuée ou agrandie, elle ondoie, ses angles sont aigus ou durs, ou bien ses courbes sont lisses : elle a une texture. Et ne marchons-nous pas sur elle comme sur un sol rocailleux, comme sur des feuilles mortes, parmi les herbes d’une prairie ou sur un terrain mouvant, marécageux ?
Extrait du texte de Paul Thomas Konietschke, le 8/09/2025
Livres Uniks 6
Galerie Topographie de l’art 15, rue de Thorigny 75003

Thomas Paul Konietschke, Kassa Buch ., 2021 Collage-papier, encre, crayon (Bleisitft), gouache. — 22 × 17,5 × 6 cm. Courtesy de l’artiste.
07.09.2025 à 11:52
Quand tout va vraiment mal pour Mark Tamer

Texte intégral (2237 mots)
Ces diptyques tentent de communiquer ce que c'est que de vivre avec des migraines vestibulaires chroniques, des stimuli sensoriels accablants et des signaux erratiques dans les voies neuropathiques, tout en essayant d'apprécier la beauté des moments de calme et la complexité du cerveau humain. Photographies et texte de Mark Tamer.

Everything is Wrong © Mark Tamer
Je vis depuis 20 ans avec des migraines vestibulaires chroniques. Mon cerveau surinterprète les différentes informations sensorielles : les lumières sont trop vives, les sons trop forts et les mouvements me donnent la nausée. À cela s'ajoutent les maux de tête et le brouillard cérébral permanent qui rendent difficile toute pensée claire. Il n'y a pas de bouton « off », c'est donc ainsi que je perçois le monde aujourd'hui.
En substance, mes voies neuropathiques sont défectueuses, les signaux envoyés par mes nerfs se dégradent en cours de route, fournissant à mon cerveau des informations erronées. Et pourtant, cette expérience m'a donné la capacité de ralentir, de trouver la beauté dans les moments de calme et d'apprécier la complexité du cerveau humain et la façon dont il construit soigneusement notre réalité.

Everything is Wrong © Mark Tamer

Everything is Wrong © Mark Tamer
Ce projet est ma tentative de communiquer un peu de cette expérience vécue.
Je suis un photographe expérimental basé à Londres qui travaille avec des procédés analogiques. À travers mon travail, je cherche à trouver un équilibre entre le hasard et le contrôle, entre la construction et la destruction, entre le signal et le bruit, et finalement entre la vie et la mort. J'accepte les accidents et les erreurs, car non seulement ils nous rappellent à quel point nous sommes vulnérables et fragiles, mais ils peuvent aussi souvent nous montrer quelque chose de nouveau.
Mark Tamer, pour Lens Culture le 8/09/2025
Quand tout va vraiment mal.

Everything is Wrong © Mark Tamer

Everything is Wrong © Mark Tamer
07.09.2025 à 11:43
Rachida 5 sur le départ, quel Mickey 6 pour le ministère de la Culture ?

Texte intégral (1708 mots)
Portée par d’autres ambitions, Rachida Dati est de ces rares ministres qui n’en ont ouvertement rien à battre de leur ministère. Même par politesse. Bientôt vacant, un ministère de la Culture en déshérence ?

Image issue de « Mickey 17 », de Bong Joon-ho @ WARNER BROS. PICTURES @Chroniques d’architecture
Installée au ministère de la Culture depuis le 11 janvier 2024, sous trois gouvernements successifs (Attal, Barnier, Bayrou), il y a un record que Rachida Dati pourtant ne devrait pas atteindre, celui de Jack Lang, parmi les 28 titulaires depuis Malraux la véritable bernique de la rue de Valois et champion hors catégorie de longévité ministérielle sous cinq gouvernements : Mauroy, Rocard, Fabius, Cresson et Beregovoy. Quel que soit le résultat du scrutin du 8 septembre 2025 en effet, même si François Bayrou, encore Premier ministre à l’heure d’écrire ces lignes, réussissait son pari improbable et sauvait son gouvernement, la candidature officielle de Rachida à la Mairie de Paris en 2026 met un terme à sa « séquence culture ».
Les cinéphiles auront peut-être noté la sortie en 2025 de la comédie d’action et de science-fiction américano-sud-coréenne écrite et réalisée par Bong Joon-Ho, Mickey 17. Mickey est un « remplaçable », l’employé jetable d’une expédition humaine de colonisation de l’espace. À chaque fois qu’il meurt au fil de ses dangereuses missions, ce qui n’est pas très agréable, un nouveau Mickey est réimprimé tel quel en 3D et conserve ses souvenirs, sa vie, son emploi, etc. et c’est reparti pour une autre dangereuse et létale mission. Mickey 17 donc est la dernière version en date de Mickey. Quand l’action débute, tout le monde croit Mickey 17 mort et Mickey 18 est donc imprimé. Deux Mickeys vivants, c’est la pagaille !
Tout ça pour dire que très bientôt Rachida Dati ne sera plus ministre de la Culture et la ministre des architectes. Pourquoi Rachida 5 ? Parce que d’évidence elle fait partie des « remplaçables ». Voyons.
Quand un nouveau président arrive en 2017 à la tête du pays, il enjoint à son Premier ministre de former le meilleur gouvernement possible et les premiers ministres de ce premier gouvernement d’une nouvelle ère se doivent d’être les meilleurs dans le genre, des héros issus de toutes les provinces, pour la Culture y compris ! Surtout pour la Culture…
Premier choix, Françoise 1 (Nyssen)* (17 mai 2017 – 16 octobre 2018) la surprise du chef. L’une de ses premières tâches sera de veiller à l’application des décrets de la loi sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine (loi LCAP) adoptée sous la législature précédente. Françoise 1 sera confrontée à un texte plus conflictuel, la loi ELAN, destiné soi-disant à « faciliter la construction de nouveaux logements et à protéger les plus fragiles ». Provinciale, elle sera piégée par un système D de m² indus. On connaît la suite pour les nouveaux logements et les plus fragiles.
Second choix, Franck 2 (Riester)** (16 octobre 2018 – 6 juillet 2020) qui aura eu le mérite de ne jamais froisser personne ; il est dit d’ailleurs que son fantôme hante gentiment les couloirs de Matignon et de l’Assemblée nationale. Pour ce qui concerne l’architecture, il n’a pas imprimé, ni réimprimé.
Alors évidemment, plus le temps passe et que rien n’avance, il faut reconfigurer l’imprimante et voici Roselyne 3 (Bachelot) (6 juillet 2020 – 20 mai 2022), qui s’était pourtant retirée des voitures. Sa gouaille et sa culture ont donné l’illusion d’un ministère en mouvement et, pour ce qui concerne l’architecture, quelques discours et de vagues promesses. Aujourd’hui, quel bilan ? Peu importe, elle au moins n’a pas fini à la broyeuse !
Avec Rima 4 (Abdul Malak) (20 mai 2022 – 11 janvier 2024), nous avons découvert à la Culture un service communication dernière génération : il ne communique rien et brûle les discours de la ministre en de discrets autodafés.*** Pour autant, comment lui en vouloir, Rima 4 était au service de son maître, comme un vassal et son lord, puisqu’elle s’est retrouvée avec sur les bras la restauration de Notre-Dame de Paris ou encore la construction de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts. Heureusement que Macron ne lui a pas demandé de sauter du Pont des arts… Et puis finalement si, quand elle s’est dite « heurtée » par la loi Immigration et a évoqué la procédure visant à retirer la légion d’honneur à Gérard Depardieu. Lèse-majesté ? Le prince a eu sa tête ! Bon, cela n’a rien à voir avec l’architecture, encore que…****
Et donc Rachida 5 (Dati) – depuis 2008 maire du VIIe arrondissement de Paris, celui des parvenus – qui pour le coup ne tient sa position ministérielle que de la volonté de Vulcain ex-Jupiter dont chacun sait le goût pour la réimpression en 3D à l’identique de concepts éculés. Sous ce parapluie, Rachida 5 réimprimée groupie s’est surtout préoccupée de museler les médias à travers sa volonté féroce de réformer le service public tout en laissant libre cours à sa passion agressive pour ses intérêts propres. De ce point de vue, Rachida 5, partout où elle passe – et repasse – est son propre avatar, un concept qui dans la religion hindoue désigne chacune des incarnations de Vishnu.
Pour ce qui concerne l’architecture, c’est depuis le 11 janvier 2024, jour de sa nomination, une ode impérieuse au patrimoine, argumentation paresseuse pour qui affiche clairement ses ambitions pour la mairie de Paris, ville musée. D’ailleurs, le 16 janvier 2025, c’était hier, lors de la présentation de son « Plan Cathédrales » – tout est dans l’intitulé – la ministre expliquait que son « engagement pour le patrimoine est total ». Un cri du cœur qui en dit long sur la vision progressiste de la France de l’encore ministre de la Culture et de ses ineffables parrains !
Le temps aura manqué à Rachida 5 pour appliquer à l’architecture la trypophobie dont elle a fait preuve à l’encontre des archéologues à propos de la restauration du château de Dampierre-en-Yvelines par un propriétaire privé.***** Selon Le Parisien (23/04/2024) et sur X, la ministre de la Culture affirme qu’il ne faudrait plus « creuser des trous juste pour le plaisir », et qu’elle préférait « mettre de l’argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour un trou ».
Bref, sauf surprise, sans regarder en arrière parce que les municipales de 2026 se profilent, Rachida 5 ne sera bientôt plus ministre de la Culture. Pour autant, il faut lui rendre ce qui lui appartient – elle est de ces rares ministres qui n’en ont rien à battre de leur ministère ou d’être ministre, sinon , « en même temps », pour les émoluments liés à la fonction. Cela a le mérite de la clarté.
Sauf gouvernement technique qui nous emmène jusqu’en février 2026 avec les mêmes, qui d’autre pour descendre encore d’un échelon au ministère de la Culture de Macron Président dès la semaine prochaine et s’afficher en Mickey 6 ? Stéphane 6 Le pieux ?******
Christophe Leray (avec Syrus) le 8/09/2025
* Lire Architecture pour tous et une ministre de la Culture pour personne (2018)
** Lire Franck Riester, nouveau héraut impuissant des architectes (2018)
*** Lire Le Grand Prix national d’Architecture, un non-évènement culturel (2022)
**** Lire Au Vélodrome, le père François droit au but (2023)
***** Le duc de Dampierre ayant déclaré que tous les cocus devaient être noyés, Madame de Dampierre lui a demandé s’il était bien sûr de savoir nager !!! (Psaumes – Chansons paillardes)
****** Lire Pour le patrimoine français, les boules de Stéphane Bern (2018)
07.09.2025 à 10:41
Mieux comprendre rat-taïaut et l'agent orange avec "L’Enfance du monde " / "La science-fiction capitaliste"

Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.

Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.

Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.

En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.

« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).

Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.

Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.

☀︎
Notes de lecture 2024, Nouveautés
Note de lecture : « L’Enfance du monde » / « La science-fiction capitaliste » (Michel Nieva)
Posté par Hugues ⋅ 23 juillet 2025 ⋅ Poster un commentaire
Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.
x
x
x
Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.
x
Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.
x
En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.
x
x
x
« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).
x
Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.
x
Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.
La science-fiction capitaliste – Ou comment les milliardaires vont nous sauver de l’apocalypse
x
Le techno-multimilliardaire ne sait pas vraiment lire, quelles que soient les apparences éventuelles, mais il sait détourner – on le sait au moins, toutes proportions gardées, depuis le fondamental « Le nouvel esprit du capitalisme » (1999) de Luc Boltanski et Eve Chiapello. Mais on lui sert si volontiers la soupe, économique et médiatique, le moment venu, qu’il parvient à faire semblant très longtemps – voire à réécrire les créations passées à l’aune de son propre appétit – insatiable. Si Kim Stanley Robinson s’arrache à raison les cheveux en entendant les travestissements de son œuvre que colporte si volontiers Elon Musk, et si Iain M. Banks se retournerait à coup sûr dans sa tombe face aux avanies que fait subir le même forcené à la sienne, c’est à partir d’un autre exemple séminal que procède Michel Nieva dans ce bref essai, publié en 2024 et traduit également par Sébastien Rutès pour inclusion, quasiment en postface, dans l’édition française de « L’enfance du monde ». : il s’agit du fondamental « Le Samouraï virtuel » (dont, une fois de plus, le titre français fait légèrement frémir de honte par rapport à l’original « Snow Crash »), publié en 1992 par Neal Stephenson.
Ce qui frappe dans ce roman publié en 1992, c’est qu’il imagine une époque qu’on ne peut qualifier de dystopique que dans la mesure où elle renforce, dans un avenir pas si lointain, des logiques néolibérales de précarisation du travail, de délocalisation industrielle et de renforcement du pouvoir des mégacorporations face à un reliquat d’État en faillite qui existaient déjà aux États-Unis à l’époque où le roman a été écrit. Néanmoins, peut-être à cause de son contexte de publication particulier – sur la Côte ouest, deux ans avant le début de l’usage commercial d’internet pour les ordinateurs personnels -, sa dimension de pamphlet lapidaire contre le capitalisme sauvage est passée inaperçue et s’est vue immédiatement éclipsée par les innovations technologiques que le roman conjecturait dans ce futur néolibéral frénétique.
En quelques années, Le Samouraï virtuel s’est taillé dans la Silicon Valley la réputation d’un oracle de légende ayant inspiré quelques-unes des technologies qui deviendraient des icônes du capitalisme digital, comme par exemple la cryptomonnaie, Google Earth, les applications de livraison à domicile, le jeu vidéo Quake, la plateforme Second Life, Wikipédia, le métavers (lequel à dire vrai avait déjà été inventé par William Gibson dans Neuromancien, sous le nom évocateur de « Matrice »), en plus d’avoir popularisé le terme d’origine sanskrite « avatar ». Ce livre a imaginé avant l’heure tellement de produits et de concepts informatiques que les compagnies de la Silicon Valley ont obligé leurs créatifs à le lire, et que des gourous du secteur comme Bill Gates, Sergueï Brin, John Carmack ou Peter Thiel ont reconnu une filiation intellectuelle entre leurs créations et celles présentes dans Le Samouraï virtuel.
Étant donné les qualités futurologiques de son œuvre, Neal Stephenson n’a pas manqué d’offres de la part de différentes sociétés d’innovation technologique? Il a d’abord mis son imagination, nourrie de space opera et de fanzines cyberpunk, au service de Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos, où il a travaillé à l’innovation astronautique pendant sept ans, mais il occupe désormais le poste de « futurologue » chez Magic Leap, une compagnie qui développe des casques de réalité augmentée à des fins commerciales et scientifiques, ce qui en fait un concurrent du groupe Meta.
En 2021, au moment où Zuckerberg a annoncé la création de son métavers, Neal Stephenson a démenti sur Twitter toute responsabilité intellectuelle dans le projet. Cependant, toujours dans un tweet, il a expliqué que la raison de ce désengagement n’était pas qu’il condamnait la prostitution de ce qui avait d’abord été une critique acerbe du capitalisme à une des compagnies les plus monopolistes et multimilliardaires de la planète, mais tout simplement que son idée originale ne lui rapportait aucun droit d’auteur.
Comme on peut le lire, le caustique Michel Nieva n’hésite pas un instant à décaper les complaisances et les connivences au sein d’un milieu littéraire science-fictif historique (mais aussi contemporain, les proxy fights autour des votes pour le prix Hugo en 2015 en témoignaient hélas encore récemment) qui n’a pas toujours uniquement brillé par son progressisme social et politique. Il traite ici directement, sous une forme ironique et enjouée, l’emprise idéologique et culturelle des techno-milliardaires (qui ont pourtant fréquemment le culot, pour les plus vociférants d’entre eux, de prétendre ne pas pouvoir s’exprimer), en particulier autour de la conquête spatiale (remédiant ainsi indirectement au principal point aveugle de l’essai par ailleurs excellent et stimulant de Irénée Regnauld et Arnaud Saint-Martin, « Une histoire de la conquête spatiale », également publié en 2024) et de la quête de l’immortalité (nous rappelant toujours à quel point le « Jack Barron et l’éternité » de Norman Spinrad, pourtant publié en 1969, ne prend guère de rides au fil du temps – si l’on ose dire sur pareil sujet).
Porté par un souffle proprement jubilatoire, ce petit essai en six chapitres et un épilogue, avec des titres aussi évocateurs que « Métavers, tourisme spatial, immortalité, sojapunk », « Le changement climatique, la grande fierté de l’homme blanc » ou « La science-fiction capitaliste, phase supérieure du colonialisme », illustre à la perfection ce qu’une science-fiction critique et incisive peut produire à l’encontre d’un discours qui – malgré le tour de passe-passe insensé du « on ne peut plus rien dire » – demeure bien le discours dominant, et surtout celui qui dirige les actions et les inactions des powers that be. Et l’on se reportera avec joie à la dernière phrase du texte, que je vous laisse le soin de découvrir le moment venu sans la citer ici.
Ces exemples – le métavers de Zuckerberg, le business interplanétaire de SpaceX, l’immortalité d’Auubrey de Grey ou le « sojapunk » de Grobocopatel – sont autant de preuves éclatantes d’une tendance de plus en plus visible et globale : l’appropriation par le capitalisme technologique du langage de la science-fiction, le séduisant storytelling d’un futur hypertechnologique que les mégacorporations et leurs directeurs généraux instrumentalisent non seulement pour habiller leurs produits mais aussi pour offrir une solution hypothétique aux graves crises socio-environnementales que le capitalisme lui-même a provoquées. On a dit qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme, eh bien ! ces compagnies développement déjà le capitalisme extra-terrestre qui lui survivra. Quant à leurs dirigeants, ils cherchent à nous faire croire que, si nous aussi nous voulons survivre, il nous faut acheter leurs produits, car rien d’autre ne pourra nous sauver – du moins ceux qui peuvent se les offrir.
La science-fiction capitaliste offre le récit fantastique d’une « humanité sans monde », faite de touristes qui vivent mille ans et voyagent à travers le cosmos pour prendre des selfies pendant que la Terre s’embrase, récit qui permet à l’establishment industriel de monopoliser le droit à penser le fuur, après avoir plongé les sociétés dans l’incapacité à projeter leurs propres visions. Dans une citation aussi célèbre qu’inspirante tirée des textes fondateurs de SpaceX, Elon Musk dit : « Tout le monde a envie de se lever le matin en se disant que l’avenir sera grandiose : voilà ce que veut dire devenir une civilisation qui voyage dans l’espace. Il s’agit de croire au futur et de penser qu’il sera meilleur que le passé. Je ne peux rien imaginer de plus excitant que de voyager là-haut et de vivre parmi les étoiles ». En même temps que le capital condamne les travailleur.euses du monde entier à un présent continuellement fait d’instabilité, d’incertitude et d’endettement, les milliardaires se posent comme les seuls capables d’anticiper et de donner de la valeur à l’avenir. La science-fiction capitaliste est une violence qui réserve aux grandes compagnies le monopole du droit à imaginer notre futur. Voilà comment, dans la continuité directe de cet esprit de l’époque que Mark Fisher a qualifié de « réalisme capitaliste », ce sentiment nihiliste hégémonique que le capitalisme est le seul système politique et économique viable sous prétexte qu’on n’arrive pas à en imaginer de meilleur ni de pire, nous vivons une ère où le capitalisme ornemente des atours d’une esthétique hyperfuturiste le soupçon que c’est son fonctionnement même qui nous conduit à la catastrophe.
Hugues Charybde, le 8/09/2025
Michel Nieva - L’enfance du monde, suivi de La science-fiction capitaliste - collection Chimères, ed Christian Bourgois
L’acheter chez Charybde, ici

Texte intégral (11742 mots)
Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.

Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.

Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.

En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.

« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).

Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.

Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.

☀︎
Notes de lecture 2024, Nouveautés
Note de lecture : « L’Enfance du monde » / « La science-fiction capitaliste » (Michel Nieva)
Posté par Hugues ⋅ 23 juillet 2025 ⋅ Poster un commentaire
Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.
x
x
x
Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.
De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.
Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :
– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?
– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?
– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?
Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.
De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.
Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.
x
Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.
Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).
Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.
x
En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.
Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.
En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :
– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !
Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.
Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.
Du boudin !
Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.
x
x
x
« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).
x
Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.
Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.
De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.
Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…
Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.
x
Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !
Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?
Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.
La science-fiction capitaliste – Ou comment les milliardaires vont nous sauver de l’apocalypse
x
Le techno-multimilliardaire ne sait pas vraiment lire, quelles que soient les apparences éventuelles, mais il sait détourner – on le sait au moins, toutes proportions gardées, depuis le fondamental « Le nouvel esprit du capitalisme » (1999) de Luc Boltanski et Eve Chiapello. Mais on lui sert si volontiers la soupe, économique et médiatique, le moment venu, qu’il parvient à faire semblant très longtemps – voire à réécrire les créations passées à l’aune de son propre appétit – insatiable. Si Kim Stanley Robinson s’arrache à raison les cheveux en entendant les travestissements de son œuvre que colporte si volontiers Elon Musk, et si Iain M. Banks se retournerait à coup sûr dans sa tombe face aux avanies que fait subir le même forcené à la sienne, c’est à partir d’un autre exemple séminal que procède Michel Nieva dans ce bref essai, publié en 2024 et traduit également par Sébastien Rutès pour inclusion, quasiment en postface, dans l’édition française de « L’enfance du monde ». : il s’agit du fondamental « Le Samouraï virtuel » (dont, une fois de plus, le titre français fait légèrement frémir de honte par rapport à l’original « Snow Crash »), publié en 1992 par Neal Stephenson.
Ce qui frappe dans ce roman publié en 1992, c’est qu’il imagine une époque qu’on ne peut qualifier de dystopique que dans la mesure où elle renforce, dans un avenir pas si lointain, des logiques néolibérales de précarisation du travail, de délocalisation industrielle et de renforcement du pouvoir des mégacorporations face à un reliquat d’État en faillite qui existaient déjà aux États-Unis à l’époque où le roman a été écrit. Néanmoins, peut-être à cause de son contexte de publication particulier – sur la Côte ouest, deux ans avant le début de l’usage commercial d’internet pour les ordinateurs personnels -, sa dimension de pamphlet lapidaire contre le capitalisme sauvage est passée inaperçue et s’est vue immédiatement éclipsée par les innovations technologiques que le roman conjecturait dans ce futur néolibéral frénétique.
En quelques années, Le Samouraï virtuel s’est taillé dans la Silicon Valley la réputation d’un oracle de légende ayant inspiré quelques-unes des technologies qui deviendraient des icônes du capitalisme digital, comme par exemple la cryptomonnaie, Google Earth, les applications de livraison à domicile, le jeu vidéo Quake, la plateforme Second Life, Wikipédia, le métavers (lequel à dire vrai avait déjà été inventé par William Gibson dans Neuromancien, sous le nom évocateur de « Matrice »), en plus d’avoir popularisé le terme d’origine sanskrite « avatar ». Ce livre a imaginé avant l’heure tellement de produits et de concepts informatiques que les compagnies de la Silicon Valley ont obligé leurs créatifs à le lire, et que des gourous du secteur comme Bill Gates, Sergueï Brin, John Carmack ou Peter Thiel ont reconnu une filiation intellectuelle entre leurs créations et celles présentes dans Le Samouraï virtuel.
Étant donné les qualités futurologiques de son œuvre, Neal Stephenson n’a pas manqué d’offres de la part de différentes sociétés d’innovation technologique? Il a d’abord mis son imagination, nourrie de space opera et de fanzines cyberpunk, au service de Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos, où il a travaillé à l’innovation astronautique pendant sept ans, mais il occupe désormais le poste de « futurologue » chez Magic Leap, une compagnie qui développe des casques de réalité augmentée à des fins commerciales et scientifiques, ce qui en fait un concurrent du groupe Meta.
En 2021, au moment où Zuckerberg a annoncé la création de son métavers, Neal Stephenson a démenti sur Twitter toute responsabilité intellectuelle dans le projet. Cependant, toujours dans un tweet, il a expliqué que la raison de ce désengagement n’était pas qu’il condamnait la prostitution de ce qui avait d’abord été une critique acerbe du capitalisme à une des compagnies les plus monopolistes et multimilliardaires de la planète, mais tout simplement que son idée originale ne lui rapportait aucun droit d’auteur.
Comme on peut le lire, le caustique Michel Nieva n’hésite pas un instant à décaper les complaisances et les connivences au sein d’un milieu littéraire science-fictif historique (mais aussi contemporain, les proxy fights autour des votes pour le prix Hugo en 2015 en témoignaient hélas encore récemment) qui n’a pas toujours uniquement brillé par son progressisme social et politique. Il traite ici directement, sous une forme ironique et enjouée, l’emprise idéologique et culturelle des techno-milliardaires (qui ont pourtant fréquemment le culot, pour les plus vociférants d’entre eux, de prétendre ne pas pouvoir s’exprimer), en particulier autour de la conquête spatiale (remédiant ainsi indirectement au principal point aveugle de l’essai par ailleurs excellent et stimulant de Irénée Regnauld et Arnaud Saint-Martin, « Une histoire de la conquête spatiale », également publié en 2024) et de la quête de l’immortalité (nous rappelant toujours à quel point le « Jack Barron et l’éternité » de Norman Spinrad, pourtant publié en 1969, ne prend guère de rides au fil du temps – si l’on ose dire sur pareil sujet).
Porté par un souffle proprement jubilatoire, ce petit essai en six chapitres et un épilogue, avec des titres aussi évocateurs que « Métavers, tourisme spatial, immortalité, sojapunk », « Le changement climatique, la grande fierté de l’homme blanc » ou « La science-fiction capitaliste, phase supérieure du colonialisme », illustre à la perfection ce qu’une science-fiction critique et incisive peut produire à l’encontre d’un discours qui – malgré le tour de passe-passe insensé du « on ne peut plus rien dire » – demeure bien le discours dominant, et surtout celui qui dirige les actions et les inactions des powers that be. Et l’on se reportera avec joie à la dernière phrase du texte, que je vous laisse le soin de découvrir le moment venu sans la citer ici.
Ces exemples – le métavers de Zuckerberg, le business interplanétaire de SpaceX, l’immortalité d’Auubrey de Grey ou le « sojapunk » de Grobocopatel – sont autant de preuves éclatantes d’une tendance de plus en plus visible et globale : l’appropriation par le capitalisme technologique du langage de la science-fiction, le séduisant storytelling d’un futur hypertechnologique que les mégacorporations et leurs directeurs généraux instrumentalisent non seulement pour habiller leurs produits mais aussi pour offrir une solution hypothétique aux graves crises socio-environnementales que le capitalisme lui-même a provoquées. On a dit qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme, eh bien ! ces compagnies développement déjà le capitalisme extra-terrestre qui lui survivra. Quant à leurs dirigeants, ils cherchent à nous faire croire que, si nous aussi nous voulons survivre, il nous faut acheter leurs produits, car rien d’autre ne pourra nous sauver – du moins ceux qui peuvent se les offrir.
La science-fiction capitaliste offre le récit fantastique d’une « humanité sans monde », faite de touristes qui vivent mille ans et voyagent à travers le cosmos pour prendre des selfies pendant que la Terre s’embrase, récit qui permet à l’establishment industriel de monopoliser le droit à penser le fuur, après avoir plongé les sociétés dans l’incapacité à projeter leurs propres visions. Dans une citation aussi célèbre qu’inspirante tirée des textes fondateurs de SpaceX, Elon Musk dit : « Tout le monde a envie de se lever le matin en se disant que l’avenir sera grandiose : voilà ce que veut dire devenir une civilisation qui voyage dans l’espace. Il s’agit de croire au futur et de penser qu’il sera meilleur que le passé. Je ne peux rien imaginer de plus excitant que de voyager là-haut et de vivre parmi les étoiles ». En même temps que le capital condamne les travailleur.euses du monde entier à un présent continuellement fait d’instabilité, d’incertitude et d’endettement, les milliardaires se posent comme les seuls capables d’anticiper et de donner de la valeur à l’avenir. La science-fiction capitaliste est une violence qui réserve aux grandes compagnies le monopole du droit à imaginer notre futur. Voilà comment, dans la continuité directe de cet esprit de l’époque que Mark Fisher a qualifié de « réalisme capitaliste », ce sentiment nihiliste hégémonique que le capitalisme est le seul système politique et économique viable sous prétexte qu’on n’arrive pas à en imaginer de meilleur ni de pire, nous vivons une ère où le capitalisme ornemente des atours d’une esthétique hyperfuturiste le soupçon que c’est son fonctionnement même qui nous conduit à la catastrophe.
Hugues Charybde, le 8/09/2025
Michel Nieva - L’enfance du monde, suivi de La science-fiction capitaliste - collection Chimères, ed Christian Bourgois
L’acheter chez Charybde, ici

08.07.2025 à 17:55
Loin de toute figure imposée : Terry Riley

Texte intégral (875 mots)
Jean-Louis Tallon s’est attaqué à la biographie du précurseur du minimalisme US, Terry Riley. Même si ce dernier refusa le terme, le trouvant trop limitant pour ses activités et son art en expansion. Au fil de 250 pages, vous allez découvrir le travail d’un homme qui ne se limita jamais à ce qu’on attendait de lui et qui, de lieu en lieu, de voyage physique en découverte musicale explora toute sa vie la radicalité d’un propos toujours en construction : du saxo au piano et à la voix ( proche de celle de Robert Wyatt ) du jeu à l’écriture de quartet, de la composition solo à des pièces avec La Monte Young ou le Kronos Quarter et même avec un opéra dédié à l’art brut d’Adolf Wölfli. Haut en couleurs et singulièrement inattendu, Terry Riley.
Le propos de l’éditeur : « Du compositeur américain Terry Riley, né en 1935, on connaît surtout *In C*, pièce pionnière et révolutionnaire de musique répétitive qui, depuis sa création, jouit d’une popularité internationale incontestée. *In C* est néanmoins l’arbre qui cache la forêt d’une œuvre immense et universelle, à l’intersection du minimalisme, de la musique indienne, du jazz et de l’électronique, entre improvisation et écriture, Orient et Occident. On compte notamment l’album *A Rainbow In Curved Air*, qui influença Mike Oldfield, Pete Townshend de The Who ou Soft Machine, mais également *The Harp of New Albion*, sans oublier la vingtaine de quatuors à cordes conçus pour le Kronos Quartet depuis 1980. Premier ouvrage en français entièrement dédié au compositeur, *Terry Riley, figure libre* revient ainsi en détail sur la trajectoire d’un artiste dont l’esthétique plurielle et spirituelle, au-delà des modes, occupe aujourd’hui une place fondatrice dans l’histoire de la musique. »
On peut assurément adorer ou détester, mais pas passer à côté du personnage, ce drôle de hippie façonné à la pensée indienne et au travail du chant par le maître Pandit Pran Nath ; ce virtuose des claviers capable de gérer plus de choses avec ses deux mains qu’un musicien techno avec ses samplers, sans jamais rater un temps ; assez incroyable quand on y pense. Pour ma part, je suis fondu de « A Rainbow in Curved Air ». A tout le moins, un grand passeur, autant ami du Deavid Allen de Gong que de Don Cherry, de la Monte Young que de Pauline Oliveiros, Steve Reich ou Philip Glass. De l’aventure des répétitions aux répétitions par diverses aventures, un pionnier. En continu. On ne conseille pas de tout écouter d’un coup, mais la diversité du propos mérite plus qu’une oreille attentive, une envie à naître… Très bon bouquin pour l’été.
Jean-Pierre Simard, le 8/07/2025
Jean-Louis Tallon - Terry Riley, figure libre - éditions Le mot et le reste

29.06.2025 à 10:57
Quand Wolfgang Tillmans s'approprie l'architecture de la B.P.I.

Texte intégral (6635 mots)
« J’ai commencé ce projet en fréquentant régulièrement la BPI, en y passant du temps, en échangeant avec ses visiteurs, en écoutant leurs récits de moments de vie intenses et importants vécus là : certains y ont même rencontré des amis ou des partenaires. J’ai découvert un côté romantique à ce lieu…. J’ai passé la majeure partie du temps – en fait, toute la première année – à réfléchir à l’architecture, à la mise en espace, à la manière d’activer et d’utiliser ce lieu. » Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans - Table des livres et des publications. ©PascalTherme2025
« Ce qui m’intéresse, c’est de faire des images, de l’art – comme traduction du monde que je vois. » Wolfgang Tillmans
Le Centre Pompidou consacre à Wolfgang Tillmans une très large rétrospective du 13 Juin au 22 Septembre 2025, sur plus de trente cinq années de production; l’ensemble de ses pratiques se confronte aux murs de la Bibliothèque Publique d’Information, BPI sur 6000 M2, (la BPI est la combinaison d’une vaste bibliothèque publique parisienne d’environ 400 000 documents, dont 360 000 volumes, et d’une médiathèque. Dès ses débuts, sa vocation est encyclopédique.) il y a là un engagement de théâtralité de cette rétrospective totalement offert aux regards par l’espace qui lui est dédié. La BPI est en plein déménagement, ce sont donc de grands espaces désormais libres, avec des linéaires de murs iort considérable, la coursive des pompiers fait plus de 130 M de long, et n’avait connu aucun accrochage d’ailleurs; une BPI libre donc s’offre à Wolfgang Tillmans et à sa photographie, comme un lieu plastiquement ouvert, expérimental, qui n’empêche pas d’avoir eu à réfléchir la scénographie présente.
La BPI et les espaces créés dans l’exposition par la scénographie, les œuvres, entre le plafond bleu et les moquettes de couleur au sol, vestiges quasi archéologiques d’une signalétique, permettent à la fois à l’espace de reprendre ses perspectives monumentales et de montrer les œuvres de Wolfgang Tillmans.

https://pascaltherme.com/portfolio/wolfgang-tillmans/
En lien avec les mobiliers résiduels de la bibliothèque, moquettes aux lignes vertes, mauves, grandes tables, étagères et livres, espaces dédiés au numérique, bureaux et ordinateurs, écrans géants où se projettent les videos de l’artiste, ou s’entendent certaines ambiances sonores, où le son, la musique viennent s’adjoindre à un vaste corpus d’imprimés et d’objets personnels, issus de sa propre collection, bref tout a été conçu dans ce sens, pour un dialogue en Fa majeur entre l’histoire d’une photographie en prise avec la vie et donc ses actualités, ses modes, et ce lieu déconstruit savamment, livrant, à travers son dénuement, la puissance de ses lignes de fuites, la présence de ses tuyaux, de ses plafonds bleus, architectures qui rendent l’espace intérieur de la bibliothèque au dialogue des missions retenues et des savoirs anciennement transmis dans leur diversité sociale grâce à cette première fonction heuristique de la BPI.
L’ heuristique sert à la découverte, elle désigne la méthode qui permet au chercheur de découvrir, de sélectionner et de hiérarchiser les documents qu’il utilise. À ce titre, étant donné la nature du travail de recherche historique, elle a beaucoup à voir avec l’archivistique. On connait la « passion » de Wolfgang Tillmans pour les magazines, les livres, les imprimés, et les vitrines. Remarquable également sera la table ou nombre de livres qui lui sont consacrés sont mis à disposition du public, pour les consulter, s’en réjouir, ou simplement les feuilleter.
Accueillir Wolfgang Tillmans pour la mise en sommeil du bâtiment de Piano et Rogers est un événement exceptionnel. Au cours de sa carrière artistique, Tillmans (né en 1968 à Remscheid, en Allemagne) a repoussé les frontières du visible, captant et révélant la beauté fragile du monde physique. Proposant de nouvelles façons de faire des images, il explore la profonde transformation des médiums et supports d’information de notre époque.
Il a ainsi façonné un univers esthétique distinctif, né de l’esprit de la contre-culture du début des années 1990. Une œuvre multiple, par laquelle il s’est engagé dans la quête d’un nouvel humanisme et de voies alternatives du vivre ensemble, influençant durablement la création contemporaine. Son travail est profondément ancré dans l’« Ici et Maintenant » : il dresse un panorama des formes de savoir et propose une expérience sincère et libre du monde, scrutant la condition contemporaine de l’Europe tout en explorant les techniques de reproduction mécanique. https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/nSlcbMZ












Cette exposition peut s’apparenter à une immense installation globale, investissant toute la sentimentalité joyeuse du photographe qui expose petits tirages collés au mur, grands formats encadrés, et toute un panorama, à travers un immense collage au final de ses photographies, petites et grandes, moyennes, faisant, le tour de cette existence photographiée, à partir du point central de cet ici et maintenant, d’où le titre de l’exposition, avant sans doute que l’image ne vienne à disparaitre; il en va donc de la situation globale de ce qui contamine chaque image en partant de tout ce qui l’entoure, l’enfante, la rend présente, au sommet des sens pourrait-on penser, parce que cela a été vécu au plus profond de l’être, dans ses perceptions profondes vue, toucher, (regard esthétique haptique) et sentimentale, cette joie profonde répondant à l’inquiétude et l’émerveillement devant le Cosmos, les étoiles, perçus dans la veine romantique, exprimant ce qui dépasse l’humain, l’ancre dans ces perceptions physiques et méta-physiques, l’éveille aux correspondances et lois entre l’infini grand et l’infiniment petit, en ce qui croit dans un dialogue plus ou moins avéré de ces semblants faisant la chair et le discours premier de sa photographie. Le photographe est ici bien incarné et très présent à sa mission.







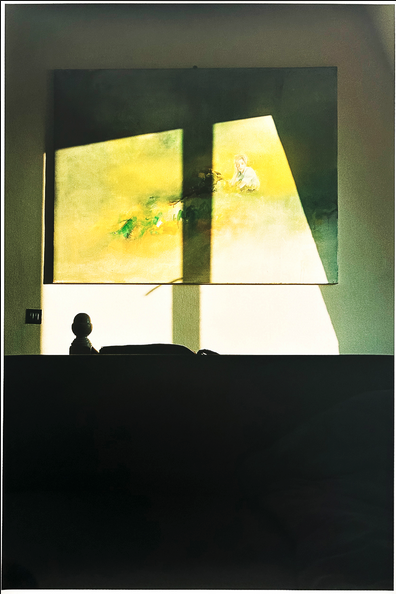


Wolfgang Tillmans, différentes vues et œuvres exposées dont Paper Drop 2021, la salle Video à la demande, chapitre auto formation dans l’exposition, et Silver, 1992, en cours.
L’installation s’est emparée de toute la topographie des espaces libres qui fuient, en tout cas pour le moins entre le ciel des tuyaux bleus et ces lignes de couleurs au sol, un vecteur impose l’espace où les lignes, au sol, qu’elles proviennent des traces de cloisons ou qu’elles soient le reliquat des moquettes faisant partie de la signalétique historique de la BPI, ces lignes jaunes et vertes, relèvent le gigantesque défi des 6000 M2 de l’espace presque nu; pertinence des espaces d’accrochage, non simplement comme des parois où les cimaises viendraient positionner les œuvres, mais comme, un mur devenu lui aussi plus libre dans sa fonctionnalité, plus accueillant aux œuvres accrochées, comme si, toute une révolution secrète et enchanteresse avait eu lieu, une sorte de chute du mur de Berlin symboliquement ayant contaminé ce désir des surfaces libres et ouvertes, afin que le corps – et il est toujours question du corps dans les photographies de Wolfgang Tillmans- ne soit ni séparé ni clivé par cette fonction de ruptures des espaces mais retrouve au contraire sa plasticité de surface aimantée et libre dans ces carrés de réels que sont les photographies, par les œuvres accrochées, comme un immense livre ouvert s’exposant à espace quasi ouvert, comme on pourrait écrire à ciel ouvert…. Il y a là, à mon sens, une sorte de citation, de rappel à Voltaire; Micromégas s’acquitte de son voyage swiftien à Liliput, dans une dimension non pas idéologique abstraite mais au contraire concrète et matérialiste, voire philosophique, quel ce héros par lequel on voit ce qui nous est montré, par quels regards est-on édifié, dans quelle sociabilité, amicalité, se trouve t-on réconcilié au sortir de l’exposition, sans doute parce que nous avons partagé à la fois ces réalités et la façon de pouvoir les photographier, en tant que traces de cette vie et en tant que document sociologique, voire dans une approche anthropologique socialement partageable.








« Ô atomes intelligents, dans qui l’Être éternel s’est plu à manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe : car, ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; c’est la véritable vie des esprits. Je n’ai vu nulle part le vrai bonheur ; mais il est ici, sans doute. » « Voltaire, Micromégas.
Revenu à cet espace culturel politique de la BPI, même à travers un certain pluri-culturalisme, voire aussi à se souvenir du projet encyclopédique des Lumières, Tillmans offre en signe de protestation et d’état des lieux, une résistance à cette dérive de l’époque actuelle: cohésion de l’Europe, effets de la mondialisation, canaux de diffusion de l’information, du Savoir, où la Démocratie souffre, comme le processus d’attaque des libertés fondamentales et de l’actualité dans la réduction des libertés par cette mondialisation, la puissance fascisante des oligarchies. La réfraction politique, l’interprétation qu’en donne Tillmans revient au geste juste du photographe, de sa réflexion globale sur ses pratiques et sur son vécu, dans un travail qui s’ancre aussi dans les corps, individués comme dans le corps social, voire ses scènes sociales..
D’ailleurs que dit-il de cet à propos du lieu gigantesque investi par son installation et son pouvoir d’attraction, en forme du titre donné à l’exposition; Tout nous y préparait, rien ne nous y préparait…
« Oui, et je voulais faire preuve d’un grand respect. Je ne voulais surtout pas que cela ressemble à “la bibliothèque déménage, l’art contemporain emménage”. J’ai donc imaginé plusieurs gestes en hommage à la BPI. L’un d’eux fut d’organiser une journée d’étude filmée, le dernier jour d’ouverture de la bibliothèque. J’adore la vision de ces centaines de personnes assises, travaillant ensemble dans le calme. Cet acte d’étude est, pour moi, une image magnifique. J’ai aussi transformé plusieurs des grandes tables de la bibliothèque en surfaces d’exposition et conservé deux rayonnages de quinze mètres de long, qui condensent l’ensemble de la collection de la BPI. Il y a des bureaux avec des moniteurs qui montrent des portraits de lecteurs, et aussi une installation laser jouant avec les tubes bleus du plafond que j’ai toujours aimée. » Réponse de Wolfgang Tillmans à la question « comment il a investi l’espace de la BPI ». https://www.vogue.fr/article/wolfgang-tillmans-exposition-photographie-centre-pompidou-paris-2025
Ceci est tout a fait surprenant , il s’agit des essais sur les chromies et les couleurs monochromes des tirages en partie compressés et traités comme des sculptures ou des objets en volume, trois dimensions, non plus comme de simples tirages à la surface plane, où des pliures de cette simple feuille en forme de goutte de couleur, si design, si pure que la forme ici, accomplit le geste dont elle est issue.

WOLFGANG TILLMANS AU CENTRE POMPIDOU, RIEN NE NOUS Y PRÉPARAIT TOUT NOUS Y PREPARAIT.
©PascalTherme2025
Le reportage photographique que j’ai réalisé donne à voir ces dialogues féconds entre un accrochage d’œuvres de différents formats, de petits formats jusqu’à des formats monumentaux, utilisant la hauteur sous plafond du centre, et la longueur des parois laissées à disposition ou, reformulées sans doute pour intégrer les neuf chapitres de l’exposition. La scénographie se révèle dans sa sobriété, généreuse, d’ une grande efficacité pour mettre en situation ou en scène ce travail entre l’espace historique architecturé par Piano et Rogers et l’exposition dans ces espaces re-configurés pour l’accueillir, dans et par leurs fonctions historiques de lieux des savoirs et de la connaissance, lieux de la conservation des documents et de leur archivage, lieu de l’exposition où, rien, ne semble devoir avoir été laissé au hasard. Il semble que Wolfgang Tillmans ait été très présent, depuis le début du projet jusqu’à sa touche finale de ce jeudi 12 Juin 2025.
Et pour en finir avec cette fascination « imbécile » de l’IA, Wolfgang Tillmans déclare par ailleurs: « On peut faire confiance à mon travail : tout ce qu’on y voit est né du fait que la lumière a touché une surface, un point. Et non pas que j’aie déplacé les pixels après coup. Pourquoi lorsqu’on, fait des images; de l’art, aurait-on besoin de l’IA? , je trouve ce monde déjà tellement intéressant, tellement fantastique, que je n’ai aucun attrait pour le traitement numérique, la manipulation, l’IA. »

WOLFGANG TILLMANS AU CENTRE POMPIDOU, RIEN NE NOUS Y PRÉPARAIT TOUT NOUS Y PREPARAIT.
REPORTAGE PHOTO SUR la BPI LES LIEUX MÊMES ET SUR LES ESPACES CRÉÉS DANS L’EXPOSITION PAR LA SCÉNOGRAPHIE
« Ces dernières années, Wolfgang Tillmans a fait l’objet de rétrospectives majeures dans de grandes institutions, notamment à la Tate Modern de Londres en 2017 et au MoMA de New York en 2022. Il a également présenté une importante exposition itinérante sur le continent africain intitulée « Fragile » (2018 − 2022 à Kinshasa, Nairobi, Johannesburg, Addis Ababa, Yaoundé, Accra, Abidjan, Lagos).
L’exposition au Centre Pompidou est la première monographie institutionnelle à Paris depuis son ambitieuse installation au Palais de Tokyo en 2002. Elle est accompagnée d’un catalogue et de la publication d’une version augmentée et traduite en français du Tillmans’ Reader, regroupant divers textes et entretiens de l’artiste. » https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/nSlcbMZ
Wolfgang Tillmans, Rien ne nous y préparait – Tout nous y préparait, au Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris), du 13 juin au 22 septembre 2025. L’entrée sera gratuite de 11h à 23h le 13 juin, le 3 juillet, le 28 août et le 22 septembre 2025, dans le cadre des journées “ACCÈS LIBRE par CELINE”
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-midis-de-culture/wolfgang-tillmans-photographe-pour-l-exposition-rien-ne-nous-y-preparait-tout-nous-y-preparait-7372510?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2025-06-18&at_position=3
Pascal Therme, le 30/06/2025
Quand Wolfgang Tillmans s'approprie l'architecture de la B.P.I.
24.06.2025 à 11:59
Inspirations pour l’été

Texte intégral (1749 mots)

Jordi Colomer : En la pampa

Billie Holiday à l’Olympia, 1958.

Thomas Gosset - L’ordre moins le pouvoir
L'air du temps
PNL - Au DD

Le haïku de dés
Monde de rosée
Rosée du monde
Et pourtant
Kobayashi Issa
L'éternel proverbe
Il faut répondre au diable dans la langue du diable.
Proverbe sanskrit

Les mots qui parlent (1)
Un danseur danse parce que son sang danse dans ses veines.
Anna Pavlova

Anna Pavlova et Laurent Novikoff, photographie Carlo Leonetti
Les mots qui parlent (2)
Les enfants montrent des cicatrices comme des médailles.
Les amants les utilisent comme des secrets à révéler.
Une cicatrice est ce qui se passe quand le mot est fait chair.
— Leonard Cohen

Old Ideas, LLC
19.06.2025 à 19:03
Régressons dans la joie avec les Feelies !

Texte intégral (728 mots)
Ce qui n'était au départ qu'un simple exercice numérique pour les rockeurs du New Jersey The Feelies est devenu une nouvelle compilation de certaines de leurs reprises les plus difficiles à trouver. Les héros du jangle pop sortent Rewind, un album de neuf titres comprenant des reprises de morceaux des Beatles (« She Said She Said », « Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey »), de Neil Young (« Barstool Blues », « Sedan Delivery »), de Bob Dylan (« Seven Days »), des Rolling Stones (« Paint It Black ») et bien d'autres.
La plupart ont été enregistrées pendant l'apogée du groupe dans les années 80 et au début des années 90, bien que « Seven Days » et une version de « Take It As It Comes » des Doors aient été enregistrées en 2016 et publiées deux ans plus tard sur un EP Record Store Day.
Rewind s'ouvre sur la reprise par le groupe de « Dancing Barefoot » de Patti Smith, qui a été le moteur initial de l'album. Au départ, les Feelies voulaient simplement rendre ce morceau, sorti en face B en 1988, disponible en version numérique, mais ils ont finalement décidé de compiler d'autres reprises issues de leurs archives, qui figuraient pour la plupart en face B et sur des EP. (« Me and My Monkey », qui met en vedette une formation antérieure avec la section rythmique composée du bassiste Keith DeNunzio et du regretté Anton Fier à la batterie, figurait sur le premier album du groupe, Crazy Rhythms, sorti en 1980.)
Le succès culte des Feelies dans les années 80 et au début des années 90 a donné lieu à une série d'albums célèbres sur les labels Stiff, Twin/Tone et A&M, dont The Good Earth en 1986, coproduit par Peter Buck de R.E.M. Pilier de la scène club des trois États jusqu'à sa dissolution en 1991, la formation la plus connue du groupe (le chanteur Glenn Mercer, le guitariste Bill Million, la bassiste Brenda Sauter, le batteur Stan Demeski et le percussionniste Dave Weckerman) s'est reformée en 2008. Depuis, ils ont sorti deux albums originaux, ainsi qu'un album hommage en 2023 à l'un de leurs principales influences, The Velvet Underground. Donc régressons dans la joie et dandinons-nous de concert avec ces nouveaux et crazy rhythms !
Jean-Pierre Simard, le 23/06/0/2025
The Feelies - Rewind - Bar-None Recorfs

19.06.2025 à 18:23
Festival New Beat(nick) perché au Moulin Blanchard 2/2

Texte intégral (2996 mots)
Le Festival Moulin Blanchard hors les murs se tient à Perche en Nocé et alentours jusqu’au 15 juillet. “Ce lieu patrimonial vernaculaire singulier abrite le cœur du Champ des Impossibles, ambitieux projet de développement du territoire par l’art et la culture qui inclut un festival d’art contemporain, des expositions, des rencontres, des concerts, des ateliers de pratique artistique, une artothèque récemment ouverte, ainsi qu’un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles pour l’aménagement des extérieurs.”

HORS LES MURS
Le festival se poursuit HORS LES MURS, avec l’exposition SOUND TRACK au Manoir de COURBOYER, parc naturel régional du perche. Les peintures d’Anton Hirschfeld, représenté par la galerie Christian Berst Art Brut, expriment, sous forme de triptyques, des variations sur un thème modal, Anton peignant plusieurs toiles à la fois en écoutant le concerto d’Aranjuez, Round Midnight de Miles Davis, I Fall in love too easily , You and the night and the music de Chet Baker, Back to black de Amy Whitehouse, le Köln Concert de Keith Jarett, I put a spell on you de Nina Simone. La grande attractivité de son travail pictural est un dialogue avec ces morceaux de jazz sélectionnés où les rythmes et la couleur jouent les formes, souvent très abstraites, comme des faisceaux de lumières ou des vitraux de cathédrale, quelque chose de très spécial a lieu entre la musique de Jazz et la peinture d’Anton, dans une sorte d’évènement, de happening, une réverbération d’un absolu revenu au centre des mouvements de l’âme, un langage commun s’articulant dans la physique même de la couleur et des formes autour de la vibration première de l’ Apollon sonore, source de la création… Avec les peintures d’Anton Hirschfeld, pastelliste, on peut paraphraser ces vers si connus de Rimbaud en écrivant, » c’est quoi l’éternité, c’est la musique de Miles et de Chet allée avec la peinture d’Anton... » quand quelque chose d’irrépressiblement haut s’exprime en retour des émotions vécues au plus profond de l’enchantement musical. Le travail D’Anton réjouit, réconforte, il s’anime à la lumière, imprégné du mouvement de cette physique de l’âme, inconnue et pourtant si vivante, ici, mouvements qui ont fait la joie des peintres les plus illustres tout au long de l’histoire de la peinture impressionniste et qui pétille ici dans les salles du manoir de Courboyer.
Un film a été réalisé sur son travail, Le Voyage d’Anton, diffusé récemment sur Arte, excellent film documentaire réalisé par Mariana Loupan.
Frédérique Founès et Madame Hirschfield présentent le travail d’Anton.

Pierre Amourette céramiques exposition Notre Dame de Courthioust, photos ©pascalTherme2025
L’église NOTRE DAME DE COURTHIOUST accueille l’exposition des céramiques de PIERRE AMOURETTE. Celui-ci s’exprime très largement sur son histoire et cette production enchanteresse, Art Singulier, Alchimie autour de la figure de la Reine, de la Vierge et l’enfant, des figures de la maternité, de la Grande Mère, GaÏa ou Isis, cette production est réjouissante et solaire même quand s’incarnent sous ses mains de terre des personnages ou des visions plus tourmentées. L’homme, instituteur hier, s’est vu entrainé dans cette aventure par une commande singulière, il y a plus de vingt ans. il se définit comme suit:
« je suis céramiste tripoteur de terre. Je travaille également d’autres matériaux: bois, pierre, fer, plâtre en fonction des projets qui me viennent à l’esprit ou des sollicitations. Si la terre s’est imposée à moi, c’est qu’elle me permet de travailler vite, d’aller directement à l’émotion. En effet, les céramiques créées se veulent être un média, une histoire que chacun peut interpréter à sa façon. »
« Depuis sa petite enfance, la nature l’attire ; escargots et lézards l’ont accompagné dans ses jeux favoris, aujourd’hui ce sont des animaux que l’on peut retrouver dans certaines de ses oeuvres. Dans la pierre d’abord, le bois ensuite et en ce moment à travers la céramique, il crée des personnages souvent ambivalents qui ne laissent pas indifférents. Une part importante de sa production porte sur la maternité, mais il crée également des jarres, assiettes, plats et parfois des animaux. Pour lui « ce n’est pas l’objet en lui-même qui est intéressant mais la mémoire d’un moment qu’il véhicule ». https://www.pierreamourette.fr/index.html
Son travail est régulièrement et largement exposé en France et en Europe.
Pierre Amourette s’explique Viva Voce de son œuvre en Notre Dame de Courthioust
Le Manoir de Lourmarin- Nocé reçoit deux expositions liées à l’Art Brut, dont les œuvres de Hubert Cherrey, né en Suisse, devenu ouvrier typographe, interné suite à une déception sentimentale irréparable, interné dans quatre établissements psychiatriques, dont Le Mans et Alençon. Dès qu’il fut interné, il ne cessa de s’exprimer, de dessiner et de peintre, …

Hubert Cherrey, Art Brut exposition du Manoir de Lormarin /Nocé. photos©PascalTherme2025
Le Manoir de Lourmarin- Nocé expose également une sélection d’œuvres des collections du Musée Saint Anne, assez remarquables. Faut-il rappeler que nous devons à Jean Dubuffet le terme d’ ART BRUT, regroupant les œuvres de personnes n’ayant aucune culture artistique, s’exprimant « naturellement ». Art libre, Art des fous, des marginaux, des reclus, bien souvent ces productions libres relatent une expérience plus directe, sans rapport esthétique revendiqué, dans un langage direct, dans une étroite relation avec la surface. Née de l’intuition de Jean Dubuffet, l’Art Brut bouscule les frontières de l’art conventionnel en valorisant les créations spontanées des marginaux, des autodidactes et des « fous », offrant ainsi une nouvelle perspective sur la beauté brute, détachée des normes académiques et sociales. La qualité esthétique des œuvres présentées est probante, magistrale, comme en témoignent les photographies ci-dessous.

collection du Muséee saint Anne au Manoir de Lormarin/Nocé, photos©pascalTherme2025
C’est également, par ce retour au prisme de la Beat Generation, en tant que tel, une mise en perspective de notre présent actuel inquiétant. Faut-il voir un message tout particulier dans cette programmation étoilée, ce retour du refoulé dans une actualité ô combien mortifère, une mise en exergue de ces Libertés et des mouvements culturels et artistiques qui en portent toujours l’éclat et la lumière; lampe d’Aladin, à frotter sans modération afin de faire surgir ce cantique quantique, baume de l’âme, de l’esprit et du corps en révolution, en rébellion, en recherche de ce qui compte vraiment créativement et collectivement, des productions qui se sont inscrites dans la chair du temps et qui continuent d’émettre au delà leurs fréquences rebelles, comme si, une radio encore branchée sur ces années continuait d’émettre ces slogans inscrits en filigrane des œuvres, ces injonctions à être, être libre, être soi même et s’insurger encore et toujours contre l’ordre établi quand il est porteur de guerres et d’injustices, du mensonge général de la soumission.
N’hésitez pas à passer une belle journée au cœur du Perche, avec la programmation étoilée du Moulin Blanchard IN et HORS les murs. Pour information les expositions hors les murs sont à moins d’un quart d’heure du Moulin Blanchard.
Quatre lieux d’expositions dans un petit rayon…

https://www.calameo.com/read/0073456241adc6e5a0bf9
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-moulin-blanchard/74372
Pascal Therme, le 23/06/2025
Festival New Beat(nick) perché au Moulin Blanchard 2/2
19.06.2025 à 18:00
Pu$h Thru, l'expérience latino aux USA en version rococo d'Yvette Mayorga

Texte intégral (1464 mots)
Connue pour ses peintures acryliques délicieuses, fleuries et parfois inquiétantes, réalisées à l'aide d'ustensiles de boulangerie, Yvette Mayorga rend hommage à sa mère, qui travaillait comme boulangère, et fait référence à l'art baroque et rococo tout en examinant de manière critique la famille, la communauté et les notions de prospérité.

La Ursupadora Not 4 Me” (2025), collage, textile, glitter, lamp shade, pen, electrical outlet, hoop earrings, shoes, jeans, marker, pastel, drawer handles, lampshade, ceramic, belt, felt, pastel, clock, stickers, gold flakes, gold foil, mirror, acrylic nails, textile, nail charms, TV control, and acrylic piping on canvas, 60 x 120 inches
Les œuvres de Mayorga sont « dominées par des nuances de rose afin d'examiner de manière critique le rêve américain et l'expérience latino-américaine, empruntant souvent des compositions à des photos personnelles et familiales ainsi qu'à l'histoire de l'art », explique la galerie Monique Meloche, qui présente une exposition solo de l'artiste.
Pu$h Thru, la première exposition de l'artiste avec la galerie et la première dans sa ville natale de Chicago depuis 2018, adopte une approche semi-autobiographique en réfléchissant à ses expériences au cours de la dernière décennie dans la ville. Au-delà de ses œuvres caractéristiques inspirées de la confiserie, elle a créé des compositions à grande échelle incorporant des objets trouvés tels que des abat-jours, des vêtements et des bijoux, ainsi que des morceaux de céramique, des pastels, des feuilles d'or, des ongles en acrylique, etc.

“W3 R TIR3D” (2025), collage, rhinestones, plastic butterflies, acrylic marker, pastel, silver foil, gold foil, pen, acrylic nails, car sticker, butterflies, glitter, gold flakes, silver flakes, textile, belt, rhinestones, nail charms and acrylic piping on canvas, 48 x 36 inches
Bon nombre de ces œuvres s'inspirent des souvenirs personnels de Mayorga, comme des instantanés de l'artiste enfant lors d'une fête d'anniversaire ou assise dans le salon familial. Convergeant avec l'esthétique et le style rococo romantique, comme les portraits inspirés d'Élisabeth Vigée Le Brun ou de Jean-Honoré Fragonard, l'artiste aborde le récit euro-centrique de l'histoire de l'art et son omission générale d'autres identités. Mayorga a même inventé un terme pour décrire son approche, Latinxoco , qui fusionne l'identité latinx avec l'esthétique rococo.
« Le rose, une couleur qui a une longue histoire dans la pratique de Mayorga, est utilisé comme une stratégie conceptuelle pour déstabiliser les idéaux occidentaux en matière de teint de peau, évoquant des questions de race, de classe et d'incarnation du genre, tout en faisant référence à l'esthétique cosmétique et domestique — une réappropriation ironique et radicale de la douceur comme force », explique la galerie.
Plus sur le site de l’artiste et son instagram
Kate Mothes pour Colossal, le 23/06/2025
Yvette Mayorga - Pu$h Thru -> 26/07/2025

“Self Portrait of the Artist After Élisabeth Louise Vigée Le Brun” (2025), textile, collage, stickers, gold flakes, silver flakes, pen, lace, buttons, acrylic nails, nail charms, and acrylic piping on canvas, 72 x 60 inches
19.06.2025 à 17:53
De l’éphémère durable, une vision pour faire barrage ?

Texte intégral (1823 mots)
Malgré les apparences, il ne faut pas désespérer de la politique. En témoigne un minuscule animal, l’éphémère, dont la présence sur la Seine est un signe de l’amélioration de la qualité de l’eau, ce qui tombe bien à l’heure où la baignade dans le fleuve est autorisée sur trois sites dès le 5 juillet 2025.

C’est Le Parisien (13/06) qui rapporte l’évènement : pour la première depuis des lustres, ce petit insecte préhistorique, aussi appelé mouche de mai, a été repéré entre la cathédrale Notre-Dame et l’Île-Saint-Louis. Un miracle ? « La mouche de mai est une espèce extrêmement sensible à la pollution qui vit habituellement dans les rivières les plus propres », explique le biophysicien Bill François qui a fait la découverte. « Ce qui est encore plus rassurant est de savoir que cette mouche est bien née dans la Seine et qu’elle n’a pas été poussée par le vent », précise-t-il. L’occasion d’apprendre que la présence sur terre de cet insecte est attestée depuis 300 millions d’années avant les dinosaures et qu’il fut, pour tout dire, le tout premier animal à voler. « Partout en France, on voit les eaux se dégrader, la Seine est le seul contre-exemple », souligne le scientifique.
La naissance de cet éphémère n’est pas une anecdote. Il n’y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour se souvenir de la Seine comme d’un cloaque. Une situation si malodorante pour une ville lumière que Jacques Chirac, alors maire de Paris, promet en 1988 de rendre à nouveau le fleuve propre à la baignade et de le prouver en nageant dans la Seine. Une promesse non tenue ? Voire… Certes il ne s’y baigna jamais et il fallut près de quarante ans pour que quiconque s’y risquât, jusqu’aux jeux olympiques de 2024 et qu’une ministre et une maire tombe ou se jette à l’eau. Personne n’est mort. Donc, autorisée la baignade. Les pêcheurs s’en félicitent qui trouvent dans l’eau du bain 36 espèces de poissons en 2024 contre 14 en 1990.
En vérité, la boutade de Chirac a enclenché une dynamique conjointe de l’État et de la Ville de Paris à tel point que le credo fut ensuite repris sans discontinuer par les maires suivants, de Bertrand Delanoë à Anne Hidalgo. En 2002, le premier met en place l’opération Paris Plages, pas question donc de s’y asphyxier ou attraper des boutons…
En 2015, un grand plan d’amélioration de la qualité de l’eau de la Seine et de la Marne « pour atteindre les niveaux requis pour autoriser la baignade » est engagé par la seconde avec l’État et ses opérateurs, les collectivités franciliennes et les acteurs de l’assainissement. Quatre grandes priorités sont établies pour la baignade grand public : l’amélioration des processus de traitement des stations d’épuration pour renforcer encore la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, la résorption des mauvais branchements, la réduction des rejets des eaux non traitées en cas de pluie et le raccordement des bateaux aux réseaux d’assainissements.
Rien de très sexy en apparence mais rien qui ne fasse du mal à la nature ou à l’économie, au contraire ! De fait, avec les Jeux olympiques en guise d’accélérateur des bonnes volontés, six ouvrages d’assainissement ou bassins de rétention ont été construits, dont le VL 8, un collecteur de grande capacité d’une longueur de 10 kilomètres situé entre Essonne et Val-de-Marne.
De plus, pour en arriver là – aller se baigner à Paris sans autre danger que la noyade – il a fallu pour l’État, la Ville de Paris et nombre de collectivités locales en amont et en aval engager des chantiers colossaux qui se comptent ensemble en milliards d’euros et se déploient bien au-delà du centre de Paris, qu’il s’agisse du traitement des eaux ou de leur gestion, en aval comme en amont.
En témoigne en amont le barrage mobile de Vives Eaux (Seine-et-Marne) qui régule depuis 1928 les niveaux amont et aval du fleuve pour assurer sa navigation.* Exemple parmi de nombreux autres des ouvrages qui concourent à l’amélioration de la qualité de l’eau, il a été entièrement reconstruit et modernisé en 2018 pour 40 M€. Destiné à la sécurité de la gestion hydraulique au service de la navigation fluviale, il a d’autres vertus quant à l’usage de l’eau (eau potable, industries…), tout en améliorant les conditions de travail des agents d’exploitation. L’ouvrage est équipé d’une passe à poissons et d’une nouvelle passerelle publique reliant les villages des deux rives de la Seine, un point de vue devenu très couru. Bref, un investissement qui a atteint son objectif pour les prochaines décades.
« Au-delà de sa finalité fonctionnelle et technique, la reconstruction de ce barrage a fourni l’occasion d’une requalification générale du site naturel sensible de la vallée de la Seine où il s’implante », souligne ainsi Luc Weizmann (LWA) qui en signe l’architecture. « De par son dessin-même, le nouvel équipement intègre une valeur symbolique et devient un ‘ouvrage d’art’ au sens noble du terme. La nouvelle circulation publique sur la passerelle, à l’aplomb de la chute d’eau, forme à ce titre un élément précieux de valorisation de l’environnement », poursuit l’architecte. Ecologie en tout point positive donc, même si le barrage est coulé en béton… Et preuve en est qu’il y a de la place pour l’architecture !
En témoigne en aval la capacité des unités de traitement biologiques de l’usine d’épuration d’Achères Seine-Aval (Yvelines). Réalisées par LWA et LELLI Architectes et mises en service en novembre 2017, leur débit est égal à la moitié de celui de la Marne. Le chantier, gigantesque, a compté jusqu’à 1 200 personnes en même temps et duré 50 mois pour un coût de 777 M€. Ecologie punitive, vraiment ?
Ces exemples parmi d’autre prouvent qu’avec une approche globale, c’est tout le territoire jusqu’à Rouen qui bénéficie aujourd’hui d’une eau de la Seine somme toute de bonne qualité, pas seulement les bobos baigneurs parisiens. Sans même parler ici des vastes bassins naturels désormais préservés pour anticiper les inondations dans la capitale et ailleurs.
Il convient toutefois de noter que tout cet effort, au-delà de ses vertus écologiques et républicaines – gouverner, c’est prévoir – semble avoir en l’occurrence été pensé pour un usage de loisirs. Pour espérer un océan propre et accepter l’investissement nécessaire au ménage, faut-il que toute la croisière s’amuse ?
Comme l’indique Bill François, le biophysicien, partout en France les eaux se dégradent, sauf pour la Seine. C’est qu’ailleurs, ça ne rigole pas ! Pourtant il est possible, d’évidence, d’améliorer la qualité des eaux de nos rivières et de l’environnement qui leur est attaché quasiment sans même que nous nous en apercevions !
En tout cas, quoi qu’en disent les politiciens sans imagination, investir pour le bien du pays, en respectant l’environnement, avec des résultats économiquement, socialement et écologiquement certifiés durables, c’est possible, certes sur le temps long. Cette réussite est visible également avec les toutes nouvelles stations de métro et gares du Grand Paris. Les J.O. en sont une nouvelle démonstration, qui ont rapporté plus qu’ils ont coûté ! Mener à bien des projets utiles, c’est possible !
Que manque-t-il donc aujourd’hui à ce pays qu’il se retrouve empêtré à ce point entre petites autoroutes mesquines et privées et grandes bassines pour faire sécher l’eau du sous-sol, le niveau zéro de la pensée à l’échelle du territoire ? Bonjour l’ambition ! Il y a pourtant la place pour d’autres perspectives… A moins évidemment qu’un costume trop grand…
Pour autant, il ne faut pas désespérer de la politique. Après tout, pour la baignade dans la Seine, il s’en est fallu, il y a quarante ans ou presque, d’une promesse en l’air de l’impétueux Jacques Chirac qui – fait rare – a engagé toutes celles et ceux qui l’ont reçue.
Christophe Leray, le 23/06/2025
*Lire Le barrage passerelle de Luc Weizmann ou l’élégance de l’ouvrage d’art
19.06.2025 à 17:43
Chez Catherine Putman on évoque le silence pour l'été

Texte intégral (975 mots)
Si certaines œuvres sont évocatrices d’un silence synonyme de calme, de vide, ou de contemplation, on se plaît alors à leur trouver des correspondances visuelles. Entre apaisement et angoisse ; le silence est polysémique et par là même, ses symboliques et ses images deviennent multiples.

photo de Rebecca Fanuele
Il évoque la concentration du créateur et se traduit par une forme d’épure et de radicalité dans l’œuvre qui en résulte. Il en va ainsi des abstractions bleutées de Geneviève Asse, d’une série de paysages des îles Féroés, saisis sur le vif à la pointe sèche sur zinc, par le danois Per Kirkeby, ou d’un ciel de papier teinté à l’indigo d’Éloïse Van der Heyden. Il devient onirique avec la machine à écouter le silence imaginée par Bernard Moninot dans son travail intitulé Silent Listen. Un blanc est un silence, il pourrait être sa couleur, comme l’illustre l’œuvre de Dana Cojbuc Trace de silence matérialisée dans l’image par une traînée de farine blanche dans un paysage carbonisé.

photo de Rebecca Fanuele
Le silence est dans le sommeil du Dormeur d’Éloïse Van der Heyden, ou dans la solitude de la silhouette qui s’aventure de nuit dans une eau marécageuse du dessin de Frédéric Poincelet. Il est l’absence de présence vivante dans une salle aux chaises vides dessinée par le même artiste ou sur le mur usé d’une maison de famille photographié par Sophie Ristelhueber.
Faire silence, c’est aussi se taire ou faire taire, Frédéric Malette a choisi pour titre d’une série de dessins Les Cris silencieux, pour traduire l’impuissance des cris de souffrance passés et présents.
JIm Pinceau-Velu le 23/06/2025
Collectif - Silence -> 11/07/2025
Galerie Catherine Putman 40, rue Quincampoix 75004 Pariis
19.06.2025 à 13:03
« J’essaie d’imaginer un énorme mensonge. C’est le départ de toutes mes histoires, mais il faut que le mensonge soit intéressant. » Naoki Urasawa invité d’honneur à Amiens

Texte intégral (5261 mots)
Le mangaka qui signe l’affiche de la 29e édition des rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens est à l’honneur jusqu’au 22 juin avec deux expositions différentes accessibles gratuitement. On vous propose un triple entretien croisé avec Naoki Urasawa, mais aussi Anthony Pardi commissaire principal de l’expo « Naoki Urasawa auteur en série » et Stéphane Jarno, commissaire de l’expo « Naoki Urasawa, un talent monstre ».

La semaine dernière, je vous ai proposé une interview de Sophie Mille, la directrice des rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens pour découvrir les coulisses de ce festival qui court jusqu’à ce week-end du 21 & 22 juin. Aujourd’hui focus sur son invité d’honneur que j’ai pu rencontrer avec mes collègues dans un cadre intimiste avec nos questions collectives, une occasion de mieux comprendre son processus créatif, mais également son quotidien ou avoir une idée de ses futurs projets.
En parallèle, j’ai pu aller à la rencontre des deux commissaires d’exposition qui proposent deux lectures de l’œuvre de Naoki Urasawa pour la faire découvrir au plus grand nombre. Je vous propose quelques morceaux choisis.
Quand on demande à Anthony Pardi, chargé de mission manga auprès du festival, depuis combien de temps ils prévoient cette exposition, il explique avec enthousiasme que « Ça fait quasiment 4 ans qu’on a commencé a entamé les premiers échanges avec Kana, mais c’est une idée qui est là depuis des années. » Mais aussi sur le choix de ce mangaka en particulier « C’est une icône dans le milieu du manga. À Amiens, on commence à peine à faire du manga, on a eu quelques projets comme Les Carnets de l’apothicaire, Blue Giant, Haikyu, mais c’était à la marge et on voulait taper un grand coup avec un auteur patrimonial.
C’est aussi parce que notre public n’est pas encore assez connaisseur de ce médium-là, on s’est dit autant faire quelqu’un qui est assez européen dans sa création, dans son découpage. C’est une très bonne porte d’entrée pour les personnes qui ont vraiment des stéréotypes en tête comme “le manga c’est de la baston et des gens qui crient”. Eh bien non ! C’est aussi pour ça qu’on a fait venir Naoki Urasawa : on amène doucement le public vers des expositions mangas chaque année. Et concrétiser cette expo avec en plus avec sa venue, c’est quelque chose d’assez fou, c’est un petit miracle, on va pas se mentir. »

Au coeur de l’expo Naoki Urasawa à la Maison de la Culture d’Amiens / Photo ©Thomas Mourier
Deux expositions ?
La proposition est surprenante, deux expositions dans deux lieux différents autour d’un même auteur, mais quand on demande à Anthony Pardi si l’idée est de croiser les publics, il confirme « Exactement ! On travaille avec la Maison de la culture sur des expositions BD depuis 4-5 ans de mémoire et Laurent Dréano, le directeur de la Maison de la culture, qui a aussi une appétence pour le travail de Naoki Urasawa. Ils se sont très vite mis dans le projet et on a essayé de créer un lien entre eux et nous. »
L’exposition « Naoki Urasawa auteur en série » présente plusieurs œuvres dans une scénographie immersive, avec une pièce maîtresse autour d’Asadora! qui met en scène la créature, l’avion d’Asa pour présenter des reproductions de planches ou encore une double pièce dédiée à Monster avec un tableau de suspect géant. À la Maison de la culture, l’expo « Naoki Urasawa, un talent monstre » se concentre elle sur 2 œuvres 20th Century Boy et Monster dans une scénographie plus épurée qui présente des agrandissements de cases en regard des pages.
Stéphane Jarno, commissaire de l’expo « Naoki Urasawa, un talent monstre », nous parle de la visite du dessinateur « Quand Naoki Urasawa a visité l’exposition hier soir, il était comme un enfant : quand on est dessinateur voir ses créations en 2D en volume devant soi, ça fait un choc. » Le monstre sans nom en version physique ouvre l’exposition avant de passer aux agrandissements de cases, Stéphane Jarno poursuit « Pour le choix des visuels, l’idée était de trouver des scènes qui montrent des aspects de la personnalité de chaque personnage, mais aussi des scènes d’anthologie. »
Pourtant dans les deux cas, pas de planches originales. Anthony Pardi précise « La politique de Shôgakukan est très stricte sur la sortie d’originaux hors du Japon. Ce sont des trésors nationaux, surtout Naoki Urasawa, qui est considéré là-bas comme un des plus grands mangakas.
On est un peu des bébés dans le manga game, pour parler très cru. Donc, forcément, on a moins la confiance que peuvent avoir Angoulême par exemple qui ont 3 expos manga avec des originaux. On n’est pas encore à leur niveau, mais on essaye petit à petit d’y arriver : ça va être des voyages au Japon dans le futur pour se présenter, montrer ce que l’on a fait et potentiellement négocier pour avoir des planches originales.
Tout Shôgakukan a vu l’exposition en 2D par échange de mail en amont. Du coup, on s’est lâché sur la scénographie, parce que c’est un peu ce qui nous caractérise en tant que festival et aussi parce sans originaux, on n’a pas la facilité de la planche. On a des reproductions qui sont certes magnifiques, mais c’est moins l’impact d’un original donc forcément, on s’acharne encore plus sur la scénographie pour rendre le truc très immersif. »

Au coeur de l’expo Naoki Urasawa à la Halle / Photo ©Thomas Mourier
L’instant où tout bascule… dans les coulisses d’une œuvre
Dans l’exposition Naoki Urasawa, un talent monstre », on rentre par les personnages, la scénographie dévoile les protagonistes de Monster et de 20th Century Boys comme points d’accroche. On y voit dès l’entrée, le combat entre Kenzō Tenma & Johann puis au loin un robot géant, sorti de 20th Century Boys.
Interrogé sur les personnages, le mangaka explique que pour lui : « L’antagoniste est plus important que le protagoniste. Je suis en train d’explorer encore, mais je me dit que le personnage principal est peut-être le personnage le moins intéressant parmi tous —c’est peut-être pour cela que je n’aime pas le personnage de Tenma— en tout cas mes personnages secondaires ont plus de caractères et de personnalité. »
Pour Stéphane Jarno, 20th Century Boys marque un tournant dans son œuvre, un moment de bascule : « À partir de 20th Century Boys, il s’autorise des choses qu’il n’a pas pu faire dans Yawara, Pineapple Army ou Master Keaton. Dans ses témoignages 20th Century Boys ça né d’une vision : il s’endort dans son bain —c’est comme ça qu’il le raconte— et il a une vision d’une scène qu’il y a dans 20th Century Boys où Ami et ses sbires sont accueillis à l’ONU comme des amis de l’humanité. Il a ce flash et il envoie tout de suite un mot à son éditeur pour lui dire “j’ai une idée” alors qu’il voulait justement lever le pied parce qu’il avait trop bossé. C’est sans doute une césure dans son œuvre. »
Quand on demande à Stéphane Jarno pourquoi il y a peu de textes d’accompagnement dans l’exposition pour prolonger ces réflexions, il répond que Naoki Urasawa « se méfie beaucoup des commentaires et des analyses sur son œuvre » et du coup « ça faisait partie du cahier des charges. »
L’auteur s’est prêté en échange aux interviews et dévoile qu’il a « l’impression de faire des œuvres humoristiques, mais que les gens ne le croient pas. Je parle de drame humain, et l’humour en fait partie comme le mystère, le suspens et le polar. Je vends toujours Monster comme une œuvre d’humour et personne ne me croit. »
Plutôt qu’un regard ou des interprétations sur son travail, le mangaka explique comment il travaille, expliquant pourquoi certaines œuvres sont plus complexes que ce qu’il avait imaginé à la base : « Quand je commence une histoire, j’ai déjà l’idée jusqu’à la fin, j’ai une image assez précise de la fin, mais au fur et à mesure que j’avance : la narration évolue, les personnages évoluent et moi-même en tant qu’auteur j’évolue aussi. Et c’est pour cela que l’intrigue évolue et que finalement la fin n’a rien à voir avec ce que j’avais conçu au début. »
À propos de sa méthode de travail, il a expliqué comment il se documente et construit ses intrigues en prenant l’exemple d’Asadora!, sa série en cours : « Avant tout, j’essaie d’imaginer un énorme mensonge. C’est le départ de toutes mes histoires, mais il faut que le mensonge soit intéressant : je commence à ajouter des éléments de réalisme pour donner corps à ce mensonge.
“Pour Asadora!, je voulais parler de l’histoire d’une pilote et je me suis renseigné et j’ai compris que c’est à l’âge de 17 ans que l’on peut avoir sa licence de pilote. À partir de cette idée, j’ai cherché quels sont les moments importants dans l’histoire du Japon et c’est là que j’ai trouvé le grand typhon de 1959 dans la baie de Ise — je suis né en 1960, donc cet événement a eu lieu 1 an avant ma naissance et quand j’étais petit ma mère me parlait de ce typhon dévastateur. Asa avait 12 ans en 1959, et je trouvais intéressant de raconter la vie de cette femme avec ce contexte historique.
Je me suis aussi renseigné sur les façons de piloter les avions et j’ai même rencontré un pilote qui avait plus de 100 ans et j’ai beaucoup appris grâce à lui. J’ai rencontré un biologiste pour savoir si la chose pourrait exister réellement et il m’a confirmé que ce n’était pas possible.”

Un artiste en haut de l’affiche
À Amiens, Naoki Urasawa a donné un concert dessiné où il a interprété ses chansons, dont certaines inédites, d’autres avec des paroles en français et en anglais, en s’accompagnant au dessin pour en illustrer les thèmes. En parallèle de ses mangas, il a sorti deux albums et se produit sur scène, seul ou avec son groupe.
Dans l’exposition “Naoki Urasawa, un talent monstre”, on peut découvrir une partie dédiée à la musique, avec aussi bien ses disques que des planches dédiées aux musiciens, ses carnets de bords et ses chansons. Stéphane Jarno détaille “Quand il dessine, il peut avoir une idée musicale, il s’arrête, prend sa guitare et enregistre ou alors quand il joue, il a une image qui vient. Il y a parfois des allers-retours, il ne dissocie pas, dans sa création, le dessin et la musique.”
À ce propos, Naoki Urasawa revient sur cette distinction, “Dans 20th Century Boys, il y a la chanson Bob Lennon qui sert à la narration, mais je ne cherche pas à mettre des chansons dans mes mangas.” Les deux disciplines se répondent, mais ne parasitent pas. “Par contre, il ne dessine pas en musique, il est concentré” rajoute Stéphane Jarno.
Les rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens lui ont confié la réalisation de l’affiche, une proposition qu’il a acceptée très vite, “ce qui est un peu fou” comme l’explique Anthony Pardi “Le fait qu’il ait représenté tout Amiens aussi est un peu fou, elle marche très bien.
On fournit un cahier des charges aux auteurs, autrices pressenties pour faire l’affiche de la future édition et pour Urasawa sensei, on a fait la liste de tous les endroits d’Amiens qui peuvent être sur l’affiche. Et finalement il a fait un mix de tout ça pour nous faire une planche de BD avec tous les éléments cités dans le cahier des charges.
On était assez surpris, mais assez heureux de se dire que cette affiche marche très bien, même pour la ville. En communication pure et dure, pour la ville, c’est cool de montrer plein de spots différents d’Amiens avec en plus des personnages iconiques d’Urasawa.”

Au coeur de l’expo Naoki Urasawa à la Halle / Photo ©Thomas Mourier
Un auteur au sommet, qui a su prendre du recul
En fin d’entretien, Naoki Urasawa nous explique qu’il a “travaillé en parallèle sur 2 séries pendant 20 ans. Avec une série dans un magazine hebdomadaire et l’autre série qui sortait toutes les deux semaines. Et donc j’avais des deadlines 6 fois par mois, je dessinais entre 130 et 140 pages par mois. Quand je repense à cette période, je me dis que c’était un véritable enfer.
Je vous invite à imaginer les conditions de cette vie, d’habitude on se dit je vais finir cette semaine et je vais me reposer. Pendant 20 ans, aucune pause, quand je regarde à l’horizon ce ne sont que des dates de rendu qui continuent éternellement et je me dis heureusement que j’ai pu survivre à cette période.
À ce moment-là, je pensais à Osamu Tezuka qui dessinait entre 500 et 600 pages par mois, le chiffre était incomparable : moi 140 et lui 600 pages par mois. Sa vie a été courte, il est mort à l’âge de 60 ans et moi je me suis dit non, je ne vis pas comme ça.”
À 65 ans le mangaka a pris du recul sur cette figure de mentor —après un très bel hommage Pluto— et explique son envie de traiter de nombreux sujets en manga, et dévoile qu’après Asadora ! [toujours en cours de publication] il aimerait “traiter le manga de samurai avec un angle et une approche nouvelle.”
Et on sera au rendez-vous !
D’ici là, vous avez de quoi faire avec cette double expo mais également les dernières parutions comme Jigorô ou Asadora ! T9 qui viennent de sortir en juin.
Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur le site de l’événement.
💡 Infos pratiques
Festival Gratuit
Ouvert de 10h à 18h les 3 week-ends de juin :
7 & 8 JUIN WEEK-END D’OUVERTURE (70 artistes invités)
14 & 15 JUIN WEEK-END MUSÉAL
21 & 22 JUIN WEEK-END DE CLÔTURE (60 artistes invités)📍 Halle Freyssinet, Rue de la Vallée, 80000 Amiens
-> les liens renvoient sur le site Bubble pour se procurer les ouvrages évoqués
Image principale : au cœur de l’expo Naoki Urasawa à la Maison de la Culture d’Amiens / Photo ©Thomas Mourier
Thomas Mourier, le 23/06/2025
Naoki Urasawa invité d’honneur à Amiens

Le mangaka en rencontre avec les journalistes / Photo ©Thomas Mourier
19.06.2025 à 12:58
Space opera en Acadie, fun à tout point de vue

Texte intégral (3561 mots)
Très drôle et formidablement rusée, une novella de space opera transhumaniste conduite à quelques trains d’enfer pour démontrer avec éclat qu’en matière de récit, tout est encore et toujours affaire de point de vue.

Je hais la chute libre. Il a fallu au moins dix ans et plusieurs réglages minutieux de la part des Écrivains pour me faire surmonter la nausée et la terreur de m’écraser au sol, mais je n’arrive pas à m’y faire. Je déteste tout autant voler. Quand on regarde les Gamins, ça a l’air facile, élégant. Mais c’est en fait bigrement corsé et je n’ai jamais pris le coup. Un de mes premiers gestes en tant que Président a été d’inciter la Trésorerie à construire un monorail dans quelques-uns des habitats les plus vastes, et à légaliser les jet packs individuels dans chacun d’entre eux. Sauf que le conseil a opposé son veto. Je suis peut-être Président, mais le Conseil ne me prête aucune attention, à moins que quelque chose ne tourne mal.
L’hôtel de ville se situe près du centre de l’habitat, niché au cœur d’un énorme massif de kudzu. J’atterris tant bien que mal sur la terrasse couverte, retire ma combi et entre.
Comme à peu près tous les autres bâtiments de la Colonie, l’hôtel de ville est un polype de construction sphérique. C’est aussi la plus grosse et la plus ancienne structure du coin : une boule nacrée et noueuse de la taille d’un paquebot. Assez vaste pour faire office de pièce de survie pour toute la population de l’habitat en cas de désastre de très, très grande ampleur, elle n’en est pas moins pratiquement vide la plupart du temps, peuplée par des équipes d’administrateurs, d’ingénieurs et de techniciens réduites au minimum.
Elle abrite aussi mon bureau, et il n’y a pas de quoi se vanter. Je n’y ai passé plus de cinquante minutes depuis le début de mon mandat, huit mois plus tôt, et en toute honnêteté, je serais incapable d’y mener quiconque à travers les tunnels sinueux de l’hôtel de ville.
Fort heureusement, je ne me rends pas à mon bureau. Je vais au Bureau, plus facile à trouver, car bien plus grand et situé en plein cœur de la structure. Je constate en sortant du tunnel qu’il est rempli de gens visiblement nerveux discutant à voix basse devant leurs écrans, leurs plans de travail et les infofiches.
« Joyeux anniversaire ! me lance Connie alors que je flotte vers elle.
– Hum. Bon, qu’est-ce qu’on a ?
– Un appareil ennemi. » Elle désigne une grande infofiche à l’autre bout de la salle : on y voit un fond noir incommensurable au milieu duquel dérive une sonde. Celle-ci mesure environ quinze mètres de long pour cinq de large, un cylindre blanc cassé portant les lettres AC peintes sur un de ses flancs. À une extrémité, un bon gros bouclier antimétéores conique en glace centrifugée ; à l’autre, la mince cloche de la tuyère propulsive d’un réacteur à fission à haut rendement. Entre les deux, on aperçoit le paysage grumeleux et désordonné des radômes du moteur à hyperpropulsion, des nacelles de capteurs et des microtuyères à fusion. Concept relativement simple, fabrication peu onéreuse ; l’Agence de la Colonisation en assemble des centaines chaque année et les envoie en mission de survol rapide vers les systèmes planétaires inexplorés. Je sens mon cœur se serrer.
« Pas un rocher, donc, insiste Connie.
– Pas un rocher », je confirme avant de pousser un juron. « D’où vient cette image ? »
Elle me répond. Je jure de nouveau. Et pas qu’un peu.

Fondée par des scientifiques en rupture de ban d’États-Unis réactionnaires et théocratiques, la Colonie vit depuis cinq cents ans en secret, à bord de dizaines d’habitats spatiaux construits à partir du vaisseau de colonisation volé pour fuir la Terre et la colère des services spéciaux américains, installée loin, très loin, des routes spatiales commerciales et des missions coloniales d’exploration. Mais l’Agence Coloniale, qui a la mémoire longue, continue sa traque imperturbable, arrosant l’univers connu et inconnu de ses sondes automatisées. Bien que bénéficiant des technologies ultra-avancées développées au fil du temps par ses scientifiques d’origine (les « Écrivains ») et par leurs créations génétiques aux intelligences résolument hors normes (les « Gamins »), l’utopie réalisée hors des sentiers battus doit rester vigilante. Lorsqu’une sonde se présente par surprise quasiment aux portes de la Colonie, détectée beaucoup trop tardivement pour être neutralisée efficacement, c’est à Duke, le président élu par cette meute d’hédonistes surdoués et farceurs, élu précisément parce qu’il paraissait afficher, de toutes et tous, le plus de désintérêt pour la politique, qu’il revient de gérer la pire crise que cette population persécutée (le clin d’œil du titre à l’authentique Acadie canadienne vous éclairera a posteriori sur les nombreuses ruses malicieusement disséminées dans le choix des noms propres tout au long du texte) ait eu à gérer depuis sa création.
La Colonie ne possède pas de gouvernement en tant que tel. Chaque habitat élit annuellement le représentant d’une sorte de vague corps consultatif dont le but est de s’assurer que la machine fonctionne sans heurts. D’après le principe voulant qu’on ne peut décemment pas confier le pouvoir politique aux personnes qui le recherchent, les seuls membres admis au sein de ce collectif sont ceux qui ne désirent absolument pas en faire partie. Comme ça vaut pour à peu près tout le monde, les deux ou trois mois précédant les élections voient généralement s’orchestrer une avalanche de campagnes guignolesques à l’enthousiasme suffisant pour disqualifier le moindre candidat. J’ai moi-même mené de belles campagnes par le passé, et j’ai longtemps réussi à esquiver le tir, mais je me trouvais hors-système lors du dernier suffrage, occupé à ramener quelqu’un jusqu’à Nova California. Les autres y ont vu le signe d’un désintérêt envers la politique, et à mon retour, j’ai découvert que non seulement j’avais été élu, mais que les sales fourbes avaient interprété mon absence comme la preuve que je n’en avais vraiment rien à battre, aussi m’avaient-ils carrément nommé Président.
Ce mandat n’accorde en réalité que très peu de pouvoir. En revanche, il entraîne pas mal de responsabilités, notamment en cas de situation si problématique que tout le monde s’efforce de refiler la patate chaude au premier venu. Or le premier venu, c’est moi, et ce pour les trois ans et demi à venir environ. Président de la Colonie : le type qui se tape le boulot que personne d’autre n’a la volonté ou la patience de faire et prend les décisions merdiques que personne ne veut assumer.

Relativement peu connu en dehors des cercles d’initiées, et jamais traduit en français jusqu’ici, le Britannique Dave Hutchinson (qui, homme de goût s’il en est, confie en entretien que c’est le grand « Pavane » de Keith Roberts qui l’a le plus influencé dans la définition de ce qu’il souhaitait réaliser en tant qu’écrivain), mérite toute notre attention, au vu de cette novella de 2017, traduite par Mathieu Prioux en 2019 dans la collection Une Heure-Lumière du Bélial’. En dehors de ce qui a déjà été écrit plus haut, je me garderai bien d’éclairer la fin de cette novella construisant elle aussi (la parenté de sa thématique apparente avec celles familières aux lectrices et lecteurs d’Alastair Reynolds ne saurait être totalement fortuite) un espace de la révélation. En se laissant porter par un humour geek et même potache – qui n’a pourtant absolument rien de gratuit ici -, on découvrira dans les derniers mètres l’un de ces retournements dont la grande fiction peut avoir le secret, nous rappelant avec l’art mêlé d’un Henry James et d’un Iain Banks que petits récits et grande Histoire naissent d’abord et avant tout d’un point de vue – et que c’est à ses risques et périls (ou pour la profonde joie du twist) que la lectrice ou le lecteur l’ignoreraient.
Le Conseil est composé d’elfes, de nains, de hobbits, de gobelins et de Dieu seul sait quoi d’autre. Je n’ai pas lu les bons livres ni vu les bons films pour tous les reconnaître, mais j’aperçois aussi quantité de klingons. Assister à une réunion du Conseil revient à participer à un concours de cosplay. Après avoir fondé la Colonie, les Écrivains ont voulu s’amuser un peu… Et si pour ça il leur faut se réécrire en personnages de la culture populaire de la fin du vingtième siècle, je n’ai rien à y redire. En général, ils laissent la Colonie se gérer toute seule, du coup, mes contacts avec eux sont limités. Malheureusement, il y a parfois des cas où la décision finale leur revient ; après tout, ils restent les Fondateurs. Je suis venu ici à quatre ou cinq reprises durant ma présidence – bien que la situation n’ait jamais été si sérieuse -, et chaque fois c’était comme faire un exposé devant une salle remplie de toons.
Le stade où se tient l’assemblée est une vaste dépression herbeuse entourée d’arbres. Il y a d’un côté un petit monticule avec au sommet un podium rustique en bois et je suis planté là, une énorme infofiche dans mon dos pour l’aspect audiovisuel, à leur faire mon topo. Je leur montre les images de la sonde, leur raconte ce qu’Ernie a fait, l’échec apparent de la ligne d’alerte, ainsi que mon évaluation de la situation. J’expose mes arguments aussi clairement qu’il est possible de le faire devant une foule compacte d’elfes, de loups-garous, d’orcs, de vampires, de goules, de zombies, de Jedi, de plusieurs copies de Tom et Jerry, d’Itchy et Scratchy, de Bip-Bip et de Coyote, d’assortiments de super-héros, d’innombrables Darth Vador et d’au moins deux lions colossaux. Histoire de préserver ma santé mentale autant que ma dignité, je garde les yeux fixés au sol et parle rapidement.
« J’estime, dis-je pour conclure, que cette sonde représente un danger manifeste et immédiat. D’une façon ou d’une autre, elle a traversé la ligne d’alerte, donc soit celle-ci est défectueuse – et là-dessus, notre enquête est toujours en cours -, soit la sonde a été conçue pour infiltrer des systèmes dotés de périmètres de défense passifs, ce qui me donne à penser qu’elle était à notre recherche. » Je lève les yeux, me demande pour la énième fois qui pourrait bien se réécrire en zombie. Je prends une grande inspiration.
« Vous avez examiné la sonde ? » demande un Wolverine.
Je soupire. Il y en a toujours un… « Comme je l’ai déjà évoqué, rappelé-je au public, la sonde est une épave. Son réacteur principal l’a rendue prodigieusement radioactive. À tel point que, dans d’autres circonstances, je vous recommanderais de porter plainte contre l’Agence pour l’avoir balancée dans notre système. »
Silence… Exigeant comme public. Les Écrivains adorent les blagues, tant que ce sont eux qui les font.
Hugues Charybde, le 23/06/2025
Dave Hutchinson - Acadie - éditions Le Bélial
L’acheter chez Charybde, ici

15.06.2025 à 13:47
Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force et son nouveau Khadim

Texte intégral (1161 mots)
Qui se souvient des boitiers en alu qui contenaient les productions de Basic Channel, le label berlinois de Moritz von Oswald et Mark Ernestus ? Ces pépites dub techno qui se brisaient au moindre effort d’ouverture forcée ? Quand vous arriviez à les ouvrir, le jeu consistait à découvrir le dub présent enfoui sous des tonnes de bruit et de crachements. Mais une fois l’oreille faite, c’était le nirvana. Aujourd’hui, entre Dakar et Berlin, Ernestus reconfigure le son autrement. Explications.
Khadim est une reconfiguration époustouflante du son Ndagga Rhythm Force. L'instrumentation est radicalement réduite. La guitare a disparu, tout comme la concaténation des sabars et la batterie. Chacun des quatre morceaux se concentre sur un ou deux batteurs seulement ; sinon, le seul élément enregistré est le chant, tout le reste est programmé. Les synthés sont dialogiquement verrouillés dans le rythme de la batterie. De manière révélatrice, Ernestus a fait appel à son Prophet-5 bien-aimé, un instrument emblématique depuis l'époque de Basic Channel, il y a trente ans. Sur le plan textural, le son est plus dubwise, piquant d'effets. Il y a une nouvelle spatialité, annoncée dès le début par les sons ambiants de la vie urbaine à Dakar. Au micro, Mbene Diatta Seck se délecte de cette nouvelle ouverture : diva du mbalax, elle transforme avec émotion chacune des quatre chansons en un épisode dramatique distinct, en utilisant différents ensembles de techniques rhétoriques. La musique est tendue, groovy et complexe, comme auparavant, mais plus volatile, intuitive et accessible, avec une expressivité émotionnelle et spirituelle turbulente.
Cela ne veut pas dire que Khadim représente une rupture. Sa capacité de transformation trouve ses racines dans les centaines et centaines d'heures que le Rhythm Force a passées à jouer ensemble. Près d'une décennie s'est écoulée depuis Yermande, le précédent album du groupe. Chaque année pendant cette période, à l'exception des confinements, le groupe a effectué de nombreuses tournées en Europe, aux États-Unis et au Japon. L'improvisation étant au cœur de sa création musicale, chaque performance a été évolutive, menant finalement à Khadim. « Je ne voulais pas simplement continuer avec la même formule, explique Ernestus. Je préférais attendre une nouvelle approche. Après avoir joué tant de fois en live, je voulais capturer une partie de l'énergie et de la liberté de ces performances. » Bien que plusieurs membres de l'ensemble en tournée ne participent pas à cet enregistrement – les percussionnistes sabar, le batteur, le synthétiseur –, leur présence reste présente dans la structure et le swing de la musique.
Lamp Fall est un hommage à Cheikh Ibra Fall, fondateur de la communauté spirituelle Baye Fall. La mosquée de la ville de Touba est connue sous le nom de Lamp Fall, car sa tour principale ressemble à une lanterne. Soy duggu Touba, moom guey séen / Quand vous entrez à Touba, c'est lui qui vous accueille. Après un début rapide et incantatoire, Mbene chante avec un sérieux réfléchi. Sa voix tourbillonne avec une réverbération, sur une interaction serrée, funky et propulsive entre le synthé et la batterie, entrelacée de deux coups de basse. Cheikh Ibra Fall mi may way, mo diayndiou ré, la mu jëndé ko taalibe… Cheikh Ibra Fall amo morome, aboridial / Cheikh Ibra Fall montre la voie à suivre, il nous donne de la force, il rassemble ses disciples… Débordant de grâce, Cheikh Ibra Fall n'a pas d'égal.
Entrecroisée de proverbes wolofs, Dieuw Bakhul est une chanson accusatrice sur la trahison, le mensonge et la médisance. Sur des synthés maussades et tourbillonnants et une basse sinistre et épurée, Mbene lance des bribes de voix flottantes, comme si elle repassait de vieilles conversations dans sa tête. La musique accompagne son désespoir jusqu'au bord de la rupture, à un moment où elle semble si perdue dans ses pensées et ses souvenirs qu'elle menace de se désintégrer. Bayilene di wor seen xarit ak seen an da ndo... Dieuw bakhul, dieuw ñaw na / Arrête de juger tes amis et tes compagnons... Un mensonge n'est pas bon, un mensonge est laid.
Khadim est un morceau phare, actuellement la pièce maîtresse des concerts de Ndagga Rhythm Force. La chanson est dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba, alias Khadim, fondateur de l'ordre soufi Mouride. Serigne Bamba mi may wayeu / Serigne Bamba est celui qui me fait chanter. Les couplets citent les noms de membres vénérés de sa famille et de sa confrérie, tels que Sokhna Diarra, Mame Thierno et Serigne Bara. Bien que l'islam soit pratiqué au Sénégal depuis un millénaire, ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il a commencé à imprégner profondément la société sénégalaise ordinaire, parallèlement à l'anticolonialisme. Les vers rappellent ici l'exil de Bamba par les Français au Gabon, puis en Mauritanie, à cette époque fondatrice. Pendant son exil, ses ravisseurs ont un jour introduit un lion dans sa cellule : gaïnde gua waf, dieba lu ci Cheikhoul Khadim / le lion ne bouge pas, il se soumet à Cheikh Khadim. Une basse profonde et puissante, une grosse caisse régulière et des accords simples et réverbérés sur le contre-temps confèrent à ce morceau l'atmosphère et l'élan du reggae steppers. Une flûte joue des bribes d'une mélodie traditionnelle Baye Fall ; le jeu de batterie polyrythmique éblouissant est signé Serigne Mamoune Seck. Mbene mêle de manière captivante vocalises percussives, suspense narratif, louanges exultantes, introspection et griefs.
Nimzat est un hommage dévotionnel à Cheikh Sadbou, un contemporain de Bamba, enterré dans un mausolée à Nizmat, dans le sud de la Mauritanie. Way nala, kagne nala... souma danana fata dale / Je t'appelle et je m'interroge sur toi... Si je suis submergé, viens à mon aide. La ville revêt une importance particulière pour le soufisme khadr. Un pèlerinage annuel y est organisé encore aujourd'hui. Le rythme est joyeusement funky ; l'ambiance est sombre, sobre, inquiétante. Ponctué par des coups de tonnerre, Mbene chante avec une révérence contenue et intense, d'une voix rauque et confidentielle, inébranlable. Nanu dem ba Nimz. Afrique future, techno future, à vous de voir. Mais à écouter en boucle(s) !
JP Samba africaine le 16/06/2025
Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force - Khadim - Ndagga
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
