
05.02.2026 à 10:35
Venezuela-Iran : la realpolitik selon Trump
Habituellement, le soutien à la démocratisation n’est pas une des priorités diplomatiques de Donald Trump et les deux derniers cas du Venezuela et de l’Iran viennent le confirmer. Au Venezuela, à la suite de l’intervention étasunienne, le même régime est en place simplement avec une nouvelle dirigeante qui va favoriser les exportations pétrolières pour les États-Unis. En Iran, Donald Trump a incité la révolte populaire iranienne en promettant de l’aide qui n’est jamais arrivée et il finira sûrement par négocier avec un régime qui a du sang sur les mains concernant l’encadrement du programme nucléaire iranien. Ces évènements montrent bel et bien que les États-Unis défendent toujours leurs propres intérêts et qu’une intervention étasunienne est rarement bénéfique.
L’article Venezuela-Iran : la realpolitik selon Trump est apparu en premier sur IRIS.
Lire plus (205 mots)
Habituellement, le soutien à la démocratisation n’est pas une des priorités diplomatiques de Donald Trump et les deux derniers cas du Venezuela et de l’Iran viennent le confirmer. Au Venezuela, à la suite de l’intervention étasunienne, le même régime est en place simplement avec une nouvelle dirigeante qui va favoriser les exportations pétrolières pour les États-Unis. En Iran, Donald Trump a incité la révolte populaire iranienne en promettant de l’aide qui n’est jamais arrivée et il finira sûrement par négocier avec un régime qui a du sang sur les mains concernant l’encadrement du programme nucléaire iranien. Ces évènements montrent bel et bien que les États-Unis défendent toujours leurs propres intérêts et qu’une intervention étasunienne est rarement bénéfique.
L’article Venezuela-Iran : la realpolitik selon Trump est apparu en premier sur IRIS.
04.02.2026 à 17:46
L’ordre mondial selon Trump. Avec Justin Vaïsse | Entretiens géopo
Pascal Boniface · L’ordre mondial selon Trump. Avec Justin Vaïsse | Entretiens géopo Le monde fait face à des recompositions internationales majeures, précipitées par la politique étrangère du deuxième mandat de Donald Trump. Avec un positionnement qui diffère de celui de son précédent mandat, Trump redéfinit la manière d’exister dans le système international, en dictant ses règles : faire primer la puissance et la stratégie pour établir des relations internationales au service des intérêts nationaux et conditionnées par les rapports de force. Un bouleversement qui s’accompagne d’une profonde remise en cause du système international post-1945 et du multilatéralisme. Si les États-Unis ont longtemps été perçus comme le berceau du modèle démocratique-libéral, cette réalité semble désormais bien lointaine. Le monde occidental, profondément désorienté par la dégradation de la relation transatlantique, semble désormais devenir un concept presque obsolète. Dans ce paysage instable et face à l’abandon de Washington de ses traditionnelles alliances, l’Europe fait-elle preuve de lucidité stratégique ou d’une inquiétante complaisance ? Sa posture est-elle encore adaptée aux équilibres actuels et aux recompositions qui émergent ? Quelles sont les différences concrètes en matière de positionnement entre les administrations Trump I et II ? Dans ce podcast, Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la Paix, nous offre un tour d’horizon des enjeux géopolitiques contemporains.
L’article L’ordre mondial selon Trump. Avec Justin Vaïsse | Entretiens géopo est apparu en premier sur IRIS.
Lire plus (430 mots)
Le monde fait face à des recompositions internationales majeures, précipitées par la politique étrangère du deuxième mandat de Donald Trump. Avec un positionnement qui diffère de celui de son précédent mandat, Trump redéfinit la manière d’exister dans le système international, en dictant ses règles : faire primer la puissance et la stratégie pour établir des relations internationales au service des intérêts nationaux et conditionnées par les rapports de force. Un bouleversement qui s’accompagne d’une profonde remise en cause du système international post-1945 et du multilatéralisme. Si les États-Unis ont longtemps été perçus comme le berceau du modèle démocratique-libéral, cette réalité semble désormais bien lointaine. Le monde occidental, profondément désorienté par la dégradation de la relation transatlantique, semble désormais devenir un concept presque obsolète.
Dans ce paysage instable et face à l’abandon de Washington de ses traditionnelles alliances, l’Europe fait-elle preuve de lucidité stratégique ou d’une inquiétante complaisance ? Sa posture est-elle encore adaptée aux équilibres actuels et aux recompositions qui émergent ? Quelles sont les différences concrètes en matière de positionnement entre les administrations Trump I et II ?
Dans ce podcast, Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la Paix, nous offre un tour d’horizon des enjeux géopolitiques contemporains.
L’article L’ordre mondial selon Trump. Avec Justin Vaïsse | Entretiens géopo est apparu en premier sur IRIS.
04.02.2026 à 15:56
Le Japon face à la désinformation : le cas du rejet des eaux traitées de Fukushima
Le rejet en mer des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi s’est rapidement imposé comme un épisode marquant de la diplomatie japonaise. Au-delà des enjeux techniques et environnementaux, cette décision a mis en lumière un double impératif pour Tokyo : asseoir sa légitimité scientifique et faire face aux offensives informationnelles, notamment en provenance de Chine.
L’article Le Japon face à la désinformation : le cas du rejet des eaux traitées de Fukushima est apparu en premier sur IRIS.
Lire plus (168 mots)
Le rejet en mer des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi s’est rapidement imposé comme un épisode marquant de la diplomatie japonaise. Au-delà des enjeux techniques et environnementaux, cette décision a mis en lumière un double impératif pour Tokyo : asseoir sa légitimité scientifique et faire face aux offensives informationnelles, notamment en provenance de Chine.
L’article Le Japon face à la désinformation : le cas du rejet des eaux traitées de Fukushima est apparu en premier sur IRIS.
04.02.2026 à 15:22
Tenir : l’agriculture comme colonne vertébrale d’un monde instable
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Déméter 2026 – Appétits stratégiques et pivots agricoles (IRIS Éditions, 2026), sous la direction de Sébastien Abis. Dans un monde déséquilibré et inconstant, où tout semble virevolter et s’accélérer jusqu’à la nervosité, tracer des lignes d’horizon devient un exercice délicat. Prendre de la distance et trouver de la hauteur se révèlent d’autant plus malaisé que l’indétermination progresse de concert avec l’incertitude. Le présentisme domine les réflexions, le brouillard s’épaissit dans les champs de vision. L’urgence et l’impatience s’imposent, souvent attisées par le flot continu d’émotions passagères. Une tendance qui ne cesse de s’amplifier ces dernières années[1], alors qu’une pandémie en 2020 devait soi-disant nous amener à penser au « monde d’après ». Or l’immédiateté et l’individualisme forment le couple en vogue, montant par populisme. Se projeter vers l’avenir avec d’autres s’affiche au contraire comme une démarche vaine, voire « àquoiboniste ». Résistons à cette tentation et persistons dans une démarche qui consiste à s’ouvrir pour penser, penser pour agir et agir pour progresser. L’agriculture, cette immortelle À travers les analyses proposées dans cet ouvrage prospectif et collectif, nous nous efforçons de lutter contre l’instantanéité et l’enfermement. Résolument exploratoire de futurs possibles et contradictoires, cette livraison annuelle peut paraître, sinon contracyclique, du moins décalée par rapport à d’autres lectures[2]. N’est-ce pas, au fond, une singularité que de publier depuis plus de trente ans un ouvrage consacré à l’agriculture ? Sans jamais nier les transformations du monde ni la complexité de ces changements, n’avons-nous pas persisté à porter un message aussi simple que trop souvent sous-estimé : les questions agricoles et alimentaires constituent des invariants des affaires humaines, des piliers du développement et des éléments incontournables de la géopolitique. Il ne s’agit pas ici de nous autotresser des lauriers. Juste le souhait de poser calmement un constat sur ce qui distingue […]
L’article Tenir : l’agriculture comme colonne vertébrale d’un monde instable est apparu en premier sur IRIS.
Texte intégral (4523 mots)
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Déméter 2026 – Appétits stratégiques et pivots agricoles (IRIS Éditions, 2026), sous la direction de Sébastien Abis.
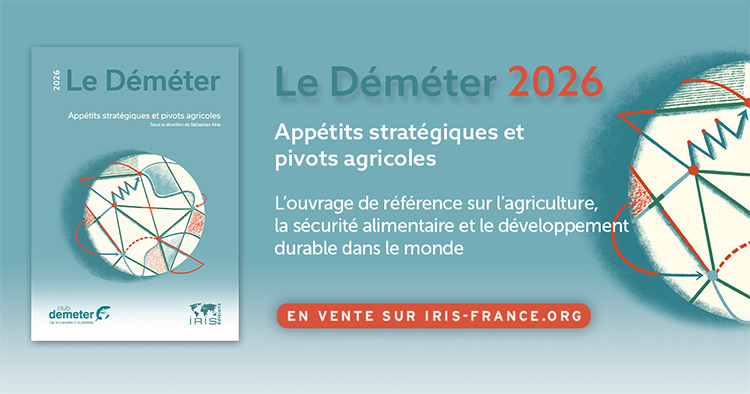
Dans un monde déséquilibré et inconstant, où tout semble virevolter et s’accélérer jusqu’à la nervosité, tracer des lignes d’horizon devient un exercice délicat. Prendre de la distance et trouver de la hauteur se révèlent d’autant plus malaisé que l’indétermination progresse de concert avec l’incertitude. Le présentisme domine les réflexions, le brouillard s’épaissit dans les champs de vision. L’urgence et l’impatience s’imposent, souvent attisées par le flot continu d’émotions passagères. Une tendance qui ne cesse de s’amplifier ces dernières années[1], alors qu’une pandémie en 2020 devait soi-disant nous amener à penser au « monde d’après ». Or l’immédiateté et l’individualisme forment le couple en vogue, montant par populisme. Se projeter vers l’avenir avec d’autres s’affiche au contraire comme une démarche vaine, voire « àquoiboniste ». Résistons à cette tentation et persistons dans une démarche qui consiste à s’ouvrir pour penser, penser pour agir et agir pour progresser.
L’agriculture, cette immortelle
À travers les analyses proposées dans cet ouvrage prospectif et collectif, nous nous efforçons de lutter contre l’instantanéité et l’enfermement. Résolument exploratoire de futurs possibles et contradictoires, cette livraison annuelle peut paraître, sinon contracyclique, du moins décalée par rapport à d’autres lectures[2]. N’est-ce pas, au fond, une singularité que de publier depuis plus de trente ans un ouvrage consacré à l’agriculture ? Sans jamais nier les transformations du monde ni la complexité de ces changements, n’avons-nous pas persisté à porter un message aussi simple que trop souvent sous-estimé : les questions agricoles et alimentaires constituent des invariants des affaires humaines, des piliers du développement et des éléments incontournables de la géopolitique. Il ne s’agit pas ici de nous autotresser des lauriers. Juste le souhait de poser calmement un constat sur ce qui distingue la conviction de la communication. Tout en précisant que la conviction, par essence, refuse les certitudes figées. Elle interroge au contraire une idée ou un sujet, en permanence et en conscience, c’est-à-dire avec attachement et clairvoyance. Elle évolue sans rompre à la racine, sous peine de perdre son fil essentiel et de se déplacer au gré des vents dominants.
Entendons-nous bien : si l’agriculture s’enracine dans l’histoire, elle se tourne inévitablement aussi vers l’avenir. Elle éclaire, structure et projette le temps, d’où cette idée de colonne vertébrale inamovible. Cela ne veut pas pour autant dire rigidité et immobilisme. Bien au contraire, l’agriculture est une somme de changements et d’adaptations permanentes, progressives, raisonnées et parfois audacieuses. D’ailleurs, sans cela, elle ne saurait être immortelle, surtout dans ce siècle des vertiges.
Au-delà de l’importance atemporelle et universelle de l’agriculture comme secteur stratégique, trois convictions irriguent ces pages, année après année : voir long, voir loin, voir large. Autrement dit, raisonner dans le moyen et le long termes pour identifier les enjeux structurels, sans négliger les signaux faibles ; chercher la bonne altitude telle une montgolfière pour observer les dynamiques qui s’exercent sur le planisphère ; enfin, croiser les approches afin de favoriser des pensées circulaires, réalistes, intuitives et parfois disruptives. Dans cette perspective mêlant lucidité et enthousiasme, rigueur et vagabondage, les tonalités et les alertes de cet éditorial ont évolué progressivement[3] :
- en 2019, nous rappelions que « L’agriculture dans le monde voit son importance renforcée et sa puissance déplacée », soulignant le rôle central de l’alimentation dans la géopolitique des ressources et la persistance de besoins agricoles majeurs à l’échelle planétaire ;
- en 2020, nous proposions « Une cartographie des mondes agricoles et alimentaires pour la décennie », structurée autour de dix points cardinaux : sino-mondialisation, stress hydrique, emballement normatif, inflation alimentaire, vieillissement démographique, pouvoir de la science, lien social face à la désinformation, foire au carbone, fragilité de l’unité européenne, Afriques en mouvement ;
- en 2021, nous affirmions un triptyque mobilisateur, « Sécurité, santé, soutenabilité : quand l’agriculture prend tout son sens », pour inscrire les questions agricoles sur une orbite de progrès exigeant mais inclusif, à l’échelle du siècle ;
- en 2022, nous constations « Relance, puissance, appartenance : des priorités (agricoles) pour tous », trois termes à consonance mondiale, trois thèmes pour une Europe vitale, trois mots aussi à résonance hexagonale ;
- en 2023, avec « Le réarmement agricole du monde est une bonne nouvelle », nous soulignions le retour de politiques agricoles nationales indispensables à la stabilité, dans un contexte de risques géopolitiques et climatiques croissants, en miroir d’une remilitarisation globale préoccupante ;
- en 2024, « Europe : globally alone » annonçait l’entrée du continent dans une période d’inconforts, de confusions et de marginalisation potentielle, selon sa capacité à préserver ses forces agricoles et sa sécurité alimentaire, tout en soulignant la désynchronisation des agendas européens avec une bonne partie de la planète ;
- en 2025, pour cristalliser l’état transformatif des relations internationales et intersociales, nous mettions en lumière leur férocité, leur vélocité et leur polygamie, à travers une métaphore zoopolitique – « Nourrir le futur à l’ombre des hippopotames » –dont nous n’avons pas fini de supporter le poids vu l’actualité la plus pressante.
Dans le prolongement de ces éditoriaux, une problématique émerge avec acuité et que nous pourrions résumer ainsi : comment tenir dans la durée, tenir le choc et tenir ensemble ? Car il ne s’agit plus seulement de comprendre les déséquilibres à l’œuvre ni même de les anticiper, mais de traverser une époque où les tensions se sont pleinement installées et où les arbitrages sont devenus permanents. Dans ce contexte agité, où l’encombrement de la pensée s’intensifie au détriment de la clairvoyance, où la raison et la science sont alors aussi souvent malmenées, il convient donc de s’interroger sur ce qui tient vraiment quand tout tangue autour de soi et sur ce qui nous relie réellement lorsque trop de mouvements concourent à opposer. Dans ce maelstrom qui en aspire beaucoup, où se situent les repères qui résistent aux tourbillons et nous invitent à la concentration stratégique ?
Si tenir est le refus de la sidération, la capacité à faire des choix et la possibilité de garder son cap, alors l’agriculture s’affiche comme un puissant révélateur du monde. Elle traverse les saisons et les époques : une très vieille activité toujours portée par le futur. Certes, elle est un secteur économique aux compétences techniques et le miroir grossissant des vulnérabilités climatiques. Mais en pointant le curseur sur l’agricole, nous dévoilons des jeux de puissance et des aveux d’impuissances, nous découvrons des fractures sociales et des cassures territoriales et comprenons mieux les stratégies d’investissement opérées par les acteurs publics ou privés. Nous nous situons aussi au cœur de cette géopolitique où le nationalisme a pris, hélas, les commandes sur le patriotisme. Allons plus loin à propos de cette nouvelle donne qui se propage : souverainisme, transactionnalisme, brutalisme, impérialisme, etc., autant de termes envahissant les narratifs pour tenter de décrire la marche actuelle du monde. Ne les contestons pas, posons-nous la question de leur conséquence dans cette sphère agricole et alimentaire qui résiste au temps et fait appel à l’intelligence des interdépendances pour aller de l’avant. Tenir, ce n’est pas uniquement produire. C’est savoir durer. Tenir, ce n’est pas simplement préserver. C’est continuer d’innover. Tenir, ce n’est pas seulement résister. C’est gagner en robustesse. Tenir, ce n’est pas un acte éphémère ou isolé, mais bien un effort continu et collectif. C’est avoir une colonne vertébrale qui conserve dans un monde en fusion. Dit autrement, l’agriculture nous propose une épreuve de vérité, et particulièrement à nous, Européens.
Les carrefours de l’Union européenne
Après moult hésitations à la maintenir sur la ligne d’horizons, nous nous trouvons désormais sur une ligne de crête particulièrement périlleuse au sein de l’Union européenne (UE). Nous sommes entrés dans ce millénaire la fleur sans le fusil, cherchant à moraliser les relations internationales avec une arrogance anachronique et décrétant la fin d’une ère productive sans nous donner les moyens véritables d’une écologie de progrès, si ce n’est par le truchement de la délocalisation ou de la décroissance programmatique des niveaux de vie. Là où la Chine s’est lancée dans une industrialisation de la décarbonation[4], nous avons diminué nos émissions de dioxyde de carbone (CO2) en désindustrialisant. Là où l’Histoire nous enseigne qu’il n’existe aucune démocratie solide sans économie, nous avons plombé la durabilité par des mesures dissuasives et mélangé le vert avec des couleurs trop radicales. Là où il aurait été possible de capitaliser sur l’élargissement à de nouveaux États membres en matière de pouvoirs et d’influences, l’UE s’est égarée sur le chemin à même d’exprimer sa puissance et sa différence. Résultat, après un quart de siècle traversé, l’Europe doit se remettre à travailler, financer sa propre sécurité et éviter d’être marginalisée, ou pire, demain vassalisée. Sauf à vouloir avancer à reculons comme une écrevisse, comme le redoutait déjà un célèbre philosophe italien il y a vingt ans[5], ou à accepter par fatalisme d’être assise en haut d’un toboggan, l’UE aborde un virage géopolitique assurément escarpé.
Pendant ce laps de temps, qui s’étire de la chute du mur de Berlin en 1989 à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’agriculture n’a pas disparu du continent européen. Mais elle s’est décentrée du regard prospectif et a été déclassée dans l’ordre des priorités, comme si l’Europe, pour se moderniser, devait se délester de ses habits traditionnels et embrasser le XXIe siècle dans une parure productive immatérielle. Et pourtant, malgré ces mutations, nous avons eu un budget européen encore principalement dédié à ce secteur agricole, sans pour autant expliciter de manière intelligible au citoyen-consommateur qu’il en était le premier bénéficiaire. Erreur cruciale, qu’il est difficile de corriger, sauf à imaginer qu’il n’y ait plus de soutiens publics demain pour l’agriculture, soit dans un scénario d’une Europe désunie et déconstruite, soit dans celui d’une Europe désargentée ou contrainte de placer ses dépenses sur le terrain militaire face aux menaces qui prolifèrent. Il sautera alors aux yeux des Européens combien fut précieuse et peu coûteuse cette politique agricole commune (PAC) développée depuis des décennies[6]. Autre erreur européenne vis-à-vis de son agriculture : avoir sous-estimé les effets du changement climatique sous ses propres latitudes, tout comme l’accroissement de certains risques. En somme, pas d’urgence et pas d’inquiétude, ici tout ira mieux qu’ailleurs et pour toujours. Or, d’ores et déjà, aucune filière n’est à l’abri d’une mauvaise année de récoltes, les maladies animales ou végétales s’amplifient et des retards s’accumulent sur la préparation de systèmes agricoles aux nouvelles conditions géographiques dans l’espace européen. Nous avons beaucoup misé sur l’atténuation, très peu sur l’adaptation. Et nous avons même eu l’outrecuidance d’expliquer à certains pays dans le monde comment produire sous formes agroécologiques, alors que ce sont eux qui expérimentent depuis plus longtemps la rareté des ressources et la variabilité climatique, sans même parler d’autres instabilités sociopolitiques nuisibles au développement agricole.
Ajoutons à cela une crise de compétitivité européenne compte tenu d’un paysage agricole et agroalimentaire mondial profondément recomposé, et nous obtenons un choc de méfiance grandissant envers l’avenir de la part d’un secteur qui pourtant aura été le moteur principal de la construction européenne et qui peut se targuer d’être a priori immortel, comparativement à bon nombre de domaines d’activités condamnés à disparaître. Précisons bien ici notre propos : le monde ne peut pas se passer d’agricultures, eu égard aux nécessités alimentaires ou encore énergétiques via la biomasse mobilisée pour réduire la dépendance aux hydrocarbures ; l’Europe peut ne plus avoir d’agricultures à domicile mais toujours faudra-t-il qu’elle dispose de solutions pour s’approvisionner auprès des autres continents. Et en parlant de solutions, à l’ère de nouvelles fragmentations géographiques[7], nous pensons bien entendu à des moyens économiques, logistiques et diplomatiques appropriés. Or nous savons qu’ils ne sont pas illimités au niveau européen, pour ne pas dire qu’ils sont bien minces à l’échelle de chaque État membre. S’associer les uns aux autres ou disparaître lentement et chacun séparément : Europe, tel est ton destin[8] ?
En forçant de telles hypothèses, nous souhaitons nourrir notre propos sur cette impérieuse nécessité de tenir. Tenir l’unité entre Européens et entre les générations[9]. Tenir les valeurs qui fondent l’UE et doivent encore l’animer envers et contre tout. Tenir compte aussi des intérêts européens cependant, pour ne pas la voir dévorer par des puissances carnivores ou au menu d’appétits particuliers. Et donc pour toutes ces raisons, tenir encore et encore l’agriculture au centre du projet européen. Tenir ce secteur en considération, pour ne pas s’étonner de le voir érupter à la moindre occasion d’une réforme réglementaire, d’un accord commercial ou d’une décision environnementale. Tenir l’agriculture et ses infrastructures, physiques, immatérielles et humaines, dans toutes leurs diversités de fonction et d’expression, non pour préparer une future exposition à propos du passé de l’Europe, mais bien pour construire l’avenir, avec une ambition et un cap correspondant aux enjeux de notre époque. La rentabilité économique d’une exploitation ou d’une entreprise n’est pas un objectif incompatible avec la soutenabilité sociale et écologique. Que voulons-nous garder, renforcer, transmettre et défendre en Europe ? Tenir suppose de préserver des lignes d’horizon, à atteindre et à conquérir, entre convictions et visions, pour permettre à des sociétés de rester debout sans se durcir, d’encaisser sans se fragmenter, d’avancer sans se renier. C’est à cette condition que l’agriculture pourra continuer d’éclairer le futur de l’UE : non comme une variable d’ajustement, mais comme une colonne vertébrale des mondes à venir, pour elle comme pour d’autres. D’ailleurs, la guerre en Ukraine n’oubliera pas de nous le rappeler[10]. Quand l’agriculture va mal, ce n’est jamais un problème agricole esseulé.
CUBITA : le choix de six États pivots
Reprenons le large et délaissons notre presqu’île européenne, qui n’a nullement le monopole des moments pivotaux, bien d’autres régions du monde soient exposées à des bascules potentielles[11] – géopolitiques, économiques et/ou climatiques – susceptibles de fragiliser leurs agricultures et de générer de nouvelles insécurités, alimentaires ou autres. Un tel diagnostic pourrait être posé partout, même si l’intensité et la portée des enjeux ne sont ni homogènes ni comparables[12]. Nous avons néanmoins choisi d’opérer un arrêt sur présages prospectifs à partir de six pays, aux caractéristiques distinctes, dont la trajectoire à venir n’est pas nécessairement celle que l’on perçoit aujourd’hui. Par leur taille territoriale et démographique, par l’abondance de leurs ressources naturelles, mais aussi par leur sismicité potentielle, ces États sont appelés à jouer un rôle pivotal – pour le meilleur comme pour le pire – à l’horizon 2050. De leurs déterminations, de leurs orientations et de leurs actions dépendront des équilibres agricoles, alimentaires et environnementaux qui excèdent largement le cadre de leurs seules frontières. C’est ce qui justifie leur inscription dans un registre restreint d’États pivots, notre hexagone agrostratégique, composé comme suit : République démocratique du Congo, Ukraine, Brésil, Indonésie, Turquie et Australie (CUBITA), un acronyme à dessein géométrique, assumant l’idée de volume et de structure.
Les CUBITA sont ces États qui donneront du corps aux trouées ou aux percées agricoles et alimentaires de demain. Non par exclusivité, mais parce qu’ils constituent, à nos yeux, une masse critique dont les évolutions méritent une vigilance soutenue. Ce qui relie la République démocratique du Congo, l’Ukraine, le Brésil, l’Indonésie, la Turquie et l’Australie n’est pas un indicateur unique, mais la combinaison de plusieurs masses stratégiques : foncière et écologique, démographique et culturelle, productive et exportatrice, carrefour logistique et conflictuel, vulnérabilités climatiques et politiques. Pris séparément, ces facteurs existent ailleurs. Combinés aux enjeux agricoles et alimentaires, ils produisent de potentielles instabilités aux effets de bascule globaux. Les CUBITA regroupent 15 % des terres émergées du globe, 10 % de la population et 30 % des exportations agricoles mondiales. S’ils dérapent, ils seront des multiplicateurs de risques ou d’instabilités. S’ils tiennent, politiquement et climatiquement, ils deviennent des amortisseurs planétaires.
D’autres pays auraient pu intégrer de telles grilles de lecture, en raison de leurs poids géoéconomiques sur l’échiquier agricole et alimentaire du monde. Pensons au Mexique, au Viêtnam, à la Russie, au Maroc, au Nigeria, au Canada et, bien entendu, à l’Inde. Comment ne pas considérer par ailleurs l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Kazakhstan ou le Japon comme candidats de poids à notre géométrie du futur ? Et s’il fallait le répéter, l’UE en est bien, elle aussi, partie prenante, comme nous l’avons explicité préalablement. Mais assumons l’acronyme CUBITA, qui n’est pas un club de pays performants ni une photographie statique du monde actuel. C’est une hypothèse selon laquelle ces États, par leurs volumes, leurs positions et leurs instabilités potentielles, pèseront disproportionnellement sur les équilibres agricoles et alimentaires mondiaux. Autrement dit, ils sont moins des pays leaders que des pays déterminants. CUBITA n’est pas une prophétie mais un poste d’observations, une vigie pour discerner les tremblements éventuels d’une planète qui tiendra moins bien sans eux et sans leurs agricultures.
Par ailleurs, la rivalité sino-états-unienne comporte des dimensions agricoles qu’il ne faudrait surtout pas mésestimer. Mais pour mieux les entrevoir, force est d’admettre qu’il convient d’abord et avant tout de bien mesurer la confrontation graduelle et globale dans laquelle Pékin et Washington sont entrés. Les institutions multilatérales sont à la peine alors que l’Organisation des Nations unies (ONU) vient de célébrer en catimini son 80e anniversaire. Et force est d’admettre que le commerce international, tout comme l’Agenda mondial du développement, patine devant de telles paralysies internationales. On n’avance plus, on gère les différends ; on progresse peu, on sauve ce que l’on peut. En parallèle, de nouvelles enceintes, comme les BRICS ou l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), faisant dialoguer des pays qui ne sont d’accord sur rien, sauf sur précipiter la fin d’une hégémonie états-unienne ou l’inutilité d’une escale à faire sur le sol européen. Et simultanément, des appétits sans cesse plus affirmés pour les affaires agricoles et alimentaires, de la part de mastodontes financiers méconnus du grand public ou des professionnels du secteur, des matières premières au pouvoir désormais considérable, des espaces ouvertement convoités pour leurs ressources comme dans le Grand Nord, ou encore ce narcobusiness dont nous ne saurions taire l’origine agricole.
Il y a toujours une part de géopolitique dans chaque histoire agricole : n’ignorons plus cette évidence. Alors, ayons l’audace d’une provocation prospective, sur laquelle nous devrions nous pencher sérieusement : y aura-t-il encore, demain, une part d’agricole dans chaque histoire alimentaire ? Avec la révolution des GLP-1, la poussée des coupe-faims nous plonge dans un univers inconnu. Tenir nos ceintures, certes. Mais surtout tenir nos agricultures, dès lors que l’alimentation pourrait, pour la première fois, se détacher partiellement ou progressivement de son lien à la terre et à la mer. Une rupture médicale encore silencieuse, qui déplacerait à la fois les frontières nutritionnelles de nos métabolismes et les fondations anciennes de nos sociologies.
[1] Voir François Hartog, Chronos. L’Occident aux prises avec le Temps (Paris : Gallimard, coll. « Folio histoire », 2024 [2020]) ; et Clément Tonon, Gouverner l’avenir. Retrouver le sens du temps long en politique (Paris : Tallandier, 2025).
[2] Invitons aussi les lecteurs et lectrices à consulter ou à découvrir la revue française Futuribles, pionnière en Europe en matière de prospective et référence internationale depuis sa création il y a un demi-siècle.
[3] Cet éditorial prospectif, du directeur de la publication, a été initié en 2019 lors de la mise en place d’une nouvelle maquette, fruit d’un partenariat entre le Club DEMETER et l’IRIS, coéditeurs chaque année du Déméter.
[4] Dan Wang, Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (Londres : Allen Lane, 2025).
[5] Umberto Eco, À reculons comme une écrevisse (Paris : Grasset, 2006).
[6] Prenons le cas de la France. Pour la période 2022-2027, le pays perçoit 65 milliards d’euros de l’UE au titre de la PAC. Si l’on convertit ce montant en coût par habitant et par jour, que ce soit dans sa composante alimentaire et non alimentaire, mais aussi de contribution au développement rural, à la gestion des ressources naturelles et à l’entretien des paysages, nous sommes à 13 euros par mois par Français ou 43 centimes par jour.
[7] Edward Fishman, Chokepoints: How the Global Economy Became a Weapon of War (Londres : Elliott & Thompson Limited, 2025).
[8] David Marsh, Can Europe Survive? The Story of a Continent in a Fractured World (New Haven : Yale University Press, 2025).
[9] Tim Ingold, Le passé à venir. Repenser l’idée de génération (Paris : Seuil, 2025).
[10] Voir Sébastien Abis, Arthur Portier et Thierry Pouch, Russie-Ukraine : la guerre hybride. Aux racines agricoles d’un bouleversement Mondial (Malakoff : Armand Colin, 2026).
[11] Neil Shearing, The Fractured Age: How the Return of Geopolitics Will Splinter the Global Economy (Londres : John Murray Business, 2025).
[12] Peter Frankopan, The Earth Transformed: An Untold History (Londres : Bloomsbury,2023).
L’article Tenir : l’agriculture comme colonne vertébrale d’un monde instable est apparu en premier sur IRIS.
03.02.2026 à 12:30
Les Kurdes de Syrie : quel avenir ? | Les mardis de l’IRIS
Chaque mardi, Pascal Boniface reçoit un membre de l’équipe de recherche de l’IRIS pour décrypter un fait d’actualité internationale. Aujourd’hui, échange avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, autour de l’accord signé entre Damas et les forces kurdes après de longs mois de conflit ainsi que des enjeux liés à l’intégration des forces et de l’administration kurdes au sein de l’État syrien.
L’article Les Kurdes de Syrie : quel avenir ? | Les mardis de l’IRIS est apparu en premier sur IRIS.
Lire plus (148 mots)
Chaque mardi, Pascal Boniface reçoit un membre de l’équipe de recherche de l’IRIS pour décrypter un fait d’actualité internationale. Aujourd’hui, échange avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, autour de l’accord signé entre Damas et les forces kurdes après de longs mois de conflit ainsi que des enjeux liés à l’intégration des forces et de l’administration kurdes au sein de l’État syrien.
L’article Les Kurdes de Syrie : quel avenir ? | Les mardis de l’IRIS est apparu en premier sur IRIS.
03.02.2026 à 10:30
Mali, Sahel : une « souveraineté retrouvée » ?
Au Mali, comme dans l’ensemble du Sahel central, les autorités issues des coups d’État revendiquent une souveraineté retrouvée, symbolisée dans le cas malien par le retrait des forces françaises en 2022 et mise en scène à travers une célébration nationale, le 14 janvier dernier. Cette rupture constitue un tournant politique majeur, sans pour autant signifier l’exercice effectif d’une souveraineté consolidée. Entre instabilité sécuritaire persistante, reconfiguration contrainte des alliances extérieures et retrait volontaire de plusieurs cadres régionaux et internationaux, la souveraineté malienne apparaît comme un processus conflictuel, fortement limité par des dépendances structurelles, comme l’a illustré le blocage des routes d’approvisionnement en carburant en septembre 2025. L’analyse de cette séquence permet d’interroger les marges de manœuvre réelles du Mali et de ses partenaires au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), ainsi que la nature des recompositions induites par l’entrée en scène de nouveaux acteurs non occidentaux. Quelles sont les circonstances qui ont produit le changement systémique observé actuellement au Mali ? L’histoire en cours a commencé avec un premier coup d’État, le 18 août 2020, qui a mis fin au régime du président élu Ibrahim Boubacar Kéita. L’événement a été compris comme le point de résolution d’un long conflit entre les oppositions et un pouvoir fortement contesté. Alors que la junte issue de ce coup d’État s’était engagée à une période de transition n’excédant pas une année – à la demande, notamment, de la CEDEAO -, un deuxième putsch est advenu le 24 mai 2021, destiné, selon ses auteurs, à « rectifier » les orientations de l’exécutif militaire. C’est ce « coup d’État dans le coup d’État » qui marquera un tournant décisif pour le pays, en transformant ce qui devait être un régime de transition en une rupture systémique. Le nouveau dirigeant du pays, le colonel Assimi Goïta – il sera promu […]
L’article Mali, Sahel : une « souveraineté retrouvée » ? est apparu en premier sur IRIS.
Texte intégral (1854 mots)
Au Mali, comme dans l’ensemble du Sahel central, les autorités issues des coups d’État revendiquent une souveraineté retrouvée, symbolisée dans le cas malien par le retrait des forces françaises en 2022 et mise en scène à travers une célébration nationale, le 14 janvier dernier. Cette rupture constitue un tournant politique majeur, sans pour autant signifier l’exercice effectif d’une souveraineté consolidée. Entre instabilité sécuritaire persistante, reconfiguration contrainte des alliances extérieures et retrait volontaire de plusieurs cadres régionaux et internationaux, la souveraineté malienne apparaît comme un processus conflictuel, fortement limité par des dépendances structurelles, comme l’a illustré le blocage des routes d’approvisionnement en carburant en septembre 2025. L’analyse de cette séquence permet d’interroger les marges de manœuvre réelles du Mali et de ses partenaires au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), ainsi que la nature des recompositions induites par l’entrée en scène de nouveaux acteurs non occidentaux.
Quelles sont les circonstances qui ont produit le changement systémique observé actuellement au Mali ?
L’histoire en cours a commencé avec un premier coup d’État, le 18 août 2020, qui a mis fin au régime du président élu Ibrahim Boubacar Kéita. L’événement a été compris comme le point de résolution d’un long conflit entre les oppositions et un pouvoir fortement contesté. Alors que la junte issue de ce coup d’État s’était engagée à une période de transition n’excédant pas une année – à la demande, notamment, de la CEDEAO -, un deuxième putsch est advenu le 24 mai 2021, destiné, selon ses auteurs, à « rectifier » les orientations de l’exécutif militaire. C’est ce « coup d’État dans le coup d’État » qui marquera un tournant décisif pour le pays, en transformant ce qui devait être un régime de transition en une rupture systémique. Le nouveau dirigeant du pays, le colonel Assimi Goïta – il sera promu général d’armée en 2024 – proclame le début d’une « révolution », au nom de la souveraineté, du panafricanisme et de la lutte contre l’impérialisme occidental. Une option inspirée alors d’une conjonction de facteurs : l’enlisement de la lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT), la montée des ressentiments à l’égard de la présence militaire française, la convocation de rancœurs non soldées de la colonisation, la décrédibilisation des acteurs politiques civils associés à une crise avancée du processus démocratique… Porté par ces différents constituants, le projet de la junte malienne sera conforté par l’activation, dans cette région, des stratégies d’influence de la Russie.
Comment distinguer, dans le cas malien, la souveraineté revendiquée par l’État, la souveraineté exercée dans les faits et la souveraineté vécue par les populations, dans un contexte marqué par l’insécurité persistante et le retrait volontaire de cadres régionaux et internationaux (CEDEAO, OIF) ?
Pour faire la démonstration de son projet souverainiste, la junte malienne a engagé des procédures de rupture avec ses partenaires traditionnels peu ou prou associés à ce qui est désigné comme « l’occident ». Ruptures avec la France, les États partenaires européens, les États-Unis, les ONG, la Minusma (Mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali) et la CEDEAO, accusée d’être sous influence française. Ces mesures ont favorisé la mise en œuvre d’une coopération exclusive, à la manière d’un huis clos, avec la Russie, dans les domaines de la sécurité, de l’exploitation minière et des stratégies informationnelles. La séquence des ruptures – sur fond d’éléments de langage « révolutionnaires » et de cyber-propagande – aura surtout permis à la junte d’imposer son agenda, à l’instar des juntes du Burkina Faso et du Niger, tous trois réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel, après leur retrait de la CEDEAO en 2024. Cinq ans après la prise du pouvoir d’État par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP, junte malienne), l’exécutif de transition s’est transmué en un régime non élu, et sans limitation de durée. Pour la population qui a associé la « souveraineté retrouvée » à la fin de l’insécurité, il faudra encore attendre. La coopération avec la Russie, qui s’était un temps cantonnée à la protection de la junte par les mercenaires du Groupe Wagner, n’a pas permis l’éradication promise des GAT. La dégradation continue de la situation sécuritaire a accru le recul du contrôle de l’État sur des pans entiers du territoire. Pour nombre de Maliens, la rupture conflictuelle avec la CEDEAO, avec ses conséquences sur les dynamiques de l’intégration régionale, demeure une énigme, ou une hérésie. Une rupture qui demeure relative, toutefois. Car, les trois pays sahéliens sont toujours présents au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), corollaire monétaire de la CEDEAO pour les États de la Zone franc.
Au Mali, la ruine du tissu entrepreneurial, l’absence d’un programme économique identifié et, plus généralement, les effets collatéraux de l’insécurité sur la vie des populations ont instauré un climat de précarité endémique. Dans ce contexte, les autorités militaires ont exclu l’expression des libertés démocratiques et fondamentales du corpus idéologique souverainiste. Si une partie de la population continue de croire que le « Mali refondé » mérite bien les sacrifices suggérés par le pouvoir, d’autres se demandent si l’on ne s’est pas trompé d’histoire de souveraineté. La question persistante est de savoir si le référentiel souverainiste pourrait indéfiniment résister à l’exigence d’une normalisation du pouvoir d’État, par le rétablissement de l’ordre constitutionnel et du verdict électoral.
La rupture avec les anciennes tutelles européennes, en particulier française, a-t-elle élargi les marges de manœuvre politiques et sécuritaires des États du Sahel central, ou a-t-elle déplacé les contraintes vers d’autres formes de dépendance, de vulnérabilité et de négociation ?
L’objectif initial de ces États était en effet d’amplifier leurs marges de manœuvre, en termes de décision et de détermination politique. En pratique, ils ont mécaniquement provoqué une contraction de leur champ de négociation. En désignant une partie de la communauté internationale – y compris la CEDEAO et l’Union africaine – comme des entités hostiles à leur « révolution », ils ont, de fait, bridé leur capacité de négociation sur la scène régionale et internationale. La rupture conflictuelle avec la CEDEAO a dramatiquement entravé l’indispensable mutualisation des moyens régionaux pour la lutte contre le terrorisme. Le huis clos relationnel avec l’allié politique de Moscou marque ses limites. À telle enseigne que ce dernier a invité, en décembre 2025, l’AES et la CEDEAO à renouer le dialogue, au nom du principe de réalité,afin de produire des solutions communes pour la lutte contre le terrorisme. Déjà, enaoût 2025, le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Tchoumakov, avait exprimé l’urgence d’un soutien à l’échelle mondiale en faveur du Sahel central, afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Des propos relayés par le représentant permanent du Mali auprès de l’ONU, Issa Konfourou, qui a signifié l’entière disposition de l’AES à coopérer avec les pays de la région et l’ensemble des partenaires qui le souhaitent. Cette évolution du discours se manifeste à un moment où les régimes de l’AES se départissent du postulat de la rupture radicale pour énoncer celui d’une diversification des partenariats… au nom de la souveraineté. Une nouvelle phase de diversification qui n’exclut plus de possibles négociations avec les États-Unis ou l’Union européenne.
Quels types de ressources, de soutiens et de contraintes l’intervention croissante d’acteurs extérieurs non occidentaux (Russie, Chine et autres partenaires) introduit-elle dans les configurations politiques, sécuritaires et diplomatiques du Sahel central ?
La Russie, qui n’est pas, traditionnellement, un partenaire au développement, poursuit son assistance sécuritaire, avec le dispositif Wagner rebaptisé Africa Corps. Discrètement, la Chine préserve ses avantages anciens, en ayant symboliquement porté en 2024 les relations sino-maliennes au niveau de « partenariat stratégique ». Dans cette configuration concurrentielle qui déborde du cadre du Sahel central, Pékin applique la continuité d’une coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce ou des infrastructures. La Turquie, sur la base de protocoles inédits, fournit des services d’assistance sécuritaire par l’intermédiaire de sociétés privées. En contrepartie, elle bénéficie d’avantages spécifiques pour l’accès au secteur minier dans les pays de l’AES. Les Émirats arabes unis (EAU) s’invitent aussi dans le Sahel central, dans le cadre d’une coopération portant sur la défense et les échanges économiques. Moins officiellement, les EAU espèrent consolider une diplomatie d’influence dans un contexte de vives tensions entre les autorités de l’AES et l’Algérie qui, par ailleurs, accuse Abou Dhabi de comportements hostiles à son encontre…
En réalité, la liberté de choix des partenaires ne relève pas de l’innovation. Depuis les années 80, tous les pays du continent ont engagé des politiques souveraines de diversification des partenaires extérieurs. L’enjeu persistant pour tous étant de renforcer, en tout lieu, leur pouvoir de décision, ainsi que la maîtrise pertinente des mécanismes des interdépendances mondiales. Actuellement dans le Sahel central, la question est de savoir le degré de compatibilité entre les agendas de ces partenaires sollicités dans l’urgence, et les défis multisectoriels de la région. Au regard de l’agenda international de certains partenaires – la Russie, notamment –, le risque existe pour ces États sahéliens confrontés à divers facteurs de vulnérabilité, de devenir des variables d’ajustements pour des enjeux géopolitiques échappant au périmètre de négociation de leurs intérêts spécifiques, et ceux de leurs populations.
L’article Mali, Sahel : une « souveraineté retrouvée » ? est apparu en premier sur IRIS.
03.02.2026 à 09:37
En Amérique latine, l’expansion des droites
En 2026, cinq élections majeures se tiendront en Amérique latine. Au-delà des configurations internes propres à chaque pays concerné, ces élections s’inscrivent dans un contexte commun dans une Amérique latine divisée sur le plan idéologique. Ce dernier est marqué par une poussée des forces de droites conservatrices, religieuses (catholiques et évangéliques) et d’extrême droite au détriment des gauches locales et par le retour agressif des États-Unis dans la région après leur intervention militaire illégale au Venezuela ayant débouché le 3 janvier 2026 sur l’enlèvement du président M. Nicolas Maduro et son épouse. Washington affiche son ambition : reconquérir sa sphère d’influence latino-américaine – par la coercition ou le consentement – pour garantir sa suprématie et sa sécurité futures dans l’« Hémisphère occidental » (l’ensemble du continent américain dans le langage stratégique de Washington, du Groenland à la Terre de Feu) face à ses adversaires et rivaux (Chine et secondairement Russie). Note d’actualité réalisée par l’IRIS pour le compte de l’Agence française de développement.
L’article En Amérique latine, l’expansion des droites est apparu en premier sur IRIS.
Lire plus (288 mots)
En 2026, cinq élections majeures se tiendront en Amérique latine. Au-delà des configurations internes propres à chaque pays concerné, ces élections s’inscrivent dans un contexte commun dans une Amérique latine divisée sur le plan idéologique. Ce dernier est marqué par une poussée des forces de droites conservatrices, religieuses (catholiques et évangéliques) et d’extrême droite au détriment des gauches locales et par le retour agressif des États-Unis dans la région après leur intervention militaire illégale au Venezuela ayant débouché le 3 janvier 2026 sur l’enlèvement du président M. Nicolas Maduro et son épouse. Washington affiche son ambition : reconquérir sa sphère d’influence latino-américaine – par la coercition ou le consentement – pour garantir sa suprématie et sa sécurité futures dans l’« Hémisphère occidental » (l’ensemble du continent américain dans le langage stratégique de Washington, du Groenland à la Terre de Feu) face à ses adversaires et rivaux (Chine et secondairement Russie).
Note d’actualité réalisée par l’IRIS pour le compte de l’Agence française de développement.
L’article En Amérique latine, l’expansion des droites est apparu en premier sur IRIS.
- GÉNÉRALISTES
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- La Tribune
- Time France
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie