Accès libre
25.07.2024 à 17:39
Sébastien Rome : « Le phénomène majeur est la convergence ordo-libérale du centre et du RN »
Guillemette Magnin
Texte intégral (4010 mots)
En 2022, Sébastien Rome avait été élu député de la 4e circonscription de l’Hérault, sous l’étiquette de la France insoumise. Cet ancien professeur des écoles originaire de Nîmes avait gagné au second tour, d’une courte tête, face à la candidate du Rassemblement national. Deux ans plus tard, c’est l’extrême-droite qui l’emporte. L’implantation historique du RN sur le pourtour méditerranéen est désormais observable partout en France. Comment expliquer la dynamique de ce parti, la stabilisation et la diversification à la fois géographique et sociologique de son électorat ? Quelles leçons la gauche doit-elle en tirer, en dépit de sa majorité relative à l’Assemblée nationale ? Retour sur une campagne éclair dans l’ancien « Midi rouge ».
LVSL – Comment expliquez-vous l’ancrage et la progression du Rassemblement national dans votre circonscription, la 4e de l’Hérault, et plus globalement dans votre région ?
Sébastien Rome – La progression du RN est nationale. Elle a commencé dans le sud, mais elle concerne aujourd’hui toute la France, tous les territoires, même les banlieues. Le RN a d’abord remplacé la droite qui a déçu, jugée trop libérale par les uns et trop laxiste avec l’immigration par les autres. Son image est alors celle d’un parti qui va rétablir l’ordre dans la société. Puis il a remporté un électorat âgé, libertaire en 1968, qui fut ensuite électeur du PS et de Bayrou, que Macron a radicalisé, qui refuse de revenir à gauche, limitant la République à lui-même pour protéger ce qu’il a acquis dans les années « glorieuses » de la France.
Les difficiles reports de voix au second tour, largement freinés par le « ni-ni », ont logiquement offert plus de sièges au RN, suivant une logique de protection du capital. Toutefois, par un travail de terrain, la gauche peut progresser et résister à la vague RN. Dans ma campagne de 2022, il y a eu 14% de votes blancs et nuls au second tour. En 2024, c’était 9% ; à 8% je gagnais. Cela s’est joué à peu.
« Le phénomène majeur des deux dernières années est la convergence ordo-libérale du centre et du RN. »
Ainsi, le phénomène majeur des deux dernières années est la convergence ordo-libérale du centre et du RN. D’un côté, le RN a abandonné le peu de mesures sociales qu’il portait pour s’attirer les bonnes grâces du pouvoir économique – qui le lui rend bien dans les médias. De l’autre, la Macronie a adopté de nombreuses mesures du RN (port de l’uniforme à l’école et classes de niveau, fin du repos hebdomadaire pour les vendangeurs, préférence nationale, loi immigration…) croyant attirer ses électeurs. Ce faisant, elle a tout simplement légitimé l’original, plutôt que la copie, et ouvert un passage des électeurs de droite et du centre vers le RN.
Enfin, les effets du tourisme de masse sont ravageurs du point de vue social, environnemental et économique. Les taux de chômage dans le sud (la zone d’emploi avec le plus de chômage en France est Pézénas-Adge, depuis des années) sont parmi les plus hauts de France. L’inflation immobilière renforce l’enrichissement de certains et prive les jeunes locaux de la possibilité de se loger sur place. Rien n’est mis en place pour accueillir les travailleurs saisonniers qui ont tant perdu avec les réformes du chômage successives. Le bilan environnemental, en termes de consommation d’espace agricole et d’eau pour trois mois d’activité, doit nous interroger. L’installation de nouvelles populations, notamment de retraités, qui n’ont pas pris les habitus locaux, sur un temps très court, coïncide avec les très hauts scores du RN.
Il est temps de penser à l’installation d’activités économiques de production et d’arrêter avec une économie de la consommation. Dans le sud, ce sont des gens qui ne sont pas d’ici qui vendent et consomment le plus de produits fabriqués ailleurs. Le côté méditerranéen est un décor, pas un support à la création de richesses.
LVSL – La campagne a été extrêmement courte : un mois si on inclut l’entre-deux-tours. Quelles ont été les implications de cet agenda très particulier pour vous, sur le terrain ?
S.R – D’abord, l’impression d’avoir basculé dans un moment politique historique dès le dimanche soir de la dissolution. Le lundi matin, je me réunissais avec mon équipe. Le lundi après-midi, un premier tract était conçu et je lançais un appel à un premier rassemblement. Le mercredi, lors du rassemblement, les premières équipes de citoyens non encartés étaient prêtes à partir en campagne. Ils ont reçu les tracts et ont directement commencé à les distribuer.
Ce fut très efficace et rapide. Près de 400 personnes ont participé. Je les en remercie chaleureusement, car ce fut une belle expérience humaine et joyeuse. Nous avons tenu 12 réunions publiques, en plus des distributions sur le marché, des porte-à-porte, des appels téléphoniques, de la participation aux fêtes locales, la presse… La circonscription est immense. Elle englobe quatre-vingt-dix-neuf communes très espacées les unes des autres, du bassin de Thau jusqu’au Larzac avec les Cévennes, le Pic Saint Loup et la Vallée de l’Hérault. La brièveté de la campagne a catalysé les énergies du pays.
LVSL – Les thèmes de la campagne étaient-ils les mêmes en 2024 qu’en 2022 ? Quels éléments de votre mandat avez-vous mis en avant ?
S.R – Pendant cette campagne éclair, le national a tout écrasé. La candidate RN, parachutée, n’a même pas mis son visage sur les affiches, ni sur les professions de foi. Jordan Bardella et Marine le Pen étaient les seuls arguments du côté du RN.
De mon côté, j’ai tenté de « localiser » ma campagne. J’ai mis en avant mon travail de terrain reconnu par tous, même par la presse locale, pourtant peu aimable avec la France insoumise habituellement. J’ai mis en avant ma personnalité : je suis un enfant du pays, qui connait les habitudes, les manières de dire et de faire. J’ai aussi montré ma capacité à faire du consensus localement comme à l’Assemblée nationale, autour de textes d’enjeu majeur pour ce territoire : la mobilité, l’accès à la santé et la défense des services publics, le droit à l’emploi… J’ai eu un vrai bilan à défendre malgré un mandat de seulement deux ans.
LVSL – Depuis la formation du Nouveau Front Populaire, on entend dans les médias beaucoup de commentaires sur l’hétérogénéité de cette alliance. Comment l’union de la gauche a-t-elle été perçue dans votre circonscription ? Est-ce ou non un enjeu pour les électeurs ?
S.R – Personnellement, avant la Nupes, j’étais pour l’union de la gauche et des écologistes. Je l’ai prouvé à de nombreuses reprises comme lors des départementales de 2021 où j’étais en binôme avec Julia Mignacca, aujourd’hui présidente du conseil fédéral d’EELV. C’est la condition pour gagner ici et j’ai une fibre à chercher ce qui unit.
L’union de la gauche est une des raisons qui font que je me reconnais dans la figure de Jean Jaurès. Cette figure cherchait à unir non seulement les « sectes » socialistes mais aussi le « petit pays » du Midi Rouge, le « grand pays » qu’est la nation républicaine française, les peuples, l’humanité et…même l’humain avec la nature. Cette terre viticole est marquée par la présence de Jean Jaurès. Il y a un souhait d’union inconscient chez les électeurs de gauche.
LVSL – Les derniers scrutins ont confirmé la progression de l’extrême-droite dans la France rurale et périurbaine. À l’exception de Nice ou de Perpignan, les grandes villes restent principalement à gauche. Pourtant, vous avez récemment exprimé votre désaccord avec l’analyse de François Ruffin autour de « la France des bourgs » et « la France des tours ». Pourquoi son cas, en Picardie, constitue-t-il une exception, selon vous ?
S.R – La question n’est pas d’avoir des impressions vagues à des fins de communication, mais de connaître la France et la littérature scientifique sur ce sujet. La première impression vague, qui consiste à généraliser le cas de la Somme, est une erreur intellectuelle majeure. Imaginons que nous généralisions le cas des Pyrénées Orientales : la ville-centre vote RN et les villages votent NFP. L’ouest de la France donne des majorités à Renaissance et au NFP. Il n’y aurait pas d’ouvriers blancs dans l’ouest ? C’est la principale zone de création d’emploi industriel.

François Ruffin, malheureusement, reprend la lecture de Christophe Guilluy, largement démenti par toute la communauté scientifique. Il explique que nous [la gauche] aurions tout donné aux quartiers populaires – et donc aux immigrés – et que l’État a abandonné les territoires ruraux – et donc les blancs. La rhétorique est la même chez François Ruffin : la France insoumise ne s’occuperait que des quartiers et oublierait les territoires ruraux. Bien sûr, le RN veut désavantager les quartiers les plus pauvres pour flatter les campagnes, quand François Ruffin veut les réconcilier. Mais il accepte les règles du jeu fixées par cette grille de lecture, séparant les uns et les autres, au lieu d’inventer un autre discours.
« La relation territoriale que l’on observe fréquemment est plutôt un rapport entre la centralité, qui vote à gauche, et la périphérie, qui vote RN à toutes les échelles de territoires. »
La seconde impression vague, qui suit la première, consiste à croire que le NFP, et notamment la FI, ne progresse ou n’est devant le RN que dans les plus grandes villes. Albi, Apt, Avignon, Amiens, Abbeville, Etampes, Gap, Limoges, Le Mans, Mende, Valence…mais aussi de nombreuses petites villes autour de 10.000 habitants ont pourtant vu une progression de la gauche ! La règle est plutôt la suivante : plus grande est la ville, plus importante sera la probabilité d’un vote de gauche élevé.
La relation territoriale que l’on observe fréquemment réside plutôt dans un rapport entre la centralité, qui vote à gauche, et la périphérie, qui vote RN à toutes les échelles de territoires. Dans les petites centralités, on retrouve majoritairement le secteur public comme employeur – malgré toutes les difficultés qu’il rencontre – et des personnes aux revenus faibles (moins de 1250€ par foyer) qui ne votent pas, votent RN (38%) mais aussi NFP (35%). C’est particulièrement vrai dans l’arc méditerranéen où le RN a gagné pratiquement toutes les circonscriptions. Si on regarde de loin, seules les villes de Montpellier, Avignon et Marseille ont « résisté ». On observe là l’effet du découpage territorial et celui du tourisme de masse, dont j’ai parlé, qui pèse dans le résultat final. Si on regarde de plus près, on retrouve en Piémont, dans les montagnes et autour des petites centralités, un vote NFP.
« Dans la position de la France insoumise, il y a un angle mort pour porter des solutions dans les petites villes et les territoires ruraux qui ne se limitent pas à l’agriculture. »
Les cartographies d’Hervé le Bras analysant les aspects culturels et historiques du vote, localisés sur des terres, sont efficaces pour prédire les résultats d’une élection. C’est donc la lecture globale des villes contre les campagnes que je conteste, à partir de la recherche en sciences sociales mais aussi de mon expérience de terrain. Il y a des tours dans les bourgs. Il y a aussi des flux entre les tours et les bourgs : les habitants des tours vont vivre dans les bourgs dès qu’ils ont un emploi et inversement, quand ils vivent dans un logement insalubre de centre-ville, et qu’ils espèrent avoir une place dans une tour.
Dans la position de la FI, il y a un angle mort pour porter des solutions dans les petites villes et les territoires ruraux qui ne se limitent pas à l’agriculture. C’est tout le travail que j’ai commencé, avec d’autres, durant les deux dernières années, avec la volonté d’élargir notre espace politique. Nous avons constitué un groupe de députés ruraux et commencé un travail novateur. Ce travail continue. Mes propres travaux portaient sur les enjeux de ces territoires : réhabiliter les centres anciens, se déplacer, travailler, accéder aux services publics.
LVSL – D’après vous, le vote pour le RN est plus un vote de rejet que de pauvreté. La classe moyenne inférieure, qui vote majoritairement pour l’extrême-droite, est composée de travailleurs – dont de nombreux fonctionnaires – éprouvant des difficultés à boucler leurs fins de mois. Pourquoi la gauche ne parvient-elle pas ou plus à lui parler ?
S.R – Si l’on considère les choses à l’échelle intercommunale, les familles qui travaillent, avec des revenus leur permettant d’avoir accès au crédit pour acheter une maison en lotissement (fonctionnaires catégorie C, artisans ou ouvriers, personnels du soin, manutentionnaires, caristes, caissiers, vendeurs, retraités…) s’installent en périphérie des petites centralités. Ainsi, on retrouve souvent une sorte d’effet d’halo. Le centre plus pauvre vote à gauche et sa périphérie avec des revenus supérieurs (sans être CSP+) vote RN. Quand on parle avec ces personnes qui vivent dans la couronne des petites centralités, très clairement, il y a une volonté de se distinguer des « cas-sos » (« cas sociaux » qui vivraient bien des aides de l’État) et de ne pas se mélanger. Le racisme n’est alors jamais très loin.
« Le programme, qui est notre pierre angulaire à gauche, est un élément secondaire du vote. Ce que l’on représente, ce que l’on incarne compte bien plus. »
C’est la voiture qui permet de spécialiser les espaces sociaux (zone commerciale, zone dortoir, zone de travail). Elle implique que les nouvelles personnes installées ne se fondent pas vraiment dans le village. Le lien social se perd et les locaux ne reconnaissent plus leur village. Au final, les uns et les autres votent RN pour des raisons différentes. Dès que celles et ceux qui s’installent ont des revenus plus élevés, de plus hauts diplômes, du fait de la déconcentration de la métropole, le vote de gauche se réinstalle par réimplantation des habitudes de la ville. Il n’est pas étonnant que le RN veuille baisser le niveau de formation des jeunes et les envoyer le plus tôt possible sur le marché du travail : c’est son électorat.
Par ailleurs, à gauche nous oublions parfois que les électeurs votent plus souvent avec leurs tripes qu’avec leur tête. Le programme, qui est notre pierre angulaire à gauche, est un élément secondaire du vote. Ce que l’on représente, ce que l’on incarne, compte bien plus. C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut lire nos scores, si haut dans les quartiers populaires. Nous sommes la seule force politique qui affirme que l’on ne juge pas un Français sur sa religion, sa couleur de peau, ses habitudes alimentaires, vestimentaires, sur ces manières de parler ou son accent mais sur son statut de citoyen ayant le droit de vote. C’est ce que Jean-Luc Mélenchon nomme la Nouvelle France. Or, à quelques kilomètres des grandes villes, il y a aussi des Français qui ont des habitudes, des imaginaires, des croyances différentes. L’héritage de la France des territoires est aussi une composante de cette Nouvelle France qui se grandit, comme son histoire de l’immigration l’a prouvé, par accumulation successive des cultures.
« Il est important pour les dominants de légitimer leur autorité sociale sur les dominés par l’institution d’une culture légitime, qui a pour fonction de délégitimer les cultures populaires. »
Pour le dire autrement, et avec Pierre Bourdieu, une des fonctions de la culture des musées, des livres et des spectacles est de faire croire qu’il y a des choses qui sont interdites à certains. Il est important pour les dominants de légitimer leur autorité sociale sur les dominés par l’institution d’une culture légitime, qui a pour fonction de délégitimer les cultures populaires. Or, il y a des pratiques culturelles populaires, de fêtes, de jeux, de traditions qui ont une valeur que nous recherchons à gauche : réunir la Nouvelle France et faire communauté nationale.
On ne peut pas représenter le peuple sans faire une part à sa culture. Jean Jaurès lançait à la chambre des députés en 1910 : « Oui, nous avons, nous aussi [la gauche face aux réactionnaires], le culte du passé. Ce n’est pas en vain que tous les foyers des générations humaines ont flambé, ont rayonné ; mais c’est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau, c’est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux ; nous en avons pris la flamme, vous n’en avez gardé que la cendre. » Le NFP est l’hérité du foyer des aïeux. Il nous faut entretenir la flamme.
LVSL – Pensez-vous néanmoins que certains thèmes ou certains positionnements de la gauche constituent des repoussoirs pour cet électorat acquis à l’extrême-droite ?
S.R – On entend beaucoup, dans les médias, que cet électorat serait « anti-tout ». C’est la surface des choses. Plus fondamentalement, le thème de l’égalité est majeur, mais il s’exprime en tout sens. Entre les riches et les pauvres bien sûr, mais aussi entre personnes de la même condition sociale ; c’est le voisin qui a eu un poste à la mairie « par piston » ou les « cas-sos », « les gris » qui ont un logement HLM en priorité… Tout cela ne repose souvent sur rien. Mais les perspectives de progrès collectif sont tellement bouchées que c’est une guérilla sociale.
Le racisme devient alors un signe de reconnaissance sociale pour les électeurs du RN. Dans les deux premières minutes d’une rencontre, un propos raciste est prononcé. Le sociologue Félicien Faury décrit bien cette réalité qui sert d’appel à l’autre où on lui dit « hein, tu es comme moi ou pas ? ». Par contre, la famille « arabe » dans le lotissement, dans la villa d’à côté, dont le mari est éducateur spécialisé et la femme infirmière, « c’est pas pareil ». Malgré ce racisme réel, nous ne pouvons pas réduire les électeurs du RN à cela. C’est encore moins vrai pour les électeurs ruraux ! Si nous refusons l’assignation sociale, nous n’avons pas à la reproduire. Les êtres humains sont des infinis, disait Émile Durkheim. Nous devons donc ouvrir des chemins positifs dans lesquels ces électeurs peuvent aussi se reconnaître.
« Nous devons saisir ce qui fait lien dans cette culture populaire. Nous ne devons pas la délégimiter. »
Je prendrai l’exemple du barbecue qui a valu beaucoup de critiques à Sandrine Rousseau. Oui, la gestion du feu est genrée, ce sont les hommes qui tiennent les pinces. Mais le barbecue, c’est aussi un rapport positif au monde : l’accès à un extérieur, à la convivialité et à l’invitation du voisin. Nous devons saisir ce qui fait lien dans cette culture populaire. Nous ne devons pas la délégimiter. L’autre aspect, c’est que la gauche ne promeut pas suffisamment d’élus issus de la diversité populaire française, pour que les électeurs se sentent représentés. Les Français doivent se voir en reflet avec leurs élus et la gauche a le devoir d’être exemplaire sur ce point.
Au final, ce qui est le plus repoussoir pour un vote de notre côté, c’est la gauche qui a déçu, c’est la gauche qui a trahi. Alors, nous ne devons pas manquer à notre devoir de tenir parole. De tenir parole, une première fois, puis la fois suivante et encore la suivante. Quand on perd la confiance d’une personne que l’on a aimé, il faut de nombreuses preuves d’amour pour refaire lien. La démocratie se définit par le contrôle des représentants par le peuple. Le NFP doit être cette occasion pour que le peuple redise à sa gauche qu’il peut lui faire à nouveau confiance, mais pas en étant simplement spectateur des décisions et des jeux des partis. Mes électeurs me le demandent. Nous nous retrouverons le 21 septembre pour prendre acte de ce nouveau contrat social. Aujourd’hui, demain ou prochainement, nous devons aboutir à ce nouveau contrat social avec la France.
24.07.2024 à 20:25
Le retrait de Joe Biden sauvera-t-il le Parti démocrate ?
Branko Marcetic
Texte intégral (1693 mots)
Le retrait de Joe Biden est-elle une bonne nouvelle pour le Parti démocrate ? Au-delà de son âge, le candidat avait abandonné ce qui avait permis le succès de sa campagne quatre ans plus tôt : la défense d’un programme politique de redistribution. Celui-ci avait permis, en 2020, la mobilisation de la base militante et de l’aile progressiste du Parti démocrate. En 2024, Joe Biden avait renoué avec une stratégie plus traditionnelle, focalisée sur la dénonciation du danger trumpiste, et centrée sur les classes moyennes. Une voie dont Kamala Harris ne déviera sans doute pas, et qui rappelle tristement celle empruntée par Hillary Clinton en 2016…
La dynamique en faveur de l’éviction de Joe Biden s’était renforcée parmi les démocrates au vu des mauvais sondages qui avaient fait suite à sa prestation ratée lors du dernier débat avec Donald Trump. La tentative d’assassinat contre ce dernier ayant fait exploser sa popularité, le retrait de Biden s’imposait. La succession de Kamala Harris est-elle pour autant une bonne nouvelle pour les démocrates ?
Le retrait de Joe Biden aurait pu être l’occasion, pour le Parti démocrate, de faire son aggiornamento sur la direction dans laquelle il l’avait entraîné au cours des dix-huit derniers mois. D’autant que ces deux dernières années étaient riches en enseignement quant aux stratégies efficaces et perdantes.
La stratégie du barrage au trumpisme, qui avait prévalu en 2016, consistait à répéter aux électeurs qu’il n’y avait pas d’alternative entre le Parti démocrate et le chaos. Elle a manifestement échoué. En 2020, une stratégie alternative avait été couronnée de succès : il s’agissait de faire cause commune avec les progressistes afin de proposer un programme ambitieux en matière sociale favorable aux classes populaires.
D’innombrables facteurs ont bien sûr joué dans les deux résultats – notamment l’impopularité de Trump, l’indignation et la lassitude que sa présidence chaotique avait suscitées. Mais comme de nombreux commentateurs l’ont souligné à l’époque et depuis, les efforts de Joe Biden – sans commune mesure avec ceux de Hillary Clinton – pour séduire les progressistes et unifier le parti ont permis de rassurer les sceptiques, de dynamiser les électeurs progressistes et les classes populaires et de motiver les militants de base à faire du porte-à-porte. Joe Biden avait ainsi offert un contrepoids à la stratégie cynique de Donald Trump consistant à dégeler des aides sociales éphémères et à effectuer des injections monétaires de dernière minute – qui lui ont cependant permis d’obtenir des résultats finaux assez surprenants.
Pourtant, quand bien même ces événements se sont déroulés il y a tout juste quatre ans – et quand bien même il s’agissait de leur propre stratégie gagnante – Joe Biden et son camp ont inexplicablement décidé de réitérer la stratégie de 2016.
Le jour de sa démission, le candidat Biden n’avait toujours pas de programme politique ; lors de ses apparitions publiques ou sur son site Internet, c’est à peine s’il mentionnait ce qu’il comptait accomplir au cours de son second mandat. Il semblait avoir renoncé aux propositions populaires qu’il avait échoué à imposer, comme la gratuité de l’enseignement supérieur ou l’abaissement de l’âge d’éligibilité à l’assurance-maladie. Face aux préoccupations croissantes des Américains, le président et son entourage ont simplement refusé de prendre au sérieux leurs inquiétudes.
Selon plusieurs sources, il s’agirait d’un choix délibéré de Biden et de ses conseillers, convaincus qu’il leur suffisait de ressasser que Donald Trump représente une menace pour gagner en novembre – même si cette approche a vu Joe Biden constamment distancé dans les sondages, malgré la condamnation pénale de l’ancien président et ses projets de plus en plus fous en vue d’un second mandat. Joe Biden et son équipe attendaient-ils que de bonnes nouvelles tombent du ciel – comme un hypothétique abaissement des taux de la FED – pour inverser les courbes ?
Pire encore : c’est vers les électeurs les plus conservateurs que Joe Biden avait manifestement décidé de se tourner, partant du principe que les électeurs de gauche n’auraient d’autres choix que de lui donner leur suffrage.
Cette année, Joe Biden a arraché deux victoires politiques, pour lesquelles il a remué ciel et terre : Les deux principaux combats politiques qu’il a arrachés cette année – remuant ciel et terre – ont été une nouvelle restriction du droit d’asile et l’affectation de 100 milliards de dollars à des guerres à l’étranger – après avoir depuis longtemps rompu avec son vœu d’une « politique étrangère en faveur de la classe moyenne ». Ces mesures ne l’ont manifestement pas aidé à gagner la confiance des électeurs républicains et, dans le cas de la guerre hautement impopulaire contre Gaza, elles ont déchiré son parti – et provoqué des levers de boucliers de la part d’un large éventail d’électeurs autrement fidèles aux démocrates.
Écarter le candidat Biden de l’équation permettra-il le retour à une stratégie similaire à celle de 2020 ? Cela nécessiterait de s’appuyer sur un programme audacieux, qui mettrait l’accent sur la lutte contre la précarisation économique dont souffrent les Américains. Le travail est déjà pré-mâché : il suffirait aux démocrates de défendre les idées les plus populaires que Biden a abandonnées après 2021 : salaire minimum à 15 dollars, programme universel d’éducation préscolaire, subventions pour la garde d’enfants, formule d’assurance maladie publique, dont il a d’ailleurs cessé de parler depuis son élection. La question du logement, préoccupation majeure pour les jeunes électeurs démocrates, pourrait constituer un axe stratégie central – l’occasion de défendre des mesures de plafonnement national des loyers, comme l’a proposé Bernie Sanders en 2020. Ce sont de telles mesures qui ont permis à Claudia Scheinbaum, successeur du président mexicain d’Andrés Manuel López Obrador (« AMLO ») de remporter une victoire écrasante lors du premier tour des dernières élections.
Plus urgent encore peut-être : un changement radical de cap sur la question de Gaza pourrait relancer la dynamique en faveur des démocrates. La politique israélienne du camp Biden – soutien inconditionnel à l’État d’Israël – s’est avérée catastrophique sur le plan électoral. Outre qu’il est devenu une figure détestée dans une partie de l’opinion publique – au point d’être physiquement empêché de faire campagne sur les campus universitaires -, le conflit menace d’éclater à tout moment en une guerre régionale calamiteuse, qui pourrait entraîner les États-Unis vers une énième confrontation militaire, que la majorité des Américains ne souhaitent pas. Au successeur de Joe Biden revient la lourde tâche d’éviter un nouveau bourbier au Moyen-Orient, et de laver l’honneur des démocrates sur la question palestinienne.
Un changement de cap improbable si l’on considère le curriculum de Kamala Harris – sauf si la force des choses contraint les démocrates à renouer avec une stratégie victorieuse ?
24.07.2024 à 12:46
« Project 2025 » : une plateforme pour réconcilier Trump et l’establishment
Pierre Mourier
Texte intégral (3550 mots)
Contrairement à 2016, la campagne de Donald Trump est activement soutenue par l’establishment du Parti républicain. Une institution a joué un rôle central dans ce rapprochement : la Heritage Foundation. Ce think tank rassemble un bataillon « d’experts » et d’hommes d’influence qui avaient obtenu des postes de premier plan dans l’administration Trump. Avec son « Project 2025 », programme de 922 pages qui a défrayé la chronique médiatique, il entend imprimer sa marque sur le candidat Trump. Et le mener vers un agenda plus nettement interventionniste sur les questions de politique étrangère.
Le 15 juillet 2024 démarrait dans l’État du Wisconsin la convention du Parti républicain. C’est sans surprises que Donald Trump fut investi candidat. Victime d’une récente tentative d’assassinat, il se trouvait sous l’œil des caméras. Sous les radars médiatiques, des présentations étaient organisées par les think tanks liés au Parti républicain : la Faith and Freedom Coalition, l’America First Policy Institute et bien sûr l’incontournable Heritage Foundation.
Ces trois think tanks sont emblématiques de l’évolution du parti. Si la Heritage Foundation est le laboratoire historique des conservateurs, Faith and Freedom ne remonte qu’à 2009 quand l’America First Policy Institute a été créé en 2021. Le premier est une plateforme unissant la droite chrétienne et des groupes proches du Tea Party, quand le second est le bras armé du trumpisme (dans son conseil d’administration on trouve Ivanka Trump, fille de l’ancien président).
À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’American Enterprise Institute. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.
Ces think tanks constituent un véritable écosystème autour du Parti républicain. En 2016, la victoire de Donald Trump aux primaires républicaines avait constitué un séisme : sa campagne populiste et ses propos erratiques avaient violemment divisé les think tanks conservateurs. La Heritage fut le seul à réellement tirer profit de la situation.
Depuis sa défaite de 2020, la mainmise de Donald Trump sur le camp conservateur n’a fait que s’accroître. Mais dans le même temps, les think tanks entendaient bien imprimer leur marque sur l’opposant à Joe Biden, plutôt que de devoir s’adapter à une situation nouvelle, comme ce fut le cas en 2016.
Aux origines de la « Heritage »
C’est la fin de la Seconde guerre mondiale qui marque la première explosion de « think tanks ». Il s’agit alors de fournir des synthèses d’experts à des élus. Sous la tutelle du secteur privé ; ainsi, la Douglas Aircraft Company accouche de la RAND Corporation en 1946, avec pour objectif de travailler sur les conflits internationaux et la balistique transcontinentale. Fonds privés, expertise et liens avec le pouvoir politique : la recette devait faire mouche. Et la Heritage Foundation allait devenir son produit le plus emblématique.
Elle naît d’une conversation entre deux assistants parlementaires, Edwin Feulner et Paul Weyrich, à la cafétéria du Congrès des think tanks conservateurs en 1971. L’American Enterprise Institute (AEI) avait alors renoncé à publier un rapport concernant l’aviation, craignant que celui-ci influence les votes au Congrès. Or, Feulner et Weyrich, qui perçoivent le potentiel politique des think tanks, entendent justement peser sur les votes. Ils appellent de leurs voeux un organisme qui proposerait des argumentaires aux élus du Congrès.
La Heritage Foundation voit ainsi le jour, avec le soutien du groupe industriel Coors. Elle accompagne une dynamique plus générale de politisation des think tanks et d’accaparement par les lobbys, qui cherchent à les instrumentaliser. À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’AEI. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.
La Heritage Foundation adopte une approche résolument activiste. Son bras armé, « Heritage Action », rassemble ses « analystes » qui vont directement au contact des élus, au Congrès ou dans les États, afin de les convaincre d’adopter les positions de l’institut. Un artifice qui permet aux lobbyistes présents au sein du think tanks d’être maquillés en « analystes » lors des auditions du Congrès…
Le think tank connaît son heure de gloire en 1980, avec la publication d’un « Mandate for Leadership ». Mastodonte de 3000 pages, le document synthétise les propositions du camp conservateur pour l’élection présidentielle. Une fois élu, Ronald Reagan devait fournir à chacun de ses ministres une version abrégée du document (de 1100 pages). 60% des propositions du think tank seront ainsi reprises par le président.
La Heritage Foundation connaîtra des relations plus difficiles avec H. W. Bush, notamment sur la question des hausses d’impôts. Quelques années plus tard, c’est finalement un président démocrate que l’organisation soutient et conseille. Bill Clinton défend en effet des accords de libre-échange, notamment l’ALENA [entre le Canada, les États-Unis et le Mexique NDLR], en accord avec le positionnement libre-échangiste du think tank. Acteur clef de la nébuleuse conservatrice, la Heritage Foundation était en butte à la concurrence de deux autres géants : le Cato Institute et l’AEI.
Concurrence libertarienne et néoconservatrice
Le Cato Institute voit officiellement le jour en 1976, mais sa création, sous le nom de « Charles Koch Foundation », est antérieure de deux ans. Le nom des frères Koch continue de figurer en haut de la liste des donateurs réguliers, aux côtés de ceux du milliardaire Sheldon Adelson ou de la famille Mercer. La Koch Industry est spécialisée dans le secteur primaire, l’extraction de ressources minières et de transformation des matière premières. La ligne libertarienne défendue par l’institut recoupe assez largement les intérêts des frères, lorsqu’il s’agit de prôner un adoucissement des normes – notamment environnementales – sur ces secteurs d’activités.
Si les fonds du Cato Institute proviennent majoritairement de l’industrie du tabac et du pétrole, le think tank – fait notable pour un institut conservateur – ne boude pas les financements d’entreprises « progressistes » de la Silicon Valley, notamment Facebook ou Google. Une porosité peu surprenante si l’on considère la sensibilité libertarienne du think tank.
Conséquent dans son libertarianisme, il s’est ainsi opposé aux politiques bellicistes des présidents Bush, en particulier à une occupation de long terme de l’Afghanistan et de l’Irak. Et il se prononce en faveur de la disparition des barrières douanières et de la libéralisation complète des marchés, ce qui lui permet notamment de bénéficier du financement de CME, groupe financier qui détient la bourse de Chicago…
L’AEI, quant à lui, prétend s’inscrire dans le sillage du philosophe Leo Strauss et se spécialise dans la production de rapports. Influent depuis les années 1940, il connaît une perte de vitesse consécutive à l’apparition de la Heritage Foundation, et il faudra attendre les années 2000 pour qu’il regagne en importance. Il est alors proche de l’extrême-droite – avec des auteurs comme Richard Murray, eugéniste, ou encore Dinesh D’Souza, qui défend que l’antiracisme est une réaction pathologique et que les esclaves afro-américains étaient plutôt bien traités…
Ici encore, le lien entre financements et rapports est de plus directs. Financée par l’industrie du tabac, l’AEI produit de nombreuses études pour tempérer sa nocivité ; financée par le secteur des télécommunications, elle s’oppose à la neutralité d’internet.
À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence est proche de l’institut.
Surtout, l’institut est le principal pourvoyeur de l’administration Bush – à tel point que peu après son élection, le président s’est rendu au siège de l’AEI pour remercier ses membres. Hébergé par l’AEI, on trouve le Project for the New American Century de Dick Cheney, dont l’influence sur la politique étrangère de George W. Bush a été conséquente. Sans surprises ici également : l’AEI est abondamment financé par les entreprises du complexe militaro-industriel…
#NeverTrump : la ligne de fracture au sein des think tanks
L’investiture de Donald Trump comme candidat républicain et sa victoire de 2016 devaient marquer un séisme dans les relations traditionnelles entre partis et think tanks. La campagne erratique et populiste du candidat n’était pas du goût des organisations conservatrices, qui lui préféraient largement un Jeb Bush. De nombreux cadres du Parti républicain et de think-tanks conservateurs se sont refusés à soutenir Trump – sans résoudre à rallier ouvertement une candidature démocrate. Dans les signatures des tribunes rédigées pour critiquer sa campagne, on trouvait les noms de plusieurs figures des think tanks liés au Parti républicain. Une seule exception : la Heritage Foundation.
L’AEI ne prend que timidement position pour Trump en février 2016 – par le biais d’une tribune publiée par Charles Murray, co-auteur du livre The Bell Curve, livre qui lie « race » et intelligence. Le Cato Institute, au contraire, s’oppose publiquement au président nouvellement élu. Il s’attaque notamment au décret présidentiel 13769, surnommé Muslim Ban. Celui-ci suspend des programmes d’accueil des réfugiés, interdit à tous les Syriens d’être accueillis aux États-Unis. Il a conduit à la détention de 700 voyageurs et à la remise en cause de 50.000 visas. Cette prise de position heurte les plus libertariens des conservateurs qui sont, pour la majorité d’entre eux, favorables à l’immigration – perçue comme le prolongement d’une libéralisation du marché du travail. De même, les mesures protectionnistes de Trump sont vivement critiquées par l’Institut ; il faut dire que la mise en place d’une taxe sur l’acier l’acier menaçait directement les profits des entreprises Koch…
C’est la Heritage Foundation qui profite de la conjoncture. Edwin Feulner, son ancien président, est nommé dans l’équipe de transition du candidat. Dès son élection, ce sont pas moins de soixante-six anciens analystes ou salariés du think tank qui occupent des postes à responsabilité dans la nouvelle administration. À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence et le Procureur général Jeff Sessions sont tous deux proches de l’institut.
Jim DeMint, le président du think tank, décide de pousser l’avantage. L’institut adopte la même stratégie qu’en 1980 et publie un document au titre similaire : « Mandate For Leadership ». Il s’agit de 321 propositions conservatrices à destination du nouveau président. En un an de mandat, la Heritage Foundation affirmait que 64 propositions ont été totalement reprises par l’administration Trump. Ce dernier a même eu recours à l’organisme pour lui fournir une liste de juges conservateurs en vue d’une future nomination à la Cour Suprême.
Le fait que la Heritage Foundation se positionne sur l’ensemble des prérogatives de l’État et l’abreuve de recrues la rend incontournable. Pourtant, en mai 2017, le conseil d’administration retire son poste de président à Jim DeMint, dénonçant une trop grande complicité avec l’administration Trump. Une inflexion qui ne devait pas empêcher la Heritage Foundation de demeurer centrale dans la nébuleuse trumpienne…
L’agenda militariste du « Project 2025 »
« Nous allons connaître une seconde révolution américaine », déclarait le président du think tank Kevin Roberts. « Et elle sera pacifique si la gauche se mêle de ses affaires » devait-il ajouter. En ce début de juillet 2024, il est interviewé par Steve Bannon et s’affiche aux côtés des Républicains tendance « MAGA » [Make America Great Again, slogan de Donald Trump NDLR]. Qu’un président de think tank soit interviewé au micro de l’un des soutiens de la tentative de putsch du 6 janvier peut sembler incongru. Mais la scène est emblématique du chemin parcouru par le Heritage Foundation dans la nébuleuse conservatrice.
Le positionnement central du think tank permet de lancer le « Project 2025 » sur le modèle de « Mandate For Leadership », financé à hauteur d’un million de dollars. Peu à peu, le projet agrège d’autres think tanks et lobbies. Aujourd’hui, pas moins de 110 organisations gravitent autour de la Heritage Foundation – 40% d’entre elles bénéficiant du fonds DonorsTrust alimenté par Leonard Leo. Cet avocat et connaisseur du système judiciaire américain organise des dîners somptueux où il se plaît à jouer les faiseur de rois dans le domaine juridique – jusqu’à la Cour Suprême. On compte d’importants sponsors pour le DonorsTrust : outres les financiers traditionnels de la Heritage Foundation, on trouve… les frères Koch. La présence de ces noms résume à elle seule l’évolution des rapports de force entre ses concurrents et la Heritage Foundation…
Le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump.
Celle-ci espère désormais forcer la main de Donald Trump. Elle a accouché des 922 pages du « Project 2025 », qui a d’abord scandalisé les démocrates par sa proposition d’accroissement des pouvoirs de l’exécutif. Elle fait écho à la tentative, durant le mandat de Trump, de permettre le licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux – le décret avait été remis en cause par Joe Biden. À travers le « Project 2025 », la Heritage Foundation propose de substituer, à la loyauté envers l’État, celle à l’égard du président et à son projet politique.
Au-delà de cet aspect, qui génère des craintes d’une dérive illibérale, le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump. Celui-ci tente, en 2024, de rejouer la partition de 2016, critiquant le complexe militaro-industriel et les faucons du Pentagone. Il faut rappeler combien son arrivée au pouvoir avait alors sidéré le camp néoconservateur. Les déclarations de Trump à propos de l’OTAN et ses promesses de rapprochement avec la Russie avaient fait l’effet d’un séisme. S’il avait par la suite mené une politique étrangère en contradiction complète avec ces proclamations – jusqu’à adopter la posture « la plus dure à l’égard de la Russie depuis la Guerre froide », selon les termes de son administration – et en accord total avec le complexe militaro-industriel, Trump est, encore aujourd’hui, perçu avec méfiance par une partie de l’establishment néoconservateur.
Avec le « Project 2025 », la Heritage Foundation tente d’appuyer l’aile la plus interventionniste et militariste du trumpisme. De nombreuses préconisations ne surprennent guère, notamment concernant l’accroissement du budget militaire et l’intensification de la guerre économique avec la République populaire de Chine. D’autres sont en contradiction avec le discours du candidat : le « Project 2025 » prône un approfondissement du soutien à l’État d’Israël, quand Donald Trump critique timidement les massacres à Gaza.
À rebours de ses déclarations isolationnistes, le « Project 2025 » prône une course aux armements et un accroissement tous azimuts des sanctions financières pour contrer les « menaces » russe et chinoise. Alors que Donald Trump promet de « mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures », le « Project 2025 » envisage de poursuivre le soutien miliaire à Kiev, en échange d’une décrue de l’aide humanitaire. Le document précise qu’il s’agit d’un compromis entre les diverses sensibilités du camp conservateur, des plus russophiles – qui souhaitent un abandon de l’Ukraine – aux plus néoconservatrices – qui envisagent un engagement militaire plus direct. Une synthèse pas très éloignée de la politique actuelle du président Biden…
Sur les questions de société et les réformes institutionnelles, le Projet 2025 s’inscrit dans le conservatisme religieux qui avait caractérisé le mandat de Donald Trump. La Heritage Foundation propose ainsi de faire disparaître le service fédéral de l’éducation, qui serait dévolu aux États. À l’inverse, il est prévu d’étendre à l’échelle fédérale la possibilité de censurer une série de livres (accusés de propager la « culture woke ») dans les espaces scolaires et universitaires – expérimentée par le gouverneur de Floride Ron de Santis.
Enfin, on trouve une série de prescriptions prévisibles sur le plan économique, qui oscillent entre réformes néolibérales et fantaisies libertariennes. Certaines – réduction du budget de l’éducation au profit de coupons permettant aux enfants pauvres de s’inscrire dans les écoles privées – pourraient être directement traduites en politiques publiques par une administration Trump ultérieure. D’autres – abolition de la Réserve fédérale et du dollar comme monnaie internationale – constituent de simples slogans destinés à flatter la phobie anti-étatiste de sa base électorale.
Un simple fantasme des démocrates ?
Quelle importance accorder au « Project 2025 » ? Donald Trump lui-même s’en est distancié, face aux attaques incessantes des démocrates, déclarant « Je ne sais pas qui est derrière ça. Je suis en désaccord avec certaines choses, et certaines propositions qu’ils avancent sont profondément ridicules. Quoi qu’ils fassent, je leur souhaite bonne chance, mais je n’ai rien à voir avec eux ». Des paroles que contredisent frontalement ses liens fusionnels, passés et présents, avec le think tank.
Si Donald Trump devait, en novembre prochain, retrouver le chemin de la Maison Blanche, il est difficile de concevoir que la Heritage Foundation n’aurait pas son mot à dire sur son administration. La liste toute prête « d’experts » prêts à la rejoindre et à gouverner en suivant un plan structuré constitue un indéniable atout. Surtout, si l’on considère la position plus centrale que jamais acquise par la Heritage Foundation, qui est parvenue à satelliser de nombreuses organisations autrefois rivales. La composition de ses principaux donateurs a également changé. Là où les grands groupes pétroliers et les chaînes de supermarchés soutenaient la Heritage Foundation à sa création, les donateurs actuels représentent désormais un pan très large des classes dominantes américaines…
22.07.2024 à 15:48
Une idéalisation des sociétés sans État ? Retour sur « Zomia » de James C. Scott
Loïa Lamarque
Texte intégral (4287 mots)
Comment s’est déroulé le processus de formation des États au cours des deux derniers millénaires ? Quel a été son effet sur le mode de vie des populations des montagnes d’Asie du Sud-Est ? À rebours de l’histoire civilisationnelle classique, l’anthropologue James C. Scott (décédé le 19 juillet 2024) montre au travers d’une ethnographie comment les formes étatiques se sont imposées par la violence et l’assujettissement dans cette région. Et ce, au prix d’une détérioration des conditions matérielles et psychologiques des habitants qui, pour certains, ont préféré la fuite et le nomadisme dans les hautes terres à la réduction à l’esclavagisme. En filigrane de cette ethnographie, Scott dresse un portrait rousseauiste de ces sociétés sans État, présumées plus prospères, égalitaires et pacifiques que les sociétés étatiques – au mépris, parfois, de quelques faits historiques sur les conditions de vie objectives de ces populations.
Un contre-récit de l’histoire civilisationnelle classique
Zomia est un terme issu de plusieurs langues tibéto-birmanes qui signifie « gens de la montagne », et qui, géographiquement, désigne un ensemble de territoires situés à plus de trois cents mètres d’altitude qui s’étend des hautes vallées du Vietnam aux régions du nord-est de l’Inde, traversant ainsi six pays d’Asie du Sud-Est : le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Chine et la Birmanie. Au total, cette zone s’étend sur 2,5 millions de kilomètres carré et est peuplée par près de 100 millions de personnes issues d’une centaine d’ethnies différentes et pratiquant des langues empruntées à cinq grandes familles linguistiques distinctes. À défaut d’une unité ethnique, politique ou géographique, la Zomia rassemble des populations qui partagent de nombreuses caractéristiques, ce qui en fait une entité politique et donc un objet d’étude à part entière.
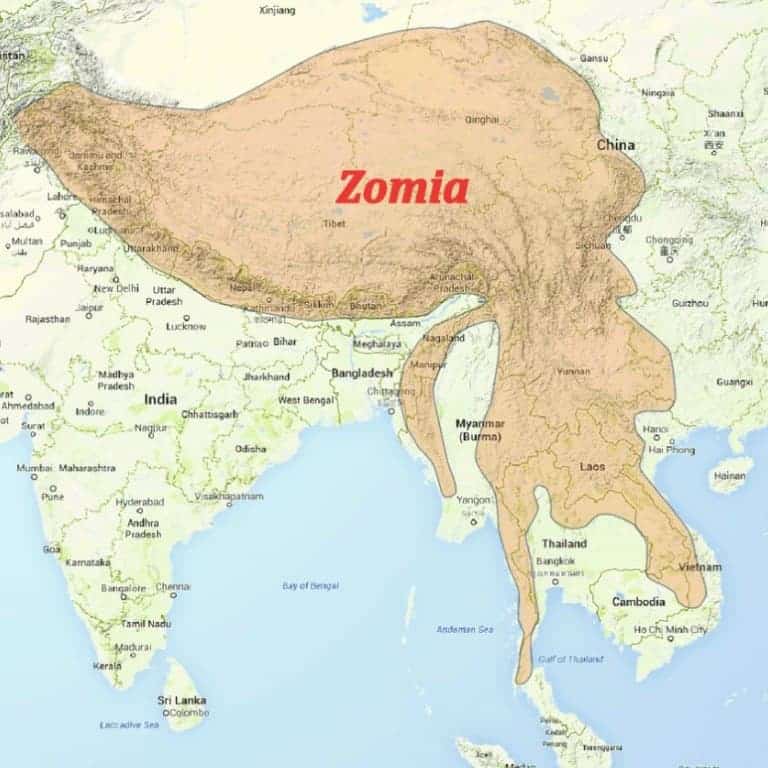
C’est l’histoire de ces peuples que Scott relate dans son ouvrage, une histoire intimement mêlée à celle des États d’Asie du Sud-Est. Si certains des habitants de la Zomia n’ont jamais connu l’État, beaucoup y ont été confrontés et ont choisi la fuite plutôt que l’assimilation et la servitude. À rebours de l’histoire civilisationnelle et évolutive traditionnelle, Scott montre d’une part que l’État n’est pas la forme achevée de civilisation – rappelant les piètres conditions de vie d’une grande majorité de la population étatique asservie – et d’autre part que les peuples des collines ne sont pas de lointains ancêtres qui n’auraient pas évolué. Ils sont au contraire un « effet d’État » : leur mode de production comme leurs structures sociales – nomadisme, égalitarisme, oralité – peuvent être vus comme des stratégies qui facilitent la dispersion et l’exode, mais surtout, adaptés pour empêcher toute institution étatique d’accéder à l’existence. Les peuples des collines sont, écrit-il, « barbares à dessein » : ils ont abandonné l’agriculture sédentaire pour d’autres formes d’organisation souples et propices à la fuite. La Zomia constitue en cela une zone refuge idéale, montagneuse, difficile d’accès, à l’ultra-périphérie des centres étatiques.
Scott entend également renouveler l’épistémologie anthropologique et historique. Tout d’abord, peuples des collines et des vallées n’ont cessé de se mélanger au travers de mouvements de population incessants et réciproques, de commercer, et de coévoluer, les États définissant sans cesse leur identité en opposition avec les « barbares », et qui n’auraient pu voir le jour sans les ressources alimentaires et humaines des collines. En ce sens, Scott s’inscrit, dans la lignée de Pierre Clastres, dans le courant anthropologique constructiviste, rendant ainsi inopérante toute tentative d’essentialisation des deux peuples. C’est enfin l’histoire de l’État que Scott entend renouveler afin de mettre à distance une histoire centrée sur les élites et les centres monarchiques selon laquelle la construction de l’État est un processus stable et inéluctable. À l’inverse, l’auteur dresse une contre-histoire des populations et dépeint le processus d’étatisation comme un épiphénomène à l’échelle de l’humanité, instable par nature et mouvant, se restructurant en permanence autour d’unités politiques élémentaires. Le sous-titre du livre, « Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est » prend alors tout son sens.
Les conditions d’émergence de l’État : plaine, densité de population et assujettissement
Scott commence par décrire le processus de construction des États. D’abord, l’émergence de l’État coïncide avec celle de l’agriculture sédentaire : les ressources, souvent obtenues sous la forme de revenu fiscal ou de rente agricole, sont une condition nécessaire au bon fonctionnement de l’État pour alimenter une bureaucratie ou une cour monarchique. Le foyer étatique doit donc se trouver près d’un terrain à la fois fertile et propice à l’appropriation des richesses, autrement dit être aisément accessible afin de permettre aux percepteurs de lever l’impôt.
L’autre ressource cruciale pour la puissance étatique est la main-d’œuvre, nécessaire pour cultiver les terres mais également pour combattre ou défendre les ressources en cas d’attaque. La formation de l’État est donc fortement contrainte géographiquement : le terrain doit permettre une concentration des ressources et des sujets. En Asie du Sud-Est, ce sont les plaines alluviales propices à la riziculture irriguée qui répondent à ce double impératif. L’absence de relief autour de ces plaines rend possible la circulation des marchandises et le prélèvement de l’impôt. Le rendement par unité de terrain y est élevé et les ressources peuvent donc être concentrées sur un territoire restreint.
Enfin, l’espace étatique est contraint par les frictions de terrain que sont les collines, par les intempéries, les cours d’eau. Il n’est donc jamais, contrairement aux conceptions actuelles de l’État-nation, un territoire nettement délimité. Il s’étend près des cours d’eau et le long des plaines, mais est absent au-delà d’une certaine altitude. Ces territoires difficiles d’accès sont donc une ressource stratégique pour ceux qui souhaitent se tenir à distance de l’État.
Pour s’assurer d’avoir à portée de main une population corvéable et mobilisable en cas de guerre, les bâtisseurs d’État ont le plus souvent utilisé la contrainte, la guerre et l’esclavage, comme en témoignent de nombreuses archives historiques : marquage au fer rouge des esclaves, mention du nombre de prisonniers après chaque bataille, guerres dans l’ensemble peu meurtrières dans la mesure où les perdants étaient capturés et asservis. La contrainte s’applique également aux individus intégrés à l’espace étatique puisque l’État doit faire face à une double difficulté : éviter l’exode de sa population en la fixant, et taxer les rendements agricoles le plus possible – ce que Scott appelle « réduire l’écart entre le PIB sur un territoire et la production recouvrable par l’État ». Pour ce faire, l’une des priorités de l’État est de rendre lisibles et imposables tous les biens marchands et humains. Monoculture et agriculture sédentaires répondent à cette nécessité pour la puissance étatique d’inventorier la production, en dépit de son manque d’efficacité. L’agriculture sur brûlis fut ainsi largement interdite et, jusqu’à nos jours, les États du Sud-Est asiatique continuent de pourchasser les nomades et d’en mépriser la culture.
« Un peuple était considéré comme civilisé dés lors qu’il était soumis à une administration étatique »
Ce dernier point, le mépris de la vie en altitude et du nomadisme, est crucial car il soulève un paradoxe : alors même que les peuples des collines et ceux des vallées étaient des partenaires économiques et qu’il a toujours existé une forte mobilité géographique entre l’une et l’autre région, ceux des collines sont systématiquement essentialisés et considérés comme sauvages. Cette distinction établie par les élites des basses terres entre barbares et civilisés, sauvages et apprivoisés, cru et cuit, relève vraisemblablement d’une volonté des bâtisseurs d’État de discréditer les alternatives à la vie au sein de l’État. Cette séparation des mondes atteint son paroxysme avec la naissance de l’hindouisme et du bouddhisme dans les sociétés birmanes d’Asie du Sud-Est. Ceux qui pratiquent ces religions étant considérés comme raffinés et cultivés, les autres, comme de sauvages païens.
C’est à ce moment d’émergence des États et des religions institutionnelles que se sont construits les récits généalogiques des peuples des hautes terres, considérés comme de lointains ancêtres auxquels il faudrait apporter la culture civilisatrice et qu’il est possible de civiliser étant donné le socle génétique commun. Dans les faits, un peuple était considéré comme civilisé dès lors qu’il était soumis à une administration étatique ou, pour reprendre les termes de l’administration Qing au XVIIIe siècle pour qualifier les habitants des hautes terres du Hainan, dès lors qu’ils « figuraient sur la carte ».
La distinction entre barbares et civilisés tient donc moins à une véritable différence de pratiques culturelles, mais davantage à l’incorporation ou non à un État, et semble servir aux bâtisseurs d’État à discréditer la culture d’une population qui lui échappe. Ces entrepreneurs de morale sont, en d’autres termes, des entrepreneurs d’État.
La Zomia, une zone refuge
La Zomia serait une zone refuge pour les populations souhaitant échapper à la servitude, mais également aux piètres conditions de vie associées à la monoculture : risques de famine causée par la faible diversité agricole, épidémies dues à la plus forte densité de population.
L’ensemble de leurs pratiques culturelles doit ainsi se lire comme des adaptations à la fois pour résister aux invasions étatiques extérieures, et pour empêcher l’étatisation d’advenir au sein de la société. Installation dans les collines difficiles d’accès (dans le Yunnan par exemple), culture sur brûlis et cueillette toutes deux compatibles avec le nomadisme sont adoptées car elles offrent la possibilité de se disperser et empêchent toute forme de taxation. Les structures sociales des peuples des collines sont également calibrées pour résister à la captation et à l’assujettissement. La dissolvabilité de l’organisation tribale et son égalitarisme empêchent d’une part aux États d’entrer en négociation avec les peuples des collines – faute d’identifier ce peuple et d’en trouver l’interlocuteur – et d’autre part l’émergence de chefs au sein du groupe. Les Wa du Nord de la Birmanie refusent par exemple aux plus riches d’organiser des offrandes festives, de peur qu’ils n’aspirent au statut de chef. Les peuples des collines ont par ailleurs un large répertoire de modèles politiques, allant de l’égalitarisme strict des Wa à l’existence de sociétés munies d’un chef héréditaire, comme les Gumsa de Birmanie étudiés par Edmund Leach. Loin d’être figée, leur structure sociale oscille entre ces différentes options politiques, elle est par nature plastique et polymorphe pour faciliter la dispersion et l’adaptation que nécessitent l’évitement de la captation étatique.
De même, l’oralité est une transformation récente de la culture collinéenne à la suite des exodes et relève d’un choix délibéré des tribus qui maintiennent l’illettrisme afin de rendre souples les récits généalogiques. Ainsi, les Akha, les Wa et les Karènes sont dotés d’un récit expliquant l’abandon de l’écriture, toujours lié à un bouleversement écologique ou politique et suggérant alors que ces populations ont délibérément abandonné l’écriture qu’ils maitrisaient autrefois. Sans État, l’écriture perd d’abord fortement son utilité : nul besoin de lire ou rédiger des documents administratifs dans une tribu. L’oralité présente par ailleurs l’avantage d’être plus démocratique, partagée par tous et plus modelable au gré de ce que les individus souhaitent se rappeler en fonction de leurs intérêts. Leur histoire est donc flexible, laissant ainsi la possibilité à un groupe de se scinder et de modifier son récit généalogique en conséquence. Plus radicalement, l’oralité offre la possibilité de se passer de généalogie afin d’éviter à toute institution gouvernante d’émerger au nom d’une légitimité historique.
L’auteur aborde enfin la question de la religion des populations des hautes terres, avec un accent particulier mis sur le millénarisme des Hmong, Karènes et Lahu, populations dotées d’un passé révolutionnaire fort. Le millénarisme s’accompagne en effet d’une croyance dans l’inversion soudaine du monde, des statuts et des fortunes, portant ainsi en germe des révoltes sociales. En tant qu’initiateur de mouvement et d’exode, les croyances millénaristes peuvent elles aussi être comprises comme un atout de plus dans la panoplie des structures sociales fugitives destinées à tenir à distance les États.
L’art de ne pas être gouverné consiste à établir une distance culturelle avec les peuples étatisés et à affirmer le refus de constituer un État. Les Akha d’Asie du Sud-Est ont même bâti leur identité sur ce refus de l’État : un des personnages de leur récit généalogique est un roi du XIIe qui aurait été massacré par son peuple après avoir institué un recensement. Ce récit fait office d’avertissement contre les hiérarchies et la formation d’un État.
Ces exemples montrent donc que, contrairement à ce que voudrait la doxa, ces populations ne sont pas les vestiges des premiers humains. Elles ont elles-mêmes eu des velléités étatistes jusqu’à ce que la menace d’être assujetties par un autre État les pousse à changer d’organisation sociale et à s’exiler dans les collines. Le peuple Tai autrefois étatisé a été repoussé vers l’est et le sud-ouest, comme en témoignent ses pratiques culturelles caractéristiques : religion séculaire, pratique de la riziculture irriguée, autant d’indices qui permettent d’affirmer que ce peuple fut un bâtisseur d’État. De même, la culture sur brûlis ou le nomadisme pratiqué au cours des siècles passés ne précèdent pas la riziculture sur la très contestable échelle de l’évolution sociale : ces pratiques sont, au contraire, des « adaptations secondaires » qui relèvent d’un choix essentiellement politique.
La mosaïque d’identités comme stratégie d’évitement de l’État
Au grand désarroi des administrateurs et des colons, les peuples des collines sont fortement hétérogènes et présentent peu d’unité identitaire interne (linguistique ou culturelle). Sans trait partagé par le groupe, il est donc délicat de définir les contours d’une « tribu », et Scott réfute ainsi la pertinence du terme d’ethnie. Les peuples des collines pratiquent une variété d’agriculture et de culture, et pour cause : ces groupes des collines n’ont cessé d’incorporer d’autres groupes avec qui ils interagissaient en permanence. Tout comme Clastres avait montré que les populations amérindiennes étaient d’anciens agriculteurs sédentaires contraints d’abandonner l’agriculture en raison des conquêtes et de l’effondrement démographique, Scott montre que l’histoire du peuple des hautes terres est intimement liée à celle des basses terres, que ces régions ont été marquées par des échanges symboliques, économiques et humains. L’unité de ces peuples est donc par nature instable et chaotique, ce qui empêche toute classification.
Si le concept d’ethnie est utilisé par les acteurs, ce n’est pas pour mimer la dynamique identitaire des États mais pour défendre leur autonomie et donc pour y résister. Les États eux-mêmes sont fondés sur la combinaison d’une multitude d’ethnies et n’auraient pas, comme le laisserait penser l’histoire nationaliste moderne, une base ethnique mais bien cosmopolite. Pour accréditer leur récit historique, les nations ont gommé les différences antérieures par la coercition et l’uniformisation. C’est donc un « constructivisme radical » qu’adopte ici Scott, postulant que les identités sont par nature multiples et mobiles, artificiellement délimitées par l’État dans le but de contrôler sa population mais également à des fins de catégorisation des territoires voisins.
L’idée développée dans cette partie est radicale et assumée comme telle par Scott : les tribus, au sens d’unités sociales distinctes, sont une pure invention des administrateurs pour classifier et recenser les populations. Les peuples des collines possèdent plusieurs modèles politiques et identitaires qu’ils adaptent stratégiquement en fonction de leur relation avec les États. Ainsi, certains Lahu de Chine ont choisi de s’établir dans les montagnes et de pratiquer la cueillette dans certaines circonstances, et, dans d’autres, d’adopter un mode de vie sédentaire au sein de villages agricoles. En 1973, plusieurs d’entre eux quittèrent les basses terres de la Birmanie après qu’une révolte contre l’État birman eut échoué pour se réfugier dans les collines.
L’auteur déplore enfin la disparition progressive de la Zomia dans cette dernière phase de construction de l’État qui voit l’espace administré se confondre avec pratiquement toute la surface du globe. Cette dernière phase de l’expansion de l’État s’explique par les nouvelles technologies à la disposition des États pour absorber les périphéries et parachever le processus de formation des États-nations.
Scott, entre constructivisme anarchiste et essentialisation de l’État
En filigrane de son œuvre, Scott brosse un portrait de l’État peu reluisant qui, en plus d’être asservissant pour sa population, en dégrade les conditions de vie en raison de l’adoption de la monoculture et des taxes. L’État serait donc par nature et invariablement coercitif, imposant à une majorité les décisions d’une minorité. Or, les premiers États d’Asie décrits par Scott sont tout sauf semblables aux États contemporains, moins meurtriers (du moins pour les populations internes) et plus protecteurs. L’État-providence en est l’exemple le plus récent et le plus frappant puisqu’il assure une protection sociale et une redistribution des richesses à grande échelle.
Partant de ce constat que l’État serait, de tout temps et en tous lieux, contraire aux intérêts des individus, Scott développe l’idée selon laquelle l’organisation sociale et économique des habitants de la Zomia serait pensée pour conserver leur autonomie. Or, on peut se demander si ces structures adoptées par les populations des collines ne découlent pas simplement des contraintes géographiques et environnementales des espaces dans lesquels ils vivent, plutôt que d’être un choix politique d’anarchisme. Leur mode de production pourrait en fait être une simple adaptation à la vie dans les montagnes, de même que leurs structures sociales pourraient être la conséquence de l’organisation que nécessite un certain mode de production. Il a par exemple été montré que la culture du blé requiert moins de coordination que la culture du riz qui demande davantage d’interdépendance entre les individus1. Cette différence entre culture du blé et culture du riz peut expliquer les différences culturelles entre Chine du Sud, davantage holiste et valorisant la hiérarchie, le népotisme et la loyauté, et Chine du Nord, plus individualiste. Scott semble donc privilégier l’explication des caractéristiques sociales en termes de stratégies individuelles, sans aborder les déterminants structurels (environnementaux et sociaux) de ces caractéristiques.
En lien avec cette idée que les peuples des collines ne sont pas si averses à l’État que Scott le laisse entendre, Brass2 souligne que les Karènes se sont battus pour exiger un État karène ethniquement constitué en 1940, avec l’aide des conservateurs britanniques voulant affaiblir l’État birman. On peut alors se demander si l’absence d’État dans les collines est véritablement un choix politique ou une simple résignation.
Une romanticisation des sociétés sans État ?
Enfin, Scott souligne à plusieurs reprises le contraste de qualité de vie entre collines et vallées. La vie dans les collines prémunirait des famines et des épidémies récurrentes dans l’État en raison de l’agriculture diversifiée et de la faible densité de population, une idée présentée par Richard B. Lee au symposium « Man the Hunter » en 1966. S’appuyant sur ses ethnographies des !Kung du désert de Kalahari en Namibie, Lee avait montré que contrairement aux croyances communes, l’espérance de vie des !Kung après 60 ans était largement comparable à celle des populations industrialisées3.
Toutefois, de nombreuses données suggèrent que le mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs est loin d’être idéal. Nancy Howell notait que « les !Kung sont très maigres et se plaignent souvent de la faim, à tout moment de l’année. »4 L’espérance de vie n’était guère plus reluisante, avec une moyenne à trente-six ans chez les !Kung5, l’hypothèse principale avancée étant que le nomadisme empêche les organismes de développer des anticorps prémunissant des maladies locales. Si les populations sédentaires, comme le souligne Scott, encourent le risque de maladies infectieuses et d’épidémies, les chasseurs-cueilleurs sont donc confrontés à d’autres risques sanitaires autrement importants.
Plus largement, la forte mortalité des populations de chasseurs-cueilleurs ne s’expliquerait-elle pas par un niveau extrêmement élevé d’homicides et de violences intergroupes ? C’est ce que suggère Peter Turchin dans Ultrasociety6, qui défend l’idée que le lot commun des sociétés pré-étatiques est un état constant de guerre. Les fouilles archéologiques révèlent par exemple que parmi 264 cadavres d’Indiens de l’Illinois vivant à la fin du Moyen Âge, 16% sont morts suite à des violences infligées par des armes (haches en pierre, flèche). Sur un échantillon de quinze sociétés de petite-échelle, onze ont un taux d’homicide supérieur à celui des nations modernes7.
Si l’on comprend les intentions d’un tel discours d’inspiration rousseauiste – renverser le discours progressiste dominant jusqu’en 1960 selon lequel la marginalité rurale était sous-développée et constituait donc un problème à résoudre – il est toutefois regrettable que James C. Scott ne rende pas précisément compte des conditions de vie de ces populations.
Notes :
[1] Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture. Science, 344(6184), 603–608. https://doi.org/10.1126/science.1246850
[2] Brass, T. (2012). Scott’s “Zomia,” or a Populist Post-modern History of Nowhere. Journal of Contemporary Asia, 42(1), 123–133. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634646
[3] Lee, R. B. (1968). What hunters do for a living, or, how to make out on scarce resources. In Man the Hunter (pp. 30–48). Aldine Publishing Company. https://hraf.yale.edu/ehc/documents/743
[4] Citation originale: “The Kung are very thin and complain often of hunger, at all times of the year.”
[5] Gurven, M., & Kaplan, H. (2007). Longevity Among Hunter- Gatherers: A Cross-Cultural Examination. Population and Development Review, 33(2), 321–365. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00171.
[6] Turchin, P. (2015). Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth. Beresta Books.
[7] Fry, D. P. (2013). War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views. OUP USA.
19.07.2024 à 21:21
Grande-Bretagne : la barque travailliste tangue déjà
Richard Seymour
Texte intégral (1725 mots)
A-t-on jamais conquis un pays de cette façon ? Une majorité sans légitimité et un raz-de-marée qui n’en est pas un. Les travaillistes ont remporté 64 % des sièges avec 34 % des voix, soit la plus faible part de voix jamais obtenue par un parti arrivant au pouvoir. La participation, estimée à 59 %, a été la plus faible depuis 2001 (et auparavant, 1885 !). Lorsqu’à la fin du mois de mai le Premier ministre Rishi Sunak a fini par jeter l’éponge, tous les sondages donnaient aux travaillistes une avance à deux chiffres, soit plus de 40 %. La litanie des maladresses de Sunak, l’énorme écart de financement entre le parti travailliste et le parti conservateur ainsi que la cohorte d’hommes d’affaires et de journaux appartenant au magnat australien Rupert Murdoch apportant leur soutien aux travaillistes auraient dû contribuer à maintenir cette avance. Au lieu de cela, le nombre total de voix des travaillistes est tombé à 9,7 millions – contre 10,3 millions en 2019. Par Richard Seymour, traduction par Alexandra Knez pour LVSL depuis la New Left Review.
Les conservateurs ont chuté de 44 % à 24 %, alimentant une poussée du parti d’extrême droite Reform UK qui, avec 14 % des voix, a obtenu quatre sièges. Le vote combiné Tory-Reform, avec 38 % des voix, a été plus important que celui des travaillistes. Comme l’a souligné le sondeur John Curtis, ces derniers n’auraient pas progressé du tout sans les avancées des travaillistes en Écosse, rendus possibles par l’implosion du SNP. Dans le même temps, la gauche du pays, malgré son retard et son manque d’orientation stratégique, s’en est plutôt bien sortie. Les Verts sont passés de moins de 3 % à 7 % des voix et ont obtenu quatre sièges. Cinq candidats indépendants pro-palestiniens siégeront à leurs côtés à la Chambre des communes, dont Jeremy Corbyn, qui a battu son rival travailliste à Islington North avec une marge de 7 000 voix.
Jamais le fossé n’a été aussi béant entre les attentes de la population et sa représentation au sein des hautes sphères. Et peu de gouvernements ont été aussi fragiles au moment de leur entrée en fonction. Pour Keir Starmer, il n’y aura aucun état de grâce, tant les travaillistes et leur leader sont impopulaires – certes moins que les conservateurs, pour le moment.
L’ampleur de la majorité travailliste à Westminster cache la croissance spectaculaire des circonscriptions marginales, où le parti a eu du mal à s’accrocher. À Ilford North, la candidate indépendante de gauche Leanne Mohamad est passée à 500 voix de détrôner le nouveau ministre de la santé Wes Streeting ; à Bethnal Green & Stepney, la députée sortante Rushanara Ali, qui a refusé de soutenir un cessez-le-feu à Gaza, a vu son écart réduit de 37 524 à 1 689 voix ; à Birmingham Yardley, Jess Phillips, de l’aile droite, a failli être battu par le Workers’ Party ; et à Chingford et Woodford Green, Faiza Shaheen n’a pas pu se présenter comme candidate travailliste, mais s’est battue contre son ancien parti jusqu’à un match nul, divisant le vote et permettant ainsi aux Tories de conserver leur siège…
Comment les travaillistes ont-ils pu faire aussi bien avec des résultats aussi piètres ? La part de voix du parti diminue généralement au cours d’une campagne électorale. Pourtant, la problématique fondamentale est celle de la base sur laquelle il s’est appuyé. Le facteur décisif a été la crise du coût de la vie. En période de stagnation salariale, les hausses de prix érodent le pouvoir de consommation de ceux qui sont en marge du système, mais depuis 2021, les crises a répétition dans la chaîne d’approvisionnement et les profits des entreprises ayant fait grimper les coûts, une partie de la classe moyenne elle-même s’est sentie touchée. La tentative du gouvernement Tory de transformer alors les grévistes en boucs émissaires n’a connu qu’un faible succès. Le virage des conservateurs vers une guerre de classe ouverte a mis à mal leur discours sur le « nivellement par le haut » et a démenti leur volonté de se rapprocher des Britanniques ordinaires.
Vers la fin de la campagne, il est apparu que les travaillistes espéraient voir des gestionnaires d’actifs prendre la tête d’une vague d’investissements dans le secteur privé.
Le parti conservateur a réagi à cette crise en se repliant sur lui-même et sur son leader, Boris Johnson. Le résultat a été l’intermède désastreux de Liz Truss. Se présentant comme une réactionnaire « antimondialiste », à l’écoute des préoccupations d’un électorat conservateur protégé du pire de la crise mais stagnant par rapport à l’explosion de la richesse des super-riches, Liz Truss a littéralement écrasé le favori des médias, Rishi Sunak. Mais, après un mini-budget comprenant 45 milliards de livres de réductions d’impôts non financées, son gouvernement a immédiatement fait l’objet des mêmes agressions institutionnelles que celles habituellement réservées à la gauche. Le secteur financier, la Banque d’Angleterre et les médias nationaux n’ont fait qu’une bouchée d’elle.
Sunak a été hâtivement porté au pouvoir sans vote des membres du parti, et un assortiment de partisans de l’austérité a été nommé au Trésor. La stratégie adoptée depuis lors – et qui s’est poursuivie jusqu’aux élections – a consisté à combiner une pression fiscale avec une guerre culturelle sans efficacité. Cette stratégie s’est traduite par un réalignement du centre politique derrière les travaillistes, ce qui a modifié les calculs électoraux.
Dès lors, le parti travailliste pouvait bien se présenter aux élections sans légitimité. Il a vite abandonné ses engagements les plus ambitieux en matière de dépenses, notamment les 28 milliards de livres à consacrer aux investissements « verts ». Il s’est positionné comme une option sûre pour l’establishment. Son offre était parlante : une politique qui « pèserait plus légèrement » sur la vie des gens. Une plateforme à l’imprécision manifeste. Ses engagements en matière d’impôts et de dépenses n’y représentaient que 0,2 % du PIB, ce qui est peu compte tenu de la crise que traversent les infrastructures britanniques, la santé, les écoles, le réseau de distribution d’eau ou le logement. Mais le « petit changement » est le point fort de Keir Starmer : petit changement par rapport au dernier gouvernement, petit changement dans les dépenses, petit changement dans la part des votes. Le mantra fastidieux des travaillistes a été la « croissance ». Sans que soit jamais expliquée la manière dont elle devait être défendue, étant donné que les travaillistes ne sont pas disposés à augmenter les impôts sur les hauts revenus ou les bénéfices des entreprises pour financer l’investissement – si l’on l’excepte de vagues références à la législation sur l’aménagement du territoire.
Vers la fin de la campagne, il est clairement apparu que les travaillistes espéraient voir des gestionnaires d’actifs prendre la tête d’une vague d’investissements dans le secteur privé. Le patron de BlackRock, Larry Fink, qui a soutenu Starmer, a vanté les mérites de sa société qui, selon lui, permettrait de fournir des ressources supplémentaires pour les investissements verts sans augmenter la fiscalité des plus riches. « Nous pouvons construire des infrastructures », écrit-il dans le Financial Times, « en débloquant l’investissement privé ». On retrouve ici le fameux « partenariat public-privé » à grande échelle. BlackRock est déjà propriétaire de l’aéroport de Gatwick et détient une participation substantielle dans le secteur de l’eau en Grande-Bretagne, ces même entreprises étant actuellement en pleine déconfiture et vomissant des déchets et eaux contaminées à tout va (70 % de ce secteur est détenu par des gestionnaires d’actifs).
Comme l’écrit Daniela Gabor, « les profits que BlackRock espère générer en investissant dans l’énergie verte risquent d’avoir un coût énorme ». Comme le souligne Brett Christopher dans sa critique de la « société basée sur la gestion d’actifs », les propriétaires sont très éloignés des infrastructures qu’ils contrôlent et ne sont guère incités à en prendre soin. Ils se contentent de créer des mécanismes de mise en commun des capitaux d’investissement, d’exploiter l’actif pour ce qu’il vaut et de passer à autre chose. Et telle est la grande idée sur laquelle le parti travailliste fonde sa fragile fortune : on comprend mieux pourquoi il n’a pas voulu l’expliquer à l’électorat.
Le danger réside en ceci qu’un gouvernement impopulaire mais s’appuyant sur une majorité disproportionnée au parlement, se mette à imposer, à marche forcée, un programme dont la majorité ne veut pas. Starmer connaîtra-t-il le sort d’Olaf Scholz, ainsi que l’a suggéré Grace Blakeley ? Si tel est le cas tous ceux qui, à gauche, se seront compromis avec lui, sombreront avec lui.
17.07.2024 à 18:53
Juger Franco ? Impunité, réconciliation, mémoire
Sophie Baby
Texte intégral (5175 mots)
Le 17 juillet 1936, une tentative de coup d’État contre le gouvernement républicain du Frente popular plonge l’Espagne dans une guerre civile. Ce conflit extrêmement violent, faisant plus de 500 000 victimes et presque autant de réfugiés, se solde trois ans plus tard par la victoire du camp nationaliste, grâce à l’aide militaire de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste. À sa tête, le général Franco impose une dictature et dirige le pays durant près de quarante ans, jusqu’à sa mort, le 20 novembre 1975. Si les crimes du franquisme n’ont jamais été jugés, la Transition démocratique faisant le choix de la réconciliation, son héritage est encore défendu en Espagne par des fondations voire des mouvements politiques, à l’image du parti d’extrême droite Vox, voire par la droite du Partido popular (PP). Comment expliquer alors l’absence de jugement et de condamnation du franquisme dans un pays devenu depuis les années 1980 une démocratie consolidée, et intégrée à l’Union européenne ? Cette interrogation guide l’ouvrage de Sophie Baby, Juger Franco ? Impunité, réconciliation, mémoire (La Découverte, 2024). Maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, l’historienne avait déjà publié un ouvrage très remarqué sur Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982) (Casa de Velázquez, 2012). Dans ce nouveau livre, elle éclaire les fractures de la société espagnole contemporaine à la lumière de cette période, et des « autres possibles » non advenus, comme le jugement du franquisme par un tribunal international ou l’exhumation de ses victimes. Nous en reproduisons ci-après quelques bonnes feuilles.
On a vu dans les chapitres précédents combien le modèle espagnol de réconciliation, imputé à la transition, s’inscrivait dans la continuité de réflexions menées depuis plusieurs décennies tant par l’opposition républicaine traditionnelle à l’étranger que parmi les voix critiques à l’intérieur de la péninsule ; le chemin emprunté par la démocratisation espagnole avait été débattu et esquissé depuis longtemps, même si tout n’était pas, contrairement aux dires du dictateur, « atado y bien atado », « ficelé et bien ficelé » à l’heure de sa mort le 20 novembre 1975. La science politique a mis à juste titre l’accent sur la grande incertitude propre aux processus de transition vers la démocratie, les acteurs agissant dans un bruissement d’expectatives en perpétuel changement face à un avenir imprévisible : l’histoire n’était en rien prédictible. Et si ce qui constitue le substrat culturel de la transition avait été forgé et consolidé antérieurement, autour de la volonté partagée de réconciliation nationale, ses contours n’étaient pas tracés et auraient pu être autres […]. Ce qui se déployait avec force depuis vingt ans était l’absolue nécessité d’en finir avec les déchirures héritées de la guerre civile et avec le cycle de violences débuté dans les années 1930. La transition était donc pensée non seulement comme un processus de démocratisation, mais aussi comme un processus de sortie de guerre à retardement. Sortir de la guerre comme condition de possibilité de la fondation de la démocratie : tel fut le double enjeu de la transition. […]
Mais la réhabilitation morale des combattants de la liberté et de la démocratie contre le fascisme, au cœur de la refondation de l’Europe post-1945, était imprononçable, tandis que la responsabilité était entièrement portée sur l’État, entité abstraite et collective, et jamais dirigée vers des individus qui auraient mérité châtiment : la faute des uns comme des autres était absoute. Le célèbre communiqué du gouvernement socialiste émis à l’occasion du quarantième anniversaire du soulèvement, le 18 juillet 1986, marqua l’apogée d’un tel modèle réconciliateur fondé sur l’équivalence des souffrances et des légitimités : « Une guerre civile n’est pas un événement que l’on commémore », affirmait-il. S’il désirait « rendre hommage et honorer la mémoire de tous ceux qui, en tout temps, contribuèrent par leur effort et pour beaucoup, leur vie, à la défense de la liberté et de la démocratie en Espagne », il tenait aussi à montrer son « respect à ceux qui, depuis des positions distinctes de celles de l’Espagne démocratique, ont lutté pour une société différente, pour laquelle beaucoup ont également sacrifié leur propre vie ». L’essentiel était que « plus jamais, pour aucune raison, pour aucune cause, le spectre de la guerre et de la haine ne revienne hanter notre pays, assombrir notre conscience et détruire notre liberté » et que « le 50e anniversaire de la guerre civile scelle définitivement la réconciliation des Espagnols ».
D’autres possibles : juger et exhumer
Peu nombreux furent ceux qui élevèrent la voix contre le récit dominant de la réconciliation, qui imposait que l’amnistie soit mutuelle pour garantir la pacification sociale, que les légitimités qui s’étaient affrontées se taisent, que l’égalité et l’attention humanitaire soient les seuls arguments valides pour remédier aux injustices du passé. Est-ce à dire qu’il ne restait plus rien des velléités d’exiger des comptes aux responsables de la dictature ?
Des intellectuels réunis autour de la revue critique Cuadernos de Ruedo ibérico, publiée depuis Paris, s’insurgèrent en 1975 contre le mode opératoire annoncé de la transition, qui n’était selon eux qu’une succession de renoncements de la part de l’opposition. L’écrivain basque Luciano Rincón dénonça l’octroi de « concessions aussi scandaleuses […] que l’offre d’une amnistie “pour tous” persécutés comme persécuteurs, torturés comme tortionnaires, sous prétexte d’être tous des citoyens ». « Et en plus, aujourd’hui, on nous demande qu’on se réconcilie avec nos propres assassins et avec les complices de la répression », renchérit l’universitaire Juan Martínez Alier dans un article intitulé « Contre la réconciliation ». « Qui amnistiera l’amnistiant ? », s’interrogeait-il, regrettant l’absence de débat au sein de la gauche alors que l’amnistie réciproque envisagée reviendrait « pour le franquisme et ses successeurs à se laver les mains […] de centaines de milliers de morts », ce qui pourrait à l’inverse, estimait-il, être « une bonne arme pour attaquer la droite ».
Il faut exiger des responsabilités politiques non seulement aux policiers tortionnaires mais aussi aux organisateurs et complices de la répression. Pourquoi ? Non par soif de vengeance, mais parce que la demande de responsabilités politiques va de pair avec une discussion nécessaire et un éclaircissement total de la répression de 1936 à aujourd’hui […]. Une fois les faits éclaircis et les faits débattus, une fois la droite collaboratrice du franquisme discréditée pour son rôle dans la répression, alors oui on pourra leur octroyer une grâce ou une amnistie, et nous pourrons nous réconcilier.
Enquêter, éclaircir les faits, pointer les responsabilités comme condition préalable de la réconciliation : Martínez Alier anticipait un protocole d’action qui fit ensuite florès, sous le nom de droit à la vérité, mais heurtait de front l’absorption des légitimités fondatrice du processus d’ouverture démocratique. L’historien Carlos Fuertes Muñoz souligne combien, dans les villages, « pardonner n’était pas tâche aisée ». La soif de justice resurgissait ponctuellement dans les publications de l’opposition, comme en 1974 quand un militant défendait la position du PSOE contre l’accusation de vouloir « faire table rasse du passé lorsque, sans remonter à la guerre civile, il y a trop de comptes à rendre et de linge sale à laver pour que le peuple soit trahi, alors qu’il ne demande depuis trente-huit ans qu’une seule chose : Justice ». Mais aucune modalité d’exercice de cette justice n’était plus abordée. Quant à l’élite intellectuelle de Ruedo Ibérico, si elle avait pu constituer dans les années 1960 le cœur battant d’un antifranquisme renouvelé, son lectorat s’était réduit à une peau de chagrin, sa marginalisation politique étant à la mesure de son indépendance critique.
Deux types d’initiatives reflètent ces autres possibles au-delà de l’étroitesse du tracé gouvernemental. Elles faisaient fi de l’échelon national pour se déployer par-delà les frontières ou, à l’inverse, dans les recoins des villages.
C’est donc bien du côté des marges qu’il faut chercher les propositions alternatives, rendues inaudibles par l’écrasante hégémonie du discours réconciliateur dans l’espace public : marges géographiques – exils, périphéries péninsulaires et rurales-, marges sociales, marges politiques. Deux types d’initiatives reflètent ces autres possibles au-delà de l’étroitesse du tracé gouvernemental. Elles faisaient fi de l’échelon national pour se déployer par-delà les frontières ou, à l’inverse, dans les recoins des villages. La première tenta d’incarner l’exigence de justice par la figure du tribunal international. La seconde se concentra, localement et parfois avec le soutien des réseaux de l’exil, sur les corps des disparus.
Un tribunal international pour l’Espagne ?
Deux tentatives de constitution d’un tribunal international pour l’Espagne sont décelables dans les sources, l’une émanant en 1972 des syndicats de l’opposition, l’autre en 1978 de révolutionnaires issus de l’exil.
Le Tribunal syndical international contre la répression franquiste
La première tentative a été exhumée par Roldán Jimeno à partir d’un câble diplomatique confidentiel perdu dans la masse révélée par Wikileaks. En provenance de l’ambassade des États-Unis à Madrid, daté du 14 juin 1974, le télégramme informait Washington du projet d’un tribunal international sur la répression franquiste. […]
Le point de départ réside dans le « procès des 1 001 », ces dirigeants syndicaux des Commissions ouvrières (CC.OO.) arrêtés en juin 1972 lors d’une réunion clandestine. L’annonce du procès, qui commença le jour même de l’assassinat par l’ETA du chef du gouvernement, l’amiral Luis Carrero Blanco, le 20 décembre 1973, s’accompagna d’une intense campagne menée par le Parti communiste, qui mobilisa ses réseaux internationaux pour obtenir la clémence des juges. Dans le cadre de cette mobilisation, fut lancé un appel unitaire des syndicats espagnols clandestins « pour la constitution d’un Tribunal syndical international contre la répression franquiste », dont l’initiative revient aux détenus eux-mêmes. Marcelino Camacho et Nicolás Sartorius, parmi d’autres, avaient rédigé un communiqué en août 1972 depuis les geôles de Carabanchel, suivant la longue tradition d’écrits envoyés par les prisonniers à l’opinion publique internationale depuis le lancement de la campagne pour l’amnistie. […]
L’appel des détenus, relayé en Europe par des représentants des CC.OO., fut entendu par les trois grands syndicats italiens qui, lors d’une réunion romaine en novembre 1972, adhérèrent au projet. […] Un an plus tard, les syndicats britanniques se rallièrent à leur tour et, avec le soutien du Labour, Londres fut choisie pour qu’y siège en 1974 le « Tribunal international pour juger les violations par le régime de Franco de la Charte des droits de l’homme », désormais déconnecté du procès des leaders des CC.OO. Les partis socialistes français allemand et italien avaient tour à tour refusé d’héberger le tribunal, signale le câble diplomatique révélé par Wikileaks. Le document insiste sur les rivalités existantes au sein de la gauche européenne, entre socialistes et communistes, qui pourraient expliquer in fine l’échec du projet. […]
L’orientation syndicale du tribunal se reflète dans l’attention prioritaire qui devait être accordée à la « répression syndicale », dans le droit fil du « procès des 1 001 », avant les questions plus classiques de la violation des droits et libertés et du statut des prisonniers politiques. Il s’agissait aussi d’enquêter sur les « firmes multinationales » opérant en Espagne et les conditions de travail qui s’y déployaient, suivant la tonalité anti-impérialiste prise par les gauches européennes. Les diplomates s’inquiétaient de ces « connotations anti-américaines » ciblant des entreprises comme les géants de l’automobile Ford, General Motors et Chrysler.
Le tribunal devait être constitué « d’éminents juristes de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de France, d’Italie et des pays scandinaves », garantissant par leur expertise et leur autorité la recevabilité des conclusions. Le mode opératoire n’était pas celui d’un procès en juridiction universelle mais celui d’une « commission d’enquête ». Le mot « tribunal » était d’ailleurs préféré en anglais à celui de « trial », procès, à la signification plus clairement judiciaire. […] Le projet s’inscrivait ainsi dans la longue tradition des commissions d’enquête juridiques analysée dans les chapitres précédents, tout en innovant dans la forme choisie. Il faut y voir la patte de ce qui en constitua, sans nul doute, le référent : le Tribunal Russell.
L’expérience menée en 1967 par le philosophe et mathématicien britannique Bertrand Russell pour juger les crimes états-uniens commis au Vietnam, était en effet revenue dans l’actualité par le biais du Tribunal Russell II sur la répression au Brésil et en Amérique latine, dont les sessions célébrées à Rome et Bruxelles entre 1974 et 1976 coïncidèrent avec le projet espagnol. Tout comme les États-Unis avaient été déclarés coupables du crime de génocide à l’égard du peuple vietnamien par le tribunal présidé par Jean-Paul Sartre, les gouvernements dictatoriaux du Brésil, du Chili, de l’Uruguay et de Bolivie furent déclarés en 1976 coupables de crimes contre l’humanité et de violations graves, répétées et systématiques des droits humains.
Le Tribunal syndical espagnol était, comme ces tribunaux, pensé comme un jury d’opinion, constitué d’intellectuels et de personnalités reconnues – ici, des juristes. La procédure était conçue comme une instruction judiciaire à partir de témoignages recueillis et vérifiés sans constituer pour autant une cour pénale – en ce sens ils avaient pour antécédent non pas tant le tribunal de Nuremberg, qui en était la référence historique, que la CICRC créée en 1950 par David Rousset (voir supra, chapitre 1). […] Faire le procès d’un système était bien ce qu’ambitionnaient les syndicalistes à l’origine de l’idée du Tribunal syndical. Ils furent suivis quelques années plus tard, en pleine transition, par les promoteurs d’un second projet de tribunal international du franquisme.
Entre révolution et héritage républicain
Ce second projet fut porté par un groupe révolutionnaire d’extrême gauche, le Parti communiste espagnol (marxiste-léniniste) (PCE (m-l)), fondé en 1964 entre Bruxelles, Paris et Genève par des exilés en rupture avec la ligne pacifiste et réconciliatrice du PCE. Le parti partageait avec d’autres organisations d’extrême gauche une ligne radicale de dénonciation de la répression franquiste, jusqu’à réclamer l’épuration des « corps répressifs » et la poursuite en justice des responsables des exactions. Mais cette exigence de justice pénale concernait les crimes dont leurs militants étaient victimes à la fin du franquisme : les crimes de la guerre civile et de la grande répression des années 1940 ne figuraient pas dans leur bréviaire révolutionnaire internationaliste et anti-impérialiste. Les partis de la gauche radicale n’avaient cure de la Seconde République et de sa mémoire. Le PCE (m-l) fait ici figure d’exception. […]
L’Appel républicain aux peuples d’Espagne renouait ainsi avec la rhétorique républicaine traditionnelle : Franco s’était vendu à Hitler et Mussolini, qui avaient mené une guerre sanglante contre l’Espagne
Ce retour à la République s’accompagna d’un regain de revendications plus anciennes, où la dénonciation de la continuité de la répression était articulée à celle d’un système criminel né du soulèvement de juillet 1936. L’Appel républicain aux peuples d’Espagne renouait ainsi avec la rhétorique républicaine traditionnelle : Franco s’était vendu à Hitler et Mussolini, qui avaient « mené une guerre sanglante contre l’Espagne […], semé la terreur et la mort et instauré une dictature fasciste qui brisa toutes les avancées démocratiques, toutes les transformations sociales et toutes les perspectives de progrès qui s’étaient ouvertes en Espagne pendant la période républicaine ». S’y ajoutait une tonalité anti-impérialiste plus en vogue, qui accusait le dictateur d’avoir livré l’Espagne aux « monopoles étrangers » et à l’« impérialisme américain » tandis que « la Monarchie de Juan Carlos s’était confirmée comme étant le franquisme sans Franco », « une monarchie fasciste » qu’il fallait renverser au profit d’un retour à la « légitimité républicaine ». La question des responsabilités passées, écrasée sous celle des crimes d’alors, resurgit ainsi avec cette réaffirmation de la légitimité républicaine – à l’encontre du processus d’absorption des légitimités porté par la réconciliation. […]
La forme révolutionnaire des tribunaux populaires, incarnation de la justice du peuple, rencontra celle du tribunal international et le 28 novembre 1978, se réunit à Madrid une Junte promotrice du Tribunal civique international contre les crimes du franquisme. […] Une véritable politique mémorielle était précocement envisagée : aujourd’hui des plus ordinaires, elle était pour l’heure inaudible en Espagne, noyée par l’écrasante hégémonie réconciliatrice et empêchée par l’efficacité répressive.
La répression fut en effet immédiate et implacable : la police fit irruption dans l’hôtel madrilène où se déroulait la réunion de présentation et procéda à l’interpellation de vingt-cinq participants, parmi lesquels un certain nombre de personnalités, relâchées après plusieurs heures, voire plusieurs jours de garde à vue.
Maintenir vivace la solidarité internationale
Une seconde dynamique, internationale, connut néanmoins un succès plus significatif. Une Commission européenne du Tribunal fut créée à Paris le même jour que la réunion de la Junte promotrice à Madrid, et des sessions de présentation du Tribunal furent organisées ailleurs en France et en Europe. À Genève, où Julio del Vayo avait vécu (il y est enterré) et avait entretenu de vastes réseaux dans les milieux onusiens des droits humains, la présentation organisée le 2 décembre, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, présidée par le secrétaire suisse de la LDH, réunit plus de trois cents personnes, dont un vice-président de I’ONU, un ministre, plusieurs députés. Les sections suisse et française du Tribunal semblent avoir été les plus actives, d’après les traces trouvées dans les archives, où figure un bulletin publié entre 1979 et 1982 par la section française, animée par Marie-Paule Molins, qui nous éclaire sur ses activités.
Les intellectuels souscrivant au Tribunal furent ceux qui étaient classiquement engagés dans la dénonciation du franquisme, depuis le temps même de la guerre comme l’écrivain hispaniste Jean Cassou, le cinéaste Joris Ivens qui avait tourné en Espagne aux côtés d’Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, ou l’ancien résistant et déporté Claude Bourdet. S’y ajoutaient les acteurs dont l’engagement au service de la défense des droits humains remontait aux luttes pour la décolonisation, en particulier à la guerre d’Algérie : ainsi des avocats Gisèle Halimi, Yves Dechezelles, Jean-Jacques de Felice, Henri Leclerc, pour la plupart affiliés à la Ligue des droits de l’Homme (de Felice en fut vice-président en 1983-1996, Leclerc président en 1995-2000) et investis dans le Mouvement d’action judiciaire (MAJ qu’ils avaient créé en 1968 pour défendre les droits des prisonniers. À leurs côtés le directeur de la Cimade, André Jacques , investi dans la défense du statut des réfugiés espagnols en France, et des membres d’Amnesty International. […] Le but, stratégique, était selon Pablo Mayoral « d’internationaliser et de généraliser la dénonciation de la dictature et des crimes qui avaient eu lieu, et qui continuaient ». Mais les soutiens politiques restèrent minimes.
L’ambition innovante du projet disparut ainsi au profit d’actions inscrites dans la continuité de la solidarité antifranquiste des décennies précédentes, sous le nom-étiquette de Tribunal international contre les crimes du franquisme. […]
En 1981, la tentative de coup d’État du 23-F démontra a posteriori la validité de la thèse soutenue par le PCE (m-l) – de la continuité du fascisme dans les institutions – et revivifia l’idée d’une Espagne en danger : l’espoir de retrouver alors la flamme perdue des mobilisations transnationales contre le franquisme fut néanmoins éphémère, rendu vite obsolète par le triomphe des socialistes aux élections de 1982. La secrétaire du Tribunal félicita Felipe González pour sa victoire, espérant qu’elle soit l’occasion d’une « rupture authentique avec le franquisme », réclamant à nouveau épuration de l’armée, sanction des « policiers tortionnaires » et que justice soit rendue pour les « dizaines de victimes tombées sous les balles des forces répressives ou sous les coups des bandes de tueurs fascistes ».
L’organisation d’hommages sembla constituer une forme de compensation à l’impossible réparation morale : « Face à l’absence de volonté de faire le procès du franquisme, souligne Pablo Mayoral, nous reconvertîmes nos efforts dans les hommages susceptibles de réunir de nombreuses forces politiques et des gens de la culture ». L’ultime mention du Tribunal figure dans les signataires de l’appel à un grand rassemblement organisé à Madrid autour du 27 septembre 1985, date anniversaire des dernières exécutions du franquisme, par le PCE (m-l) pour rendre hommage aux « victimes du franquisme qui continuent d’attendre, dix ans après la mort du dictateur, leur réhabilitation ». À la classique rhétorique antifasciste s’ajoutait alors un tout nouveau référent, destiné à marquer profondément le mouvement mémoriel espagnol : « Le peuple argentin qui à peine sorti d’une dictature relativement brève, exigeait du gouvernement le procès des membres des Juntes militaires responsables des crimes et des “disparus”. » La dernière tentative de faire le procès international du franquisme dans la lignée des tribunaux d’opinion des années 1960-1970, s’achevait ainsi avec l’entrée dans l’ère González. Le Tribunal international à peine ébauché sombra dans l’oubli et ne connut aucune postérité, ni parmi les militants de la mémoire ni parmi les historiens.
Retrouver ses morts : la quête silencieuse des villageois
Il s’inscrivait dans une attention plus globale portée aux victimes de la dictature et en particulier, aux morts. À Valence, le 1er novembre 1978, jour des morts, l’adhésion au Tribunal fut discutée après un hommage rendu aux républicains fusillés dans le cimetière de Paterna. Une trentaine de familles de victimes s’était réunie pour discuter de leur volonté de récupérer la propriété des tombes, d’ériger un monument en l’honneur des « martyrs antifascistes et républicains fusillés », et de leur dédier des rues dans les villages. L’hommage aux morts, empêché pendant des décennies, devenait possible avec la disparition de Franco. Il était, pour leurs proches, un devoir, un geste qu’il leur fallait accomplir. Non plus au sein du seul espace de l’intimité familiale, où photographies et souvenirs des disparus étaient présents même s’ils pouvaient être soustraits à la vue des visiteurs par peur des représailles, mais aussi là où gisaient leurs restes, abandonnés depuis quarante ans au cycle de la nature. Les fosses communes, où avaient été balancés les corps des fusillés à l’arrière ainsi que ceux des soldats de l’armée républicaine tués au front, devinrent le lieu situé, ancré dans la terre, de la dette des vivants envers les morts. Il fallait rendre leur humanité à ces morts jetés « comme des chiens », par un processus de « dignification » de la fosse ; en la signalant en la distinguant de l’espace dévolu à la nature, en y laissant une plaque, un monument comportant les noms, et parfois en exhumant les restes osseux pour les réinhumer « dignement », dans des cercueils, au cours d’une cérémonie rituelle. Et ainsi, réintégrer ces parias dans la « communauté des morts ».
Le « cycle d’exhumations » de la transition
Les exhumations de fosses communes au cours de la transition sont un objet historique récent: jusqu’à il y a peu, on pensait généralement que la première exhumation d’une fosse de républicains avait eu lieu en l’an 2000, quand Emilio Silva, fondateur de la principale association mémorielle, l’Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH), avait entrepris de retrouver les restes de son grand-père. Le mouvement de récupération de la mémoire historique s’insurgeait même contre l’inertie de la transition, coupable d’avoir imposé le « pacte d’oubli » et d’avoir empêché toute forme de réhabilitation des morts. Pourtant, c’est précisément la vague d’exhumations postérieure à cette excavation considérée comme pionnière qui fit resurgir, peu à peu, l’existence d’exhumations antérieures, traçant des connexions intimes, mises en lumière par Zoé de Kerangat : « Les exhumations de la transition sont intégrées dans le cycle mémoriel actuel », affirme l’historienne, et « sont revenues à la vie depuis la phase postérieure », constituant « un même processus non linéaire de mémoire ». […]
Douze mille cadavres la plupart non identifiés, soit plus d’un tiers des trente-quatre mille corps recensés, furent ainsi exhumés des « fosses de la défaite » et gisent aux côtés du dictateur qui les fit fusiller.
La quête des corps de la guerre d’Espagne et de la répression s’inscrit dans une histoire longue, où quatre périodes se dégagent. La première vague, du temps même de la guerre et de l’immédiat après-guerre, concernait exclusivement les combattants du camp franquiste et les victimes de la violence républicaine à l’arrière. Elle fut strictement encadrée par les autorités du nouveau régime afin d’éviter les excavations informelles et les profanations de sépultures. Elle fut un « élément clé de la consolidation idéologique de la dictature », selon l’anthropologue Francisco Ferrándiz, intégrée à la martyrologie héroïque, glorifiée par des funérailles, des commémorations, des hommages, des monuments aux « caídos », les « tombés ». C’est d’ailleurs l’érection d’un monument paroxystique, la basilique de Valle de los Caídos, qui donna lieu au second cycle d’exhumations du franquisme. Prévu dès le premier anniversaire de la « Victoire », le 1er avril 1940, pour perpétuer la mémoire « des héros et martyrs de la Croisade », le monument fut inauguré en 1959 après plus de quinze ans de travaux titanesques, effectués notamment par des milliers de prisonniers républicains. Près de cinq cents transferts de restes furent organisés, depuis le printemps 1959 jusqu’en 1983, pour remplir les cryptes de la basilique. Loin d’abriter uniquement le premier des martyrs, José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange, et les restes de morts du camp franquiste, pour lesquels les familles avaient donné leur accord, les niches furent également remplies par des ossements de morts républicains, suivant les velléités de l’Église de donner une coloration inclusive à la basilique, vingt ans après la fin de la guerre civile. Douze mille cadavres la plupart non identifiés, soit plus d’un tiers des trente-quatre mille corps recensés, furent ainsi exhumés des « fosses de la défaite » et gisent aux côtés du dictateur qui les fit fusiller.
En marge de cette colossale entreprise d’État, des témoignages récents révélèrent que, sous le franquisme, quelques fosses avaient été exhumées de-ci, de-là, dans la clandestinité, pour donner au défunt une sépulture dans le caveau familial. Mais il fallut attendre la mort de Franco pour que se déroule le troisième temps de la quête des morts – avant la quatrième étape, amorcée en l’an 2000. Paloma Aguilar situe ce « cycle d’exhumations » entre 1978 et 1980, avec un pic significatif en 1979. La politiste en recense plus d’une centaine pour les trois régions étudiées (Navarre, La Rioja, Estrémadure), Serge Murillo en dénombre treize pour l’Aragon, Javier Giráldez Díaz une vingtaine pour l’Andalousie. Leur nombre est donc loin d’être négligeable et sans nul doute, destiné à s’accroître à mesure des enquêtes de terrain. On peut néanmoins les interroger depuis l’énonciation de la marginalité : en dépit de leur nombre, elles furent tues et ignorées jusque bien avancées les années 2000 et c’est effectivement en regardant du côté des « marges du régime de vérité qu’elles purent émerger ». Comment dès lors interpréter cette quête des disparus postérieure à la mort de Franco et le silence qui l’a entourée ? En quoi menaçait-elle l’ordre restaurateur transitionnel au point d’en devenir invisible ?
16.07.2024 à 14:26
Médire des cons : une passion française
Luca di Gregorio
Texte intégral (4900 mots)
« Élections, piège à cons ». La formule a fait florès depuis Mai 68 et resurgit régulièrement pour dénoncer les faux-semblants démocratiques des retours aux urnes. Dans Médire des cons (Éditions du Cerf, 2024), Luca Di Gregorio revient précisément sur l’histoire de ce « snobisme populaire », consistant à tracer, de manière aussi expéditive que péremptoire, des frontières infra-politiques entre un eux (les cons) et un nous (les autres). Ni de droite, ni de gauche, le jugement de connerie s’autorise également, selon l’auteur, d’une certaine intelligence apartisane, capable de flairer les compromissions ordinaires. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait quelques vertus à médire des cons, comme le suggère le chapitre conclusif. De quoi ébranler les préjugés des élites culturelles qui voudraient éduquer le peuple, au lieu de l’écouter – et substituer aux discours contre les cons leurs remontrances contre les beaufs. Les lignes qui suivent sont extraites du chapitre 4, « L’après 68, de la radicalité au retour à l’ordre ».
1981 : « génération lyrique » et politisation du con
Les années passant, les transformations s’intensifient pour le discours du con. Après l’inflation et la diversification de ses usages ayant marqué les années 1970, la décennie qu’inaugure l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République apporte son train d’évolutions. Des novations apparaissent qui, sans abolir les usages précédents (plusieurs chantres du snobisme populaire disparaissent durant cette période – Brassens en 1981, Fallet en 1983, Audiard en 1985 –, mais ces décès n’empêchent pas que leurs œuvres soient encore goûtées, et pour certaines patrimonialisées), élargissent encore leur répertoire imaginaire. Ce qui sera dit du con, mettons, entre 1975 et 1988, les turpitudes, les attributs inédits qui lui seront prêtés, la rhétorique d’Audiard ou de San-Antonio les ignorait, et dans une certaine mesure aussi celle de Cavanna. En particulier se repose la question du profil politique de la connerie, d’une façon surprenante dont fera les frais l’un des traits pourtant originels de ce discours : son désalignement farouche et son irrepérabilité idéologique.
La trame historique où s’inscrivent ces évolutions est bien connue. Récoltant les fruits de dix années de bouillonnements militants et intellectuels dans la société civile, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, était parvenu à unir la gauche puis à la hisser au pouvoir le 10 mai 1981 – une première sous la Ve République. Souterrainement à cette élection dont « l’événement démocratique » s’est ensuite affadi à l’épreuve des faits, le phénomène le plus important de la période est à nos yeux l’important glissement d’hégémonie qu’elle a provoqué chez les élites politiques et culturelles. Une petite bourgeoisie de sensibilité progressiste, soutenue dans ses valeurs par la classe dirigeante ou la politique d’État, recolore l’imaginaire social de la décennie, y compris sa vidéosphère et sa culture médiatique. Corollaire inévitable d’une culture qui se juge elle-même à la lumière de son reflet médiatique, l’effet générationnel joue à plein dans ce phénomène. Il y assume un rôle omniprésent, d’une ampleur inconnue depuis la « jeunesse S.T.O. » et qu’on ne retrouverait peut-être qu’avec les générations « Climat » ou « MeToo ». Ministre régalien dans les cabinets répressifs de la IVe République, Mitterrand passait jusque-là pour aussi peu dépaysant que peu subversif. S’il aura déçu la composante ouvrière de son électorat dès le « tournant de la rigueur » de 1983, son tour de force résidera dans sa capacité à flatter la classe culturelle, jeunesse de toutes les jeunesses, qui avait contribué à l’élire. Ventriloque générationnel, le néo-président s’était rapidement flanqué de quelques bardes : le soir de la victoire, Barbara chantera que « quelque chose » d’« indéfinissable » venait de changer dans le pays. Sept ans plus tard, Renaud reprendra ce rôle de pourvoyeur de supplément de sens en inspirant un slogan (« Tonton, laisse pas béton ») qui animera la brève campagne de 19881. Si l’on commence alors à parler de « génération Mitterrand », c’est aussi pour capitaliser cet acquis de la décennie.
François Ricard a appelé la génération lyrique cette classe d’âge stratégique, circonscrite aux natifs du baby-boom (1945-1955). Dès son entrée dans l’adolescence, elle fut la première à se voir explicitement exaltée en tant que génération dans la « pop culture » française d’inspiration anglo-saxonne (Johnny, les idoles « yéyé » et « le temps des copains ») et parallèlement auscultée par des sociologues comme Edgar Morin, lesquels inventent à son intention une nouvelle catégorie : celle des jeunes. Entrée dans la vie active après 1968, cette génération animera la culture française de l’entre-deux-mai2 puis, à la fin de la décennie 1970, deviendra la classe d’âge dominante sur le marché du travail. Elle se trouve alors en droit d’attendre un langage et un cérémonial politiques, c’est-à-dire de nouveaux codes petits-bourgeois, mieux adaptés à la nouveauté de ses mœurs, de ses désirs et de ses aspirations3. Mitterrand saura se faire l’interprète (surtout après 1983) de ce besoin symbolique de postures malgré tout progressistes, de cette nécessité d’inventer – à politique économique constante, il faut toujours le rappeler – de nouvelles affectations de classe. Philippe Muray verra ainsi dans « la trouvaille de la “génération Mitterrand”4 », l’invention d’un Frankenstein rusé passé maître dans l’art de s’effacer tactiquement derrière sa créature ; il lui fera accroire aussi souvent que nécessaire (aux élections, aux changements de ligne politique…) qu’il est agi par elle.
Très vite donc, l’objectif de la classe dirigeante au pouvoir devient moins de poursuivre les mesures sociales de 1981 (pourtant si substantielles aux yeux d’un matérialiste) que d’animer, en accord avec la société civile, ce qui allait devenir le style de la « génération Mitterrand ». Débouchés emblématiques de ce changement de cap (loin d’être blâmables en soi, d’ailleurs), les radios libres, les Enfants du rock, Canal+ ou S.O.S. Racisme constituent autant de dispositifs baignés dans la nouvelle culture médiatique. Une culture plus intégrée que jamais et recouverte, de surcroît, par une sorte de politisation ouatée : le monde associatif s’arroge les codes de la publicité et, presque en contrepartie, la pop culture se met à parler le langage de l’humanitarisme post-matérialiste (Les Restos du cœur, We Are the World…). Cela se traduit aussi dans le domaine du discours. Partout naissent des slogans inspirés du langage parlé qu’on suppose employé par les classes d’âge qui font désormais référence.
En accompagnant la popularisation d’autres parlers vernaculaires comme le verlan des cités, l’action publique flèche sa communication en direction d’un univers jeune, tendanciellement urbain. Mantra des années 1983-1988, le vocable « pote » s’impose également avec toutes les caractéristiques d’un signifiant vide. Lexème issu de l’argot des voyous, il devient un signe ambigu de fraternité intercommunautaire. À peine moins creux que « copain », « pote » actionne son propre clivage : quand le copain n’existait que contre les cons, le pote se construira contre les racistes et autres attardés générationnels. Il articulera une nouvelle chaîne d’équivalences, pleinement politique, capable de coopter solidairement, avec la bienveillance du pouvoir, les composantes « branchée » (« chébran ») et « immigrée » (« rebeu ») de la société française. Où l’on voit que les désignants de groupe se succèdent au rythme même où se transforment les prescripteurs de discours ainsi que les antagonismes sociaux que ceux-ci cherchent à prescrire. En se représentant en 1988, Mitterrand se laissera appeler « Tonton » sans ignorer que ce surnom enfantin ne doit plus rien au souvenir des loubards résidentiels de Michel Audiard, mais tout avec ce langage diffus de suggestion sociologique qui lui permettra de s’afficher, plus encore qu’en 1981, comme le président des jeunes.
La sensibilité nouvelle en passe de devenir hégémonique ne se prive pas pour autant de vitupérer contre les cons, mais elle n’y consent qu’une fois qu’a été « normalisé » le clivage institué par la connerie. En l’espèce, le vocable sera renvoyé à son émetteur supposé : l’homme de droite. Titre de Renaud issu de l’album Marche à l’ombre (Polydor, 1980), Dans mon HLM donne une première illustration de cette resignification politisée du con. Le chanteur tire le portrait de ce « con droitard » au début de la liste de banlieusards qu’il égrène :
Au rez-d’-chaussée, dans mon HLM
Y a une espèce de barbouze
Qui surveille les entrées
Qui tire sur tout c’qui bouge
Surtout si c’est bronzé
Passe ses nuits dans les caves
Avec son Beretta
Traque les mômes qui chouravent
Le pinard aux bourgeois
Il s’recrée l’Indochine
Dans sa petite vie d’peigne cul
Sa femme sort pas d’la cuisine
Sinon y cogne dessus
Il est tellement givré
Que même dans la Légion
Z’ont fini par le j’ter
C’est vous dire s’il est con.
La chanson se montre d’une efficacité redoutable pour dessiner les nouvelles conflictualités culturelles. Renaud trace la frontière en jouant habilement sur deux plans, forcément inégaux : en surplomb, il y a la scène au sens strict, celle où le chanteur, omniscient, perce les appartements du regard pour brosser la stratification sociale de son immeuble. L’auditeur, le spectateur n’ont pas d’autre choix que de suivre ce guide. En contrebas, il y a la scène ou plutôt les scènes représentées par chaque résident ausculté – le jeune cadre, la publicitaire, le communiste, etc. Si chacun a ses petits travers, seul le premier d’entre eux suscite une profonde antipathie, véritable horresco referens de la chanson. Cette figure très située, à mi-chemin entre le légionnaire et le barbouze, se voit infliger quelques strophes plus loin un « Mort aux cons ! »digne de Reiser, écrit par le chanteur-narrateur lui-même sur les murs du HLM.
Fait comme un rat dans le dispositif à deux scènes de la chanson, ce voisin consternant n’a que peu de chances de rachat. Selon le tour rhétorique désormais éprouvé, l’auditeur ou le spectateur n’a d’autre choix que de s’associer au mépris de Renaud. Mais dans le cas d’espèce, s’y associer requiert davantage que de répondre à l’appel d’un signifiant vide : il faudra examiner les critères politiques situés de son éventuelle adhésion. Ce n’est plus sur une vague connivence gouailleuse de l’auteur, mais sur une sociologie bien déterminée qu’on devra faire communauté d’esprit. On mesure le chemin parcouru : tout se passe comme si ce nouveau personnage stéréotypé fixait au discours du con une incarnation stable, un profil social qui, par surcroît, renvoie en boomerang une image grimaçante aux contempteurs classiques de la connerie. Ce barbouze anachronique et farci de ressentiment ressemble en effet furieusement aux personnages qui relayaient toute la verve anti-cons de Michel Audiard. Le panache, l’héroïsme cyranien prennent du plomb dans l’aile en la personne de ce vétéran d’aventures coloniales soldées par l’échec, ce médiocre qui ne trompe son oisiveté que dans le racisme, l’alcool et la violence conjugale. L’année suivante, avec Mon beauf5, Renaud ajoute la chasse au pedigree du même genre d’ex-légionnaire maltraitant, ici gratifié des honneurs d’une chanson complète. Pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète, parfois proche d’Audiard dans le style, revisite à la mode idéologique la maxime péremptoire sur la connerie : « Le jour où les cons seront plus à droite/ Y a peut-être une chance pour qu’y vote à gauche. »
Reprenons. Pour la première fois, un profilage de l’usager du discours du con est réalisé, rejoignant celui qu’étudiera bientôt Pascal Ory : un personnage de « populo » rongeant son ressentiment et disant sus à la connerie des jeunes, des femmes, des gauchistes, des noirs ou des Arabes – catégories qu’il exècre à divers titres. S’il s’agit de tracer une frontière, le discours du con n’y perd pas au change : elle est très nette. À ceci près que cette frontière aura perdu, dans le cas présent, son caractère mouvant et l’essentiel de son ironie. L’ancien signifiant vide paraît avoir été troqué contre un portrait-robot sociologique. Abandonnant la mauvaise foi imprécise des « traités » de Frédéric Dard et de Cavanna, ce con-ci ne saurait articuler une chaîne d’équivalences très étendue. L’accusation de connerie, en se caractérisant, s’est politisée. Celui qui l’édicte formule la revendication présentée comme évidente d’une société progressiste diffuse tandis que celui qui la refuse prendra le costume du réactionnaire franchouillard. Sous l’apparente continuité langagière du Titi Renaud, chantre d’un argot rénové, pour la première fois le sens commun va s’identifier à un camp.
La nouveauté réside aussi dans l’activation d’une imagerie péjorative et en même temps progressiste (bien différente, donc, de l’ancien dégoût bourgeois pour les va-nu-pieds) d’une partie des classes populaires (chômeurs, petits commerçants et, de plus en plus souvent, ouvriers). Pour tirer son portrait collectif à ce peuple dont progressivement la gauche se détourne, le monde culturel de l’époque fera souvent usage du patronyme « Dupont », alors considéré comme le plus porté de France6. Allégorique, ce nom est censé désigner par délégation toute une francité moyenne, population réputée récalcitrante à quitter sa glèbe campagnarde – ou, si elle habite en ville, son débit de boissons. La série Superdupont de Lob et Gotlib commence ainsi à paraître en 1972 dans le journal Pilote. Dans cette francisation presque paillarde des comics américains, le marcel et le béret sont venus se substituer aux collants et masques qu’arborent Aquaman ou Spiderman, la baguette boulangère aux armes dernier cri. Chevauchant un coq, Superdupont affronte la pieuvre de l’Anti-France, nébuleuse de vilains cherchant à s’en prendre à la patrie. Autant le cliché est vivement tracé, autant le ton reste débonnaire : la parodie joyeuse continue de primer l’éventuelle morale politique qu’un lecteur plus attentif pourrait vouloir tirer. Le personnage semblait si peu détestable que le Front national le récupérera sans ironie, provoquant son abandon par un Gotlib consterné.
Le film d’Yves Boisset Dupont Lajoie (1974) flanque dans son titre le même patronyme collectif à son anti-héros Georges Lajoie. Parce qu’il vient de tuer accidentellement une adolescente qu’il était en train de violer, ce cafetier parisien farci de préjugés racistes et anti-jeunes s’arrangera pour faire accuser du meurtre les travailleurs d’un chantier d’immigrés tout proche. Si on le contextualise, le choix de Jean Carmet pour composer ce rôle de franchouillard sinistre s’avère lourd de significations : en cette même année 1974, ce protagoniste récurrent des films d’Audiard interprétait le rôle-titre de Comment réussir quand on est con et pleurnichard, histoire d’un représentant pérégrinant les bistrots pour y refourguer un vermouth équivoque. De cette comédie-ci à ce drame-là, Carmet intervient comme une figure de pivot entre deux générations de réalisateurs se prononçant différemment sur une image comparable de la francité. Le recruter pour Dupont Lajoie, c’était tordre l’emploi traditionnel de Carmet en l’astreignant à une forme de coming out actanciel, comme si l’« esprit français » à incriminer pouvait l’être d’autant mieux que l’un de ses plus fameux visages l’incarnait. Par rapport au film d’Audiard, le succès de celui de Boisset sera mitigé, mais la critique, elle, le saluera.
Et le con devint beauf…
Personnage-type du répertoire culturel post-soixante-huitard, « Mon Beauf » voit ses traits définitifs fixés autour de 1975 par Cabu dans Charlie Hebdo. L’inspiration de ce personnage de Français moyen serait venue au dessinateur à force d’entendre son camarade Cavanna évoquer les « coups de main » mutuels que lui et son beau-frère se rendaient, perpétuant une entraide en vigueur dans les communautés italiennes du Val-de-Marne. S’il y a quelque chose en effet d’assez convenu dans ces travaux d’intérieur et ces réunions dominicales, Cavanna savait aussi qu’il serait tout aussi convenu, à terme, de trop en ricaner : chez le fondateur d’Hara-Kiri, personnage complexe attaché à son histoire familiale autant que farouche insoumis, la proximité d’un beau-frère irritait autant le libertaire qu’elle appelait la solidarité domestique de l’enfant d’immigré. Fils d’enseignants catholiques de province, Cabu ne pouvait que recevoir ce tableau familial de seconde main comme plus exotique, moins attendrissant qu’il n’apparaissait à Cavanna. Aussi ajoutera-t-il à son beauf un aspect d’infréquentabilité politique en s’inspirant aussi de la figure de Jacques Médecin : ce député-maire centriste venait en effet de soulever une vive polémique en jumelant sa ville de Nice avec Le Cap, capitale législative d’une Afrique du Sud encore sous Apartheid…
Abréviation de « beau-frère », ce motappartient (comme« con », « pote », « copain » ou « beur ») à la longue liste de désignants qui accompagnent les recompositions du monde social en transitant par le langage populaire ou l’argot. Revenant plus tard sur l’invention de ce personnage, Cavanna relève immédiatement le fait que le beauf s’élabore comme une extrapolation du con, voyant dans l’alternance entre ces deux figures une sorte de passation secrète :
Tiens, « beauf’ », tu sais d’où ça vient ? Ça vient de Cabu. Cabu m’entendait évoquer les conversations de bistrot du lundi matin : « Hier, j’ai aidé mon beauf’ à repeindre sa cuisine. Normal : lui, le dimanche d’avant, il m’avait aidé à déménager. » Ça me revenait souvent, pour moi c’est toute l’horreur de la famille et des habitudes, ça suinte le pastis, la pétanque et la connerie morne, alors je ramenais toujours « mon beauf’ » : « Avec mon beauf’, c’t’été, on se fait la Yougo… » Cabu, ça l’avait fasciné, cet enfant de bourgeois, alors il en a fait le beauf’ : et il lui a donné cette effroyable sale gueule de brave mec, du con triomphant tous azimuts, et voilà, le beauf’ est en train de détrôner le con dans le dictionnaire français tel qu’il se parle. Je me marre bien…7
Cette opération de filiation entre un personnage et l’autre (ou plutôt entre un signifiant vide et un personnage) répondait – Cavanna le perçoit d’emblée – à une nécessité sociologique : le beauf apparaît pour incarner un dépassement et même une précision du con. Autant qu’une amélioration, il constitue donc une variante restrictive de con, lexème encore plastique, qui ne spécifiait pas suffisamment ce que certaines attitudes ordinaires du « populo » pouvaient avoir de politiquement lamentable aux yeux de la nouvelle classe culturelle. Traçant un profil d’ennemi identifié, le beauf se distingue donc du con par sa discernabilité. On sait où il habite, qui il fréquente, les loisirs qu’il chérit. Dans Les Années (2008), Annie Ernaux reconnaît cet enjeu de distinction sociale avec une certaine honnêteté, donnant à voir combien « beauf » est plus efficace que « con » pour illustrer les postures sociales nouvelles : « On allait dormir au petit bonheur sur des lits de camp dans l’ancienne magnanerie, ne sachant pas s’il valait mieux faire l’amour avec son voisin de droite ou de gauche, ou rien. Le sommeil nous prenait avant d’avoir décidé, euphorisés et confortés dans la valeur d’un style de vie dont on s’était offert toute la soirée à nous-mêmes le spectacle – loin des “beaufs” entassés dans des campings à Merlin-Plage8. »
Parmi les attributs devant discriminer (au sens premier) la « beauferie » par rapport à la connerie, on trouve également le racisme. « Le beauf, c’est un con qui aime pas les étrangers », résumera Coluche dans un entretien au Nouvel Observateur (24 août 1984). Sur le même registre, Renaud, dans Mon Beauf (1982), déploie sur huit couplets le portrait du réactionnaire que Mon HLM ne faisait qu’effleurer. Une poignée d’apophtegmes nettement empruntés à la manière d’Audiard permettent au chanteur de s’inscrire dans la tradition du jugement de connerie tout en la détournant par l’ajout d’une correction idéologique :
On choisit ses copains, mais rarement sa famille
Y a un gonze mine de rien qu’a marié ma frangine
Il est devenu mon beauf, un beauf à la Cabu
Imbécile et facho, mais heureusement cocu
Quand l’soleil brillera que pour les cons
Il aura les oreilles qui chauffent
Mon beauf.
Tout se passe comme si le beauf était le produit d’une mise au point – au sens optique – appliquée au con. La focale s’est resserrée sur un (et un seul) antagonisme social revenant, pour une « nouvelle gauche », à stigmatiser une droite archaïque et stéréotypée. Si notre métaphore optique a du sens, c’est aussi parce que le beauf porte sa tare sur son corps. Il est visuellement marqué par sa condition sociale et idéologique. Quelques années plus tôt, il avait suffi à Georges Wolinski d’ébaucher quelques lignes et courbes pour créer son Roi des cons, bonhomme minimaliste qui incarnait, comme le Beauf, un début de médiocrité populaire, mais le style de ce premier personnage restait dépersonnalisé. Cabu fait pour sa part un choix de graphic design aux antipodes de son camarade Wolinski. Autrement détaillé, le beauf impose une enveloppe palpable : une masse adipeuse aussi pesante que son caractère et une pilosité suspecte que peine à contenir son survet’ tricolore. Bref, le personnage n’incite guère à l’identification et laisse peu de doute sur ce qu’il convient de penser de lui. Comme l’écrit Paul Yonnet : « Mon beauf […] se reconnaît au faciès ; il est gros, blanc, rond, porte une moustache ringarde, avec l’air veule. Il représente les couches populaires restées en rade de l’évolution des mentalités, les laissés-pour-compte de la modernité9. » Cavanna avait, lui aussi, bien remarqué à quel point cette « effroyable sale gueule » constituait la meilleure signification politique du beauf.
Le personnage de Cabu réussira mieux que d’autres tentatives de même humeur parce qu’il cristallisait toutes les représentations diffuses de son époque. La redéfinition culturelle du progressisme en France qui préside à ces changements est à la fois affaire de génération et de solidarités médiatiques entre les nouvelles grandes figures de la presse magazine spécialisée. En 1982, le périodique Fluide Glacial publie un hors-série spécial pour célébrer les dix ans du beauf. Plusieurs dessinateurs y donnent leur contribution graphique, dont Cabu, qui hérite de la quatrième de couverture. Dans cet espace stratégique, il propose un cross-over, sorte de duel au sommet entre Superdupont et le beauf. Les six cases de cette planche condensent l’ensemble des traits du nouveau stéréotype social repoussoir. Même le personnage de Gotlib gagne en antipathie sous le crayon de l’ex-collaborateur de Charlie. Celui-ci fait aussi intervenir, pour décider du « match » entre les deux personnages, la caricature d’un Roger Hanin hirsute qui assènera à Superdupont, avec l’accent pied-noir qu’on imagine, cette nouvelle paraphrase d’Audiard : « Le jour où les cons voleront, toi tu seras chef d’escadrille ! »

Prix : 20 EUR
18 Mai 2024
Quoi de plus révélateur que de tels croisements médiatiques pour illustrer que ce qui se jouait, vers 1980, c’était bien l’émergence d’un imaginaire générationnel cherchant à départager autrement le conflit social et culturel ? Sans abolir les départages dépolitisés de l’ancien discours du con, cet imaginaire leur fait concurrence, souvent avec les mêmes armes (péremptoire et apophtegmes) tout en forçant le détail à partir de profils sociologiques. Cabu insistait sur le fait que son attaque portait avant tout sur cette mentalité bouffie de certitude caractéristique des Français adhérents du « sens commun » – catégorie forcément fictive pour une gauche libertaire qui considère tous les récits, quels qu’ils soient, comme équivalemment « politiques ». Mais dans sa verve à dire le vrai dans le trait, le dessinateur ne rendait-il pas les coups du péremptoire, liant la mentalité dénoncée à un « délit de sale gueule » dont l’image allait inonder la production culturelle de la fin du siècle ? Le personnage du beauf ferait florès chez Renaud comme dans les comédies populaires : celles de la troupe du Splendid (Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, etc.) ou ce film oublié, Le Beauf, qu’Yves Amoureux réalise en 1987 avec Gérard Jugnot dans le rôle-titre. Récemment, le stigmate accolé au personnage sera revendiqué par ceux qu’il entendait dénoncer : c’est ainsi que le dessinateur Marsault, « Gotlib de l’underground réac » d’après le magazine Causeur (11 décembre 2016), reformulera le beauf dans un personnage récurrent, plus skinhead que « populo » à vrai dire. Tentative qui documente avec violence les malentendus que peuvent susciter (en amont comme en aval) toutes les indignations par trop stéréotypées contre la stéréotypie.
[1] Le chanteur reviendra plus tard sur cette expression, se la réappropriant en quelque sorte, avec la chanson Tonton, nettement plus désillusionnée, présentée dans l’album Le Marchand de cailloux (1991).
[2] Cf. Pascal Ory, L’entre-deux-mai. La crise d’où nous venons, 1968-1981, Paris, Alma, 2018.
[3] On trouvera des réflexions instructives aussi bien dans Le Capitalisme de la séduction (1981 ; rééd. Delga, 2006) du philosophe marxiste Michel Clouscard (pour le volet analytique) que dans la Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col mao au Rotary (1986 ; rééd. Agone, 2014) deGuy Hocquenghem (pour le volet polémique).
[4] Philippe Muray, Désaccord parfait, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2010, p. 209.
[5] Dans l’album Le Retour du Gérard Lambert (Polydor, 1981).
[6] Selon l’INSEE, il n’est que le 6e patronyme le plus répandu en 1970.
[7] François Cavanna, Bête et méchant, Paris, Le Livre de Poche, 1983, p.247-248.
[8] Annie Ernaux, Les Années, Paris, Gallimard, 2008, p. 116.
[9] Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise français, Ibid., p. 142.
14.07.2024 à 13:07
Après les législatives, l’urgence d’une nouvelle République
William Bouchardon
Texte intégral (3998 mots)
Après le coup de poker raté d’Emmanuel Macron, la France est ingouvernable et risque de le rester pour quelques temps. Pendant que la gauche cherche un candidat pour Matignon et que le RN fourbit ses armes pour les prochaines échéances, le Président de la République reste au cœur du jeu politique grâce à ses pouvoirs exorbitants. Dans cette configuration, un nouveau sursaut autocratique, notamment à travers un gouvernement technocratique, est probable. Pour déjouer ce scénario, il est urgent que la gauche exige des réformes constitutionnelles au plus vite, notamment le RIC. Alors que la France est plus mûre que jamais pour la Sixième République, la gauche n’en parle plus. Comment l’expliquer ?
Les urnes ont parlé. Mais en l’absence de majorité, chacun y va de son interprétation des résultats de dimanche dernier et de la traduction à leur donner, à Matignon comme à l’Assemblée nationale. Quel que soit le scénario de politique fiction qui sera retenu au final, deux choses sont certaines : tout gouvernement issu de cette XVIIe législature sera extrêmement fragile et la crise démocratique reste entière. Après une campagne express sous très haute tension, l’atmosphère reste survoltée. Or, les négociations et manœuvres en tout genre qui se déroulent dans les palais de la République et le commentaire permanent et stérile des chaînes d’info n’aboutissent qu’à un seul résultat : dégoûter encore davantage les Français, qui ont le sentiment de se faire avoir une fois de plus.
Les électeurs du Rassemblement national – premier parti en nombre de voix mais troisième à l’Assemblée en raison du mode de scrutin et du barrage – sont assurément les plus frustrés, mais la même déception risque de toucher très vite ceux du nouveau Front Populaire. À l’inverse des discours mettant en avant un retour en force du Parlement, il est bien possible que le sentiment anti-parlementariste finisse par être le grand gagnant de cette séquence.
Une élection qui ne règle rien, un système à bout de souffle
Il faut dire que la barque est déjà bien chargée : outre la violation du résultat du référendum de 2005, trois élections présidentielles et maintenant une élection législative se sont terminées par la contrainte des électeurs à faire barrage à l’extrême-droite. Si pour la première fois, la gauche est aussi – en partie – bénéficiaire de ce « front républicain» , celui-ci avantage surtout les libéraux. La bonne résistance du camp macroniste à l’Assemblée nationale le prouve à nouveau. Tel était d’ailleurs le scénario initial du Président de la République avec cette dissolution : après avoir fait progresser le RN au plus haut et repris son programme dans la loi immigration, il espérait que les électeurs de gauche, orphelins de candidats au second tour faute d’union, lui offrent une fois encore une majorité pour mener sa politique de guerre sociale. Si la création du Nouveau Front Populaire a partiellement déjoué ce jeu, l’obstination des macronistes à ne pas tenir compte de ce vote barrage perdure.
Il est bien possible que le sentiment anti-parlementariste finisse par être le grand gagnant de cette séquence.
La lettre aux Français du chef de l’État est symptomatique de son déni complet de la réalité. En sortant une nouvelle fois de son rôle de gardien des institutions pour venir dicter ses conditions alors que son camp a été sanctionné et se fracture, il dévoile avant tout sa mégalomanie. Puis, en proposant – en l’enrobant dans des formules creuses – une coalition large sans le Rassemblement National et la France Insoumise alors qu’il n’a pas été capable d’en faire une avec ses alliés objectifs des Républicains pendant deux ans, il rappelle son splendide isolement. De toute façon, il est trop tard pour un tel scénario : la macronie étant devenue radioactive aux yeux d’une majorité de Français, quiconque s’y associerait serait emporté dans sa chute. Les Républicains ont donc tout intérêt à attendre et la gauche à rester unie et ne pas chercher d’hypothétiques « compromis » avec les forcenés de l’austérité et de l’ultra-libéralisme. À moins de trois ans de la prochaine présidentielle, de telles compromissions seraient suicidaires.
Si l’on exclut ces scénarios d’alliances baroques, il ne reste alors plus que deux possibilités pour gouverner avec une législature incroyablement fracturée. Le premier est celui d’un gouvernement minoritaire, du nouveau Front Populaire ou du camp présidentiel, recherchant l’appui d’une majorité au cas par cas en fonction des projets de loi, et toujours à la merci d’une censure. À côté, la IVe République est un vrai modèle de stabilité. La seconde possibilité est celle d’un gouvernement technocratique formé « d’experts » et de « personnalités » non élus. Il suffit de se tourner vers l’Italie, qui a connu quatre expériences de ce type depuis les années 1990, pour voir ce que cela donnerait : un enchaînement de mesures d’austérité, un mépris total du peuple et, au final, une victoire de l’extrême-droite. Toujours prompt à jouer avec le feu, Macron pourrait être tenté par cette option. De la même manière que le général versaillais Mac Mahon – élu Président de la République en 1873 – avait tenté de rétablir la monarchie contre la volonté populaire, il est sans doute tentant pour un ex-banquier de vouloir soumettre un pays au diktat d’un petit conseil d’administration chargé de faire appliquer la loi du marché.
Le problème politique principal de la France à cette heure ne se trouve pas à l’Assemblée nationale, mais à l’Elysée.
Ainsi, le problème politique principal de la France à cette heure ne semble pas se trouver à l’Assemblée nationale, mais plutôt à l’Elysée. En usant de sa prérogative de nomination du Premier ministre, de son pouvoir de dissolution, en refusant de signer certains décrets du gouvernement, voire en ayant recours à l’article 16 de la Constitution (qui permet au Président de s’attribuer les pleins pouvoirs notamment en cas d’interruption du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels », ndlr), Emmanuel Macron peut toujours faire la pluie et le beau temps pendant trois ans. L’absence de majorité absolue pour lui faire contrepoids risque d’ailleurs de le conforter dans l’idée d’abuser de ces pouvoirs. Dans l’interlude très incertain qui nous sépare de 2027, le risque autoritaire inhérent à la Constitution de 1958 risque donc de s’exprimer plus que jamais.
Un tel niveau de concentration des pouvoirs a toujours été dangereux. Mais le décalage des élections législatives avec la présidentielle et le risque d’alternance omniprésent dans un système bipolaire décourageait les précédents occupants de l’Elysée de trop abuser de leurs prérogatives constitutionnelles. Depuis les années 2000, l’inversion des calendriers électoraux et l’appui sur le vote « barrage » pour gagner ont fragilisé ces gardes fous implicites. Avec Emmanuel Macron, et singulièrement depuis deux ans, une nouvelle étape a été franchie : désormais, il est possible de gouverner non plus sans majorité (notamment au travers de l’article 49.3), mais même contre la majorité. Sa gestion des mouvements sociaux le démontre parfaitement : là où ses prédécesseurs étaient généralement prêts à négocier, le chef de l’État n’a qu’une seule réponse : la répression policière et judiciaire. Gilets jaunes, militants écologistes, syndicalistes et représentants associatifs peuvent en témoigner.
Censé pouvoir limiter de telles violations des libertés fondamentales, le pouvoir judiciaire dispose d’une indépendance très relative. Il suffit de regarder le mode de nomination des juges du Conseil Constitutionnel – sélection par le Président de la République, celui du Sénat et celui de l’Assemblée nationale, et siège de droit pour les anciens Présidents – pour comprendre pourquoi. Si certains mettront au crédit des « sages » la censure de quelques dérives liberticides de l’ère Macron comme la loi Avia (censure de contenus en ligne), l’article 24 de la loi sécurité globale (interdiction de filmer les policiers) ou certains articles de la loi immigration, les recours devant le juge suprême s’apparente toutefois à la loterie. Ainsi, l’instauration du pass sanitaire n’a jamais été censurée, tandis que la demande de plusieurs centaines de parlementaires d’un référendum d’initiative partagée sur la réforme des retraites a été enterrée. Un bilan qui n’offre guère d’espoirs en cas de nouveaux abus de pouvoirs.
Pourquoi la gauche ne parle plus de la Sixième République
Face à un tel constat, une réforme constitutionnelle globale est plus urgente que jamais. L’option séduit près de deux tiers des Français, en particulier les électeurs de gauche et du RN, selon un sondage réalisé juste après les législatives. Un tel résultat n’est nullement une surprise : la monarchie élective de la Ve République, inadaptée à la tripartition de la vie politique, ne séduit plus que les macronistes les plus fidèles et les électeurs LR nostalgiques du général de Gaulle. Ces dernières années, les signaux indiquant la volonté des Français de prendre part plus souvent aux décisions politiques se sont multipliés, sous des formes très diverses. La participation historique à ces législatives indique ainsi une volonté de redonner du poids au Parlement face à l’exécutif. Quelques années auparavant, une immense demande de démocratie directe s’est exprimée avec la revendication phare des gilets jaunes : la création d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant de faire et défaire les lois, mais aussi de révoquer des élus durant leur mandat (référendum révocatoire), voire de réviser la Constitution (RIC constitutionnel). Enfin, les expériences de démocratie participative comme les Conventions citoyennes pour le climat et sur la fin de vie ont montré que des citoyens de tous horizons étaient volontaires et capables de s’intéresser à des sujets complexes et d’aboutir à des propositions fortes.
L’idée d’une Sixième République séduit près de deux tiers des Français, en particulier les électeurs de gauche et du RN.
Théoriquement, la gauche est le camp le plus à même de porter ces demandes. Souhaitant permettre au peuple français de se refonder et de se donner de nouveaux droits (à l’instar du droit à l’IVG récemment ajouté à la Constitution), Jean-Luc Mélenchon plaide ainsi pour la sixième République depuis près de 20 ans. La convocation d’une Assemblée constituante élue figure d’ailleurs toujours au programme du nouveau Front Populaire (NFP), quoiqu’elle soit listée parmi les mesures de moyen terme. Le fait que cette option n’ait pas été évoquée une seule fois depuis dimanche dernier interroge donc : face au blocage institutionnel dont Macron peut largement tirer profit, pourquoi la gauche ne revendique-t-elle pas cette refonte complète des institutions dès maintenant ?
Certes, on peut arguer qu’il y a d’autres chantiers plus urgents à mener : le rétablissement des services publics, le climat, la lutte contre la pauvreté… Mais on voit mal comment le nouveau Front Populaire pourrait avancer sur ces dossiers avec son poids limité, et surtout l’opposition résolue de presque tout le reste de l’Assemblée nationale. À moins que cela ne soit justement l’explication de ce silence. La Vème République permettant de gouverner sans majorité absolue, notamment grâce à des décrets, à la non-nécessité d’un vote de confiance et au recours à l’article 49.3, un gouvernement du NFP pourrait être tenté de passer quelques mesures fortes sans vote de l’Assemblée afin de contourner les blocages. La manœuvre est à première vue pertinente sur le plan stratégique, mais elle risque de précipiter le vote d’une motion de censure mettant fin à toute cette expérience.
Outre ce potentiel calcul, il existe une autre hypothèse, moins avouable, expliquant cette disparition soudaine du thème de la VIe République dans les discours de gauche : la crainte du peuple. Pour le centre-gauche en particulier, il peut en effet apparaître dangereux de confier la réécriture de la Constitution ou d’accorder le RIC à un peuple qui vote pour un tiers à l’extrême droite. L’exemple d’un retour de la peine de mort est ainsi régulièrement convoqué comme exemple de mesure réactionnaire souhaitée par les Français en cas d’instauration du RIC. L’échec du processus constituant chilien est parfois également convoqué : le texte initial, très progressiste, n’a-t-il pas été rejeté ? On pourra cependant objecter que la peine de mort n’est défendue par aucune force politique et pratiquement jamais évoquée dans le débat public et que le texte proposé aux Chiliens a surtout été refusé en raison d’une seule mesure : la reconnaissance d’un État plurinational instaurant davantage de droits aux peuples autochtones.
Libérer la voix de la souveraineté populaire
Cette crainte de l’expression populaire en dit surtout long sur ceux qui la portent, à savoir les électeurs de centre-gauche des grandes métropoles, pour beaucoup membres des élites culturelles (journalistes, professionnels de la culture, des ONG etc). Pour cette frange très minoritaire de la population, laisser un tel pouvoir au peuple français reviendrait à laisser les médias d’extrême droite dicter la future Constitution ou les verdicts des futurs référendums. Bien sûr, ces médias représentent un vrai danger et une vaste réforme contre la concentration de l’appareil médiatique aux mains de grandes fortunes est indispensable. Considérer que les Français se laisseraient nécessairement dicter leurs choix politiques par les médias est pourtant réducteur, voire méprisant. Le référendum de 2005 en est un parfait exemple : malgré le matraquage médiatique permanent en faveur du « Oui » à une Constitution européenne ultra-libérale, 55 % des électeurs ont fini par voter non. De même, les gilets jaunes n’ont pas émergé du fait d’un appel à la mobilisation traditionnel et la critique médiatique dont ils ont fait l’objet était considérable. Pourtant, en dehors de tout cadre organisationnel, leurs revendications se sont très vite portées autour de l’exigence de justice fiscale. Croire que Vincent Bolloré et Cyril Hanouna gouverneraient indirectement la France en cas de Constituante et d’instauration du RIC est donc profondément erroné.
En outre, mettre en place le RIC aurait un double avantage pour la gauche. D’abord, cela lui permettrait d’envoyer un signal fort de confiance dans le peuple français, quelles que soient leurs sympathies politiques. Les mesures adoptées par RIC seraient d’ailleurs bien plus légitimes que celles adoptées par une Assemblée nationale particulièrement divisée. Surtout, cela permettrait à la gauche de faire campagne sur des mesures concrètes, plutôt que d’être prisonnière des querelles de personnes et de partis.
Le RIC permettrait à la gauche de faire campagne sur des mesures concrètes, plutôt que d’être prisonnière des querelles de personnes et de partis.
Or, nombre de propositions formulées ces dernières années par la France insoumise et reprises par le NFP sont extrêmement populaires dans l’opinion. De la réforme de l’impôt sur le revenu à l’augmentation du SMIC en passant par les investissements massifs dans les services publics et les propositions écologiques (règle verte, rénovation thermique des logements, prix plancher agricoles), nombre de réformes sont soutenues par au moins 70% des Français. Enfin, en allant chercher les signatures nécessaires au référendum et en faisant ensuite campagne pour faire adopter ces mesures, les militants des partis qui composent le NFP et des autres organisations qui le soutiennent (syndicats, associations écologistes…) pourraient rassurer les Français sur la crédibilité de leur programme en le mettant petit à petit en place.
La proportionnelle en place dès les prochaines législatives ?
Malgré les avantages que présente le RIC pour sortir du blocage politique et initier l’application du programme de la gauche, celle-ci n’en parle pas pour l’instant. À ce stade, une seule réforme institutionnelle est évoquée : celle de la proportionnelle aux élections législatives. Une proposition de loi en ce sens vient d’ailleurs d’être déposée par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Selon elle, en attendant l’arrivée d’une nouvelle Constitution, ce mode de scrutin permettrait de corriger un grave problème de la représentation actuelle : le fait qu’un bloc puisse avoir une large majorité de députés tout en étant minoritaire dans le pays. Si la situation a partiellement été corrigée depuis tout en restant dans le cadre du scrutin uninominal à deux tours, il suffit de se souvenir de la situation qui a prévalu lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron pour comprendre les défauts de ce mode de scrutin. Après avoir trahi leur promesse d’introduire « une dose de proportionnelle », les macronistes pourraient bien devenir les plus fervents soutiens de ce système, maintenant que leur survie est menacée. Il suffirait ainsi que leurs candidats arrivent troisièmes dans la plupart des circonscriptions et perdent les duels de second tour lors des prochaines élections pour qu’ils perdent presque tous leurs députés.
Outre le camp présidentiel, le PS et EELV ont également intérêt à la proportionnelle s’ils souhaitent ne plus dépendre des électeurs insoumis pour s’assurer une représentation parlementaire. Après tout, n’est-ce pas justement le fait que les élections européennes soient à la proportionnelle qui les a décidé à rompre la NUPES ? Il en va de même pour les communistes, bien qu’il aient intérêt à un faible seuil pour avoir des élus étant donné leur faible poids électoral. Au-delà de l’intérêt direct de ces forces politiques, la proportionnelle semble en capacité de réunir tous les promoteurs du « barrage républicain », puisqu’elle rendrait très difficile pour le RN la conquête d’une majorité absolue. Si le parti d’extrême droite est bien le premier parti de France, les élections de dimanche dernier ont en effet confirmé qu’une majorité de Français sont toujours fermement opposés à ce qu’il gouverne.
Ainsi, après des décennies de promesses rompues d’instauration de la proportionnelle, celle-ci pourrait arriver plus rapidement qu’on ne le pense. Elle permettrait en outre de sortir de l’injonction au « front républicain » devenue systématique en permettant à chacun de voter pour la liste qui représente le mieux ses idées. Plus ce refrain est utilisé, plus il s’use et plus il nourrit le discours du RN autour d’un retour de « l’UMPS ». Cependant, une fois en place, la proportionnelle impliquera la formation de gouvernements de coalition et de nombreux compromis entre partis politiques, comme cela est le cas chez nos voisins. Une manière de faire de la politique à laquelle la France n’est pas habituée.
L’instauration de la proportionnelle ne sera pas suffisante pour résoudre la crise politique actuelle.
Surtout, l’instauration de la proportionnelle ne sera clairement pas suffisante pour résoudre la crise politique actuelle. Toute réforme constitutionnelle digne de ce nom devra s’attaquer au rôle omnipotent du locataire de l’Elysée. Outre les risques que posent la concentration de pouvoirs entre les mains d’une seule personne, il est désormais évident que l’élection à deux tours, dont un duel, est inadaptée à un système politique tripolaire. Alors qu’elle a historiquement été la plus en pointe dans la critique de la Ve République, il y a donc quelque chose de surprenant à ce que la gauche n’en parle subitement plus. L’heure n’est pourtant pas aux pudeurs de gazelles.
13.07.2024 à 21:02
Face au RN, sortir la gauche du déni
Hugo Philippon
Texte intégral (3364 mots)
Ouf ! On a encore eu de la chance. La victoire du Rassemblement national a été évitée, ses dix millions de voix vite oubliés, on peut enfin respirer. L’heure est à la fête même ! On a eu chaud, mais ce n’est pas une raison pour se remettre en question. Au lendemain des législatives 2022, nous alertions face aux victoires en trompe-l’œil : deux ans plus tard, il est amer de constater qu’aucune conséquence n’a été tirée. Maintenant, tout peut recommencer comme avant. Et à gauche, on danse sur les ruines. Pourtant, seule l’analyse lucide d’un bilan accablant peut permettre d’inventer une nouvelle voie pour un pays en sursis.
C’est comme dans Game of Thrones. Qu’est-ce qu’on dit à la mort ? « Not today. » Pour Le Pen, c’est pareil. Ce ne sera pas pour cette fois, mais ça arrivera bien un jour. Et cette fois, disons-le d’emblée, on a sorti les grands moyens. Car on aime ça à gauche, se faire peur. On se sent vibrer, on se sent vivre. On se compte les uns les autres dans cet écrin de pureté qu’on appelle le « camp progressiste ». On est peu nombreux, certes. Minoritaires même. Mais le combat n’en est que plus beau. Et la lutte a été héroïque. On a scandé « No pasarán ! », on a formé une alliance allant de François Hollande à Philippe Poutou, on s’est rassemblé Place de la République et on s’est enfin désisté pour sauver Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. En fait d’un « Front populaire », c’est un Front de la trouille qui a sauvé la situation. On a fait barrage, comme d’habitude.
Pourquoi le peuple vote mal
Car les choses étaient mal engagées. Prenant la mesure du danger, la gauche a voulu expliquer les déterminants essentiels du vote RN pour mieux le combattre. Alors on a renoué avec la grande tradition de l’antifascisme de confort et on a su mobiliser les meilleurs arguments. Sur les plateaux, on invoque l’histoire : « Saviez-vous que le Front national avait été fondé par d’anciens Waffen-SS ? » Sur Twitter, on convoque la sociologie : « Saviez-vous que les électeurs du RN étaient les moins diplômés ? » En plus, Jordan Bardella a eu un 4/20 en géo à la fac, la boucle est bouclée. La reductio ad hitlerum et le point Godwin en bandoulière, la gauche rappelle utilement que les électeurs du parti à la flamme sont des idiots. L’électorat du Rassemblement national est donc composé de nazis et de cons, mais le raisonnement se heurte à un problème : à gauche, on aime le peuple. Comment expliquer que le peuple vote mal ? La réponse du militant de gauche tient en trois temps.
Les plus érudits mobiliseront la « fausse conscience », une notion-clé sur laquelle repose d’après eux une grande part de l’édifice théorique marxiste. Tant pis si on n’en trouve guère qu’une seule occurrence dans une lettre de Friedrich Engels à Franz Mehring, l’importance du « concept » tient à ce qu’il permet de dire que les gens se trompent tout en s’abritant derrière l’autorité du camarade de Marx, avec le vernis intellectuel qui va bien.
Les « classes populaires », soit les ouvriers et les employés qui représentent 45 % de la population, ne votent définitivement pas à gauche.
Les plus férus de statistiques interrogent quant à eux les chiffres. Le Rassemblement national fait 57 % chez les ouvriers et 44 % chez les employés1 ? Les choses sont plus compliquées. Ce ne sont que les suffrages exprimés, rapportez ces scores au nombre des inscrits, vous verrez qu’ils ne sont pas si importants. Et le militant Twitter de répéter les lieux communs des télés : « L’abstention ne serait-elle pas le premier parti des classes populaires ? » On pourrait pousser le raisonnement plus loin, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Intégrez les non-inscrits, les personnes résidant sur le territoire qui n’ont pas la nationalité et les moins de 18 ans, vous constaterez que le score du Rassemblement national baisse sensiblement.
Le troisième temps de la démonstration permet un heureux dénouement. À force de tronquer les tableaux et de sélectionner les données qui arrangent, on obtient les résultats que l’on souhaite. Car les chiffres sont trompeurs : le peuple, c’est les pauvres, et les pauvres votent bien à gauche. Au premier tour des élections législatives de 2024, le Nouveau front populaire obtient 35 % des voix chez les foyers dont le niveau de revenus mensuels est en dessous de 1 250 €, 7 points de plus par rapport aux 28 % obtenus nationalement. Même chose au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 où 30 % des plus bas revenus votaient Jean-Luc Mélenchon, soit 8 points de plus que le score général2. Une belle découverte. Une épiphanie. Quoique le Rassemblement national réalise des scores comparables – 31 % en 2022, 38 % en 2024.
C’est par ailleurs oublier un peu vite que le niveau de revenu n’est pas la classe sociale, qu’il ne dit rien du rapport à l’outil de travail et à l’appareil productif dans son ensemble. C’est oublier, donc, que cette catégorie de la population est celle qui bénéficie prioritairement des revenus de transfert et des minima sociaux, celle qui a intérêt à la dépense publique. Rien de problématique là-dedans, simplement un constat : les « classes populaires », soit les ouvriers et les employés qui représentent 45 % de la population, ne votent définitivement pas à gauche.
Mais les faits ont peu d’importance. Lorsqu’on ambitionne de transformer le réel, on ne s’arrête pas à ce genre de considérations. Seuls comptent les postulats de départ. Résumons. Lorsqu’il ne s’abstient pas, le peuple vote à gauche, sauf à être victime de l’épidémie de « fausse conscience » sciemment entretenue par des médias complices. Ces trois distorsions pouvant être complétées par l’explication initiale – et, reconnaissons-le, plus directe –, selon laquelle les électeurs du Rassemblement national sont fascistes parce qu’ils n’ont pas fait suffisamment d’études. Pourtant, le RN est aux portes du pouvoir, il importe donc de définir une stratégie.
« Nouvelle France » : la note Terra Nova ressuscitée
Parce qu’une analyse bancale a toutes les chances d’aboutir à un diagnostic erroné, il n’est pas étonnant que la solution déduite dudit diagnostic soit également fautive. De là l’idée de la « Nouvelle France » présentée à l’occasion des élections européennes. On croirait le bon mot de Brecht – puisque le peuple vote mal, ne serait-il pas plus simple de le dissoudre pour en élire un nouveau ? – formulé pour la circonstance. Le nouvel électorat de la gauche, celui de la France de demain, c’est cette vaste coalition rassemblant les diplômés, les jeunes, les minorités et les quartiers populaires.
En lisant cela, un ancien soutien de François Hollande pourrait croire qu’on lui parle d’autre chose. Peut-être la note Terra Nova de 2011 pourrait-elle même se rappeler à lui, tel le spectre d’un passé qu’on croyait révolu, celui d’un Parti socialiste hégémonique qui n’était pas encore devenu le cimetière des éléphants. Notre militant socialiste, un peu distrait certes, pourrait en effet trouver quelque ressemblance entre la formule actuelle et ce que présentait ledit rapport, notamment la possibilité d’un « nouvel électorat de la gauche : la France de demain », lequel électorat serait formé des diplômés, des jeunes, des minorités et des quartiers populaires.
Et Terra Nova d’insister sur la nécessité d’une « stratégie centrée sur les valeurs ». Tout en faisant le constat de la « fin de la coalition ouvrière ». Cette note a concentré les critiques de la gauche mélenchoniste pendant plus d’une décennie parce qu’elle actait l’abandon du prolétariat – comme on disait, dans le temps jadis –, parce qu’elle ne proposait aucune stratégie de reconquête de l’électorat face au Front national, parce qu’elle annonçait toutes les trahisons du quinquennat Hollande. Mais elle a été publiée il y a treize ans maintenant, sans doute que son apparente ressemblance avec l’idée de la « Nouvelle France » relève du hasard.
Il n’en reste pas moins que la stratégie actuelle fonctionne. La « Nouvelle France », c’est « le peuple des villes, des banlieues ». Toutes les cartes électorales dressées au lendemain des européennes le confirment : dans les villes et les banlieues, le succès est éclatant. Notons que c’est moins le cas dans le reste du pays, ce qu’on appelle vulgairement « la province », où le Rassemblement national arrive en tête dans 93 % des communes aux européennes. Mais à Paris, Lyon, Rennes et Toulouse, la performance mérite d’être saluée.
Une gauche coupée du pays
Traditionnellement, la France voit s’opposer le Paris révolutionnaire et les provinces conservatrices. En 1789, 1792, 1830, 1848 ou 1871, la configuration est toujours la même. À l’hiver 2018, cependant, les cartes étaient rebattues. Les provinces s’insurgeaient, Paris s’inquiétait. Cette inversion radicale du plan général de notre histoire se confirme aujourd’hui sur le plan sociologique.
L’électorat d’Emmanuel Macron soutient toutes les réformes qui lui sont proposées pour protéger son patrimoine, garantir le versement des pensions de retraite et poursuivre toujours plus avant la dynamique de libéralisation de l’économie et son ouverture à l’international. Le point commun des catégories composant cet électorat ? Elles vivent du travail des autres et ont pour cette raison intérêt à la stabilité.
L’ensemble des forces de gauche recueillait quant à lui 53 % des intentions de vote chez les étudiants, 51 % chez les enseignants, 64 % chez les professionnels des arts et spectacles, contre 24 % chez les ouvriers qualifiés dans l’industrie, 16 % chez les ouvriers exerçant dans l’artisanat, et 16 % encore chez les chauffeurs3. La gauche d’aujourd’hui est quasi complètement coupée des classes productives, de ceux qui produisent de la richesse, de ceux qui travaillent dans le secteur privé et de plus en plus des travailleurs du secteur public. Son électorat est structurellement conservateur, au sens premier du terme, en ce qu’il a pour seule boussole la préservation de ses intérêts et de sa position privilégiée dans l’appareil productif.
Il s’accommodera d’une certaine mondialisation et d’une accélération des flux, mais contrairement à l’électorat centriste, il souhaite l’accroissement de la dépense publique et une politique de redistribution plus ambitieuse. Il n’empêche, pour la gauche, le monde du travail est devenu une terra incognita. Depuis l’enseignant payé par l’État jusqu’au travailleur de la culture dépendant des subventions, en passant par le jeune urbain ouvert d’esprit et attaché à la diversité qui est ravi de pouvoir se faire livrer son Deliveroo à moindre coût, de larges pans de la gauche ont intérêt au statu quo. Et l’on ne peut que constater avec tristesse que la volonté de renverser la table est aujourd’hui captée, non par le camp dont c’est le projet historique, mais par un parti réactionnaire parvenu à étendre sa toile sur l’ensemble du pays.
Le Rassemblement national, infiniment plus « populaire » que le Front du même nom, a engagé sa mue transclassiste, c’est-à-dire tendanciellement majoritaire.
En face, la structure du vote en faveur du Rassemblement national est d’une clarté sociologique édifiante. Après avoir conquis l’électorat ouvrier et emporté l’adhésion des employés, il a patiemment progressé dans les couches les plus précarisées des classes moyennes, les a progressivement grignotées jusqu’à atteindre des secteurs qui lui étaient jusqu’alors interdits – un enseignant sur cinq se prononçait ainsi pour le RN au premier tour des législatives de 20244. Cet alignement chimiquement pur entre la structure de classes et le vote constituait jusqu’à présent le miroir inverse du vote macroniste. C’est terminé. Le prétendu plafond de verre a volé en éclats : Jordan Bardella effectue une percée dans tous les segments de l’électorat, chez les femmes (+ 15 points entre les législatives de 2022 et celles de 2024), chez les retraités (+ 19 points) et les diplômés du supérieur (+ 11 points)5. Le Rassemblement national, infiniment plus « populaire » que le Front du même nom, a engagé sa mue transclassiste, c’est-à-dire tendanciellement majoritaire.
Sortir du déni de réalité
Malgré l’histoire du parti, malgré le nom de Le Pen, malgré le CV chargé de quantité de ses responsables, malgré l’ombre de son fondateur, malgré le racisme, malgré l’antisémitisme, malgré la nullité de ses dirigeants, malgré les reniements, les mensonges, les outrances, malgré l’opprobre : les gens votent pour le Rassemblement national. Et la question reste la même. Pourquoi ? On pense à un vote contestataire ? Ses électeurs répondent qu’ils votent contre l’immigration. Un vote anti-système peut-être ? Également. Serait-ce alors en raison d’un pessimisme foncier, d’un regard négatif porté sur l’avenir ? Toujours pareil. Quelle que soit l’hypothèse formulée, la réponse est toujours la même. Jusqu’ici, il ne semble pas avoir été envisagé de croire sur parole des électeurs qui votent systématiquement pour les mêmes motifs, toujours plus nombreux, élection après élection – que voulez-vous, les voies de la science politique sont impénétrables.
Un parti à ce point médiocre, dont l’idéologie et le programme se résument à la seule et unique question migratoire autour de laquelle sont vaguement articulées quelques mesures qui sont autant de variables d’ajustement, se trouve donc aujourd’hui au seuil du pouvoir. C’est sur ce seul thème que repose tout l’édifice. L’accès à l’emploi ? L’accès au logement ? Aux prestations sociales ? La question fiscale ? Dans le logiciel lepéniste, les problèmes compliqués trouvent une réponse simple. Une seule et unique solution qui répond à une inquiétude partagée par 67 % des Français6. Une inquiétude à laquelle la gauche répond par l’ouverture d’esprit et la moraline.
Marcher sur ses deux jambes
Sur cette question comme sur celle du besoin de protection économique, de la justice fiscale, de l’insécurité ou des fins de mois difficiles, une voie peut être ouverte : l’éventualité d’une prise en compte du réel. Envisager de tenir compte de ce que dit l’immense majorité du pays sur les inquiétudes du quotidien. La possibilité, aussi, d’essayer de se reconnecter aux structures sociales du pays et aux rapports de production qui en découlent. De parler à nouveau à la France qui travaille et à la France qui paie. À la France qui produit de la richesse, aux actifs, aux travailleurs pauvres, aux ouvriers, aux employés. À cette France qui doit être unie par les intérêts matériels qui sont les siens plutôt que fracturée par les querelles identitaires qui empêchent de faire advenir la voie majoritaire qui s’impose. Car c’est là l’image partagée par la majorité des gens : celle d’une gauche vivant aux crochets de la société et qui, en plus, donne des leçons. Une gauche généreuse, certes, mais irréaliste, coupée qu’elle est de la réalité commune.
Il n’en a pas toujours été ainsi. À une époque pas si lointaine, les enseignants et les ouvriers marchaient côte à côte. Ils étaient les « deux cœurs sociologiques de la gauche » chers à Emmanuel Todd. Deux forces sociales dont le divorce consommé nous a entraînés là où nous nous trouvons aujourd’hui. Deux forces dont la réunion pourra, demain, ouvrir de nouveaux horizons.
Il n’en a pas toujours été ainsi. À une époque pas si lointaine, les enseignants et les ouvriers marchaient côte à côte. Ils étaient les « deux cœurs sociologiques de la gauche » chers à Emmanuel Todd.
À l’heure où l’effondrement des services publics essentiels fournit un puissant carburant au vote RN, leur défense, leur amélioration et leur redéploiement partout sur le territoire doit impérativement s’accompagner d’une nécessaire reconnexion avec les forces productives. C’est la mission de notre camp que de se battre pour les écoles, les postes, les stations-essence, les cafés, les boulangeries, les hôpitaux dont les fermetures s’enchaînent et sans lesquels il n’y a pas de vie. Ce n’est pas le Grand Soir, certes. C’est plus simple, mais c’est peut-être bien plus. Cette France des sous-préfectures, du périurbain, des villes moyennes et des villages, cette France-là est ignorée, oubliée, insultée. Considérée comme perdue au seul motif qu’on s’est acharné à la détruire.
Inventer une autre voie
Deux voies s’opposent. Celle du peuple des villes et des quartiers d’une part ; celle de la France des classes moyennes et des classes populaires de l’autre. Une tactique avant-gardiste reposant sur une base géographique étriquée et un patchwork d’identités clivées d’un côté ; une stratégie nationale fondée sur un front de classe clairement défini de l’autre. La première option permet de verrouiller des bastions urbains ; la seconde ajoute à la conservation de ces derniers la reconquête d’un pays passé au RN. La première option est simple et perdante ; la seconde est difficile et potentiellement victorieuse. Seule la seconde embrasse la totalité du pays. Seule la seconde offre une ambition pour l’avenir.
Voilà l’issue. Voilà la seule voie dans laquelle s’engager. Voilà comment une force de bon sens pourra renouer avec le sens commun. Comment un grand récit pourra dépasser le chaos des revendications communautaires. Comment la République sociale pourra panser les plaies d’un pays blessé.
Notes :
[1] Ipsos Talan, Législatives 2024, premier tour : www.ipsos.com/fr-fr/legislatives-2024/legislatives-2024-retour-sur-le-premier-tour
[2] Ipsos, Présidentielle 2022, profil des abstentionnistes et sociologie des électorats : www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-electorat
[3] Enquête électorale Cevipof, Fondation Jean Jaurès, Institut Montaigne, Ipsos, Le Monde, Radio France, France Télévisions, vague 6, juin 2024.
[4] 3Ces profs qui votent RN : “C’est symptomatique de la crise qui traverse l’Éducation nationale” », Le Point, 28 juin 2024.
[5] « Résultats des législatives 2024 : âge, revenus, profession… Qui a voté quoi au premier tour ? », Le Figaro, 1er juillet 2024.
[6] 67 % des sondés considèrent qu’il y a « trop d’immigrés » en France selon une étude BVA Opinion pour RTL, mai 2023.
05.07.2024 à 17:43
Volet « patrimoine » du RN : un programme réactionnaire au profit des propriétaires privés
Oscar Filtin
Texte intégral (2860 mots)
Pour ceux qui ont eu la curiosité de se pencher sur les livrets thématiques du Rassemblement national (RN), une absence était criante : la culture. Le RN lui a préféré un programme « patrimoine », d’une grande faiblesse dans ses constats comme dans sa faisabilité. Loin de bénéficier aux classes moyennes et populaires, il se focalise principalement sur le soutien financier aux propriétaires privés de monuments historiques.
La France est riche d’une tradition de rayonnement par sa politique culturelle. Dès l’ancien régime, le Roi s’efforce de partager le monopole culturel de l’église : Saint Louis crée la Fondation de la Sorbonne en 1253, Charles V la Bibliothèque royale (vers 1350). La vocation culturelle de l’Etat s’affirme à la Renaissance, notamment sous l’influence de François Ier (soutien des artistes, Edit de Villers-Cotterêts). En 1789, les révolutionnaires prônent l’idée d’un « patrimoine libéré »1 : les arts – étant un produit de la liberté – doivent être réunis au pays de la liberté, c’est-à-dire la France. Le Louvre, premier musée du Monde, ouvre ses portes le 10 août 1793. De la création du Ministère des Affaires Culturelles en juillet 1959 – avec à sa tête André Marlaux – au « tout culturel » (Marc Fumaroli) et aux grands travaux depuis les années 1980, la France a affirmé son « exception culturelle » tout au long du XXème siècle.
La diversité de l’exception culturelle française ignorée
En 2024, le champ d’action de l’État en matière de politique culturelle rassemble de multiples acteurs publics (grands musées nationaux et opérateurs de l’Etat, scènes nationales de danse et de théâtre, audiovisuel public, etc.), para-publics (fonds régionaux d’art contemporains) et privés, largement subventionnés (cinéma, producteurs et diffuseurs de musique, système de l’intermittence, propriétaires privés de patrimoine, etc.). La ventilation du budget du ministère de la Culture, d’un montant de 4,466 milliards d’euros pour 2024, est le reflet cette diversité :
2% pour le soutien aux politiques culturelles, 8% respectivement pour le livre et la presse et les médias, 12% pour la rémunération des agents publics du ministère, 19% pour la transmission, 24% pour la création et enfin 27% pour le patrimoine.
Le secteur culturel est à l’origine d’une richesse économique directe (2% du PIB, plus que l’industrie automobile), mais aussi indirecte (on pense notamment au soft power – cinéma, artisanat d’art, architecture – et à l’éducation – musées et programmes d’Education artistique et culturelle). Le Rassemblement national choisit d’ignorer donc cette diversité en traitant uniquement du « patrimoine ».
Le programme présidentiel de Marine Le Pen assume une focalisation patrimoniale réductrice, au détriment d’autres champs d’action, et notamment celui du soutien à la création artistique. Dans cette logique, la première mesure proposée par le RN est la rédaction d’un Livre blanc du patrimoine pour y recenser le patrimoine en danger, à toutes les échelles, et « notamment les églises des petites communes qui sont souvent le seul patrimoine historique ».
Cependant, du « patrimoine », le programme n’aborde que peu la diversité du champ de l’actuel Direction générales des patrimoines et de l’architecture, et notamment les musées et châteaux-musées. Le mot « musées », alors que la photographie de couverture est celle du Musée d’Orsay, n’est mentionné qu’une seule fois, à la dernière page du programme, avec une grande approximation : « un grand plan « musées » sera lancé : modernisation des bâtiments, muséographie moderne (reconstitution 3D, par exemple) et augmentation des budgets d’acquisition.»
On constate donc un double « oubli ». D’une part, comme nous l’avons vu, le champ patrimonial n’est pas abordé dans son entièreté. D’autre part, des champs historiques du ministère chargé de la Culture sont ignorés. Cette seconde ignorance est assumée : la notion de soutien à la création artistique, pourtant deuxième champ du ministère au regard de son budget, n’est mentionnée qu’une seule fois, pour proposer d’en réduire la dotation au profit de la « sauvegarde du patrimoine ». Ainsi, à propos du 1% culturel – obligation pour les constructions publiques d’inclure 1% du budget à une commande d’artiste – le RN propose de le «partager […][afin qu’il soit] aussi consacré à la sauvegarde du patrimoine existant » avec un objectif de scinder l’actuel 1% artistique à moitié pour le patrimoine, à l’autre pour la création.
Les propriétaires de monuments historiques, grands gagnants du programme
Le programme présidentiel de Marine Le Pen est clair à plusieurs reprises : il soutient les propriétaires privés de monuments historiques : « le patrimoine constitue un des lieux du contrat social : son entretien et son ouverture au public constituent une richesse pour la collectivité (premier moteur du tourisme), tout en étant (dans le cas des monuments privés) le meilleur moyen de s’appauvrir individuellement. » Le lien actuel de l’administration avec les propriétaires privés est critiqué : « il est urgent de retisser les liens entre un État aux politiques incohérentes et souvent arbitraires (éolien et infrastructures collectives, notamment) et les propriétaires par un pacte ». Enfin, le Rassemblement national propose la création « d’un statut de « chef d’entreprise du patrimoine » (terme que nous préférons à « gestionnaire ») et l’assouplissement des contraintes administratives ».
Dans la logique du constat de propriétaires privés appauvris, le programme propose plusieurs mesures d’aides financières. Pour chacune, l’usage du terme de « monuments privés » laisse un flou : les monuments historiques inscrits ou classés sont-ils les seuls concernés ou bien ces aides sont-elles élargies à des monuments privés bénéficiaires selon l’avis de l’administration en place ?
Ainsi est-il proposé « l’élargissement aux monuments privés non ouverts au public de la déduction à 100% (et non plus à 50%) des travaux non subventionnés et les dépenses de gestion ». Dans la même logique d’allègement fiscal, le programme souligne que ces monuments privés ne seraient pas retenus dans le calcul de l’impôt sur la fortune financière (forme d’ISF proposé par le RN). Plus suprêmement, le RN propose de déduire de l’impôt sur revenu les dépenses d’ameublement des monuments privés ouverts au public, « afin de favoriser le marché de l’art ».
Le programme propose aussi la refonte de la comptabilité des jours d’ouverture au public, substituée par un nombre d’heures dans l’année. Or cela reviendrait à élargir le nombre de monuments privés bénéficiant d’avantages fiscaux au motif de leur ouverture au public.
Une approche de la politique culturelle par le résultat économique
Alors que le programme ignore les champs culturels les plus créateurs de richesse et d’emplois (cinéma, spectacle vivant et musique actuelle), il mentionne le souhait d’une « refonte économique » – toujours selon une focale patrimoniale. Ainsi, à propos des entreprises de restauration du patrimoine, des dispositifs seraient « mis en place pour garantir la pérennité de ces savoir-faire et de ces entreprises » et un « Observatoire des métiers d’art » sera institué. Avec la même imprécision, le programme propose de favoriser l’apprentissage. Toutes ces mesures nous interrogent sur la connaissance, par le Rassemblement national, des missions et du travail de l’Institut national pour les savoir-faire français ou encore du label EPV2, qui œuvrent aujourd’hui sur des missions identiques.
Par ailleurs, et au risque de proposer une analyse économique incomplète, il nous semble important de mettre en exergue l’approche inégalitaire de la politique culturelle prônée par le RN. En favorisant financièrement les propriétaires privés par une refonte fiscale, ce programme ne pourra qu’accroître les inégalités de patrimoine, qui sont aujourd’hui « extrêmes », selon le Rapport sur les riches en France, 2024 de l’Observatoire des inégalités. Plus encore, la proposition de financer les diverses mesures et d’indemniser les propriétaires grâce aux fonds du loto du patrimoine ne peut qu’exacerber cette inégalité ; les recettes publiques issues de la Française des Jeux pouvant s’apparenter à un impôt « régressif3 » pesant sur les plus pauvres et les moins diplômés.
Si le volet accordé à cette refonte est court, il souligne néanmoins la vision économique de la culture du RN. A contrario, tout au long du programme, aucune notion d’émancipation ou d’épanouissement par les arts ou la culture n’est mentionné.
Une approche historique douteuse
Le Rassemblement national aborde plusieurs propositions dont la faisabilité semble compromise. Tout d’abord, certaines mesures risquent de se heurter à une impossibilité technique évidente. Par exemple, la proposition de « retrouver le régime antérieur à la loi de 1913 » concernant le double critère des 500 mètres et de la co-visibilité pour la protection des abords de tout monuments historiques semble complexe, nombre de monuments mitoyens à d’autres bâtiments étant déjà inscrits (maisons de village, par exemple). Par ailleurs, le programme propose l’extension du droit de préemption de l’État aux biens mobiliers, grâce aux fonds du loto du patrimoine. Or, en matière de biens culturels, le droit de préemption de l’État s’étend déjà aux biens mobiliers culturels, tel que le dispose l’article R123-2 du Code du patrimoine. Ledit article autorise l’État à préempter des « éléments de décor provenant du démembrement d’immeubles par nature ou par destination » et des « meubles et objets d’art décoratif ». En d’autres termes, l’État dispose déjà du droit de préemption sur les biens mobiliers culturels.
D’autres mesures semblent ignorer l’approche scientifique de l’histoire de l’art, et notamment sur l’évolution continue des monuments. Ainsi, le RN propose à plusieurs reprise de conserver des monuments dans leur état d’origine, notamment par l’attachement à « perpétuelle demeure » : est ainsi proposé « d’encourager les ensembles mobiliers historiques attachés à un immeuble laïc ou religieux : portes, glaces, trumeaux, fenêtres, bas-reliefs, fresques, cheminées, boiseries, bibliothèques, statues, tableaux et mobiliers d’origine bénéficieront ainsi automatiquement de la protection inhérente à l’immeuble, c’est-à-dire qu’ils seront inscrits ou classés et considérés comme attachés « à perpétuelle demeure ». Or, d’une part, il n’est pas aisé d’assurer historiquement ce qui est « d’origine », même en supposant de s’être accordé sur l’état d’origine pris en compte. Le château de Versailles ou l’Elysée, par exemple, ont continuellement été modifiés selon les régimes. Par ailleurs, il est tout aussi difficile d’assurer un suivi exact des ventes et des modifications, lesdits bien mobiliers étant, par nature, mobiles.
Enfin, bon nombre de notions, générales et imprécises, sont citées sans grande explication. Marine Le Pen propose ainsi « la prise en compte des 3 A : architectures, archives, archéologie » avec pour explication que « la recherche sur l’architecture, les archives doit être encouragée pour une transmission du savoir-faire ». Le programme regorge d’imprécisions, utiles à un discours presque consensuel. Il est ainsi proposer de financer l’ensemble des nouvelles mesures par le loto sur le patrimoine, qui serait « exonéré des taxes sur le loto ».
De généralités en imprécisions, le programme Patrimoine du RN se fonde sur un prétendu constat d’une culture française en péril. Dès l’introduction, on y lit que « le patrimoine français est en danger, car nombreux sont les monuments en mauvais état ou menacés d’être défigurés. Cela tient au désengagement de l’État, à la construction d’éoliennes, entre autres, à proximité, à la faillite d’entreprises du secteur, faute de commandes. Même de grands sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, comme la saline royale d’Arcs-et-Senans, l’abbaye de Vézelay, ou encore le Mont-Saint-Michel sont en danger. » Plus loin, la notion de malaise est convoquée : « le malaise du pays se reflète dans son urbanisme anarchique, la destruction du patrimoine et la défiguration des paysages. Une nation qui saccage ainsi son patrimoine sape les fondements mêmes de son histoire et donc de son relèvement et de sa cohésion.»
Le reflet d’une idéologie nationaliste appliquée à la culture
Soulignant le lien entre patrimoine matériel et environnemental, le programme de Marine Le Pen fait part à plusieurs reprises de la bataille contre les éoliennes, qui apparait donc deux fois plus que le mot « musées ». La proposition du Rassemblement national est claire : un « moratoire sur les éoliennes puis [un] démantèlement progressif ».
L’enjeu d’une politique nationale est mis en exergue, tout autant que les échelles locales et les « terroirs ». Le RN propose donc de renommer les Journées Européennes du Patrimoine en Journées nationales du patrimoine. Le champ lexical de l’échelle locale est présent dans l’ensemble du texte, de manière imprécise – et donc consensuel.
Enfin, le programme Patrimoine mentionne l’importance de la « culture française » pour les jeunes, avec la « création d’un service national du patrimoine de 6 mois renouvelable, ouvert aux jeunes de 18 à 24 ans sur la base du volontariat (restauration, protection et valorisation du patrimoine culturel et naturel de la France), en échange d’une indemnité identique à celle du service civique. » Il s’agit d’une annonce politique, les associations de conservation du patrimoine pouvant déjà faire l’objet de l’accueil de jeunes en service civique. Dans sa logique, le Rassemblement national propose que « le patrimoine [soit] appris à l’école, car il est l’incarnation de l’histoire nationale », sans expliquer en quoi les programmes scolaires actuelles n’incluent pas ledit patrimoine…
Réduction de la culture au patrimoine, réformes en faveur des propriétaires privés, oubli des classes moyennes et populaires… à vrai dire, le livret « patrimoine » ne surprendra que ceux qui ont fermé les yeux sur le tournant patronal du RN.
Notes :
1 Savoy, B. (2017). Objets du désir, désir d’objets. Fayard/Collège de France ;
Laffite, M.-P., Gantier, O. (1989). 1789, le patrimoine libéré : 200 trésors entrés à la Bibliothèque nationale de 1789 à 1799. Bibliothèque nationale de France.
2 EPV : le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), créé par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (article 23) distingue les entreprises d’exception, tant artisanales qu’industrielles, dans tous les secteurs dont ceux de la gastronomie ou des parfums qui ne figurent pas dans les métiers d’art auxquels la notion de temporalité de la production, ou de la création est attaché. Il permet aux entreprises labélisées de bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art.
3 Sanchez. “« Taxes sur le rêve » et « impôts régressifs », les jeux d’argent et de hasard, une manne pour l’Etat.” Le Monde.fr, 27 Dec. 2023 ; Berret, Sébastien, and Virve Marionneau. “Les jeux de hasard et d’argent, un impôt régressif ?” Sciences du jeu, no. 13, July 2020.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Issues
- Les Jours
- Le Monde Moderne
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?






