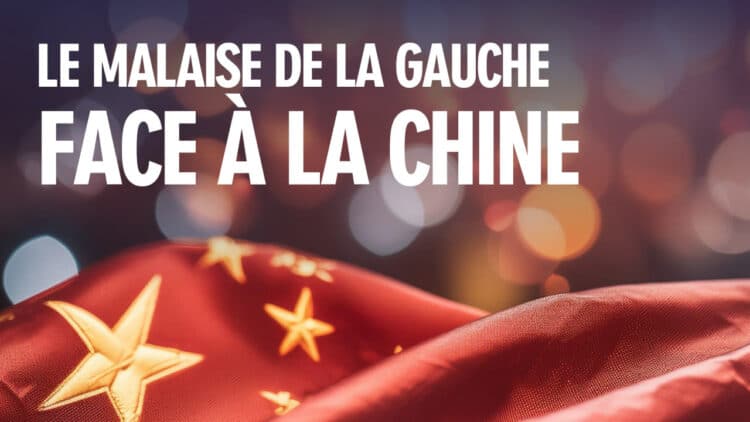Accès libre
22.10.2024 à 23:57
Charlotte Girard et Benjamin Morel – Démocratie en péril : la Ve République en cause ?
la Rédaction
Lire plus (306 mots)
Le Vent Se Lève reçoit Charlotte Girard et Benjamin Morel pour analyser les implications juridiques et politiques des dernières élections législatives. Grand retour des coalitions de parti et de la culture délibérative au Parlement, crise de régime ou alliances politiques d’appareil de circonstance ? La stabilité apparente est-elle la conséquence de la plasticité des institutions de la Ve République ou de leur dévoiement ?
 Charlotte Girard est professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre, engagée de longue date dans la vie politique, autrefois au sein de la France insoumise.
Charlotte Girard est professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre, engagée de longue date dans la vie politique, autrefois au sein de la France insoumise.
 Benjamin Morel est constitutionaliste, maitre de conférence en droit public à l’université Panthéon-Assas. Il vient de publier le livre “Le parlement, temple de la République de 1789 à nos jours” aux éditions Passé Composé. Retrouvez son dernier article pour Le Vent Se Lève: https://lvsl.fr/la-nouvelle-cinquieme… !
Benjamin Morel est constitutionaliste, maitre de conférence en droit public à l’université Panthéon-Assas. Il vient de publier le livre “Le parlement, temple de la République de 1789 à nos jours” aux éditions Passé Composé. Retrouvez son dernier article pour Le Vent Se Lève: https://lvsl.fr/la-nouvelle-cinquieme… !
21.10.2024 à 15:28
Dette publique : comment mettre fin au chantage politique ?
Barbara Goldman
Texte intégral (4523 mots)
Alors que le discours austéritaire revient en force, la gauche est généralement confiante sur la soutenabilité de déficits importants. Si elle n’a pas entièrement tort, une vraie réflexion sur la politique monétaire, l’inflation et le financement de l’Etat s’impose pour sortir du piège de la dette publique créé par les néolibéraux.
4,8 % de déficit en 2022, 5,5 % en 2023, vraisemblablement 6,1 % en 2024 Les finances de l’État sont dans le rouge. Un temps éclipsée par d’autres thèmes, la question de la soutenabilité de la dette de l’État revient au centre du débat politico-médiatique. Le chantage politique qui était en bruit de fond depuis des décennies revient au premier plan. À rebours de ce discours, une autre trajectoire budgétaire peut être suivie par la France.
Le thème de la dette est en effet un classique du discours de la droite austéritaire : en 2007 déjà, alors que la dette était à 65 % du PIB, François Fillon alors chef du gouvernement déclarait « être à la tête d’un État en situation de faillite sur le plan financier ». Le catastrophisme financier n’est donc pas nouveau et a toujours servi un agenda politique austéritaire. Et ce d’autant plus que le resserrement du crédit post-COVID opéré par la Banque Centrale européenne, inédit depuis les années 80, a abouti à une hausse des taux d’intérêts. Alors que la France s’endettait quasi-gratuitement il y a encore quelques années, elle est désormais soumise à des taux d’intérêt de 3 % pour des obligations à 10 ans. La question de la soutenabilité budgétaire est donc sérieuse, même s’il faut faire la part des choses entre la situation réelle et le ressenti biaisé par l’alarmisme tapageur de la droite austéritaire.
Loin de l’hystérisation du débat sur la dette – qui n’est pas nouvelle mais qui atteint de nouveaux niveaux dans de nombreux médias français – l’endettement de la France, quoique problématique, n’est pas catastrophique. L’affolement néolibéral autour de la situation budgétaire indéniablement compliquée de la France indique surtout l’impasse des politiques menées par ce courant idéologique. Au contraire, il est temps d’esquisser d’autres solutions au problème de la dette, en commençant par ne pas en faire une obsession, mais un moyen au service d’un futur économique plus sain et soutenable, moins inégalitaire et brutal.
Une situation tendue mais pas désespérée
Le mode de financement de l’État actuel touche à ses limites. Au sein de la zone euro, seuls l’Italie et la Grèce ont un ratio d’endettement/PIB plus élevé que la France, deux pays dont la situation économique est peu reluisante, en raison (surtout pour la Grèce) d’une mauvaise gestion de leur endettement. Est-ce vraiment un problème ? D’aucuns diraient à gauche, comme certains Économistes Atterrés, que la dette ne représente pas un vrai défi. On pourrait la faire « rouler » à l’infini, au point où ce serait tomber bêtement dans le piège néolibéral que de chercher à trouver une solution à un faux problème qui n’aurait que pour effet de légitimer l’austérité recherchée par certains.
Le contribuable paie presque autant en intérêts que pour éduquer 12 millions de Français. Un gâchis qui n’est pas tenable.
Pourtant, la dette pose de nombreux défis. En effet, les intérêts payés par l’État aux créanciers, pour plus de la moitié non-résidents, sont d’autant de dizaines de milliards pas utilisés pour investir dans la transition écologique, dans l’éducation, ou dans nos hôpitaux. Atteignant désormais plus de 50 milliards d’euros annuels, ces intérêts représentent 2 % du PIB et devraient monter à plus de 70 milliards en 2027 selon le gouvernement. À titre de comparaison, le budget de l’Éducation Nationale s’élève à 64 milliards d’euros. Autrement dit, le contribuable paie presque autant en intérêts que ce qu’il paie pour éduquer 12 millions de Français. Un gâchis qui n’est pas tenable.
Pire encore, comme un tiers de la dette de l’État arrive à échéance d’ici 2027, l’État français va faire rouler sa dette en se ré-endettant à des taux très élevés, faisant de la charge de la dette un problème qui va durer pour les finances françaises. Les obligations françaises, auparavant considérées comme très sûres, se paient désormais au prix fort. Le « spread » (différentiel de taux d’intérêt) avec les taux d’intérêts allemands est passé à 0,8 point. Ainsi, les taux d’intérêts à dix ans sont de 2,2 % pour l’État allemand et de 3 % pour l’État français.
Ce qui est surtout inquiétant, c’est que ce déficit et le niveau élevé de dette qui en découle, n’est pas un « bon déficit » qui financerait l’avenir par des investissements écologiques ou éducatifs. Avoir un déficit structurellement élevé avec si peu de vue à long terme est indéniablement un gros problème. Le nier, comme certains à gauche le font parfois, c’est faire preuve de naïveté, ouvrant la voie aux attaques en incompétence dont la droite est tant coutumière.
Toutefois, la situation n’est pas aussi catastrophique que Le Figaro et Michel Barnier aimeraient nous le faire croire. Tout d’abord, l’indicateur tant commenté du ratio entre dette publique et PIB ne correspond à rien. Comparer un stock (la dette) et un flux (le PIB) est au mieux trompeur, au pire fallacieux. Si vous avez un crédit immobilier, vous êtes probablement endetté à hauteur de plusieurs centaines de % de votre revenu annuel, alors que votre durée de vie est a priori bien plus courte que celle de l’État français. Dire que la dette publique atteint 112 % du PIB français sert donc un agenda politique, celui d’une droite austéritaire, et est un bon exemple de comment on peut faire dire n’importe quoi à des chiffres.
Ce qui est surtout inquiétant, c’est que ce déficit, et le niveau élevé de dette qui en découle, n’est pas un « bon déficit » qui financerait l’avenir par des investissements écologiques ou éducatifs.
Par ailleurs, ce taux (qui ne veut rien dire) n’a rien d’exceptionnel. L’historien économiste Barry Eichengreen et ses co-auteurs ont notamment montré que le Royaume-Uni s’est sorti d’un endettement de 200 % du PIB au début du XIXe siècle, sans défaut de paiement ni austérité excessive. La France était endettée à hauteur de 150 % du PIB dans les années 1920, endettement dont la France s’est sortie en renégociant sa dette, en l’annulant (très) partiellement en 1932 et en dévaluant sa monnaie à plusieurs reprises. On peut d’ailleurs retenir de cet épisode historique que les solutions austéritaires au problème de la dette, tentée entre autres par Paul Doumer, étaient autant impopulaires qu’inefficaces.
Surtout, si la France est endettée, elle est aussi détentrice d’actifs. Ainsi, ce qu’on pourrait qualifier de patrimoine net des administration publiques française est positif, s’élève à plus de 20 % du PIB, en soustrayant aux actifs de l’État son endettement. Ce taux se dégrade depuis 50 ans, au gré de l’augmentation de l’endettement et des privatisations, mais reste relativement modeste en termes de stock.
La dette écologique tout aussi importante que la dette publique
Ensuite, au XXIème siècle, le concept de dette économique doit être mis en balance avec le concept de dette climatique. L’équivalence entre les deux n’est pas évidente, même si le rapport sur la dette climatique publié par l’Institut Avant-Garde en juin 2024 constitue une avancée notable. Toujours est-il que s’alarmer d’une dette à 112 % du PIB quand le retard pris en termes d’engagement écologique est aussi colossal est presque comique. Quel intérêt de limiter la dette si dans 30 ans, le concept même de PIB n’a plus d’intérêt tellement la production économique sera difficile du fait du dérèglement climatique ? À l’heure où la crise écologique se fait chaque jour plus menaçante, s’inquiéter du manque de solvabilité des États membres rappelle la parabole biblique de la paille et de la poutre. La question de la soutenabilité budgétaire est risible par rapport à celle de la soutenabilité climatique : on peut faire rouler une dette financière, on ne peut pas faire rouler une dette climatique ; on peut faire faillite d’un point de vue financier, on ne peut évidemment pas se permettre une faillite écologique, comme le rappelle le socio-économiste Antonin Pottier dans Comment les économistes réchauffent la planète (2016).
Quel intérêt de limiter la dette si dans 30 ans, le concept même de PIB n’a plus d’intérêt tellement la production économique sera difficile du fait du dérèglement climatique ?
La dette peut – et doit – donc être une force pour l’État. Si la droite tente de faire de la dette un moyen de chantage politique, c’est parce qu’elle peut être très puissante. C’est ce que montre notamment l’économiste Stéphanie Kelton dans The myth of deficit. En effet, au-delà des vertus redistributives lorsque la dette est intelligemment gérée, la dette étatique est puissante car l’État est l’agent économique le plus adapté à l’endettement. D’une part, l’État peut, s’il le fait intelligemment, s’endetter dans des proportions très importantes, tout en n’étant pas soumis aux caprices des créanciers. Cela découle notamment de la durée de vie a priori infinie de l’État, de son monopole fiscal, de sa capacité théorique à s’endetter auprès de qui il veut avec des coûts de transaction très faibles, qui lui donnent en fait une marge de manœuvre colossale. Quand le Ministre de l’Économie Antoine Armand nous explique que la situation actuelle est le résultat de « 50 ans de déficits », il faut voir le verre à moitié plein : seul l’État peut se permettre de cumuler de tels déficits. Aucune entreprise, aucun ménage, ne peut s’endetter pour une durée aussi longue sans faire faillite.
Ainsi, et on le dira jamais assez, il faut tirer profit de cette capacité extraordinaire à s’endetter. Jamais le marché ne financera la transition écologique de manière efficace, car le retour sur investissement ne semble pas suffisamment rentable pour des investisseurs privés. Par contre, l’État est l’outil idéal : il peut s’endetter mieux que les entreprises tout en n’étant pas soumis à l’impératif du profit. Loin du « mythe du déficit » déconstruit par Kelton, il faut profiter de la capacité de l’État à s’endetter pour financer des investissements à long terme, en premier lieu la transition écologique. Certes, l’endettement ne doit pas être une fin en soi, mais le moyen pour l’État de mener à bien des politiques ambitieuses qu’il est le seul à pouvoir mener.
La conclusion est donc claire : la France est loin d’être en faillite, et loin de la situation grecque lors de la crise des dettes souveraines, pour des raisons multiples, la principale étant que la France a une économie bien plus compétitive et une capacité à lever l’impôt bien plus fiable, ce qui rend le spectre d’une panique des marchés financiers en fait peu probable en l’état, comme l’admet d’ailleurs l’économiste macroniste Alexandra Roulet en mars 2024 : « La France est loin du chemin de la Grèce ».
La dette pose donc de sérieux problèmes économiques, sans pour autant que la situation soit dramatique, insoluble. En tout état de cause, elle n’implique aucunement de devoir détruire le pays avec une austérité tellement brutale qu’elle rendrait David Cameron et George Osborne (Ministre de l’économie britannique entre 2010 et 2016) envieux.
La catastrophe de l’austérité
La droite propose unanimement l’austérité. Pourtant, elle serait selon toute vraisemblance une catastrophe économique. En vertu du principe de multiplicateur keynésien, la dépense publique est cruciale pour l’activité économique. Une baisse des dépenses publiques amènera à une baisse de l’activité, creusant de ce fait le déficit. En imposant l’austérité à la Grèce, la Troïka a rendu la situation financière de la Grèce encore plus insoluble, comme l’admet Olivier Blanchard, à l’époque économiste en chef du FMI. La Grèce a connu 6 ans de récession, en grande partie à cause de l’austérité. À plus long terme, l’austérité n’a pas de meilleurs effets, puisque les coups de rabot se situent souvent dans des secteurs où l’impact se voit plus tard. Les Britanniques font l’expérience amère d’un service public délabré après des années d’austérité particulièrement violentes, notamment pendant les années Cameron.
Toutefois, tout dépend de comment l’argent est dépensé ou économisé. Mais le gouvernement Barnier pourrait ainsi s’inspirer des propositions de la note du Conseil d’analyse économique de juillet 2024. Les auteurs Auclert, Philippon et Ragot, pourtant pas spécialement de gauche, y proposent de diminuer le Crédit impôt recherche et de réduire les exonérations de charges pour les employeurs, dont l’efficacité économique est au mieux discutable. Barnier n’a pas déclaré suivre toutes ces propositions lors de la présentation de son projet de budget. L’austérité est en soi inquiétante, mais l’austérité centrée sur le social que Barnier concocte va, au-delà du choc social, réduire l’activité économique française de manière nette.
Face à l’unique et catastrophique pseudo-solution que prétend apporter la droite, la gauche doit proposer mieux, tout en ne prenant pas le problème à la légère. La dette est un problème, mais en problème soluble
Comment se libérer de la dette : vers la fin du chantage politique
Il peut paraître tentant de faire défaut sur la dette. Après tout, il y a des précédents, comme le petit défaut aux grandes conséquences de décembre 1932 vis-à-vis des banques américaines ou la « Banqueroute des deux tiers » de 1797. Toutefois, les conséquences économiques seraient colossales et imprévisibles. Le défaut ne peut être qu’une solution de dernier recours qui poserait de nombreuses difficultés. Nous ne sommes pas encore à un niveau d’endettement qui permette d’y songer sérieusement, et ce d’autant plus qu’annuler sa dette ne résout pas la question du financement de l’État sur le long terme. Il faut trouver des solutions pérennes.
On peut alors imaginer deux cas de figure. Le premier est de mener ces changements dans le cadre de la zone euro. Le problème majeur est qu’il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de convaincre certains partenaires, et en particulier l’Allemagne, de réaliser de tels changements structurels de la zone euro. On peut aussi imaginer mener ces politiques en sortant de l’euro, mais cela pose d’autres problèmes, que ce soit en termes de coût de change au sein de l’Europe, de renchérissement de nos importations en cas de probable dévaluation ou plus largement car les mêmes politiques néolibérales pourraient aussi être menées dans le cadre d’un retour au franc.
L’économiste Nicolas Dufrêne a défendu une idée de politique monétaire originale, novatrice, dans son ouvrage La dette au XXIe siècle, comment s’en libérer (2023). L’idée principale est qu’il faut réaliser de la création monétaire sans contrepartie. En principe, c’est synonyme d’inflation, selon la théorie quantitative de la monnaie. Sauf si cet argent est investi directement dans des activités productives, permettant dès lors de financer la croissance et la transition écologique avec une inflation limitée. Une création monétaire sans contrepartie, bien ciblée, peut ainsi permettre de limiter les déficits, donc la dette.
En prolongement de cette idée, on peut imaginer que l’État détienne sa propre dette, en faisant en sorte que la banque centrale achète directement ses titres, ce qui suppose soit une réforme fondamentale de la BCE soit une sortie de l’euro. La différence avec l’idée de Dufrêne est qu’il faut quand même rembourser la dette, ce qui permettrait normalement de ne pas avoir d’effet inflationniste. L’État ne paierait en revanche pas d’intérêts, ou il se les paierait à lui-même, ce qui revient au même. Ainsi, longtemps l’État français s’est-il financé en forçant la Banque de France à ce qu’il puisse s’endetter à taux zéro. Aujourd’hui, l’État fédéral américain détient 20 % de sa dette (et les États fédérés en détiennent eux aussi une partie non négligeable), ce qui limite en partie le coût de l’endettement pour le contribuable américain.
Une variante de cette solution consiste pour l’État à réaliser des « emprunts forcés », dans l’idéal auprès des banques ou de la Caisse des dépôts et des consignations, emprunts rémunérés à un taux d’intérêt que l’État choisirait. Les précédents historiques sont nombreux en France dans les situations de difficultés financières. L’avantage majeur de ces emprunts forcés est qu’ils sont plus acceptables socialement que l’augmentation des impôts, même s’il s’agit surtout d’une solution de court terme. En 1976 par exemple, face à l’hostilité généralisée provoquée par l’annonce de « l’impôt sécheresse », Raymond Barre transforme l’impôt en emprunt forcé rémunéré à un taux d’intérêt inférieur à l’inflation de l’époque.
Ces diverses solutions impliquent nécessairement de revenir sur « l’indépendance » de la Banque Centrale. En 2002, les économistes André Orléan et Michel Aglietta soulignaient dans La Monnaie entre violence et confiance que la soi-disant « indépendance » de la Banque Centrale était un problème. En coupant tout lien entre démocratie et politique monétaire, la confiance des individus en la légitimité économique de l’État est affectée. De plus, la souplesse des politiques économiques est désormais soumise à l’arbitraire du directeur de la Banque Centrale.
La fin de l’indépendance de la Banque centrale permettrait aussi une meilleure coordination des politiques économiques, toute question de dette devant faire intervenir le couple politique budgétaire/politique monétaire. La coordination entre les deux est en effet capitale pour assurer la solvabilité de l’État. Ainsi, des économistes aussi libéraux que Paul Krugman (et même Olivier Blanchard dans une moindre mesure) ont pu déclarer, à propos de la crise des dettes souveraines, que « l’inflation n’est pas le problème mais la solution ». L’idée sous-jacente étant qu’il faut coupler à une politique de relance budgétaire (afin de relancer l’activité) extensive une politique monétaire accommodante permettant de sauvegarder la solvabilité des États, quitte à générer de l’inflation.
Si les salaires sont indexées sur l’inflation, celle-ci ne pénaliserait pas les travailleurs et réaliserait plutôt « l’euthanasie douce des rentiers » chère à John Maynard Keynes.
La fin de l’indépendance des banques centrales permettrait donc de mener une politique budgétaire ambitieuse sans qu’elle fasse exploser la dette. Autrement dit, elle permettrait d’investir dans l’éducation, les services publics et la transition écologique sans mettre en danger la solvabilité de l’État. Une inflation plus grande serait le prix à payer. Si les salaires sont indexées sur celle-ci, comme ce fut le cas jusqu’en 1983, l’inflation ne pénaliserait pas forcément les travailleurs et réaliserait plutôt « l’euthanasie douce des rentiers » chère à John Maynard Keynes, ayant donc des bienfaits redistributifs intéressants. Il faut toutefois veiller à ce que cette inflation reste maîtrisée, car au-dessus de 10 % elle devient difficilement gérable. Autrement dit, la politique budgétaire et sa coordination avec la politique monétaire pourraient aussi réduire les inégalités.
En définitive, si la dette budgétaire pose des problèmes, elle pose surtout des défis : comment veut-on articuler le rapport de force entre État et Capital ? Veut-on continuer à faire de l’inflation un objectif prioritaire au détriment de notre solvabilité budgétaire et de l’investissement à long terme ? Veut-on mettre sur le même plan dette budgétaire et dette climatique ? Plutôt que de s’enfermer dans l’impasse de l’austérité, il faut profiter de l’omniprésence de la question budgétaire pour trouver une réponse sereine, sérieuse, sociale, et écologique à la question du financement de l’État.
20.10.2024 à 18:00
La guerre économique Chine/États-Unis menace-t-elle la mondialisation ?
Baptiste Galais-Marsac
Texte intégral (3380 mots)
« La Chine veut-elle vraiment la guerre ? » s’interroge Arte dans son émission Le Dessous des cartes. Quelques mois plus tard, LCP devait consacrer un DébatDoc d’une heure et demie sur « les deux Chine irréconciliables », Taïwan et la République populaire de Chine (RPC). Dans le débat médiatique, jamais la « menace chinoise » n’aura été si présente. Au-delà des tensions en mer de Chine ou de la question taïwanaise, c’est la rivalité sino-américaine qui alarme les commentateurs. Et sur laquelle butte leur réflexion. La guerre économique entre Washington et Pékin ne clôt-elle pas une ère de « doux commerce », à laquelle tous deux ont contribué ? Benjamin Bürbaumer, économiste et Maître de conférences à l’IEP de Bordeaux, consacre son dernier ouvrage à cet enjeu. Dans Chine/Etats-Unis, le capitalisme contre la mondialisation (La Découverte, 2024), il défend que l’on assiste moins à un reflux de la mondialisation qu’à une intensification de la lutte pour en forger les contours.
Dès l’introduction, l’auteur se place en faux avec les explications couramment invoquées pour comprendre l’expansion chinoise. Aux théories qui naturalisent les rivalités entre États – souvent dérivées d’une « nature humaine » intrinsèquement belliqueuse -, Bürbaumer oppose une analyse fondée sur l’économie politique. Ce faisant, il sort du cadre qui domine encore largement le champ des relations internationales. Il écarte d’emblée l’explication de la rivalité sino-américaine par le « piège de Thucydide », cité ad nauseam, qui fait reposer la confrontation entre une puissance dominante et son concurrent sur une « tendance transhistorique [des États] à se faire la guerre »1.
De même, il refuse d’opposer des chefs d’État, qui seraient responsables de la montée des tensions, au « doux commerce » des firmes multinationales. Pour l’auteur, il est indispensable de « tenir compte de l’interpénétration des intérêts économiques et des stratégies politiques »2, de leur complémentarité, pour comprendre ce qui est à l’œuvre dans cet affrontement, c’est-à-dire le basculement d’une hégémonie à une autre.
Une mondialisation forgée par les intérêts américains
Pour ce faire, Benjamin Bürbaumer dresse un large panorama historique. Il rappelle que Washington ne prêtait pas grande attention à la Chine avant les années 1970, mais que l’intérêt pour ce vaste marché fut attisé par une crise de rentabilité qui a affecté le capital américain au début de la décennie. Pour remédier à la baisse conjoncturelle des profits, une partie du patronat a opté pour une « solution spatiale », selon le terme de David Harvey – autrement dit, l’extension de l’activité économique vers les marchés étrangers où les taux de profits sont plus élevés que sur le territoire national.
Mais pour que la captation de la survaleur hors des frontières soit possible, il était indispensable pour la bourgeoisie américaine d’exercer un certain contrôle sur le système économique mondial. L’impératif de maîtrise des flux commerciaux et financiers, passant par une prépondérance américaine dans les organisations internationales chargées de modeler la mondialisation (FMI, Banque Mondiale, OMC), se doublait d’une volonté de sécuriser les infrastructures stratégiques (routes maritimes, ports, réseaux routiers, télécommunications, etc.).
Face à la suraccumulation des capitaux chinois, il devenait urgent de trouver des débouchés rentables. C’est ainsi que l’on comprend le projet des « Nouvelles routes de la soie ».
Dans cette entreprise, la Maison Blanche joue un rôle de premier plan en adoptant une politique étrangère rigoureusement alignée sur l’agenda des firmes multinationales. Adossé à l’appareil d’État américain, le « capital transnational » s’est alors attelé à la construction d’une mondialisation organisée selon ses intérêts.
Dans ce contexte, la Chine est devenue une cible de premier choix, alors que le pays s’ouvrait à la mondialisation pour stimuler sa croissance. Bürbaumer détaille la manière dont la libéralisation du pays s’est effectuée de manière graduelle et contrôlée, afin de moderniser son industrie sans perdre la main sur la production. Par l’établissement de zones franches, l’assouplissement de la planification ou le sacrifice de la législation sociale chinoise sur l’autel de la compétitivité, les entreprises d’État se sont acclimatées à l’économie de marché. Du pain béni pour le capital américain, qui s’est empressé de faire de la Chine son principal sous-traitant.
Plus que de l’investissement direct à l’étranger, le capital américain se sert de sa position de sa prédominance dans les chaînes globales de valeur pour exercer une emprise sur les firmes chinoises : « Les chaînes globales de valeur sont aussi des chaînes globales de pouvoir. […] Une chaîne de valeur ne peut avoir qu’un seul leader, mais le nombre de fournisseurs potentiels ne connaît pas de limite précise. Des fournisseurs de composants à faible complexité peuvent être trouvés dans plusieurs pays, mais seul le leader détient la propriété intellectuelle et l’accès au marché des consommateurs finaux »3.
Quand la Chine veut redessiner l’ordre mondial
L’essor de l’économie chinoise a donc été assuré par son intégration dans une mondialisation supervisée par les États-Unis dans l’intérêt de ses entreprises. Aussi comprend-on pourquoi la volonté de la Chine de sortir d’une position subordonnée est au cœur de l’affrontement actuel avec les États-Unis. « Si les tensions sino-américaines sont aujourd’hui si vives, c’est parce que la Chine tente de remplacer la mondialisation par une réorganisation fondamentalement sino-centrée du marché mondial »4.
La Chine, cependant, n’allait pas tarder à autonomiser son développement du cadre fixé par les États-Unis. Aussi Bürbaumer détaille-t-il les manoeuvres de la RPC, visant à prendre le contrôle des infrastructures clés de la mondialisation (normes techniques, routes commerciales, innovations technologiques et réseaux numériques) et à internationaliser sa monnaie. Si la croissance chinoise est portée, depuis les années 1990, par des politiques économiques orientées vers l’export, les dirigeants du Parti ont rapidement pris conscience des fragilités inhérentes aux économies extraverties. En d’autres termes, la bonne santé économique du pays reposait presque entièrement sur la stabilité (ou la hausse) de la demande extérieure et sur le libre-accès aux circuits commerciaux.
À ces vulnérabilités s’est ajoutée une tendance à la surproduction et à la suraccumulation de capitaux, pour lesquels il devenait urgent de trouver des débouchés rentables. Le défi pour les autorités chinoises était alors de restreindre leur dépendance au commerce extérieur – et à une mondialisation forgée par les États-Unis. Le projet des Nouvelles routes de la soie (NRS), lancé en 2013, répond à l’objectif de doubler les exportations de marchandises par des exportations de capitaux. Il pose les fondements de la conquête des marchés par l’investissement productif et le crédit – la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, concurrente de la Banque asiatique de développement, est créée à cet effet dès 2014 – tout en participant au remodelage du système économique mondial.
La difficulté des États-Unis à maintenir l’hémisphère sud dans une situation de « servitude volontaire » ne leur laisse d’autre solution qu’un durcissement de leur posture coercitive. Mais le bâton sans la carotte ne mène qu’à la rébellion des dominés – et ouvre une brèche pour la puissance ascendante.
En ouvrant de nouvelles routes maritimes ou terrestres, en construisant des infrastructures de transport (ports, aéroports, gazoducs, oléoducs) dans des dizaines de pays en développement, la RPC s’assure la maîtrise de son commerce extérieur – « contrôler les infrastructures, c’est contrôler les flux »5. La mise au point d’un réseau commercial alternatif permet, entre autres, de contourner les goulets d’étranglement tenus par les compagnies américaines. Dès lors, le corridor Chine-Pakistan et le port de Gwadar deviennent indispensables à l’approvisionnement énergétique de celle-ci en cas de blocage du détroit de Malacca par les États-Unis ; un passage où transite actuellement 80% des importations de pétrole chinoises.
Enrayer le déclin des États-Unis
Les États-Unis prennent conscience de leur déclin, et tentent de le contrecarrer. À ce titre, l’analyse que fait l’auteur de la « bataille des puces » est éclairante6. Il met en lumière l’échec des sanctions imposées à la Chine pour freiner son progrès technologique dans le domaine des semi-conducteurs. Alors que, depuis 2018, Washington prive les Big Tech chinoises de tous les équipements que le pays est incapable de produire (logiciels, machines à haute précision) ainsi que des brevets occidentaux, la Chine poursuit sa course à l’innovation avec des réussites significatives.
Malgré les restrictions imposées par les États-Unis à ses partenaires, Huawei est parvenu à lancer en septembre 2023 un nouveau smartphone, le Mate 60 Pro, fonctionnant grâce à des puces de sept nanomètres, avec un écart technologique de seulement cinq ans par rapport au leader mondial des semi-conducteurs, l’entreprise taïwanaise TSMC.
Il faut mesurer la menace que représente l’essor de la Chine pour la suprématie américaine. Le rapport final de la Commission de Sécurité nationale sur l’Intelligence artificielle, rendu public en 2021, pose un constat alarmant pour les États-Unis : si la Chine devançait son rival américain sur le plan technologique (par exemple en devenant leader de l’intelligence artificielle), elle serait en mesure de remettre sérieusement en cause la suprématie militaire et économique des États-Unis. Face au danger chinois, les Américains choisissent de riposter en renforçant la contrainte tant sur leurs alliés que dans les périphéries de leur sphère d’influence.
Bien sûr, de telles méthodes coercitives peuvent être efficaces sur le court terme, mais cette stratégie conduit à saper la confiance des pays dominés envers leur hégémon. Les sanctions économiques offrent un cas d’école : elles peuvent faire plier les utilisateurs du dollar pendant un temps, mais elles poussent in fine certains États à se tourner vers des moyens de paiement alternatifs, et donc à édifier des infrastructures financières alternatives. Celles-ci entament la suprématie monétaire des États-Unis.
L’exclusion de la Russie du système interbancaire SWIFT dès 2022 a ainsi constitué un « effet d’aubaine pour le renminbi », générant une réorientation des transactions extérieures russes vers l’architecture financière chinoise7. Indirectement, les sanctions américaines ont intensifié l’internationalisation monétaire de leur principal concurrent. Corollaire : le pouvoir d’attraction des États-Unis s’érode à chaque crise nouvelle, tandis que la Chine ne cesse de gagner du terrain dans le cœur des pays du « Sud global ».
Ces trois dernières années, l’hypocrisie de la politique étrangère américaine, en apparence soucieuse de défendre les droits de l’homme dans le monde, a été révélée avec plus de netteté que par le passé. Aux condamnations de l’invasion russe en Ukraine et à la sévérité des sanctions répond un business as usual diplomatique face aux crimes contre l’humanité – d’une ampleur sans précédent au XXIè siècle – commis par Israël à Gaza.
S’appuyant sur une perspective gramscienne, Benjamin Bürbaumer fait remarquer que toute hégémonie repose sur l’articulation entre consentement et coercition. La difficulté des États-Unis à maintenir l’hémisphère sud dans une situation de « servitude volontaire » ne leur laisse d’autre solution qu’un durcissement de leur posture coercitive. Mais le bâton sans la carotte ne mène qu’à la rébellion des dominés et ouvre une brèche pour la puissance ascendante. Ainsi, par contraste avec l’occident libéral dominé par les États-Unis qui conditionne son aide par des plans d’ajustement structurel et autres mesures d’austérité, « la Chine est […] peu à peu apparue comme une option de développement sans douleur, sans crises ni risque de mécontentement populaire dans les pays concernés » par l’aide qu’elle fournit8.
Mondialisation ou impérialisme ?
En retraçant les trajectoires inverses de la Chine et des États-Unis, Bürbaumer décrit au fil des pages, et sans le nommer explicitement, un processus de transition – le passage d’un impérialisme dominant à un autre. Dans la littérature marxiste, l’impérialisme renvoie à un stade du développement capitaliste, marqué par une concentration du capital qui génère de gigantesques monopoles. Ceux-ci ont besoin, pour maintenir ou accroître leurs profits, de prolonger leurs activités économiques et financières en dehors des frontières nationales. Adossés à leur État respectif, les monopoles entrent en lutte ou coopèrent, en fonction de la conjoncture et des circonstances historiques, pour s’approprier les marchés extérieurs et les sources de matières premières.
En évitant de convoquer ce concept pour expliquer les rivalités sino-américaines, alors qu’il lui a entièrement consacré son premier livre, Benjamin Bürbaumer est contraint à des circonlocutions qui obscurcissent le raisonnement plus qu’elles ne l’éclairent9. Ainsi l’ouvrage est-il paru sous le titre pour le moins énigmatique du « capitalisme contre la mondialisation ». En introduction, l’auteur justifie cette formule comme suit : « Le capitalisme mine la mondialisation. Le paradoxe de la montée en puissance de la Chine, c’est qu’en devenant capitaliste, elle s’est trouvée contrainte de saper le processus même qui a permis son essor, à savoir la mondialisation »10. Le recours au terme de mondialisation, opposé de surcroît au capitalisme comme s’il s’agissait de deux réalités indépendantes et antagoniques, brouille la compréhension des phénomènes internationaux.
Ce qu’il exprime est en réalité beaucoup plus simple : le développement capitaliste de la Chine a été permis par son intégration subordonnée au système impérialiste dominé par les Américains. Pour des raisons économiques et politiques qui sont décrites dans le livre, la Chine a su autonomiser sa production et devenir elle-même une jeune puissance impérialiste, maniant les mêmes armes que son rival américain (investissement à l’étranger, crédit, construction d’infrastructures, création d’institutions internationales de portée régionale ou globale, etc.). Elle ne s’érige donc pas contre la mondialisation mais contre une mondialisation, ou plutôt contre un système économique mondial organisé par et pour les États-Unis et qu’elle cherche à supplanter.
C’est là que réside la thèse centrale de l’ouvrage – et à laquelle nous adhérons. Nous comprenons la difficulté de manier la terminologie marxiste dans les travaux académiques, tant celle-ci a perdu sa puissance d’évocation pour le lectorat français depuis la chute de l’URSS et la marginalisation du Parti communiste français. Nous pensons néanmoins qu’il est indispensable de réinvestir ce champ théorique qui conserve, à travers la notion d’impérialisme, un intérêt certain pour la compréhension des réalités géopolitiques contemporaines.
En somme, la réflexion de Benjamin Bürbaumer, bien que parfois embarrassée de formulations détournées, met en lumière un phénomène clé : la montée en puissance de la Chine, loin de s’opposer à la mondialisation, en redessine les contours pour répondre à ses propres intérêts impérialistes.
Notes :
1 Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, Paris, La Découverte, 2024, p. 14
2 Ibid., p. 9
3 Ibid., p. 155
4 Ibid., p. 12
5 Ibid., p. 132
6 Ibid., p. 151
7 Ibid., p. 208
8 Ibid., p. 226
9 Voir Benjamin Bürbaumer, Le souverain et le marché, théories contemporaines de l’impérialisme, Paris, Editions Amsterdam, 2020
10 Benjamin Bürbaumer, Chine/Etats-Unis, p. 9
18.10.2024 à 19:27
Les racines communistes d’Hayao Miyazaki
Owen Hatherley
Texte intégral (3117 mots)
Le Studio Ghibli, connu notamment à travers les œuvres de Hayao Miyazaki, n’est pas le Disney japonais, mais l’anti-Disney. Conçus par des animateurs issus du mouvement communiste japonais, ses films célèbrent le travail créatif et la solidarité humaine contre le capitalisme et la guerre. Par Owen Hatherley [1].
Les racines de l’un des studios d’animation les plus prospères de ces dernières décennies se trouvent chez Toei Doga, le département d’animation de l’une des plus grandes sociétés cinématographiques du Japon. Au milieu des années 1960, les conditions de travail dans le secteur étaient brutales, les équipes d’animateurs produisant des centaines de dessins par jour pour des dessins animés télévisés tels qu’Astro Boy (Astro le petit robot).
Les délais de fabrication étaient courts et la qualité n’avait aucune importance ; au moins un animateur est d’ailleurs mort au travail. Les jeunes animateurs Hayao Miyazaki (1941-) et Isao Takahata (1935-2018) comptaient parmi les délégués syndicaux les plus en vue du studio Toei. Il existe une photographie montrant le jeune Miyazaki, mégaphone à la main, à la tête d’une grève. Vingt ans plus tard, Miyazaki et Takahata fonderont ensemble leur propre studio, le Studio Ghibli.
Ghibli devait être tout ce que les studios existants n’étaient pas, même s’il restait dédié à l’élaboration de divertissements populaires. Ses animations fluides et riches décrivent ouvertement les dangers de la destruction de l’environnement, de la guerre et du capitalisme, mais flottent en quelque sorte – comme son héros, le « cochon rouge » Porco Rosso – sous le radar politique.
Ghibli devait être tout ce que les studios existants n’étaient pas, même s’il restait dédié à l’élaboration de divertissements populaires. Ses animations décrivent les dangers de la destruction de l’environnement, de la guerre et du capitalisme.
Miyazaki ne pouvait s’empêcher de déclarer : « Je dois dire que je déteste les œuvres de Disney », alors même que Ghibli signait en 1996 un accord de distribution à l’étranger avec le conglomérat multinational. Les films de Ghibli ne sont jamais propagandistes, mais, dans leur décontraction, ils ont donné naissance à une forme très particulière d’écosocialisme. Miyazaki et Takahata font partie des quelques cinéastes marxistes que le militant socialiste William Morris (1834-1896) aurait reconnu comme des âmes sœurs.
En même temps, l’orientation politique de Ghibli n’a jamais été un secret. En 1995, le réalisateur de Patlabor et de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, (1951) issu de la nouvelle gauche libertaire, a qualifié Takahata de « stalinien », Miyazaki de « quelque peu trotskiste » et le studio Ghibli de « Kremlin ». Le studio Toei, comme beaucoup de studios dans les années 60, était en grande partie contrôlé par le Parti Communiste Japonais, et bien que Miyazaki ait déclaré n’avoir jamais été un membre cotisant, il ne fait aucun doute que Takahata et lui étaient des compagnons de route.
On trouve quelques références malicieuses à ce sujet dans leurs films. L’as de l’aviation de Porco Rosso (1992), par exemple, refuse de s’engager dans l’armée de l’air sous Benito Mussolini – déclarant « mieux vaut être un cochon qu’un fasciste » – et dans une scène, son amante Gina chante l’hymne de la Commune de Paris « Le Temps des Cerises ». Mais la vision politique de Ghibli se manifeste surtout dans ses œuvres qui traitent de la campagne, au Japon et ailleurs, qui apparaît à la fois comme un rêve et un cauchemar.
Ghibli est basée à Tokyo, la plus grande métropole du monde, et c’est peut-être l’absence d’une « campagne » proche qui en fait un tel centre d’intérêt pour le travail du studio. Dans Mon voisin Totoro (1988), les créatures d’une forêt fantasmée et transfigurée aident à consoler deux enfants de la ville dont la mère est soignée pour une maladie chronique.
Mais l’un des mondes oniriques les plus politiquement révélateurs de Ghibli apparaît dans le précédent Le château dans le ciel (1986), dans lequel un garçon d’un village minier se retrouve à explorer la citadelle flottante détruite d’une société de haute technologie devenue obsolète que se disputent des aristocrates malveillants. Les paysages du film sont directement inspirés de la visite de Miyazaki et Takahata dans le sud du Pays de Galles en 1985.
Ayant l’intention de réaliser un film sur la révolution industrielle, ils se sont embarqués pour un voyage de recherche dans les Vallées (South Wales Valleys), une région aux étranges paysages ruraux et industriels où les maisons en terrasse sont entrecoupées de montagnes, de mines et d’usines sidérurgiques. Pour quiconque connaît les Valleys, le film est plutôt inquiétant, mais le sud du Pays de Galles n’a pas été qu’une simple source d’inspiration visuelle. Le hasard a voulu qu’ils s’y trouvent au lendemain de la grève des mineurs de 1984-85. L’année suivante, Miyazaki a exprimé son admiration pour le « véritable sens de la solidarité » qu’il a trouvé dans les villages miniers, et le film en est clairement inspiré.
Comme leur film précédent, la fable écologique post-apocalyptique Nausicaä de la vallée du vent (1984), Le Château dans le ciel est l’affirmation d’une vision particulière de la nature et d’une vision particulière du travail. Ghibli, malgré le grotesque de certains de ses films, n’a jamais cherché à être branché ou odieux. Parlant en 1982 de son rejet de la vague de bandes dessinées nihilistes gekiga d’après 1968, Miyazaki a expliqué qu’il avait décidé qu’il était « préférable d’exprimer de manière honnête que ce qui est bon est bon, que ce qui est joli est joli et que ce qui est beau est beau ». Le travail manuel est l’une des choses que Miyazaki et Takahata présentent constamment comme belles.
Des fonderies du Château dans le ciel aux ouvrières qui assemblent des avions dans Porco Rosso, les films Ghibli regorgent d’images de personnes en train de fabriquer des objets. Les films peuvent facilement être caricaturés comme étant anti-technologiques, étant donné la quantité de destruction écologique qu’ils dépeignent, en particulier avec les films plus récents comme Ponyo sur la falaise (2008) qui traitent explicitement du changement climatique.
Mais le Studio Ghibli adhère davantage à une distinction inspirée par le socialiste William Morris entre « travail utile » et « labeur inutile », ce dernier étant illustré de manière particulièrement mémorable dans le travail sans fin, digne du purgatoire et organisé de manière despotique du film Le voyage de Chihiro (2001). En 1979, Miyazaki a critiqué les séries de robots mecha pour lesquelles le Japon commençait à être connu à l’étranger, en raison de l’approche inévitablement juvénile et aliénée de la technologie dans ce genre. Il préférait que « le protagoniste se batte pour construire sa propre machine, qu’il la répare lorsqu’elle tombe en panne et qu’il doive la faire fonctionner lui-même ».
Les films peuvent facilement être caricaturés comme étant anti-technologiques, étant donné la quantité de destruction écologique qu’ils dépeignent. Mais le Studio Ghibli adhère davantage à une distinction inspirée par William Morris entre « travail utile » et « labeur inutile ».
« La faire fonctionner lui-même ». C’est exactement ce que font les gens dans les films de Ghibli, s’exprimant à travers le travail qu’ils font avec leurs mains. Les films de Miyazaki peuvent témoigner à la fois d’une admiration pour les réalisations du travail humain et d’une horreur pour leurs conséquences, comme dans Le vent se lève (2013), un film d’époque situé dans les années 1930 qui dépeint avec amour le développement et la construction de l’avion Mitsubishi A6M et montre comment il a été utilisé par l’impérialisme japonais.
Takahata est resté marxiste jusqu’à sa mort en 2018, tandis que Miyazaki a perdu la foi dans les années 1990 alors qu’il achevait la version manga de Nausicaä de la vallée du vent. Selon les termes de Miyazaki, il a « fait l’expérience de ce que certains pourraient considérer comme une capitulation politique », c’est-à-dire qu’il a décidé « que le marxisme était une erreur ». Il souligne que cela n’a rien à voir avec des événements politiques ou personnels, mais qu’il s’agit plutôt d’un rejet philosophique du romantisme ouvriériste – « les masses sont capables de faire un nombre infini de choses stupides », a-t-il déclaré – et d’un rejet du « matérialisme marxiste » et de la philosophie du progrès matériel.
Miyazaki lui-même a résumé son parcours politique en disant qu’il était « redevenu un vrai simple d’esprit ». Le fait d’être copropriétaire d’une entreprise à succès soutenue par Disney n’y est peut-être pas étranger. Bien que les conditions de travail chez Ghibli soient réputées bien meilleures que dans la plupart des studios d’animation japonais, il s’agit toujours d’une entreprise capitaliste, qui gagne des millions grâce aux produits dérivés.
Néanmoins, Miyazaki et le Studio Ghibli ont conservé un dégoût pour la guerre – il n’y a peut-être pas de plus grand film anti-guerre que Le tombeau des lucioles (1988) de Takahata – et pour l’impérialisme. La représentation des fascismes japonais et allemand dans Le vent se lève (2013) a suscité la colère des nationalistes japonais, tandis que le féroce Le château ambulant (2004), le dernier véritable chef-d’œuvre de Miyazaki, a canalisé la « rage » du réalisateur face à la guerre en Irak, durant laquelle il a refusé de se rendre aux États-Unis. Le château de ce film, une machine organique, changeante et réactive, est l’une des images les plus puissantes de Miyazaki d’une technologie non aliénée. De même, Miyazaki ne s’est jamais, au moins sur le plan philosophique, réconcilié avec le capitalisme : Le voyage de Chihiro regorge d’images horribles de l’exploitation industrielle et de la domination des classes sous l’apparence d’une fantaisie enfantine.
Bien que les conditions de travail chez Ghibli soient réputées bien meilleures que dans la plupart des studios d’animation japonais, il s’agit toujours d’une entreprise capitaliste, qui gagne des millions grâce aux produits dérivés.
Les subtilités de la vision de Ghibli sur le développement peuvent être mieux perçues dans certains de ses films les plus calmes. Deux films des années 1990 se déroulent dans la ville nouvelle de Tama, un projet de développement piloté par l’État qui a rasé d’immenses pans de campagne à l’extérieur de Tokyo dans les années 1970 : Pompoko et Si tu tends l’oreille. Pompoko, sorti en 1994, est une écocritique à la manière de ce que l’on peut attendre de Ghibli, dans laquelle les tanuki, les chiens viverrins considérés dans le folklore japonais comme ayant une double vie, à la fois animaux ordinaires et dotés de pouvoirs magiques comme la métamorphose, complotent pour empêcher la construction de la ville nouvelle.
Il s’agit d’une merveilleuse farce et d’une description plus optimiste des révolutionnaires non humains que tout ce qu’a pu écrire George Orwell. Mais Tama, une fois sortie de terre, est le cadre de la romance adolescente apparemment ordinaire de Si tu tends l’oreille, sorti en 1995. Une jeune fille qui vit dans une cité danchi – les logements sociaux construits en grand nombre à Tama – a le béguin pour un garçon qui vit en amont, dans un quartier plus ancien et plus aisé de la ville.
L’antagonisme des classes et l’attirance entre les deux, assistés par un chat fantôme anthropomorphique, sont décrits sans amertume, et le paysage urbain est dessiné avec amour et précision : une image de la modernité japonaise elle-même comme quelque chose de doux et d’humain. Cela reflète peut-être le rejet par Miyazaki de la lutte des classes, mais cela fait également partie de sa réaction au nihilisme sous toutes ses formes. Ici aussi, dans le paysage moderne, ce qui est beau est beau.
Le film le plus dialectique du studio Ghibli, et le plus subtilement marxien, est Souvenirs goutte à goutte (1991) d’Isao Takahata. Dans ce film, Taeko, une femme approchant la trentaine et insatisfaite de sa vie à Tokyo, se rend dans un village pour aider à la récolte. Un jeune ouvrier agricole la conduit à travers le paysage, avec ses rivières, ses champs, ses marais et ses forêts, tous animés avec amour dans des détails luxuriants et méticuleux. Elle le contemple avec émerveillement, exprimant son admiration pour la « nature ». Un film de Disney en resterait là, mais pas Ghibli. Le fermier, souriant mais quelque peu méprisant, insiste sur le fait que tout ce qu’elle peut voir est le résultat du travail humain.
Semblant paraphraser The Country and the City du marxiste gallois Raymond Williams (1912-1988), il lui dit que « les citadins voient les arbres et les rivières et sont reconnaissants à la « nature » ». Mais « chaque parcelle a son histoire, pas seulement les champs et les rizières. L’arrière-arrière-grand-père de quelqu’un l’a planté ou défriché ». À la fin du film, Taeko décide de rester dans le village, précisément parce que son expérience a été celle d’un travail au sein d’une communauté plutôt que celle d’une spectatrice et d’une contemplatrice.
Les mondes imaginaires du Studio Ghibli sont des paysages de production et des espaces de solidarité, et voici, dans son film le plus réaliste, une petite image d’une véritable utopie.
Note :
[1] Article initialement publié par notre partenaire Jacobin.
16.10.2024 à 21:34
Les algorithmes de la CAF pour contrôler les usagers
la Rédaction
Texte intégral (8907 mots)
Le 16 octobre 2024, quinze associations saisissent le Conseil d’État contre la CAF, pour demander le retrait de l’algorithme qui cible les plus précaires. Depuis près de quinze ans, la CAF emploie un algorithme pour contrôler ses allocataires. Croisant les données des administrations, il assigne à chaque allocataire un score de risque de « fraude ». Plus le score de risque est élevé, plus il est probable que la personne soit contrôlée. Des associations comme Changer de Cap et la Quadrature du Net ont documenté la manière dont ces pratiques pénalisent les plus précaires. Elles dénoncent des suspensions automatiques des droits, des contrôles à répétition, le manque de transparence autour de décisions prises et le manque de voies de recours. De quelle politique sociale cet algorithme est-il le nom ? Entre réduction des dépenses, criminalisation de la pauvreté et contrôle de la fraude, il met en lumière la face autoritaire et austéritaire du système contemporain de protection sociale.
Nous publions ici le compte-rendu d’une rencontre organisée en avril dernier par le Mouton Numérique avec Bernadette Nantois, fondatrice de l’association APICED, qui œuvre pour l’accès aux droits des travailleurs immigrés ; Vincent Dubois, professeur de sociologie et de science politique à Sciences Po Strasbourg et auteur de Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre (Raisons d’Agir, 2021) et les membres de La Quadrature du Net, association de défense des libertés en ligne. Transcrit par Dany Meyniel et édité par MBB.
Mouton Numérique – Depuis les années 1990, la branche « famille » de la Sécurité sociale a mis en place une politique de contrôle. En 2022, le collectif Stop Contrôles et Changer de Cap ont commencé à alerter sur la mise en place d’algorithmes de contrôle à la CNAF et sur leurs impacts : suspensions préventives des allocations, manque de justification de ces décisions, impossibilité de faire recours… Derrière ces pratiques, un algorithme de notation des personnes allocataires. Comment fonctionne-t-il ? A quoi est-il destiné ?
Noémie Levain (La Quadrature du Net) – À la Quadrature, on a commencé à travailler sur le sujet des algorithmes de contrôle à la CAF en rencontrant le collectif « Stop Contrôles ». On est une association qui se bat pour les libertés numériques et principalement contre la surveillance : d’abord la surveillance privée des GAFAM, la surveillance d’État et le renseignement, enfin la surveillance dans l’espace public et les outils de surveillance policiers installés dans les villes de France. La question de la dématérialisation et des algorithmes publics est arrivée par un cas de dématérialisation chez Pôle emploi où un demandeur d’emploi s’était fait radier parce qu’il faisait des demandes d’emploi en format papier plutôt qu’en ligne. On a fait un article dessus, ce qui nous a amené à rencontrer le collectif « Stop Contrôles » qui regroupe des syndicats et des associations et à lire le livre de Vincent Dubois sur l’histoire du contrôle à la CAF.
On sait que grâce à la dématérialisation des dix dernières années, la CAF dispose de profils très fins des allocataires. Elle dispose des données collectées par les services sociaux, partagées et interconnectées avec d’autres nombreux services. La volonté politique affichée au moment de développement de l’algorithme était de lutter contre la fraude à la CAF, en définissant un profil-type de « fraudeur » social et en le comparant à chaque allocataire. Ce profil type est constitué de plusieurs variables, qui correspondent à des caractéristiques, qui permettent d’établir pour chaque personne allocataire un score de risque qui va de zéro à un.
Plus la personne est proche du profil type, plus le score de risque est élevé ; et plus le score est élevé plus cette personne a une probabilité de subir un contrôle. Parmi ces critères, figurent par exemple le fait d’être un parent seul ou d’être né en dehors de l’UE. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les critères de l’algorithme, on a fait des demandes d’accès à des documents administratifs auprès de la CNAF. [Voir le détail du fonctionnement de l’algorithme et la liste des critères pris en compte dans l’enquête de la Quadrature, n.d.r.].
Alex (LQDN) – Au tout début, autour de 2010, l’algorithme a été créé pour lutter contre la fraude mais il ne marchait pas trop bien : la fraude implique un élément intentionnel et c’est donc très compliqué, malgré toutes les données, de qualifier un élément intentionnel à partir de données socio-démographiques, professionnelles ou familiales. Par contre, l’algorithme détecte très bien les indus, les trop-perçus liés aux erreurs de déclaration des allocataires. La CAF a donc ré-entrainé son algorithme pour viser le trop-perçu. Et ça, ça a bien marché.
Sauf que dans leur discours, la CAF a continué de parler de son algorithme comme un algorithme de lutte contre la fraude. Ils ont même été interviewés à l’Assemblée Nationale, par la Délégation Nationale de lutte contre la fraude, une sorte de pseudo institution créée par Sarkozy pour chapeauter la lutte contre la fraude en France et qui œuvre au transfert de « bonnes pratiques » entre administrations. Ils mettaient toujours la CAF en avant et la CAF, à ce moment-là, parlait de son algorithme comme un algorithme contre la fraude alors même qu’elle savait que c’était la lutte contre les trop-perçus. Pendant dix ans elle a joué un jeu un peu flou et aujourd’hui où on lui dit : « vous notez les gens selon leur potentialité d’être fraudeur(se)s », elle se rend compte que ce n’est pas bon et fait un rétropédalage et dit : « non, nous on a un truc qui détecte les erreurs ».
En creusant le sujet de la CAF on s’est rendu compte que ce type de pratiques sont présentes à l’Assurance Maladie et à l’Assurance Vieillesse. En ce qui concerne Pôle emploi, ils ont des projets pour organiser les contrôles des chômeurs et chômeuses par du profilage. Les impôts font la même chose. C’est le même principe que la surveillance automatisée dans l’espace public que nous constatons dans Technopolice : on va confier à un algorithme la tâche de repérer un profil type avec des critères et des paramètres préétablis, qui vont être la source d’une interpellation ou d’une action policière. Chaque institution a son profil type de profils à risque : dans la rue on a des profils type de comportements suspects ; la DGSI flague les suspects en surveillant l’intégralité des flux internet ; la Sécurité Sociale a ses fraudeurs. On assiste à une multiplication des scores de risques dans les administrations dans l’opacité la plus totale. Mais elle a des implications très concrètes et très violentes pour les usagèr.es.
M.N. – Comment ces techniques de data mining ont-elles été développées dans l’action sociale ?
Vincent Dubois – En ce qui concerne la constitution des modèles et leurs données, la CNAF diligente périodiquement des enquêtes grandeur nature avec des échantillons extrêmement importants. Au début du datamining, c’était cinq mille dossiers d’allocataires sélectionnés de façon aléatoire qui ont fait l’objet de contrôle sur place, d’enquêtes très approfondies. L’idée était donc d’identifier, sur ce grand nombre de dossiers, les dossiers frauduleux.
À partir du moment où on a identifié les dossiers frauduleux et des dossiers avec des erreurs et des possibilités d’indus, on s’est intéressé aux caractéristiques qui spécifiaient ces dossiers par rapport aux autres. C’est là qu’intervient la technique de datamining qui est une technique de statistique prédictive qui modélise, calcule les corrélations entre les caractéristiques propres à ces dossiers « à problème » de façon à construire des modèles qui ensuite vont être appliqués à l’ensembles des dossiers. Une fois ces modèles réalisés, l’ensemble des dossiers des allocataires sont chaque mois passés de façon automatisée sous les fourches caudines de ce traitement statistique et là effectivement on détermine ce que l’institution appelle un « score de risque ».
Les Caisses locales reçoivent les listings avec les scores de risque et décident de lancer des contrôles sur pièces, sur place et les dossiers les plus fortement scorés font systématiquement l’objet de contrôles et ensuite on descend dans la liste en fonction du nombre de dossiers concernés et rapportés aux moyens humains déployés. Donc si on veut être précis, ce n’est pas en tant que tel un outil de contrôle, c’est un outil de détection des risques de survenance d’une erreur qui sert au déclenchement d’un contrôle.
M.N. – Si l’algorithme a été généralisé autour des années 2010, il s’inscrit dans un politique de contrôle de longue date, laquelle est-elle ?
Vincent Dubois – La longue histoire politique du contrôle commence autour de 1995, quand Alain Juppé commandite le premier rapport parlementaire et lance le premier plan de ce qui va devenir le plan de lutte contre la fraude. C’était tout de suite après l’élection de Chirac, dont la campagne avait été consacrée à la fameuse fracture sociale, plus ou moins oubliée par la suite, et à des réductions d’impôts qui n’ont pas eu lieu. Il y a alors une ambition très politique, c’est assez explicitement pour donner le change que Juppé met en avant la « bonne dépense » de l’argent public plutôt que de chiffrer le montant de la fraude dont on n’a à l’époque aucune idée.
La Cour des comptes, l’ensemble des organismes soutenaient d’ailleurs que c’était impossible à chiffrer. La politique ne sera donc pas fondée sur une évaluation a priori ni de l’importance de la fraude ni de l’augmentation de la fraude. C’est très politique, même si le sens peu changer dans le temps. Ce qu’il se passe autour de 2007, c’est que la dimension morale intervient. On ne fait pas seulement rogner sur la protection sociale : autour de 2007, le grand projet de société proposé par Sarkozy – je personnalise mais Sarkozy n’est pas le seul – c’est le travail, la valeur travail. Tous les sociologues savent que pour qu’une norme existe il faut aussi identifier son contraire. Le contraire de la valeur travail c’est l’assistanat, et le comble de l’assistanat c’est l’abus des prestations sociales. Mon hypothèse est que si à l’époque de Sarkozy on a autant mis l’accent là-dessus, c’est que c’était un moyen de, par contraste, de promouvoir ce qui était au cœur du projet de société sarkozyste.
À la Caisse Nationale des Allocations Familiales, il y a trois formes essentielles de contrôle.Je vais les détailler pour permettre de comprendre la place qu’occupe effectivement le datamining. La première, c’est le contrôle automatisé par échange de données entre administrations. Lorsque les allocataires déclarent leurs ressources à la CAF, on les croise avec celles déclarées à l’administration fiscale ; si ça ne correspond pas, cela débouche sur une suspicion de fausse déclaration ou d’erreur de déclaration. La pratique s’est développée grâce à l’autorisation de l’usage du NIR[Numéro d’Inscription au Répertoire, n.d.r.], le numéro de sécurité sociale.
Pour la petite histoire, la licitation de l’usage du NIR pour ce genre de pratiques, auparavant interdites, est le produit dans les années 90 d’un amendement déposé par un député, ancien maire ex-communiste de Montreuil, qui l’avait déposé pour la lutte contre la fraude fiscale1. Depuis 1995-1996, les échanges de données se sont démultipliés par petites touches successives, de convention bilatérale en convention bilatérale entre la CNAF et les Impôts, la CNAF et Pôle emploi, la CNAF et les rectorats pour l’inscription des enfants dans les établissements scolaires, les autres caisses nationales de sécurité sociale, etc. Cette complexité est bien faite pour empêcher toute visibilité publique du développement de ces échanges.
Celles et ceux qui s’intéressent à ce sujet connaissent l’historique classique de la loi informatique et libertés et le fichier Safari, un grand projet de concentration des données personnelles détenues par les administrations de l’État. Au milieu des années 1970, il a induit un grand débat donnant lieu à la Loi Informatique et Libertés et la création de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) pour encadrer, réguler et vérifier les usages du numérique dans les administrations. Avec le croisement de données grâce au NIR il n’y a pas eu de débat, parce que ce sont des mesures techniques qui ont eu lieu institution par institution. Résultat : une prolifération de techniques et un volume de données personnelles détenues par les administrations sans commune mesure avec le projet Safari.
Le deuxième volet du contrôle, avec son outil le plus classique, c’est ce qu’on appelle le contrôle sur pièces : l’appel de documents complémentaires ou de justificatifs lancé par les techniciens conseil dans les CAF qui demandent de leur envoyer une fiche de paye, un certificat de scolarité ou autres. Le troisième outil est le contrôle sur place. Des contrôleurs assermentés et mandatés pour aller vérifier sur place les situations des personnes avec toute une série de techniques qui se pensent comme quasi policières avec d’ailleurs des prérogatives qui sont plus importantes que celle d’un officier de police judiciaire qui n’agit que sur commission rogatoire et qui ne peut pas rentrer dans le domicile des personnes alors que les contrôleurs de la CAF le peuvent. Ça prend souvent la forme d’une enquête de voisinage, une visite au domicile avec un interrogatoire qui a changé un petit peu de forme et puis de statuts durant ces dernières années entre autres sous l’effet du datamining.
Ces trois outils sont inégalement appliqués en fonction des caractéristiques sociales des allocataires. Schématiquement, une personne allocataire ou une famille qui ne perçoit que les allocations familiales et/ou un peu d’allocation logement, qui a un foyer stable, un emploi stable etc., n’est contrôlée que de façon distante et invisible, par des échanges de données informatisées. Les appels sur pièces sont un peu plus ciblés sur des cas un peu plus difficiles et les contrôles sur place, les plus intrusifs sont quasiment exclusivement réservés aux dossiers les plus complexes, qui sont en fait les dossiers des allocataires aux situations les plus précaires. Il y a une différenciation sociale dans la manière d’être contrôlé et dans l’exposition aux sanctions.
M.N. – En quoi consiste cette différenciation sociale du contrôle et de l’exposition aux sanctions ? Et en fonction de quelles catégories socio-démographiques ou prestations le contrôle à la CNAF va-t-il varier ?
Vincent Dubois – En règle générale, on peut dire que datamining intensifie la différenciation sociale du contrôle déjà à l’œuvre avec les techniques antérieures. La politique de contrôle de la CNAF a été formalisée au milieu des années 90, de manière de plus en plus rationalisée avec des objectifs contractuellement définis dans les Conventions d’Objectifs et de Gestion (les COG, qui lient contractuellement les branches de la Sécu et l’État2) avec une batterie d’indicateurs : indicateurs de performance, de réalisation, d’intéressement, indicateurs de risque, indice de risque résiduel, etc.
C’est là qu’a été établi un plan annuel de contrôles avec des objectifs chiffrés : « objectif fraude », « objectif fraude arrangée », etc. Le déclenchement des contrôles sur pièces et sur place reposait précisément sur ces cibles. Avant cette politique, les cadres de la CNAF proposaient des cibles de contrôle sur la base des résultats des politiques antérieures. Tout ça a disparu au profit du datamining qui est une déduction ex-post des types de dossiers susceptibles d’erreurs et donc objets de contrôle. C’est important, parce que ça permet à l’institution de se dédouaner complètement de ses choix. Ça lui permet de soutenir que personne ne décide de surcontrôler les bénéficiaires du RSA, que c’est juste le calcul algorithmique qui établit que le niveau de risque est plus important pour les bénéficiaires du RSA. « C’est la machine qui le dit. »
La technique de data mining a, de fait, un effet discriminatoire et conduit à surcontrôler les plus précaires. Plus les situations sont précaires, plus les personnes qui les vivent sont éligibles à des prestations dont les critères sont extrêmement complexes et nombreux. Pour le RSA par exemple, il y a énormément de critères pris en compte et une déclaration trimestrielle à remplir. De façon mécanique, plus il y a de critères et plus il y a d’échéances, plus il y a de risques d’erreur, de non-déclarations intentionnelles ou non, de retards dans la déclaration…
Ce qui ne veut pas du tout dire que les bénéficiaires du RSA trichent davantage que les bénéficiaires de l’allocation logement, mais que la structure même de la prestation qu’ils reçoivent les conduisent à être surcontrôlés. Ajoutez que les personnes dans des situations de précarité sont définies précisément par l’instabilité de leurs revenus, de leurs statuts d’emploi, parfois de leurs situations familiales et de leurs logements… Elle sont sujettes à davantage de changements et il y aura forcément davantage de risques d’erreurs qui justifient techniquement le surcontrôle.
Il est possible de prouver tout ça statistiquement, avec les données mises à disposition par la CNAF et les CAF, qui sont en fait des institutions assez ouvertes, du moins pour des éléments statistiques. J’ai pu avoir et mettre ensemble des données sur les types de contrôle rapportées aux caractéristiques des allocataires et constater de façon extrêmement claire que les chances de statistiques d’exposition au contrôle croissent linéairement avec le niveau de précarité. Autrement dit, plus on est précaire plus on est contrôlé.
M.N. – Comment interpréter le type de politique sociale qui se dégage de ces pratiques de contrôle ? Est-elle guidée par une volonté de contrôle ? Ou bien, plus classiquement, par une ambition de réduction des dépenses ?
Noémie Levain (LQDN) – Le livre de Vincent illustre comment les enjeux de fraude ont été créés dans les années 90. C’est aussi le moment où s’installe l’idée que les personnes précaires qui demandent des aides sont redevables à l’égard de la société – comme avec le RSA, où ils et elles sont redevables de quinze ou vingt heures de travail. Demander des aides a une contrepartie : on va te surveiller, tu es sur le fil constamment, tu n’as pas le droit à l’erreur avec la vieille rengaine du « Si tu n’as rien à cacher, ce n’est pas grave ». Surveiller les demandeurs et demandeuses d’aide est en fait très grave et lié à une forme de criminalisation de la pauvreté.
Bernadette Nantois – Outre cette dimension de surveillance, il y a clairement une logique néo-libérale de réduction des dépenses publiques. Elle n’est pas assumée et opère de fait, par la complexité du système. C’est le cas dans les différentes branches de la Sécurité sociale : je pense qu’il y a une véritable volonté de réduire les dépenses sociales par l’introduction d’obstacles de l’accès aux droits.
Peu importe l’intention précise des dirigeants CNAF : le non-recours est budgété chaque année dans les budgets de l’État. Ce que les organismes sociaux appellent le « non-recours » c’est le fait que des gens qui auraient droit à des prestations ne les réclament pas. Or, une partie du budget est prévue comme étant non-dépensée ; c’est inclus et calculé. Cela signifie que l’on affiche la lutte contre le non-recours alors qu’on l’organise dans la pratique. Ça n’élimine pas cette dimension de surveillance mais qu’il y a aussi une logique purement politique froide, économique, claire qui consiste à dire que « les pauvres ont un coût et ils coûtent trop cher » même si en réalité ils coûtent beaucoup moins que d’autres dépenses. Mais ça, c’est un autre sujet…
Vincent Dubois – Quelques chiffres pour avoir un ordre de grandeur au sujet de la fraude et du non-recours. Le montant de la fraude détectée dans la branche famille et sécurité sociale se situe entre 300 et 320 millions d’euros par an3 [le montant s’élevait à 351 millions d’euros pour l’année 2022, n.d.r.]. L’évaluation qui est faite du non-recours au seul RSA dépasse les 3 milliards. Dans tous les cas, le montant de fraude évaluée reste inférieur au montant du non-recours évalué pour le seul RSA. On pourrait ajouter à cela de nombreuses comparaisons avec les montants et les proportions en matière de travail non déclaré, le défaut de cotisation patronale, sans parler de l’évasion fiscale, pour laquelle on est dans des ordres de grandeur qui n’ont rien à voir. C’est ce qu’en tout cas disent des institutions aussi furieusement libertaires et gauchistes que la Cour des Comptes !
En ce qui concerne les objectifs politiques de la CNAF, je ne suis pas à l’aise à l’idée de donner un grand objectif à ces politiques parce que c’est en fait – c’est un mot de sociologue un peu facile – toujours plus compliqué que ça. En matière d’objectif proprement financier, on constate que le contrôle en tant que tel ne produit pas tant de rentrées d’argent que ça, rapporté et au volume global des prestations et surtout rapporté aux autres formes de fraude.
Ce qui est intéressant cependant, c’est qu’alors qu’on renforçait le contrôle des bénéficiaires de prestations sociales, qu’on adoptait une acception de plus en plus large de la notion même de « fraude » dans le domaine de la Sécurité sociale, on a largement assoupli le contrôle fiscal. Le travail du sociologue Alexis Spire le montre très bien. De même, alors qu’en 2005 on a fait obligation légalement, dans le code de la Sécurité sociale, aux caisses de Sécurité sociale de déposer plainte au pénal dans les cas de fraudes avérées qui atteignent un certain montant.
Avec le « verrou de Bercy » – certes un peu assoupli par la loi de 2018 – on est dans le cas symétriquement inverse [le « verrou de Bercy » définit le monopole du Ministère du budget en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, n.d.r.] Enfin, on a doté les corps de contrôleurs d’effectifs supplémentaires, passant de 500 à 700 controleurs ; ça ne semble pas beaucoup mais dans un contexte de réduction des effectifs, c’est une augmentation nette. Pendant ce temps, les moyens alloués au contrôle fiscal ont décliné…
Dernier élément : je vous parlais de l’explosion du nombre d’indicateurs (de performance, de réalisation, d’intéressement, de risque, etc.). On calcule vraiment beaucoup de choses, sauf une : le coût du contrôle, c’est étonnant… Le coût du contrôle n’est jamais calculé, sauf pour le contrôle sur place.
La culture du contrôle a essaimé au sein des institutions et ça fait partie du rôle quotidien d’un grand nombre d’employés qui ne sont pas spécifiquement dédiés au contrôle, du guichetier aux techniciens conseil en passant par l’agent comptable, etc. Donc l’argument financier qui voudrait que ce soit de bonne gestion, en fait, ne s’applique pas si bien que ça. Je dirais qu’il y a davantage une logique de mise en scène de la gestion rigoureuse qu’une logique véritablement comptable de limitation des dépenses dans le cadre de la lutte contre la fraude.
M.N. – On a parlé des pratiques, des techniques et des objectifs du contrôle. Qu’en est-il de ses conséquences du point de vue des allocataires ? On sait qu’un contrôle conduit souvent à la suspension des allocations, à des sanctions envers les allocataires, qui sont par ailleurs très difficiles à contester.
Bernadette Nantois – Je vais reprendre ce qui a été dit à un niveau peut-être plus concret, en partant du point de vue des allocataires. En 2022, il y avait 13,7 millions de personnes allocataires à la CAF et 31,1 millions de personnes concernées par les prestations versées4. Concrètement, la plupart des prestations versées par les CAF le sont sous condition de ressources ; c’est notamment le cas du RSA, de la prime d’activité et de l’AAH, qui représentent 7,43 millions de bénéficiaires sur un total de 13,7 millions foyers allocataires. Elles sont soumises à des déclarations de ressources trimestrielles (DTR).
Cela permet une grande collecte de données par le dispositif de ressources mensuelle, DRM, mis en place pour permettre le croisement entre administrations5. Les CAF reçoivent des données qui viennent de Pôle emploi, de l’assurance maladie, de la CNAV, des Impôts, qui viennent des URSSAF via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) par les employeurs et toutes ces données sont mises en écho avec les données déclarées par les personnes allocataires. C’est ce qui aboutit aux fameux contrôles automatisés dont parlait Vincent Dubois, qui sont extrêmement fréquents et les allocataires n’en ont connaissance que quand il y a une incohérence, qui peut avoir plusieurs raisons.
Les raisons peuvent être des erreurs des allocataires, puisqu’effectivement pour chaque allocation la base ressource à déclarer n’est pas la même, mais aussi un retard dans des feuilles de paye ou des heures en plus ou en moins qui causent une incohérence… Une variation de 50 à 100 euros suffit à déclencher un contrôle.
Ça se traduit dans les faits sur ce qu’on appelle une « suspension préventive » des droits. Concrètement, la personne découvre tout simplement que le cinq du mois, l’AAH ne tombe pas… et généralement ce n’est pas que l’AAH qui ne tombe pas c’est aussi l’allocation logement, ou la prime d’activité, les allocations familiales sous condition de ressources et l’APL ne tombent pas.
Selon la CNAF, il y a 31,6 millions de contrôles automatisés par an – pour 33 millions de personnes bénéficiaires et 13,7 millions de foyers6. Ce qui signifie qu’un foyer peut faire l’objet de plusieurs contrôles en même temps. Il y a 4 millions de contrôles sur pièces – en gros la moitié des bénéficiaires du RSA, de la prime d’activité et de l’AAH, et 106 000 contrôles sur place. Les contrôles sur place ont quelque chose de pervers et de malhonnête – je ne peux pas le qualifier autrement. Ce dont on se rend compte, c’est qu’ une partie de ces contrôles sur place sont faits de façon inopinée, c’est-à-dire qu’on le découvre quand on est au contentieux face à la CNAF. L’allocataire n’est pas mis au courant qu’il y a eu le passage d’un contrôleur à son domicile, et de fait si par hasard, il n’était pas à son domicile, on décide qu’il s’est volontairement soustrait à un contrôle. C’est comme ça que la CAF argumente quand on se retrouve devant le pôle social du tribunal judiciaire lorsqu’on conteste la suspension du versement des prestations.
Les contrôles automatisés – avec les scores de risque derrière- sont le cas le plus massif de contrôle. Le plus souvent, les personnes allocataires ne seraient pas informées s’ils ne se traduisaient pas par la suspension des droits. Cette suspension peut durer des mois et des mois. Lorsque c’est la seule ressource dont elles disposent, les situations deviennent assez vite extrêmement dramatiques ; concrètement on peut avoir des ménages avec deux/trois contrôles par an, avec suspension des droits. Ce n’est pas rare : c’est la moyenne de ce qu’on constate au quotidien depuis les sept/huit dernières années de travail avec les personnes allocataires.
Ces contrôles peuvent aussi être déclenchés du fait du dysfonctionnement interne de ces organismes – c’est fréquemment le cas en Ile-de-France – en raison des les pertes de documents et en raison des délais de traitement des documents. À Paris, c’est six mois de délai… Ce délai signifie qu’il y a deux déclarations de ressources trimestrielles qui ne sont pas arrivées. L’allocataire va s’apercevoir qu’il n’a pas eu de versement sur son compte. Conséquence : une famille avec trois enfants qui a une allocation soutien familial, si elle fait l’objet d’un contrôle automatisé dont elle n’est pas informée, va se trouver confrontée à la suspension des droits qui est corrélative. Cela va suspendre aussi l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement, a minima.
Ce sont vraiment des situations assez dramatiques et qui peuvent durer : il faut au minimum trois ou quatre mois pour arriver à rétablir une suspension de droits. Au mieux, ça se dénoue moyennant intervention d’une association ou d’un juriste, sans en arriver au contentieux total. Pendant ce temps, impossibilité de payer le loyer, d’assurer les dépenses courantes, de payer l’électricité, endettement, frais bancaires, emprunts auprès des proches, etc. Ça créé des situations de profonde détresse. Les suicides ne sont pas rares.
En cas de trop-perçus, les allocataires ne reçoivent pas non plus de notification.Ils ne sont pas informés des modalités de calcul, de comment l’indu a été identifié, des possibilités qu’ils ont de rectifier – alors qu’il y a quand même cette fameuse loi du droit à l’erreur de 2018 – et quand il y a des notifications, elles sont sommaires, automatiques et ne permettent en rien d’organiser la défense de la personne. Pour les montants des retenues c’est exactement la même chose, ils ne sont pas calculés en prenant en compte la situation de l’allocataire et de ce qu’on appelle le reste à vivre, le minimum à lui laisser pour qu’il puisse s’en sortir.
En revanche, ni les rappels, ni les suspensions, ni les dettes ne sont prises en compte pour demander d’autres droits, comme la Complémentaire de Santé Solidaire (C2S) ou la prime d’activité. Pour faire une demande de C2S, ça se fait sur la base des revenus de l’année précédente, sur le montant total reçu, sans prendre en compte les rappels et les suspensions. Ça génère des cumuls de précarité pour les personnes. Et ce, sans oublier que les rappels et suspensions sont souvent liées à des dysfonctionnements internes et pas seulement à des erreurs, voire intention de fraude.
Que faire pour se défendre ? Face à une suspension de droits, la première des choses est de faire une demande de motif pour la suspension. Généralement il n’y a pas de réponse, donc on essaie d’avoir des arguments pour organiser la défense sans réponse sur les motifs. Il faut d’abord faire un recours amiable devant la commission de recours amiable : c’est obligatoire pour aller au contentieux. Et les commissions de recours amiable ne répondent jamais. Au bout de deux mois sans réponse, on va aller au contentieux, soit devant le tribunal administratif, soit devant le pôle social du tribunal judiciaire. Et là se pose le problème des délais. Le recours est censé être suspensif, c’est-à-dire de rétablir le versement des droits, mais le fait de faire un recours n’interrompt pas la suspension et les allocataires restent toujours sans ressources, dans une situation véritablement d’impasse.
Il faut compter quatre, six mois, voire un an dans une procédure normale pour avoir une audience. Et une fois devant la justice, les CAF sont très familières d’un procédé qui est le renvoi d’audience : dès lors qu’elles reçoivent une assignation et qu’une date d’audience est fixée, elles font généralement un rappel partiel ou total des droits pour lesquels l’allocataire a saisi la juridiction, avec une incitation vive à ce que l’allocataire se désiste.
Si ce dernier ne le fait pas et qu’il va jusqu’à l’audience, un renvoi est systématiquement demandé – les renvois c’est encore trois, quatre cinq, six, huit mois – et les CAF vont utiliser des manœuvres dilatoires, elles vont par exemple redéclencher un contrôle. Je l’ai vu dans tous les cas qui sont passés au pôle social du tribunal judiciaire. A l’issue de ce laborieux processus, on peut arriver à terme à obtenir des bons jugements et à rétablir la situation des personnes allocataires, mais elles se seront trouvées pendant huit, neuf, dix mois, un an sans ressources. Je vous laisse imaginer les situations que ça peut générer…
M.N. – Par-delà l’accompagnement des personnes allocataires, comment les associations se mobilisent-elles dans de telles circonstances ?
Bernadette Nantois – Les défenses individuelles sont un peu désespérantes. Elles sont nécessaires mais laborieuses et énormément d’allocataires se retrouvent dans une impasse complète, sans aucune assistance pour se défendre. Ce n’est pas APICED qui se mobilise toute seule, loin de là. Le collectif « Changer de Cap » a fait un énorme travail de recensement de témoignages et d’identification de ces problèmes. On essaie de mobiliser à différents niveaux : on commence à avoir un petit relai médiatique avec quelques émissions sur ces questions-là ; il y a eu une mobilisation au niveau associatif, avec la mise en place de groupes d’entraide entre personnes allocataires, et on essaie de mobiliser des grosses structures (Secours Catholique, ATD Quart Monde, Ligue des Droits de l’Homme, Fondation Abbé Pierre, etc.) pour qu’elles relayent le travail auprès des instances de concertation auxquelles elles participent, notamment au sujet des Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG).
Au niveau des revendications, ce que Changer de Cap essaie de porter auprès de la CNAF, c’est premièrement l’égalité des pratiques et des contrôles et d’instaurer un contrôle de légalité et mise en place des évaluations des obstacles rencontrés par les allocataires. Le deuxième point c’est d’essayer d’humaniser les pratiques et les relations, de remettre un accueil physique en place avec des agents qualifiés, de restaurer un accompagnement social de qualité, de créer des postes qualifiées au sein des CAF, pour réinternaliser un certain nombre d’actions, à commencer par les services numériques et par les agents techniciens. Aujourd’hui, il y a énormément de marchés privés qui sont contractés par la CNAF. À titre d’exemple, elle a attribué 477 millions d’euros en novembre 2022 à des cabinets de conseil sur des questions de prestations informatiques et sur des questions de gestion de la relation aux usagers.
Troisième point : c’est restaurer la transparence. On demande que toutes les circulaires ou les textes internes qui ont valeur de circulaires, qui ont des effets juridiques soient publiés. On est dans une situation de dissimulations totale, alors qu’il y a une obligation légale que les organismes sociaux transmettent ces informations à l’ensemble de la population. On demande aussi de mettre le numérique au service de la relation humaine.
La formule est large mais l’idée ce serait qu’il y ait un débat public autour de ces questions et notamment autour de cette sous-traitance au privé. Enfin, associer les usagers aussi aux interfaces. Nous ne nous illusionnons pas, nous n’allons pas revenir à un traitement papier, mais que ceux contraints d’utiliser ces interfaces soient a minima associés pour pouvoir expérimenter, essayer de trouver des systèmes qui soient un peu plus fluides et un peu plus simples. Et puis, d’une manière plus large, en finir avec l’affaiblissement de la protection sociale, et revoir le budget de la protection sociale à la hausse.
Alex (LQDN) – Du côté de la Quadrature, nous allons continuer le travail de documentation. On a demandé le code source de l’algorithme, demande évidemment refusée par la CNAF. On a saisi la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) qui est censée dire si notre demande était légitime, et celle-ci ayant répondu qu’elle l’était, nous allons redemander le code source à la CAF. L’argument principal pour refuser le code source de l’algorithme consiste à dire qu’il permettrait aux fraudeurs et fraudeuses de le déjouer.
Si l’on considère que les principaux critères qui dégradent la note des personnes allocataires sont des critères de précarité, l’argument est simplement scandaleux. Comme si, une fois les critères connus, les gens se trouvaient un emploi bien payé et changeaient de quartier de résidence pour mieux… frauder. Mais comme on sait que ces algorithmes sont mis à jour régulièrement, on en a demandé les versions antérieures, pour lesquelles il n’est pas possible d’avancer l’argument de la fraude.
On parle actuellement de l’algorithme de lutte contre la fraude, mais il y a aussi le problème de l’algorithme de calcul des prestations sociales CRISTAL, qui est une sorte d’énorme masse informatique, fourrée d’erreurs. C’est un algorithme qui est censé prendre la loi et calculer le montant des droits, mais on finit par comprendre que le programme informatique est plein des bugs. Un certain nombre d’associations a repéré que des droits étaient régulièrement refusés ou calculés de manière erronée. Évidemment CAF a connaissance de ces problèmes-là, puisque pour les personnes qui ont la chance d’être accompagnées par des structures qui font des recours individuels ont fini par identifier les problèmes, mais elle ne change toujours pas le code de son programme.
Dernier point : Macron a beaucoup mis l’accent sur l’importance de la solidarité à la source7. Seulement, cette mesure requiert pour sa mise en œuvre la collecte et l’échanges de données entre administrations. L’idée est d’avoir une sorte d’État social automatisé où il n’y aurait plus rien à déclarer et les aides seraient versées (ou non) automatiquement. Ça implique concrètement une transparence ultra forte vis-à-vis de l’État, avec une sorte de chantage : si vous n’êtes pas transparents on ne vous donne pas d’argent. Mais la collecte de données n’est pas neutre. Ce que l’on a récemment découvert, c’est par exemple que la police peut aussi demander les données de l’URSSAF, de Pôle emploi, de la CAF… Lors des enquêtes, elle sollicite la CAF, qui a une adresse mail dédiée aux réquisitions. Par-delà la promesse d’automatisation, la solidarité à la source c’est aussi plus de transparence face à l’État, plus d’interconnections de fichiers. C’est un pouvoir que l’on donne à l’État.
Vincent Dubois – Le datamining, même s’il est initialement conçu pour identifier les fraudes et plus généralement les erreurs, peut aussi permettre identifier le non-recours. Je l’avais naïvement écrit dans mon premier rapport : pourquoi ne pas faire des modèles pour lutter contre le non-recours ? Mais voilà, le modèle de data mining date de plus de dix ans, et rien n’a été mis en place pour lutter contre le non-recours de façon systématique…
Bernadette Nantois – Au vu du niveau de dysfonctionnement actuel, je suis très réservée sur la question de la solidarité à la source. Inverser le datamining, mais l’utiliser pour repérer ceux qui ont des droits théoriquement… Sur les espaces des allocataires aujourd’hui, on a souvent des alertes rouges sur la page d’accueil : « alerte », un gros carré rouge et un message qui vous dit : « vous avez droit à la prime d’activité… » et c’est probablement lié à une programmation informatique… Le problème c’est que généralement ce n’est pas vrai et ça peut aussi être un élément de blocage pour l’allocataire qui ne souhaite pas y répondre.
Que ce soit pour des allocations sous conditions de ressources ou pour l’allocation soutien familial, une personne peut très bien ne pas souhaiter faire une procédure ou demander l’allocation pour différentes raisons. Mais s’il ne le fait pas, ça bloque… Il y a des petits indices dans la manière dont les choses se passent aujourd’hui qui font que je ne suis absolument pas favorable ni à l’inversion du datamining ni à la solidarité à la source qui s’accompagnerait d’un DRM généralisé (dispositif de déclaration des ressources mensuelles), avec la transmission totale des données entre tous les organismes de Sécurité sociale et assimilés : URSSAF, les déclarations des employeurs, ainsi que les impôts.
Alex (LQDN) – Cette proposition de retourner le datamining, c’est aussi pour justifier l’utilisation du datamining à des fins de contrôle. Pour la petite histoire, dans les années 2012-2013, le directeur des statistiques de la CAF qui a écrit un petit article pour présenter l’utilisation du datamining par la CAF à des fins de contrôle et il finit son article en disant : « ça nous embête un peu de le faire que pour la lutte contre le contrôle, on aimerait bien aussi le faire pour utiliser le datamining à des fins de non-recours… ». Donc quand en 2022, la CAF dit ça y est, on a un peu travaillé sur l’algorithme de non-recours, ce qu’elle ne dit pas c’est que ça fait dix ans qu’elle aurait pu le faire et qu’en interne par ailleurs il y avait des demandes. Ça fait dix ans qu’ils ne le font pas et ils ne le font pas sciemment.
Personne du public – Je pense que cette idée d’inversion du contrôle n’est pas la bonne. D’une part, ça implique une collecte de données de plus en plus invasive, massive et fine. De l’autre, vous avez cité Brard, l’ancien maire de Montreuil qui a autorisé l’utilisation du NIR : c’était originairement à des fins de contrôle fiscal… Ce qu’on voit, c’est qu’il n’y a pas un mauvais ou un bon contrôle. Les gens veulent opposer fraude dite sociale et fraude fiscale, mais tout le monde est d’accord pour lutter contre les fraudeurs, seulement pas sur leur identité. C’est contrôle la logique du contrôle qu’il faut lutter. Ce contrôle-là, comme vous l’avez dit, n’est pas motivé par une raison strictement comptable : il n’y a pas énormément d’argent en jeu.
Ce que vous avez moins évoqué c’est qu’il y a une idéologie « travailliste » forte et que c’est là-dessus que le mouvement ouvrier est d’accord avec les patrons, avec les Macron : il faut que les gens aillent bosser… La première fois où j’ai entendu parler d’assistanat c’est dans la bouche de Lionel Jospin en 1998, ce n’était pas Sarkozy et la valeur travail. Ceux qui nous ont rabâché pendant des décennies avec le fait qu’on avait sa dignité dans le boulot, ce sont les socialistes.
C’est une idéologie extrêmement forte, qui lutte pied à pied contre l’idée de la solidarité collective et de l’aide sociale. Personne ne veut défendre des pratiques qui sortent de la norme, comme la fraude, donc personne ne va prendre la défense de ces catégories-là, même s’il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer lorsqu’on arrive à dire, comme le fait La Quadrature du Net, qu’on s’oppose à la logique du contrôle.
Notes :
1 L’amendement Brard réintroduit la possibilité, supprimée par la Loi Informatique et Libertés de 1978, de réintroduire le NIR dans les fichiers, ce qui permet de rapprocher les informations détenues sur une même personne par différentes administrations. Initialement prévu pour lutter contre la fraude fiscale, cet usage va être progressivement étendu à la « fraude sociale », puis généralisé. Voir à ce sujet l’article de Claude Poulain sur la revue Terminal.
2 Conventions conclues depuis 1996 entre l’État et les différents organismes de Sécurité sociale, elles établissent sous forme d’un document contractuel les axes stratégiques et les objectifs de gestion des caisses.
3 Ce chiffre concerne la fraude détectée. Il soulève la question de savoir quelle part de fraude est effectivement détectée, et à quel point ses montants dépendent d’une augmentation de la fraude réelle ou plutôt une augmentatin des moyens consacrés à sa détection. La CNAF est le seul organise à avoir établi des projections permettant d’évaluer ce que serait la fraude réelle, au-delà de celle détectée. Elle serait comprise entre 1,9 et 2,6 milliards d’euros par an.
4 Les prestations se divisent entre allocations liées à la famille, les aides personnalisées au logement (toutes deux issues du budget de l’État) et les allocations de solidarité envers les personnes les plus fragiles (le RSA, issu des budgets des départements ; la prime d’activité en complément des revenus pour les travailleurs aux revenus modestes et l’allocation adulte handicapés, issue du budget de l’État). Le versement d’une prestation – ou sa suspension – affecte autant l’allocataire que les membres de son foyer.
5 Créée en 2019, cette base de données centralise pour chaque assuré social différentes données. Le 31 janvier 2024, l’emploi a été étendu à titre d’expérimentation, afin de permettre par exemple de cibler les contrôles à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ou pour commencer à mettre en place le projet de solidarité à la source.
6 En 2022, le nombre de contrôles automatisés était de 29,2 millions. Source CNAF.
7 Projet de versement automatique des aides sociales, sur le modèle du prélèvement à la source mise en place par les impôts.
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- La Croix
- Euronews
- Le Figaro
- France 24
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE
- Courrier Europe Centle
- Euractiv
- Toute l'Europe
- INTERNATIONAL
- Equaltimes
- CADTM
- Courrier International
- Global Voices
- Info Asie
- Inkyfada
- I.R.I.S
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- N-Y Times
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Of AFP
- Rojava I.C
- OSINT / INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- G.I.J.N
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- L'Insoumission
- Issues
- Les Jours
- LVSL
- Marianne
- Médias Libres
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Extrême-droite
- Human Rights
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
- Vrai ou Fake ?